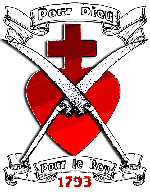LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE X. — DANS LA RATIÈRE.
|
LANDÉVANT, Mendon, Sainte-Barbe, Plouharnel, Carnac, tout le quadrilatère était perdu : la presqu’île seule, qu’on a comparée à une bourse, restait à l’armée royale et pas tout entière encore, car, au collet de la bourse, à son point de rattachement avec la terre ferme, à Sainte-Barbe et sur la chaussée du Bégo, plus un Chouan ne se voyait. Pour enfermer d’Hervilly dans la bourse, il n’y avait qu’à serrer le cordon, autrement dit à barrer l’isthme en retournant, équipant et portant d'une mer à l’autre le retranchement sommaire utilisé par les Chouans : l’officier du génie Moreau de Jonès s’en chargera sur les indications de Hoche ; dans les vingt-quatre heures, avec des galets, des mottes, de la tangue, de la paille hachée et chacun y mettant du sien, les officiers en bras de chemise comme les hommes et ne gardant que le hausse-col, ce sera fait : le retranchement, long de 1.500 mètres, s’appellera la redoute du Mât de Pavillon. Par derrière. Hoche assoira quatre batteries de 12 et de 8 qui prendront d’enfilade toute la falaise jusqu'au fort Penthièvre, et qui seront cependant hors de l’atteinte des canons anglais. Mais d’abord il lui faudra repousser avec des moyens de fortune et dès la nuit même une assez forte attaque montée par d’Hervilly qui, sans être bien convaincu encore de sa criminelle sottise, s'est laissé persuader par Puisaye d’essayer de la réparer, — bien mieux, qui a consenti, pour la première fois, à faire coopérer ses réguliers et les troupes chouannes. Essai malheureux : les colonnes d’attaque, parvenues au pied du retranchement à la faveur des ténèbres, ne se reconnaissent pas et se fusillent. Hoche dédaigna de les poursuivre. Le lendemain et les jours suivants, il consommait l’investissement de la presqu’île par l’installation de redoutes sur tous les points dominants de Sainte-Barbe ; il poussait ses avant-postes jusqu’à l’orée de la falaise, à l’abri d’une ligne de circonvallation qui en faisait une sorte de premier camp retranché. Il ne négligeait pas le quadrilatère, solidement occupé par Josnet et Drut pour parer à toute tentative nouvelle de débarquement. Lui-même s’établissait avec Lemoine et son chien Pitt au village de Glévenès, à la ferme David, dans une grange proche le vieux moulin seigneurial de Kergonan dont la tour crénelée lui servira d’observatoire. Et cela fait, la nuit venue, ses derniers ordres expédiés, une caresse donnée à Pitt dont sa jeune femme lui demande des nouvelles et qui compose provisoirement tout son état- major, il écrit à Chérin sur un chiffon la lettre fameuse : Les Anglo-Émigrés-Chouans sont
ainsi que des rats enfermés dans Quiberon, où l’armée les tient bloqués.
J’espère que dans quatre jours nous en serons quittes.... Je suis sans secrétaire, sans aide de camp, sans adjudant
général, sans papier et presque sans vivres. Il pourrait ajouter sans lit, car, ce soir-là, il couchera sur un banc. Des ombres confuses dansent dans la pièce, dont l’obscurité n’est combattue que par un maigre suif. Mais, dans son cerveau, où s’enfante la victoire, tout est clarté, certitude : la Convention, l’armée, son chef n’ont qu’une même âme et opèrent en plein accord. C’est dans le parti qui se qualifie de parti de l’ordre, tristesse ! que sont la division, l’anarchie. Puisaye assiste à la déroute de ses combinaisons stratégiques, et comme toute sa vie n’a été jusque- là qu’une suite d’échecs et de rebondissements, il ne veut pas encore désespérer, il regarde vers la mer d’où lui viendra peut-être le salut. D’Hervilly, dont cette déroute est l’œuvre, travaille à l’exploiter. Qu’a-t-il cherché ? Que l'ennemi le forçât à rembarquer ? Puisaye le dit, mais, si d’Hervilly avait eu le temps d’écrire ses Mémoires, nous entendrions peut-être une autre antienne. Il a réussi du moins à préserver son armée qui, à quelques douzaines d’assaillants près, tombés dans la nuit du 7, peut être considérée comme intacte. C’est l’essentiel pour d’Hervilly qui s’en sait comptable devant son roi, devant l’avenir, et qui l’a ménagée, comme le lui demandaient ses instructions, autant qu’il a pu. Le jour même de l’offensive, il s’était porté avec son régiment jusqu’à la hauteur de Sainte-Barbe ; il y avait vu les Chouans à l’œuvre, rasant le sol, s’égayant, gaspillant la poudre, inaptes au maniement de la baïonnette comme à tout mouvement ordonné, et, dégoûté de cette tactique barbare, il avait fait remettre l'arme au bras à ses troupes pour ne pas les exposer davantage à un spectacle si démoralisant. Que ces brutes, s’il leur plaisait, continuassent leur voltige de Hurons, lui, posté sur le bord de la montée du fort Penthièvre, faisait défiler ses grenadiers au pas, vérifiant l’alignement et reprenant aigrement ceux des officiers qui ne saluaient pas avec ensemble. D’Hervilly, comme le Guichamp du poète, semble avoir eu sur l’esprit deux abat-jour : la discipline et la consigne. Il marchait devant lui dans l’espace, un peu étroit, laissé libre par ces œillères, mais il y marchait droit. Et il voulait qu’on marchât comme lui. Quelques jours plus tard, il mènera ses grenadiers à un nouvel assaut des positions de Hoche ; il les conduira jusqu’au pied du retranchement ; il eût pu l’emporter à la faveur du trouble jeté par la surprise de son attaque ; les Toulonnais de Royal-Louis, l’élément le plus sûr de sa troupe, l’en suppliaient mais il s’était aperçu d’un certain flottement chez les autres, et il répondit : — Non certainement, messieurs. Je ne suis pas assez content de vous pour cela. C’est une réponse presque romaine. Il y a une certaine grandeur chez cet homme trop décrié et qui d’ailleurs saura mourir, une grandeur un peu sèche, un peu roide et d’avant Jean-Jacques, mais qui, sur un autre théâtre et dans des circonstances plus propices, eût pu trouver son emploi. Aussi bien l’attaque montée cette nuit-là (11 juillet) n’était qu’une diversion et qui, somme toute, avait réussi : il s’agissait de retenir l’attention de Hoche pour qu’elle ne se portât point vers Port-Haliguen et Port-Orange où, dans le même temps, deux flottilles de chasse-marée appareillaient, l’une vers la presqu’île de Rhuis, avec une partie des familles de réfugiés, 3.500 Chouans et une compagnie de Loyal-Émigrant sous les ordres de Tinténiac ; la seconde vers l’anse du Pouldu, avec d’autres réfugiés et un corps de Chouans un peu plus faible sous les ordres de Lantivy-Kerveno. C’est Georges qui avait eu l’idée de cette manœuvre tactique destinée autant à décongestionner la presqu’île où, les vivres commençant à manquer, d’Hervilly prétendait mettre les troupes chouan nés à la portion congrue, qu’à créer une menace dans le dos de Hoche et à le prendre éventuellement entre deux feux. Avec Tinténiac et outre d’Allègre, Mercier La Vendée et Georges lui-même, s’étaient embarqués quelques émigrés, je vicomte de Pont-Bellanger, le comte de Guemissac, M. M. de La Houssaye, de La Marche, de Busnel, de Closmadeuc, de Lorgeril, etc. Jean Jan, dans l’autre corps, doublait Lantivy. D’Hervilly, cette fois, n’avait pas fait d’objection au projet, qui servait trop bien les siens en le débarrassant d’une méprisable cohue et qui lui eût souri davantage encore si Puisaye avait pris le même chemin qu’elle. Le comte de Châtillon l’en pressait : Puisaye déclina l’invitation en phrases tout imprégnées de la sensibilité à la mode : Si je n’écoutais que mon cœur, etc., mais ses yeux restaient tournés vers Londres d’où il attendait la réponse qui devait décider entre d’Hervilly et lui. D’ailleurs un certain nombre de Chouans étaient demeurés dans la presqu’île. Et peut-être la lutte stérile qu’il soutenait depuis trois semaines contre son rival avait-elle épuisé toute son énergie : on ne reconnaîtra plus désormais le Puisaye d’antan, supérieur à la fortune et la dominant par sa ténacité. L’épreuve a plus fait que de le vaincre : elle l’a aigri, amoindri, et, quand il reprendra le commandement, l’aura rendu inapte à l’exercer. Les deux corps expéditionnaires avaient touché terre aux points convenus ; leur débarquement s’était opéré sans rencontrer de résistance et, tout de suite allégés de leurs impedimenta, ils s’étaient mis en route, l’un en direction d’Elven, l’autre vers Pont-Aven et Quimperlé : celui-ci fondit en chemin, bien loin de faire la moindre recrue, aspiré par ses guérets et l’appel impérieux de la moisson ; l’autre, mieux en main, se grossit un moment des bandes de Guillemot, déjoua Grouchy lancé à ses trousses, enleva Elven, poussa même jusqu’à Plaudren. Mais là, au lieu de continuer sur Baud où il devait faire sa jonction avec le corps de Lantivy et de Jean Jan pour retourner tous ensemble vers la presqu’île et tomber dans le dos de Hoche, Tinténiac le fit obliquer brusquement vers l’intérieur : l’Armée rouge, comme on l’appelait, en raison de la casaque écarlate à boutons de cuivre qui lui avait été infligée au départ, était le 14 à Saint-Jean-Brévelay, le 15 à Josselin, le 16 à Mohon, près de la Trinité-Porhoët. Or, si Puisaye dit vrai, le matin de ce même 16 juillet, au petit jour, elle aurait dû se trouver sur les derrières de Hoche pour l’attaque générale convenue. Comment un chevalier de Tinténiac, la loyauté faite homme, put-il, en des circonstances si graves, manquer à des engagements si précis ? Pour l’abbé Guillevic, secrétaire de Cadoudal et dont l’opinion a du poids, rien de plus simple : c’est que Puisaye ment ou s’abuse et qu’aucune date n’avait été arrêtée entre les deux chefs. Ceci résulterait du caractère même de la mission confiée par Puisaye à Tinténiac et à Lantivy qui devaient commencer par rallier toutes les bandes chouannes du Finistère et des Côtes-du-Nord avant de se rabattre avec elles sur les derrières de Hoche : mais quinze jours au moins étaient nécessaires pour l’exécution d’un tel plan. Puisaye se flattait-il qu’il en fallait à peine la moitié ? Ou, de naturel ombrageux, céda-t-il à la crainte de voir entrer en scène un nouvel arrivant,- beau, jeune, intrépide, comblé de tous les dons de l’esprit et du cœur, le propre frère de cette jeune fille sublime qui, disait-on, dans les prisons de l’Abbaye, avait cru acheter la grâce de son vieux père en acceptant de boire un verre de sang, le comte Charles de Sombreuil ? Une auréole romanesque l’enveloppait lui-même, pour s’être résigné, docile aux ordres de ses princes, mais le cœur déchiré, à quitter une fiancée chérie, Mlle de La Blache, le jour même qu’il devait l’épouser. Sombreuil, qui s’était illustré en Hollande n’ayant pas vingt-cinq ans, commandait la seconde division d’émigrés embarqués à Portsmouth sur la flotte de lord Moira dont, chaque matin, Puisaye guettait les voiles à l’horizon. Hile parut enfin, dans l'après-midi du 15, mais trop tard au gré de l’intéressé, et les choses étaient trop engagées pour qu’on les arrêtât. Cependant, avant la nuit, Sombreuil était chez Puisaye. Et il lui apportait, pour don de bienvenue, la réponse de Wendham tant attendue qui tranchait le conflit en sa faveur : d’Hervilly rentrait dans le rang et Puisaye redevenait le seul chef. A la manière toute détachée dont d’Hervilly accueillit la nouvelle, on put juger qu’elle n’était point une surprise pour lui et qu’il estimait qu’ayant consciencieusement rempli le mandat dont l’avait chargé l’Agence royaliste, temporisé et retraité à souhait pendant trois semaines, il pouvait fort bien maintenant passer la main à son rival et même le seconder : toute crainte d’une offensive sur Rennes était écartée et le prestige de Puisaye suffisamment atteint. Mais les instances les plus pressantes de Sombreuil pour obtenir que l’attaque en préparation fût retardée d’un jour jusqu’au débarquement de sa division, forte de quinze cents hommes, presque tous émigrés et rompus au métier militaire, échouèrent devant l’obstination de d’Hervilly et de Puisaye lui- même qui répondait : — Impossible. Je ne pourrais avertir Tinténiac. Il le croyait donc bien au rendez-vous. Sombreuil sollicita du moins la faveur de prendre part à l’action en qualité de volontaire et pour que sa division y fût représentée dans la personne de son chef. Mais comment Puisaye — car d’Hervilly lui abandonnait volontiers ce qui touchait aux troupes chouannes — ne s'était-il pas assuré d’abord que Tinténiac avait pu exécuter son mouvement tournant ? Quoi ! Quand la mer est libre, pas un a gent de liaison entre les deux chefs ! Lantivy trouvera bien le moyen, après la dislocation de ses bandes à Plouay, de regagner Quiberon, trop tard pour avertir Puisaye, à temps pour y mourir. Avec Vauban du moins, chargé de l’attaque de flanc et qui doit débarquer avant la pointe du jour sur la plage de Carnac, on communiquera par des fusées : une fusée voudra dire qu’on a pris terre, deux fusées que l’attaque est ratée. Mais il arrivera que la deuxième fusée, lancée au lever du soleil et parce que les chaloupes de Warren n’étaient pas prêtes à l’heure, ne sera point aperçue de Puisaye, si tant est qu’elle ait été lancée. La grande attaque enveloppante, de tête, de dos et de flanc, se réduisait ainsi, par la carence de Vauban après celle de Tinténiac, à une simple attaque frontale comme les précédentes. Celle-ci était seulement montée avec plus de soin et l’on y avait engagé l’élite du corps expéditionnaire et jusqu’au bataillon des vieux chevaliers de Saint- Louis : en tête, sous le major d’Haize, quatre cents hommes du régiment de la Châtre déployés en tirailleurs. Puis trois colonnes en formation de marche, distantes chacune de cent vingt pas : dans celle de droite, les régiments du Dresnay et de Royal-Marine, avec six cents Chouans commandés par le duc de Lévis ; dans la colonne de gauche, Royal-Louis, les mille Chouans du chevalier de Saint-Pierre et la garde nationale d’Auray aux ordres du notaire Glain promu colonel pour sa belle retraite du 7 ; dans la colonne du centre le comte de Rothalier, commandant de l’artillerie, et ses canons. Quatre mille hommes au total. Ils partirent vers Sainte-Barbe à une heure du matin : les nuits sont brèves en juillet, mais il n’y a qu’un ruban de quelques kilomètres entre Penthièvre et Sainte-Barbe ; l'aube, près de poindre quand on s’engagea dans la falaise, n’empêcha pas de voir la première fusée de Vauban qui, avec ses Chouans et deux cents fusiliers prêtés par Warren, avait pu débarquer sur la plage de Carnac, mais que le feu nourri de Roman, insuffisamment contrebattu par celui des canonnières anglaises, força presque aussitôt de rembarquer. Cependant, comme on n’avait point vu la seconde fusée, Puisaye et d’Hervilly en conclurent avec quelque logique que Vauban progressait. Et la précipitation avec laquelle les avant-postes d’Humbert, sans attendre même le choc, se replièrent sur les lignes de Sainte-Barbe, leur fut une occasion de méprise encore plus grave. D’Hervilly, le premier, y vit l’effet de l’attaque à revers de l’Armée rouge et vint en prévenir Puisaye qui n’eut pas plus d’hésitation : — C’est Tinténiac, marchons ! Sur quoi la charge battit. D’Hervilly commanda En avant ! ordre répété par tous les chefs de colonne qui ajoutaient comme Contades pour enlever leurs hommes : Voyez, les Républicains décampent ! Et déjà le premier barrage était emporté et pas le moindre signe de réaction n’apparaissait chez les Républicains, Ce silence et cette passivité eussent dû donner à réfléchir aux assaillants dont certains, en approchant du grand retranchement, crurent entendre des voix qui, de l’autre côté du rempart, recommandaient : Pas encore ! Ne tirez pas encore ! Le piège s’avérait. C’était, toutes proportions gardées, celui-là même que Foch et Gouraud tendront un jour, devant Reims, aux feldgrauen de Ludendorff : prévenu la veille, par deux transfuges, de l’assaut projeté, Lemoine, qui commandait en l’absence de Hoche, s’était entendu avec Humbert pour simuler une panique et l’abandon précipité des avant-postes, mais, derrière le grand retranchement, tout était disposé pour recevoir les colonnes d’assaut et les mitrailler à bout portant. Dans un pli de la dune, la cavalerie attendait, sabre au clair. Les mêmes bouches qui recommandaient quelques secondes auparavant de ne point tirer partit le cri : Feu ! Toute la falaise trembla : quatre batteries s’étaient démasquées, dont la mitraille et les obus fauchaient dans la colonne de droite des files entières d’assaillants. Du premier coup soixante officiers et la presque totalité des grenadiers mordirent la dune ; le reste, débandé, courait entre la colonne de gauche et la mer (Beauchamp). C’est avec cette colonne, fortement décimée elle-même par la mousqueterie qui s’était allumée d’un bout à l’autre du retranchement, que d’Hervilly tenta de continuer l’attaque : il la lance au pas de charge sur le retranchement, tandis que Rothalier, avec ses six canons enlisés jusqu’au moyeu, travaille à se dégager pour répondre aux batteries républicaines ; quelques émigrés de Royal-Louis, de cette espèce de Français indomptables que rien n’arrête, parvinrent ainsi jusqu’aux derniers redans. Refoulés, ils revenaient à la charge. — A la bonne heure ! auraient dit à ce moment des officiers bleus, on voit que ce sont des Français. Beauchamp veut même qu’étonnés de tant d’audace les Républicains aient été sur le point d’abandonner la position, lorsque d’Hervilly, sur des monceaux de morts et de mourants, fut atteint à son tour, en pleine poitrine, d’un coup de biscaïen. A ce moment lui parvenait, de Puisaye, l’ordre d’arrêter l’attaque. Il le remit à son aide de camp qu’un boulet emporta avant d’avoir rempli sa mission près d’Attily, commandant de Royal-Louis, et le résultat fut qu’une partie de l’armée royaliste continua d’attaquer, tandis que l’autre retraitait. Ainsi était rendu inutile, une fois de plus, par une sorte de conjuration des forces obscures dressées contre elle, le magnifique esprit de sacrifice de cette noblesse française, si inférieure dans l’action politique, mais à qui les champs de bataille restituaient toutes ses anciennes vertus. Lemoine, qui tenait en réserve sa cavalerie, n’eut plus qu’à la lâcher sur Puisaye ; les colonnes royalistes, mêlées aux bandes chouannes, roulaient en désordre vers la falaise, et le sabre des hussards de Vernot-Dejeu se fatiguait à tailler dans cette masse inorganique. Les cent vingt chevaliers de Saint-Louis étaient réduits à quarante-neuf. Rothalier, avec les trois canons qui lui restaient, essayait d’arrêter l’effroyable poursuite et, voyant son fils tomber à côté de lui, ordonnait : Enlevez cet officier, puis continuait à diriger le tir. Chièvre, avec deux pièces, défendait non moins âprement le passage de la falaise vers la Mer Sauvage. Et c’est encore Charles de Corday, le frère de Charlotte, qui, pressé par les hussards, se retourne : — Comment ! Nous nous laisserions charger par quarante bougres comme ça ! Rien n’y fit. Et la boucherie eût été complète, Penthièvre même enlevé peut-être, si leur échec sur Carnac n’avait amené là par grand hasard Vauban et Warren, l’un avec ses Chouans, l’autre avec ses canonnières : les Bleus, pris d’écharpe, durent rentrer dans leurs lignes, — pas si vite que certains ne trouvassent le temps de faire main basse au passage sur les croix, l’argent, les souliers et jusqu’aux chemises des morts qui couvraient la dune et entre lesquels ils 11e prenaient pas la peine de distinguer. Hoche apprendra ainsi avec indignation que son jeune adjudant général et ami Vernot-Dejeu, tombé au cours de la poursuite, a été dépouillé de ses vêtements par ces coquins qui, au témoignage d’un des leurs, ne se privaient même pas d’achever les blessés... |