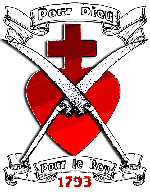LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE IX. — QUIBERON.
|
LE 25 juin 1795 au matin, le commandant de la demi-brigade d’Auray, Roman, reçut avis qu’un grand mouvement se remarquait en direction de Carnac. Ce n’étaient plus les habituels sillages, les rampements furtifs dans les herbes aux heures troubles d’entre chien et loup : trente paroisses déménageaient. Les routes elles- mêmes, en plein jour, étaient encombrées de charrettes cahotantes et grinçantes sous le poids du mobilier qui s'y empilait, de troupeaux de bœufs et de moutons que leurs conducteurs des deux sexes poussaient devant eux, de croix paroissiales, de calices et de saints sacrements tirés de leurs cachettes et portés ostensiblement, à bras d’homme. Chose plus grave, des bandes armées escortaient ce déménagement pareil à un exode de peuple roulant vers la mer, comme si toute la Bretagne croyante, derrière ses prêtres, reprenait le chemin par lequel elle était venue autrefois des côtes de Cambrie et du Cornwal, chassée par les invasions saxonnes. Que signifiait cela ? Roman n’ignorait pas qu’une expédition franco-anglaise cinglait vers un point du littoral, mais ni lui, ni personne, pas même la petite Lise, déjà peut-être au service de Hoche et si experte à confesser les gens, ne savait au juste lequel : le 22 juin, après avoir essayé de barrer la route à l’escadre de lord Bridport qui précédait le convoi, Villaret-Joyeuse s’était heurté dans les eaux de Groix à toute la flotte britannique commandée par sir John Borlase Warren sur qui s’était replié Bridport. Quelques volées le balayèrent. La route était libre et, le 25 au matin, la flotte britannique se présentait devant Quiberon ; le soir elle y mouillait sur rade. C’est à sa rencontre que se portait la migration de peuple signalée à Roman qui tenta bien, avec 900 hommes — tout ce qu’il put rassembler, — de couvrir Carnac, dont le poste, très faible d’ailleurs, ainsi que celui du tumulus Saint-Michel, relevait de son commandement. Mais les deux postes étaient déjà tombés. D’Allègre et Bois-Berthelot avaient pris Carnac ; Tinténiac et Rohu, la butte Saint-Michel, au haut de laquelle, faute d’étamine fleurdelysée, Tinténiac hissait à la drisse du pavillon un drapeau blanc taillé dans sa chemise. Cadoudal et Mercier La Vendée accouraient ; ils avaient reçu quelques jours auparavant des armes et des munitions par d’Allègre et Bois-Berthelot que leur avait dépêchés Puisaye sur une frégate : pour regagner Auray avec les débris de sa colonne, Roman dut se faire jour à la baïonnette. Il trouva dans Auray les cent cinquante hommes du poste Sainte- Barbe qui, sans attendre l’attaque, s’étaient repliés : la défense de la presqu’île n’était plus assurée que par ses garnisons intérieures, Quiberon, Orange, Beg-Rohu, le Fort-Neuf, surtout le fort Sans-Culotte, ci-devant Penthièvre. Mais ces forts et fortins ne paraissaient guère en état ; leurs batteries portaient tout juste à 400 mètres. Pas de vent, une mer sans ride : le débarquement des troupes franco-anglaises sur la plage de Carnac pouvait s’opérer sur l’heure en toute sécurité. Puisaye était donc parvenu à ses fins. Là où le marquis du Dresnay, Frotté, La Robrie, Mallet du Pan, Botherel, Mgr de La Marche, dix autres s’étaient vus rebutés, son génie informé, les merveilleuses ressources de sa diplomatie enveloppante, lui ouvraient tout de suite les bourses et les cœurs : dès le 15 octobre 1794, le comte d’Artois reconnaissait Puisaye comme lieutenant général au service du roi de France de l’armée catholique et royale de Bretagne ; en décembre de la même année, Wendham et Pitt adoptaient son plan d’intervention franco-anglaise ; un moment désarçonné par la nouvelle des traités de la Jaunaie et de la Mabilais, puis mieux renseigné sur la valeur de ces engagements, l’habile homme remontait bien vite en selle et y faisait remonter avec lui les ministres anglais dans l’esprit desquels l’Agence royaliste de Paris travaillait vainement à le ruiner. Tout semblait céder à ses désirs et il n’y avait pas d’obstacle qu’il ne parvînt à surmonter ou à tourner : au mois de mai 1795, la première division française de débarquement — cinq régiments dont un, le Royal-Marine ou régiment d’Hector, comprenant l’élite de nos anciens officiers de vaisseau — était sur pied, les cadres au complet, l’artillerie approvisionnée, les uniformes — aux couleurs des deux nations — distribués : tricorne, veste, pantalons blancs et casaque rouge à cocarde blanche ; la souplesse, l’entregent de Puisaye avaient eu raison de la jalousie et de l’esprit individualiste de ces gentilshommes dont pas un ne voulait céder à l’autre et ne se sentait apte aux grades inférieurs, mais qui acceptèrent comme une transaction honorable de former un corps de volontaires ; on avait comblé les vides — les trop grands vides — de certains régiments avec des prisonniers républicains, grave faute, cette fois, l’enrôlement ne s’étant pas fait de bon gré, mais sous menace, de l’aveu même de l’émigré Berthier du Grandry ; la flotte britannique destinée à débarquer ces corps sur le continent et à les soutenir du feu de ses canons était la plus imposante qui se fût depuis longtemps réunie à Portsmouth — près de cent voiles — ; la masse de vivres, de munitions, de harnachements, de matériel, dont elle sera frétée cap et queue, étonnera justement les républicains qui devront mobiliser pendant quinze jours 4.000 chariots pour l’emporter ; Puisaye enfin, le 6 juin, recevait officiellement du ministre de la Guerre Wendham le commandement en chef de cette expédition pour le succès de laquelle l’Angleterre n’avait rien ménagé, bien loin qu’elle ait nourri le ténébreux dessein de la faire échouer. Seulement, comme il fallait tout prévoir, la capture ou même la mort de Puisaye, un adjoint militaire, le comte d’Hervilly, lui était donné qui, d’après Wendham, ne devait avoir que le rôle et les pouvoirs de second et qui, par l’inadvertance, selon les uns, par la fourberie du gouvernement anglais, selon les autres, se révéla, au cours de la traversée, investi d'une autorité égale à la sienne. L’expédition, en un mot, avait deux têtes : dès ce moment, elle était perdue. Pour dégager la responsabilité des gouvernants anglais, Gabory, qui le premier a étudié sur place les documents, met eu cause cette singulière Agence de Paris que Puisaye, soupçonné tour à tour de préparer les voies du trône au comte d’Artois, au duc de Chartres ou même au duc d’York, avait trouvée contre lui dès la première heure. Il est certain que l’Agence royaliste ne négligea rien pour faire échouer l’expédition et qu’elle y réussit assez bien ; il est certain encore que d’Hervilly était sa créature. Quand tant d’autres noms éclatants de l’ancienne armée pouvaient être proposés à l’agrément des ministres, comment, disent les puisayistes, était-on allé leur préférer ce petit officier de détail, routinier, formaliste, empêtré de théories archaïques et ne retrouvant quelque souplesse que dans l’intrigue, brave sans doute, même un peu bretteur, dont le plus beau titre, et peut-être le seul, était d’avoir refusé de crier à Nantes, devant l’émeute : Vive la Nation ! sans ajouter : Vive le roi ! Le fait de s’être employé antérieurement, comme aide de camp du comte d’Estaing, au service des insurgents d’Amérique ne lui conférait pas une expérience particulière du commandement, et ainsi en jugèrent d’ailleurs un certain nombre d’officiers supérieurs, tels que le comte d’Hector, le duc de La Châtre, le marquis du Dresnay, qui préférèrent demeurer en Angleterre plutôt que de se plier aux ordres d’un subalterne sans vertu, esprit ni renom. Mais tout d’abord d’Hervilly n’était point le petit officier qu’on dit : sa noblesse balançait au moins celle d’Hector que Puisaye avait eu grand soin d’écarter, à cause de ses sympathies pour Charette, et qui était trop vieux d’ailleurs ; d’Andigné lui-même, tout en contestant que d’Hervilly eût jamais vu brûler une amorce, reconnaît qu’il avait la théorie de son métier et que sa fermeté en quelques circonstances lui avait créé une certaine réputation ; ce n’était point non plus un homme sans clairvoyance que celui qui, le 2 mai 1795, mettait en garde les ministres anglais contre l’enrôlement forcé des prisonniers républicains et témoignait le sentiment de peine infinie que la mesure lui avait causée : cette raclure de pontons ne le rassurait point et c’est introduire dans nos rangs un ennemi, écrivait-il prophétiquement. Et il eût préféré que tant qu’à expédier un corps de sept ou huit mille réguliers en Bretagne ou en Vendée, le cabinet de Saint-James patientât un peu jusqu’à ce qu’on eût assez d’émigrés pour composer ce corps. Était-ce si mal raisonner même pour un homme à la dévotion de l’abbé Brottier ? Quand il serait vrai enfin — ce qu’on peut admettre — que cet homme ait surpris la confiance de Pitt et de Wendham, il resterait encore à expliquer qu’ils aient pu lui délivrer une lettre de commission si notoirement limitative des pouvoirs qu’ils conféraient dans le même temps à Puisaye. Parler de grattage, de suppression, de maquillage possible de la lettre ministérielle, voire de son remplacement par un autre texte, n’est point de nature à satisfaire, quand on sait la prudence des bureaux britanniques et le nombre de visas officiels qu’y doivent recevoir les moindres pièces. Le document a disparu sans doute avec d’Hervilly, mais un duplicata devait se trouver dans les archives. S’il a disparu, comme l’original, c’est peut-être que ceux dont il émanait tenaient faiblement à sa divulgation, et le plus vraisemblable en somme n’est-il point que l'Agence royaliste de Paris, qui avait réussi à imposer d’Hervilly à Pitt, était aussi parvenue à lui faire accepter, comme une mesure de sûreté, la dualité de commandement ? Se surveillant l’un et l’autre, d’Hervilly et Puisaye n’entreprendraient rien de contraire aux intérêts anglais. Bonne raison. Wendham, mieux disposé pour nous que Pitt, y fut-il lui- même insensible ? J’aurais dû trancher la ligne du commandement, avouera-t-il plus tard au comte de La Fruglaye. C’est moi le coupable. Quoi qu’il en soit du mobile auquel obéirent Wendham et Pitt, les conséquences de cet inepte régime ne furent pas longtemps à se faire sentir : pressés à l’avant des navires, impatients de fouler cette terre de la patrie que tant d’entre eux, vétérans des guerres de Sept Ans et d’Amérique, désespéraient de revoir jamais, les gentilshommes du corps expéditionnaire eussent volontiers enjambé les bastingages pour être plus tôt à destination. Puisaye partageait leur impatience : il comptait sans d’Hervilly, fort âcre, dit Vauban, qui exhibe pour la seconde fois — il l’avait déjà fait en cours de route — sa lettre de commission. Puisaye se récrie. D’Hervilly tient bon. Tinténiac et Bois-Berthelot qui surviennent joignent leurs instances à celles de Waren, désireux de mettre à profit l’absence de vent, le calme des eaux. D’Hervilly n'en démord pas, et le 27 au matin seulement, après avoir passé la journée de la veille à promener sa lunette sur les criques, les roches, les moindres accidents d’une côte où, sauf à Penthièvre, ne se découvrait aucun ennemi sérieux, il se décide à donner l’ordre de débarquer. Entre la Mer Sauvage si bien nommée qui le bat vers l’Ouest et la baie si plane, si lisse, où est mouillée la flotte anglaise, s’allonge une sorte de grand appendice granitique, ancien îlot devenu presqu’île par le colmatage graduel de la chaussée de galets et de sable qu’y a formée le jeu des marées : c’est Quiberon et sa falaise ; en face, vers la terre, par delà le moutonnement des dunes, s’étagent ou se détachent des collines hérissées de frustes stèles funéraires, des pitons isolés recouvrant des chambres sépulcrales, un pays d'ombres gardé par des monstres de pierre et dont on redouterait l’approche, n’était la flèche des clochers qui pointe par endroits d’un pli du sol sans parvenir à dissiper complètement l’impression de malaise causé par ces présences souterraines et par cette faune mégalithique : c’est Carnac, ses tumuli et ses alignements. D’Hervilly, homme de goût, doit pester d’opérer dans un pays si peu racinien. Formaliste et tatillon de son naturel, on dirait qu’il raffine encore sur sa méticulosité ordinaire pour obéir aux instructions de l’Agence royaliste qui lui ont bien recommandé de veiller à n’agir que sous sa responsabilité personnelle, de n’avancer dans l’intérieur que lorsqu’il serait sûr du concours de tous et de laisser ainsi le temps à M. de Puisaye de démasquer ses plans. Ce dernier point était peut-être la grande affaire. Peu confiant par ailleurs et dès l’origine dans le succès d’une expédition numériquement trop faible et où l’on avait fait entrer tant d’éléments indésirables, d’Hervilly conçut des doutes plus grands encore à l’aspect des bandes hirsutes au milieu desquelles il tombait : quand il s’attendait à trouver des hommes alignés sur deux rangs, la giberne au dos et lui présentant les armes, c’est dans les savanes du Nouveau-Monde qu’il crut avoir remis le pied. Le pays et l’habitant lui parurent en harmonie parfaite : cela chantait, hurlait, trépignait, brandissait des fourches et des matraques, touchait ses gris-gris, chapelets, scapulaires, médailles bénites, et plongeait soudain dans une sombre torpeur. Beaucoup étaient ivres sans doute, de joie plus que d’alcool. Mais la suite ne vaudra pas mieux et, à peine en possession des fusils calibrés qu'on leur apporte, ces sauvages se mettront à déchirer les cartouches et à faire parler la poudre sans nécessité, pour le plaisir. Un vrai feu roulant, dit Berthier du Grandry et qui dura tout le long du jour, nonobstant la défense qui leur en fut faite et réitérée. L’impression fâcheuse qu’en éprouvèrent Berthier et ses amis fut évidemment partagée par d’Hervilly, bien vite persuadé que le concours de telles bandes serait plus nuisible qu’utile à ses régiments. Avant de les employer, il fallait les dégrossir, les équiper, les instruire. Cela prendrait du temps. D’Hervilly à Quiberon, c’est Trochu au siège de Paris : ni l’un ni l’autre ne croient aux armées improvisées ; l’un et l’autre, pour les mêmes raisons, se refuseront à la grande trouée que réclament les braillards. Puisaye, comme Gambetta, y perdra sa peine. Moins impressionnable ou moins ondoyant et passant outre à l’opinion des émigrés, il eût exécuté séance tenante d’Hervilly. Ainsi en eussent agi Guillemot et Cadoudal : Puisaye préféra recourir à Londres, y détacher un cutter de l’escadre pour demander à Wendham de prononcer entre d’Hervilly et lui. Quand la réponse arrivera — par Sombreuil, — la partie sera si bien compromise qu’on pourra l'estimer perdue. Cependant la foule campée en plein air autour de Carnac, à l’ombre de ses mystérieux alignements, n’y comprenait rien : elle attendait depuis deux jours les libérateurs qui lui étaient annoncés et qu’un mot d’ordre inexplicable retenait sur leurs vaisseaux. Ils se détachèrent enfin du bord vers la grève de Por-en-Drou, tout de suite couverte de peuple, les contingents de Royal-Louis et du Royal-Émigrant dans les premières chaloupes, et ce fut à leur approche un déchaînement de joie paysanne comme il ne s’en était jamais vu ; on criait à tue-tête Vive le roi ! Vive la religion ! les seuls mots de français que la plupart connussent. On pleurait, on riait en même temps ; on tendait les mains vers les chaloupes ; on fendait l’eau pour les haler sur le sable ; on s’attelait aux canons ; on eût porté les arrivants en triomphe, s’ils se fussent laissé faire. Mais eux, les émigrés bretons surtout, avides de retrouver leurs pierres grises et l’odeur des bruyères natales, se jetaient à genoux en débarquant pour baiser et respirer cette terre âpre dont ils rêvaient dans l’exil. Spectacle plus touchant encore : d’une des chaloupes descendit une compagnie de vieux officiers, tous chevaliers de Saint-Louis, dont l’insigne était suspendu à leur cou par un simple ruban de laine, faute d’avoir pu s’en acheter un de soie. Ils portaient le mousquet et touchaient la paye de simples soldats ; le moins âgé comptait cinquante ans et leur capitaine, M. de Rossel, en déclarait fièrement soixante-douze.... Où l’émotion fut à son comble, c’est quand parut l’évêque de Dol, Mgr de Hercé, vénérable vieillard à cheveux blancs, mitré, la crosse en main, et qu’assistaient quarante prêtres en vêtements sacerdotaux : d’un même mouvement toute cette foule se prosterna, fléchit la tête pour recevoir sa bénédiction. Cinq ou six mille Chouans des nouvelles levées, derrière elle, dans la même attitude, contrastant avec la frénésie des démonstrations auxquelles ils se livraient naguère, présentaient au geste du prélat leurs massives encolures, comme ces hordes de fauves qui se courbaient, dit-on, à la voix de l’ermite Hervé. Le marquis de Talhouet-Bonamour, détaché par l’Agence de Paris, n’avait pu les convaincre de rentrer dans leurs foyers. A toutes ses objurgations, ils répondaient par le silence ou en montrant l’horizon plein de sinistres rougeoiements : le bruit courait que Crublier, qui en avait fini avec Boishardy, approchait, et, sachant le sort que ses troupes réservaient à leurs pauvres ménages, ils s’étaient hâtés d’en distraire le plus précieux, coffres, armoires, crucifix, pour le mettre, avec leurs troupeaux, sous la protection de l’armée royale. Peut-être, comme les clans vendéens dans l'exode sur Granville, méditaient-ils d’emporter avec eux ces signes de la patrie jusqu’à Rennes, sous les murs de Paris au besoin. Car il n’y avait pas à craindre cette fois que la marche en avant fût arrêtée et se changeât en déroute : les villes n'attendaient même pas d’en être sommées pour se rendre ; Auray, la première, arborait le drapeau blanc, et sa garde nationale, commandée par le notaire Glain, accourait se donner à Puisaye. Exemple que suivraient les gardes nationales des autres villes : les 4.000 hommes de l’armée royale et les 10.000 Chouans des trois divisions morbihannaises commandées par Vauban, Tinténiac et Bois-Berthelot, avec d’Allègre, Cadoudal, Mercier, Jean Jan et Lantivy-Kerveno pour lieutenants, seraient 50.000 dès Ploërmel, 80.000, affirmait généreusement Puisaye à Pitt. Et comment Hoche, en effet, eût-il pu briser l’élan d’un tel mascaret ? Ses troupes éparpillaient leurs colonnes le long de la côte, qu’il ne pouvait songer à découvrir complètement : Chabot devait défendre Brest jusqu’à la mort, Aubert-Dubayet Saint-Malo, Canclaux Nantes ; tout au plus si les deux derniers pouvaient lui prêter quelques maigres bataillons, tandis que Chérin battrait le haut pays, avec ordre d’y ramasser tout ce qu’il trouverait pour en former à Rennes un corps de six ou sept mille hommes, — Rennes suprême boulevard de la résistance, Rennes où, Hoche le croyait comme Puisaye, se déciderait la terrible partie. L’arrivée de la flotte anglaise devant Quiberon l’avait évidemment surpris et il devait l'attendre sur un autre point de la côte, puisqu’en doublant les étapes lui-même n’arrivait à Vannes que le 27 au soir, trop tard pour empêcher le débarquement. 400 fantassins, 30 cavaliers, c’est tout ce dont il disposait : il essaie pourtant avec eux, le 28, de pousser jusqu’à Auray et ne va pas plus loin que Pontsall : les Chouans de Bois-Berthelot barraient la route. Il les culbute sans trop de peine, mais suspend la poursuite, craignant d’être débordé, et rentre à Vannes un peu moins inquiet après cette pointe téméraire qui lui a permis de se rendre un compte approximatif des forces de l’ennemi : néanmoins il alerte le directoire du département et l’invite à rassembler d’urgence ses fonds, ses papiers, pour le suivre éventuellement vers l’intérieur. Lorient reçoit pareille invitation. Mais, le lendemain, le surlendemain, ni les troupes chouannes, ni l’armée des émigrés n’ont esquissé le moindre mouvement : au lieu de foncer en avant, de bourrer, comme dira Foch à la Marne, elles demeurent l’arme au pied. Et cependant les renforts arrivent à Hoche : voici Josnet, voici Drut, voici Mermet, voici Humbert, demain Lemoine, Valletaux. Le 30 juin, Hoche avait déjà deux mille hommes sous la main, qui, dans quatre jours, seront treize mille. La situation commence à se retourner et, puisque l’ennemi ne bouge pas et lui laisse tout le temps d’opérer sa concentration, Hoche ne songe plus à retraiter ; il entrevoit que la décision pourra être obtenue sur place ; il prend ses dispositions en conséquence, fait battre le rappel partout, dépêche jusqu’à la Convention pour réclamer de nouvelles troupes — de la cavalerie particulièrement dont il dit avoir grand besoin — et vers les représentants pour demander du pain dont il a plus besoin encore. Car on est terriblement rationné dans l’armée des Côtes de Brest : vingt onces de gruau par jour, et le soldat, que talonne la faim, maraude, pille, torture un peu, si l’on résiste, égorge tout à fait, si l’on s’obstine. Tallien, à défaut de farine, dont on manque à Paris autant que dans le Morbihan, lui apportera de l’eau-de-vie — par tonneaux : on ne sait pas encore que l’alcool est un aliment, mais on fait comme si on le savait. Et, en dernier recours, pour enlever ses hommes. Hoche n’a qu’à leur montrer dans le camp royaliste les immenses réserves de provisions débarquées par la flotte anglaise et à leur dire comme Bonaparte aux troupes d’Italie : Tout cela est à vous. Vous n’avez qu’à le prendre. Dès le 30, il fait attaquer Tinténiac à Landévant par les bataillons faméliques de Josnet qui lui enlèvent ce poste avancé ; Bois-Berthelot, à son tour, est débusqué d’Auray qu’il reprendra, comme Tinténiac, en traversant à la nage deux bras de mer, reprendra Landévant, mais d’où Mermet le délogera définitivement le 3 juillet. l’un et l’autre, le premier surtout, trop en flèche, ne pouvaient résister sérieusement s’ils n’étaient épaulés par quelques bons éléments fie troupes soldées. D’Hervilly leur fit espérer trois ou quatre centaines de grenadiers et n’envoya rien. Il n’est pas guéri encore de ses préventions contre les Chouans, préventions à peu près générales, on le sait, chez les émigrés du corps de débarquement, et ni lui ni eux n’en guériront de sitôt. Ce bon chrétien de Jean Rohu, un peu enclin à la bouteille comme tous les Bretons et qui se garda honnête tant qu’il put boire à sa soif, raconte que Georges — on commençait d’appeler ainsi Cadoudal — l’avait envoyé porter un message à d’Hervilly, au bourg de Carnac. Il vidait chopine dans l’antichambre, en attendant la réponse du général, quand survinrent deux émigrés qui tournèrent curieusement autour de lui et dont l’un dit à l’autre : — Qu’est-ce que cela ? — Un Chouan apparemment. On ne voit que cela ici. — Prenez patience, messieurs, dit Jean Rohu en se levant : avant longtemps vous en verrez d’une autre couleur plus que vous ne voudrez. Des hommes qui ne savent pas marcher au pas, qui ignorent les secrets de la charge à douze temps, qui n’ont pour uniformes qu'une cocarde et un chapelet, n’étaient pas des soldats pour les émigrés. Des égaux encore moins. Le matin du débarquement, tandis que Mgr de Hercé célébrait en plein air, pour Puisaye et ses Chouans, une messe d’action de grâces où l’on acclamait le nouveau roi — on avait appris en cours de route la mort du petit Louis XVII —, les émigrés allaient entendre une autre messe à l’église de Carnac — une messe noble, commandée par d’Hervilly. Entre ces défenseurs d’une même cause, dont les uns avaient retrouvé toute leur morgue de caste et dont les autres sentaient gronder en eux la vieille passion égalitaire qui fait le fond du caractère armoricain, le malentendu ne pouvait que s’aggraver ; des mots aigres s’échangeaient, prélude de rixes prochaines. Puisaye devait courir des uns aux autres et, quand tout le pressait d’agir, dépenser ce qui lui restait d’autorité à régler de mesquins conflits d’amour-propre. Mais, enfin, puisque d’Hervilly, contestant la valeur des troupes chouan nés, refusant même de les assister et estimant sans doute que leur salut ne valait pas les os d’un de ses grenadiers, s’entêtait à ne pas sortir du quadrilatère de Carnac, au moins fallait-il qu’il n’eût point à son flanc cette menace de Quiberon, sur les redoutes duquel flottaient toujours les odieuses couleurs de la République. Sans-Culotte surtout, clef stratégique de la presqu’île, inquiétait Puisaye. — Finissons-en, prenons-le, proposait-il. — Nous n’avons pas d’artillerie de siège, répondait d’Hervilly qui eût tenu pour messéant de faire tomber une place contre les règles. Les canons de l’escadre anglaise, par grand’chance, suppléèrent à l’indigence de l’armée royale : Quiberon, le Beg-Rohu, etc., dès la première bordée, s’étaient rendus ; Sans-Culotte, plus copieusement bombardé, en fit autant après un semblant de résistance (3 juillet). On récompensera Warren de son concours en levant dans la presqu’île un régiment de cavalerie à son nom, hommage doublement agréable à ce marin et à ce sportif qui assiste à nos batailles comme à un match et ne dédaigne pas d’y lancer lui-même la balle. En réalité Sans-Culotte, faute de vivres, fût tombé tout seul. Mais, pour décider d’Hervilly à cueillir cette proie facile, il n’avait pas moins fallu que la chute définitive d’Auray et la peur d’être pris entre deux feux : huit jours s’étaient passés en conférences, harangues, parades et autres fariboles ; docile aux instructions de l’Agence royaliste, d’Hervilly suspendait toute offensive, laissait écraser sans scrupule, sinon volontairement, Tinténiac, Bois-Berthelot, Vauban. Et Puisaye, de son côté, qui avait fait arborer les couleurs britanniques à côté des couleurs françaises sur le fort Sans-Culotte redevenu Penthièvre — détail relevé avec soin par d’Hervilly, — commettait l’insigne folie d'enrôler dans l’armée royale les deux tiers de la garnison, quatre cents soldats, que, pour comble d’imprudence, il maintenait à leur poste après les avoir harangués. Leur adjoindre quelques éléments de la Châtre et de Royal-Louis sous les ordres de M. de Folmont remplaçant le commandant Maire, était-il une garantie suffisante et comment d’Hervilly, cette fois, ne s’interposa-t-il pas ? Mais son régiment à lui-même, qu’il avait levé et qui portait son nom avant de reprendre celui de Royal-Louis, était bourré d’anciens pensionnaires des pontons anglais. On se perd dans ces contradictions. — Messieurs, avait dit Puisaye aux émigrés, une fois maîtres du fort, nous filerons sur Rennes. Il n’était que temps en vérité. Un morne découragement avait succédé chez les Chouans à l’enthousiasme des premières heures : ces guerriers de talus, qu’on ne trouvait dignes d’être secondés ni par l’artillerie, ni par les troupes de ligne (Rohu) et dont l’attitude au feu déroutait tous les-principes, se lassaient à la longue d’être un simple objet de curiosité pour les lorgnettes des émigrés. Seuls Puisaye, Tinténiac, Bois-Berthelot, d'Allègre, Lantivy et quelques autres, qui avaient bataillé avec eux sous les fourrés, estimaient à son juste prix leur tactique de primitifs, leur science innée de l’embuscade et de la surprise ; mais Puisaye, en grand crédit chez les Chouans, n’en avait presque aucun chez les émigrés, et Contades lui-même, son major général, le brocardait et chansonnait par derrière. D’Hervilly, à peine Quiberon entre ses mains, s’était hâté d’y transporter son quartier général et son artillerie : il se trouvait là comme dans une place forte, un camp retranché de tout repos, un Gibraltar royaliste et qui lui donnait moins que jamais l’envie de bouger. Il ne rejeta point cependant le plan d’offensive de Puisaye ; il fit même semblant d’y abonder, mais en différa autant qu’il put l’exécution et, finalement, sous prétexte de faciliter la jonction des forces royalistes en vue de l’attaque imminente, ordonna aux divisions chouannes de se replier entre Plœrmel et Carnac : elles devraient tenir sur ces nouvelles positions jusqu’à la dernière extrémité, le dos à la mer, la gauche seule de Vauban communiquant avec la presqu’île. Singulière façon de comprendre la percée, remarque Gabory. Mais d’Hervilly l’avait-il jamais voulue ? On en peut douter. Il reste que rien mieux que ces atermoiements ne pouvait servir les desseins de Hoche, nullement insensible, comme on l’a dit, à la perte de la presqu’île et qui augurait plus favorablement de la fermeté du commandant Delise à Quiberon et du commandant Maire à Sans-Culotte, mais qui n’en poussait qu’avec plus de vigueur le rassemblement et le regroupement de ses forces. D’Hervilly était en l’occurrence son meilleur lieutenant, son plus actif auxiliaire : le temps qu’il lui accordait si généreusement, Hoche, désireux d’en finir d’un seul coup, l’employait à étoffer par tous les moyens ses minces effectifs : les renforts ne lui arrivaient pas assez vite à son gré, bien qu’il en reçût d’un peu partout, même de l’armée royale où les signes de dislocation commençaient d’apparaître ; chaque jour l’immense lande de Lanvaux, choisie comme point de concentration, se hérissait de nouvelles baïonnettes. Hoche pressait l’envoi de cinq mille autres qu’il attendait de Laval, quand il apprit le recul de Vauban et des divisions chouannes : il ne leur laisse même pas le temps de s’organiser sur leurs positions de repli et, le 6 au matin, à son signal, toute l’armée bleue dévale sur trois colonnes vers Erdeven, Plœrmel et Carnac. Humbert commandait la première colonne, Valletaux la seconde, Lemoine la troisième. Un raz de marée républicain, méthodique et irrésistible, remplaçait le raz de marée royaliste annoncé et toujours différé, et son approche, comme celle des grands cataclysmes naturels, était signalée par une fuite éperdue de la population. Gagnés de panique, les émigrants des campagnes voisines, qui étaient venus quelques jours auparavant, avec leurs meubles et leurs bestiaux, chercher un asile dans les lignes royalistes, poussaient des cris aigus et ajoutaient à la confusion : ils tournaient sur eux- mêmes, ils ne pouvaient songer, dit l’abbé Le Garrec, à percer les lignes ennemies qui, d'heure en heure, se resserraient autour d’eux plus épaisses ; ils ne se résignaient pas non plus à s’engager dans [cette partie étranglée de l’isthme qu’on appelle] la falaise, au delà de laquelle ils ne voyaient que la mer. Leur unique espoir était dans d’Hervilly qui devait se porter avec deux régiments, Royal-Louis et Royal-Émigrant, sur Plouharnel, mais qui, après un commencement d’exécution, et quand les trois divisionnaires chouans se raidissaient pour lui laisser le temps de déboucher, faisait reprendre à ses troupes le chemin de la presqu’île, sans avoir brûlé une amorce. Puisaye, confondu, désemparé, qui le cherchait partout, sur la chaussée du Bégo, sur les retranchements de Sainte-Barbe, l’aperçut enfin du haut de la dune qui rentrait, l’arme au bras, sous la poterne du fort Penthièvre. Mais d’autres que Puisaye l’avaient vu. Pourquoi ce monstre [ou ces monstres] n’a-t-il pas été englouti dans la mer avant d’arriver à Quiberon ? se serait écrié Georges. Et Vauban, définitivement édifié sur son chef, parlait de le faire traduire en conseil de guerre pour haute trahison. De toute façon la retraite s’imposait, et elle ne pouvait se faire que vers la presqu’île. Elle s’exécuta d’abord en assez bon ordre, le feu des échelons alternant avec des retours offensifs à la baïonnette vigoureusement menés. Mais ensuite ce fut la ruée. Il ne restait plus en action que le bataillon d’Auray cantonné au manoir de Kergonan où on l’avait oublié et, derrière les troupes chouannes, trente mille fuyards des deux sexes, femmes, enfants, vieillards, ecclésiastiques, se lançaient par l’anse de Plouharnel avec leurs troupeaux, leurs charrettes, leurs vaisseaux saints, vers l’espèce de goulot que forme la falaise à cet endroit. La mer montait, mais l’anse n’était pas encore couverte et la fusillade se rapprochait, quand par bonheur survinrent Jean Rohu et ses marins, les meilleures troupes de la division Tinténiac, retraitant de Sainte-Barbe dont elles occupaient le retranchement. Leur chef, chargé de l’arrière-garde, les fit s’établir en crochet défensif devant l’anse jusqu’à ce que la mer eût fini sa montée. Cette généreuse diversion, attribuée par d’autres à Georges, mais justement revendiquée par son lieutenant, sauva du même coup les restes du bataillon d’Auray qui détalait vers la chaussée du moulin, talonné par les Bleus. Rohu ne s’en alla qu’après que Tinténiac en personne, au grand galop, fût accouru lui intimer l’ordre de se replier. Et, à ce moment, il aperçut sa bonne femme de mère, ses sabots à la main, qui, depuis deux heures, le suivait silencieusement.... |