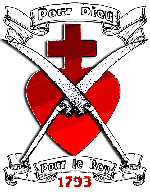LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE VIII. — LA MORT DE BOISHARDY.
|
IL faut reconnaître, à la louange des représentants, que leur réaction fut aussi foudroyante que la découverte qui l’avait provoquée, et jamais situation ne fut retournée avec plus de promptitude. Cela commence le 26 mai par l’arrestation de Cormartin et de ses lieutenants Solilhac, Jarry, Saint-Gilles, etc., à la sortie du dîner que leur offrait le représentant Bollet. Puis, sans prendre la peine de dénoncer la rupture du traité, Josnet, avec trois colonnes, tombe, le 27, sur le vieux Silz au château de Penhouet, près de Granchamp, et le fait sabrer par ses hussards ; le 30, il déloge à la baïonnette Lantivy-Kervéno des tailles de Saint-Bily et lui tue 250 hommes. Long cri de rage, de vengeance, dans tout le Morbihan et qui se répercute jusqu’aux extrémités des territoires insurgés. Mais on n’était pas sur ses gardes ou on ne l’était pas assez ; mais la poudre manquait et, en faisant fricasser sur une poêle celle, un peu humide, que lui avait remise un bateau anglais. Guillemot, à Dronidan, déterminait une explosion générale qui tuait vingt-deux de ses hommes et le blessait grièvement. Que devenir sans munitions ? Une expédition — l’une des plus audacieuses du genre en raison de la distance à parcourir (trente lieues, presque tout un département) — est décidée sur la manufacture de Pont-de-Buis qu’enlève Lantivy, assisté des bandes de Leissègues, Videlo et du Chélas : comme butin, huit barriques de poudre, et voilà la fusillade rallumée dans tous les fourrés de la péninsule. Cependant Caqueray, avant même la rupture, était cerné et tué près de Redon ; Coquereau, vers Craon ; Tristan l’Hermite et le comte de Geslin, aux environs de Laval ; Doisy, l’adjudant général de Frotté, se faisait prendre près de Caen et le même sort attendait Boisguy près de Fougères, si, prévenu à temps, il n’avait pu s’échapper du piège en démolissant la colonne lancée à sa poursuite. La plus déplorable et la plus innocente victime de ces sanglantes représailles fut sans conteste Boishardy. Ses hommes croyaient qu’il avait une recette pour enchanter les balles, mais elle ne
devait pas valoir celle, si simple, de Jean Rohu, le lieutenant de Cadoudal,
qui consistait à réciter chaque matin, en chargeant son fusil, un De
profondis pour les âmes du purgatoire. Et le fait est que Jean Rohu
mourut dans son lit, le 20 août 1849, comblé d’ans et même d’honneurs, bien
qu’il fût passé aux gages du préfet Julien, tandis que Boishardy, le sorcier, tomba le 15 juin 1795, aux issues d’un
labour, n’étant encore que dans sa trente-troisième année. Trente-trois ans, l’âge du sans-culotte Jésus, l’âge fatal
aux révolutionnaires, déclamait devant ses juges Camille Desmoulins.
C’est aussi quelquefois — Charette, après Bonchamps et Boishardy, le montrera
— un âge fatal aux représentants des anciens partis. Rien n’a changé dans le Mené, la région intérieure des Côtes-du-Nord où opérait Boishardy : les gentilhommières tapies sous les chênes, les vallées tendues de brume, les landes jaunissantes au flanc des collines rocheuses, les villes même, Moncontour, Quintin et leurs architectures du temps des Bourbons, tout est intact. Cherche-t-on celui qui, cinq ans, fit la loi dans ce léthargique royaume ? Une croix de pierre, sans fût, enfouie dans le fossé, au bord de la route de Moncontour, s’appelle la croix de Boishardy, mais il faut être du pays pour le savoir. Pas une date, pas un nom. L’anonymat le plus complet. Tristesse. L’homme qui tomba près de là, devant la brèche du champ de
François Verdes, fut pourtant une des gloires de la Chouannerie, et son
modèle pour l’esprit chevaleresque, sinon pour la continence, car Souvestre,
d’accord avec la tradition locale, lui attribue presque autant d’aventures
galantes qu’à Charette, si peu de sa terre au surplus ! D’Elbée, La Rochejacquelein,
Bonchamps, Cathelineau, Lescure, à la bonne heure. L’austère vertu du sol
vendéen est en eux ; il n’y a pas de femmes
autour d’eux ou bien ces femmes sont des mères, des épouses, des sœurs ; la
Vendée est une croisade et là seulement, suivant la profonde observation
d’Émile Gabory, le nom de saint a pu être donné sans trop d’exagération à un
Lescure, le saint du Poitou, ou à un
Cathelineau, le saint de l’Anjou. On ne voit
point en retour que personne ait songé à canoniser Frotté, fils de
protestants et qui lie brûlait que d’un amour modéré pour la foi catholique,
ni Tinténiac, le chouan-chevalier, ni Guillemot, le roi
de Bignan, le justicier implacable, ni Cadoudal lui-même, ce Danton
des bruyères morbihannaises, ni Boishardy, figure plus nuancée, plus complexe
peut-être, au moins vers la fin et dont quelques traits tenteront Balzac pour
son marquis de Montauran. Mais quoi ! Boishardy, après qu’il a fixé un grand
crucifix d’étain au hêtre de son cantonnement, se tient quitte du reste et
continue de courir la prétantaine comme devant. Nous ne devons point sans
doute une confiance entière à Souvestre qui romançait plus qu’il n’écrivait
l’histoire et que des scrupules, parfaitement respectables, inclinaient par
ailleurs à modifier certains noms portés encore par des vivants. Mme Catherine, avec son élégant costume de drap
bleu garni de brandebourgs, son chapeau à plume blanche, ses bottines à
frange d’or et sa carabine incrustée de nacre, surtout son air de Diane
adolescente, son goût de l’intrigue et sa passion de l’autorité, n’en a pas
moins chez lui, à défaut du nom, tout l’essentiel du caractère que ses plus
récents biographes prêtent à Joséphine de Kercadio, Mme
Fine, l’amazone de seize ans qui accompagnait Boishardy, quand au
petit jour, dans une pommeraie où il avait accroché son hamac, il fut surpris
par le détachement du féroce capitaine Ardillas. Du premier coup d’œil, dit
Souvestre, on reconnaissait, en arrivant chez Boishardy, celle de ses maîtresses que ses soldats avaient surnommée
la Royale. Elle restait sourde aux appels de sa mère, internée à
Lamballe et qui la suppliait de la rejoindre, de cesser sa vie de casse-cou ;
son emprise était telle sur Boishardy qu’elle l’obligea de l’emmener aux
conférences de la Mabilais, où sa présence étonna les chefs chouans réunis à
l’appel de Cormartin. La suite des aventures de cette Clorinde armoricaine
n’est pas beaucoup faite pour la relever à nos yeux quand on la voit, un an
après l’assassinat de son amant et grosse de six mois, convoler en justes
noces avec son lieutenant Hervé du Lorin, puis troquer celui-ci contre
Benteau, qui deviendra général et baron de l’Empire. Excellent du Lorin,
qu’une pension de 300 livres rendit le plus souple des époux ! Après quoi il
est malaisé de prendre Joséphine de Kercadio pour une Virginie, une Agnès. Mais Boishardy, lui, a fait l’unanimité sur son nom. Ce petit gentilhomme campagnard, lancé aux trousses de ses briquets, se révèle, l’occasion venue, un entraîneur d’hommes extraordinaire, tour à tour passionné, mordant, spirituel, en même temps qu’un manœuvrier de buissons sans rival : c’est Achille pour la bravoure et c’est Ulysse pour la fertilité des inventions, comme ce jour où il se rend au marché de Lamballe, dont les gardes nationaux le cherchent partout, un panier sur l’épaule et grimé en marchand d’œufs. Sa tête est mise à prix et il pourrait user de représailles : mais qu’il tienne entre ses mains l’homme qui s’est installé dans son patrimoine confisqué, il se contentera de lui botter les fesses ; qu’un ravitailleur passe, menant des bœufs aux patriotes lorientais, et il lui délivrera un sauf-conduit, ne voulant pas, dit-il en riant, faire main basse sur les bœufs destinés à de pauvres bougres de révolutionnaires qui crèvent de faim. Comment cette franche et loyale nature ce goguenard compagnon, tout en dehors, s’assombrit-il brusquement ? Le fait est là, constaté par d’Andigné et par bien d’autres. D’Andigné avait trouvé Boishardy dans son réduit du Mené, changeant de gîte chaque nuit, pouvant mettre sur pied en vingt-quatre heures douze cents Chouans et retardant toujours de les convoquer. L’indécision que je remarquai chez lui, observe d’Andigné, me laissait des inquiétudes... Hoche n’avait rien négligé pour se l’attirer. L’espèce de nonchalance à laquelle il s’abandonnait semblait un pressentiment du sort qui l’attendait. Deux jours après notre entrevue, il fut surpris et massacré. En somme, si d’Andigné dit vrai, Hoche, auquel il faut ajouter Humbert, avait réussi à troubler cette conscience jusque-là si limpide et non pas sans doute à la gagner aux idées républicaines, mais à la rendre quelque peu perplexe sur ses obligations de Français. Au lendemain de la Mabilais, à la veille de Quiberon, où était le devoir ? En attendant, Boishardy et Joséphine songeaient à régulariser leur liaison ; la bénédiction nuptiale devait leur être donnée, la nuit suivante, dans une chapelle de la montagne : un traître, dit-on, les vendit, le propre domestique de Boishardy, suivant Alphonse Beauchamp, qui, si près des événements (1805), nous étonne encore par la sûreté de sa documentation et l’ordre relatif qu’il sut introduire dans l’un des plus extraordinaires imbroglios de l’histoire. En réalité, Charles — nom ou prénom supposé de ce traître — n’a pas révélé son identité : on croit reconnaître en lui un jeune garçon de dix-sept ans, épave du désastre vendéen, recueilli par Boishardy et confié par lui à la femme d’un de ses partisans, Carlo, le métayer du Vaugourio. Une autre femme, celle qui épinglera le drap du mort, s’appelle Madeleine Caro. Charles, Carlo, Caro, singulière rencontre de noms presque identiques. L’homme, quoi qu’il en soit, semble bien n’avoir pas agi de sa propre initiative et pour son propre compte ; il put bien n’être que l’instrument d’une vengeance féminine, dénoncée par Souvestre et provoquée par l’arrogance de la Royale. La Vendée est une eau claire ; nul remous, nul limon en elle : la Chouannerie reste la grande chose obscure dont parlait Barbey d’Aurevilly. Toutes sortes de passions y remuent. Les quelques lueurs projetées sur ce grouillement font apparaître trop d’inquiétantes silhouettes féminines telles que cette Le Tellier de Vaubadon, descendante de Tourville, étrennant dans une avant-scène de Bayeux un cachemire rouge, prix du sang de d’Aché, ou cette marquise du Grégo, jeune, belle, irritante, qui livre à Hoche pour rien, pour le plaisir, le plan des émigrés et passe de ses bras, ivre de dénonciations, dans ceux de ses généraux. Qu’avait-elle à venger, celle-là, dont le mari va conduire la colonne détachée de Quiberon et se fera tuer, peut-être de dégoût, quand il connaîtra les trahisons de sa femme ? La Révolution, qui avait commencé par envoyer des bouchers contre la Vendée et les Chouans, n’eut pas à regretter son changement de tactique et d’avoir délégué à la pacification de l’Ouest ses plus beaux fils, ce Humbert et ce Hoche qui n’avaient qu’à paraître pour troubler le cœur des femmes. La Tour d’Auvergne les connaissait bien, le premier du moins, auquel il écrivait, le 15 ventôse an VIII : Comme vous cajolez, mon aimable
général ! Avec ce doux langage, que de conquêtes vous devez faire au
milieu de nos très intéressantes, mais trop crédules petites Bretonnes ! Hoche est plus redoutable encore. A Moncontour, où il descend chez Mme Latumier du Clézieux, qui fit sur lui et reçut peut-être de lui la plus forte impression, il se rencontre avec Boishardy, que cette dame, extrêmement belle et vertueuse, n'avait pas toujours laissé lui-même indifférent. Les assassins du chef chouan le savaient-ils ? Croyaient-ils flatter ou venger Hoche ? A quel sentiment donc auraient-ils obéi quand, après avoir promené la tête de Boishardy au bout de leurs baïonnettes, ils vinrent la déposer sur le bord de la fenêtre de Mme du Clézieux pour qu’elle l’aperçût à son lever, toute sanglante et les yeux éteints ? Cependant, dit Levot, l’homme, le Charles ou Carlo qui livra Boishardy, exploitant la trahison sous toutes ses formes, eut plus tard des relations avec le cuisinier qui fut soupçonné d'avoir empoisonné Hoche. C’est comme une spirale ténébreuse qui se déroule.... |