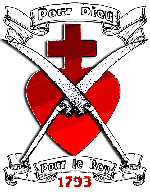LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE VII. — LES CONFÉRENCES DE LA MABILAIS.
|
C’EST bien sur quoi compte Puisaye. D’ailleurs, si tout est prêt ici, tout est à faire à Londres, à commencer par la consécration de ses pouvoirs, et ses lieutenants devront se contenter jusqu’à son retour de recruter et d’entraîner leurs bandes ; ce sera, pour quelque temps encore, la guerre de clair de lune, coups de main, rafles, arquebusades de prêtres mariés, d’agents du fisc, de maires sans-culottes, d’acquéreurs de biens nationaux, la petite guerre brigande, préface de l’autre, la guerre stratégique au grand jour, avec armées régulières, tambours, fifres, pavillons déployés, dont Quiberon donnera le signal et qui consommera la déroute de l’infernale République. Avant de partir, il rassembla une dernière fois ses officiers au quartier général du chevalier de Chantreau, pour connaître avec eux la conduite à tenir pendant son absence. Un de ses affidés, Mathurin Dufour, marin de Saint-Coulomb, plus tard colonel, s'occupait de lui trouver une barque pour passer à Jersey. Ce n’était pas aisé, avec les patrouilles des chaloupes canonnières et une côte gardée, dit Dufour dans ses Mémoires, par une ceinture de tentes dressées à cinquante pas l’une de l’autre et occupées chacune par quinze hommes sous le commandement d’un officier. Pour déjouer cette double surveillance, on devait attendre la conjonction d’une nuit très sombre et d’une mer démontée, où les canonnières cherchaient l’abri ; mais il restait toujours à traverser la ligne des tentes, ce qui ne se pouvait faire qu’à plat ventre, le fusil armé et en banderole, prêt à répondre par une décharge au qui-vive des factionnaires. Problème difficile. Concédons en sus — on parlera tant de la lâcheté de Puisaye ! — qu’il requérait quelque courage de ceux qui s’attaquaient à sa solution. Les quinze jours demandés par Dufour pour trouver un canot et des conditions favorables à l’embarquement de son passager ne furent pas perdus pour celui-ci, qui acheva de prendre langue et de tout régler avec ses interlocuteurs : il fut convenu, précisé et répété jusqu’à satiété dans les dernières conférences qu’on réserverait toute action importante jusqu’à son retour et qu’on se contenterait d’ici là de continuer à travailler la province sans trop l’alarmer, multipliant les approches sournoises, organisant une espèce d’interdit des villes, surtout qu’on ne laisserait pas filtrer le bruit de son départ pour l’Angleterre. Un conseil de chefs, composé de Boishardy, de Chantreau, de Jarry et de l’ex-constituant girondin Le Deist de Botidoux, que Puisaye avait connu à Caen et qui était passé aux royalistes, devait pendant son absence pourvoir aux besoins les plus pressants. La caisse de l’association était abondamment garnie d’ailleurs : au seul Boulainvilliers, qui se donnait du prince de Croy et qui n’était qu’un chevalier d’industrie vivant aux crochets de Mme de Forzan, Puisaye remettait pour ses troupes 50.000 livres que le coquin oubliera de leur distribuer : Guillemot l’en fera souvenir par deux balles dans le dos. Cependant il fallait un major général pour conduire les délibérations du conseil. Mais, sur les entrefaites, Prigent débarqua au Q. G. de Chantreau avec trois nouveaux émigrés qu’il amenait de Jersey : Chabron de Solilhac, le chevalier de Jouette et un inconnu qui se donnait du baron, comme Boulainvilliers du prince, pour avoir trouvé dans le douaire de sa femme, veuve du sieur de Sercy et propriétaire en Bourgogne, une terre de Cormartin. Son vrai nom était Dezoteux (Pierre-Félicité). Ancien officier de dragons, les choses de la guerre ne lui étaient pas complètement étrangères : il avait voyagé, poussé une pointe chez les insurgents d’Amérique et servi en 1791 à l’état-major de Bouillé. Un certificat en faisait foi. Ce certificat et une recommandation du Conseil des princes, qui lui avait confié de vagues missions dans les Cévennes et en Vendée, n’auraient pas suffi à le faire appeler par Puisaye à la direction, même temporaire, des affaires de Bretagne ; mais Puisaye n’était peut-être pas très soucieux de nommer à ce poste une personnalité trop en relief, comme Boishardy ; Cormartin, d’autre part, homme vif et bouillant (d’Andigné), portait beau, mettait de la passion dans tout ce qu'il disait ; il semblait enfin avoir quelque teinture de l’administration : bref Puisaye proposa Cormartin comme major général et, quelques jours après (13 septembre), en compagnie de Dufour et de Prigent, il s’embarqua sous la falaise de Saint-Briac, non sans peine d’ailleurs et n’échappant au cordon des gardes-côtes et aux chaloupes canonnières que pour tomber dans la rafale et tourne- bouler avec elle jusqu’aux Minquiers. Le secret de son départ avait-il été bien observé ? Le peu d’émotion que manifesta le gouvernement de la découverte (par le comité dinannais) du complot, auquel a été donné le nom disproportionné, semble-t-il, de Conspiration de la Cour-Porée (28 août 1794), tendrait à prouver le contraire. Peut-être était-il déjà au courant par ses espions ; peut-être en tenait-il le détail de l’Agence royaliste de Paris, ramassis d’incapables, de bambocheurs et de vendus, que manœuvrait de Venise une espèce de coupe-jarret blasonné, investi de la confiance de Monsieur, le comte d’Antraigues, amant de la Saint-Huberty, et dont la plus forte tête, avec Fontaine, son directeur, était cet abbé Brottier, catholique de profession, athée de vocation, brouillon qui eut désuni les légions célestes, disait de lui le cardinal Maury. Ca Cour-Porée est le nom d’une ferme de Saint-Helen où furent saisis la plupart des documents relatifs au complot. Ces autres, ceux qui avaient mis sur sa trace et qui concernaient des prisonniers anglais qu’on voulait faire évader, un commissionnaire manchot et boiteux, Joseph Jan, arrêté aux portes de la ville, les cachait dans la doublure de sa veste. Le public sut par eux et par les papiers trouvés à la Cour-Porée que l’armée catholique et royale était formée, prête à entrer en campagne, que ses opérations étaient dirigées par un conseil militaire qui avait à sa tête le général comte de Puisaye, qu’elle-même était divisée en six commandements principaux, savoir : Lamballe sous les ordres de Boishardy ; Locminé-Bignan sous les ordres de Boulainvilliers ; Rochefort sous les ordres du chevalier de Silz ; Fougères .sous les ordres de Boisguy ; Saint-Helen sous les ordres de Solilhac ; Guipry sous les ordres de Tromelin. La Bourdonnaye, en outre, commandait dans le Morbihan. Il était ajouté que, quelque espoir que le conseil [de l’armée chouanne] parût fonder sur la protection du gouvernement britannique, il avait cru nécessaire d’envoyer le comte de Puisaye près de ce gouvernement et des princes français. La révélation de ce complot n’en fut une que pour l’opinion bretonne. Quant au gouvernement, retenant des papiers ce qui avait trait aux cinq ou six cents prisonniers anglais de la ville, il fit vérifier les verrous et doubler la garde des prisons. Mais le reste lui parut négligeable : aussi bien l’Agence royaliste de Paris ne prêchait-elle pas le désarmement, persuadée — ou feignant de l’être — que la France, par dégoût, lassitude, reviendrait toute seule à ses rois légitimes ? Et, se conformant à la consigne qu’elle leur faisait passer à l’insu de Puisaye, la plupart des chefs insurgés ne demeuraient-ils point sur l’expectative, soit qu’ils ne pussent faire autrement, soit qu’ils commençassent d’en croire l’Agence et les bruits calomnieux qu’elle répandait sur Puisaye ? Depuis le raid que Boulainvilliers, en mai précédent, avait conduit dans les districts de Broons, Montfort, Josselin et Ploërmel, en y pillant les patriotes et en coupant les arbres de la liberté, plus une bande n’avait reparu dans les Côtes-du-Nord ; la municipalité de Broons, le 9 août, poussait l’optimisme jusqu’à déclarer que les dangers avaient été exagérés..., qu’un simple cantonnement à Merdrignac suffirait pour contenir les déserteurs réfugiés dans les forêts voisines de Bosquen et de Catuélen. De même en Maine-et-Loire, revenu de l’effroi que lui avait causé l’égorgement des cinquante hommes du poste de Combrée par un lieutenant de Scépeaux, Sarrazin, qui y trouva la mort. Jusque dans le Morbihan, au rapport de l’agent national de Josselin, les Chouans semblent vouloir éviter toute collision grave et, seulement quand on les gêne — comme à Collédo où les Bleus ont pris un réfractaire, l’abbé De Clerc, que Guillemot leur arrache —, frappent de rudes coups (Le Falher). Après la découverte du complot de la Cour-Porée, tout changea. Il apparut que cette retraite, ce silence des Chouans ne trompaient que Paris ; les villes bretonnes, elles, sous la menace directe de l’orage qui s’amoncelait, les interprétaient autrement : on eût dit que l’ombre de Quiberon se projetait par anticipation sur leurs murs-soucieux. Et cependant les événements semblèrent vouloir d’abord donner raison à Paris. C'est qu’il y avait vraiment, en haut, chez les dirigeants, quelque chose de changé. Le terrebant pavebantque de Tacite se répétait à quinze siècles d’intervalle : ces terroristes tremblaient à leur tour pour eux et, entre les restes encore redoutables du parti robespierriste et l’audace croissante de la contre-Révolution vendéenne et chouanne, ne voyaient de salut que dans le désaveu, au moins provisoire, de leur ancien absolutisme. Un Tallien, un Fouché eux-mêmes parlaient avec modération des insurgés de l’Ouest, plus égarés que coupables. On n’en eût cru qu’à moitié ces tigres bêlant des mots de clémence, mais la Convention ne s’en tenait pas aux mots : renversant toute sa politique intérieure, elle remplaçait ses frénétiques proconsuls de naguère, les Carrier, les Pochole, les Lecarpentier, raccourcis ou déportés pour n’avoir pas su retourner leur carmagnole à temps, par des missionnaires de paix, des apôtres de la réconciliation générale, comme ce Boursault-Malherbe passé des tréteaux des Variétés sur la scène plus vaste des Tuileries et qui n’avait que le tort de draper dans un verbe un peu emphatique la générosité et la parfaite sincérité de ses sentiments. Brue, Guezno, Guermeur, Bretons tous les trois et chargés avec lui de travailler à la pacification des esprits, n’étaient pas moins recommandables : jacobins sans doute, mais aux mains propres et à la conscience droite. Enfin, pour le commandement des troupes, le choix de Carnot, le nouveau ministre de la Guerre, s’était porté sur un soldat aux vues larges, plus ami des actes que des paroles et dont le programme laconique : Repousser l’Allemagne, rallier la Vendée [on enveloppait sous ce nom tous les départements insurgés] et fondre sur l’Anglais, répondait pleinement aux propres vues de la Convention régénérée : Lazare Hoche, le vainqueur de Wœrth et de Frœschwiller, détenu la veille à la Conciergerie. Il y avait été jeté par Saint-Just qui le détestait, mais lui-même, par ses délations, avait causé la perte de Colaud, de Souhan et, après Quiberon encore, il dénoncera Kléber comme un des ennemis les plus redoutables du Directoire. Il n’était pas sans tache. Il flatta Marat, il fleureta avec Barras. Marié du mois précédent à une jeune Thionvilloise de seize ans, Adélaïde Dechaux, il l’aimera, la cajolera et la trompera sans scrupules. Tout cela, c’était les mœurs du temps. En outre, une telle séduction émanait de ce beau guerrier à l’œil brun et aux cheveux bouclés ! Mais le fond chez lui était humain, généreux, dans la mesure où ces sentiments peuvent se concilier avec les exigences du métier militaire et le souci de l'avancement. Moins gêné aux entournures ou plus naïf, Boursault, dans tout le feu de son apostolat, allait jusqu’à réclamer pour les insurgés la liberté des cultes, le rétablissement immédiat des autels. Comment ne pas se flatter qu’avec de tels hommes le terrible malentendu qui divisait la nation serait bientôt dissipé ? Encore fallait-il n’avoir point affaire à des cœurs trop aigris ou à des esprits trop échauffés. Tant de sang avait coulé et qui criait vengeance ! Tant d’ambitions s’étaient révélées chez ces petits hobereaux ou ces simples paysans promus colonels, maréchaux de camp, même lieutenants-généraux et à qui le comte d’Artois prodiguait dans ses messages du cher ami ! L’amnistie accordée à tous les insurgés, les prisons ouvertes, la réquisition suspendue, l’exercice du culte toléré, sinon autorisé, les campagnes indemnisées, la signature des représentants du peuple au complet s’offrant en garantie de l’exécution du pacte de réconciliation soumis à l’agrément des chefs chouans et vendéens, ces réalités immédiates, si précieuses qu'elles fussent, compensaient-elles la perte de l’immense espérance à quoi l'on renonçait ? Chacun des intéressés se posait la question et la résolvait à sa manière : Charette et Boishardy penchaient pour l’accommodement ; Stofflet, Guillemot et Cadoudal opinaient contre. Mais les circonstances, là encore, servaient singulièrement la politique de la Convention, car celui de ses adversaires qui, en l’absence de Puisaye, devait lui opposer la résistance la plus acharnée et décider de la résistance des autres, Cormartin, fut, par une rencontre proprement inouïe, le premier et le plus empressé à recevoir ses ouvertures. L’Agence royaliste, hostile par principe à tout ce qui émanait de Londres, l’y avait sans doute incliné par un de ses agents, Duverne de Presles, que Fouché fera entrer plus tard dans sa police ; mais lui-même n’éprouvait que trop de propension à s’engager dans les voies obliques, et, pour doubler Boursault dans sa propagande pacifiste, peut-être avait-il d’autres raisons encore, dont le piètre état de ses finances. D’aucuns, comme d’Andigné, l’ont cru sincère. Et il y eut des moments où il semble l’avoir été : il avait la larme facile, mais elle séchait vite et, plus qu’une simple girouette, c’était l’homme à deux faces qui se montre dans la lettre à Puisaye du 31 décembre 1794 : Jamais nous ne traiterons. Nous allons amuser, et, malgré les obstacles réitérés qui m’entourent, je vais porter la lettre à Canclaux [qu’on pensait acheter] et lier correspondance avec Charette. Le 15 mai suivant, au lendemain de la Mabilais, il rédigera, pour les représentants, l’adresse fameuse à la Convention : Législateurs, nous avons signé la paix, nous ne devons plus faire qu’une seule et même famille, etc. 30.000 livres qu’il a touchées en numéraire, 450000 en assignats l’ont affermi dans ces sentiments pacifistes. Mais une semaine ne sera pas écoulée qu’il écrira du château de Cicé au comte de Silz et au conseil royaliste du Morbihan pour prier l’un de lui envoyer sa signature en blanc, l’autre de différer à se remettre en campagne jusqu’à l’heure du soulèvement général. Quelque pénible que soit la dissimulation, tout nous y contraint, disait la lettre. Et il poussait l’imprudence jusqu’à donner à son correspondant, sur la suscription des dépêches, ses noms et titres nobiliaires. Le mieux qu’on puisse dire, avec Guillaume Le Jean, d’un tel niais cousu dans la peau d’un Machiavel, c’est que c’est un vaniteux — ambitieux est trop beau pour lui —, qui ne voit dans le commandement d’une province qu’un uniforme à effet, dans la signature d’un traité que l’occasion de parader en musique, — après avoir passé à la caisse, — une variété nouvelle du bourgeois gentilhomme, militaire, diplomate, libertin et profitard, et, pour dernier trait, le seul Chouan de marque — ou de contremarque — que la République ait dédaigné d’envoyer à la guillotine quand elle le tint sous les verrous. Mais les représentants de la Convention, eux, Bancelin au premier rang, qui, dans les conférences préliminaires au traité de la Mabilais, dirige les débats et trop souvent flotte à leur remorque, sont incontestablement sincères, sincères jusqu’à la candeur : une volonté inébranlable de paix, de rapprochement et de réconciliation des partis, est en eux comme chez Boursault, comme chez Humbert, l’adjoint de Hoche, comme chez Hoche lui-même, si forte qu’elle leur fait fermer l’oreille et les yeux à tous les démentis de l’expérience. Boishardy peut fondre sur Jugon au petit jour, le j6 décembre, y désarmer la garde nationale, brûler les registres de la maison commune, abattre l’arbre de la liberté et s’en retourner vers sa bauge de Bréliant avec deux voitures d’effets pour la 17e brigade ; un poste peut être enlevé vers le même temps sous le fort Penthièvre, à la barbe des canonniers ; Bignan, voir le massacre d’une colonne républicaine dont Cadoudal d’ailleurs renvoya généreusement au général Josnet les onze survivants faits prisonniers ; Basset, le seul clairvoyant des représentants en mission, dans l’Ille-et-Vilaine, peut écrire, à la date du 19 novembre : Depuis deux mois, plus de deux cents patriotes [vingt et un, rien que du 12 octobre au 5 décembre dans le seul district de Fougères, presque tous fonctionnaires publics, précisera la Société populaire] ont été assassinés dans les campagnes. Plusieurs communes ont arboré le drapeau blanc et sont en pleine rébellion. Il est évident qu’un grand feu couve sous la cendre, — rien n’y fait. Et la tentative même de débarquement sur la grève du Palus, en Plouha, le 4 mars 1795, d’une escadrille anglaise chargée d’émigrés et de munitions et appuyée par 1.500 Chouans qui s’étaient retranchés derrière les douves d’une gentilhommière du voisinage, la Ville-Mario, fut impuissante contre l’optimisme d’Humbert et de Boursault : la tentative avait échoué sans doute grâce au chef de bataillon Ménage, et il est vrai que Boishardy, qui négociait au même temps avec eux, était resté étranger à cette affaire et en avait désavoué les auteurs, Tinténiac, Jouette et l’ancien douanier La Roche dit Rodrigue, dont le courage était égal à la scélératesse (Habasque). Ces tractations et les autres qui se poursuivaient sur les deux rives de la Loire avec les divers chefs insurgés aboutissaient le 17 février au traité de la Jaunaie, le 20 avril au traité de la Mabilais, accepté le 2 mai par Stofflet, qui mettaient fin officiellement à la Vendée et à la Chouannerie. A la Mabilais, dans le voisinage de Rennes, bruyante et parée comme pour une fête, où se rendaient chaque soir les membres de la conférence et où Cormartin, en braies blanches à ganse de velours noir, le Sacré-Cœur au côté, le chapelet en sautoir, paradait dans les avant-scènes de la Comédie au milieu d’un essaim de fascinantes Dalilas, vingt et un seulement des chefs chouans, sur les soixante ou quatre-vingts présents, avaient apposé leur signature au bas du papier : Cadoudal, Guillemot étaient partis les premiers, claquant les portes ; Silz pleurait d’avoir signé. Avec lui, deux encore de ces étranges signataires semblent avoir été de bonne foi : Boishardy chez les Chouans, Stofflet chez les Vendéens. Tous les autres n’ont signé que par nécessité, parce qu’ils n’ont plus ni pain ni poudre, comme Charette, et pour gagner du temps (ce sont les plus honnêtes) ou par vanité et se garnir les poches (Cormartin). Hoche, à l’écart, observait. Le jour de la signature, se promenant avec ses lieutenants Chérin et Krieg aux abords de la Mabilais, il leur fit remarquer deux bandes de corbeaux qui volaient de concert au-dessus de la ferme. Bientôt, écrit-il à sa jeune femme, elles se séparèrent ; l’une d’elles resta unie et l’autre se divisa. Bons anciens, n’eussiez-vous pas vu là un présage de ce qui doit arriver après la pacification ? Mais la Convention avait trop exulté à l’annonce de la paix vendéenne et bretonne et pour si plâtrée que fût cette paix, comme il apparut bien vite. Toute la salle, debout, battait des mains, criait : Vive la République ! C’était du délire. On est tant porté à croire ce que l'on souhaite que, malgré les avertissements qui lui arrivaient de Londres et de Bretagne, l’assemblée eût continué de faire confiance aux signataires du traité, si la lettre de Cormartin à Silz, surprise en cours de route et remise aux représentants Brue et Guermeur, ne l’avait brutalement tirée d'un songe où, depuis longtemps, elle était seule à se bercer. |