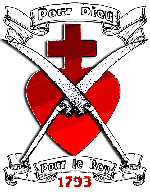LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE VI. — LA VIE SECRÈTE DE LA CHOUANNERIE.
|
MAIS le premier manifeste trouva les campagnes attentives. Si bien disposées qu’elles eussent été à l’origine pour le nouveau régime, la moisson de colères qu’y avait fait lever la Terreur arrivait à maturité dans l’instant où cette même Terreur s’affaissait dans les villes sous le poids de ses crimes : une autre Terreur s’apprêtait, celle des landes et des fourrés, aussi sanguinaire que sa sœur. Là, Puisaye n’avait pas travaillé dans le vide. Il trouvait sans doute le terrain préparé par La Rouërie. Mais, quand il n’était qu’un simple outlaw sans autorité, un Robin des bois armoricains, autour duquel les proscrits, les réfractaires, les misérables hôtes du reste de la forêt commençaient à se rallier, à s’unir en une sorte de petite fraternité militaire, c’est bien lui seul qui, sans prendre conseil de personne, leur avait donné cette organisation ingénieuse en sections de sept hommes par cabanes ou huttes, une réunion de sept cabanes formant un cantonnement, une réunion de sept cantonnements formant une division. L’heure venue de l'étendre à tout le pays insurgé, il n’aura qu’à développer et mettre au point cette organisation rudimentaire en superposant aux divisions, comme chez La Rouërie, les commandements départementaux ou grands commandements : les titulaires de ces commandements auront rang de maréchal de camp ; les divisionnaires le rang de colonel ; les chefs de canton, chargés de lever les compagnies qu’ils formeront de déserteurs réquisitionnés et de tous les habitants mécontents en état de porter les armes, le rang de major. Et c’est Puisaye encore, sinon qui créa, au moins qui rétablit, développa et parfît ces lignes de correspondance, vraie carte routière de la Chouannerie, qui, partant de divers points des côtes de la Manche à proximité de Jersey et rayonnant vers les centres insurgés et jusqu’à Paris et à la frontière, menait à destination, plus sûrement que les routes nationales, les courriers des princes, comme Prigent, et les émigrés désireux de servir à l’intérieur, comme Tinténiac. La Rouërie et Botherel en avaient établi l’esquisse et commencé de régler le système, avec Georges de Fontevieux pour premier courrier. Des amorces brûlées sur la falaise, les étincelles d’un briquet, la croix dessinée par une lanterne dans quelque creux de rocher, faisaient, la nuit, l’office de signal entre la côte et le large, qui répondait par quelque autre signal convenu. Une fois à terre et s’il avait échappé aux chaloupes canonnières, au feu des batteries, aux patrouilles de gardes nationaux, au cordon de douaniers tendu le long du rivage, l’agent des princes gagnait en rampant, derrière son guide, la première des maisons de confiance placée sur sa route et qui, avec ses caches profondes, ses issues dérobées, son personnel aux aguets et dévoué jusqu'à la mort, lui offrait toutes les garanties de sécurité : la Ville-Mario, ancienne baronnie désaffectée, près des grèves du Portrieux, le clos Huet, près des grèves de Saint-Coulomb, la métairie du bonhomme La Fluve, près des grèves de Granville.... Une, souvent deux chaînes de communication se détachaient de là dont on avait pris soin de varier les anneaux, sinon le personnel, toujours choisi parmi les gens du bon Dieu : c’était tantôt une hôtellerie de modeste apparence comme l’Hôtel du Pélican à Saint-Servan ; tantôt une vieille gentilhommière comme ce Boscénit, propriété des De Gris-Duval, tellement dérobée aux yeux par de grands bois qu’on ne l’apercevait, pour ainsi dire, qu’en la touchant (Levot) ; tantôt, au contraire, une ferme isolée et dominante comme le Roc de Bignan, tenu par la veuve Lohézic, la mère des Chouans et ses huit serviteurs des deux sexes. Mais, ferme, château, cabaret ou simple loge de sabotier, l’agent ne pénétrait dans la maison de correspondance que s’il était en possession du mot de passe, qui variait assez souvent, ou après quelque tambourinement d’une certaine espèce à la vitre, un grattement de la pierre du seuil avec la pointe du couteau. La cache, plus ou moins grande, pratiquée dans une armoire de chêne à double fond ou derrière une plaque de cheminée, contenait un peu de paille, quelquefois un lit de camp : il y dormait le jour et, la nuit venue, se coulait avec son guide vers une autre maison de confiance qui le recevait après l'échange des mêmes formalités. Arrivé à destination, il remettait ses dépêches, roulées le plus souvent dans un bâton creux. Puisaye avait été jusqu’à prévoir la création d’ambulances, de maisons de retraite à l’écart pour recevoir les blessés et les malades. Tant de précautions, pour excessives qu’elles semblent, n’étaient pas superflues par ce temps d’espionnage intense, de délations frénétiquement intéressées. Les mouches pullulaient, policières et autres. Puisaye avait donné l’exemple de la prudence en troquant son nom contre celui de comte Joseph, et il est vrai qu’il était comte et qu’il portait le prénom de Joseph. Et l’on voit bien aussi pourquoi le fidèle Frotté prit le surnom de Blondel, le souple Cormartin celui d'Obéissant, Duviquet, qui venait des Bleus, par antiphrase, celui de Constant, et Mercier, qui venait d’outre-Loire, par fierté, celui de La Vendée. Des raisons plus obscures décideront Cadoudal à s’appeler Gédéon, Guillemot Valentin, La Bourdonnais Coco, Saint-Régent Pierrot, Armand de Chateaubriand John Fall, d’Oilliamson Gabriel, Keranflec’h Jupiter, Treton Jambe-d’Argent, l’aîné des Cottereau Pierre-qui-Mouche. Et voici, derrière eux, toute la Chouannerie qui prend le masque, maquille son état civil : les déserteurs d’abord, avec leurs sobriquets rapportés du régiment, Belle-Humeur, Sans-Souci, Brin-d’Amour, Va-de-Bon-Cœur, etc., puis les réfractaires répondant aux noms de Tape-à-Mort, Court-aux-Bleus, Perce-Pataud, Bénédicité, Galope-la-Frime, Happe-Galette, voire Pille-Miche ou Marche-à-Terre, comme chez Balzac. Il n’est pas jusqu’aux insermentés qui n’aient leur nom de guerre : l’abbé Lhermitte s’appelle Lucas l’herboriste, l’abbé Corre Fanchoun, l’abbé Laya Fricandeau, l’abbé Emery Petit-Bonhomme, l’abbé Moulin Sans-Peur, etc. Il arrivera que le même sobriquet soit porté par plusieurs Chouans : ainsi Branche-d’Or, pris par quatre d’entre eux. Et d'autre fois on ne saura pas au juste quelle personnalité il recouvre : ainsi les pseudonymes de Théobald et de Pipi. La Chouannerie ne change pas de caractère en passant aux ordres de Puisaye : une guerre de clair de lune investissant les villes, coupant les routes et menée sur la bruyère au chuintement du hibou par des soldats fantômes, c’est la figure déjà connue et seulement intensifiée dans son expression, qu’elle va continuer de nous présenter jusqu’à la Mabilais. D’où la même difficulté pour la saisir, la fixer. On pense la tenir et elle échappe. Les généraux républicains, les représentants aux armées, les administrateurs, tous gémissent sur cette mobilité incroyable de l’adversaire, sur sa faculté presque fabuleuse de disparaître, de se volatiliser. Parti de bandits, écrivaient déjà sous la Terreur les délégués de la Convention : disséminés en pelotons plus ou moins forts, ils se répandent dans les campagnes, sur les routes et dans les champs. Sont-ils en nombre, ils attaquent nos postes ; sont-ils isolés, c’est à l’abri des haies qu’ils tirent leur coup de feu sur les voyageurs, et principalement sur nos soldats. Ils ont plutôt l’air d’agriculteurs que de brigands embusqués. Tel a été saisi, un hoyau à la main, qui avait caché son fusil derrière un buisson... Hoche renchérira un an plus tard : Nous voyons, dans chaque sortie que nous faisons, les sentinelles des brigands. Marchons-nous dessus ? Tout disparaît et se terre. Il ne reste aucun vestige. Tout les sert, les femmes, les enfants. On jurerait qu’ils ont des télégraphes. Un uniforme au moins les trahirait. Les Bleus ont le leur, bleu et rouge, mais où le bleu domine qui leur a valu leur nom et la chanson fameuse qu’ils entendent quelquefois corner à leur oreille : Tu portes l’habit bleu, Tu te bats contre Dieu : Maudite République !... Même en haillons, quand l’habit n’a plus ni forme ni couleur, quand la guêtre ne tient plus au soulier rattaché par des ficelles, leurs baudriers en croix, leurs briquets à poignée de cuivre, le balai de crin rouge de leurs vieux tricornes, la cadenette qui leur tape le dos et leurs longues moustaches gauloises les dénoncent à trois cents mètres. Et l’on reconnaît encore mieux les généraux républicains aux plumets de leurs bicornes, à leurs manteaux sombres sur la redingote boutonnée, à leurs écharpes tricolores tortillées en ceintures... Il n’est pas jusqu'aux gardes nationaux qui n’aient leur signalement rudimentaire dans ces pantalons rayés qui ont remplacé la culotte laissée aux ci-devant. Mais les Chouans ! Sauf les déserteurs, dont beaucoup portent encore l’uniforme de l’ancienne armée, les guêtres, la culotte, l’habit blanc ou gris à parements et à revers noirs, les autres, pareils aux premiers paysans venus du Maine ou du Morbihan, ne sauraient en être distingués à l’œil nu. Le costume des campagnes semble avoir été d’ailleurs à cette époque beaucoup moins divers qu’aujourd’hui. Dans le Maine comme dans la Cornouaille on retrouvait chez les paysans ce bonnet de laine bleue ou rouge d’où coulaient jusqu’aux épaules de longs cheveux plats ou bouclés et que remplaçait, les jours de fête, le grand chapeau à cuve, cette veste brune ou grise doublée en hiver par une peau de bique ou de mouton, ces braies courtes et larges de berlinge, nommées bragou-braz en Bretagne et dont le surnom de grandes culottes donné aux premiers insurgés léonards n’est que la traduction, ces guêtres de cuir jaune, ces jarretières de couleur tranchante, ces sabots ou ces souliers ferrés pour les longues marches. C’était là indistinctement et à quelques nuances près le costume de toute la paysantaille masculine de l’Ouest. Rien là de militaire, rien de significatif. Dans les expéditions, dans la bataille seulement, les signes distinctifs du clan apparaissent : des parements mobiles de diverses couleurs, le Sacré- Cœur accroché sur la poitrine ou porté en brassard, le chapelet à la ceinture ou au gilet, la médaille ou la statuette bénite de plomb fixée au chapeau avec la cocarde blanche. Et le porteur de hoyau de tout à l’heure se révélait le fusil de chasse au poing et la poire à poudre en sautoir. Mais que la poursuite commence, que le détachement des Bleus ou des gardes nationaux franchisse la haie et tombe sur l’assaillant embusqué derrière, tout disparaît à la seconde, fusil, poire à poudre, cocarde, amulettes, Sacré-Cœur : il n'y a plus qu’un nigous quelconque qui, à toutes les interrogations, répond par son décourageant nentenket — je ne comprends pas. Les chefs eux-mêmes n’ont pas de costume spécial. Ce n’est qu’aux conférences de la Mabilais qu’on les verra, pour éblouir les Rennaises, arborer de grands feutres à plumet blanc, des écharpes de soie blanche, des épaulettes d’or, des bottes à revers et y ajouter même, comme Cormartin, pour avoir l’air d’un vrai Chouan, le Sacré-Cœur sur la poitrine et le chapelet passé à la boutonnière. En campagne on voit Boishardy, tantôt en chasseur, tantôt en paysan, avec la veste cintrée et le chapeau à cuve l’hiver, en berlinge gris et chapeau de paille l'été, comme ses hommes. Saint-Régent est d'abord en pelisse de hussard jaune et garnie d’hermine, pantalon de peau, gilet moucheté couleur café, débris de son équipement d’officier de l’ancien régime. Et l’on peut douter, malgré la caution d’Hugo, que Beauvilliers se battait en robe de procureur, un chapeau de femme sur son bonnet de laine, mais il est certain qu’on vit plusieurs fois Carfort, pour pénétrer dans des bourgs suspects, costumé en paysanne, avec la coiffe et le jupon de droguet. Ruses de guerre qui ne trompaient que les patauds. Le seul insigne commun à tous les chefs chouans paraît avoir été la plume blanche au chapeau : dans les troupes de Boishardy, ce Pipi non identifié qui passait pour Jersyen et qui, plus probablement, d’après son surnom, diminutif familier de Pierre en bas-breton, était un petit gentilhomme du Trégorrois, n’avait pas d’autre marque distinctive de commandement dans les rassemblements qu’il présidait en l'absence de son chef. Ce n’est qu’au moment de Quiberon et plus tard, en Normandie, avec Frotté, qu’un uniforme fut porté par les Chouans : encore les bandes de Cadoudal rejetèrent-elles bien vite cette livrée écarlate qui leur donnait trop l’apparence d’un corps à la solde de l’Angleterre. Chez Frotté au moins, l’uniforme et l'équipement gardaient quelque chose de national : c’étaient la carmagnole à raies, plus un chapeau rond couvert de toile cirée jaune ou verte, une giberne, un sabre, un fusil à deux coups et des pistolets. Sur les camps ou campements chouans, il n’est pas plus facile de se faire une opinion précise que sur les costumes. Peut-on même dire que ce fussent là des camps ? Ce sont tantôt des carrières abandonnées comme les caves de Laudéan, dans la forêt de Fougères ; tantôt des souterrains de fraîche date comme ceux d’Hubert dans la forêt de Vitré, aménagés en dortoirs au revers d’une faible éminence et où l’on n’accédait qu’après avoir marché plus de cent pas dans un ruisseau (Pontbriand) ; tantôt une série d’alvéoles profondes, recouvertes de branchages et creusées derrière le rempart de quelque talus, comme à Saint-Bily (Le Falher) ; tantôt des baraques de planches, sept ou huit, avec chacune vingt-cinq couchettes, comme a Bossény (Lenotre) ; tantôt enfin — mais seulement après des razzias républicaines ou en cas d’émigration — de vrais villages sylvestres comme celui qu’a décrit Souvestre sous le nom de Placis de la Prenessaye et où cent huttes de charbonniers, dans une clairière, entouraient quelque grand chêne druidique exorcisé par les saintes images et l’autel de verdure qui s’adossaient à son tronc. Mais la plupart du temps, quand le signal du rassemblement les tirait de leurs chaumières, les Chouans ne s’embarrassaient point de tout ce luxe : la nuit venue, si le temps était propice, ils se roulaient à la belle étoile dans leur peau de bique et, au cas contraire, empruntaient le paillis ou le grenier d’une ferme voisine. Des grand’gardes, on ne prenait même point toujours la peine d’en poster ; les enfants, alertés, surveillaient les routes et, au premier bruit d’une troupe en marche, détalaient vers le camp en criant : la Nation ! Quant à la consigne donnée à ces troupes hétéroclites, si rebelles à toute discipline, mais animées du même esprit de représailles, elle variait aussi sans doute selon les heures et les chefs : un Boishardy n’a pas l’humeur féroce d’un Jean Jan où d’un Coquereau. Il semble pourtant qu’à l’heure où nous sommes parvenus elle ait été à peu près la même sur toute la ligne : Pas de quartier ! La Terreur blanche, après la Terreur rouge, que sa frénésie sanguinaire avait fini par étouffer, pour en finir plus vite éprouvait à son tour le besoin de frapper fort. Elle y était encouragée par la dépression même qu’elle sentait chez sa rivale, par les grincements qui se faisaient entendre un peu partout dans la machine révolutionnaire usée par ses excès. La réaction thermidorienne commençait : les villes, soûles de sang, de dénonciations, entrebâillaient la porte des prisons, en attendant de remiser au grenier la guillotine. Il était trop tard et il y eût fallu d’autres mesures que la clémence précaire dont elles se targuaient envers quelques suspects : le couperet restait toujours suspendu sur la tête des prêtres insermentés ; les réquisitions, le maximum et le cours forcé n’avaient pas arrêté leurs effets. Plus de transactions commerciales entre les villes et les campagnes qui, réduites elles-mêmes à la portion congrue, gardaient jalousement pour elles le peu de blé noir et de bestiaux étiques qu’elles arrivaient à soustraire aux réquisitions. On ne sait pas assez que toute la France, pendant ces années qui devaient ouvrir l’ère de la félicité universelle, mangea du pain gris et quelquefois même ne mangea pas de pain du tout : les campagnes se contentaient d’une bouillie de sarrasin, seule nourriture, à peu près connue d’elles et qui entraîna l’effroyable dysenterie des armées vendéennes obligées de se contenter de cet indigeste brouet dont elles n’étaient point coutumières. Plus de bestiaux, partant plus de cuir ; plus de fer même pour labourer le sol. Le directoire de Dinan, interprète de la détresse des communes rurales du district, gémit près de Lecarpentier sur la disette affreuse où elles se trouvent d’instruments aratoires, le fer étant mis en réquisition de toutes parts pour fournir des armes à la République... Et cependant les campagnes languissent, les terres restent incultes. A la disette du fer s’ajoute celle des bras, réquisitionnés eux aussi pour la défense des frontières : l’ensemencement du blé noir est ainsi mis lui-même en péril et l’on prévoit que, l’hiver suivant, il faudra se contenter de poisson séché, de barriques de sardines de Concarneau. Les villes en sont réduites pour se sustenter au système primitif des échanges. Port-Malo propose de céder aux Dinannais, contre tel autre aliment qui lui manque, quelques bocaux de riz, du fromage de Hollande, des carteaux de bœuf d’Irlande ; Dinan, à son tour, propose à Bécherel de lui céder contre de la farine et du blé du poisson salé, sardines, harengs. Comment la foi révolutionnaire, l’ardente conviction républicaine de naguère, eût-elle survécu à un tel désarroi ? Elle survivait pourtant, mais atténuée, ramenée à une formule plus conciliante, voisine de la formule girondine, dans les municipalités des villes et des bourgs. Et, même dans les campagnes bretonnes, on le verra, toute affection pour le régime qui a supprimé les servitudes féodales, l'insupportable tenue convenancière, n'est pas éteinte. La Révolution et nos prêtres, ce cri des municipalités rurales de l’an III traduit exactement le sentiment de l’ensemble du territoire paysan. Mais cette concession suprême, qu’il lui faudra bien faire un jour — et assez prochain — pour avoir la paix, la Révolution ne peut pas se décider à la faire tout de suite ; elle n’a plus qu’un fétichisme, mais elle y tient : elle est violemment anticléricale ou, pour mieux dire, anticatholique, anti-romaine. Le 1er mai 1795, au lendemain de la Mabilais, elle décrète la peine de mort contre tout prêtre insermenté pris sur le territoire de la République. Alors les autres concessions seront comme si elles n’étaient pas. |