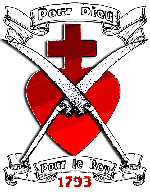LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE V. — L’ÉNIGMATIQUE PUISAYE.
|
QU’ÉTAIT-CE donc que ce Puisaye, dont on n’a fait jusqu’ici qu’entrevoir le profil perdu au cours ou au détour des événements qui viennent d’être racontés ? Peu d’hommes ont laissé l’opinion plus hésitante. Il a fini mal sans doute et peut-être n’avait-il pas commencé très bien. Mais, entre le commencement et la fin, tout est-il si méprisable chez lui ? Peut-être n’a-t-il manqué à Puisaye que d’avoir su s’ensevelir dans son désastre : on eût mieux mesuré de quelle hauteur il était tombé ; on eût vu autre chose en lui qu’un mauvais Talleyrand de guerre civile, comme l’appelle Guillaume Le Jean, qui, pour atténuer ce que cette définition pourrait avoir encore de trop flatteur, s’empresse d’ajouter : égoïste, immoral, à genoux devant l’Anglais qui l’humilie, à genoux devant l’insurgé qui le méprise, c’est l’intrigue dans toute sa rampante stérilité. Non. Et d’abord c’est à Puisaye, pour dégager tout de suite un de ses principaux mérites, que la Chouannerie a dû de lier ses mouvements jusque là désordonnés. D’armée catholique et royale de Bretagne, il n’en existait avant lui que sur le papier. Des coups de main héroïques exécutés par des bandes aussitôt dispersées que formées, et surtout du brigandage, des pillages de diligences et de caisses publiques, tout un sinistre répertoire d’attentats individuels, c’était jusqu’à lui la Chouannerie. Il ne parviendra peut-être pas à la discipliner complètement ; il ne lui ôtera pas — elle en fût morte — son caractère de guérilla : il lui infusera cependant un sang nouveau par l’apport continu d’émigrés qu'il fera entrer dans ses rangs, tel que cet indomptable Frotté attendu par la Normandie pour se joindre au mouvement ; il lui assurera surtout, par Foudres, les crédits, l’argent, les munitions qui lui manquent et — chose plus difficile — la coopération même de la flotte britannique sous les canons de laquelle s’opérera le débarquement de la grande armée régulière dont il va bientôt presser la levée à Portsmouth et qui, unie aux bandes chouannes, ne peut manquer de tout balayer devant elle jusqu’à Paris. Mais la fortune, qui servit tant de fois Puisaye, lui fut infidèle aux heures décisives. Ferme dans ses vouloirs, il l’était moins sur les principes : député du Perche à l’Assemblée constituante, il avait incliné presque tout de suite vers le tiers, avec la minorité orléaniste de la noblesse ; sous la Terreur on l’avait vu fédéraliste, associé au général de Wimpffen et lui prêtant la main pour la formation de cette ridicule armée de carabots à tête de mort dont lui-même portait les macabres insignes sur sa manche. Romantisme polonais d'avant la lettre. Vernon, ou plutôt Pacy-sur-Eure, dénommé la bataille sans larmes, parce que les deux armées en présence trouvèrent le moyen de n’y pas perdre un homme, vit la déroute de ses illusions girondines. Après quoi, condamné à mort, sa tête mise à prix, mais les poches heureusement garnies des diamants de Mme de Puisaye et du bon argent sonnant et trébuchant que lui avaient rapporté la vente de ses propriétés du Perche et le remboursement de sa charge d’exempt de la Garde du Roi, il n’eut cure provisoirement que de se dérober aux embrassades de Louisette, comme on appelait la guillotine. Les fourrés de Bretagne n’étaient pas loin : il s’y jeta avec un de ses officiers d’ordonnance, le colonel Le Roy, et son médecin, le dévoué Joseph Focard, erra quelque temps de couvert en couvert, marchant la nuit, dormant le jour, poussa jusqu’à Ploërmel, revint sur ses pas et, finalement, sur la lisière du Maine, dans la forêt du Pertre, découvrit sous le taillis une loge abandonnée où il se glissa. La forêt semblait déserte. En réalité c’était une ville, — une ville souterraine. Il y avait aux environs de la loge de Puisaye trente, cinquante tanières semblables à la sienne et dissimulées comme elle à ras de terre. Le prestige naturel de Puisaye eut vite fait de l’imposer à leurs tremblants locataires, des insoumis pour la plupart, quelques nobles, des prêtres réfractaires, vivant de racines les jours où chômait la main charitable, féminine le plus souvent, qui les ravitaillait clandestinement d’une ferme voisine. Il les rassembla, leur montra les avantages d’une formation défensive en sections, cantonnements, divisions. Mais lui-même ne se découvrit point à eux tout de suite. Sans doute l’Assemblée constituante ni Vernon n’étaient des titres à la confiance de vrais royalistes ; son nom disparut de l'affiche : il y eut simplement, dit Lenotre, le comte Joseph — comme il y avait l’archiduc Charles — et ne dit-on pas bientôt dans son entourage, ne laissa-t-il pas entendre peut-être qu’il était de sang royal, apparenté à la famille de la reine ? — Cet homme avait dû méditer profondément Machiavel et Retz : il avait appris d’eux qu'il n’est pas de petits moyens pour intéresser la crédulité des masses et qu’un certain cabotinisme y est autant de mise et plus opérant peut-être que le mérite personnel. Tout le sert dans ce nouveau rôle : sa prestance, sa taille colossale jusqu’à le faire paraître un peu dégingandé, son verbe assuré, le mystère même de son origine. Parmi les réfractaires bretons et les traîneurs vendéens qui se pressaient de plus en plus nombreux autour de lui, attirés par sa légende ou séduits par ses largesses, se trouvaient deux anciens affidés de La Rouërie, les frères de Legge, l’un naguère capitaine au régiment de Brie, l’autre curé sans cure. Sont-ce eux qui l’entretinrent de la défunte Association bretonne, qui l’initièrent au détail du vaste plan dressé par son auteur pour mettre toute la Bretagne sur pied ? Ou bien le plan, assez semblable, que lui-même allait ébaucher, lui fut-il inspiré, comme le veut Beauchamp, par les propos d’une jeune pastoure vaticineuse : Dieu est avec vous.... Un temps viendra que vous vous défendrez. Il ne sera pas
permis que les Républicains soient toujours les plus forts.... Les prophètes sortaient de terre par douzaines en ces époques de fièvre et de sang. On baignait dans le surnaturel : des lettres de Jésus-Christ circulaient ; la Vierge apparaissait dans le Goëlo, saint Michel à Bothoa. C’était généralement pour annoncer la fin du monde ou, tout au moins, comme Jean Bannier, le Voyant de Carou, en Saint-Brandan, que Boishardy recueillera dans ses bandes, toutes sortes de calamités prochaines. La pastoure de Puisaye avait l’avantage de parler un langage optimiste et qui s’accordait parfaitement aux désirs secrets de son interlocuteur. Frappé de ses paroles comme d’un horoscope personnel, Puisaye, dès ce moment, ne s’occupa, selon Beauchamp, que de la pensée et des moyens de devenir chef de parti. Il s’en entretenait sous le taillis avec Focard ; c’était le thème, presque obsédant, de leurs conversations habituelles. Et Beauchamp de s’étonner, d'admirer même, — étonnement, admiration qui se communiqueront après lui aux historiens les plus prévenus contre Puisaye. Deux hommes isolés, proscrits, ne pouvant se montrer en plein jour au milieu d’un pays qui leur est inconnu et où ils sont étrangers à tous ceux qui l’habitent, sans munitions, sans armes, sans coopérateurs intelligents, forment à eux seuls le dessein de lever une armée et d’attaquer les forces d’un ennemi qui tient à sa disposition les ressources de l’empire le plus puissant de l’Europe, n'est-ce point là en effet de quoi frapper l’imagination, et les hommes ou plutôt l’homme qui avait conçu un projet si ambitieux, si démesuré, si pertinemment supérieur à ses ressources, peut-il être donné pour un intrigant vulgaire, surtout s’il arrive à faire de son rêve une réalité ? En moins d’une année, neuf mois exactement, il y parvint. Et à travers quels obstacles ! Précisément, à l’heure où il prétendait à la direction des affaires de Bretagne, Monsieur désignait le marquis du Dresnay pour succéder à La Rouërie en qualité de commandant en chef — purement théorique, d’ailleurs, avec Q. G. de tout repos à Jersey, — mais commandant en chef quand même, de l’armée catholique et royale. Dès ses premiers pas, Puisaye, inconnu de la petite cour de Vérone, suspect en outre à l’Agence de Paris, se voyait couper l’herbe sous le pied. Mais qui diantre se fût avisé à cette époque de lui croire le pied si hardi ? Hors du district forestier qu’il s’était taillé en Ille-et-Vilaine et qu’il faisait administrer par un conseil d’ecclésiastiques et de laïcs à sa dévotion, son crédit était si faible que Boisguy avait hésité à déférer aux demandes d’entrevue qu’il lui faisait porter. Et à supposer que l'entrevue eût eu lieu et que Puisaye y eût démasqué son personnage et l’ambition qu’il nourrissait de commander aux chefs bretons, une telle prétention chez cet aventurier étranger à la Bretagne et à peu près dénué de tout, sauf d’écus et de toupet, n’eût pu manquer de faire sourire Boisguy, comme elle eût fait sourire Boishardy, Silz ou le vieux Francheville. Hugo se trompe qui croit que, dans les mouvements de ce genre où tous se jalousent et où chacun a son buisson ou son ravin, quelqu’un de haut qui survient rallie instantanément ces petites vanités. Les dernières années du XVIIIe siècle avaient été marquées dans la noblesse bretonne par une recrudescence de l’esprit féodal, le plus ennemi qui soit de toute autorité. Mais, sur les entrefaites, vers la fin de décembre 1793, Puisaye, sans qu’on sache bien exactement par quel concours de circonstances romanesques, fut mis en possession de tout un lot de dépêches qu’apportait d’Angleterre aux chefs de l’armée royaliste un ancien agent de La Rouerie, coutumier de ces traversées téméraires, Noël Prigent, lequel avait pris terre près de Saint-Malo le 2 décembre précédent. Prigent expliquait, dans la lettre jointe au paquet, qu’après avoir employé tous les moyens imaginables pour parvenir jusqu’aux dits chefs et n’ayant pu se procurer de guide, ne sachant même où se trouvait l'armée royale depuis son échec devant Granville, il avait dû rester en route avec ses dépêches. Son désarroi était grand. A qui recourir ? Quelqu’un — peut-être son compagnon Bertin — lui nomma Puisaye et, sans bien examiner s’il était le plus qualifié sur place des chefs royalistes, il lui fit tenir ses dépêches. Tout cela sent fort l’intrigue. De quelque façon que les choses se soient passées — et l’on peut être sûr tout au moins que Prigent, qui n’était pas encore un traître et qui en aucun temps ne fut un sot, n’aurait pas remis ou fait remettre ses dépêches au premier venu, — elles tournèrent à l’avantage de Puisaye qui, sans s’arrêter davantage à la suscription du paquet, passa illico au dépouillement de son contenu — une déclaration de S. M. B. aux Français, une lettre du secrétaire d’État Dundas, une autre du capitaine J. N. Cray, commandant de Guernesey, une quatrième de milord Balcaras, commandant de Jersey, avec le double de la lettre du même à milord Moyra, commandant en chef les troupes d'Angleterre, le tout certifié authentique par le marquis du Dresnay — et y fit réponse comme s’il en avait été l’unique destinataire. Mais, en vérité, d’où lui seraient venus ses scrupules ? Qui donc, en dehors de lui, avait l’envergure, le large et compréhensif esprit que réclamait la situation ? Qui était capable de rassembler les fils noués par Fa Rouërie, de manœuvrer les coulisses de ce réseau d’intelligences, de sourdes complicités, que son prédécesseur avait étendu sur toute la province et que lui-même s’occupait activement de raccorder ? Cadoudal ne s’était pas encore révélé et le fédérateur, le généralissime, ne pouvait être ni Boisguy, cet enfant, ni Boishardy, ce coureur de lièvres et de cotillons. Donc autant lui, et même lui plus qu’un autre. Sa réponse, transmise dans la quinzaine par Prigent, qui se vantait d’avoir des bateaux à ses désirs, fut d’ailleurs la plus sage du monde : le gouvernement de S. M. B. protestant de la constance de sa sympathie à l’égard des tenants de la restauration monarchique en France et de sa ferme intention de leur venir en aide aussitôt qu’ils se seraient rendus maîtres d’un port de la côte, Cancale de préférence, Puisaye prenait acte de ces offres séduisantes, mais il demandait qu’on lui permît, avant d’y recourir, d’avoir terminé son organisation. Elle était en effet fort embryonnaire à cette époque. Mais il n’était pas nécessaire d’en prévenir le ministre à qui le compère Prigent présenterait les choses sous le jour le plus opportun. En outre, comme Puisaye était l’inventeur d’un ingénieux système de dépréciation des assignats révolutionnaires, très supérieur à celui de Calonne, dont il fit part — cette fois-là ou une autre — à lord Dundas et qui consistait à leur opposer des assignats royaux fabriqués à Londres et exactement semblables en apparence, mais que distinguait pour les yeux avertis un signe secret rendant possible leur remboursement en numéraire à la paix, il acheva par cette suggestion de se concilier les bonnes grâces du gouvernement britannique. Il ne lui restait plus qu’à se concilier celles des différents chefs qui s’étaient levés en Bretagne pour la défense du trône et qui n’étaient point hommes à lui accorder leur confiance sans examen. La vue des dépêches expédiées de Londres, le titre qu’il y portait et qu’il soutenait avec tant d’aisance, grâce à ce magnétisme secret des esprits supérieurs qui donne tant de force à l’imposture, commencèrent de les disposer favorablement ; l’exemple de Forestier, de Jarry, de Duperrat et des autres chefs vendéens, que Le Roy, chargé de travailler le district de Redon, lui avait amenés de la forêt de Gavre et des roseaux de la Vilaine où ils se cachaient, fit aussi sur eux une très vive impression ; mais sa meilleure caution fut encore ce jeune et ardent chevalier de Tinténiac, qui s’était donné à lui avec cette frénésie de dévouement dont il essayait de racheter ses erreurs passées. Tinténiac appartenait à l’une des plus vieilles familles bretonnes ; il avait pris pour devise : un chef et de la poudre ! Il l’allait clamant partout ; sa propagande, ses protestations enflammées rallièrent à Puisaye les derniers dissidents. Par lui enfin la Chouannerie eut une tête. Assuré du concours de ces chefs expérimentés, fort de l’autorité qu’ils lui avaient reconnue, Puisaye put alors se tourner vers l’Angleterre, pivot de son action, et cependant, avant de s’embarquer, lança ses deux manifestes. Le premier, du 26 juillet 1794, qui était une adresse aux finançais et qui portait la signature de quarante-cinq généraux et officiers royalistes, s’ouvrait par un bref rappel du passé ; il y était dit ensuite que les circonstances terribles qui agitaient le pays ne permettaient plus à personne de demeurer incertain et flottant entre la scélératesse et la vertu. Donc obligation pour tous et particulièrement pour les Bretons de se rallier aux drapeaux de la religion et du roi. Seraient réputés rebelles et traités en conséquence ceux qui refuseraient d’obtempérer ; item toute ville, bourg ou village dont les habitations seraient abandonnées à l’approche des troupes royalistes ; item tout receveur ou payeur de la République qui ne mettrait pas ses fonds à la disposition des dites troupes. Le second manifeste, signé des mêmes noms et lancé le 20 août, commençait, lui aussi, par un appel pathétique aux soldats républicains que l’on conjurait de se rallier aux troupes royales. Car enfin n’était-on pas les uns et les autres des Français, des frères ? Or, continuait le manifeste, qui l’a provoquée, cette guerre atroce que nous nous faisons journellement ? Qui sommes-nous et pourquoi nous battons-nous ? D’un côté une République monstrueuse, une assemblée imbécile, des soi-disant représentants aussi ridicules qu’ils sont féroces. De notre côté le respect et l’honneur des propriétés, la liberté des individus — et aussi les gratifications, les soldes régulièrement payées, la possession des grades, l’amélioration des retraites, tous les avantages, toutes les sécurités que l’ingrate République refusait à ses partisans. Inauguré sur le mode patriotique, l’appel aux soldats républicains s’achevait, assez bassement, sur la promesse d’une prime à la désertion. Il ne fut entendu que par la racaille. |