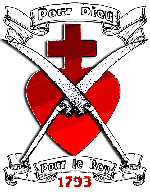LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE IV. — LA TERREUR ROUGE.
|
LE péril passé, l’entente cessera. Mais au 1er janvier 1794, huit jours après la clôture de l’effroyable hallali d’hommes, de femmes, d’enfants qu’avait été, du Mans à Savenay, la poursuite de l’armée brigandine, cette entente dure encore ; l’apaisement s’est fait un peu partout en Haute et Basse-Bretagne, sauf sous quelques fourrés, dans les trous de carrière, que hantent les contumaces, les prêtres insermentés et les derniers réfractaires auxquels vont se joindre les débris de la petite et de la grande Vendée. Moins d’une année pourtant nous sépare du mouvement protestataire de mars 93, si promptement et si durement réprimé. Cadoudal lui-même, après l’échauffourée d’Auray où il ne joua qu’un rôle insignifiant, n’avait pas cru devoir se soustraire plus longtemps à la réquisition. Que ne l’avait-on expédié aux frontières ! La sottise fut de le diriger sur la Vendée et dans le moment où les hostilités prenaient un caractère particulièrement atroce. Entre Bonchamps et Rossignol, le héros magnanime et l’ancien septembriseur, comment hésiter ? Cadoudal déserte, passe aux brigands et fait si bien, au cours de la marche sur Granville, qu’il force l’admiration du difficile Stofflet : — Si un boulet n’enlève pas cette grosse tête, je vous jure qu’elle ira loin, disait Stofflet. Elle roulera en effet jusqu’à la place de Grève : d’ici là, avec les autres rescapés mainiaux et bretons du désastre vendéen, Cadoudal reprend la route de son village et, six mois durant, ne cherche qu’à s’y faire oublier, ne demande peut-être lui- même, au début, qu’à oublier.... Car il n’eût dépendu que de la Convention, et pour la Bretagne tout au moins, de changer en paix définitive cette trêve patriotique de quelques semaines. Mais la Convention, les clubs, la populace des faubourgs ne se connaissaient plus : après la Vendée et la Bretagne, Lyon, Marseille insurgés, Toulon livré à l’amiral anglais Hood, Landau bloqué par les Autrichiens, Dunkerque par York, Cambrai par Cobourg, la concordance et la gravité du péril intérieur et du péril extérieur, la misère, la faim avaient fait descendre une brume de sang sur les esprits. Juste le jour où la Gironde succomba — sans avoir combattu — à Vernon (13 juillet 1793), Marat expirait dans sa baignoire sous le poignard, non émoussé celui-là, d’une adepte normande de cette même Gironde, Charlotte Corday, descendante du grand Corneille. Morte la bête, mort le venin, pensait Charlotte. Erreur. Les restes de Marat, pleuré comme un dieu, sont transportés au Panthéon ; Marat est plus puissant, plus agissant, mort que vivant ; le 5 septembre au soir, quand Barère monte à la tribune pour demander que la Terreur soit placée à l’ordre du jour, c’est proprement à l’installation officielle de la doctrine et du culte maratiste que nous assistons. Pour desservir ce culte, entre Robespierre, qui se réserve, et Danton, qui s’efface, qui commence d’incliner vers la modération depuis son mariage religieux clandestin avec Louise Gély béni par un réfractaire breton, l’énigmatique abbé de Keravenan — le même dont Cadoudal demandera l’assistance à l’heure du supplice —, il y a, en haut, dans les clubs, Billaud-Varenne et Collot d’Herbois ; en bas, dans les départements, Fréron, Saint-Just, Barras, Le Bas, Fouché, vingt autres représentants en mission plus obscurs, mais aussi sanguinaires ; en Bretagne Jeanbon Saint-André, Prieur, Pochole, Lecarpentier, Carrier, qui les passa tous en froide férocité : ce n’est pas la hyène hystérique qu’on a dit, ou bien cette hyène voyait singulièrement clair dans sa haine contre le négociantisme et s’acheminait, par des voies obliques, mais sûres, vers une sorte de communisme atténué, le régime de l’égalité des fortunes dans l’universelle médiocrité. Mais enfin la Terreur n’atteignit pas le même degré de frénésie sur tous les points du territoire breton. Dans les cyclones les plus violents, il y a des zones réservées : là où la guillotine chôme, le fusil de chasse et la fourche restent volontiers au râtelier. Bile ne chôma pas assez à Laval, Rennes, Fougères, Brest, Vannes, Auray, Lorient, Saint- Malo, etc., même dans de simples bourgades comme Ernée (38 exécutions), sans parler de Nantes, comblé véritablement par son proconsul qui, pour aller plus vite, lui adjoignit la baignoire nationale, les noyades collectives dans la Loire, par le moyen d’ingénieux bateaux à soupapes, mobilisa dans les prisons jusqu’au typhus et à la peste bubonique. L’excuse d’un Carrier, s’il en pouvait invoquer une, est l’insuffisance de la loi des suspects, la grande loi terroriste, égale à la grandeur du péril, mais aux possibilités d’application intégrale de laquelle ses auteurs n’ont pas pourvu. Par le jeu ou l’extension arbitraire du jeu de cette loi qui, suivant l’expression d’Hugo, faisait la guillotine visible au-dessus de toutes les têtes, tout citoyen, et jusqu’aux femmes, aux enfants, avait en lui l'étoffe d’un suspect, autrement dit d’un condamné à mort : étaient suspects, non pas seulement les ci-devant nobles, les fonctionnaires destitués, tout partisan, convaincu ou supposé, de la royauté ou du fédéralisme, quiconque même ne justifiait pas de l’accomplissement de ses devoirs civiques, mais encore les proches, les domestiques, les familiers de ces malheureux, les riches, les gueux, les sots, les gens d’esprit, les infirmes et les trop bien portants, les maris ombrageux et les femmes sans complaisance, le citoyen Bodinier, pour avoir été l'ami du girondin Defermon, le citoyen André pour avoir déchiré, étant ivre, un assignat de 50 livres, le citoyen Chanu pour avoir dit à la sentinelle, sur les remparts de Saint-Malo, qu’il y avait là plus de canons que d’hommes, le citoyen Blanchard pour détention d’armes offensives, lesquelles consistaient en trois carquois remplis de flèches et trois grands arcs dorés à la chinoise, la citoyenne Hervé pour avoir donné du Messieurs aux membres du département, la citoyenne Saliou pour n’avoir manifesté aucune opinion sur les principaux événements de la Révolution, la citoyenne Benazé pour avoir lu une lettre qu’elle ne devait pas lire, la citoyenne Kergrist pour être aussi spirituelle que son mari est simple.... C’est la moitié, les deux tiers de la France à raccourcir, et le rasoir national, si bien affilé soit-il, n’en viendrait pas à bout. D’où la nécessité de lui trouver des substituts plus expéditifs. — Il suffit, dit à Port-Malo (ex-Saint-Malo) Lecarpentier, que nous restions dans cette commune 3.000 bons sans-culottes. Et elle compte 11.000 habitants ! Quel espoir d’autre part pour les prévenus ou susceptibles de prévention d’échapper aux mailles d’un filet aussi étroitement lacé, noué, serré ? L’intervention d’En-Haut, le recours à une Providence bénévole ? On venait de décréter l’athéisme. C’était bien la peine d’avoir mis le pays à feu et à sang pour l’adoption d’une Constitution civile du clergé répudiée par la Révolution elle-même ! Fini de la distinction entre les deux clergés, les assermentés et les insermentés, les juroux et les réfractaires : si les assermentés ne déposent pas leurs lettres de prêtrise et ne se marient pas dans la quinzaine ou le mois pour bien attester leur libération des liens du fanatisme, on leur appliquera le même traitement qu’aux insermentés. L’évêque Le Coz, qui s’honore le premier par sa résistance et que Lecarpentier fait enfermer au Mont-Saint-Michel, connaîtra dans cette Bastille marine des rigueurs épargnées par l’ancien régime à son légendaire prédécesseur La Balue ; les autres récalcitrants moisiront un peu partout dans les geôles des directoires. Seul des prélats constitutionnels bretons. Minée se soumettra, prendra femme et finira, dans quelque rue Mouffetard, épicier. Plus de dimanche, de fêtes chômées, de semaines, de calendrier romain : à leur place le calendrier révolutionnaire et ses mois aux noms idylliques, floréal, germinal, fructidor, messidor, etc., divisés en trois décades, le décadi substitué au dimanche, l’histoire du monde commençant à l’an I de la République une et indivisible. Plus de saints, dont le nom seul blesse également l'œil et l’oreille du républicain : à leur place, des fruits, des légumes, les ingrédients d’un de ces solides pot-au-feu disparus de la consommation publique, depuis que le monde est entré dans l’ère de la félicité universelle. Plus de Dieu : à sa place la Raison, sous la forme de quelque gourgandine dépoitraillée paradant sur les autels. Et qu’on n’essaie pas de biaiser comme à Solidor (ex-Saint-Servan) où, pour sauver l’image de la ci-devant Vierge, de bonnes âmes imaginent de la décorer aux couleurs nationales en la baptisant Liberté : Lecarpentier décrète que toutes les statues et niches seront employées à la fabrication du salpêtre. Déjà Rouyer-Guermeur entre à cheval dans les églises du Finistère ; bientôt on rasera ces monuments de la superstition, comme dit le citoyen La Vallée, ou on en fera des granges à foin, des ateliers à salpêtre. En attendant, on les saccage : à Tréguier (mai 1794), une chienlit ignoble, les 800 tape-dur du bataillon d’Étampes, après avoir brisé le tabernacle, les stalles merveilleuses, le tombeau de saint Yves, chef-d’œuvre de l’art ogival, parcourt les rues en habits sacerdotaux et conduit un enterrement simulé au milieu de chants obscènes ; à Montagne-sur-Odet (Quimper), le jour de la fête patronale du ci-devant saint Corentin (12 décembre 1793), l’infâme Dagorn, à la tête du bataillon de Loir-et-Cher, entre dans la basilique, brise l’autel à coups de hache, s’empare du calice et, à la face du peuple, le souille de ses propres ordures qu’il répand ensuite sur les degrés (Ch.-M. Laurent). La campagne la plus soumise frémit, serre les poings, au récit de ces sacrilèges dont elle est quelquefois — Broons, Trémorel, Runan, Saint-Isle, etc. — le témoin horrifié jusque dans ses propres sanctuaires. Gare après cela au patriote assez imprudent pour se risquer seul sur les routes entre chien et loup ! Gare à l’acquéreur de biens nationaux, surtout de biens cultuels ! Et ce ne sera pas impunément non plus que le dernier prieur de Bégard déposera ses lettres de prêtrise pour épouser une clarisse de Dinan ; quelque soir un canon de fusil s’introduira par l’ouverture du contrevent et le couchera aux pieds de sa légitime. Représailles isolées, qui se multiplient cependant, qui commencent d’inquiéter les administrateurs, mais dont la répression en somme est moins du ressort de la troupe que d’une gendarmerie un peu énergique. Ht la preuve en est que, si les campagnes frémissent, si même l’indignation, la colère y déterminent maints attentats individuels, dans l’ensemble elles ne bougent pas de toute la Terreur, soit qu’en effet elles fussent terrorisées, soit que le cuisant souvenir de la dure répression de mars 93 les eût induites à la prudence, soit plutôt qu’après la magnifique preuve de civisme qu’elles venaient de donner à la Nation en marchant contre les Vendéens, elles répugnassent à lui fausser compagnie pour faire le jeu de ce qui restait de ces mêmes Vendéens. Dans l’extrême Est seulement de la région insurgée — le bassin supérieur de la Vilaine, l’Anjou chouan, le Bas-Maine, le Bocage bas-normand —, pays d’origine de la Petite-Vendée et vers qui elle refluera naturellement quand la Grande Armée battra en retraite — d’où la rigueur particulière de la répression dans cette contrée —, on constate dès le milieu de février 1794 une fermentation assez vive, voire un retour, comme à Mellé, dans la nuit du 14 au 15, à la pratique des coups de main collectifs. Mais c'est là, malgré l'apparence, de la défensive plus que de l’offensive : les intéressés se rendent bien compte que dans ces campagnes qui ne leur sont que partiellement acquises, où nombre de municipalités travaillent à les perdre, ils n’ont qu’un moyen de mater les haines, de museler la dénonciation, qui est de les devancer en leur courant sus. Il s’y ajoute, dans le Maine, des raisons d’ordre historique et économique : nous sommes céans au berceau même de la Chouannerie, fille imprévue de la faux-saunerie qui s’exerçait à main armée de père en fils et donnait du pain à plus de vingt mille familles ; la Chouannerie sera un gagne-pain, comme la faux-saunerie. Ils appellent cela travailler, dit Beauchamp. Mot révélateur du métier qu’est pour eux la guerre, tout au moins le genre de guerre qui a pris d’eux son nom. Rohu l’entendit pour la première fois, ce nom, en Basse- Bretagne, sur la côte, au cours de l’hiver 1794-1795. De Chouans, dans le Maine lui-même, il n’y en avait d’abord qu’au bois de Misedon, paroisse d’Olivet, près de Laval, où c’était le sobriquet de deux des quatre frères Cottereau, peut-être d’un seul d’entre eux, le plus fameux, Jean Chouan, car on désignait plus communément René Cottereau, dit le Chouan sur l’état de 1814, par le sobriquet de Faraud. Et il se peut aussi que le mot Chouan vienne du nom donné au chat-huant dans les campagnes de cette partie de la France. Comme cet oiseau nocturne, dit d’Andigné, les premiers insurgés ne paraissaient que la nuit ; ils passaient le jour dans les bois et imitaient, dit-on, pour se reconnaître, le cri de ces animaux. Les faux-sauniers l’imitaient déjà et en avaient fait avant eux un signal d’alarme ou de ralliement. Mais, en Bretagne, c’est le cornet à bouquin ou korn-boud, la trompe d’appel à la soupe, qui sonnera les rassemblements. L’origine du mot reste donc indécise. Comment se généralisa-t-il ? Est-ce son pittoresque qui le fit étendre de Jean Cottereau à ses compagnons de guerre, puis à tous les insurgés de la rive droite de la Loire ? Est-ce l’audace déployée, dans leurs coups de main, par les premiers Chouans ou la nouveauté de leur tactique de chasse ou son caractère intéressé, voisin de la piraterie ? La nuit a leurs préférences, mais ils opèrent aussi le jour, quand la nécessité les presse. Un convoi, une diligence, est signalé venant de Laval ou de Mayenne. Soudain une chouette hulule sous le couvert. Quoi ! une chouette en plein midi ? D’autres que ces gardes nationaux fanfarons ou ces grenadiers en ribote dresseraient l'oreille. Nouveaux chuintements plus rapprochés et qui semblent se répondre. Le convoi poursuit son train de sourd : parvenu dans quelque bas de côte propice, au tournant d’un pont, au coin d’un bois, il est pris entre deux feux de salve tirés de derrière les talus et qui couchent à terre une partie de l’escorte. Le reste se débande, abandonnant le convoi. On n’a rien vu, on n’a entendu qu’une chouette sous la feuillée et, presque aussitôt, le roulement de la fusillade. C’est là, peut-on dire, schématisé, le coup de main type des Chouans, susceptible d’une infinité de variantes, mais où l’on retrouve toujours les mêmes éléments de mystère, de surprise et de pillerie. La Rouerie, on le sait, avait tout de suite distingué les Cottereau : François, qui fut un de ses agents de recrutement les plus actifs ; Jean, né à Saint-Berthevin (Mayenne) le 30 octobre 1757, rusée caboche de contrebandier, blond, membru, à grosses jambes, mais singulièrement agiles, rompu par sa lutte continuelle avec la matelote à toutes les formes de l’embuscade, arrêté pour meurtre sous la monarchie et relaxé faute de preuves. On peut ne pas porter la Gabelle dans son cœur et rester, comme Jean Chouan, un fervent catholique, même un fidèle sujet du roi. La Rouërie en jugea ainsi et le nomma sous-lieutenant ; la Révolution mit sa tête à prix ; l’armée vendéenne, en marche sur Granville, l’accueillit dans ses rangs, avec sa mère, qui périra écrasée dans la déroute, et les deux ou trois centaines de peaux de biques râpées qui composaient ses troupes. A la dislocation de l’armée, après la bataille du Mans, les quelques survivants de cette phalange barbare reviendront se terrer avec Jean et ses frères dans les bois d’Olivet d’où ils sortiront la nuit pour tendre des embuscades, piller les caisses publiques, fusiller les agents du directoire et les métayers douteux, couper les communications avec la ville par des tranchées et des abatis d’arbres, et c’est alors aussi que le nom de Chouans gagnera, remplacera peu à peu dans le public celui de brigands qu’on donnait indifféremment jusque-là aux insurgés des deux rives de la Loire. Le 23 février 1794, une lettre de la municipalité de Louvigné (Ille-et-Vilaine) signalait au Comité de surveillance l’apparition d’une horde de scélérats connus sous le nom de Chouans, ce qui semble l’indice que le mot était encore peu répandu, bien qu’employé par Beaufort dans un rapport du 6 janvier de la même année au président de la Convention. — Citoyen, dira un peu plus tard, à la Mabilais, un représentant du peuple au chevalier de Sainte-Gemmes — le futur d’Andigné —, vous avez pris un nom bien ignoble. — Nous l’anoblirons, répondit Sainte-Gemmes. Les chefs chouans des Côtes-du-Nord introduiront même les chats-huants dans les armoiries parlantes de leurs sceaux. Et d’autres survivants de la Petite-Vendée, d’autres petits chefs de bandes revinrent en même temps que les Cottereau, après Le Mans, Ancenis ou Savenay, retrouver leurs fourrés du Maine-et-Loire, du Bas-Maine, du Cotentin, du Fougérois, du Vitrelais : Moulins, ci-devant commis des fermes et ennemi de Jean Chouan, dans les bois de Concise ; Treton, dit Jambe-d’Argent et qui avait simplement une jambe plus longue que l’autre, dans les bois de Quelaines ; aux environs de Châteauneuf, l’ainé des Cottereau, Joseph, un ancien toilier, très brave, mais féroce, brûlé d’alcool, le boucher des Bleus, comme Westermann était le boucher des Vendéens — son frère Louis, qui le remplacera après sa mort, vaudra mieux et n’y aura pas de peine — ; dans la Chamie, près Sainte-Suzanne, Louis Courtillé, dit Saint-Paul, au parler doux, vingt ans, bâtard et commandant la sinistre bande de la Vache-Noire ; autour de Domfront et de Mortain, Moulin et La Roque-Cahan qui prépareront le terrain à Frotté ; Blouin-Duval dit Croco, la terreur de l’Avranchin ; Billard de Veaux, un Cyrano louche, Douéry d’Ollendon, un illuminé, dans le Bocage et le pays d’Auge ; sur la lisière vitréenne de la forêt du Pertre, le modeste et digne Hubert, déjà nommé, qui s’y était pratiqué une cache souterraine, véritable place d’armes où pouvaient tenir 80 personnes ; Aimé de Boisguy surtout, dans les parages de Fougères, d’où il a commencé par retirer sa mère et sa sœur pour les mettre en sûreté chez des amis bas-normands. Après quoi il reprend avec son frère sa vie précaire dans la brousse. Si précaire, si exposée soit cette vie, il se trouve pourtant des nouveaux venus qu’elle tente, des émigrés pour la plupart, Tinténiac, Bouteville, Saint-Gilles, Baillorche, vingt, cent autres : las de leur faction stérile sur les falaises britanniques, ils préfèrent risquer l’aventure marine dans la frêle barque de Prigent, le fils d’un fruitier malouin qui s’est frotté dans les salles d’armes à la noblesse, et, la côte atteinte, se glisser sous le couvert jusqu’à Boisguy ou Puisaye, le comte Joseph, comme il se fait appeler, toujours tapi aux environs de Rennes où il attend son heure. Joignons-leur une douzaine d’anciens chefs de la grande armée vendéenne étrangers à la Vendée, tristes épaves du désastre rejetées vers leurs lieux respectifs d’origine, tels que d’Autichamp qui s’est enrôlé dans un régiment de hussards pour échapper au carnage, tandis que sa femme entrait comme fille de basse-cour au service d’un administrateur de district ; le vicomte de Scépeaux, petit, maigre, tout en nerfs, capable de sauter des douves de vingt pieds, atteint d’un biscaïen en couvrant la retraite sur Bavai et qui, avec ses deux lieutenants, le chevalier de Turpin et Bouis de Dieusie, assumera sous peu le commandement de tout le territoire insurgé entre le Maine et la Vilaine ; Bruneau de La Mérousière, le mystérieux M. Jacques de Barbey d’Aurevilly, dont l’auteur du Chevalier des Touches a quelque peu romancé la vie, mais dont il n’a point exagéré la bravoure sans fracas, l’élégance et le tour mélancolique ; l’orgueilleux prince de Talmont enfin, le commandant en chef de la cavalerie vendéenne, le grand responsable de la marche sur Granville dont ne voulaient ni Bonchamps, ni Lescure, ni La Rochejacquelein, et qui, surpris par Stofflet au moment où il cherchait à s’évader vers Jersey et condamné par lui à quinze jours de mise à pied, pendant lesquels il dut faire la retraite démonté, sans armes, comme un simple croquant, ne reviendra dans Laval que pour y être fusillé devant son château, le 27 janvier 1794, décapité et sa tête attachée au bout d’une pique sur la principale porte du ci-devant château. Il se trouvera même un certain nombre de capitaines vendéens qui, de gré ou de force, renonceront à rejoindre Charette ou Stofflet et courront la chance d’une nouvelle carrière dans les rangs de la Chouannerie naissante. Ainsi, dans les bandes de Puisaye, qu’ils dégrossiront au cours de sa randonnée hardie sur le Morbihan, le comte de Bellême, Auguste de Béjarry, Duperrat, du Chesnier, le chevalier de Caqueray, le chevalier de Chantreau, Jarry surtout et Forestier, qui commandait en second la cavalerie vendéenne ; ainsi encore, un peu plus tard, sur les bords de la Rance, Solilhac, un Gascon, auquel il confiera l’un de ses six grands commandements. Mais le plus célèbre d’entre eux, l’alter ego, le frère d’armes de Cadoudal, le Patrocle de cet Achille armoricain, Pierre Mercier, dit La Vendée, opérera presque toujours en Morbihan comme son chef, et le Morbihan, où Silz et sa misérable troupe se sont fait horriblement maltraiter en prairial par le général Avril, ne rentrera vraiment en combustion qu’après Thermidor. Non que les âmes y soient plus patientes que dans l’Est ; mais le pays, Lanvaux, la grande lande ténébreuse, Carnac, gardé par ses sphinx, Vannes par ses îles, aussi nombreuses que les jours de l’année, se défend mieux géographiquement ; il eût été difficile, pour ne pas dire impossible à un Beaufort, appelé à Fougères le 19 décembre par Jeanbon-Saint-André, avec 9.000 hommes de troupes solides, du canon et de la cavalerie, et chargé de nettoyer sur vingt lieues de front la région entre Châteauneuf et Laval, d’y exécuter les battues qui pendant deux mois foulèrent en tous sens ces couverts. Les forêts du Pertre, de Fougères et de Haute-Sève, les bois de Beaufeu, de Fatines, d’Illivet, etc., furent fouillés buisson par buisson ; dans la forêt du Pertre on ouvrit, après avoir dégagé leurs abords, douze chemins de 200 pieds de large : c’est au cours d’une de ces battues que Talmont se fit prendre sur la commune de la Bazouges et que François Cottereau, le 1er février, fut tué sur les lisières du Maine — s’il n’y mourut pas d’épuisement —. Ses deux sœurs, appréhendées comme otages, l’aînée dix-sept ans, la cadette quinze, seront guillotinées à Laval le 25 avril et Pierre aura le même sort le 11 juin. — Il y a malheur sur les Cottereau, entendra-t-on dire à Jean Chouan. Pas un ne s’en sauvera et mon tour n’est pas loin. Il vint le 9 Thermidor suivant : ce jour-là (27 juin 1794), qui fut celui où Robespierre fut décrété d’accusation et qui marqua la fin de la Terreur rouge, Jean Chouan bivouaquait à la closerie de la Babinière avec une quinzaine d’hommes. Ses vedettes s'étaient-elles endormies ? Quelqu’un l’avait-il vendu ? Voilà les patauds ! lui crie sa belle-sœur, femme de René, le seul des Cottereau qui mourra dans son lit, sous la Restauration. Il pouvait fuir, mais une grossesse avancée retardait sa belle-sœur au passage d’une haie : pour l’aider, Jean Chouan revint sur ses pas et, touché mortellement, fut entraîné par ses hommes sous le fourré. Il y mourut le lendemain : son fantôme continua la guerre. Puisaye, vendu aussi, mais plus chanceux, un matin de l’hiver précédent où Beaufort lui courait sus — 28 décembre[1] — avait pu s’échapper en chemise ; mais deux gentilshommes de son état- major, Le Haichois et La Massue, étaient tués ; Focard, son médecin et le dépositaire de ses secrets, blessé grièvement. Le 6 janvier 1794, Beaufort écrivait au président de la Convention : Nous faisons des prises tous les jours, nous détruisons la horde infernale des Chouans. J’espère, citoyen président, t’annoncer [bientôt] leur destruction entière. Au 13 du même mois, c’était fait, et l'inepte Rossignol mandait à son digne collègue Turreau qu’il n’y avait plus de Chouans : Beaufort les a tous détruits... Cinq cents prisonniers, le reste est tué. La Convention en fut si bien persuadée qu’elle ôta, le mois suivant, près de la moitié de ses troupes à Beaufort afin d’en grossir l’armée des Côtes de la Manche qu’on formait pour une descente en Angleterre, et que la plupart des cantonnements qui couvraient la légion furent levés ou réduits. Les communes patriotes, Mellé, Saint-Brice-en-Coglais, Saint-Georges-de-Reintembault, etc., si longtemps tremblantes, recognées derrière leurs fortifications improvisées, en sortaient tumultueusement pour fondre sur les communes royalistes, y massacrer, avec la belle assurance que donne la certitude de l’impunité, les derniers prêtres réfractaires et les habitants soupçonnés de leur avoir procuré asile. Ou reprendre le fusil ou périr égorgé : Boisguy, plus particulièrement visé par la quête ardente de Beaufort et des patriotes de la région fougéraise, n’avait pas d’autre choix. Dans la nuit du 14 au 15 février, il rassemblait deux cents de ses Chouans, cernait silencieusement Mellé et, à six heures du matin, commandait l’assaut : vingt soldats de la garnison, un officier et quelques patriotes y passèrent. Même histoire à Saint-Brice enveloppé dans la nuit du 16 au 17, assailli au petit jour et emporté de plein saut, quoique la garnison y fût sur le qui-vive : un tambour, le premier qui ait battu à la tête de leurs colonnes (du Breil de Pontbriand) et quatre cents paquets de cartouches restèrent aux mains des hommes de Boisguy qui allèrent en faire l’essai le jour même, aux buttes de la Houlette, contre la garde nationale de Fougères alertée par les fuyards : la garde n’y mourut pas toute, parce qu’elle avait des jambes, mais cinquante des siens demeurèrent sur la route. Landéan, le 26, quand cette même garde eut été renflouée par des troupes de Rennes, lui fut une faible revanche et, des soixante insurgés qu’elle réussit à cerner, une charge massive de ceux-ci en délivra cinquante. Beaufort, revenu de ses illusions, se remit de plus belle à tailler dans les forêts, les gênetaies. Mais il n’était plus l’homme de la situation : il avait refusé, dit-on, le 18 janvier, de brûler six cents prisonniers au château de Thorigny sous couleur qu’en se dévouant au service de la République il n’avait pas pris la charge de bourreau. Appelé à l’armée des Pyrénées- Orientales, il passa la main à Vachot qui n’avait pas les mêmes scrupules et jura d’en finir avec ces démons. J’emploierai contre eux le fer et le feu, écrivit Vachot au comité de Salut public.... Je ne perdrai jamais de vue le mot exterminer que porte votre arrêté. C’était un de ces généraux improvisés comme en enfantait chaque matin le pavé révolutionnaire et qui, n’ayant ni génie ni métier, se flattait d’y suppléer par l'emphase. Vachot avait pris pour devise : Mort aux Chouans ! Il en décorait son papier officiel, il en truffait ses harangues, sabrant, fusillant tout en paroles et quelquefois en acte, sans cependant y mettre les raffinements et le pittoresque d’un Boulard qui tapissait sa chambre d’adjudant général, à Fougères, d’oreilles humaines payées vingt livres par paire à ses soldats. Boisguy, lui, le féroce Boisguy, se contentait provisoirement de raser la tête de ses prisonniers qu’il renvoyait ensuite dans leurs cantonnements, à moins qu’ils n’acceptassent de s’enrôler dans ses bandes. Le 24 mai il s’emparait du Loroux ; dans la nuit du 27 au 28, et pour la seconde fois, de Mellé, qui n’avait pas été suffisamment châtiée sans doute et dont le maire et le curé juroux, Gilles Larcher, furent proprement égorgés dans leur lit auquel on mit ensuite le feu ; le 7 avril, il s’embusquait aux abords de Javené et abattait cent vingt soldats d’une colonne de trois cents hommes de troupe de ligne qui marchaient sur Vitré.... Cette dernière affaire fit grand bruit. Puisaye, dont l’ambition grandissante travaillait à coordonner les mouvements épars de l’insurrection, jugea que c’était le moment de s’aboucher avec un chef d’un tel allant : il lui fit donner un rendez- vous à la Chapelle-Saint-Aubert, entre Fougères et Saint-Aubin-du-Cormier. Boisguy, assez mal disposé et qui ne savait trop à quoi tendaient ces ouvertures, accepta cependant le rendez-vous, n’y trouva personne et faillit être enveloppé au retour par quatre colonnes républicaines dont il dispersa l’une, mais dont les trois autres, qui le prenaient de face, de flanc et de revers, ne lui laissaient aucune chance de s’évader. Il s’en tira néanmoins à force d’audace, en faisant abattre par son ancien garde-chasse Decroix le capitaine de la compagnie de grenadiers qui lui criait : Rends-toi, J... F..., et il est vrai que les deux autres colonnes étaient composées de ces gardes nationaux dont Rossignol, qui s’y connaissait, disait qu’ils étaient bons seulement à mettre la déroute. Les patauds ne démentirent pas cette fois encore leur réputation et se débandèrent, mais, dans l’ardeur de la poursuite, un aide de Boisguy, le chevalier de Baillorche, alla donner aux portes de Fougères dans une embuscade, y fit tuer dix de ses hommes et, capturé lui-même, fut immédiatement passé par les armes. C’est la dernière affaire un peu importante de la Chouannerie orientale jusqu’à la mise à exécution du plan de Puisaye, qui dut fournir sans doute à Boisguy des raisons valables de son absence au rendez-vous de la Chapelle-Saint-Aubert : il s’apprêtait à partir pour son grand raid sur le Morbihan dont l’organisation lui prenait tout son temps. Appuyé par Forestier qui commandait sa colonne de gauche, il tenta en cours de route d’enlever Rennes par surprise — la mèche fut éventée par deux canonniers de Vern qui coururent alerter la garnison — et, se rejetant vers Baignon, y fut joint par trois mille hommes d’infanterie et quatre-vingt chevaux de l’armée républicaine qu’il dispersa par une charge brusque, en poussant de grands cris et sans tirer un coup de feu (Beauchamp). La suite de l’expédition ne répondit pas à ses commencements. Puisaye poussa cependant jusqu’à Concoret où il pensait rencontrer Guillemot et l’abbé Guillo, délégués vers lui par les divisions morbihannaises : il n’y trouva que leurs lettres et leurs protestations d’entier dévouement. Mais c’est de quoi il était le plus avide, ayant surtout entrepris ce raid pour faire reconnaître son autorité : elle n’était point encore si affermie parmi ses propres troupes qu’il pût les empêcher de se débander aux approches de leurs villages et de piller en cours de route, surtout quand l’exemple leur était donné par un Hay de Saint-Hilaire, dit le Hulan, qui brûlait la cervelle du procureur de la commune de Saint-Germain-sur-Ille pour lui enlever sa caisse. Affaibli par les désertions, talonné par les colonnes républicaines, il dut s’estimer personnellement heureux d’échapper près de Liffré à la débâcle totale de ses troupes : quatre de ses officiers, Tuffin d’Ussy, le chevalier de Troroux, Poncé et Fabré, périrent dans cette affaire qui parut avoir mis fin à la Chouannerie vitréenne ; dégoûtés, mal faits à ces égorgeries de chemins creux suivies de pilleries et de soûleries. Forestier, Duperrat, Bréchard, parmi les Vendéens, préférèrent repasser la Foire. Puisaye lui- même rentra sous ses fourrés et s’y tint coi jusqu’à l’été de 1794, où il sortit tout à coup de sa cachette avec le titre ronflant et les pouvoirs de général en chef, commandant pour le roi l’armée catholique de Bretagne. Il n’y manque simplement que le visa des princes. Or, à ce moment-là — 26 juillet, date de la première des deux proclamations de Puisaye qui vont donner une sorte d’existence officielle à la Chouannerie ; la seconde est du 20 août —, la Terreur n’a plus qu’un jour à vivre, et Carrier, son incarnation en Bretagne, s’apprête à rejoindre Robespierre sur l’échafaud. |