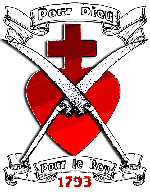LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE III. — L’INSURRECTION SPONTANÉE.
|
PAYS âpre, secret, angustié, brousse ou forêt, avec quelques éclaircies çà et là, des prairies, de maigres champs d’orge et de sarrasin, des linières en friche par suite de l’arrêt du commerce des toiles, une terre comme écorchée que les vents de mer raclent jusqu’à l’os, qui monte, s’affaisse, remonte, retombe et, sous un ciel sans sourire, semble prolonger sur le continent le mouvement onduleux des vagues, une Libye granitique et brumeuse, gardée par de frustes mégalithes, de grandes pierres muettes, dont les alignements autour de Carnac et jusqu’au nom de cette localité évoquent les avenues hypostyles et les monstrueuses divinités de la Haute-Égypte, un désert et une énigme historique, ainsi se présente aux yeux des contemporains la Bretagne de 1793, la Bretagne des grèves, des bois et des landes, dont Lequinio dira si bien, à la Convention, qu’elle est à 2.000 lieues de Paris et qui en est peut-être plus loin encore dans le temps. Les sinistres Côtes- du-Nord, écrira La Vallée en 1794. Mais le Finistère, surtout le Morbihan, ne donnent pas au voyageur une impression plus réconfortante : Ce sont encore des landes, des coteaux, couronnés de bois épais et sombres, des champs coupés par des espèces de remparts hérissés de ronces et de buissons... et partout, le long des routes, aux carrefours, la procession funèbre des croix, des calvaires, monuments de la superstition et du fanatisme qu’on s'étonne de trouver debout en ce siècle de lumières. Cambry, à la même date, pourra bien protester que c’est là seulement l’apparence, qu’il est des coins fertiles, de délicieux asiles champêtres, au milieu de ces landes immenses, derrière ces fouillis d’arbres et de buissons. Le froid pays, entouré par la mer, dira Hoche en 1795. Onze ans après, Alphonse Beauchamp, pour ne pas citer Chateaubriand, suspect de romantisme, parlera encore (1806) de l'aspect dur et sombre de la Bretagne, de son ciel humide. Exception n’est faite chez ces auteurs que pour la région de Vitré, de Fougères et de Rennes, la Haute-Bretagne, moins déshéritée et qui conserve quelques vestiges de cette richesse agricole que l’industrie française (?) a semée sur toute la surface de la République. Mais là aussi, dans la profusion et la densité des forêts, dans ces talus abrupts cernant les petites divisions territoriales et tout barbelés d’ajoncs, d’épines, de chênes tors, dans ce perpétuel ruissellement d’eaux vives, de sources, de cascatelles, dans ces chemins encaissés si propres à la reptation du féroce Marche-à-Terre et de ses compagnons, la Bretagne a commencé de mettre son cachet particulier, son signe. Et ne le retrouverait-on point, ce signe, jusque dans le Cotentin, lande et granit, plus celte que normand, conviendra Barbey d’Aurevilly ; dans le Bas-Maine lui-même, au climat encore maritime, à l’aspect semi-forestier, où, comme en Bretagne, les champs sont entourés de haies et généralement plantés d’arbres (René Musset), où, comme en Bretagne, la seule industrie connue est celle du tissage à main ? Sous Nominoë d’ailleurs, ces régions étaient bretonnes, agrégées du moins au domaine du grand tyern. Comme tous les borders, les pays de marche, elles participent d’une double nature, dont la fusion n’est point si parfaite qu’elle ne cède aux circonstances, aux effets de certains chocs. Supposez une Bretagne victorieuse et redevenue indépendante : c’est vers cette Bretagne restaurée que leurs affinités de race, de mœurs, de croyances, les eussent portées plutôt que vers la France jacobine. Aussi bien ne saurait-on trop insister, pour comprendre la Chouannerie, sur le caractère à part et, si l’on peut dire, émancipé, individualiste, du massif armoricain. Rien en lui de français. Nulle attache notamment avec le bassin parisien dont l’isole une bordure de terrains jurassiques et crétacés, mais, au contraire, une tendance prononcée à l’évasion vers le nord-ouest, vers cette Cornouaille anglaise à laquelle le relie une zone secrète de granit sous-marin. Quiberon naîtra de là, nœud du drame et qui en rassemble un moment, sous le pavillon britannique uni aux fleurs de lys, les éléments sans cohésion, mais pour les rendre presque tout de suite à leur dispersion, à leurs rampements, à leurs guérillas de chemins creux, seule guerre possible dans ce pays compartimenté au moral comme au physique et impropre à toute action militaire de grande envergure. Il s'en faudra même que toute la campagne soit acquise au mouvement : en plus des villes, des gros bourgs, sur qui la République peut compter et dont les velléités girondines ne résisteront point à l'épreuve des événements, nombre de petits bourgs, de localités moyennes, par peur, par intérêt ou sous l’influence d’un directoire de district conciliant, d’un magistrat municipal avisé, d’un sermentaire qui aura fini par s’imposer au respect de la population, demeureront fidèles à la Révolution, passives tout au moins. Nulle part, sauf dans le Morbihan, un chef de bandes ne sera complètement le maître d’un canton : la carte de la Chouannerie, si on la dressait, ressemblerait à un manteau d’Arlequin. Ainsi s’explique qu’on ne puisse la parcourir d’affilée : il faut se porter d’une pièce à l’autre en sautant par-dessus la pièce intermédiaire rarement de même nuance. La Rouërie est mort, mais la plupart de ses lieutenants ont échappé et leur tête peut être mise à prix, ils ne l’en défendront désormais que plus énergiquement. Ils ont des intelligences, des complices tout prêts, autour de leurs manoirs sylvestres, chez les paysans parmi lesquels ils vivent, dont ils portent le costume et qu’ils ont commencé d’endoctriner. Souvent un insermenté est leur hôte. Jadis en désaccord, la persécution les a rapprochés : la vie du prêtre réfractaire n’est pas moins exposée que celle du ci-devant : pour l’un, c’est la prison, pour l’autre la déportation ; quelquefois, déjà, pour les deux, la guillotine. Comme la mort, la Révolution va vite. Cependant, cahin-caha, le pays la suit. Même en mars 1793, quand la Convention aux abois, attaquée, pressée sur toutes nos frontières, décrète la grande levée de 300.000 hommes, puis, le 16 août, le levée en masse, la révolte n’est pas aussi unanime qu’on l’a dit : la Cornouaille finistérienne qui, en juillet de l’année précédente, avait montré à Fouesnant quelque velléité de résistance, ne bouge pas — et c’est sans doute que le clergé assermenté y balance ou presque le clergé réfractaire — ; ni la partie bretonnante des Côtes-du-Nord, Guingamp, Lannion, et ce qui a été annexé au Finistère du territoire de l’ancien diocèse de Tréguier, lequel s’étendait jusqu’à la rive droite incluse de la rivière de Morlaix — et cependant on est là sur les domaines, dans l’obédience de l’incendiaire prélat Le Mintier — ; ni le district de Châteaubriant en Loire-Inférieure, qui ne prendra feu que plus tard, alors que l’ardeur des autres, soufflée par Pallierne, Caradeuc et le chevalier de Magnan, se sera refroidie ; ni les districts de Dol, d’Antrain, de Pleine-Fougères en Ille-et-Vilaine, bien qu’un peu vacillants ; ni les districts gallots du Morbihan lui-même où la race, le type physique et moral, long, sec, positif, est très différent du type vannetais, court, ramassé, taciturne, ennemi des nouveautés. Dans le Léon et jusqu’aux portes de Brest, grande colère assurément, bouillonnement de presque toute la masse paysanne : Canclaux doit marcher avec du canon sur Saint-Pol, forcer le passage au pont de Kerguiduff coupé par les émeutiers, se battre encore au pont de Plougoulm. Lutte sévère, qui semblait en annoncer de plus rudes. C’est ici le pays noir, la terre des prêtres, une sorte de Paraguay breton ; les insermentés y sont quasiment inconnus : 27 constitutionnels contre 282 réfractaires. S’il y avait un district où la Chouannerie dût se trouver chez elle, dans un terroir de choix, s’enraciner et s’épanouir, c’est celui-ci. Et, le lendemain même de l’insurrection, tout y rentre dans l’ordre : les communes soulevées délèguent à Canclaux qui s’apprêtait à les occuper militairement, font leur soumission, s’engagent par traité à ne plus reprendre les armes. Et le plus extraordinaire est qu’elles tiendront parole, paieront l’amende, rongeront leur frein. A la Cornouaille loyaliste s’ajoutera ainsi un Léon pacifié qui, avec elle et le territoire tout entier du Trégor, formera dans la Basse-Bretagne un bloc d’un seul tenant où la Chouannerie ne mordra plus. Tour à tour Canclaux, Hoche, dont le quartier général se transportera maintes fois à Lesneven, capitale du pays noir, Brune, Hédouville, Bernadotte, mettront à profit ces dispositions excellentes et véritablement inespérées de trois sur quatre des anciens diocèses bas-bretons. Preuve que la langue parlée dans ces diocèses 11’influe en rien sur leur conduite politique, qu’elle n’est pas une langue réactionnaire, comme on le prétendra au temps du combisme. Hoche en particulier le sait bien, qui utilisera cette langue pour ses proclamations et qui fera du Finistère une des pinces de la tenaille où il espère prendre la Chouannerie. Un seul des anciens diocèses bretons donnera — et à force, il est vrai — dans l’insurrection : le diocèse de Vannes, compris presque tout entier dans le Morbihan. Tous les autres départements ou parties de départements insurgés : Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Côtes-du-Nord, sont, comme la Manche, la Mayenne, l'Eure-et- Loir, des départements de langue française. Nul besoin de truchement pour s’y faire entendre. Des juges de paix demandent à des prévenus la raison de leur soulèvement : — Puisqu’il n’y a plus de roi, ni de prêtres, répondent-ils assez logiquement, nous voulons crocher [nous expliquer ?] avec la Nation. Nous voulons savoir de quel droit elle prétend nous recruter. Ou elle laissera nos enfants tranquilles, ou nous nous lèverons tous. Tous ? Non. Et pas longtemps. Presque partout l’insurrection, sans cohésion, sans plan, sans chef, s'affaisse, ainsi qu’à Saint-Pol, son premier effort jeté. Comme en noyant, fusillant ou brûlant les chartriers des châteaux, elle pensait ruiner le régime féodal, elle croit naïvement supprimer le recrutement en détruisant ses registres. Elle ne cherche pas plus loin dans la grande majorité des cas. Elle est la digne fille de ces Bonnets-Rouges de Mme de Sévigné qui, voyant chez leur curé une grande horloge qu’ils ne connaissaient point, la prirent pour la Gabelle et l’allaient traiter en conséquence si le curé n’avait eu le bon esprit de leur dire que c’était le Jubilé. Un moment menacés, emportés même de plein saut assez souvent, Machecoul, Saint-Pliilbert, Clisson, Ancenis, Blain, Savenay, Guérande, Le Croisic dans la Loire-Inférieure, Pacé, Plélan, Redon, La Guerche, Vitré, Dol, Landéan, Fleurigné, Rennes dans l’Ille-et- Vilaine, Lamballe, Dinan dans les Côtes-du-Nord, La Roche-Bernard, Rochefort, Pluméliau, Pontivy, Auray, Vannes dans le Morbihan, d’autres villes encore ou gros bourgs, désignés pour le tirage au sort, voient presque aussitôt refluer la marée paysanne qui a failli les submerger et qui laisse quelquefois entre leurs mains, comme à Vannes, jusqu’à 150 prisonniers. Avec 180 fusils de gardes nationaux, une brigade de gendarmerie, 39 hommes du 109e de ligne et quelques fédérés de Guéméné- sur-Scorf, Pontivy tient tête toute une journée à une cohue de plusieurs milliers d’insurgés ; Fougères, assiégée par une troupe aussi forte et sommée de se rendre, parlemente, tergiverse, est sur le point de céder et finalement riposte par un feu nourri et quelques volées de canon qui changent en déroute la révolte de la Saint-Joseph, nom donné à cet incohérent prologue de la longue tragédie dont Aimé de Boisguy sera le principal protagoniste. Il avait dix-sept ans ; il sortait de chez lui, une badine à la main, avec son garde-chasse Decroix ; une bande de jeunes réfractaires le rencontre, l’acclame : — Ah ! voilà notre petit seigneur. Il sera notre général. Et ils l’entraînent. Il n’y gagna, comme son frère aîné Louis, qu’une condamnation à mort par contumace. Les bourgeois de Vannes, de Pontivy, de Fougères ont eu chaud. Plus de bruit que de mal au demeurant. D’incidents vraiment graves, on n’en signale qu’à la Roche-Bernard, à Rochefort-en- Terre et aux abords de Lamballe. Encore le premier de ces incidents semble-t-il le fruit d’une méprise. Les bandes armées de fusils, de pistolets, de sabres, de faulx, de brocs, de bâtons, qui s’étaient jetées sur la ville ne nourrissaient aucun dessein sanguinaire, sauf contre les registres du recrutement. N’éprouvant aucune résistance de la part du maire et des officiers municipaux, elles allaient vraisemblablement s’en retourner comme elles étaient venues, leur haine de la paperasse officielle satisfaite. Mais, ô malheur déplorable ! dit le rapport des magistrats, dans le temps même que les deux partis s’embrassaient en signe de paix, un coup de fusil, parti en l’air, sert de prétexte ou de signal aux révoltés pour commencer le carnage... Parti en l’air. Est-ce bien sûr ? Un homme tomba du côté des insurgés. En cherchant à pallier la gravité du fait, les magistrats se dénoncent : le coup est parti de leurs rangs. Et alors ce fut le massacre, la boucherie : 115 tués sur les 120 hommes de troupes régulières du sous-lieutenant Monistrol, le futur maréchal de camp, qui défendaient la ville avec les gardes nationaux. Leur résistance désespérée ne peut empêcher la paysantaille de pénétrer jusqu’au siège du directoire, où se sont réfugiés Joseph Sauveur, président, et Le Floc’h, procureur syndic du district. Quelqu’un, Plessis de Grénédan ou un autre, dans l’espoir peut-être que la nuit refroidirait ces colères, inclinerait le vainqueur à la pitié, dut suggérer de ne pas les massacrer tout de suite, de les réserver pour le lendemain. Mais la nuit ne fut qu’une longue soûlerie. Et, le lendemain, les têtes étaient aussi chaudes que la veille. Il n’y eut ni interrogatoire ni jugement : Le Floc’h est haché sur le seuil de la prison ; Sauveur, qu’on accuse d’avoir tiré le coup de fusil qui déchaîna l’émeute, devra à son nom de connaître une mort plus lente, plus raffinée, le dérisoire et sanglant supplice d’un nouveau calvaire par les rues entre une double haie d’assommeurs. Rendu sur la lande qui sera son Golgotha, on l’agenouille de force, on le somme de crier : Vive le roi ! Vivent les réfractaires ! Il crie : Vive la Nation ! On lui avait déjà tiré d’un pistolet à blanc dans la bouche ; on l’avait lardé de coups de sabre ; on avait rogné ses mains, ses pieds : on lui crève l’œil gauche d’une balle et finalement on l’égorge. C’est comme une scène de la Conciergerie retournée : les massacres de Septembre ont leur pendant — en petit — dans les tueries de La Roche-Bernard. Car la caractéristique de cette émeute, représentative de beaucoup d’autres du même temps, c’est qu’elle ne porte aucune signature. Il est possible qu’en Vendée la découverte des papiers de La Rouërie ait plus fait que la mort de Louis XVI et la levée de 300.000 hommes pour susciter les Perdriau et les Souchu (Léon Dubreuil). Ici non. Pas une tête, pas un chef discernable dans cette tourbe avinée que mène son seul instinct. Une responsabilité diffuse et presque insaisissable, bien qu'un des assassins de Sauveur, reconnu plus tard, ait eu le cou scié par représailles sur l’affût d'un canon. C’est l’insurrection spontanée, comme il y aura eu, selon Taine, l’anarchie spontanée. A Rochefort-en-Terre seulement et à la lande du Gras, en Meslin, on a des noms, une organisation apparaît, un plan se dessine. Silz, dans le Bas-Morbihan, avant de se mettre en campagne, a procédé à une levée régulière ; il a fixé le chiffre des contingents pour chaque paroisse ; il a distribué ses hommes sous des chefs qui s’appellent Chevalier, Ta Rivière, La Roche-Guérin, Mont-Méjan, dit Dupuis. Lui-même, inaugurant la tactique des noms de guerre, se fait appeler le général Rochefort. Enfin il a donné à ses troupes un drapeau, celui de l’ancienne monarchie, une devise : Dieu et le Roi. Mais tout cela, qui fait souvenir de La Rouërie, c’est l’apparence, et l’individualisme foncier de ces bandes, le caractère anarchique et populaire du soulèvement vont éclater dès le premier jour (16 mars), quand, après qu’il a emporté Rochefort-en-Terre, refoulé la minuscule garnison dans le château et garanti la vie sauve à ceux qui se rendront, d’autres bandes surgissent, alléchées par l’odeur de la curée, qui se jettent sur l’administrateur Bougerai, le chirurgien Dénoual, le citoyen Duquéro, et les égorgent en dépit de Silz. La Convention, travaillée elle aussi du prurit onomastique, avait fait de La Roche-Bernard la Roche-Sauveur : elle fera de Rochefort-en-Terre, quand le général Petit-Bois l’aura dégagé, la Roche-des-Trois. La lande du Gras, dans le district de Lamballe, n’est qu’une bruyère un peu plus vaste que les autres, sur un plateau abrupt et dominant ; mais le 23 mars, au matin, c’était le carrefour d’une quinzaine de paroisses que le tocsin y avait appelées de tous les points de l'horizon pour marcher ensemble sur Pommeret et y mettre en pièces le rôle de la conscription. A leur tête un petit gentilhomme campagnard de Bréhan-Moncontour, ancien officier de Royal-Marine, remarqué par La Rouërie qui lui avait confié l’un des commandements des Côtes-du-Nord, Amateur-Jérôme-Sylvestre Le Bras de Forges de Boishardy, trente ans, de taille moyenne, mais extrêmement vigoureux, leste, adroit, au dire de d’Andigné, joli garçon en outre, bon musicien, aimé des belles qu’il enchaîne à sa flûte, le poil châtain, l'œil bleu, ironique à la fois et rêveur, une vraie' nature de Celte, ardente et sentimentale, brusque et généreuse, prompte à l’enthousiasme comme au désenchantement. Un fusil de chasse à deux coups sous l’aisselle, il est sauté à l’aube de son pigeonnier familial sur la place, puis sur le mur du cimetière de Bréhant, pour haranguer les conscrits de la paroisse, vilipender le minotaure révolutionnaire, l’abominable régime qui, après avoir tué le roi, proscrit Dieu, ruiné l’État, décime la jeunesse bretonne et l’envoie mourir aux frontières... Est-ce donc là ce qu’on avait promis ? Hurlements, acclamations, qui reprennent sur la lande du Gras quand Boishardy recommence sa harangue devant les conscrits des autres paroisses accompagnés de leurs maires, cocarde tricolore au chapeau — preuve de leur civisme antérieur —. En un clin d’œil les couleurs nationales sont arrachées, piétinées, remplacées par des cocardes blanches en papier. Frère Morin, ci-devant capucin, étend un large geste de bénédiction sur la troupe, 4.000 hommes, selon les rapports, armés de fusils, de faulx, de fourches, de massues ou marottes, qui font les cent coups dans Pommeret et, mis en appétit par ce premier succès, vont attendre la malle-poste aux Ponts-Garnier, sur la grande route de Lamballe à Saint-Brieuc. La garde nationale, accourue au bruit et chargée par Boishardy, donna pour excuse de sa fuite précipitée le manque de munitions. Que vont faire cependant ces 4.000 insurgés — qui ne sont peut-être que 700 ou 800 —, ce noyau d’armée royaliste si promptement formée autour d’un chef tout de suite populaire, jeune, éloquent, brave, familier, vêtu d'une veste de cultivateur et que rien extérieurement ne distingue de ses hommes ? Ils s’égaient dès le lendemain, se font prendre chez eux ou hacher sur la route par paquets. Les commissions militaires en condamnent neuf à mort, dix-huit à la déportation, après quoi tout s’apaise et le recrutement suit son cours. Boishardy, pour défendre sa peau — il a été, lui aussi, condamné à mort, mais par contumace —, doit se contenter d’une petite troupe de partisans choisis, quelques réfractaires qu’il exerce au maniement des armes, des boisseliers de la Hunaudaye, qui ont le coup d’œil sûr des braconniers. Quatre de ces braves et lui-même suffiront contre l’administrateur du département, Hello, le grand-père du mystique auteur de la Physionomie des Saints, qui a mobilisé pour sa capture 25 canonniers de Guingamp avec leur pièce et des volontaires de Lamballe, Hénon, Pleslan, Quintin : Boishardy désarme leurs postes, file à leur barbe. Ses hommes l’appellent le Sorcier. Mais sa sorcellerie ne va pas — pour le moment — jusqu’à faire recommencer aux paroisses insurgées le grand rassemblement du 23 mars ni à changer en armée régulière quelques douzaines d’outlaws du Méné. A-t-il même tant changé leurs opinions, et cette cocarde blanche, qu’ils ont substituée, sur la lande du Gras, à la cocarde républicaine, est-elle demeurée bien longtemps piquée à leurs bonnets ? On peut se le demander quand on voit le frémissement d’inquiétude qui court les masses paysannes en Bretagne — et non pas seulement la bourgeoisie des villes — à la nouvelle que la Vendée, après avoir battu tout un mois les murs de Nantes, défendue par Canclaux et l’héroïque maire Baco — que le rasoir national en récompensera —, venait de forcer la Loire un peu en amont et de déborder sur le Maine et la Basse-Normandie. Entre la Vendée et la Bretagne, jusqu’alors, aucune sympathie, aucun point de contact : la Vendée, c’est pour la Bretagne, même insurgée, la contre- Révolution sans phrase, la restauration pure et simple de la monarchie, le retour à la corvée, aux rentes féodales, au domaine congéable, aux procureurs fiscaux, aux droits sur le vin, le tabac, le sel, à tout ce qu’elle abhorre. Et la Bretagne ne s'est pas insurgée pour le rétablissement de ces abus, qu’elle incarne dans la monarchie. La preuve en est qu’au mois de février 1793, deux ans avant Quiberon, quand le bruit circula, savamment entretenu par des proclamations dans les deux langues, que 15.000 émigrés, appuyés par la flotte anglaise, s’apprêtaient à prendre terre sur un point de la côte bretonne, ces spectres du passé y refirent immédiatement l’unanimité contre eux. Depuis, sans doute, il y avait eu la levée de 300.000 hommes. Des âmes s’étaient aigries ; dans la balance des avantages et des inconvénients, l’obligation du service militaire, mal compensée par la privation du service religieux, avait commencé de faire remonter un peu le plateau monarchique. La haine, non du Roi peut-être, mais de ses bureaux archaïques, le souvenir du lourd et oppressant système féodal, anti-égalitaire, tatillon, monopoleur, restaient encore si puissants sur les esprits qu’ils abolirent, à l’annonce du péril vendéen, toute conscience de l’identité profonde des deux causes et ne laissèrent plus voir aux intéressés que la menace et les dangers d’une restauration. Il en fut de même pour les villes bretonnes qui oublièrent de ce coup leur passion girondine. Et cependant la Gironde eût pu fédérer contre la Montagne — mais non contre la République (le marquis du Dresnay et son délégué Contrideux se tromperont sur ce point) — les aspirations urbaines et paysannes : si les campagnes avaient durement payé pour leur foi. Rennes, Brest, Quimper, Lorient, Vannes, ne paieront pas d’une rançon moins sanglante leurs sympathies trop affichées pour les proscrits du 2 juin retranchés en Normandie, leur participation armée à la piteuse offensive des carabots normands de Wimpfen et de Puisaye. Le péril vendéen efface tout. Ne nous laissons pas piper aux chiffres, encore moins au pittoresque des anecdotes. Une de celles-ci représente Jean Chouan — de son vrai nom Jean Cottereau — chapeletant sous le couvert avec ses gars, un soir d'octobre 1793, quand un bruit sourd de tonnerre ou de marée montante arrive jusqu’à lui. Il applique son oreille contre terre et se relève en criant, fou de joie : — Le canon de la Vendée ! L’armée royale qui vient à nous. En route pour Laval, mes gars ! Et se reprenant : — Achevons d’abord notre chapelet. Mais nous sommes là hors de Bretagne, bien que sur ses lisières, et la situation des insurgés mainiaux, anciens faux-sauniers, colporteurs réduits à l'indigence depuis la suppression des douanes intérieures et constitués en hors la loi presque dès le début de la Révolution, n'a que de très vagues rapports avec celle des domaniers et métayers bretons. Puis l’armée vendéenne était à deux pas : comment résister à son magnétisme ? Et du Maine à la Vendée d’ailleurs la transition est si facile, les nuances si faibles ! Le nom même de Petite-Vendée, étendu à toute la coopération chouanne, mais donné d’abord aux troupes de la Mayenne, montre l’affinité des deux peuples, la ressemblance des deux insurrections. Rien dans la Vendée ne choquait le Maine. De Bretagne aussi des hommes se mirent en route, vers l’armée vendéenne : des isolés pour la plupart, des émigrés débarqués de la veille ou qui croyaient l’heure propice, comme Puisaye et La Haye-Saint-Hilaire, pour quitter leurs terriers. Le plus gros du contingent venait de Haute-Bretagne, de Vitré, avec Louis Hubert, l’ancien maréchal ferrant de Saint M’Hervé devenu chef de bande, des taillis du Pertre surtout, près de Fougères, où le jeune Picquet du Boisguy commençait à prendre une autorité qui s’affirmera, chemin faisant, par l'enlèvement nocturne — sans effusion de sang — du poste fortifié de la Gravelle avec le général Lespinasse qui y dormait à poings fermés. Au total combien de recrues ? Puisaye en annonçait 50.000, suivant Mme de La Rochejacquelein : un peu plus de 6000 se présentèrent, suivant Mme de Lescure. Acceptons le chiffre. Que représente-t-il près de l’afflux du reste des campagnes bretonnes dans les rangs républicains où venait de les appeler le Conseil général du département le plus menacé ? Citoyens, les brigands de la Vendée sont à nos portes, Dol est en leur pouvoir. Ils marchent sur Dinan et nous n’avons point de forces disponibles à leur opposer. Il faut que les républicains se lèvent en masse et qu’ils courent les exterminer. Point d'exception d’âge.... Que tous les hommes vigoureux marchent armés de piques, faux, fourches et de tous les autres instruments capables de les assommer. Prévenez ceux qui marcheront d’apporter avec eux pour huit jours de vivres et des farines, s’il est possible ; que des charrettes soient requises, etc. Elles s'offrirent d’elles-mêmes. Cette fois, dit un historien peu suspect, l’abbé Pommeret, les campagnes ne refusèrent pas de contribuer à la défense nationale, car elles redoutaient, presque autant que les villes, les bandes indisciplinées dont on leur signalait la dangereuse proximité.... Et peut-être redoutaient-elles plus encore le rétablissement du régime détesté dont la victoire de ces bandes eût été la conséquence : ces mêmes rustiques à tête dure qui s’insurgeaient la veille encore contre la levée en masse, on les vit qui, suspendant leurs labours d’automne, prenaient en foule les routes défoncées et boueuses du haut pays, armés quelques-uns de fusils de chasse, la plupart de piques, de faux renversées, de pioches ou simplement de bâtons, et suivis de longues files de charrettes... et de troupeaux de bœufs destinés à leur approvisionnement ; ces taciturnes criaient sur leur passage : Vive la Nation ! Vive la République ! et mettaient à brailler les airs patriotiques à la mode le même entrain que les sans-culottes. Il en accourut tant, surtout du Finistère et des Côtes-du-Nord et jusque d’îlots perdus de l’Atlantique, qu’il fallut en renvoyer les quatre cinquièmes, n’en conserver que quelques milliers qui furent utilisés autour de Dinan à barricader les routes, à raccommoder les remparts. Carrier lui-même, alors à ses débuts en Bretagne, dans l’Ille-et-Vilaine, en fut émerveillé. |