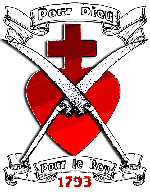LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE II. — LA CONJURATION DE LA ROUËRIE.
|
En vertu des articles de cette Constitution et des dispositions législatives précédentes ou suivantes, les réguliers étaient déliés de leurs vœux ; les vœux eux-mêmes abolis ; les biens de mainmorte, les fondations pieuses, y compris celles pour la délivrance des âmes du Purgatoire, confisqués au profit de la Nation ; le casuel supprimé. La nouvelle organisation ecclésiastique ne conservait que les évêques et les prêtres, qui devenaient des fonctionnaires publics et recevaient un traitement, mais leur nomination, soustraite au Saint-Siège, était remise aux fidèles. Une nouvelle division des diocèses, ramenés en Bretagne de neuf à cinq, les faisait coïncider avec les départements, qui remplaçaient l’ancienne division en pays d'élections et pays d’états. Et, si ce n’était point tout à fait une organisation hérétique, puisqu’il n’y était point touché au dogme, c'était du moins la subordination complète du culte au pouvoir civil, la formation d’une véritable église gallicane et démocratique indépendante de Rome, un schisme. Les intéressés ne s’y méprirent pas longtemps. S’ils ne protestèrent pas tout de suite, c’est que, promulguée les 12 juillet et 21 août 1790, la Constitution civile du clergé resta en sommeil jusqu’au 27 novembre, date où l’Assemblée, pour assurer sa marche, qui commençait d’apparaître bien aventurée, crut devoir déférer au serment tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics — exactement comme en 1762, pour assurer le respect des quatre propositions et la fidélité aux principes de l’Église gallicane, le parlement de Bretagne avait voulu déférer les Jésuites au serment. Triste, mais juste retour des choses. Quoi qu’il en soit, cette obligation néfaste, aggravée par la loi du 4 janvier 1791 qui ordonnait de prêter serment sans préambule, explication ou restriction, fit éclater le divorce latent : tous les évêques bretons et 80 p. 100 des membres du clergé refusèrent le serment ou, l’ayant rendu, se rétractèrent. La Constitution civile, selon la réponse de l’un d’eux, ne faisait pas qu’attaquer la hiérarchie, elle la renversait ; elle tendait à rompre les liens sacrés qui depuis Clovis unissent la monarchie française au siège de saint Pierre ; elle était l’œuvre d’incompétents et d’inaptes substitués au concile national, seul juge, après Rome, en telles matières ; elle portait à l’erreur ; on pouvait même dire qu’elle était hérétique en quelques points (abbé Cormaux). Quand Rome eut parlé, après les évêques, sanctionnant ce rude verdict d’un prêtre de campagne, tout fut dit. Le refus du serment entraînait la démission de l’insermenté et son remplacement par un sermentaire. Mais les prêtres de ce genre étaient le petit nombre ; de plus, les remplaçants, assez souvent pris parmi les cordeliers, carmes, bernardins et autres congréganistes lâchés dans le siècle, n’étaient pas tous des miroirs de sainteté ; ces intrus ou jureurs, ainsi que les appelait le peuple des campagnes, bien loin de faire oublier les réfractaires expulsés manu militari, relégués à six lieues de leur ancienne paroisse ou jetés dans les prisons du directoire, ajoutaient aux regrets que leurs prédécesseurs avaient laissés. N’oublions pas cependant que, la Terreur venue qui les mettra en demeure de déposer leurs lettres de prêtrise et de se marier, eux aussi pour la plupart préféreront la prison à une apostasie — abbé Pommeret —, ce qui n’est pas l’indice de si vilaines âmes : 51 abdicataires pour tout le diocèse de Rennes, qui en contient le plus grand nombre, dont 20 seulement prennent femme ; dans les Côtes- du-Nord, un Nicolas Armez lui-même, panthéiste, libertin et trembleur, s’arrange pour esquiver l’obligation matrimoniale. Enfin l’installation du sermentaire se faisait rarement sans protestation ; quelquefois-on l’accueillait à coups de pierre et, d’autres fois, les poings, les penn-baz, les fourches, entraient en danse. Un cadet de noblesse appelé à une certaine notoriété dans les fastes de la Chouannerie, Carfort, recevait sa première blessure, le 9 novembre 1790, en défendant à l’assermenté Boscher l’entrée de l’église de Plémy. Et c’est dans une affaire semblable, à Saint-Ouen-des-Toits, contre l’intrus Pottier, qu’apparaît pour la première fois Jean Chouan. De proche en proche la fermentation gagnait ; des paroisses entières s'armaient, marchaient sur le chef-lieu du district ; un hasard seul sauvait Vannes, investie, le 13 février 1791, par les 3.000 vassaux du vieux comte de Franche ville, l’ancien chevalier de la Tribune dont raffolaient toutes les dames de Rennes, exact au plaisir comme à la bataille et qu’on avait vu naguère se faire passer pour mort afin d’échapper à ses créanciers. D’ailleurs, si la plupart des évêques dépossédés avaient pris le large, remplacés à l’élection par l’honnête gallican Claude Le Coz, condisciple et ami de La Tour d’Auvergne, par le bonhomme Jacob, escoft an dero, l’évêque des chênes et qui n’en avait que la rugosité extérieure, par l'énergumène Expilly qui entonnera le Ça ira en montant à l’autel, par un vieillard cacochyme, Le Masle, malade d’ambition rentrée, par l’exécrable Minée dont les Nantais affûteront la dernière syllabe et qu’ils appelleront dérisoirement sur le pas des portes : Minet... Minet..., beaucoup des anciens desservants de campagne, bénéficiant de l’obscurité, n’avaient pas quitté leurs paroisses et y célébraient des messes clandestines dans les granges, les caves, les antres forestiers et marins d’accès difficile tels que la grotte de l’autel à Morgat, voire au large, la nuit, pour les grandes fêtes, sur le pont d'un lougre, au milieu des barques de pêche accourues, comme dans les régions de Perros et de Cancale — l’abbé Inizan, Herpin —. Près de Saint-Malo, un petit oratoire en ruines, Notre- Dame-de-Grâce, recueillait l’héritage d’Israël (Bertrand Robidou) : on y baptisait et mariait au nez des gendarmes ; près de Vire, sur la bruyère de Monlevou, une tente, servant aux mêmes pratiques, devenait le centre d’une véritable mission, avec sermons en plein vent, plumets, drapeaux, tambours, trompettes, etc. (La Sicotière) ; autour de Saint-Brieuc, croix paroissiale en tête, des processions se rendaient de jour vers des sanctuaires fermés par ordre, Sainte-Anne-du- Moulin, Notre-Dame-des-Grafaux, Notre-Dame-de-Bon-Repos de Plérin, etc., et, quand ces pèlerinages de protestation furent interdits, la foule les reprit au brun de nuit, pieds nus, les sabots en main, pour déjouer l’attention des gardes nationaux. Un peuple d’ombres, les délégations de quatorze paroisses, conduisait dans les ténèbres sa lamentation hoquetante, déroulait par les landes et les chemins creux sa psalmodie angoissée : Écrasez les juroux, Rendez-nous nos rectoux... Le directoire du district n’en eut raison qu’à coups de fusil : deux processionnaires furent tués par une salve qui en blessa plusieurs autres et dispersa le reste. Recrues toutes trouvées pour l'insurrection qui travaillait à s’organiser dans l'ombre sous l’homme le plus propre à lui assurer le succès, — si la trahison et la mort n’avaient, comme deux anges funèbres, veillé à ses côtés : Tuffin, marquis de La Rouerie, le colonel Armand des guerres de l’Indépendance où il avait suivi La Fayette et levé à ses frais deux légions. Terré dans son manoir familial, en Saint-Ouen, sous le couvert de forêts centenaires, La Rouërie guettait l’occasion, laissait mûrir les événements. C’était une tête volcanique, que son passé ne semblait point prédisposer pour l’exécution d’un plan réfléchi : le bruit de la guerre d’Amérique l’avait fait sortir de la Trappe, où il s’était enfermé après un duel malheureux pour une chanteuse de l’Opéra, la Beaumesnil, et une tentative avortée d’empoisonnement. De retour en France il se maria, perdit sa femme et, à son chevet, se lia avec le médecin qui la soignait, La Touche-Chèvetel, de Bazouges, un jouisseur, perdu de dettes, ami de Danton et qui devait le livrer à celui-ci. De 1790 à 1793, le manoir de Saint-Ouen, relié par des fils secrets à toute la province et aux provinces limitrophes, fut un laboratoire et bientôt une véritable usine de contre-révolution. La Chouannerie, sous le premier nom d’Association bretonne, sortit de là tout armée. La Rouerie, après deux voyages à Coblentz où l’accompagnait l’ancien procureur général de Bretagne, le comte de Botherel, avait réussi à convaincre les princes et à obtenir leur blanc-seing pour le soulèvement de l’Ouest. Peut-être attendit-il un peu trop à ouvrir la campagne. Il voulait faire coïncider le soulèvement avec l’entrée des Prussiens en France : l’échec de Brunswick (septembre 1792), l’annonce d’une nouvelle coalition l’engagèrent à remettre encore le signal du mouvement, soigneusement préparé et qui s’étendait à la Mayenne et à l’Avranchin. On a dit qu’il connaissait mal les hommes, et sa confiance en Chèvetel appuierait assez cette opinion ; et l’on a dit encore qu’il ne faisait pas assez de fond sur les campagnes, qu’il voyait trop les choses en militaire de l’ancienne armée, ignorant ou défiant des immenses ressources de l’âme populaire. Mais qu’en sait-on ? D’ailleurs Cadoudal ne s’était pas encore révélé et La Rouerie n’avait écarté ni Guillemot, qu’on appellera le roi de Bignan, ni Jean Cottereau dit Jean Chouan, faux-saunier et contumace, le parrain du mouvement. Il reste de toute façon que la plupart des gentilshommes à qui il avait distribué des commandements supérieurs et qui les exercèrent dans la suite ne trompèrent pas sa confiance : ni un Talmont dans la Mayenne, ni un Boisguy à Fougères, bien qu’à peine adulte, ni un Silz et un Tinténiac dans le Morbihan, ni un Boishardy dans les Côtes-du-Nord. Nous les retrouverons sur notre chemin, avec bien d’autres, inscrits sur les listes de La Rouërie et qui, sauf le prince de Talmont, n’appartenaient pas à l’aristocratie la plus huppée : petits hobereaux pour la plupart, haussés non sans peine au grade de lieutenant ou de capitaine dans l’armée royale et, parmi eux, Boisguy, un écolier. Mais c’est le propre des grandes crises sociales de brasser l’océan humain à la manière des tempêtes qui font monter à la surface les algues des profondeurs. Dans les deux camps adverses, les chefs qui s’affronteront seront des hommes nouveaux. La Révolution se délivre tout de suite des vieux figurants ; pour la soutenir, comme pour la combattre, elle ne veut que des jeunes premiers. Et, après avoir trop attendu, le mouvement peut-être se déclara trop tôt, avant même que le signal en eût été donné par La Rouërie : la précipitation de deux ou trois comparses, Charles Elliot à Rennes, René Maloeuvre à Lorient, qui tentèrent de soulever la garnison de ces villes, perdit tout. Mais dès lors que Danton avait en mains le plan de la conspiration, les noms des conspirateurs — dont douze seront arrêtés et périront sur l’échafaud —, pouvait-elle aboutir ? Les moindres démarches de La Rouërie étaient épiées, suivies, ses futaies, son manoir cernés ; il lui fallait changer chaque nuit de quartier général, courir de Saint- Ouen à la Fosse-Hingant, à la Baronnais, à la Ville-Even, l’admirable Thérèse de Moëlien en croupe, son domestique Saint-Pierre et son secrétaire Loisel sur une autre monture, avec les portemanteaux, les papiers, le trésor de la conspiration. Et, de surcroît, la maladie s’en mêle. Chassée de la Ville-Even, traquée de ferme en ferme, une nuit la petite troupe s’égare. Un temps sinistre : neige et rafales et le sourd gémissement de la forêt flagellée. La Rouërie, qui galope en tête, s’abat dans une douve glacée. On l’en retire grelottant. Une dernière gentilhommière perdue sous les chênes, La Guyomarais, le recueille à demi mort. Mais une telle volonté de vie et d’action est en lui qu’il ne désespère pas, conteste jusqu’à son mal, pleurésie aiguë ou congestion pulmonaire. Et d’ailleurs Thérèse est là, avec les trois médecins qu’elle a fait appeler : si Dieu dut jamais un miracle à son peuple, c’est aujourd’hui. Qu’il se dépêche donc, car l’étreinte des milices républicaines, alertées par Danton, se resserre autour de La Guyomarais ! On n’a que le temps de transporter le moribond dans une métairie voisine. Les hôtes sont sûrs, l'endroit écarté. Quelle fatalité suprême voulut qu’il y traînât un journal où était relatée l’exécution de Louis XVI que l’entourage de La Rouërie avait réussi jusqu’alors à lui cacher ? Il lit, se dresse, tord les poings, fulmine — et meurt (30 janvier 1793). Vivant, eût-il mené à bien sa tentative ? Devons-nous croire avec Bertrand Robidou, qui porta les premiers rayons dans cette pathétique intrigue, que, raccordée à temps au mouvement vendéen, l’habile conspiration de la Rouërie eût donné aux guerres de l’Ouest l’unité qui leur a manqué ? La trahison, dit-il, et la mort prématurée du chef la firent échouer. Elle laissa une foule de membres épars et compromis qui n’entreprirent rien avec ensemble. La contre-Révolution, en Bretagne, était tuée. Elle ne s’éleva jamais depuis — sauf dans l’épisode de Quiberon — à la hauteur d'une conception stratégique. Mais s’y fût-elle haussée avec La Rouërie lui-même ? Sur le papier peut-être, qui supporte tout. Dans la réalité, non, et le caractère anecdotique, populaire et dispersé, de cette guerre d’embuscades et de surprises était commandé à la fois par la nature des lieux et par les habitudes individualistes de leurs habitants. La Rouërie n’y eût pas plus échappé que ses successeurs, et déjà sa fin, cette agonie de bête traquée, est comme la préfigure de la mort de loups qui attend, sous leurs fourrés, les autres chefs de la Chouannerie. |