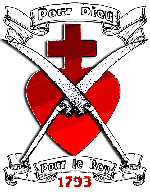LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE PREMIER. — LES ORIGINES DU MOUVEMENT.
|
LA Chouannerie, c’est sans doute une variété de guerre agraire, un hérissement des ajoncs, la lande du Faou qui s’insurge contre Paris, dira le vieil Hugo, et cependant elle n’est pas plus une guerre sociale qu’une guerre politique. A la différence des guerres agraires de l’antiquité, la possession du sol n’y est pas en cause ; les franchises bretonnes invoquées par les gentilshommes du clan de Botherel et de La Rouërie, l’établissement de la monarchie parlementaire rêvée par Puisaye, fadaises, nourriture de cerveaux creux. Le Chouan pur, le paysan, la peau de bique, la grande culotte, s’insurge uniquement contre la tyrannie de l’État républicain persécuteur de sa foi, non contre la forme de cet État. Les levées en masse, la conscription, les réquisitions, le maximum et le cours forcé achèveront de lui faire prendre le régime en horreur. Plus encore que la Vendée, on peut définir la Chouannerie un duel entre le réalisme terrien et le philosophisme révolutionnaire. Mais, à l’origine, la Révolution n’a pas de plus chaud partisan que ce même rustique qui va lui planter sa fourche dans le dos. L’agitation de la province, de 1789 à 1791, ne doit pas faire illusion : ces troubles de Rennes, Nantes, Vannes, Quimper, Lannion, Saint-Pol, etc., ne diffèrent pas essentiellement de ceux qu’on observe sur le reste du territoire, non plus que les sacs de châteaux et d’abbayes, les auto-dafé de titres féodaux ne diffèrent dans les campagnes bretonnes des brûleries et des sacs de même ordre dont pâtissent les autres provinces. Sorte d’impétigo, d’éruption violente, déterminée dans le corps du pays par la brusque subversion qui s’y est produite ; par les espérances immodérées, les invraisemblables illusions dont se repaît l’imagination des masses depuis cette entrée dans le Chanaan révolutionnaire ; par la difficulté, presque, l’impossibilité de substituer du jour au lendemain un système d’administration à un autre ; par les conditions défectueuses de vie qui en résultent et que sont venus aggraver la disette des grains, l’évasion du numéraire, le développement du vagabondage et, en Basse-Bretagne et dans le Bas-Maine spécialement, l’arrêt à peu près total du commerce de la toile, principale ressource des deux tiers de nos campagnes, dit un contemporain, Le Vaillant, de Pleudaniel.... Ces troubles, quoi qu’il en soit, n’ont aucun caractère anticonstitutionnel : tantôt, comme à Lannion et à Tréguier, il s’agit d’un conflit au sujet de l’attribution d’un convoi de blé ; tantôt, comme à Quimper, d’une coalition des débitants pour se soustraire à l’impôt sur les vins qu’ils pensent aboli avec toute l’ancienne fiscalité. A Brest seulement, l’indiscipline des équipages, le vieil antagonisme entre les officiers nobles, dont la morgue passait toute créance, et les officiers bleus ou roturiers, l’imprudence des uns, les excitations des autres, aboutissaient à de véritables émeutes, des chasses à l’homme dignes du pavé parisien : maintes têtes sont déjà promenées au bout des piques ; M. de Marigny, major général de la Marine, est pendu en effigie à la porte de sa femme ; M. de La Jaille, commandant du Duguay-Trouin, saisi, colleté, assommé, n’échappe à la mort que par l’intervention d’un charcutier herculéen du nom de Lauvergat. Réparant ses anciens torts et poussant l’esprit de renoncement jusqu'au point où il eût cessé d’être compatible avec l’honneur et la fidélité au trône, le Grand-Corps, son chef, le comte d’Hector en tête, s’est pourtant plié de bonne grâce aux exigences du nouveau régime et a tout fait pour ramener la concorde sur les vaisseaux : son temps est passé, son autorité méconnue et, s’il ne veut être pendu autrement qu’en effigie, il n’a plus qu’à émigrer. L’exemple vient de haut, d’ailleurs, et lui a été donné, à peine la Bastille tombée, par les plus grands personnages du royaume, le comte d’Artois, les ducs d’Angoulême et de Berry, les princes de Condé, de Conti, les Guiche, les Broglie, les Vaudémont, les Lambesc, les Polignac, l’ex-garde des sceaux Barentin, etc. Dans la province même, nombre de gentilshommes résidant, justement alarmés par les derniers événements qui prennent toute la tournure d’une jacquerie, ont gagné avec leurs familles le port le plus proche d’où ils n’ont fait qu'un saut jusqu’à Jersey ou à Plymouth. La paysantaille, armée jusqu’aux dents, ne se bornait point à forcer l’entrée des châteaux et à faire main basse sur les titres des chartriers qu’elle emportait pour les noyer ou qu’elle brûlait sur place, les fusillant quelquefois, comme à Châteauneuf, pour plus de précaution, avant de les jeter dans le vivier : s’il arrivait qu’on lui résistât, elle se fâchait rouge et tantôt, comme au château de Beaumanoir, elle mutilait une futaie centenaire ; tantôt comme à Coatlau, chez le marquis de Guer, elle brûlait une bibliothèque privée de 30.000 volumes ; tantôt, comme au Kerlouet, elle attachait la châtelaine — en l’espèce la vieille et charitable marquise de Roquefeuil — à la poulie de son puits et la trempait dans l’eau glacée jusqu’à ce qu’elle eût cédé ; tantôt, enfin, comme chez M. de Pinieu, à qui furent dérobés, au témoignage de Limon du Tymeur, 11.000 livres d’argent comptant, elle promenait la torche dans les appartements et grillait l’immeuble avec les papiers. A la date du 19 février 1790, ce même Limon du Tymeur, beau-frère de La Tour d’Auvergne, comptait ainsi dans la province plus de 22 châteaux pillés, brûlés ou dévastés, sans compter l’abbaye des Bénédictins de Redon, et, comme il allait clore sa lettre, il apprenait encore l’incendie de deux autres châteaux, Bruc et Renac, sur la route de Rennes à Nantes.... Le courant d'émigration s’en accélérait d’autant, à la grande joie des uns, au grand dépit des autres, comme Limon, qui cherchait par qui ou par quoi remplacer les nobles dans ces campagnes qu’ils comblaient de charité et de bienfaisance[1]. La Grande Peur semble avoir été tout à fait étrangère à ces mouvements qui commencèrent le ii août 1789 avec le sac du Kerlouet (Finistère) et, par Plounévez-Moëdec, Plouër, Ploubalay — sacs du Marquès, de Beaumanoir, du Chêne-Ferron, etc. —, s’étendirent peu à peu à toute la province avec des relâches, des reprises, une intensité particulière autour de Dinan et dans l’Ille-et-Vilaine, même dans certaines paroisses morbihannaises de la sénéchaussée de Ploërmel où deux vieillards, M. de Villeneuve et sa femme, sont chauffés, même en Loire-Inférieure — sac des hôtels de MM. de Granville et du Halgouët — et jusque dans la Mayenne — incendie et sac des châteaux de Cuillé et d’Hauteville —. L’on pénètre difficilement le motif de ces ravages et d’où en peut venir l’impulsion, écrivait à son correspondant Limon du Tymeur qui constatait cependant que parmi les brigands, tous armés de sabres, fusils, haches, fourches, couteaux attachés au bout des bâtons, se trouvaient beaucoup de déserteurs, cartouches jaunes... qui ont soulevé et attroupé des paysans de chaque endroit. Il se peut bien en effet que l’étincelle soit venue de cette racaille et des vagabonds que Paris refoulait vers les provinces et auxquels on devait payer trois sous par lieue, mais qui ne se contentaient point toujours de cette dérisoire indemnité de chômage : ce qu’il y a de sûr, c'est que la matière où l’étincelle tombait était particulièrement inflammable, au point qu’en certains endroits elle prit feu toute seule. C’est au domaine congéable — mode de fermage dans lequel la surface appartenait aux tenanciers, le fond aux bailleurs, et qui eût été très tolérable sans les lourdes servitudes féodales dont il s’accompagnait — que les paysans bretons en voulaient surtout : les cahiers des paroisses s’étaient montrés unanimes à le dénoncer et leurs rédacteurs n’avaient pas eu besoin là- dessus d’être soufflés par les robins. Les incendies, les pillages, les immenses soûleries terminées en coliques de miserere, où l’on mettait à sec des caves entières et jusqu’à la pharmacie du château, même les violences et les meurtres ne sont que l’accessoire : l’abolition du régime domanial est la grande affaire, et quel moyen plus radical d’en assurer l’abolition que de briller, de noyer, de détruire les titres qui l’établissent, ces rentiers et ces registres terriers que l’imprudente aristocratie bretonne, à la veille de la Révolution, s’est avisée sottement de faire remettre à jour ? Les directoires de district s’en rendaient parfaitement compte : ils détachaient bien au début contre les brigands quelque colonne de gardes nationaux, un peloton de dragons ou de hussards qui sabrait cette canaille ; à la fin ils laissèrent faire et les émeutiers ne furent plus poursuivis, ou, poursuivis, s’en retournèrent acquittés. En somme, directoires urbains et insurgés ruraux n’avaient-ils point le même ennemi, cette noblesse qu’il s’agissait d’évincer, ceux-ci en lui prenant le pouvoir politique, ceux-là, disposant déjà de la surface du sol, en s’appropriant le fond ? Ainsi, au début de la Révolution, rien ne sépare en Bretagne la classe paysanne de la bourgeoisie, et tout les rapproche ; elle est même si peu suspecte de tiédeur envers les idées nouvelles, cette Bretagne des guiraour (domaniers) cornouaillais et vannetais et des métayers du haut pays, elle apporte tant de feu à l’épuration du territoire, n’attendant pas toujours la promulgation des décrets pour en assurer par main propre l’exécution, que sa commère la bourgeoisie, plus rassise, plus formaliste, serait tentée de lui dire comme Elmire à Mme Pernelle : Vous marchez d’un tel pas qu’on a peine à vous suivre !... Le clergé observe-t-il une attitude différente ? Le haut clergé, oui. Cependant, quoiqu’il ait refusé avec la noblesse de députer aux États, il ne se déclare pas tout de suite : Mgr Conan de Saint-Luc, évêque de Quimper, l’ennemi personnel des francs-maçons qu’il dénonce et traque sans pitié depuis son avènement, est d’ailleurs fort vieux et malade ; Mgr de Bellescize, évêque de Saint- Brieuc, ne réside pas ; Mgr de La Marche lui-même, bien qu'ancien lieutenant de dragons, garde tout d’abord ou semble garder, dans son diocèse du Léon, une attitude expectante. Semblablement, Mgr de Hercé, évêque et comte de Dol et le futur martyr de Quiberon, qui n’élève de réserves contre les décrets en préparation que dans la fête civique du 21 mars 1790. Seul Mgr Le Mintier, évêque et comte de Tréguier, part en guerre sans plus attendre. Son fameux mandement, où il dénonçait le philosophisme régnant comme la source de tous les maux contemporains et protestait avec virulence contre les réformes de la Constituante, qu’il qualifiait d’innovation dangereuse, est du 14 septembre 1789. Lorsque le premier, le plus illustre trône de l’univers est ébranlé jusque dans ses fondements, écrivait-il, lorsque les mouvements convulsifs de la capitale se font sentir dans les provinces les plus reculées, serait-il permis à un évêque de garder le silence ? Hélas ! qu’elle est différente d’elle-même, cette monarchie française, le plus beau domaine de l’Église catholique, et quel est le ministre des autels dont les entrailles ne seraient pas déchirées ? La religion est anéantie, ses ministres sont réduits à la triste condition de commis appointés des brigands.... Évidemment — et si c’est là le texte exact de son mandement — cet évêque ne mâchait pas ses mots. Traiter de brigands la majorité de l’Assemblée nationale, avant même qu’elle eût abordé le projet de réforme ecclésiastique et quand elle n’avait à son passif que la suppression des dîmes remplacées par un traitement fixe, excédait peut- être la liberté de langage permise à un haut dignitaire de l’Église. C’est le 29 mai 1790 seulement, près de neuf mois après la publication du mandement de Mgr Le Mintier, que s’ouvrirent les débats sur la Constitution civile du clergé ; c’est le 12 juillet que fut promulgué le décret sur cette Constitution, et il faudra encore cinq mois pour que le serment soit imposé. On ne peut refuser néanmoins à Mgr Le Mintier un certain don de prophétie. Les scènes de jacquerie qui avaient commencé d’éclater étaient une autre excuse à sa fougueuse offensive contre les chimères des systèmes d’égalité dans les rangs et dans les fortunes proposés à la crédulité du pays. Tel fut sans doute le sentiment des juges du Châtelet devant lesquels dut comparaître l’irascible et trop clairvoyant prélat : passant outre au rapport du député Alquier, nettement défavorable au prévenu sur les deux chefs principaux d’accusation, excitation des populations rurales à la révolte, entente criminelle avec les nobles de son diocèse pour affaiblir les milices urbaines et leur substituer une organisation de résistance, ils le renvoyèrent des fins de la plainte après onze mois d’enquêtes et de contre-enquêtes. Mais il est vrai que dans l’intervalle Mgr Le Mintier avait daigné bénir les drapeaux de la garde nationale de Saint-Brieuc : la Terreur n’était point encore à l’ordre du jour, et cette concession le sauva. Reste le bas clergé. Pas d’hésitation ici : en très grande majorité, pour ne pas dire en totalité, les simples prêtres, recteurs, vicaires, etc., ainsi que les réguliers des différents ordres établis dans la province, sont acquis aux idées nouvelles, — même des saints hommes comme cet abbé Cormaux promis à la guillotine et qu’invoqueront dans leurs litanies nocturnes ses paroissiens de Plaintel : Des habits bleus et des juroux, O saint Cormaux, délivrez-nous !... La réforme du clergé le scandalise et l’effraie si peu qu’il la prône publiquement à ses confrères, bien mieux qu’il accepte, après le 9 juin 1790, où il a prêché dans la cathédrale de Saint-Brieuc sur les beautés de la Constitution, les fonctions de président du district. Ab uno.... En somme, la Révolution ne trouve contre elle, en Bretagne, jusqu’en 1791, que les coquins d’aristocrates, pour parler à la façon de l’avocat lannionnais Rivoalan, si prompt à oublier les services rendus par ces alliés de la veille. Car, en 1788 encore, noblesse et tiers bataillaient côte à côte pour la sauvegarde des franchises bretonnes, la restitution du droit de remontrance aux parlements : ils ne mangeront point tout le minot de sel ensemble, comme dit le peuple, et cette belle entente aura duré quelques mois, le temps de forcer la main au faible Louis XVI. En réalité le tiers se souciait bien de la duchesse Anne et de son contrat gothique ! Mais tout lui était bon qui pouvait affaiblir la Couronne et favoriser sa propre ascension. Cela a fini, comme il était logique, par des horions et quelques tués et blessés dans les rues de Rennes. Force est restée au tiers qui réclamait le doublement de sa représentation aux Etats : première victoire, présage de beaucoup d’autres et dont le retentissement est énorme. On chantera bientôt dans Paris : Vivent les Marseillois, Les Bretons et nos lois ! Que n’attendait-on pas de ces têtes chaudes ! Toute la France a les yeux tournés vers la Bretagne, pouvait écrire de Paris sans la moindre hyperbole, le 19 janvier 1789, Jacques Violard, et tout le monde nous accoste pour demander si nous commençons à nous battre chez nous. Bien obligés. Mais il faudra patienter encore un peu avant qu’on en vienne sérieusement aux prises, et ce ne sera pas la faute des gentilshommes. Aux élections pour les États généraux, plutôt que d’accepter le vote par tête, la dure loi du nombre, la noblesse bretonne s’est dédaigneusement retirée, suivie du haut clergé : ni l’un ni l’autre, tenus désormais pour ennemis de la chose publique, ne députeront à l’Assemblée nationale. Bouderie stupide qui faussera la balance de la représentation bretonne, la privera du contrepoids nécessaire. Toute l’influence passera au tiers, à la robinocratie. Mais, d’une part, les paysans qui se flattaient, par la destruction des titres, de pouvoir mettre la main sur le sol, vont s’apercevoir, quand la vente des biens nationaux aura opéré le transfert de la propriété rurale, qu’ils ne sont point les bons marchands de l’opération et qu’ils n’ont fait en somme que troquer des maîtres assez accommodants dans l’ensemble contre d’autres beaucoup plus exigeants ; le petit desservant, de son côté, ne verra pas sa condition grandement améliorée par l'abolition des dîmes, des prébendes, des canonicats et la confiscation des biens de mainmorte, même du bout de jardinet de sa cure, qui profitera encore à la seule classe bourgeoise dont l’appétit extraordinaire engloutirait tout le royaume. La situation commence visiblement à se retourner : voilà deux fractions du tiers dont l’enthousiasme révolutionnaire est déjà bien refroidi. Il serait d’une bonne politique de le réchauffer, de l’entretenir, comme on fait pour la classe artisane qui n’a pas beaucoup plus gagné que les fractions précédentes à la Révolution et qu’on amuse de fêtes civiles, de manifestations oratoires, qu’on tient par les clubs, les sections, l’embrigadement dans les milices urbaines et les bas services publics, par la sportule quotidienne. En outre, l’ouvrier des villes est volontiers esprit fort, disposé donc à recevoir sans autre examen le nouvel évangile démocratique né au sein de l’Assemblée nationale de la collaboration des jansénistes, des gallicans et des disciples de Rousseau et connu sous le nom de Constitution civile du clergé. Mais le bas clergé lui-même et, avec lui, la classe paysanne presque tout entière, déjà bien aigrie, méfiante de ce papier qui a remplacé le numéraire et qu’achèvera de discréditer le cours forcé, ne seront point d’esprit aussi accommodant. Ils ne font qu’un au demeurant, ruraux et prêtres : la classe paysanne se reconnaît, se retrouve dans ces humbles desservants de village, recteurs, vicaires, qui lui parlent sa langue, tâtent de son brouet et goûtent à sa piquette, qui, bien qu’assez dénués pour la plupart, ne se montrent point trop exigeants, — ce pourquoi la dîme, qu’on ne paie qu’en rechignant à l’abbaye, on continuera de l’acquitter volontairement entre leurs mains après qu’elle aura été supprimée, — qui ne sont point non plus si sots ni si ignorants qu’on le dit — tel recteur de Buhulien, au XVIIIe siècle, encourra le blâme de ses paroissiens pour l’abus qu’il fait du grec dans ses prônes —, qui n’ont point enfin les mœurs relâchées du clergé des villes et de qui le respect qu’inspire leur caractère sacerdotal n’est point gâté par des réserves sur leurs personnes. Ils sont peuple, comme leur troupeau ; toucher à eux, c’est toucher à lui. On le vit tout de suite, ha Constitution civile du clergé, avec le changement de personnel ecclésiastique qui en fut la conséquence, telle est la première cause du mécontentement des campagnes, mécontentement général, mais plus ou moins profond, qui revêtit des formes très diverses, s’apaisa même assez rapidement sur beaucoup de points et prit en d’autres, tant en Bretagne que dans les provinces limitrophes (Normandie, Maine, Anjou), la forme aiguë à laquelle on a donné le nom de Chouannerie. |