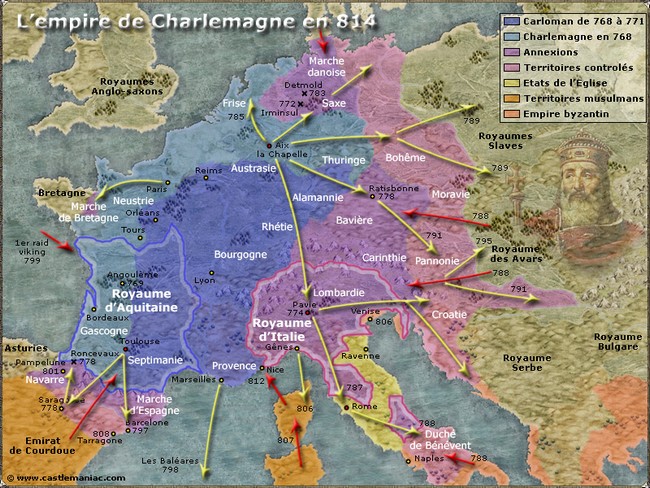Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
CHAPITRE XLIX
Introduction, culte et persécution des images. Révolte de l’Italie et de Rome. Domaine temporel des papes. Conquête de l’Italie par les Francs. Etablissement des images. Caractère et couronnement de Charlemagne. Rétablissement et décadence de l’empire romain en Occident. Indépendance de l’Italie. Constitution du corps germanique.
|
JE n’ai envisagé l’Église que dans ses rapports avec l’État et dans les avantages qu’elle procure aux corps politiques ; manière de voir à laquelle il serait bien à désirer qu’on se fût tenu inviolablement attaché dans les faits ainsi que dans mon récit. J’ai eu soin de laisser à la curiosité des théologiens spéculatifs la philosophie orientale des gnostiques, l’abîme ténébreux de la prédestination et de la grâce, et la singulière transformation qui s’opère dans l’eucharistie lorsque la représentation du corps de Jésus-Christ se convertit en sa véritable substance[1] ; mais j’ai exposé avec soin et avec plaisir ceux des faits de l’histoire ecclésiastique qui ont influé sur la décadence et la chute de l’empire romain, tels que la propagation du christianisme, la constitution de l’Église catholique, la ruine du paganisme, et les sectes qui sont sorties des controverses mystérieuses élevées touchant la Trinité et l’Incarnation. On doit mettre au rang des principaux faits de cette espèce le culte des images, qui occasionna des disputes forcenées aux huitième et neuvième siècles, puisque cette question d’une superstition populaire a produit la révolte de l’Italie, le domaine temporel des papes et le rétablissement de l’empire romain en Occident. Les premiers chrétiens étaient dominés d’une invincible, répugnance pour les images ; on peut attribuer cette aversion à leur origine judaïque et leur éloignement pour les Grecs. La loi de Moïse avait sévèrement défendu tous les simulacres de la Divinité, et ce précepte avait jeté de profondes racines dans la doctrine et les mœurs du peuple choisi. Les apologistes de la religion chrétienne employèrent tous les traits de leur esprit contre les idolâtres qui se prosternaient devant l’ouvrage de leurs mains, devant ces images d’airain ou de marbre[2], qui, si elles eussent été douées de mouvement et de vie, auraient dû plutôt s’élancer de leur piédestal pour adorer la puissance créatrice de l’artiste. Quelques gnostiques qui venaient d’embrasser la religion chrétienne, accordèrent peut-être aux statues de Jésus-Christ et de saint Paul, dans les premiers moments d’une conversion mal assurée, les profanes honneurs qu’ils avaient rendus à celles d’Aristote et de Pythagore[3], mais la religion publique des catholiques fut toujours uniformément simple et spirituelle, et il est question des images pour la première fois dans la censure du concile d’Illibéris, trois cents ans après l’ère chrétienne. Sous les successeurs de Constantin, dans la paix et l’abondance dont jouissait l’Église triomphante, les plus sages d’entre les évêques crurent devoir, en faveur de la multitude, autoriser une sorte de culte capable de frapper les sens ; depuis la ruine du paganisme, ils ne craignaient plus un parallèle odieux. Ce fut par les hommages rendus à la croix et aux reliques que commença à s’introduire ce culte symbolique. On plaçait à la droite de Dieu, les saints et les martyrs dont on implorait les secours ; et la foi du peuple aux faveurs bienfaisantes et souvent miraculeuses qui se répandaient autour de leur tombeau, était affermie par cette foule de dévots pèlerins, qui allaient voir, toucher et baiser la dépouille inanimée qui rappelait leur mérite et leurs souffrances[4] ; mais une fidèle représentation de la personne et des traits du saint, reproduite par les moyens de la peinture, ou de la sculpture, offrait des souvenirs encore plus intéressants que son crâne ou ses sandales. La tendresse particulière ou l’estime publique a mis dans tous les temps beaucoup d’intérêt à ces représentations si analogues aux affections humaines. On prodiguait des honneurs civils et presque religieux aux images des empereurs romains ; les statues des sages et dès patriotes recevaient des hommages moins fastueux, mais plus sincères ; et ces profanes vertus, ces brillants péchés disparaissaient en présence des saints, personnages qui s’étaient dévoués à la mort pour leur éternelle et céleste patrie. On fit d’abord l’essai du culte des images avec précaution et avec scrupule ; on les permettait pour instruire les ignorants, pour exciter les dévots peu fervents, et se conformer aux préjugés des païens, qui avaient embrassé ou qui désiraient d’embrasser le christianisme. Par une progression insensible, mais inévitable, les honneurs accordés à l’original se tendirent à la copie ; le dévot priait devant l’image d’un saint ; et la génuflexion, les cierges allumés, l’encens et d’autres cérémonies païennes, s’introduisirent dans l’Église. Le puissant témoignage des visions et des miracles vint imposer silence aux scrupules de la raison et de la piété. On pensa que des images qui parlaient, se remuaient et versaient du sang, devaient avoir une force divine, et pouvaient être l’objet d’une adoration religieuse. Le pinceau le plus hardi devait trembler de l’audacieuse pensée de rendre, par des traits et des couleurs, l’esprit infini, le Dieu tout puissant qui pénètre et soutient l’univers[5] ; mais un esprit superstitieux se prêtait, avec moins de peine, à peindre, à adorer, les anges, et particulièrement le fils de Dieu, sous la forme humaine qu’il avait daigné adopter pendant son séjour. Sur la terre. La seconde personne de la Trinité s’était revêtue d’un corps réel et mortel ; mais ce corps était monté au ciel, et si on n’en eût pas offert quelque simulacre aux yeux de ses disciples, les restes ou les images des saints auraient effacé le culte spirituel de Jésus-Christ. On dut permettre, par les mêmes motifs, les images, de la sainte Vierge ; on ignorait le lieu de sa sépulture ; et la crédulité des Grecs et des Latins s’était, hâtée d’adopter l’idée de son assomption en corps et en âme dans les régions du ciel. L’usage et même le culte des images était bien établi avant la fin du sixième siècle. Il plaisait à l’imagination brillante des Grecs et des Asiatiques : de nouveaux emblèmes ornèrent le Panthéon et le Vatican ; mais les Barbares plus grossiers et les prêtres ariens de l’Occident se livrèrent plus froidement à cette apparence d’idolâtrie. Les formes hardies des statues d’airain ou de marbre qui remplissaient les temples de l’antiquité, blessaient l’imagination ou la conscience des chrétiens grecs ; et les simulacres qui n’offraient qu’une surface coloriée et sans relief, ont toujours paru plus décents et moins dangereux[6]. Le mérite et l’effet d’une copie dépendent de ressemblance avec l’original ; mais les premiers chrétiens ne connaissaient pas les véritables traits du fils de Dieu, de sa mère ou de ses apôtres. La statue de Panéas en Palestine[7], qu’on croyait être celle de Jésus-Christ, était vraisemblablement celle d’un sauveur révéré seulement rôtir des services temporels. On avait condamné les gnostiques et leurs profanes monuments ; et l’imagination des artistes chrétiens ne pouvait être guidée que par une secrète imitation de quelque modèle du paganisme. Dans cet embarras, on eût recours à une invention hardie autant qu’adroite, et qui établissait à la fois la parfaite ressemblance de l’image et l’innocence du culte qu’on lui rendait. Une légende de Syrie sur la correspondance de Jésus-Christ et du roi Abgare, fameuse au temps d’Eusèbe, et que des écrivains modernes ont abandonnée avec tant de regret, servit de fondement à une nouvelle fable. L’évêque de Césarée[8] rapporte la lettre d’Abgare à Jésus-Christ[9] mais, ce qu’il y a de singulier, il ne parle pas de cette empreinte exacte[10] de la figure de Jésus-Christ sur un linge dont le Sauveur du monde récompensa la foi de ce prince qui avait invoqué sa puissance dans une maladie, et lui avait offert la ville fortifiée d’Édesse, afin de le mettre à l’abri de la persécution des Juifs. Pour expliquer l’ignorance où était restée à cet égard la primitive Église, on supposa que cette empreinte avait été longtemps emprisonnée dans une niche d’un mur, d’où, après un oubli de cinq siècles, elle fut tirée par un évêque prudent, et offerte, au temps propice, à la dévotion de ses contemporains. La délivrance de la ville attaquée par Chosroès Nushirwan fut le premier miracle qu’on lui attribua : bientôt on la révéra comme un gaga qui, d’après la promesse de Dieu, garantissait Édesse contre les armes de tout ennemi étranger. Il est brai que le texte de Procope attribue la délivrance d’Édesse à la richesse et à la valeur des citoyens, qui achetèrent l’absence du monarque persan, et repoussèrent ses attaques ; il ne se doutait pas, ce profane historien, du témoignage qu’on le force de rendre dans l’ouvrage ecclésiastique d’Evagrius, où Procope assure que le palladium fut exposé sur les murs de la ville, et que l’eau lancée sur la sainte face allumait, au lieu de les éteindre, les flammes jetées par les assiégés. Après cet important service, on conserva l’image d’Édesse avec beaucoup de respect et de reconnaissance ; et si les Arméniens ne voulurent point admettre la légende, les Grecs plus crédules adorèrent cette représentation de la figure du Sauveur du monde, qui n’était pas l’ouvrage d’un mortel, mais une production immédiate du divin original. Le style et les idées d’une hymne chantée par les sujets de Byzance, montreront en quoi le culte rendu par eux aux images s’éloignait du système grossier des idolâtres. Avec des yeux mortels comment pourrons-nous regarder cette image dont les saints qui sont au ciel n’osent pas envisager la céleste splendeur ? Celui qui habite les cieux daigne nous honorer aujourd’hui de sa visite par une empreinte digne de nos respects : celui qui est assis au-dessus des chérubins, vient se présenter aujourd’hui à notre adoration dans un simulacre que notre père tout-puissant a fait de ses mains sans tache, qu’il a formé d’une manière ineffable, et que nous devons sanctifier en l’adorant avec crainte et avec amour. Avant a fin du sixième siècle, ces images faites sans mains, comme les Grecs l’exprimaient par un seul mot[11], étaient communes dans les armées et les villes de l’empire d’Orient[12]. Elles étaient des objets de culte et des instruments de miracles. Au moment du danger, ou au milieu du tumulte, leur présence révérée rendait l’espérance, ranimait le courage ou réprimait la fureur des légions romaines. La plus grande partie de ces images, n’étant que des imitations faites par la main de l’homme, ne pouvaient prétendre qu’à une ressemblance imparfaite, et c’était à tort qu’on leur appliquait le même titre qu’à la première image ; mais il y en avait de plus imposantes, produites par un contact immédiat avec l’original, doué à cet effet d’une vertu miraculeuse et prolifique. Les plus ambitieuses prétendaient, non pas descendre de l’image d’Édesse, mais avoir avec elle des rapports de fraternité ; telle est la véronique de Rome, d’Espagne ou de Jérusalem, mouchoir que Jésus-Christ, lors de son agonie et de sa sueur de sang, avait appliqué sur son visage, et remis à une des saintes femmes. Bientôt il y eut des véroniques de vierge Marie, des saints et des martyrs. On montrait, dans l’église de Diospolis, ville de la Palestine, les traits de la mère de Dieu[13], empreints jusqu’à une assez grande profondeur sur une colonne de marbre. Le pinceau de saint Luc avait décoré, disait-on, les Églises d’Orient et d’Occident ; et on a supposé que cet évangéliste, qui paraît avoir été un médecin, avait exercé le métier de peintre, métier, aux yeux des premiers chrétiens, si profane et si odieux. Le Jupiter Olympien, créé par le génie d’Homère et le ciseau de Phidias, pouvait inspirer à un philosophe une dévotion momentanée ; mais les images catholiques, productions sans force et sans relief, sorties de la main des moines, attestaient le dernier degré de dégénération de l’art et du génie[14]. Le culte des images s’était introduit peu à peu dans l’Église, et chacun des progrès de cette innovation était favorablement accueilli par l’esprit superstitieux, comme augmentant le nombre des moyens de consolation qu’on pouvait se permettre sans péché. Mais au commencement du huitième siècle, lorsque l’abus fut dans toute sa force, quelques Grecs d’une conscience timorée commencèrent à craindre d’avoir, sous les dehors du christianisme, rétabli la religion de leurs ancêtres ; ils ne pouvaient supporter sans douleur et sans impatience le nom d’idolâtres que leur donnaient sans cesse les Juifs et les musulmans[15], à qui la loi de Moïse et le Koran inspiraient une haine immortelle pour les images taillées, et toute espèce de culte qui pouvait y avoir rapport. La servitude des Juifs affaiblissait leur zèle et donnait peu d’importance à leurs accusations ; mais les reproches des musulmans triomphants, qui régnaient à Damas et menaçaient Constantinople, avaient tout le poids que peuvent donner la vérité et la victoire. Les villes de la Syrie, de la Palestine et de l’Égypte, étaient munies d’images de Jésus-Christ, de sa mère et des saints, et chacune de ces places avait l’espoir où comptait avoir la promesse d’être défendue d’une manière miraculeuse. Les Arabes subjuguèrent en dix années ces villes et leurs images ; et, selon leur opinion, le Dieu des armées prononça un jugement décisif sur le mépris, que devaient inspirer ces idoles muettes et inanimées[16]. Édesse avait résisté longtemps aux attaques du roi de Perse ; mais cette ville de prédilection, l’épouse de Jésus-Christ, se trouva enveloppée dans la ruine commune, et l’empreinte du visage du Sauveur du monde devint un des trophées de la victoire des infidèles. Après trois siècles de servitude, le palladium fut rendu à la dévotion de Constantinople, qui pour l’obtenir paya douze mille livres d’argent, remit en liberté deux cérats musulmans, et promit de s’abstenir à jamais, de tout acte d’hostilité contre le territoire d’Édesse[17]. A cette époque de détresse et de crainte, les moines employèrent toute leur éloquence à défendre les images ; ils voulurent prouver que les péchés et le schisme de la plus grande partie des Orientaux avaient aliéné la faveur et anéanti la vertu de ces précieux symboles ; mais ils eurent contre eux les murmures d’une foule de chrétiens ou simples ou raisonnables, qui invoquèrent les textes, les faits et l’exemple des temps primitifs, et qui désiraient en secret la réforme de l’Église. Comme le culte des images n’avait été établi, par aucune loi générale ou positive, ses progrès, dans l’empire d’Orient fuirent retardés où accélérés selon les hommes et selon les dispositions du moment, selon les divers degrés des lumières répandues dans les diverses contrées, et selon le caractère particulier des évêques. L’esprit léger de la capitale et le génie inventif du clergé de Byzance s’attachèrent avec chaleur à un culte tout de représentation tandis que les cantons éloignés de l’Asie, plus grossiers dans leurs mœurs, montraient peu de goût pour cette espèce de faste religieux. De nombreuses congrégations de gnostiques et d’ariens gardèrent après leur conversion le culte simple qu’ils avaient suivi avant d’avoir abjuré, et les Arméniens, les plus guerriers des sujets de Rome, n’étaient pas réconciliés, au douzième siècle, avec la vue des images[18]. Tous ces noms divers amenèrent des préventions et des haines qui produisirent peu d’effet dans les villages de l’Anatolie et de la Thrace, mais qui influèrent souvent sur la conduite du guerrier, du prélat ou de l’eunuque parvenu aux premières dignités de l’Église ou de l’État. Le plus heureux de tous ces aventuriers fut l’empereur Léon III[19], qui, des montagnes de l’Isaurie, passa sur te trône de l’Orient. Il ne connaissait ni la littérature sacrée ni la littérature profane ; mais son éducation rustique et guerrière, sa raison, et peut-être son commerce avec les Juifs et les Arabes, lui avaient inspiré de l’aversion pour les images, et l’on regardait alors comme le devoir d’un prince le soin d’obliger ses sujets à régler leur conscience sur la sienne. Toutefois, dans les commencements d’un règne mal affermi, durant dix années de travaux et de dangers, Léon se soumit aux bassesses de l’hypocrisie ; il se prosterna devant des idoles qu’il méprisait au fond du cœur, et rassura chaque année le pontife romain par une déclaration solennelle de son zèle pour l’orthodoxie. Lorsqu’il voulut réformer la religion, ses premières démarches furent circonspectes et modérées : il assembla un grand conseil de sénateurs et d’évêques, et ordonna, d’après leur aveu, d’enlever toutes les images du sanctuaire et de l’autel, de les placer dans les nefs à une hauteur où on pût les apercevoir, et où la superstition du peuple ne pourrait atteindre ; mais il n’y eut pas moyen de réprimer de l’un et de l’autre côté l’impulsion rapide de la vénération et de l’horreur : les saintes images placées a cette hauteur édifiaient toujours les dévots et accusaient le tyran. La résistance et des invectives irritèrent Léon lui-même. Son parti l’accusait de mal remplir ses devoirs, et lui proposa pour modèle le roi juif qui avait brisé le serpent d’airain. Un second édit ordonna non seulement l’enlèvement, mais la destruction des tableaux religieux. Constantinople et les provinces furent purifiées, de toute espèce d’idolâtrie : les images de Jésus-Christ, de la mère de Dieu et des saints, furent détruites, et on revêtit d’une légère couche de plâtre les murailles des édifices. La secte des iconoclastes eut pour appui le zèle et le pouvoir despotique de six empereurs, et durant cent vingt années, l’Orient et l’Occident retentirent de cette bruyante querelle. Léon l’Isaurien voulait faire de la proscription des images un article de foi sanctionné par l’autorité d’un concile général ; mais ce concile ne fut assemblé que sous son fils Constantin, et quoique le fanatisme de la secte triomphante l’ait représenté comme une assemblée d’imbéciles et d’athées[20], ce qui nous reste de ses actes dans quelques fragments mutilés, laisse apercevoir de la raison et de la piété. Les discussions et les décrets de plusieurs synodes provinciaux avaient amené ce concile général qui se tint dans les faubourgs de Constantinople, et fut composé de trois cent trente-huit évêques de l’Europe et de l’Anatolie, car les patriarches d’Antioche et d’Alexandrie étaient alors esclaves du calife, et les pontifes de Rome avaient détaché de la communion des Grecs les Églises d’Italie et d’Occident. Le concile de Byzance s’arrogea le titre et le pouvoir de septième concile général ; cependant c’était reconnaître les six conciles généraux antérieurs, qui avaient établi d’une manière si laborieuse l’édifice de la foi catholique. Après une délibération de six mois, les trois cent trente-huit évêques déclarèrent et signèrent unanimement que tous les symboles visibles de Jésus-Christ, excepté dans l’Eucharistie, étaient blasphématoires ou hérétiques, et que le culte des images dérogeait à la pureté de la foi chrétienne et ramenait au paganisme ; qu’il fallait effacer ou anéantir de pareils monuments d’idolâtrie ; que ceux qui refuseraient de livrer les objets de leurs superstitions particulières se rendraient coupables de désobéissance à l’autorité de l’Église et de l’empereur. Leurs bruyantes acclamations célébrèrent les mérites de leur rédempteur temporel, et, ils confièrent à son zèle et à sa justice l’exécution de leurs censures spirituelles. A Constantinople, de même que dans les conciles précédents, la volonté du prince fut la règle de la foi épiscopale ; mais je suis tenté de croire qu’en cette occasion un grand nombre de prélats sacrifièrent à des vues d’espérance ou de crainte les opinions de leur conscience. Durant cette, longue nuit de superstition les chrétiens s’étaient écartés de la simplicité foi de l’Évangile, et il n’était pas aisé pour eux de suivre le fil et de reconnaître les détours du labyrinthe. Dans l’imagination d’un dévot, le culte des images se trouvait lié d’une manière inséparable avec la croix, la Vierge, les saints et leurs reliques. Les miracles et les visions enveloppaient de nuages la base de cet édifice sacré, et les habitudes de l’obéissance et de la loi avaient engourdi les deux puissances de l’esprit, la curiosité et le scepticisme. On accuse Constantin lui-même de doute, d’incrédulité, ou même de quelques plaisanteries royales sur les mystères des catholiques[21] ; mais ces mystères se trouvaient bien établis dans le symbole public et privé de ses évêques, et l’iconoclaste le plus audacieux ne dut attaquer qu’avec une secrète horreur les monuments de la superstition populaire, consacrés à la gloire des saints qu’il regardait encore comme ses protecteurs auprès de Dieu. Lors de la réforme du seizième siècle, la liberté et les lumières avaient augmenté toutes les facultés de l’homme ; le besoin des innovations l’emporta sur le respect pour l’antiquité, et l’Europe, dans sa vigueur, osa dédaigner les fantômes devant lesquels tremblait la faiblesse efféminée des Grecs avilis. Le peuple ne connaît le scandale d’une hérésie, sur des questions abstraites, que par le bruit de la trompette ecclésiastique ; mais les plus ignorants peuvent apercevoir, les plus glacés doivent ressentir la profanation et la chute de leurs divinités visibles. Les premières hostilités de Léon se portèrent sur un crucifix placé dans le vestibule et au-dessus de la porte du palais. On allait l’abattre ; mais l’échelle dressée pour y atteindre fut renversée avec fureur par une troupe de fanatiques et de femmes. La multitude vit avec un pieux transport les ministres du sacrilège, précipités du haut de l’échelle, tomber et se briser sur le pavé ; ceux qui s’étaient rendus coupables de cette action avaient été justement punis pour crime de meurtre et de rébellion, leur parti prostitua en leur faveur les honneurs accordés aux anciens martyrs[22]. L’exécution des édits de l’empereur entraîna de fréquentes émeutes à Constantinople et dans les provinces : la personne de Léon fut en danger ; on massacra ses officiers, et il fallut employer toute la force de l’autorité civile et de la puissance militaire pour éteindre l’enthousiasme du peuple. Les nombreuses îles de l’Archipel, qu’on nommait la mer Sainte, étaient remplies d’images et de moines : les habitants abjurèrent sans scrupule leur fidélité envers un ennemi de Jésus-Christ, de sa mère et des saints ; ils armèrent une flottille de bateaux et de galères, déployèrent leurs bannières sacrées, et marchèrent hardiment vers le port de Constantinople, afin de placer sur le trône un homme plus agréable à Dieu et au peuple. Ils comptaient sur des miracles ; mais ces miracles ne purent résister au feu grégeois, et, après la déroute et l’incendie de leurs navires, leurs îles sans défense furent abandonnées à la clémence ou à la justice du vainqueur. Le fils de Léon avait entrepris, la première année de son règne, une expédition contre les -Sarrasins ; et durant son absence, son parent Artavasdes, ambitieux défenseur de la foi orthodoxe, s’était emparé de la capitale, du palais et de la pourpre. On rétablit en grande pompe le culte des images ; le patriarche renonça à la dissimulation qu’il s’était imposée, ou dissimula les sentiments qu’il avait adoptés ; et les droits de l’usurpateur furent reconnus dans la nouvelle et dans l’ancienne Rome. Constantin se réfugia sur les montagnes où ses aïeux avaient reçu le jour ; mais il descendit à la tête de ses braves et fidèles Isauriens, et, dans une victoire décisive, il triompha des troupes et des prédictions des fanatiques. La longue durée de son règne fut continuellement troublée par des clameurs, des séditions, des conspirations, une haine mutuelle et des vengeances sanguinaires. La persécution des images fut le motif : ou le prétexte de ses adversaires, et s’ils manquèrent un diadème temporel, ils reçurent des Grecs la couronne du martyre. Dans toutes les entreprises qui furent formées contre lui, soit en secret, soit à découvert, l’empereur éprouva l’implacable inimitié des moines, fidèles esclaves de la superstition à laquelle ils devaient leurs richesses et leur influence. Ils priaient, prêchaient et donnaient des absolutions ; ils échauffaient le peuple et conspiraient : un torrent d’invectives sortit de la solitude de la Palestine, et la plume de saint Jean Damascène[23], le dernier des pères grecs, proscrivit la tête du tyran dans ce monde et dans l’autre[24]. Je n’ai pas le loisir d’examiner jusqu’à quel point les moines s’étaient attiré les maux réels ou prétendus dont ils se plaignaient, ni combien ils ont exagéré leurs souffrances, ni quel est le nombre de ceux qui perdirent la vie ou quelques-uns de leurs membres, les yeux ou la barbe, par la cruauté de l’empereur. Après avoir châtié les individus, il s’occupa de l’abolition de leurs ordres ; leurs richesses et leur inutilité purent donner à son ressentiment l’aiguillon de l’avarice et l’excuse du patriotisme. La mission et le nom redoutable de Dragon[25], son visiteur général, en fit, pour toute la nation enfroquée, un objet d’horreur et d’effroi. Les communautés religieuses furent dissoutes, les édifices furent convertis en magasins ou en baraques ; on confisqua les terres, les meubles et les troupeaux ; et des exemples modernes nous autorisent à penser que non seulement les reliques, mais les bibliothèques, prirent devenir la proie de ce brigandage, qu’excita la licence ou le plaisir de nuire. En proscrivant l’habit et l’état de moine, on proscrivit avec la même rigueur le culte public et privé dès images ; et il semblerait qu’on exigea des sujets, ou du moins du clergé de l’empire d’Orient, une abjuration solennelle de d’idolâtrie[26]. L’Orient soumis abjura avec répugnance ses images sacrées le zèle indépendant des Italiens les défendit avec vigueur et redoubla de dévotion pour elles. Pour le rang et pour l’étendue de sa juridiction, le patriarche de Constantinople étain presque l’égal du pontife de Rome ; mais le prélat grec était un esclave sous les yeux de son maître, qui, d’un signe de tête, le faisait passer tour à tour d’un couvent sur le trône, et du trône dans le fond d’un couvent. L’évêque de Rome, éloigné de la cour et dans une position dangereuse, au milieu des Barbares de l’Occident, tirait de sa situation du courage et de la liberté : choisi par le peuple, il lui était cher ; ses revenus considérables fournissaient aux besoins publics et à ceux des pauvres. La faiblesse ou la négligence des empereurs le déterminait à consulter dans la paix et dans la guerre, la sûreté temporelle de la ville. Il prenait peu à peu, dans l’école de l’adversité ; les qualités et l’ambition d’un prince : l’Italien, le Grec ou le Syrien qui arrivait à la chaire, de saint Pierre, s’arrogeait les mêmes fonctions et suivait la même politique ; et Rome, après avoir perdu ses légions et ses provinces, voyait sa suprématie rétablie de nouveau par le génie et la fortune des papes. On convient qu’au huitième siècle ils fondèrent leur domination sur la révolte, et que l’hérésie des iconoclastes produisit et justifia la rébellion ; mais la conduite de Grégoire II et de Grégoire ni durant cette lutte mémorable, est interprétée diversement parleurs .amis et par leurs ennemis. Les écrivains byzantins déclarent d’une voix unanime, qu’après un avertissement inutile ; les papes prononcèrent la séparation de l’Orient et de l’Occident, et privèrent le sacrilège empereur du revenu et de la souveraineté de l’Italie. Les Grecs, témoins du triomphe des papes, parlent de cette excommunication d’une manière encore plus claire ; et comme ils sont plus attachés à leur religion qu’à leur pays, ils louent, au lieu de les blâmer, le zèle et l’orthodoxie de ces hommes apostoliques[27]. Les auteurs qui ont défendu la cour de nome dans les temps modernes, se montrent fort empressés à faire valoir l’éloge et le fait ; les cardinaux Baronius et Bellarmin célèbrent ce grand exemple de la déposition des rois hérétiques[28] ; et si on leur demandé pourquoi on ne lança pas les mêmes foudres contre les Néroli et les Julien de l’antiquité, ils répondent que la faiblesse de la primitive Église fut la seule cause de sa patiente fidélité[29]. L’amour et la haine ont produit en cette occasion les mêmes effets, et les zélés protestants, qui veulent exciter l’indignation et alarmer le pouvoir des princes et des magistrats, s’étendent sur l’insolence et le trimé des deux Grégoire envers leur légitime souverain[30]. Ces papes ne sont défendus que par les catholiques modérés, pour la plupart de l’Église gallicane[31], qui respectent le saint sans approuver son délit. Ces défenseurs de la couronne et de la tiare jugent de la vérité des faits d’après la règle de l’équité, les ouvrages qui nous restent, et la tradition ; et ils en appellent[32] au témoignage des Latins, aux vies[33] et aux épîtres des papes eux-mêmes. Nous avons deux épîtres originales de Grégoire II à l’empereur Léon[34] ; et si on ne peut les citer comme des modèles d’éloquence et de logique, elles offrent le portrait ou du moins le masque d’un fondateur de la monarchie pontificale. On compte, lui dit-il, dix années de bonheur, durant lesquelles nous avons eu la consolation de recevoir vos lettres royautés, signées en encre de pourpre ; et de votre propre main : ces lettres étaient pour nous des gages sacrés de votre attachement à la loi orthodoxe de nos aïeux. Quel déplorable changement et quel épouvantable scandale ! Vous accusez maintenant les catholiques d’idolâtrie, et, par cette accusation, vous trahissez seulement vôtre impiété et votre ignorance. Nous sommes forcés de proportionner à cette ignorance la grossièreté de notre style et de vos arguments. Les premiers éléments des saintes lettres suffisent pour vous confondre ; et si, entrant dans une école de grammaire, vous vous y déclariez l’ennemi de notre culte, vous irriteriez la simplicité et la piété des enfants qu’on y instruit, au point qu’ils vous jetteraient leur alphabet à la tête. Après ce décent exorde, le pape essaie d’établir la distinction ordinaire entre les idoles de l’antiquité et les images du christianisme. Les idoles, dit-il, sont des figures imaginaires attribuées à des fantômes et des démons, dans un temps où le vrai Dieu n’avait pas manifesté sa personne sous une forme visible ; les images sont les véritables formes de Jésus-Christ, de sa mère et de ses saints, qui ont prouvé, par une foule de miracles, l’innocence et le mérite de ce culte relatif. Il faut qu’en effet il ait bien compté sur l’ignorance de Léon, pour lui soutenir que, depuis le temps des apôtres, les images ont toujours été en honneur, et qu’elles ont sanctifié de leur présence les six conciles de l’Église catholique. Il tire de la possession du moment et de la pratique actuelle, un argument plus spécieux ; il prétend que l’harmonie du monde chrétien ne rend plus un concile général nécessaire, et il a la franchise d’avouer que ces assemblées ne peuvent être utiles que sous le règne d’un prince orthodoxe. S’adressant ensuite à l’impudent, à l’inhumain Léon, bien plus coupable qu’un hérétique, il lui recommande la paix, le silence, et une soumission implicite à ses guides spirituels de Constantinople et de Rome. Il fixe les bornes de la puissance civile et de la puissance ecclésiastique ; il assujettit le corps à la première, et l’âme à la seconde : il établit que le glaive de la justice est entre les mains du magistrat ; qu’un glaive plus formidable, celui de l’excommunication, appartient au clergé ; que, dans l’exercice de cette divine commission, un fils zélé n’épargnera point son coupable père ; que le successeur de saint Pierre a le droit de châtier les rois du monde. Ô tyran ! ajoute-t-il, vous nous attaquiez d’une main charnelle et armée : désarmés et nus comme nous le sommes, nous ne pouvons qu’employer Jésus-Christ, le prince de l’armée céleste, et le supplier de vous envoyer un diable pour la destruction de votre corps et le salut de votre âme. J’expédierai mes ordres à Rome, dites-vous avec une arrogance insensée ! je mettrai en pièces l’image de saint Pierre ; et Grégoire, ainsi que Martin, son prédécesseur, sera conduit, chargé de chaînes au pied du trône impérial, pour y subir l’arrêt de son exil. Ah ! plût à Dieu qu’il me fût permis de marcher sur les traces de saint Martin ! Mais que le sort de Constans serve d’avis aux persécuteurs de l’Église. Lorsque le tyran eut été justement condamné par les évêques de la Sicile, tout couvert de péchés, il périt par la main d’un de ses domestiques : ce saint est encore adoré chez les peuples de la Scythie, parmi lesquels finirent son exil et sa vie. Mais nous devons vivre pour l’édification et l’appui des fidèles, et nous ne sommes pas réduit à compromettre notre sûreté dans un combat. Quelque incapable que vous soyez de défendre votre ville de Rome, sa situation sur le bord de la mer peut lui faire craindre vos déprédations ; mais nous pouvons nous retirer à vingt-quatre stades[35], dans la première forteresse des Lombards, et alors vous poursuivriez les vents. Ne savez-vous pas que les papes sont les liens de l’union et les médiateurs de la paix entre l’Orient et l’Occident ? Les yeux des nations sont fixés sur notre humilité ; elles révèrent ici-bas comme un dieu l’apôtre saint Pierre, dont vous nous menacez de détruire l’image. Les royaumes les plus reculés de l’Occident présentent leurs hommages à Jésus-Christ et à son vicaire, et nous nous disposons à aller voir un des plus puissants monarques de cette partie du monde ; qui désire recevoir de nos mains le sacrement de baptême[36]. Les Barbares se sont soumis au joug de l’Évangile ; et, seul, vous êtes sourd à la voix du berger. Ces pieux Barbares sont pleins de fureur ; ils brûlent de venger la persécution que souffre l’Église en Orient. Renoncez à votre audacieuse et funeste entreprise ; faites vos réflexions, tremblez et repentez-vous. Si vous persistez dans vos desseins, on ne pourra nous imputer le sang qui sera versé dans cette querelle : puisse-t-il retomber sur votre tête ! Les premières hostilités de Léon contre les images de Constantinople avaient eu pour témoins une foule d’étrangers venus de l’Italie et des différents pays de l’Occident ; ils y racontèrent avec douleur et indignation le sacrilège de l’empereur ; mais, en recevant l’édit qui proscrivait ce culte, ils tremblèrent pour leurs dieux domestiques : les images de Jésus- Christ, de la Vierge, des anges, des martyrs et des saints, furent enlevées de toutes les églises de l’Italie, et l’on offrit au choix du pontife de Rome la faveur impériale pour prix de sa soumission, ou la déposition et l’exil pour châtiment de sa désobéissance. Le zèle religieux et la politique ne lui permettaient pas d’hésiter, et la hauteur du ton qu’il prit envers l’empereur annonçait une grande confiance dans la vérité de sa doctrine, ou dans ses moyens de résistance. Sans compter sur les prières ou sur les miracles, il s’arma contre l’ennemi public, et ses lettres pastorales avertirent les Italiens de leurs dangers et de leurs devoirs[37]. A ce signal, Ravenne, Venise, et les villes de l’exarchat et de la Pentapole, adhérèrent à la cause de la religion ; des naturels du pays formaient la plus grande partie de leurs troupes de terre et de mer ; et ils inspirèrent aux mercenaires étrangers l’esprit de patriotisme et de zèle dont ils étaient animés eux-mêmes. Les Italiens jurèrent de vivre et de mourir pour la défense du pape et des saintes images ; le peuple romain était dévoué à son père spirituel, et les Lombards eux-mêmes désiraient partager le mérite et les avantages de cette guerre sacrée. La destruction des statues de Léon fut l’acte de rébellion le plus apparent, le plus audacieux, et celui qui se présentait le plus naturellement : le plus efficace et le plus avantageux fut de retenir le tribut que l’Italie payait à Constantinople, et de dépouiller ainsi le prince d’un pouvoir dont il avait abusé depuis peu, en exigeant une nouvelle capitation[38]. On élut des magistrats et des gouverneurs, et de cette manière on conserva une forme de gouvernement. Telle était l’indignation publique, que les Romains se disposaient à créer un empereur orthodoxe, et à le conduire avec une escadre et une armée dans le palais de Constantinople. En même temps Grégoire II et Grégoire III étaient déclarés par l’empereur auteurs de la révolte, et condamnés comme tels : on employait toutes sortes de moyens pour s’emparer de leur personne, soit par fraude ou par violence, ou pour leur ôter la vie. Des capitaines des gardés, des ducs et des évêques, revêtus d’une dignité publique ou chargés d’une commission sécrète, s’introduisirent dans Rome ou se présentèrent à diverses reprises pour l’attaquer ; ils débarquèrent des troupes étrangères ; ils trouvèrent dans le pays quelques secours, et la superstitieuse ville de Naples doit rougir de ce que ses ancêtres défendaient alors la cause de l’hérésie. Mais la valeur et la vigilance des Romains repoussèrent ces attaques ouvertes ou clandestines ; les Grecs furent battus et massacrés, leurs chefs subirent une mort ignominieuse, et les papes, quel que fût leur penchant à la clémence, refusèrent d’intercéder en faveur de ces coupables victimes. Des querelles sanglantes, produites par une haine héréditaire, divisaient depuis longtemps les différents quartiers de la ville de Ravenne[39] : ces factions trouvèrent un nouvel, aliment dans la controverse religieuse qui s’élevait alors ; mais les partisans des images avaient la supériorité du nombre ou de la valeur, et l’exarque, qui voulut arrêter le torrent, perdit la vie dans une sédition populaire. Pour punir cet attentat et rétablir sa domination en Italie, l’empereur envoya une escadre et une armée dans le golfe Adriatique. Longtemps retardés par les vents et les flots qui leur causèrent beaucoup de dommage, les Grecs débarquèrent enfin aux environs de Ravenne ; ils menacèrent de dépeupler cette coupable ville, et d’imiter, peut-être de surpasser Justinien II, qui, ayant eu jadis à punir une rébellion, avait livré aux bourreaux cinquante des principaux habitants. Les femmes et le clergé priaient sous le sac et la cendre, les hommes étaient en armes pour la défense de leur pays ; le péril commun avait réuni les factions, et ils aimèrent mieux risquer une bataille que de s’exposer aux longues misères d’un siége. On combattit en effet avec acharnement. Les deux armées plièrent et s’avancèrent, tour à tour : on vit un fantôme, on entendit une voix, et la certitude de la victoire rendit Ravenne victorieuse. Les soldats de l’empereur se retirèrent sur les vaisseaux ; mais la côte de la mer, qui était très peuplée, détacha une multitude de chaloupes contre l’ennemi : tant de sang se mêla dans les eaux du Pô, que le peuple passa six années sans vouloir manger du poisson de ce fleuve ; et l’institution d’une fête annuelle consacra le culte des images et la haine du tyran grec. Au milieu du triomphe des armes catholiques, le pontife de Rome, voulant condamner l’hérésie des iconoclastes, assembla un concile de quatre-vingt-treize évêques. Il prononça, de leur aveu, une excommunication générale contre ceux qui, de paroles ou d’actions, attaqueraient la tradition des pères et les images des saints : ce décret comprenait tacitement l’empereur[40] ; cependant la résolution que l’on prit de lui adresser sans espoir de succès une dernière remontrance, semble prouver que l’anathème n’était alors que suspendu sur sa tête coupable. Il semble aussi que les papes, après avoir établi les points qui intéressaient leur sûreté, le culte des images et la liberté de Rome et de l’Italie, se relâchèrent de leur sévérité et épargnèrent les restes de la domination du souverain de Byzance. Ils différèrent et empêchèrent, par des conseils modérés, l’élection d’un nouvel empereur, et exhortèrent les Italiens à ne pas se séparer du corps de la monarchie romaine. On permit à l’exarque de résider dans les murs de Ravenne, où il joua moins le rôle d’un maître que celui d’un captif ; et jusqu’au couronnement de Charlemagne, l’administration de Rome et de l’Italie fut toujours au nom des successeurs de Constantin[41]. La liberté de Rome, opprimée par les armes et l’adresse d’Auguste, fut délivrée, après sept cent cinquante années de servitude, de la tyrannie de Léon l’Isaurien. Les Césars avaient anéanti les triomphes des consuls ; dans le déclin et la chute de l’empire romain, le dieu Terme, cette limite sacrée, s’était retiré peu à peu des rives de l’Océan, du Rhin, du Danube et de l’Euphrate, et Rome se trouvait réduite à son ancien territoire, comprenant le pays qui s’étend, de Viterbe à Terracine, et de Narni à l’embouchure du Tibre[42]. Après l’expulsion des rois, la république reposa sur la solide base qu’avaient établie leur sagesse et leur vertu. Leur juridiction perpétuelle se partagea à deux magistrats qu’on élisait tous les ans ; le sénat demeure revêtu de la puissance administrative et délibérative ; et les assemblées du peuple exercèrent le pouvoir législatif, distribué entre les différentes classes, dans une proportion bien calculée d’après la fortune et les services de chacun. Les premiers Romains, étrangers aux arts de luxe, avaient perfectionné la science du gouvernement et celle de la guerre : les droits des individus étaient sacrés ; la volonté de la communauté était absolue ; cent trente mille citoyens se trouvaient armés pour défendre leur pays, ou pour l’étendre par des conquêtes ; une troupe de voleurs et de proscrits était devenue une nation digne de la liberté, et enflammée de l’amour de la gloire[43]. A l’époque où la souveraineté des empereurs grecs s’anéantit, Rome n’offrait plus que l’image de la dépopulation et de la misère ; l’esclavage était devenu pour elle une habitude, et sa liberté fut un accident produit par la superstition, et qu’elle-même ne put envisager qu’avec surprise et avec terreur. On ne retrouvait pas dans les institutions ou dans le souvenir des Romains le moindre vestige de la substance ou même des formes de la constitution ; et ils n’avaient ni assez de lumières ni assez de vertu pour reconstruire l’édifice d’une république. Le faible reste des habitants de Rome, tous nés d’esclaves et d’étrangers, était l’objet du mépris des Barbares triomphants. Lorsque les Francs et les Lombards voulaient employer contre un ennemi les paroles les plus méprisantes, ils l’appelaient un Romain ; et ce nom, dit l’évêque Luitprand, renferme tout ce qui est vil, tout ce qui est lâche, tout ce qui est perfide ; les deux extrêmes de l’avarice et du luxe, et enfin tous les vices qui peuvent prostituer la dignité de la nature humaine[44]. La situation des Romains les jeta nécessairement dans un gouvernement républicain grossièrement conçu. Ils furent obligés de choisir des juges en temps de paix, et des chefs durant la guerre ; les nobles s’assemblaient polir délibérer, et on ne pouvait exécuter leurs résolutions sans le consentement de la multitude. On vit se renouveler les formes de style du sénat et du peuple romain[45] ; mais on n’y retrouvait plus leur esprit, et la lutte orageuse de la licence et de l’oppression déshonora cette nouvelle indépendance. Le défaut de lois ne pouvait être suppléé que par l’influence de la religion, et l’autorité de l’évêque dirigeait l’administration au dedans et la politique au dehors. Ses aumônes, ses sermons, sa correspondance avec les rois et les prélats de l’Occident, les services qu’il venait de rendre à la ville, les serments qu’on lui avait prêtés et la reconnaissance qu’on lui devait, accoutumèrent la Romains à le regarder comme le premier magistrat ou le prince de Rome. Le nom de dominus ou de seigneur n’effaroucha pas l’humilité chrétienne des papes, et on retrouve leur figure et leur inscription sur les plus anciennes monnaies[46]. Leur domination temporelle est aujourd’hui affermie par dix siècles de respect, et leur plus beau titre est le libre choix d’un peuple qu’ils avaient délivré de l’esclavage. Au milieu des querelles de l’ancienne Grèce, le peuple saint de l’Élide jouissait, d’une paix continuelle sous la protection de Jupiter et dans l’exercice des jeux olympiques[47]. Il eût été heureux pour les Romains qu’un privilège semblable défendît le patrimoine de l’Église des calamités de la guerre, et que les chrétiens qui allaient voir le tombeau de saint Pierre se crussent obligés, en présence de l’apôtre et de son successeur, de remettre leurs épées dans le fourreau ; mais ce cercle mystique n’aurait pu être tracé que par la baguette d’un législateur et d’un sage : ce système pacifique ne s’accordait pas avec le zèle, et l’ambition des papes. Les Romains n’étaient pas, comme les habitants de l’Élide, adonnés aux innocents et paisibles travaux de l’agriculture ; et les institutions publiques et privées des Barbares de l’Italie, malgré l’effet que le climat avait produit sur leurs mœurs, se trouvaient bien au-dessous de celles des États de la Grèce. Luitprand, roi des Lombards, donna un exemple mémorable de repentir et de dévotion. Ce vainqueur, à la tête de son armée, à la porte du Vatican, prêta l’oreille à la voix de Grégoire II[48], retira ses troupes, abandonna ses conquêtes, se rendit à l’église de Saint-Pierre ; et, après y avoir fait ses dévotions, déposa sur la tombe de cet apôtre son épée et son poignard, sa cuirasse et son manteau, sa croix d’argent et sa couronne d’or. Mais cette ferveur religieuse fut une illusion et peut-être un artifice du moment ; le sentiment de l’intérêt est puissant et durable. L’amour des armes et du pillage était inhérent au caractère des Lombards, et les désordres de l’Italie, la faiblesse de Rome et la profession pacifique de son nouveau chef, furent pour eux et pour leur roi un objet de tentation irrésistible. Lorsqu’on publia les premiers édits de l’empereur, ils se déclarèrent les défenseurs des images. Luitprand envahit la province de Romagne, déjà désignée alors par cette dénomination ; les catholiques de l’exarchat se soumirent sans répugnance à son pouvoir civil et militaire, et un ennemi étranger fut pour la première fois introduit dans l’imprenable forteresse de Ravenne. La ville et la forteresse furent bientôt recouvrées par l’activité des Vénitiens, habiles et puissants sur la mer ; et ces fidèles sujets se rendirent aux exhortations de Grégoire, qui les engagea à séparer la faute personnelle de Léon de la cause générale de l’empire romain[49]. Les Grecs oublièrent ce service, et les Lombards se souvinrent de cette injure. Les deux nations, ennemies par leur foi, formèrent une alliance dangereuse et peu naturelle ; le roi et l’exarque marchèrent à la conquête de Spolette et de Rome : cet orage se dissipa sans produire aucun effet ; mais le politique Luitprand continua à tenir l’Italie en alarmes par de perpétuelles alternatives de trêves et d’hostilités. Astolphe, son successeur, se déclara tout à la fois l’ennemi de l’empereur et du pape. Ravenne fut subjuguée par la force ou par la trahison[50], et cette conquête termina la suite des exarques, qui, depuis le temps de Justinien et la ruine du royaume des Goths, avaient exercé dans ce pays une espèce de royauté subordonnée. Rome fut sommée de reconnaître pour son légitime souverain le Lombard victorieux ; on fixa la rançon de chaque citoyen à un tribut annuel d’une pièce d’or ; le glaive suspendu sur leur tête était prêt à punir leur désobéissance. Les Romains hésitèrent ; ils supplièrent, ils se plaignirent, et l’effet des menaces des Barbares fut arrêté par les armes et par les négociations, jusqu’à ce que le pape se fût ménagé au-delà des Alpes un allié et un vengeur[51]. Dans sa détresse, Grégoire Ier avait imploré les secours du héros de son siècle, de Charles Martel, qui gouvernait la France avec le titre modeste de maire, ou de duc, et qui, par sa victoire signalée sur les Sarrasins, avait sauvé son pays et peut-être l’Europe du joug des musulmans. Charles reçut les ambassadeurs du pape avec le respect convenable, mais l’importance de ses occupations et la courte durée de sa vie ne lui permirent de se mêler des affaires de l’Italie que par une médiation amicale et infructueuse. Son fils Pépin, héritier de son pouvoir et de ses vertus, se déclara le défenseur de l’Église romaine, et il paraît que le zèle de ce prince fut excité par l’amour de la gloire et par la religion ; mais le danger était sur les bords du Tibre, les secours se trouvaient sur ceux de la Seine, et notre compassion est languissante pour des misères éloignées de nous. Tandis que la ville de Rome se livrait à la douleur, Étienne III prit la généreuse résolution de se rendre lui-même à la cour de Lombardie et à celle de France, de fléchir l’injustice de son ennemi ou, d’exciter la pitié et l’indignation de son ami. Après avoir soulagé le désespoir public par des prières et des litanies, il entreprit ce laborieux voyage avec les ambassadeurs du monarque français et ceux de l’empereur grec. Le roi des Lombards fut inflexible ; mais ses menaces ne purent contenir les plaintes ou retarder la diligence du pontife de Rome, qui traversa les Alpes Pennines, se reposa dans l’abbaye de Saint-Maurice, et se hâta d’aller saisir cette main de son protecteur, qui dans la guerre et pour l’amitié ne s’élevait jamais en vain. Étienne fut accueilli comme le successeur visible de l’apôtre. A la première assemblée du champ de mars ou de mai, le roi de France exposa à une nation dévote et guerrière les divers griefs du pape, et le pontife repassa les Alpes, non en suppliant, mais en conquérant, à la tête d’une armée de Français que leur roi commandait en personne. Les Lombards, après une faible résistance, obtinrent une paix ignominieuse ; ils jurèrent de rendre les possessions et de respecter la sainteté de l’Église romaine ; mais Astolphe ne fut pas plus tôt délivré de la présence des troupes françaises, qu’il oublia sa promesse et se souvint seulement de sa honte. Rome se vit de nouveau investie par ses soldats, et Étienne, craignant de fatiguer le zèle des alliés qu’il s’était acquis au-delà des Alpes, imagina de fortifier sa plainte et sa requête d’une lettre éloquente, écrite par saint Pierre lui-même[52]. L’apôtre assure ses fils adoptifs, le roi, le clergé et les nobles de France, que, mort corporellement, il vit toujours en esprit ; que c’est la voix du fondateur et du gardien de l’Église de Rome qui se fait entendre à eux, et qu’ils doivent lui obéir ; que la Vierge, les anges, les saints et les martyrs, et toute l’armée céleste, appuient la requête du pape, et leur font un devoir de s’y rendre ; que pour les récompenser de leur dévote entreprise, ils obtiendront la fortune, la victoire et le paradis ; et que la damnation éternelle sera la peine de leur négligence, s’ils souffrent que son tombeau, son Église et son peuple, tombent entre les mains des perfides Lombards. La seconde expédition de Pépin ne fut ni moins rapide ni moins heureuse que la première : saint Pierre obtint ce qu’il désirait ; Rome fut sauvée une seconde fois, et, sous la férule d’un maître étranger, Astolphe apprit enfin à respecter la justice et la bonne foi. Après ce double châtiment, les Lombards ne firent plus que languir et déchoir l’espace d’environ vingt ans. Leur caractère toutefois ne s’était pas conformé à l’abaissement de leur condition ; et, au lieu de s’adonner aux paisibles vertus des faibles, ils fatiguèrent les Romains par une multitude de prétentions, de subterfuges et d’incursions, qu’ils renouvelèrent sans réflexion et qu’ils terminèrent sans gloire. Leur monarchie expirante était pressée d’un côté par le zèle et la prudence du pape Adrien Ier, et de l’autre par le génie, la fortune et la grandeur de Charlemagne, fils de Pépin : ses héros de l’Église et de l’État se réunirent par une alliance et par l’amitié, et lorsqu’ils foulèrent les faibles à leurs pieds, ils eurent soin de se couvrir des plus spécieuses apparences de l’équité et de la modération[53]. Les défilés des Alpes et les murs de Pavie étaient la seule défense des Lombards. Le fils de Pépin surprit ces défilés et investit ces murailles ; et, après un blocus de deux ans, Didier, le dernier de leurs princes naturels, remit au vainqueur son sceptre et sa capitale. Les Lombards, soumis à un roi étranger, mais gardant leurs lois nationales, devinrent les concitoyens, plutôt que les sujets des Francs, qui tiraient, comme eux, leur origine, leurs mœurs et leur langue de la Germanie[54]. Les obligations réciproques des papes et de la famille Carlovingienne, forment l’important anneau qui réunit l’histoire ancienne et moderne, l’histoire civile et ecclésiastique. Les défenseurs de l’Église avaient été encouragés à la conquête de l’Italie par une occasion favorable, un titre spécieux, les vœux du peuple, les prières et les intrigues du clergé. La dignité de roi de France[55] et celle de patrice de Rome furent les dons les plus précieux que reçut des papes la dynastie. Carlovingienne. I. Sous la monarchie sacerdotale de saint Pierre, les nations commençaient à reprendre l’habitude de chercher sur les bords du Tibre leurs monarques, leurs lois et les oracles de leur destinée. Les Francs se trouvaient embarrassés entré deux souverains, l’un de fait et l’autre de nom : Pépin, simple maire du palais, exerçait tous les pouvoirs de la royauté, et, excepté le titre de roi, rien ne manquait à son ambition. Ses ennemis se trouvaient abattus sous sa valeur ; sa libéralité multipliait le nombre de ses amis. Son père avait été le sauveur de la chrétienté, et quatre illustres générations appuyaient et relevaient les droits de son mérite personnel. Le dernier descendant de Clovis, le faible Childéric, conservait toujours le nom et les apparences de la dignité royale ; mais son droit tombé en désuétude ne pouvait plus servir que d’instrument à des séditieux ; la nation désirait rétablir la simplicité de sa constitution, et Pépin, sujet et prince, voulait fixer son rang et assurer la fortune de sa famille. Un serment de fidélité liait le maire et les nobles envers le fantôme royal : c’était le pur sang de Clovis, toujours sacré pour eux. Leurs ambassadeurs demandèrent au pontife de Rome de dissiper leurs scrupules ou de les absoudre de leurs promesses. L’intérêt détermina promptement le pape Zacharie, successeur des deux Grégoire, à prononcer en leur faveur : il décida que la nation avait le droit de réunir sur la même tête le titre et l’autorité de roi ; que l’infortuné Childéric devait être immolé à la sûreté publique ; qu’il fallait le déposer, le raser et l’enfermer dans un couvent pour le reste de ses jours. Une réponse si conforme au désir des Francs fut reçue, par eux comme l’opinion d’un casuiste, l’arrêt d’un juge ou l’oracle d’un prophète la race mérovingienne disparut, et Pépin fut élevé sur le bouclier par un peuple libre, accoutumé à obéir à ses lois, et à marcher sous son étendard. Il fut couronné deux fois avec la sanction de la cour de Rome la première, par le fidèle serviteur des papes, saint Boniface, apôtre de la Germaine ; et la seconde, par les mains reconnaissantes d’Étienne III, qui, dans le monastère de Saint-Denis, plaça le diadème sur la tête de son bienfaiteur. On eut alors l’adresse d’y ajouter l’onction des rois d’Israël[56] : le successeur de saint Pierre s’arrogea les fonctions d’un ambassadeur de Dieu ; un chef germain devint, aux yeux des peuples, l’oint du Seigneur, et la vanité ainsi que la superstition contribuèrent à répandre cette cérémonie juive dans toute l’Europe moderne. On affranchit les Francs de leur premier serment de fidélité ; mais on les dévoua, ainsi que leur postérité, aux plus affreux anathèmes, s’ils osaient à l’avenir faire un nouvel usage de la liberté d’élection, ou choisir un roi qui ne fût pas de la sainte et digne race des princes carlovingiens. Ces princes jouirent tranquillement de leur gloire sans s’inquiéter de l’avenir ; le secrétaire de Charlemagne affirme que le sceptre de France avait été transféré par l’autorité des papes[57], et depuis, dans leurs entreprises les plus hardies, ils ne manquèrent pas d’insister avec confiance sur cet acte remarquable et approuvé de leur juridiction temporelle. II. Les mœurs et la langue avaient tellement changé, que les patriciens de Rome[58] étaient fort loin de rappeler le sénat de Romulus, et que les officiers du palais de Constantin ressemblaient peu aux nobles de la république ou aux patriciens désignés par le titre fictif de pères de l’empereur. Lorsque Julien eut reconquis l’Italie et I’Afrique, l’importance de ces provinces éloignées et les dangers auxquels elles étaient exposées, obligèrent d’y établir un magistrat suprême, résidant sur les lieux ; on le nommait indifféremment exarque ou patrice, et ces gouverneurs de Ravenne, qui tiennent leur place dans la chronologie des princes étendaient leur juridiction sur la ville de Rome. Depuis la révolte de l’Italie et la perte de l’exarchat, la détresse des Romains avait exigé, à certains égards, le sacrifice de leur indépendance ; mais dans cet acte ils exerçaient encore le droit de disposer d’eux-mêmes, et les décrets du sénat et du peuple revêtirent successivement Charles Martel et sa postérité des honneurs de patrice de Rome. Les chefs d’une nation puissante auraient dédaigné des titres serviles et des fonctions subordonnées ; mais le règne des empereurs grecs était suspendu, et, durant la vacance de l’empire, ils obtinrent du pape et de la république, une mission plus glorieuse. Les ambassadeurs romains présentèrent à ces patrices les clefs de l’église de Saint-Pierre, pour gage et pour symbole de souveraineté ; ils reçurent en même temps une bannière sainte qu’ils pouvaient et qu’ils devaient déployer pour la défense de l’Église et de la ville[59]. Au temps de Charles Martel et de Pépin, l’interposition du royaume des Lombards menaçait la sûreté de Rome, mais elle mettait sa liberté à couvert ; et, le mot de patriciat ne représentait que le titre, les services et l’alliance de ces protecteurs éloignés. La puissance et l’adresse de Charlemagne anéantirent les Lombards ; et le rendirent maître de Rome. Lorsqu’il arriva pour la première fois dans cette ville, il y fût reçu avec tous les honneurs qu’on avait autrefois accordés à l’exarque, c’est-à-dire au représentant de l’empereur. La joie et la reconnaissance du pape Adrien Ier[60] ajoutèrent même à ces honneurs quelques nouvelles distinctions. Dès qu’il fut instruit de l’approche inopinée du monarque, il envoya à sa rencontre les magistrats et les nobles avec la bannière jusqu’à environ trente milles. Les écoles ou communautés nationales des Grecs, des Lombards, des Saxons, etc., garnissaient la voie Flaminienne l’espace d’un mille ; la jeunesse de Rome était sous les armes ; et des enfants, tenant à la main des palmes et des branches d’olivier, chantaient les louanges de leur illustre libérateur. Quand Charlemagne aperçut les croix et les bannières, il descendit de cheval ; il conduisit au Vatican la procession de ces nobles, et en montant l’escalier, il baisa dévotement chacune des marches qui conduisaient au sanctuaire des apôtres. Adrien l’attendait sous le portique à la tête de son clergé. Ils s’embrassèrent comme des amis et comme des égaux ; mais, en allant vers l’autel, le roi ou patrice prit la droite du pape. Charlemagne ne se contenta pas de ces vaines démonstrations de respect. Durant les vingt-six années qui s’écoulèrent entre la conquête de la Lombardie et son couronnement en qualité d’empereur, il gouverna en maître la ville de Rome qu’il avait délivrée par ses armes. Le peuple jura fidélité à sa personne et à sa famille ; on frappa les monnaies, on administra la justice en son nom, et il examina et confirma l’élection des papes. Excepté le droit de réclamer la souveraineté de son propre chef, le titre d’empereur pouvait ajouter aucune prérogative à celles dont le patrice de Rome était déjà revêtu[61]. La reconnaissance des Carlovingiens fut proportionnée à ces obligations, et leurs noms ont été consacrés par le titre de sauveurs et de bienfaiteurs de l’Église romaine. Son ancien patrimoine, consistant en maisons et en métairies, fut transformé par leur libéralité en une souveraineté temporelle sur des villes et des provinces. La concession de l’exarchat fût le premier fruit des victoires de Pépin[62]. Astolphe abandonna en soupirant sa proie. Les clefs et les otages des principales villes furent livrées à l’ambassadeur de France, qui, au nom de son roi, les présenta sur le tombeau de saint Pierre. L’exarchat, selon l’acception la plus étendue de ce mot[63], embrassait toutes les provinces de l’Italie qui avaient obéi à l’empereur et à ses ministres ; mais, à parler rigoureusement, il ne comprenait que les territoires de Ravenne, de Bologne et de Ferrare ; il faut y joindre la Pentapole, qui s’étendait le long de la mer Adriatique, depuis Rimini jusqu’à Ancône, et qui s’avançait dans l’intérieur du pays jusqu’aux chaînes de l’Apennin. On a beaucoup blâmé l’ambition et l’avarice des papes dans cette opération. L’humilité d’un prêtre chrétien aurait dû peut-être refuser un royaume terrestre qu’il ne pouvait gouverner aisément sans renoncer aux vertus de son état. Un sujet fidèle, ou même un ennemi généreux, aurait peut-être dû montrer moins d’ardeur à partager les dépouilles du prince barbare ; et si l’empereur avait chargé Étienne de solliciter en son nom la restitution de l’exarchat, je n’absoudrais pas le pape du reproche de perfidie et de fausseté. Mais, à suivre les lois bien exactement, chacun peut sans offense accepter ce qu’un bienfaiteur peut lui donner sans injustice. L’empereur grec avait abandonné ou perdu ses droits sur l’exarchat, et le glaive d’Astolphe se trouvait brisé par le glaive plus fort du Carolingien. Ce n’était pas pour défendre la cause de l’iconoclaste que Pépin avait exposé sa personne et son armée aux dangers de deux expéditions au-delà des Alpes ; il possédait légalement ses conquêtes, et il pouvait les aliéner d’une manière légale. Il répondit pieusement aux importunités des Grecs, qu’aucune considération humaine ne le déterminerait à reprendre un don qu’il avait fait au pontife de Rome, pour la rémission de ses péchés et le salut de son âme. Il avait donné l’exarchat en toute souveraineté ; et le monde vit pour la première fois un évêque chrétien revêtu des prérogatives d’un prince temporel, du droit de nommer des magistrats, de faire exercer la justice, d’imposer des taxes, et de disposer des richesses du palais de Ravenne. Lors de la dissolution du royaume des Lombards, les habitants du duché de Spolette[64] cherchèrent un refuge contre l’orage ; ils coupèrent leurs cheveux selon l’usage des Romains, se déclarèrent serviteurs et sujets de saint Pierre, et, par cette reconnaissance volontaire, ils achevèrent l’arrondissement actuel de l’État ecclésiastique. Ce cercle mystérieux prit une étendue indéfinie par la donation verbale où écrite de Charlemagne[65], qui, dans les premiers transports de sa victoire, se dépouilla lui-même et dépouilla l’empereur grec des villes et des îles autrefois dépendantes de l’exarchat. Mais lorsqu’il fut loin de l’Italie et qu’il réfléchit plus froidement sur ce qu’il avait fait, il vit d’un œil de jalousie et de méfiance la grandeur nouvelle de son allié ecclésiastique. Il éluda d’une manière respectueuse l’exécution de ses promesses et de celles de son père ; le roi des Francs et des Lombards fit valoir les droits inaliénables de l’empire, et, durant sa vie ainsi qu’au moment de sa mort, Ravenne[66] et Rome furent toujours comptées au nombre de ses villes métropolitaines. Là souveraineté de l’exarchat s’évanouit entre les mains des papes. Ils trouvèrent dans l’archevêque de Ravenne un rival dangereux[67] : les nobles et le peuple dédaignèrent le joug d’un prêtre ; et, au milieu des désordres de ce temps, les pontifes de Rome ne purent garder que le souvenir d’une ancienne prétention qu’ils ont renouvelée avec succès à une époque plus favorable. La fraude est la ressource de la faiblesse et de l’astuce, et des barbares puissants, mais ignorants, furent souvent enveloppés dans les filets de la politique sacerdotale. Le Vatican, et le palais de Latran étaient un arsenal et une manufacture, qui, selon les occasions, produisaient ou recelaient une nombreuse collection d’actes vrais ou faux, corrompus ou suspects, favorables aux intérêts de l’Église romaine. Avant, la fin du huitième siècle, quelque scribe du saint-siège ; peut-être le fameux Isidore, fabriqua les décrétales et la donation de Constantin, ces deux colonnes de la monarchie spirituelle et temporelle des papes. Cette donation mémorable fut mentionnée, pour la première fois, dans une lettre d’Adrien Ier, qui exhortait Charlemagne à imiter la libéralité du grand Constantin, et à faire revivre son nom[68]. Selon la légende, saint Sylvestre, évêque de Rome, avait guéri de la lèpre et purifié dans les eaux du baptême le premier des empereurs chrétiens : jamais médecin n’avait été mieux récompensé. Le néophyte royal s’était éloigné de la résidence et du patrimoine de saint Pierre : il avait déclaré sa résolution de fonder une nouvelle capitale en Orient, et avait abandonné aux papes l’entière et perpétuelle souveraineté de Rome, de l’Italie et des provinces de l’Occident[69]. Cette fiction produisit les effets les plus avantageux. Les princes, grecs furent convaincus d’usurpation, et la révolte de Grégoire ne fut plus considérée que comme l’acte par lequel il rentrait dans ses droits sur un héritage qui lui appartenait légitimement : les papes se trouvèrent affranchis de la reconnaissance puisque l’apparente donation n’était plus que la juste restitution d’une modique portion de l’État ecclésiastique. La souveraineté de Rome ne dépendait plus du choix d’un peuple volage, et les successeurs, de saint Pierre et de Constantin se virent revêtus de la pourpre et des droits des Césars. Telles étaient l’ignorance et la crédulité de ce siècle, que la plus absurde des fables fut accueillie avec respect et dans la Grèce et dans la France, et qu’elle se trouve encore parmi les décrets de la loi canonique[70]. Ni les empereurs ni les Romains ne furent en état de démêler une fourberie qui détruisait les droits des uns et la liberté des autres : la seule réclamation qu’on entendit vint d’un monastère de la Sabinie, qui, au commencement du douzième siècle, contesta l’authenticité et la validité de la donation de Constantin[71]. À la renaissance des lettres et de la liberté, ce faux acte fut frappé de mort par la plume de Laurent Valla critique éloquent et Romain rempli de patriotisme[72]. Ses contemporains furent étonnés de son audace sacrilège ; mais tel est le progrès silencieux et irrésistible de la raison, qu’avant la fin de la génération suivante cette fable était rejetée avec mépris par les historiens[73] et les poètes[74], et par la censure tacite ou modérée des défenseurs de l’Église de Rome[75]. Les papes eux-mêmes se sont permis de sourire de la crédulité publique[76] ; mais ce titre supposé, et tombé désuétude, continua à revêtir leur domination ; d’une sorte de sainteté ; et, par un hasard aussi heureux que celui qui a favorisé les décrétales et les oracles de la sibylle, l’édifice a subsisté après la destruction des fondements. Tandis que les papes établissaient en Italie leur indépendance et leur domination les images, qui avaient été la première cause de leur révolte, se rétablissaient dans l’empire d’Orient[77]. Sous le règne de Constantin V, l’union du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique avait renversé l’arbre de la superstition, sans en extirper la racine. La classe d’hommes et le sexe les plus portés à la dévotion ; chérissaient en secret le culte des idoles, car c’était ainsi qu’alors on considérait les images ; et l’alliance des moines et des femmes remporta une victoire décisive sur la raison et l’autorité. Léon IV soutint, quoique avec moins de rigueur, la religion de son père et de son aïeul ; mais sa femme, la belle et ambitieuse Irène, était imbue du fanatisme des Athéniens, héritiers de l’idolâtrie plutôt que de la philosophie de leurs ancêtres. Pendant la vie de son mari, ces dispositions ne purent qu’acquérir plus de force par les dangers auxquels elles exposaient, et la dissimulation qui en fut la suite ; elle put seulement travailler à protéger et avancer quelques moines favoris qu’elle tira de leurs cavernes et qu’elle plaça sur les trônes métropolitains de l’Orient ; mais, du moment où elle commença à régner en son nom et en celui de son fils, elle s’occupa plus sérieusement de la ruine des iconoclastes ; et c’est par un édit général en faveur de la liberté de conscience, qu’elle prépara la persécution. En rétablissant les moines, elle exposa des milliers d’images à la vénération publique : alors on inventa mille légendes sur leurs souffrances et leurs miracles. Un évêque mort ou déposé était aussitôt remplacé par des hommes animés des mêmes vues qu’elle. Ceux qui recherchaient avec le plus d’ardeur les faveurs temporelles ou célestes, allaient au devant du choix de leur souveraine, qu’ils ne manquaient pas d’approuver ; et la promotion de Tarasius, son secrétaire, au rang de patriarche de Constantinople, la rendit maîtresse de l’Église d’Orient. Mais les décrets d’un concile général ne pouvaient être révoqués que par une assemblée de la même nature[78] : les iconoclastes qu’elle assembla, forts de leur possession actuelle, se montraient peu disposés à la discussion ; et la faible voix de leurs évêques était soutenue par les clameurs beaucoup plus formidables des soldats et du peuple de Constantinople. On différa le concile d’une année ; durant cet intervalle, on forma des intrigues, on sépara les troupes mal affectionnées ; enfin, pour détruire tous les obstacles, on décida qu’il se tiendrait à Nicée, et, selon l’usage de la Grèce, la conscience des évêques se trouva encore une fois dans la main du prince. On ne donna que dix-huit jours pour l’exécution d’un ouvrage si important : les iconoclastes parurent à l’assemblée, non comme des juges, mais comme des criminels ou des pénitents ; la présence des légats du pape Adrien et celle des patriarches d’Orient ajoutèrent à l’éclat de cette scène[79]. Tarasius, qui présidait le concile, rédigea le décret, lequel fut confirmé et ratifié par les acclamations et la signature de trois cent cinquante évêques. Ils déclarèrent d’une voix unanime que le culte des images est conforme à l’Écriture et à la raisons, aux pères et aux conciles ; mais ils hésitèrent lorsqu’on voulut déterminer si ce culte est relatif ou direct, si la divinité et la figure de Jésus-Christ sont susceptibles de la même forme d’adoration. Nous avons les actes de ce second concile de Nicée, monument curieux de superstition et d’ignorance, de mensonge et de folie. Je rapporterai seulement le jugement des évêques sur le mérite comparatif du culte rendu aux images, et de la moralité dans les actions de la vie. Un moine était convenu d’une trêve avec le démon de la fornication, à condition qu’il cesserait de faire ses prières de chaque jour devant une image suspendue aux murs de sa cellule. Ses scrupules le déterminèrent à prendre l’avis de son abbé. Il vaudrait mieux, lui répondit le casuiste, entrer dans tous les mauvais lieux et voir toutes les prostituées de la ville, que de vous abstenir d’adorer Jésus-Christ et sa mère dans leurs saintes images[80]. Il est malheureux pour l’honneur de l’orthodoxie, du moins celle de l’Église romaine, que les deux princes qui ont convoqué les deux conciles de Nicée, se soient souillés du sang de leurs fils. Irène approuva et fit exécuter despotiquement les décrets de la seconde de ces assemblées, et elle refusa à ses adversaires la tolérance qu’elle avait d’abord accordée à ses amis. La querelle entre les iconoclastes et ceux qui soutenaient le culte des images, dura trente-huit ans, ou pendant cinq règnes consécutifs, avec la même fureur, bien qu’avec des succès différents ; mais mon intention n’est pas de revenir en détail sur des faits pareils à ceux que j’ai déjà racontés. Nicéphore accorda sur ce point une liberté générale de discours et de conduite, et les moines ont indiqué la seule vertu de son règne comme la cause de ses malheurs en ce monde et de sa damnation éternelle. La superstition et la faiblesse formèrent le caractère de Michel Ier ; mais les saints et les images, auxquels il rendait des hommages si assidus, ne purent le soutenir sur le trône. Lorsque Léon arriva à la pourpre, avec le nom d’Arménien il en adopta la religion ; les images et leurs séditieux adhérents furent de nouveau condamnés à l’exil. Les partisans des images auraient sanctifié, par leurs éloges, le meurtre d’un tyran impie ; mais Michel II, son assassin et son successeur, était attaché dès sa naissance aux hérésies phrygiennes ; il voulut interposer sa médiation entre les deux partis, et l’esprit intraitable des catholiques le fit pencher peu à peu de l’autre côté de la balance. Sa timidité le maintint dans la modération ; mais Théophile, son fils, également étranger à la crainte et à la pitié, fut le dernier et le plus cruel des iconoclastes. Les dispositions générales leur étaient alors très défavorables, et les empereurs qui voulurent arrêter le torrent ne recueillirent que la haine publique. Après la mort de Théophile, une secondé femme, Théodora, sa veuve, à qui il laissa la tutelle de l’empire, acheva le triomphé définitif des images. Elle prit des mesures audacieuses et décisives. Pour rétablir la réputation et sauver l’âme de son mari, elle eut recours à la supposition d’un repentir tardif. La punition des iconoclastes, qui consistait à perdre la vue, fut commuée en une fustigation de deux cents coups de fouet ; les évêques tremblèrent, les moines poussèrent des cris de joie et l’Église catholique célèbre chaque année la fête du triomphe des images. Il ne restait plus qu’une question à discuter, savoir si elles ont une sainteté qui leur soit propre et inhérente : elle fut agitée par les Grecs du onzième siècle[81] ; et cette opinion est si parfaitement absurde, que je suis étonné qu’elle n’ait pas été adoptée d’une manière plus positive. Le pape Adrien reconnut et proclama en Occident les décrets du concile de Nicée, que les catholiques révèrent aujourd’hui comme le septième des conciles œcuméniques. Rome et l’Italie furent dociles à la voix de leur père spirituel ; mais la plupart des chrétiens de l’Église latine demeurèrent, à cet égard, fort en arrière dans la carrière de la superstition. Les Églises de France, d’Allemagne, d’Angleterre et d’Espagne, se frayèrent une route entre l’adoration et la destruction des images que ces peuples admirent dans leurs temples, non comme des objets de culte, mais comme des moyens propres à rappeler et à conserver le souvenir de quelques événements qui intéressent la foi. On vit paraître, sous le nom de Charlemagne, un livre de controverse écrit du ton de la colère[82]. Un concile de trois cents évêques s’assembla à Francfort, sous l’autorité de ce prince[83] : ils blâmèrent la fureur des iconoclastes ; mais ils censurèrent avec plus de sévérité la superstition des Grecs et les décrets de leur prétendu concile qui fût longtemps méprisé des Barbares de l’Occident[84]. Le culte des images ne fit parmi eux que des progrès silencieux et imperceptibles ; mais leur hésitation et leurs délais furent bien expiés par la grossière idolâtrie des siècles qui ont précédé la réforme, et par celle qu’on voit régner dans les différentes contrées, soit de l’Europe ou de l’Amérique, qui se trouvent encore enveloppées dans les ténèbres de la superstition. Ce fut après le second concile de Nicée et sous le règne de la pieuse Irène, que les papes, en donnant l’empire à Charlemagne, beaucoup moins orthodoxe, détachèrent de l’empire d’Orient, Rome et l’Italie. Il fallait opter entre deux nations rivales ; la religion ne fut pas le seul motif de leur choix : dissimulant les fautes de leurs amis, ils ne voyaient qu’avec inquiétude et répugnance les vertus catholiques de leurs ennemis ; la différence de langage et de mœurs avait perpétué l’inimitié des deux capitales, et soixante-dix ans de schisme les avaient totalement aliénées l’une de l’autre. Durant cet intervalle, les Romains avaient goûté de la liberté, et les papes de la domination ; en se soumettant ils se seraient exposés à la vengeance d’un despote jaloux, et la révolution de l’Italie avait montré en même temps l’impuissance et la tyrannie de la cour de Byzance. Les empereurs grecs avaient rétabli les images, mais, ils n’avaient pas rendu les domaines de la Calabre[85], ni le diocèse d’Illyrie[86], que les iconoclastes avaient enlevés aux successeurs de saint Pierre ; et le pape Adrien les menaça de l’excommunication, s’ils n’abjuraient pas cette hérésie pratique[87]. Les Grecs étaient alors orthodoxes ; mais le monarque régnant pouvait, infecter leur religion de son souffle : les Francs se montraient rebelles ; mais un œil pénétrant pouvait démêler qu’ils passeraient bientôt de l’usage au culte des images. Le nom de Charlemagne portait la tache du fiel polémiqua répandu par ses écrivains ; mais, quant à ses opinions personnelles, le vainqueur se conformait, avec la souplesse d’un homme d’État, aux diverses idées de la France et de l’Italie. Dans ses quatre pèlerinages ou visites au Vatican, il avait paru uni avec les papes d’affection et de croyance ; il s’était agenouillé devant le tombeau et par conséquent devant l’image de saint Pierre, et avait pris part sans scrupule à toutes les prières et à toutes les processions de la liturgie romaine. La sagesse et la reconnaissance ne s’opposaient-elles pas à ce que les pontifes de Rome s’éloignassent de leur bienfaiteur ? avaient-ils le droit d’aliéner l’exarchat qu’ils en avaient reçu ? avaient-ils le pouvoir d’abolir à Rome son gouvernement ? Le titre de patrice était au-dessous du mérite et de la grandeur de Charlemagne ; le seul moyen pour eux de s’acquitter de ce qu’ils lui devaient ou d’assurer leur position, était de rétablir l’empire d’Occident. Cette opération décisive allait anéantir à jamais les prétentions des Grecs ; Rome allait sortir de l’humiliant état de ville de province pour reprendre toute sa majesté ; les chrétiens de l’Église latine allaient être réunis, sous un chef suprême, dans leur ancienne métropole, et les vainqueurs de l’Occident allaient recevoir leur couronne des successeurs de saint Pierre. L’Église romaine acquérait un défenseur zélé et imposant ; et, sous la protection de la puissance carolingienne, l’évêque de Rome pourrait désormais gouverner cette capitale avec honneur et sûreté[88]. Avant même la ruine du paganisme, la concurrence qui s’élevait pour le riche évêché de Rome avait souvent produit des émeutes et des massacres. A l’époque dont nous parlons, le peuple était moins nombreux, mais les mœurs, étaient plus sauvages, la conquête plus importante ; et les ecclésiastiques ambitieux qui aspiraient au rang de souverain, se disputaient avec fureur la chaire de saint Pierre. La longueur du règne d’Adrien Ier[89] surpassa celle du règne de ses prédécesseurs et des papes qui vinrent après lui[90] : l’érection des murs de la ville de Rome, le patrimoine de l’Église, la destruction des Lombards, et l’amitié de Charlemagne, tels furent les trophées de sa gloire ; il éleva en secret le trône de ses successeurs, et, sur un théâtre peu étendu, il déploya les vertus d’un grand prince, On respecta sa mémoire ; mais lorsqu’il fallut le remplacer, un prêtre de l’église de Latran, Léon III, fut préféré à son neveu et à son favori, qu’il avait revêtus des premières dignités de l’Église. Ceux-ci, sous le masque de la soumission ou de la pénitence, dissimulèrent durant plus de quatre ans leurs horribles projets de vengeance ; enfin, dans une procession, une bande de conspirateurs furieux, après avoir dispersé une multitude désarmée, se jeta sur la personne sacrée du pape, qu’ils accablèrent de coups et de blessures. Ils en voulaient à sa vie ou à sa liberté ; mais, soit trouble, soit remords, ils manquèrent leur entreprise, Léon, laissé pour mort sur la place, étant revenu de l’évanouissement causé par la perte de son sang, recouvra la parole et la vue ; et sur cet événement naturel, on a fabriqué l’histoire miraculeuse de la restauration de ses yeux et de sa langue, dont l’avait privé deux fois le fer des assassins[91]. Il s’échappa de sa prison et se réfugia au Vatican ; le duc de Spolette vola à son secours ; Charlemagne fut indigné de cet attentat ; et, soit invité par lui, soit de son propre mouvement, le pontife de Rome alla le trouver dans son camp de Paderborn en Westphalie. Léon repassa les Alpes avec une escorte de comtes et d’évêques qui devaient défendre sa personne et prononcer sur son innocence ; et ce ne fut pas sans regret que le vainqueur ces Saxons différa jusqu’à l’année suivante d’aller lui-même remplir à Rome ce pieux devoir, Charlemagne se rendit en effet à Rome pour la quatrième et dernière fois ; il y fut reçu avec les honneurs dus au roi des Francs et au patrice de cette capitale. Léon eut la permission de se disculper par le serment des crimes qu’on lui imputait ; ses ennemis furent réduits au silence ; et l’on punit trop doucement, par l’exil les sacrilèges assassins qui avaient voulu attenter à sa vie. Le jour de Noël de la dernière année du huitième siècle, Charlemagne se rendit à là basilique de Saint-Pierre. Pour satisfaire la vanité des romains, il avait changé le simple habit de sa nation contre celui de patrice de Rome[92]. Après la célébration des saints mystères, Léon plaça tout à coup sur la tête du prince une couronne précieuse[93], et l’église retentit de cette acclamation : Longue vie et victoire à Charles, très pieux Auguste, couronné par la main de Dieu ; grand et pacifique empereur des Romains ! On répandit l’huile royale sur sa tête et sur son corps. D’après l’exemple des Césars ; il fut salué, ou adoré par le pontife. Le serment de son couronnement renfermait la promesse de maintenir la foi et les privilèges de l’Église ; de riches offrandes déposées sur le tombeau du saint apôtre furent le premier fruit de cette promesse. L’empereur protesta, dans des entretiens familiers, qu’il n’avait pas connu le dessein de Léon ; que s’il en avait été instruit, il l’aurait déjoué par son absence ; mais les préparatifs de la cérémonie devaient en avoir divulgué le secret ; et le voyage de Charlemagne annonce qu’il s’attendait à ce couronnement[94] : il avait avoué que le titre d’empereur était l’objet de son ambition, et un synode tenu à Rome avait prononcé que c’était la seule récompense proportionnée à son mérite et à ses services. Le surnom de Grand a été souvent accordé, et quelquefois avec justice ; mais il n’y a que Charlemagne pour qui cette belle épithète ait été jointe au nom propre d’une manière indissoluble. Ce nom a été placé dans le calendrier de Rome parmi ceux des saints ; et, par un rare bonheur, ce saint a obtenu les éloges des historiens et des philosophes d’un siècle éclairé[95]. La barbarie du siècle et de la nation du milieu desquels il s’est élevé, ajoute sans doute à son mérite réel ; mais les objets tirent aussi une grandeur apparente de la petitesse de ceux qui les environnent, et les ruines de Palmyre doivent beaucoup de leur éclat à la nudité du désert. Je puis sans injustice faire remarquer quelques taches sur la sainteté et la grandeur du restaurateur de l’empire d’Occident. La continence m’est pas la plus brillante de ses vertus morales[96] : au reste, neuf femmes, ou concubines, d’autres amours moins relevées et moins durables, la multitude de ses bâtards, qu’il plaça tous dans l’ordre ecclésiastique, le long célibat et les mœurs licencieuses de ses filles[97], qu’il semble avoir trop aimées, peuvent n’avoir pas eu de conséquences réellement funestes au bonheur public. A peine voudra-t-on me permettre d’accuser l’ambition d’un conquérant ; mais, dans un jour de rétributions, les fils de Carloman son frère, les princes mérovingiens d’Aquitaine, et les quatre mille cinq cents Saxons qu’il fit décapiter au même endroit, auraient bien quelque chose à reprocher à la justice et à l’humanité de Charlemagne. Le traitement qu’essuyèrent les Saxons[98] fut un abus du droit de la victoire. Ses lois ne furent pas moins sanguinaires que ses armes ; et dans l’examen de ses motifs, tout ce qu’on ne donne pas à la superstition doit s’imputer au caractère. Le sédentaire lecteur est étonné de l’activité infatigable de son esprit et, de son corps ; et ses sujets n’étaient pas moins frappés que ses ennemis des subites apparitions par lesquelles il les surprenait lorsqu’ils le croyaient dans les parties de l’empire les plus éloignées. Il ne se reposait ni durant la paix ni durant la guerre, ni l’hiver ni l’été ; et notre imagination ne concilie pas aisément les annales de son règne avec les détails géographiques de ses expéditions. Mais cette activité était une vertu nationale plutôt qu’une vertu personnelle : un Français passait alors sa vie errante à la chasse, dans des pèlerinages ou des aventures militaires, et les voyages de Charlemagne n’étaient distingués que par une suite plus nombreuse et un objet plus important. Pour bien juger de la réputation qu’il a obtenue dans le métier des armes, il faut considérer quels furent ses troupes, ses ennemis et ses actions. Alexandre fit ses conquêtes avec les soldats de Philippe ; mais les deux héros qui avaient précédé Charlemagne, lui avaient légué leur nom, leurs exemples et les compagnons de leurs victoires. C’est à la tête de ces vieilles troupes supérieures en nombre qu’il accabla des nations sauvages ou dégénérées, incapables de se réunir pour leur sûreté commune, et jamais il n’eut à combattre une armée égale en nombre, ou qui pût se comparer à la sienne pour les armes et pour la discipline. La science de la guerre a été perdue, et s’est ranimée avec les arts de la paix ; mais ses campagnes n’ont été illustrées par aucun siège ou aucune bataille bien difficile ou d’un succès bien éclatant, et il dut voir d’un œil d’envie les triomphes de son grand-père sur les Sarrasins. Après son expédition d’Espagne son arrière-garde fut défaite dans les Pyrénées ; et ses soldats, qui voyaient leur situation sans remède, et leur valeur inutile, purent en mourant accuser le défaut d’habileté ou de circonspection de leur général[99]. C’est avec respect que je tomberai aux lois de Charlemagne, tant louées par un jubé si respectable. Elles ne forment pas un système, mais une suite d’édits minutieux publiés selon les besoins du moment pour la correction des abus, la réforme des mœurs, l’économie de ses fermes, le soin de sa volaille et même la vente de ses œufs. Il voulait perfectionner la législation et le caractère des Français, et ses tentatives, malgré leur faiblesse et leur imperfection, méritent des éloges : il suspendit ou il adoucit par son administration les maux invétérés qui pesaient sur son siècle[100] ; mais dans ses institutions j’aperçois rarement les vues générales et l’immortel esprit d’un législateur qui se survit à lui-même pour le bonheur de la postérité. L’union et la stabilité de son empire dépendaient de sa seule vie : il suivit le dangereux usage de partager son royaume entre ses enfants, et, après ses nombreuses diètes, laissa tous les points à la constitution flotter entre les désordres de l’anarchie et ceux du despotisme. Il se laissa entraîner, par son estime pour la piété et les lumières du clergé, à remettre entre les mains de cet ordre ambitieux des domaines temporels et une juridiction civile ; et lorsque Louis son fils fut accusé et déposé par les évêques, il put avoir quelque droit de l’imputer à l’imprudence de son père. Il enjoignit par ses lois le paiement de la dîme, parce que les démons avaient proclamé dans les airs que c’était pour ne l’avoir pas payée qu’on venait d’éprouver une disette de grains[101]. Son goût pour les lettres est attesté par les écoles qu’il établit, par les arts qu’il introduisit dans ses États, par les ouvrages qui parurent sous son nom, et par ses relations familières avec ceux de ses sujets et des étrangers qu’il appela, à sa cour, afin de travailler à son éducation et à celle de son peuple. Ses études furent tardives, laborieuses et imparfaites ; s’il parlait le latin et s’il entendait le grec, il avait appris dans la conversation plutôt que dans les livres ce qu’il savait de ces deux langues, et ce ne fut qu’à un âge mûr que le souverain de l’empire d’Occident s’efforça de se familiariser avec l’art de l’écriture, que tous les paysans connaissait aujourd’hui dès leur enfance[102]. On ne cultivait alors la grammaire et la logique, l’astronomie et la musique, que pour les faire servir à la superstition ; mais la curiosité de l’esprit humain doit à la fin le perfectionner, et les encouragements accordés aux sciences composent les rayons les plus purs et les plus doux de la gloire dont s’est environné le caractère de Charlemagne[103]. Sa figure majestueuse[104], la longueur de son règne, la prospérité de ses armes, la vigueur de son administration, et les hommages que lui rendirent les nations éloignées, le distinguent de la foule des rois, et le renouvellement de l’empire d’Occident rétabli par lui, a commencé pour l’Europe une nouvelle époque. Cet empire était digne de son titre ; et le prince qui, par droit d’héritage ou de conquête[105], régnait à la fois sur la France, sur l’Espagne, sur l’Italie, l’Allemagne et la Hongrie, pouvait se regarder comme possesseur de la plupart des plus beaux royaumes de l’Europe[106]. 1° La province romaine de la Gaule était devenue la monarchie de FRANCE ; mais, dans le déclin de la ligne des Mérovingiens, ses limites furent resserrées par l’indépendance des Bretons et la révolte de l’Aquitaine. Charlemagne poursuivit les Bretons jusqu’au bord de l’océan, resserra sur les côtes cette tribu féroce, dont l’origine et la langue sont si éloignées de celles des Français, et pour punition lui imposa des tributs, en exigea des otages, et la contraignit à la paix. Après une longue querelle, la province d’Aquitaine fut confisquée, et ses ducs perdirent la liberté et la vie. C’eût été punir bien rigoureusement des gouverneurs ambitieux, coupables seulement d’avoir voulu trop fidèlement imiter les maires du palais ; mais une chartre découverte depuis peu[107], prouve qu’ils étaient les derniers descendants de Clovis et les héritiers légitimes de sa couronne par une branche cadette descendue d’un frère de Dagobert. Leur ancien royaume se trouvait réduit au duché de Gascogne, aux comtés de Fésenzac ou d’Armagnac, situés au pied des Pyrénées ; leur race se propagea jusqu’au commencement du sixième siècle, et ils survécurent à leurs oppresseurs les Carlovingiens, pour éprouver l’injustice ou les faveurs d’une troisième dynastie. Par la réunion de l’Aquitaine, la France acquit l’étendue qu’elle conserve aujourd’hui, en y ajoutant les Pays-Bas jusqu’au Rhin. 2° Les Sarrasins avaient été chassés de la France par le père et le grand-père de Charlemagne ; mais ils demeuraient les maîtres de la plus grande partie de l’Espagne ; depuis le rocher de Gibraltar jusqu’aux Pyrénées. Dans leurs dissensions civiles, un Arabe, l’émir de Saragosse, se rendit à la diète de Paderborn pour y implorer la protection de l’empereur. Charlemagne passa en Espagne ; il rétablit l’émir, et, sans distinguer les croyances, il écrasa les chrétiens qui voulurent résister, et récompensa l’obéissance et les services des musulmans. Il établit ensuite, en s’éloignant, la Marche espagnole[108], qui s’étendait depuis les Pyrénées jusqu’à la rivière de l’Èbre : le gouverneur français résidait à Barcelone ; il donnait des lois aux comtés de Roussillon et de Catalogne, et les petits royaumes d’Aragon et de Navarre étaient soumis à sa juridiction. 3° En qualité de roi des Lombards et de patrice de Rome, Charlemagne gouvernait la plus grande partie de l’Italie[109], formant, depuis les Alpes jusqu’aux frontières de la Calabre, une étendue de mille milles. Le duché de Bénévent, fief lombard, s’était agrandi aux dépens des Grecs sur tout le pays qui compose le royaume actuel de Naples. Mais le duc alors régnant, Arrechis, ne voulut point partager la servitude de son pays ; il se qualifia de prince indépendant, et il opposa son épée à la monarchie carlovingienne. Il se défendit avec fermeté ; sa soumission ne fut pas sans gloire, et l’empereur se contenta d’exiger de lui un tribut périodique, la démolition de ses forteresses, et l’engagement de reconnaître sur ses monnaies la supériorité d’un suzerain. Grimoald, fils d’Arrachis, tout en flattant Charlemagne et lui donnant adroitement le nom de père, n’en soutint pas moins sa dignité avec prudence, et Bénévent s’affranchit peu à peu du joug des Français[110]. 4° Charlemagne est le premier qui ait réuni la Germanie sous le même sceptre. Le nom de France orientale s’est conservé dans le cercle de Franconie, et la conformité de la religion et du gouvernement avait récemment incorporé les habitants de la Hesse et de la Thuringe à la nation des vainqueurs. Les Allemands, si formidables aux Romains, étaient les fidèles vassaux et les confédérés des Francs ; et leur pays comprenait le territoire de l’Alsace, de la Souabe et de la Suisse. Les Bavarois, à qui on laissait aussi leurs lois et leurs mœurs, souffraient un maître avec plus d’impatience les trahisons multipliées de leur duc Tasille légitimèrent l’abolition de la souveraineté héréditaire et le pouvoir des ducs fut partagé entre les comtes chargés à la fois de garder cette importante frontière, et d’y exercer les fonctions de juges. Mais la partie du nord de l’Allemagne, qui s’étend du Rhin au-delà de l’Elbe, était toujours ennemie et païenne : ce ne fut qu’après une guerre de trente-trois ans que les Saxons embrassèrent le christianisme et furent soumis à Charlemagne. On détruisit les idoles et leurs adorateurs : la fondation des évêchés de Munster, d’Osnabruck, de Paderborn, de Minden, de Brême, de Verden, de Hildesheim et d’Halberstadt, marque des deux côtés du Weser les bornes de l’ancienne Saxe : ces évêchés formèrent les premières écoles et les premières villes de cette terre sauvage ; et la religion et l’humanité qu’on sut inspirer aux enfants, expièrent en quelque sorte le massacre des pères. Au-delà de l’Elbe, les Slaves ou Sclavons, peuple de mœurs uniformes, bien que sous différentes dénominations, occupaient le territoire qui forme aujourd’hui la Prusse, la Pologne et la Bohême ; et quelques marques passagères d’obéissance ont engagé les historiens français à prolonger l’empire de Charlemagne jusqu’à la Baltique et à la Vistule. La conquête ou la conversion de ces pays est plus récente ; mais on peut attribuer aux armes de ce prince la première réunion de la Bohême au corps germanique. 5° Il fit souffrir aux Avares ou Huns de la Pannonie, les calamités dont ils avaient accablé les nations. Le triple effort d’une armée française qui entra dans leur pays par terre et par les fleuves, en traversant les monts Carpathes, situés le long de la plaine du Danube, renversa les fortifications cale bois qui environnaient leurs districts et leurs villages. Après une sanglante lutte qui dura huit ans, le massacre des plus nobles d’entre les leurs vengea la mort de quelques généraux français ; les restes de la nation se soumirent. La résidence royale du chagan fut dévastée et totalement détruite ; et les trésors amassés pendant deux siècles et demi de rapines enrichirent les troupes victorieuses ou ornèrent les églises de l’Italie et de la Gaule. Après la réduction de la Pannonie, l’empire de Charlemagne ne se trouva plus borné que par le confluent du Danube, de la Teyss et de la Save ; il acquit sans peine et sans beaucoup d’avantages les provinces d’Istrie, de Liburnie et de Dalmatie ; et ce fut par un effet de sa modération qu’il laissa les Grecs possesseurs réels ou titulaires des ville maritimes. Mais l’acquisition de ces pays éloignés ajouta plus à sa réputation qu’à sa puissance, et il n’osa point y risquer d’établissement ecclésiastique pour tirer les Barbares de leur vie errante et de leur idolâtrie. Il ne fit que de faibles efforts pour établir quelques canaux de communication entre la Saône et la Meuse, le Rhin et le Danube[111]. L’exécution d’un semblable projet aurait vivifié l’empire, et Charlemagne prodigua souvent à la construction d’une cathédrale plus d’argent et de travaux que n’en aurait coûté cette entreprise.
Si on rapproche les grands traits de ce tableau géographique, on verra que l’empire des Français se prolongeait, entre l’orient et l’occident, de l’Èbre à l’Elbe ou à la Vistule ; entre le nord et le midi, du duché de Bénévent à la rivière d’Eyder, qui a toujours séparé l’Allemagne et le Danemark. L’état de misère et de division où se trouvait le reste de l’Europe augmentait l’importance personnelle et l’importance politique de Charlemagne. Une multitude de princes, d’origine saxonne ou écossaise, se disputaient les îles de la Grande-Bretagne et de l’Irlande ; et après la perte de l’Espagne, le royaume des Goths chrétiens, gouvernés par Alphonse le Chaste, se trouva borné à une chaîna étroite des montagnes des Asturies. Ces petits souverains révéraient la puissance ou la vertu du monarque carlovingien ; ils imploraient l’honneur et l’appui de son alliance : ils le nommaient leur père commun, seul et suprême empereur de l’Occident[112]. Il traita plus également avec le calife Haroun-al-Raschid[113], dont les États se prolongeaient depuis l’Afrique jusqu’à l’Inde, et il reçut des ambassadeurs de ce prince une tente, une horloge d’eau, un éléphant, et les clefs du saint-sépulcre. Il n’est pas aisé de concevoir l’amitié personnelle d’un Français et d’un Arabe qui ne s’étaient jamais vus, et qui avaient une langue et une religion si différentes ; mais quant à leur correspondance publique, elle était fondée sur la vanité, et l’éloignement où ils étaient l’un de l’autre, ne permettait pas que leurs intérêts pussent se trouver en concurrence. Les deux tiers de l’empire que Rome avait possédé en Occident se trouvèrent soumis à Charlemagne ; et il était bien dédommagé de ce qui lui en manquait, par sa domination sur les nations inaccessibles ou invincibles de la Germanie ; mais, dans le choix de ses ennemis il y a lieu de s’étonner qu’il ait préféré si souvent la pauvreté du Nord aux richesses du Midi. Les trente-trois campagnes qu’il fit d’une manière si laborieuse dans les bois et dans les marais de la Germanie, auraient suffi pour chasser les Grecs de l’Italie et les Sarrasins de l’Espagne, et lui donner ainsi tout l’empire de Rome. La faiblesse des Grecs lui assurait une victoire facile ; la gloire et la vengeance auraient excité ses sujets à une croisade contre les Sarrasins, la religion et la politique l’auraient justifiée. Peut-être, dans ses expéditions au-delà du Rhin et de l’Elbe, avait-il pour objet de soustraire sa monarchie à la destinée de l’empire romain, de désarmer les ennemis des nations civilisées, et anéantir les germes des migrations futures. Mais on a sagement observé que, pour être utiles, les conquêtes de précaution doivent être universelles, puisqu’en s’élargissant, le cercle des conquêtes ne fait qu’agrandir le cercle des ennemis dont on environne ses frontières[114]. L’asservissement de la Germanie écarta le voile qui avait si longtemps caché à l’Europe le continent ou les îles de la Scandinavie. Il réveilla la valeur endormie de ses barbares habitants. Ceux des idolâtres de la Saxe qui avaient le plus d’énergie échappèrent au joug de l’oppresseur chrétien, et cherchèrent un asile dans le Nord ; ils couvrirent de leurs corsaires l’Océan et la Méditerranée, et Charlemagne vit avec douleur les funestes progrès des Normands qui, moins de soixante-dix ans après, hâtèrent la chute de sa race et celle de sa monarchie. Si le pape et les Romains avaient rétabli la constitution primitive, Charlemagne n’aurait joui que pendant sa vie des titres d’empereur et d’Auguste, et à chaque vacance, il aurait fallu qu’une élection formelle ou tacite plaçât sur le trône chacun de ses successeurs ; mais, en associant à l’empire son fils Louis le Débonnaire, il établit ses droits indépendants comme monarque et comme conquérant ; et il paraît qu’en cette occasion il aperçut et prévint les prétentions secrètes du clergé (A. D. 813). Il ordonna au jeune prince de prendre la couronne sur l’autel, de la placer lui-même sur sa tête comme un don qu’il tenait de Dieu, de son père et de la nation[115]. Ensuite lorsque Lothaire et Louis II furent associés à l’empire, on répéta la même cérémonie, mais d’une manière moins marquée : le sceptre carlovingien se transmit de père en fils durant quatre générations, et l’ambition des papes fut réduite à l’infructueux honneur de donner la couronne et fonction royale à ces princes héréditaires, déjà revêtus du pouvoir et en possession de leurs États. Louis le Débonnaire survécut à ses frères, et réunit sous son sceptre tout l’empire de Charlemagne ; mais les peuples et les nobles, ses évêques et ses enfants, découvrirent bientôt, que la même âme n’inspirait plus ce grand corps, et que les fondements étaient minés au centre, tandis que la surface extérieure paraissait encore intacte et brillante. Après une guerre ou une bataille où périrent cent mille Français, un traité de partage divisa l’empire entre ses trois fils, qui avaient violé tous leurs devoirs de fils et de frères. Les royaumes de la Germanie et de la France furent séparés pour jamais ; Lothaire, à qui on donna le titre d’empereur, obtint les provinces de la Gaule situées entre le Rhône et les Alpes, la Meuse et le Rhin. Lorsque sa portion se partagea ensuite entre ses enfants, la Lorraine et Arles, deux petits royaumes établis depuis peu et dont l’existence fut de peu de durée, devinrent le partage de ses deux plus jeunes fils. Louis II, l’aîné, se contenta du royaume d’Italie, patrimoine naturel et suffisant d’un empereur de Rome. Il mourut sans laisser d’enfants mâles : alors ses oncles et ses cousins se disputèrent le trône ; et les papes saisirent habilement cette occasion de juger les prétentions ou le mérite des candidats, et de donner, au plus soumis ou au plus libéral, la dignité impériale d’avocat de l’Église de Rome. On ne retrouve plus dans les misérables restes de la race carlovingienne aucune apparence de vertus ni de pouvoir ; et c’est par les ridicules surnoms de Chauve, de Bègue, de Gros et de Simple, que se distinguent les traits ignobles et uniformes de cette foule de rois, tous également dignes de l’oubli. L’extinction des branches maternelles fit passer l’héritage entier à Charles le Gros, dernier empereur de sa famille : la faiblesse de son esprit autorisa la défection de la Germanie, de l’Italie et de la France : il fut déposé dans une diète, et réduit à mendier sa subsistance journalière auprès des rebelles dont le dédain lui avait laissé la liberté et la vie. Les gouverneurs, les évêques et les seigneurs s’emparèrent, chacun selon sa force, de quelque fragment de l’empire tombant en ruines ; il y eut quelques préférences pour ceux qui descendaient de Charlemagne, par les femmes ou par les bâtards. Le titre et la possession de la plus grande partie de ces compétiteurs étaient également douteux, et leur mérite se trouvait analogue au peu d’étendue de leurs domaines. Ceux qui purent se montrer aux portes de Rome avec une armée, furent couronnés empereurs dans le Vatican ; mais leur modestie se contenta le plus souvent du titre de roi d’Italie : l’on peut regarder comme un interrègne l’espace de soixante-quatorze ans qui s’écoula depuis l’abdication de Charles le Gros jusqu’à l’installation d’Othon Ier. Othon[116] était de la noble maison des ducs de Saxe, et il descendait réellement de Witikind, ennemi et ensuite prosélyte de Charlemagne, la postérité du peuple vaincu régna enfin sur les conquérants. Henri l’Oiseleur, son père, choisi par le suffrage de sa nation, avait sauvé et fondé sur des bases solides le royaume de la Germanie. Le fils de Henri, le premier et le plus grand des Othons, recula de tous côtés les bornes de ce royaume[117]. On réunit à la Germanie cette portion de la Gaule qui s’étend, à l’ouest du Rhin, le long des bords de la Meuse et de la Moselle, et dont les peuples, dès le temps de César et de Tacite, avaient avec les Germains de grands rapports de langage et de complexion. Les successeurs d’Othon acquirent entre le Rhin, le Rhône et les Alpes, une vaine suprématie sur les royaumes de Paris, de Bourgogne et d’Arles. Du côté du nord, le christianisme fut propagé par les armes d’Othon, vainqueur et apôtre des nations esclavonnes de l’Elbe et de l’Oder : il fortifia, par des colonies d’Allemands, les marches de Brandebourg et de Schleswig ; le roi de Danemark et les ducs de Pologne et de Bohême se reconnurent ses vassaux et ses tributaires. Il passa les Alpes à la tête d’une armée victorieuse, subjugua le royaume d’Italie, délivra le pape, et attacha pour jamais la couronne impériale au nom et à la nation des Germains. Ce fut à compter de cette époque mémorable, que s’établirent deux maximes de jurisprudence publique, introduites par la force et ratifiées par le temps : 1° que le prince élu dans une diète d’Allemagne acquérait au même instant les royaumes subordonnés de l’Italie et de Rome ; 2° mais qu’il ne pouvait pas légalement se qualifier d’empereur et d’Auguste ; avant d’avoir reçu la couronne des mains du pontife de Rome[118]. Le nouveau titre de Charlemagne fut annoncé en Orient par le changement de son style ; le titre de père, qu’il accordait aux empereurs grecs, fit place au nom de frère, symbole d’égalité et de familiarité[119]. Peut-être, dans ses rapports avec Irène, aspirait-il au titre d’époux : ses ambassadeurs à Constantinople parlèrent le langage de la paix et de l’amitié ; et peut-être le but secret de leur mission fut-il de négocier un mariage avec cette princesse ambitieuse, qui avait abjuré tous ses devoirs de mère. Il est impossible de conjecturer quelles eussent été la nature, la durée et les suites d’une pareille union entre deux empires si éloignés et si étrangers l’un à l’autre ; mais le silence unanime des Latins doit faire penser que le bruit de cette négociation de mariage fut inventé par les ennemis d’Irène, afin de la charger du crime d’avoir voulu livrer l’Église et l’État aux peuples de l’Occident[120]. Les ambassadeurs de France furent témoins de la conspiration de Nicéphore et de la haine nationale, et ils manquèrent d’en être les victimes. Constantinople fut indignée de la trahison et du sacrilège de l’ancienne Rome ; chacun répétait ce proverbe, que les Français étaient de bons amis et de mauvais voisins ; mais il était dangereux de provoquer un voisin qui pouvait avoir la tentation de renouveler, dans l’église de Sainte-Sophie, la cérémonie de son couronnement. Les ambassadeurs de Nicéphore, après un pénible voyage, de longs détours et de longs délais, trouvèrent Charlemagne dans son camp, sur les bords de la Saal ; et, pour confondre leur unité, ce prince déploya dans un village de la Franconie toute la pompe, ou du moins toute la morgue du palais de Byzance[121]. Les Grecs traversèrent quatre salles d’audience : dès la première, ils allaient se prosterner devant un personnage magnifiquement vêtu, et assis sur un siége élevé, lorsqu’il leur apprit qu’il n’était que le connétable ou le maître des chevaux, c’est-à-dire un des serviteurs du prince. Ils firent la même méprise et reçurent la même réponse dans les trois pièces où se trouvait le comte du palais, l’intendant et le grand chambellan. Leur impatience s’étant ainsi accrue peu à peu, on ouvrit enfin la porte de la chambre où était Charlemagne ; et, ils aperçurent le monarque, environné de tout l’étalage de ce luxe étranger qu’il méprisait, et de l’amour et du respect de ses chefs victorieux. Les deux empires conclurent un traité de paix et d’alliance, et il fut décidé que chacun garderait les domaines dont il se trouvait en possession ; mais les Grecs[122] oublièrent bientôt cette humiliante égalité, ou ils ne s’en souvinrent que pour détester les Barbares qui les avaient forcés à la reconnaître. Tant que le pouvoir et les vertus se trouvèrent réunis, ils saluèrent avec respect l’auguste Charlemagne, en lui donnant les titres de basileus et d’empereur des Romains. Du moment où l’élévation de Louis le Pieux eut séparé ces deux attributs, on lut sur la suscription des lettres de la cour de Byzance, au roi, ou, comme il se qualifie lui-même, l’empereur des Français et des Lombards. Lorsqu’ils n’aperçurent plus ni pouvoir ni vertus, ils dépouillèrent Louis II de son titre héréditaire ; et, en lui appliquant la dénomination barbare de rex ou rega, ils le reléguèrent dans la foule des princes latins. Sa réponse[123] annonce sa faiblesse : il prouve avec assez d’érudition que, dans l’histoire sacrée et l’histoire profane, le nom de roi est synonyme du mot grec basileus : il ajoute que si, à Constantinople, on lui donne une acception plus exclusive et plus auguste, il tient de ses ancêtres et du pape le juste droit de participer aux honneurs de la pourpre romaine. La même dispute recommença sous le règne des Othon, et leur ambassadeur peint sous de vives couleurs l’insolence de la cour de Constantinople[124]. Les Grecs affectaient de mépriser la pauvreté et l’ignorance des Français et des Saxons ; et, réduits au dernier degré de l’abaissement, ils refusaient encore de prostituer aux rois de la Germanie le titre d’empereurs romains. Les empereurs d’Occident continuaient à exercer sur l’élection des papes l’influence que s’étaient arrogée les princes goths et les empereurs grecs ; et l’importance de cette prérogative augmenta avec les domaines temporels et la juridiction spirituelle de l’Église romaine. Selon la constitution aristocratique du clergé, ses principaux membres formaient un sénat qui aidait l’administration de ses conseils, et qui nommait à l’évêché lorsqu’il devenait vacant. Il y avait dans Rome vingt-huit paroisses : chaque paroisse était gouvernée par un cardinal prêtre ou presbyter, titre qui, modeste à son origine, voulut ensuite égaler la pourpre des rois. Le nombre des membres de ce conseil fut augmenté par l’association des sept diacres des hôpitaux les plus considérables, des sept juges du palais de Latran ; et de quelques dignitaires de l’Église. Il était sous la direction des sept cardinaux évêques de la province romaine, qui s’occupaient moins de leurs diocèses d’Ostie, de Porto, de Velitres, de Tusculum, de Préneste, de Tivoli et du pays des Sabins, situés, pour ainsi dire, dans les faubourgs de Rome, que de leur service hebdomadaire à la cour de l’évêque, et du soin d’obtenir une plus grande portion des honneurs et de l’autorité du siége apostolique. Lorsque le pape mourait, ces évêques désignaient au collège des cardinaux celui qu’ils devaient choisir pour son successeur[125], et les applaudissements ou les clameurs du peuple romain approuvaient ou rejetaient leur choix : mais, après le suffrage du peuple, l’élection était encore imparfaite ; et, pour sacrer légalement le pontife, il fallait que l’empereur, en qualité d’avocat de l’Église, eût déclaré son approbation et son consentement. Le commissaire impérial examinait, sur les lieux, la forme et la liberté de l’élection ; et ce n’était qu’après avoir bien approfondi les qualifications des électeurs, qu’il recevait le serment de fidélité, et qu’il confirmait les donations qui avaient enrichi successivement le patrimoine de saint-Pierre. S’il survenait un schisme (et il en arrivait souvent), on se soumettait au jugement de l’empereur, qui, au milieu d’un synode d’évêques, osait juger, condamner et punir un pontife criminel. Le sénat et le peuple s’engagèrent, dans un traité avec Othon Ier, de choisir le candidat le plus agréable à sa majesté[126] : ses successeurs anticipèrent ou prévinrent leurs suffrages ; ils donnèrent à leur chancelier l’évêché de Rome, ainsi que les évêchés de Cologne et de Bamberg ; et quel que fût le mérite d’un Français ou d’un Saxon son nom prouve assez l’intervention d’une puissance étrangère. Les inconvénients d’une élection populaire excusaient, d’une manière spécieuse, ces actes d’autorité. Le compétiteur exclu par les cardinaux en appelait aux passions ou à l’avarice de la multitude : des meurtres souillèrent le Vatican, et le palais de Latran ; et les sénateurs les plus puissants, les marquis de Toscane et les comtes de Tuscule, tinrent le siége apostolique dans une longue servitude. Les papes des neuvième et dixième siècles furent insultés, emprisonnés et assassinés par leurs tyrans ; et lorsqu’on les dépouillait des domaines qui dépendaient de leur Église, telle était leur indigence, que non seulement ils ne pouvaient pas soutenir l’état d’un prince, mais qu’ils ne pouvaient pas même exercer la charité d’un prêtre[127]. Le crédit qu’eurent alors deux sœurs prostituées, Marozia et Théodora, était fondé sur leurs richesses et sur leur beauté, sur leurs intrigues amoureuses ou politiques : la mitre romaine était la récompense des plus infatigables de leurs amants, et leur règne[128] a pu faire naître[129], dans les siècles d’ignorance, la fable[130] d’une papesse[131]. Un bâtard de Marozia, un de ses petits-fils et un de ses arrière-petits-fils, descendant du bâtard (singulière généalogie), montèrent sur le trône de saint Pierre ; et ce fut à l’âge de dix-neuf ans que le second d’entre eux devint le chef de l’Église latine. La maturité de son âge répondit à ce qu’on avait dû attendre de sa jeunesse ; et la foule des pèlerins qui venaient visiter Rome, pouvait attester la vérité des accusations qu’on forma contre lui dans un synode romain et en présence d’Othon le Grand. Après avoir renoncé à l’habit et aux bienséances de son état, le pape Jean XI, en sa qualité de soldat, pouvait n’être pas déshonoré par ses excès de boisson, ses meurtres, ses incendies, son goût effréné pour le jeu et pour la chasse : ses actes publics de simonie pouvaient être la suite de sa détresse ; et supposé qu’il ait, comme on le dit, invoqué Jupiter et Vénus, ce put n’être qu’en plaisantant ; mais nous voyons avec quelque surprise ce digne petit-fils de Marozia vivre publiquement en adultère avec les matrones de Rome, le palais de Latran changé en une école de prostitution, et les attentats du pape contre la pudeur des vierges et des veuves, empêchant les femmes de se rendre en pèlerinage au tombeau de saint Pierre, où elles auraient bien pu, dans cet acte de dévotion, être violées par son successeur[132]. Les protestants ont insisté, avec un plaisir malin, sur ces traits de ressemblance avec l’antéchrist ; mais, aux yeux d’un philosophe, les vices du clergé sont beaucoup moins dangereux que ses vertus. Après de longs scandales, le siége apostolique fut purifié et relevé par l’austérité et le zèle de Grégoire VII. Ce moine ambitieux s’occupa toute sa vie de l’exécution de deux projets ; dont le premier était de fixer dans le collège des cardinaux la liberté et l’indépendance de l’élection du pape, et de l’affranchir à jamais de l’influence, soit légitime, soit usurpée, des empereurs et du peuple romain ; le second objet de toute sa conduite fut de parvenir à donner et à reprendre l’empire d’Occident comme un fief ou bénéfice[133] de l’Église, et à étendre sa domination temporelle sur les rois et les royaumes de la terre. Après cinquante années de combats, la première de ces opérations se trouva achevée par le secours de l’ordre ecclésiastique, dont la liberté était liée à celle de son chef ; mais la seconde, malgré quelques succès apparents ou partiels, trouva dans la puissance civile une vigoureuse opposition, et s’est vue totalement arrêtée par les progrès de la raison humaine. Lors de la renaissance de l’empire de Rome, l’évêque ni le peuple ne pouvaient donner à Charlemagne ou à Othon des provinces perdues, comme on les avait acquises, par le sort des armes, mais les Romains étaient libres de se choisir un maître, et le pouvoir délégué au patrice fut accordé d’une manière irrévocable aux empereurs français et saxons. Les annales incomplètes de ces temps-là[134] nous ont conservé quelques souvenirs du palais, de la monnaie, du tribunal, des édits de ces princes, et de la justice exécutive que, jusqu’au treizième siècle, le préfet de la ville exerça en vertu des pouvoirs qu’il recevait des Césars[135] ; mais enfin cette souveraineté des empereurs, fut détruite par les artifices des papes et la violence du peuple. Les successeurs de Charlemagne, contents des titres d’empereur et d’Auguste, négligèrent de maintenir cette juridiction locale ; dans les temps de prospérité, des objets plus séduisants occupaient leur ambition, et lors de la décadence et de la division de l’empire, leur attention fut entièrement absorbée par le soin de défendre leurs provinces héréditaires. Au milieu des désordres de l’Italie, la fameuse Marozia détermina un des usurpateurs à devenir son troisième mari, et sa faction introduisit Hugues, roi de Bourgogne, dans le môle d’Adrien, ou château Saint-Ange, qui domine le pont principal et l’une des entrées de Rome. Son fils Albéric, qu’elle avait eu d’un de ses premiers maris, fut contraint de servir au banquet nuptial : irrité de la répugnance visible avec laquelle il s’acquittait de ses fonctions, son beau-père le frappa. Ce coup produisit une révolution : Romains, s’écria le jeune homme, vous étiez jadis les maîtres du monde et ces Bourguignons étaient alors les plus abjects de vos esclaves. Ils règnent maintenant, ces sauvages voraces et brutaux, et l’outrage que je viens de recevoir est le commencement de votre servitude[136]. On sonna le tocsin, tous les quartiers de la ville coururent aux armes : les Bourguignons se retirèrent honteusement et à pas précipités : Albéric, vainqueur emprisonna sa mère Marozia, et réduisit son frère, le pape Jean XI, à l’exercice de ses fonctions spirituelles. Il gouverna Rome plus de vingt ans avec le titre de prince ; on dit que, pour flatter les préjugés du peuple, il rétablit l’office ou du moins le nom des consuls et des tribuns. Octavien, son fils et son héritier, prit avec le pontificat le nom de Jean XII : harcelé par les princes lombards, ainsi que son prédécesseur, il chercha un défenseur capable de délivrer l’Église et la république, et la dignité impériale devint la récompense des services d’Othon ; mais le Saxon était impérieux, et les Romains étaient impatients. La fête du couronnement fut troublée par les débats secrets qu’excitaient d’un côté la jalousie du pouvoir, et de l’autre les inquiétudes de la liberté. Othon, craignant d’être attaqué et massacré au pied de l’autel, ordonna à son porte-glaive de ne pas s’éloigner de sa personne[137]. Avant de repasser les Alpes, l’empereur punit la révolte du peuple et l’ingratitude de Jean XI. Le pape fut déposé dans un synode ; le préfet, placé sur un âne et fustigé dans tous les quartiers de la ville, fut ensuite jeté au fond d’un cachot : treize des citoyens les plus coupables expirèrent sur un gibet, d’autres furent mutilés ou bannis, et les anciennes lois de Théodose et de Justinien servirent à justifier la sévérité de ces châtiments. Othon II a été accusé par la voix publique d’avoir fait massacrer avec autant de cruauté que de perfidie des sénateurs qu’il avait invités à sa table sous l’apparence de l’hospitalité et de l’amitié[138]. Durant la minorité d’Othon III, son fils, Rome fit une tentative vigoureuse pour secouer le joug des Saxons, et, le consul Crescence fut le Brutus de la république. De la condition de sujet et d’exilé, il parvint deux fois au commandement de la ville ; il opprima, chassa, créa des papes, et forma une conspiration pour rétablir l’autorité des empereurs grecs. Il soutint un siège opiniâtre dans le château Saint-Ange ; mais s’étant laissé séduire par une promesse de sûreté, il fut pendu, et on exposa sa tête sur les créneaux de la forteresse. Par un revers de fortune, Othon, ayant séparé ses troupes, fût assiégé durant trois jours dans son palais, où il manquait de vivres ; et ce ne fût que par une honteuse évasion qu’il vint à bout de se soustraire à la justice ou à la fureur des Romains. Le sénateur Ptolémée dirigeait le peuple, et la veuve du consul Crescence eut le plaisir de venger son mari en empoisonnant l’empereur devenu son amant, du moins lui en fit-on l’honneur. Le projet d’Othon III était d’abandonner les âpres contrées du Nord pour élever son trône en Italie, et faire revivre les institutions de la monarchie romaine ; mais ses successeurs ne se montrèrent jamais qu’une fois en leur vie sur les bords du Tibre, pour recevoir la couronne dans le Vatican[139]. Leur absence les exposait au mépris, et leur présence était odieuse et formidable. Ils descendaient des Alpes à la tête de leurs Barbares, étrangers à l’Italie où ils arrivaient en ennemis, et leurs passagères apparitions n’offraient que des scènes de tumulte et de carnage[140]. Les Romains, toujours tourmentés par un faible souvenir de leurs ancêtres, voyaient avec une pieuse indignation cette suite de Saxons, de Français, de princes de Souabe et de Bohême, usurper la pourpre et les prérogatives des Césars. Il n’y a peut-être rien de plus contraire à la nature et à la raison que de tenir sous le joug, contre leur gré et contre leur intérêt, des pays éloignés et des nations étrangères. Un torrent de Barbares peut passer sur la terre ; mais, pour maintenir un empire étendu, il faut un système approfondi de politique et d’oppression. Il doit y avoir au centre un pouvoir absolu prompt à l’action et riche en ressources ; il faut pouvoir communiquer facilement et rapidement d’une extrémité à l’autre ; il faut avoir des fortifications pour réprimer les premiers mouvements des rebelles, une administration régulière capable de protéger et de punir, et une armée bien disciplinée qui puisse inspirer la crainte sans exciter le mécontentement et le désespoir. Les Césars de l’Allemagne, dans leur projet d’asservir le royaume d’Italie, se trouvaient dans une position bien différente. Leurs domaines patrimoniaux s’étendaient le long du Rhin ou étaient dispersés dans leurs diverses provinces ; mais l’imprudence ou la détresse de plusieurs princes avait aliéné ce riche héritage, et le revenu qu’ils tiraient d’un exercice minutieux et vexatoire de leurs prérogatives, suffisait à peine à l’entretien de leur maison. Leurs armées n’étaient fondées que sur le service, soit l’égal, soit volontaire, de leurs différents feudataires, qui ne passaient les Alpes qu’avec répugnance, se permettaient toute espèce de rapines et de désordres et désertaient souvent avant la fin de la campagne. Le climat de l’Italie en détruisait des armées entières ; ceux qui échappaient à sa meurtrière influence rapportaient dans leur patrie les ossements de leurs princes et de leurs nobles[141] ; ils imputaient quelquefois l’effet de leur intempérance à la perfidie ou à la méchanceté des Italiens, qui du moins se réjouissaient des maux des Barbares. Cette tyrannie irrégulière combattait à armes égales contre la puissance des petits tyrans du pays ; l’issue de la querelle n’intéressait pas beaucoup le peuple, et doit aujourd’hui peu intéresser le lecteur. Mais, aux onzième et douzième siècles, les Lombards ranimèrent le flambeau de l’industrie et de la liberté, et les républiques de la Toscane imitèrent enfin ce généreux exemple. Les villes d’Italie avaient toujours conservé une sorte de gouvernement municipal ; et leurs premiers privilèges furent un don de la politique des empereurs, qui voulaient faire servir les plébéiens à contenir l’indépendance de la noblesse. Mais le rapide progrès de ces communautés, et les extensions qu’elles donnaient chaque jour à leur pouvoir, n’eurent d’autre cause que le nombre et l’énergie de leurs membres[142]. La juridiction de chaque ville embrassait toute l’étendue d’un diocèse ou d’un district : celle des évêques, des marquis et des comtés, fut anéantie, et les plus orgueilleux d’entre les nobles se laissèrent persuader ou furent contraints d’abandonner leurs châteaux solitaires, et de prendre la qualité plus honorable de citoyens et de magistrats. L’autorité législative appartenait à l’assemblée générale ; mais le pouvoir exécutif était entre les mains de trois consuls qu’on tirait annuellement des trois ordres dont se composait la république, savoir les capitaines, les valvasseurs[143] et les communes, sous la protection d’une législation égale pour tous. L’agriculture et le commerce se ranimèrent peu à peu ; la présence du danger entretenait le caractère guerrier des Lombards ; et dès qu’on sonnait le tocsin ou qu’on arborait le drapeau[144], les portes de la ville répandaient au dehors une troupe nombreuse et intrépide, dont le zèle patriotique se laissa bientôt diriger par la science de la guerre et les règles de la discipline. L’orgueil des Césars se brisa contre ces remparts populaires, et l’invincible génie de la liberté triompha des deux Frédéric, les deux plus grands princes d’u moyen âge : le premier plus grand peut-être par ses exploits militaires, mais le second cloué certainement à un degré bien supérieur des lumières et des vertus qui conviennent à la paix. Frédéric Ier, ambitieux de rétablir la pourpre dans tout son éclat, envahit-les républiques de la Lombardie avec l’adresse d’un homme d’État, la valeur d’un soldat et la cruauté d’un tyran. La découverte des Pandectes, retrouvées depuis peu, avait renouvelé une science très favorable au despotisme, et des jurisconsultes vendus déclarèrent l’empereur maître absolu de la vie et de la propriété de ses sujets. La diète de Roncaglia reconnut ses prérogatives royales dans un sens moins odieux ; le revenu de l’Italie fut fixé à soixante mille marcs d’argent[145], mais les extorsions des officiers du fisc donnèrent à ces impôts une étendue indéfinie. Les villes les plus obstinées furent réduites par la terreur ou la force de ses armes : il livra les captifs au bourreau ou les fit périr sous les traits, lancés par ses machines de guerre. Après le siège et la reddition de Milan, il fit raser les édifices de cette magnifique capitale ; il en tira trois cents otages qu’il envoya en Allemagne, et les habitants, assujettis au joug de l’inflexible vainqueur, furent dispersés dans quatre villages[146]. Milan ne tarda pas à sortir de ses cendres ; le malheur cimenta la ligue de Lombardie ; Venise, le pape Alexandre III et l’empereur grec, en défendirent les intérêts : l’édifice du despotisme fut renversa en un jour, et dans le traité de Constance, Frédéric signa, avec quelques réserves, la liberté de vingt-quatre villes. Ces villes avaient acquis toute leur vigueur et toute leur maturité lorsqu’elles luttèrent contre son petit-fils ; mais des avantages personnels et particuliers distinguaient Frédéric II[147]. Sa naissance et sou éducation le recommandaient aux Italiens ; et durant l’implacable discorde de la faction des Gibelins et de celle des Guelfes, les premiers s’attachèrent à l’empereur, tandis que les seconds, arborèrent la bannière de la liberté et de l’Église. La cour de Biome, dans un moment de sommeil, avait permis à Henri VI de réunir à l’empire les royaumes de Naples et de Sicile ; et Frédéric II, son fils, tira de ces États héréditaires de grandes ressources en soldats et en argent. Cependant il fut enfin accablé par les armés des Lombards et les foudres du Vatican ; son royaume fut donné à un étranger, et le dernier de sa race fût publiquement décapité sur un échafaud dans la ville de Naples. Il y eut un intervalle de soixante ans, durant lequel on ne vit point d’empereur en Italie, et on ne se souvint de ce nom que par la vente ignominieuse des derniers restes de la souveraineté. Les barbares vainqueurs de l’Occident se plaisaient à donner à leur chef le titre d’empereur ; mais ils n’avaient nullement le projet de le revêtir du despotisme de Constantin et de Justinien. La personne des Germains était libre, leurs conquêtes leur appartenaient, et l’énergie qui formait leur caractère national méprisait la servile jurisprudence de l’ancienne et de la nouvelle Rome. C’eût été une entreprise dangereuse et inutile que de vouloir imposer le joug d’un monarque à des citoyens armés qui ne pouvaient souffrir un magistrat, à des hommes audacieux qui refaisaient d’obéir, et à des hommes puissants qui voulaient commander. Les ducs des nations ou des provinces, les comtes des petits districts et les margraves des marches ou frontières, se partagèrent l’empire de Charlemagne et d’Othon, et réunirent l’autorité civile et militaire telle qu’elle avait été déléguée aux lieutenants des premiers Césars. Les gouverneurs romains, soldats de fortune pour la plupart, séduisirent leurs mercenaires légions ; ils prirent la pourpre impériale, et échouèrent ou réussirent dans leur révolte sans porter atteinte au pouvoir et à l’unité du gouvernement. Si les ducs, les margraves et les comtes de l’Allemagne, furent moins audacieux dans leurs prétentions, les résultats de leurs succès furent plus durables et plus funestes à l’État. Au lieu d’aspirer au rang suprême, ils travaillèrent en secret à établir leur indépendance sur le territoire qu’ils occupaient. Leurs projets ambitieux fuirent favorisés par le nombre de leurs domaines et de leurs vassaux, l’exemple et l’appui qu’ils se donnaient mutuellement, l’intérêt commun de la noblesse subordonnée, le changement des princes et des familles, la minorité d’Othon III et celle de Henri IV, l’ambition des papes, et la vaine persévérance des empereurs à poursuivre les couronnés fugitives de l’Italie et de Rome. Les commandants des provinces usurpèrent peu à peu tous les attributs de la juridiction royale et territoriale, les droits de paix et de guerre, de vie et de mort, celui de battre monnaie et de mettre des impôts, de contracter des alliances au dehors, et d’administrer l’intérieur. Toutes les usurpations de la violence furent ratifiées par l’empereur, soit de bonne volonté, soit par une suite de la nécessité où il se trouvait et cette confirmation devint le prix d’une voix douteuse ou d’un service volontaire : ce qu’il avait accordé à l’un, il ne pouvait sans injustice le refuser au successeur ou à l’égal de celui-ci ; de ces différents actes de domination passagère ou locale s’est formée insensiblement la constitution du corps germanique. Le duc ou le comte de chaque province était le chef visible placé entre le trône et la noblesse ; les sujets de la loi devenaient les vassaux d’un chef particulier, qui souvent arborait contre son souverain l’étendard qu’il avait reçu de lui. La puissance temporelle du clergé fut favorisée et augmentée par la superstition ou les vues politiques des dynasties carlovingienne et saxonne, qui comptaient aveuglément sur sa modération et sa fidélité : les évêchés d’Allemagne acquirent l’étendue et les privilèges des plus vastes domaines de l’ordre militaire, et les surpassèrent même en richesses et en population. Aussi longtemps que les empereurs conservèrent la prérogative de nommer à ces bénéfices ecclésiastiques et laïques, la reconnaissance ou l’ambition de leurs amis et de leurs favoris soutint le parti de la cour ; mais, lors de la querelle des investitures, ils furent privés de leur influence sur les chapitres épiscopaux ; les élections redevinrent liures, et, par une sorte de dérision solennelle ; le souverain se trouva réduit à ses premières prières, c’est-à-dire au droit de recommander une fois durant son règne à une prébende de chaque église. Les gouverneurs séculiers, loin d’être soumis à la volonté d’un supérieur, ne purent plus être déposés que par une sentence de leurs pairs. Durant le premier âgé de la monarchie, la nomination d’un fils au duché ou au comté de son père était sollicitée comme une faveur ; peu à peu elle devint un usage ; et enfin on l’exigea comme un droit. La succession linéale s’étendit souvent aux branches collatérales on féminines ; les États de l’empire, dénomination qui fut d’abord populaire et qui finit par être légale, furent divisés et aliénés par des testaments et des contrats dévente ; et toute idée d’un dépôt public se perdit dans celle d’un héritage particulier et transmissible à perpétuité. L’empereur ne pouvait même s’enrichir par les confiscations et les extinctions ; il n’avait qu’une année pour disposer du fief vacant, et, dans le choix du candidat, il devait consulter la diète générale ou celle de la province. Après la mort de Frédéric II, l’Allemagne n’était plus qu’un monstre à cent têtes. Une foule de princes et de prélats se disputaient les débris de l’empire : d’innombrables châteaux avaient pour maîtres des hommes plus disposés à imiter leurs supérieurs qu’à leur obéir, et, selon la mesure des forces de chacun d’eux, leurs continuelles hostilités recevaient le nom de conquête ou celui de brigandage. Une pareille anarchie était l’inévitable suite des lois et des mœurs de l’Europe, et le même orage avait mis en pièces les royaumes de la France et de L’Italie ; mais les villes de l’Italie et les vassaux français, divisés entre eux, se laissèrent détruire, tandis que l’union des Allemands a produit, sous le nom d’empire, un grand système de confédération. Les diètes d’abord fréquentes, et enfin perpétuelles, ont entretenu l’esprit national, et la législation générale de l’État est demeurée entre les mains des trois branches ou collèges des électeurs, des princes, des villes libres et impériales. 1° On permit à sept des plus puissants feudataires d’exercer, avec un nom et un rang particuliers, le privilège exclusif de choisir uni empereur romain, et ces électeurs furent le roi de Bohême, le duc de Saxe, le margrave de Brandebourg, le comte palatin du Rhin, et les trois archevêques de Mayence, de Trèves et de Cologne. 2° Le collège des princes et des prélats se débarrassa d’une multitude confusément assemblée ; ils réduisirent à quatre voix représentatives la longue suite des nobles indépendants, et ils exclurent les nobles et les membres de l’ordre équestre qu’on avait vus, ainsi qu’en Pologne, au nombre de soixante mille à cheval, dans le champ de l’élection. 3° Malgré l’orgueil de la naissance ou du pouvoir, malgré celui que donnent le glaive et la mitre, on eut la sagesse de faire des communes la troisième branche du pouvoir législatif, et les progrès de la civilisation les introduisirent, à peu prés à la même époque, dans les assemblées nationales de la France, de l’Angleterre et de l’Allemagne. La ligue anséatique maîtrisait le commerce et la navigation du Nord ; les confédérés du Rhin assuraient la paix et la communication de l’intérieur de l’Allemagne : les villes ont conservé une influence proportionnée à leurs richesses et à leur politique, et leur négative annule encore les résolutions des deux collèges supérieurs, c’est-à-dire de celui des électeurs et de celui des princes[148]. C’est au quatorzième siècle qu’on est surtout frappé du contraste qui existe entre le nom et la situation de l’empire romain d’Allemagne, lequel, excepté sur les bords du Rhin et du Danube, ne possédait pas une seule des provinces de Trajan et de Constantin. Ces princes avaient pour indignes successeurs les comtes de Habsbourg, de Nassau, de Luxembourg et de Schwartzembourg : l’empereur Henri VII obtint pour son fils la couronne de Bohème, et Charles IV, son petit-fils, reçut le, jour chez un peuple que les Allemands eux-mêmes traitaient d’étranger, de barbare[149]. Après l’excommunication de Louis de Bavière, les papes, qui, malgré leur exil ou leur captivité dans le comtat d’Avignon, affectaient de disposer des royaumes de la terre, lui donnèrent ou lui promirent l’empire, alors vacant. La mort de ses compétiteurs lui procura les voix du collège électoral, et il fut unanimement reconnu roi des Romains et futur empereur, titre qu’on prostituait aux Césars de la Germanie et à ceux de la Grèce. L’empereur d’Allemagne n’était que le magistrat électif et sans pouvoir d’une aristocratie de princes qui ne lui avaient pas laissé un village dont il pût se dire le maître. Sa plus belle prérogative était le droit de présider le sénat de la nation, assemblé d’après ses lettres de convocation, et d’y proposer les sujets de délibération ; et son royaume de Bohême, moins opulent que la ville de Nuremberg, située aux environs, formait la base la plus solide de son pouvoir et la source la plus riche de son revenu. L’armée avec laquelle il passa les Alpes n’était composée que de trois cents cavaliers. Il fut couronné dans la cathédrale de Saint-Ambroise, avec la couronne de fer que la tradition attribuait à la monarchie des Lombards ; mais on ne lui permit qu’une suite peu nombreuse : les portes de la ville se fermèrent sur lui, et les armes des Visconti retinrent en captivité le roi d’Italie, qui fut obligé de les confirmer dans la possession de Milan. Il fut couronné une seconde fois au Vatican, avec la couronne d’or de l’empire ; mais, pour se conformer à un article d’un traité secret, l’empereur romain se retira sans passer une seule .nuit dans l’enceinte de Rome. L’éloquent Pétrarque[150], qui, entraîné par son imagination, voyait déjà recommencer la gloire du Capitole, déplore et accusé la fuite ignominieuse du prince bohémien ; et les auteurs contemporains, observent que la vente lucrative des privilèges et des titres fut le seul acte d’autorité que fit l’empereur dans son passage. L’or de l’Italie assura l’élection de son fils ; mais telle était la honteuse pauvreté de cet empereur romain, qu’un boucher l’arrêta dans les rues de Worms, et qu’on retint sa personne dans une hôtellerie pour caution ou pour otage, de ce qu’il avait dépensé. De cette scène d’humiliation portons nos regards sur l’apparente majesté que déploya Charles IV dans les diètes de l’empire. La bulle d’or, qui fixa la constitution germanique, est écrite du ton d’un souverain et d’un législateur. Cent princes se courbaient devant son trône, et relevaient leur propre dignité par les hommages volontaires qu’ils accordaient à leur chef ou à leur ministre. Les sept électeurs, ses grands officiers héréditaires, qui par leur rang eu leurs titres égalaient les rois, servaient au banquet impérial. Les archevêques de Mayence, de Trèves et de Cologne, archichanceliers perpétuels de l’Allemagne, de l’Italie et de la contrée d’Arles, portaient en grand appareil les sceaux du triple royaume. Le grand maréchal, à cheval pour marque de ses fonctions, tenait entre ses mains un boisseau d’argent rempli de grains d’avoine qu’il versait par terre, et aussitôt après il descendait de cheval pour régler l’ordre des convives. Le grand intendant, le comte palatin du Rhin, apportait les plats sur la table. Après le repas, le grand chambellan, le margrave de Brandebourg, se présentait avec l’aiguière et un bassin d’or, et donnait à laver. Le roi de Bohême était représenté, en qualité de grand échanson, par le frère de l’empereur, le duc de Luxembourg et de Brabant ; et la cérémonie était terminée par les grands officiers de la chasse qui, avec un grand bruit de cors et de chiens, introduisaient un cerf et un sanglier[151]. La suprématie de l’empereur ne se bornait pas à l’Aller magne ; les monarques héréditaires des autres contrées de l’Europe avouaient la prééminence de son rang et de sa dignité : il était le premier des princes chrétiens et le chef temporel de la grande république d’Occident[152] : il prenait des longtemps, le titre de majesté, et il disputait au pape le droit éminent de créer des rois et d’assembler des conciles. L’oracle de la loi civile, le savant Barthole, recevait une pension de Charles IV et son école retentissait de cette maxime que l’empereur romain étain le légitime souverain de la terre, depuis les lieux où se lève le soleil jusqu’aux lieux où il se couche. L’opinion opposée fut condamnée non pas comme une erreur, mais comme une hérésie, d’après ces paroles de l’Évangile : Et un décret de César Auguste déclara que tout le monde devait payer l’impôt[153]. Si, à travers l’espace des temps et des lieux, nous rapprochons Auguste de Charles, les deux Césars nous offriront un contraste bien frappant. Le dernier cachait sa faiblesse sous le masque de l’ostentation, et le premier dégoisait sa force sous l’apparence de la modestie. Auguste, à la tête de ses légions victorieuses, donnant des lois sûr la terre et sur la nier, depuis le Nil et l’Euphrate jusqu’à l’Océan Atlantique, se disait le serviteur de l’État et l’égal de ses concitoyens. Le vainqueur de Rome et des provinces se soumettait aux formes attachées aux fonctions légales et populaires de censeur, de consul et de tribun. Sa volonté faisait la loi du monde ; mais pour publier cette loi, il empruntait la voix du sénat et du peuple : c’était d’eux que leur maître recevait le renouvellement des pouvoirs temporaires qu’il en avait reçus pour administrer la république. Dans ses vêtements, dans l’intérieur de sa maison domestique[154], dans ses titres, dans tolites les fonctions de la vie sociale, Auguste conserva les manières d’un simple particulier, et ses adroits flatteurs respectèrent le secret de sa monarchie absolue et perpétuelle. |