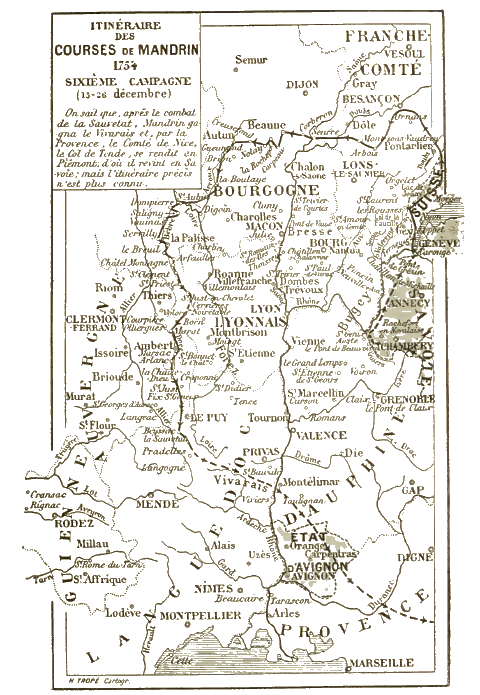MANDRIN, CAPITAINE GÉNÉRAL DES CONTREBANDIERS DE FRANCE
TROISIÈME PARTIE. — LA CARRIÈRE DE MANDRIN
XXII. — SIXIÈME CAMPAGNE[1] (15 décembre-26 décembre 1754).
|
Mandrin pénètre en France par la vallée de Joux. — Engagement avec les cavaliers d'Harcourt à Mont-sous-Vaudrey. — L'entreposeur de Seurre en Bourgogne : Mandrin lui confie ses marchandises. — La prise de Beaune et celle d'Autun. — Combats de Gueunand et de la Sauvetat. — Les Mandrins se dispersent. — Leur chef revient en Savoir par le Vivarais, la Provence et le Piémont. Mandrin pénètre en Franche-Comté dans la nuit du 14 au 15 décembre, en contournant les Rousses, où les brigades de gapians semblent dormir sous la neige. Par un brusque crochet vers le Nord, il s'engage dans la vallée de Joux. Il va avec ses hommes à toute vitesse. L'aurore s'est levée très pâle : des tons de cuivre clair sur la blancheur de la nature ; car la neige est tombée toute la nuit. Les chevaux y enfoncent jusqu'aux jarrets ; mais ils sont frais et dispos, et, pressés par leurs cavaliers, ils avancent rapidement. La neige est si blanche, qu'elle noircit par contraste le ciel, les lacs, l'Orbe aux eaux d'un bleu saphir, et les rochers à pic, tous les coins où elle n'a pu s'étaler. Les margandiers vont vite : déjà ils sont devant Pontarlier. La ville développe sur une seule ligne ses maisons sombres aux toits aigus. Ils la laissent sur leur gauche. La campagne est mie et s'incline doucement dans la direction du Nord, vers Besançon. Après avoir franchi un petit affluent du Doubs, le Drugeon, la file des chevaux, en une longue caravane, s'enfonce dans les forêts, où des touffes très denses de lieux font éclater leur feuillage taché de sang parmi les branches dépouillées des grands hêtres. Les taillis de chênes semblent en métal mat, en bronze clair ou en cuivre. On descend toujours, la neige est moins épaisse : c'est la fin des plateaux. Les Mandrins s'engagent dans les gorges de la Loue. La route, taillée dans le roc, tourne en lacets. Les rochers, aux teintes chaudes, dressent des hémicycles de murailles au sommet desquelles brille la neige. A leurs pieds la Loue se brise en écume. A partir de Mouthier-Haute-Pierre, la Loue est devenue calme. Elle coule sur du cailloutis blanc, avec un joli murmure. Un soleil pâle : c'est un rond de papier jaune collé sur une tenture de ciel gris clair, un soleil de décembre qui éclaire d'une frêle lumière la marche rapide des contrebandiers. Ornans se montre à leurs yeux du fond de sa vallée plantée d'érables. Le 15 décembre au soir, les Mandrins couchent à trois lieues de Besançon. Il fait un froid de loup. Une fois de plus, par la hardiesse et par la rapidité de ses mouvements, le jeune contrebandier a surpris et dérouté tout le monde. Le duc de Randan, lieutenant-général en Franche-Comté, en écrit à son collègue de Bourgogne, le comte de Tavanes : Les contrebandiers n'ont point passé aux Rousses ; mais leur entreprise n'en est pas moins surprenante. Ils ont fait un crochet pour éviter les postes, ont percé dans un endroit, où, faute de troupes, il n'y a point de chaîne, et, ce qui est incroyable, ils sont arrivés jusqu'aux portes de Besançon, sans que le directeur des Fermes ait eu un seul avis. En un mot, ils ont couché hier à trois lieues de cette ville, et je l'ai su par hasard[2]. Le ministre de la guerre, en réponse à la lettre du duc, ne peut s'empêcher de se laisser aller à sa mauvaise humeur. On a été trompé par un espion des Fermes et l'on a eu tort de se fier à cet imbécile — quelle expression sous la plume de M. le comte d'Argenson ! — au lieu de suivre les avis du baron d'Espagnac, annonçant que les contrebandiers remonteraient par les montagnes des Rousses, pour se faire un passage au-dessus de la ligne des postes établis à Saint-Claude[3]. Sans perdre une heure, le duc de Randan mit à la poursuite de nos compagnons 150 dragons de Beaufremont, 120 cavaliers d'Harcourt, 50 cavaliers de Fumel, 60 cavaliers de Moutiers, 100 carabiniers et deux compagnies de grenadiers de Courtes. Les bandits, disait-il, seront enveloppés. Le commandement supérieur de ces troupes fut attribué au marquis d'Espinchal. De son côté, M. de Rochebaron, gouverneur de Lyon, mobilisait un détachement des volontaires de Flandre et un corps de dragons établi à Saint-Etienne ; en outre, il donnait ordre à Fischer, cantonné à Pont-de-Vaux, de se lancer avec ses chasseurs dans une poursuite sans relâche, jusqu'à ce qu'il eût atteint et exterminé le dernier des Mandrins. Enfin, du Sud partait un fort détachement de volontaires de Flandre, sous le commandement d'un officier basque, le capitaine Pierre Diturbide-Larre, pour prendre les margandiers à revers. De Besançon, faisant un détour vers le Sud, par Arbois, Mandrin arriva avec sa troupe, dans la soirée du 16, à Mont-sous-Vaudrey, à quatre lieues de Dole, où les compagnons s'arrêtèrent pour se rafraîchir à la porte d'un cabaret. Passent les cavaliers d'Harcourt. Ils ont mis l'épée au clair, les Mandrins ont pris leur carabine. Une première décharge met à terre l'un des hommes du roi, en blesse deux autres et les cavaliers d'Harcourt de prendre la fuite, en abandonnant le corps de leur camarade, que les contrebandiers dépouillent de ses armes, de son habit, de son chapeau et de son manteau[4]. Jusqu'à ce jour Mandrin avait évité de s'attaquer aux soldats du roi, pour ne s'en prendre qu'aux gapians, c'est-à-dire aux gens de la Ferme ; mais du moment où l'armée réglée était mobilisée contre lui, force lui était, pour se défendre, de se tourner aussi contre elle. Les Mandrins entrèrent à Seurre sur la Saône, petite ville du duché de Bourgogne, le 17 décembre,
vers les cinq heures du soir. Ils étaient cent hommes bien montés. Chacun
d'eux avait son fusil à deux coups, deux pistolets à la ceinture et un autre dans l'aile du chapeau[5]. Mandrin commença
par faire publier une proclamation aux habitants pour leur dire de ne point interrompre leurs travaux. Loin que le peuple fût l'objet de ses expéditions, il
prenait ses intérêts. Aussi bien, bourgeois et artisans, en gens raisonnables, pour reprendre l'expression
de M. le procureur au parquet de Roanne, n'eurent garde de se mêler de ce qui
ne les regardait pas. Suivant son habitude, Mandrin commença par se rendre
chez l'entreposeur des tabacs. Il tira de lui 2.000 livres en échange de
quelques bennes et d'un reçu signé le capitaine
Mandrin. Cet entreposeur avait l'air d'un brave homme. On a vu précédemment comment Mandrin, pour répondre aux fermiers généraux, qui faisaient interdire au public de lui acheter ses marchandises prohibées, les avait obligés eux-mêmes, eux, les fermiers généraux, par l'intermédiaire de leurs entreposeurs et de leurs buralistes, à se faire st,s principaux clients ; — le voici, avec ses compagnons, marchands à cheval qui trament derrière eux une quantité énorme de tabac et d'étoffes, poursuivis bride abattue par les cavaliers du roi. A cette situation nouvelle, Mandrin fait tout aussitôt face par une combinaison nouvelle de sou esprit hardi et ingénieux. De même qu'il avait récemment mis en dépôt ses fusils chez les gendarmes de Rodez, pourquoi ne mettrait-il pas en dépôt ses marchandises de contrebande dans les magasins mêmes des fermiers généraux ? L'entreposeur de Seurre lui inspire confiance : il va donc abandonner à sa garde toute sa contrebande, 146 ballots. L'allure de sa troupe, traquée par les royaux, en sera allégée, et, dans les villes où il passera, au lieu de livrer directement ses marchandises aux représentants de la Ferme, il leur donnera désormais, en échange de leur argent, des bons à valoir sur le tabac et sur les étoffes laissés entre les mains de l'entreposeur de Seurre[6]. Puis les contrebandiers se rendirent chez le contrôleur, M. Raudas, par équivoque, comptant qu'il était le receveur du grenier à sel. Mais ils ne me trouvèrent pas, écrit le contrôleur lui-même. Je fus averti de leur arrivée et je m'en fus tout de suite prendre de l'argent que j'avais en caisse et le portai chez un ami. De là, ils furent chez le receveur du grenier à sel. Celui-ci avait fermé sa porte, mais les Mandrins l'enfoncèrent et entrèrent en tumulte. Ils réclamaient 100.000 livres. Le receveur en offrit 1.000. J'ai envoyé le restant de mon argent à Chalon. — J. F..., voilà un cheval tout sellé. Tu n'as qu'à mettre tes bottes, nous t'emmènerons avec nous ! Le receveur expliqua qu'il avait un ami en ville qui pourrait lui prêter 3.000 livres, lesquelles, avec les 1.000 livres qu'il possédait, feraient une somme de 4.000. Mandrin était pressé : dragons et fusiliers étaient à ses trousses ; il transigea. Après avoir pris possession de ces quatre mille livres, en échange de plusieurs ballots de marchandises et d'un nouveau reçu signé le capitaine Mandrin, on crut devoir rendre visite au capitaine général des Fermes. Celui-ci, il ne s'agissait de rien moins que de le tuer. Fort heureusement, demeura-t-il invisible. Ils enfoncèrent armoires, bahuts, commodes, cabinets ; ils lui volèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Enfin, la visite obligée à la prison. Le geôlier est contraint de faire comparaître les détenus devant Mandrin, l'un après l'autre : Pourquoi es-tu en prison ? — Monsieur pour sel. — Sors. Et toi ? — Monsieur, pour dettes. — Sors ![7] Tous les prisonniers furent ainsi élargis, en sorte que la prison est demeurée vide. Les Mandrins quittèrent Seurre entre minuit et une heure. Après leur départ, on y forma une compagnie de jeunes gens qui furent exercés par un capitaine dans Fischer : braves volontaires qui se promettaient, le cas échéant, d'accueillir à coups de fusils le retour des contrebandiers[8]. Ceux-ci furent coucher à Corberon, où ils passèrent la nuit du 17 au 18 décembre. Ils marchaient sur Beaune[9]. Les Beaunois avaient beaucoup ri de la peur manifestée par M. de Tavanes, gouverneur de Bourgogne, quand il leur avait fait passer l'avis de se tenir sur leurs gardes contre une attaque possible des margandiers. Ils regardaient la crainte de M. de Tavanes comme une frayeur panique, ne pouvant pas s'imaginer qu'une poignée de contrebandiers pût faire contribuer des villes[10]. L'alarme fut donnée à Beaune par des bonnes femmes de Corberon venues au marché. Beaune avait des fortifications imposantes, dans le grand style du XVIIe siècle. Conseil de ville se réunit d'urgence sous la présidence du maire. Il fut décidé que l'on fermerait les portes en ne tenant que le guichet ouvert, que l'on garnirait les remparts de milices et que les Beaunois étonneraient la France par l'énergie de leur résistance. Le 18 décembre, entre onze heures et midi, par le chemin de Corberon, les Mandrins arrivent, sur la route durcie par la gelée, au galop sonore de leurs chevaux. Déjà ils aperçoivent la ville, entourée de son croissant de collines, blanches de neige sous le ciel bas. On a déjà comparé l'organisation des contrebandiers à celle des flibustiers français d'Amérique. Ici encore on doit mettre en parallèle la manière dont quelques douzaines de Mandrins se rendent maîtres de villes fortifiées, et celle dont une quarantaine de Frères de la Côte, entassés dans une barque non pontée, s'emparaient des grands galions d'Espagne. Les Mandrins approchent des faubourgs de Beaune qui sont fermés par des barrières. Derrière les faubourgs, la ville close d'un rempart de grosses pierres, avec des tours d'angle, et, aux saillies, des échauguettes en encorbellement. Au pied des murs, un large fossé, où, dans le terrain humide, ont été plantés des saules qui ont grandi rapidement. De leur ramure touffue, ils entourent la cité d'une large couronne vert pâle[11]. Et quand le vent en renverse les feuilles c'est, tout autour des remparts, une couronne argentée. On accède aux portes d'entrée par des ponts dormants. Au faubourg de la Madelaine, la garde de la barrière avait été confiée à l'adjoint Terrant, homme d'esprit qui s'était beaucoup amusé, non seulement de la frayeur panique de M. le gouverneur de Bourgogne, mais aussi de la terreur des bonnes femmes de Corberon accourues pour raconter, dans un état d'agitation extraordinaire, la couchée des bandits. A la barrière de la Madelaine, il rangea ses hommes d'une manière symétrique, un groupe à droite, un autre à gauche, d'autres en arrière, bien au milieu ; le restant au troisième plan, sur deux rangs ; puis, après avoir vérifié les alignements, sans prendre d'ailleurs le soin de fermer la barrière, il s'occupa à déjeuner dans une maison du faubourg avec ses amis, qui avaient été auprès de lui rire de la peur qu'on avait des Mandrins[12]. Les convives se sont levés. Du haut du beffroi communal, le tocsin répand l'effroi. Les éclaireurs, que le maire a envoyés dans la direction de Seurre, sont revenus, hors d'haleine, pour dire que les brigands se trouvaient à Chalanges hameau de Beaune[13]. Des armes brillent au loin, sur la route. En hâte les
hommes que l'adjoint Terrant a placés en une si belle ordonnance abandonnent
la barrière qu'ils laissent ouverte. Ils ne songent qu'à se replier sur la
ville. L'homme le plus intrépide, écrit un
abbé qui se trouvait à Beaune[14], eût frémi, je ne dis pas de crainte, mais d'horreur en les
voyant arriver. Ils traversèrent le faubourg Madelaine à grande course de
cheval, fusils hauts et criant unanimement : Tue ! tue ! mettons le feu à la ville ! Le bon abbé note que le chevalier Mandrin rendit toute précaution inutile par son arrivée précipitée. Comme c'était jour de marché, il y avait beaucoup de voitures aux abords de la porte de la Madelaine, où les Mandrins se présentèrent. Le pont était encombré de charrettes entoilées. Les contrebandiers y arrivèrent pêle-mêle avec la garde montante de l'échevin Terrant. Celle-ci veut défendre l'accès du pont rempli de carrioles à limousine grise. Une fusillade s'engage. Pan ! pan ! pan ! Parmi les défenseurs de la place, le tailleur Sébastien Bonvoux et un nommé François, huissier, qui avait servi longtemps et qui poussait la porte de la ville pour la fermer — sont tués. Un soldat du régiment d'Auvergne, Jacques Gattand, en semestre chez son père, qui était marchand mercier, se montre au haut des remparts. Il tombe dans les fossés, frappé d'une balle. Le soldat avait été tué par Joseph Bertier[15]. Un autre bourgeois, un vitrier, nommé Manière, est grièvement blessé. Le reste se met en débandade. Les Beaunois avaient fini de rire. Ces contrebandiers avaient des fusils qui vous tuaient les gens, ce qui était une singulière plaisanterie. Tandis qu'une partie des Mandrins pénètrent dans la ville par la porte ouverte, leurs camarades grimpent quatre à quatre un escalier qui était à côté de la porte, appliqué au mur, jusqu'au haut du rempart[16]. Dans les rues de Beaune, les contrebandiers font éclater des salves de coups de fusil. Les habitants fuient sans distinction ; ils se terrent. Les Mandrins sont maîtres de la ville. Il est midi. Les Mandrins sont 66 ou 67 hommes. Ils ont des fusils à deux coups, des fusils à munition, des carabines et des biscaïens[17]. Ils sont jaunes et bronzés[18]. La plus grande partie, notent les chanoines du chapitre, étaient en habits de Savoyard. Ils ont bien l'air de bandits : paquets de haillons où brille l'acier des armes. Ils ont de petits chevaux vifs et nerveux, mais qui semblent harassés de fatigue. Au milieu d'eux, Mandrin, leur capitaine, est resplendissant, avec son habit gris à boutons jaunes, sa veste de panne rouge à carreaux, un mouchoir de soie autour du cou, et son grand chapeau de feutre noir, festonné d'or, à point d'Espagne, d'où s'échappent des cheveux en queue. A sa lare ceinture sont fixés un couteau de chasse et deux pistolets. Il tient en main son fusil à deux coups armé d'une baïonnette. Il avait le visage basanné et pipé, un peu gravé de petite vérole[19]. Les Mandrins se comportaient civilement clans les villes qu'ils occupaient et n'y rudoyaient que les gens de la Ferme ; mais ils n'admettaient pas qu'on leur fit l'injure de les recevoir au son du tocsin, avec des bourgeois en armes aux barrières et en leur fermant la porte au nez. Leur dignité voulait qu'ils fissent payer ces outrages[20]. La prudence leur commandait en outre, dans une ville qui paraissait hostile, de ne permettre à aucun habitant de demeurer dans la rue. Ils tiraient indistinctement sur quiconque montrait un coin de son visage, de manière à rendre les rues désertes et à faire clore les volets. Au reste, c'était invariablement leur tactique dans les localités où ils ne sentaient pas que l'opinion publique était pour eux. Mandrin était, comme de coutume, parfaitement instruit de tout ce qui concernait la localité. Il en avait donné la preuve en choisissant exactement pour l'attaque, le point faible des remparts. Il descendit au logis de la Petite Notre-Dame, faubourg de la Madelaine. C'était l'auberge la plus voisine de la ville, car il ne voulait pas pénétrer à l'intérieur des remparts, se sachant poursuivi par les soldats du roi. Il plaça des sentinelles à la porte du logis, et, après avoir mis ses pistolets sur le lit de la chambre où il s'installa, il commença à donner ses ordres. Il plaça des hommes à la tête du pont de la ville, d'autres à la porte et d'autres sur les remparts ; puis il fit entrer dans Beaune trente de ses compagnons, distribués en trois corps de dix hommes chacun, qui se suivaient à cent pas de distance. Les trente Mandrins longèrent Saint-Pierre et s'engagèrent dans la grand'rue. Tout passant ou tout curieux qui mettait le visage à la fenêtre recevait un coup de fusil. Ils arrivèrent ainsi au corps de garde, dont ils s'emparèrent. Quelques balles logées dans l'horloge communale firent cesser le tocsin. Ils donnèrent tant d'épouvante et causèrent tant d'alarme qu'on ne savait que devenir[21]. L'hôtel de ville, dont les Mandrins se rendirent maîtres, était une petite construction du XIVe siècle, la porte d'entrée à voussure en tiers-point, deux tourelles à toit pointu aux angles et, au fronton, entre les fenêtres garnies de barreaux de fer, les armes de la ville flanquées à droite et à gauche de deux porcs-épics en haut relief. Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, le restant des contrebandiers se rangèrent militairement. On ne voyait plus forme humaine dans les rues, où quelques chiens vaguaient à la recherche de leurs maîtres. Mandrin avait tout réglé d'une manière précise et ses ordres étaient exécutés ponctuellement. A la prison de la ville, quelques compagnons exigèrent du geôlier le livre d'écrou. Ils rendirent la liberté aux détenus pour contrebande ou pour dettes ; les autres prisonniers, incarcérés pour motif infamant, vol ou escroquerie, furent laissés sous les verrous. Cependant, au faubourg de la Madelaine, Mandrin déjeunait avec son état-major. Le prix du déjeuner monta à 52 écus. Il donna la pièce à la servante. Au logis de la Petite-Notre-Darne, pour reprendre l'expression dont se sert un des ecclésiastiques qui nous renseignent si précisément, Mandrin tenait sa Cour[22]. Il avait mandé devant lui le maire de Beaune, M. Pierre Gillet ; mais celui-ci avait jugé prudent de se cacher. Les Mandrins trouvèrent le précepteur de ses enfants, Claude Monnot, et le menacèrent d'un coup de pistolet s'il n'amenait pas le maire sur-le-champ. Et le maire de Beaune fut conduit entre deux Mandrins, comme un prisonnier de guerre, au logis de la Petite-Notre-Dame, dans le faubourg de la Madelaine. Chemin faisant, les compagnons rencontrèrent M. Courtot de Montbreuil, qui était habillé de bleu. Ils le prirent pour le colonel Fischer et l'obligèrent à venir avec eux[23]. Le maire de Beaune arrive au logis de la Petite-Notre-Dame.
Mandrin se lève pour le recevoir. Le bandit était très irrité. Ce chef de bande, dit un des spectateurs, était bien pris de son corps, résolu dans sa pose, bref de
la parole et du geste. Son visage, énergique dans l'expression, était moitié
hâlé, moitié terreux[24]. Mandrin annonça au maire de Beaune que, pour punir ses concitoyens de la manière dont ils s'avisaient d'accueillir les étrangers qui leur faisaient l'honneur de se présenter à leurs portes, il frappait la ville d'une contribution de 25.000 francs. Gillet se récria. Il avait une Lime de diplomate et aurait voulu entamer une négociation. Il cherchait à faire agréer des excuses : les Beaunois ne connaissaient pas Mandrin qui était venu un peu brusquement avec ses amis ; mais le contrebandier était pressé, il répliquait d'un ton vif et cassant : Vous n'avez pas 25.000 livres ? adressez-vous aux employés de la Ferme. — Emmenons le maire à défaut, insinuait Bertier d'un ton goguenard. — Tu entends, Gillet, les camarades veulent t'emmener ? appuyait Mandrin. Et comme le maire hésitait encore : Gillet, tu as entendu ? On se mit finalement d'accord à 20.000 livres. Suivant le conseil de Mandrin, le maire les envoya quérir chez M. de Saint-Félix, receveur du grenier à sel, et chez l'entreposeur des tabacs, M. Estienne. Tandis qu'on attendait que l'argent fût apporté, Mandrin se plaignit auprès de M. le maire de ce qu'on lui avait fait boire à son auberge un vin qui avait mal défendu la réputation des fameux crus de Beaune. J'en ai du bon dans ma cave, répondit M. Gillet, et je vous en offrirais de grand cœur, si nous étions chez moi. — Il faut l'aller chercher. Ce qu'on fit par douze bouteilles[25]. Le vin arriva promptement. Le maire dut vider son verre le premier, après avoir trinqué avec le bandit. Mandrin ne but d'ailleurs que très peu, crainte de se griser[26]. Apprenant que tout dans Beaune était tranquille, Mandrin dispersa ses hommes, à l'exception de sept ou huit sentinelles qui restèrent postées de distance en distance, l'œil au guet. Le restant des contrebandiers se répandirent dans les cabarets pour boire, ou chez les armuriers pour faire réparer fusils et pistolets. Au logis de la Petite-Notre-Dame, Mandrin, rassuré sur les dispositions des habitants, laissait entrer qui voulait le voir. C'était une cohue. Il n'avait gardé auprès de lui que quatre ou cinq de ses hommes, entre autres un contrebandier qu'on nommait le Brutal. Et tant de monde s'engouffra dans la chambre où il se trouvait que celle-ci en fut pleine comme un œuf[27]. Que si l'on eût voulu s'emparer de lui dans ce moment, notent les chanoines du chapitre, rien n'eût été plus aisé, car ils étaient serrés dans cette chambre au point que nul des contrebandiers n'eût pu faire usage de ses armes. Mais, ajoutent les chanoines, personne ne se souciait de tenter quelque chose en faveur des fermiers généraux. Cependant l'argent n'arrivait pas. Les receveurs des Fermes, qui n'avaient pas la somme chez eux, faisaient la quête en ville. De temps à autre, celui des Mandrins qu'on nommait le Brutal, sortait de la pièce, pour s'en aller dans la rue voir si rien ne venait, puis il rentrait pour répéter avec insistance que, décidément, il fallait partir en emmenant le maire comme otage. Gillet s'ingéniait à imaginer de bonnes paroles pour faire prendre patience. Mandrin lui, au moindre bruit, prêtait l'oreille, étant toujours en crainte des régiments mis à sa poursuite[28]. Enfin, sur les deux heures et demie, Estienne, entreposeur des tabacs, et Saint-Félix, receveur du grenier à sel, arrivèrent avec les 20.000 francs. Ils comptèrent au bandit '700 louis d'or de 24- livres, parmi lesquels il y avait six demi-louis ; le reste en trois sacs remplis d'argent blanc. M. David de Chevannes, qui avait accompagné M. le maire, crut le moment propice, tandis que l'on présentait cet argent au contrebandier, de hasarder une plaisanterie. Il avait entendu vanter les bonnes œuvres de Mandrin, qui prenait aux gros pour donner aux petits. Vous qui êtes si charitable, vous avez là des demi-louis pour faire vos aumônes. Mandrin ne répondait pas. N'est-ce pas vrai, répéta M. de Chevannes, d'un air plaisant, que vous avez bien là de quoi faire des aumônes ? — Ne me le répétez pas une troisième fois, dit Mandrin, en regardant M. de Chevannes avec des yeux foudroyants[29]. Celui-ci se tut ; il se retira modestement au second rang, et, sans qu'on prit garde à lui, il se retira. Comme le maire voulait faire compter et peser l'argent : Il n'est pas besoin, dit Mandrin, vous êtes d'honnêtes gens. Je m'en rapporte à votre droiture. Vous ne voudriez pas me tromper. Il mit une partie de l'or dans sa ceinture, le reste dans son gousset. Il confia les sacs d'écus à l'un de ses lieutenants. Puis, demandant du papier et une plume : Je dois vous faire une quittance. Les fermiers généraux ne tiendraient pas compte aux receveurs, si je ne donnais un reçu. Et, mettant un genou en terre, il écrivit le billet suivant : Je, soussigné, Louis Mandrin, reconnais avoir reçu de MM. de Saint-Félix et Estienne, entreposeurs des Fermes dans la ville de Beaune, la somme de vingt mille livres, dont MM. les fermiers généraux leur tiendront compte pour des ballots de tabac que j'ai déposés chez l'entreposeur de Seurre. A Beaune, 18 décembre 1754. Signé : Louis Mandrin[30]. Il donna en outre un bon sur les ballots de tabac qu'il avait laissés chez l'entreposeur. Cependant les contrebandiers, qui s'étaient répandus dans la ville, n'avaient pas laissé d'y commettre quelques excès. Une bonne vieille vint dire au capitaine que ses hommes lui avaient pillé des effets. Et Mandrin de lui remettre cent vingt livres, que la pauvre femme prit en lui baisant la main avec des larmes de reconnaissance[31]. L'horloger Midot, qui tenait un magasin de poudre à feu, se plaignit lui aussi, d'avoir été butiné. Mandrin le fit rentrer en possession de ce qu'on lui avait pris. Il fit payer largement tous les cabaretiers qui avaient traité sa troupe. A quatre heures moins le quart, le chef donna le signal du départ. Rendu à sa belle humeur par le vin de M. le Maire, Mandrin, en se mettant en selle, le salua de son chapeau, et ceux qui se tenaient auprès de lui : Messieurs, à vous revoir au Carnaval ![32] La troupe des margandiers se rangea militairement, et, longeant les fossés, elle quitta la ville en passant par le faubourg et par la porte Bretonnière. Elle prit la route de Chagny. L'ordre du départ fut exécuté si rapidement que l'un des contrebandiers en fut oublié dans la ville, où le lendemain il fut pris et mis en prison. Ce brave avait fait honneur, plus que de raison, au vin de Beaune. On l'avait trouvé, dormant sous une mangeoire à côté de son cheval et couché sur son fusil[33]. On imagine la stupeur que provoqua la prise, par soixante bandits, d'une ville de huit mille habitants, et qui s'était mise en défense. La gravure, la poésie s'emparèrent de cet exploit. Voici une image où l'on voit Mandrin armé d'un fusil à baïonnette, l'air triomphant sous son grand chapeau de feutre rabattu par devant. A droite, le maire de Beaune s'incline humblement, tenant en main le reçu de 20.000 livres. Au bas de l'estampe on lit : Réfractaire de l'Etat, toujours fier et tranquille, Suivi partout de ses brigands, A Beaune, il sut forcer le maire de la ville, A lui verser vingt mille francs. Ces vers manquent évidemment d'envolée poétique ; mais ils disent bien ce qu'ils veulent dire. D'autre part, le fameux Piron, fin et caustique et
Bourguignon, et qui rappelle souvent dans ses œuvres le surnom peu flatteur
dont les Beaunois étaient désignés en Bourgogne, les
ânes de Beaune, rima les petits vers suivant où
se retrouve bien sa manière : Quand Mandrin Un matin Vint à Beaune, Vous eussiez vu du Beaunois L'oreille à cette fois S'allonger de plus d'une aune. Par le Stix, Saint-Félix Dit sans cesse Que, dans les besoins pressants, Il n'avait vingt mille francs, En caisse. Cependant Mandrin le somme De lui compter cette somme. Aussitôt Le gros sot Fait la quête. La ville se cotisant, La somme se trouvant Toute prêle. C'est bien fait : Le beau trait De prudence ! Contre le meunier enfin De l'âne un peu mutin. Qu'eût servi la défense ? Par argent, S'en tirant A merveille, Beaune se tira d'embarras, On ne lui tira pas L'oreille ! Deux jours après le départ de Mandrin, c'est-à-dire le vendredi 20 décembre, le guetteur, en faction vigilante sur le haut de la tour où sonnait l'horloge communale, signala des cavaliers sur la route d'Autun. Il était onze heures du matin. En trois minutes tout ce qui était sur la place, et dans le marché, fut enlevé, le prédicateur de l'Avent demeura seul dans l'Église, l'effroi était partout[34]. C'étaient les dragons du roi. Henri Clémence !, de qui la relation est utilisée par Pierre Joigneaux, rappelle —ainsi que le font les chanoines de Notre-Dame de Beaune, — les embarras des bourgeois après le départ des Mandrins. Les grands saules, plantés dans les fossés et qui nouaient autour de la ville une ceinture verdoyante, furent abattus en une nuit. Il était quatre heures du soir quand cet ordre fut donné : aussitôt les habitants du faubourg se mirent à couper les saules, et, le lendemain, au jour, il n'en resta pas un seul[35]. Les notables avaient pensé que ces arbres étaient de nature à favoriser un nouveau coup de main. On établit d'abord une garde à chaque porte de la ville. On fit venir un détachement de canonniers pour instrumenter les canons sur les différents bastions avec des fascines et des tonneaux pleins de terre. Il fut ordonné à tous les habitants de mettre des sacs à terre sur les fenêtres et d'avoir au moins dix coups de fusil à tirer. Il y eut des espions pour savoir ce que la troupe de Mandrin deviendrait. On ne faisait ni fêtes ni dimanches. On travaillait à élever des murs, à faire des redoutes, à rectifier des fossés[36]. De cette époque datent les lourdes grilles de fer qui défendent aujourd'hui encore, de bas en haut, les fenêtres des rez-de-chaussée, dans les vieilles rues de Beaune, et les portes massives. A la noblesse des provinces aurait dû revenir, conformément aux traditions sociales de l'ancienne France, le soin de défendre le pays. Ce rôle de défense et de protection à main armée était une des raisons de ses privilèges et les avait jadis justifiés. Rien ne montre mieux, que l'histoire des expéditions de Mandrin, à quel point la noblesse s'était déclassée sur la fin de l'ancien régime, et la nécessité des réformes que la Révolution va réaliser. A Beaune, un tailleur et un huissier tombent en défendant les remparts ; tandis que les nobles s'étaient retranchés dans leurs hôtels. La bourgeoisie caustique ne laissa pas d'en faire des chansons : Sur l'air : Quand un tendron... Tant que notre noblesse vit Les Mandrins par la ville, L'on prétend que la foire prit A ce corps inutile ; Mais à peine tous les brigands Battent-ils aux champs, qu'ils se montrent : Là ! là ! ho ! ho ! Sur l'air : Des vapeurs... Messieurs, le beau sexe sans doute Redoute Votre valeur ; Il craint que votre compagnie N'essuie Quelque malheur. J'entends Climéne qui soupire Pour son chevalier en danger : Amis, soutenez-moi, j'expire ; J'ai des vapeurs ![37] Mandrin s'était fait précéder d'une avant-garde. La troupe prit la route de Chalon par Chagny. Sur la gauche, la plaine s'étendait toute plate, comme infinie, blanche de neige ; mais sur la droite, ondulaient les collines précieuses où croissent les meilleurs vins : le clos Saint-Désiré, les Aigreaux, les Grèves, le Clos du Roi, les Blanches-Fleurs, Aloys-Corton. Au pied des collines, ou bien y grimpant à mi-côte, ces villages aux noms fameux, Pommard, Volnay, Meursault. Peu avant d'atteindre Chagny, c'est-à-dire au village de Corpeau, les Mandrins changèrent de direction pour égarer la poursuite. Corpeau est un type de village bourguignon, à toitures en tuiles brunies, sur un mamelon que revêtent les clos de vigne entourés de murailles basses en pierres libres. Mandrin tourna brusquement sur sa droite, à angle aigu, descendant vers les prairies humides, où de minces filets d'eau sont jalonnés de saules argentins et de longs peupliers. A la sortie du village, un grand puits à margelle grise, fendue par le temps, où pend un seau de fer à la poulie rouge de rouille. Les contrebandiers arrivèrent sur le soir à La Rochepot dans un bas-fond entre de hautes collines couvertes de chênes. Un château de l'ancien temps, d'aspect féodal, domine le paysage de ses rondes tours hautes, aux toitures aiguës, qui encadrent, sur le fond du ciel, la flèche de la chapelle gothique. Le village est comme un nid, que l'oiseau aurait caché dans un trou de verdure. Les Mandrins rôdèrent autour du lieu à l'entour de la nuit[38]. Ils trouvèrent un pauvre homme qui avait tué un cochon. Ils le lui achetèrent et, le faisant rôtir sur place, ils en firent leur souper[39]. Les contrebandiers passèrent à La Rochepot la nuit du 18 au 10 décembre. Ils en repartirent le matin à l'aube. Le contrôleur de Nolay s'attendait à ce qu'ils tombassent chez lui, n'y ayant pas d'autre bureau dans la ville. Mais ils passèrent dans la ville, comme un foudre, à huit heures et demie du matin, sans s'arrêter[40]. Fischer, qui avait quitté Besançon avec ses chasseurs, le mardi, 16 décembre, sur les huit heures du matin[41], était arrivé à Beaune sur les minuit, c'est-à-dire huit heures après le départ des contrebandiers. Il fit sonner la trompette dan toutes les rues de Beaune et publier de recevoir et loger ses soldats et repartit le lendemain, dès avant le jour[42]. Il n'avait plus que deux heures et demie de retard sur les contrebandiers, qu'il allait détruire, disait-il, à la première rencontre. Arrivés à la Croix des Châtaigniers, les Mandrins virent à leurs pieds la plaine d'Autun. Le marquis de Ganay, colonel d'infanterie et gouverneur d'Autun, se donnait depuis deux mois un mouvement infini pour mettre la ville en état de repousser les Mandrins. Au reste, il avait, dès le premier jour, déployé de ce chef un zèle extrême. Le ministre de la guerre était accablé par lui de mémoires dont chacun contenait des moyens infaillibles pour exterminer les contrebandiers. La milice bourgeoise reçut l'ordre d'astiquer ses armes et le gouverneur annonça qu'il en ferait lui-même l'inspection[43]. Trois des portes de la ville, la porte Saint-Pancrace, la porte Cocand, la porte de Breuil, furent condamnées à demeurer fermées, par de lourdes barres de fer, nuit et jour ; quatre portes étaient laissées ouvertes, mais sous la garde permanente d'un planton de milice bourgeoise. Et, à son entrée dans la ville, tout étranger devait être arrêté, visité, fouillé, interrogé ; les aubergistes devaient fournir un état quotidien de leurs hôtes nouveaux ; les villages voisins étaient sommés d'envoyer des courriers à l'apparition de la moindre troupe armée ; et les sentinelles en faction aux portes d'Autun devaient les faire clore dès qu'un groupe de plus de trois hommes serait signalé à l'horizon. Trois hommes ! On revenait au temps, que chantera Victor Hugo, où le jeune Aimeri prenait à lui tout seul Narbonne. Le 18 décembre, les gardes postés aux entrées de la ville laissèrent passer sans défiance, trois pieux ermites, de qui le caractère suspect n'apparut qu'un peu plus tard[44]. Le maire de Beaune s'était empressé de mander à M. Roux, maire d'Autun, les événements du 18 décembre. Ce dernier fit aussitôt fermer les portes de la ville, et donna ordre à M. de Montaigu, qui commandait la milice bourgeoise, de rassembler ses troupes et de se préparer à une vigoureuse résistance. Cette milice comptait six cents hommes auxquels devaient s'ajouter les effectifs fournis par la maréchaussée et par la belle compagnie des chevaliers de l'Arquebuse, que commandait M. de Saint-Aubin. L'artillerie municipale pouvait mettre en ligne six canons de fer, deux couleuvrines de fonte, une couleuvrine de bronze et sept bottes ou pétards. Et l'enceinte de la ville était d'un aspect imposant : des murs énormes, massifs, d'une admirable profondeur, qui pouvaient défier les efforts de l'artillerie. Mandrin venait de quitter Creuzefond et il approchait de l'antique capitale des Éduens, quand il aperçut, longeant les rives de l'Arroux, que jalonnaient des aunes dénudés, une longue file de personnages, une quarantaine environ, tout de noir habillés. La plaine était couverte d'un épais tapis de neige, où étaient semés des vols de corbeaux. De temps à autre l'un d'eux s'élevait à quelques mètres du sol, battait des ailes, puis il planait dans l'air, où il décrivait des courbes légères, et retombait sur un autre point. Et le long du ruban gris de fer, dont la rivière coupait la blancheur de la campagne, les personnages noirs, qui marchaient sur deux rangs, l'un derrière l'autre, semblaient à leur tour égrener un chapelet de grands corbeaux. Sur le fond clair du ciel et de la plaine les aunes entremêlaient leurs branches dans les brumes traversées de reflets bleu pâle, dans les brumes de décembre qui estompaient le tableau. Au premier moment, Mandrin crut à une attaque, car ces hommes venaient à lui. Singulier uniforme, à vrai dire, et singulier ordre de bataille. Cependant, par prudence, il fit ranger ses contrebandiers. La troupe approcha : c'étaient de jeunes séminaristes, au nombre de trente-sept exactement, pour la plupart des fils de familles bourgeoises, parmi les meilleures de la ville d'Autun, qui, en l'absence de leur évêque, se rendaient à Chalon pour y recevoir les ordres[45]. La pieuse théorie était conduite par le supérieur du séminaire, l'abbé Hamard. Mandrin l'aborda et, après s'être fait connaître, il lui expliqua que lui et ses jeunes élèves avaient mieux à faire qu'à se fatiguer en se rendant jusqu'à anion. Ils allaient lui servir d'otages. Et il emmena les jeunes ouailles de noir vêtues jusqu'au faubourg Saint-Jean, où il les consigna dans le couvent des vénérables daines bénédictines de Saint-Jean-le-Grand. Il établit lui-même son état-major dans une maison située à l'entrée du parc, près de l'église. Après avoir rangé ses hommes dans la cour du couvent, il dépêcha des parlementaires aux Autunois, pour les prier de lui ouvrir leurs portes et de lui verser vingt-cinq mille livres, afin de ne pas le mettre dans l'obligation d'incendier les faubourgs et de massacrer les séminaristes. Il était une heure de l'après-midi. M. de Montaigu, major de la milice bourgeoise, fut chargé par les Autunois de la négociation. Il trouva les Mandrins dans le couvent Saint-Jean, occupés à faire des préparatifs de cordes, d'échelles et de claies pour escalader les murs. Par son air résolu, le jeune chef fit une grande impression sur M. de Montaigu qui revint très ému. La ville capitula. Les milices bourgeoises et tous les postes placés aux portes de la ville mirent bas les armes[46]. Par la porte des Marchaux, que le maire fit ouvrir, Mandrin entra seul, sans autre escorte que deux de ses hommes. Il avait l'air bon enfant et martial : il portait toujours son habit de drap gris avec la veste de panne rouge à petits carreaux ; une cravate de soie rouge, son grand chapeau de feutre noir bordé d'or, l'aile de devant rabattue sur les yeux et celle de derrière retroussée au-dessus de la nuque. Il tenait à la main un fusil à deux coups armé d'une baïonnette. Les deux hommes qui l'accompagnaient étaient en haillons, mais ils avaient de grands manteaux de gros drap bleu, à parements et doublure écarlates. Mandrin imposait par sa résolution et par son prestige, et aussi parce que les Autunois savaient qu'à la moindre manifestation hostile les 37 séminaristes, gardés chez les Bénédictines, devaient être immédiatement égorgés. Mandrin avait emmené avec lui dans la ville l'abbé Harvard, entre ses deux ordonnances[47]. Les représentants des Fermes, qui savaient les troupes du roi à la poursuite des contrebandiers, cherchaient à traîner les négociations en longueur[48]. Mandrin les pressait. Enfin il transigea pour une somme de neuf mille livres, qui lui fut comptée, moitié par M. Duchemain, entreposeur des tabacs, moitié par M. Pasquier, receveur du grenier à sel, et pour laquelle il donna des reçus et des bons sur les marchandises laissées au bureau de Seurre. Tout se fit d'ailleurs avec bonne grâce comme à Beaune, et Mandrin ne crut pas devoir refuser la prise de tabac que M. Duchemain eut l'honnêteté de lui offrir. Comme celui-ci lui demandait de quel droit il levait ainsi des contributions sur les Fermes : Du droit, répondit Mandrin, qu'Alexandre avait sur les Perses, et César sur les Gaules. A la prison, six détenus furent élargis, par notre jeune conquérant qui s'y présenta sans autre escorte que ses deux camarades : c'étaient trois marchands, deux laboureurs et un menuisier. Un septième prisonnier, nommé Carion de la Barre, refusa la grâce que voulait lui faire son magnanime libérateur[49]. Mandrin eut encore le temps d'enrôler à Autun sept colporteurs. Le voyant marcher seul dans la ville, suivi de ses deux gardes du corps, les gens se présentaient à lui comme à un souverain. Et l'on vit des bourgeois venir lui offrir spontanément leurs services comme correspondants et entreposeurs pour l'écoulement de ses marchandises. L'entreprise se développait, comme on voit, et s'affermissait. Les Mandrins quittèrent Autun à six heures du soir. A peine furent-ils partis que le propriétaire de la maison où leur chef était descendu, au faubourg Saint-Jean, le rejoignit au galop de son cheval. Il avait tenu à lui rapporter lui-même une épée que l'un de ses hommes avait oubliée dans une mangeoire. Les contrebandiers s'engagèrent au flanc des montagnes qui dominent la plaine ou coule l'Arroux, une route étroite, bordée de groupes touffus de chênes et d'acacias, le bois de Reunchy. Les chênes avaient conservé leurs feuilles brunies, durcies et recroquevillées par l'hiver, bourrées de flocons de neige blanche dans leurs menus replis. Deux heures après le départ de Mandrin, Fischer arrivait. Il avait été obligé de laisser à Beaune un détachement d'infanterie, si fatigué qu'il n'avait pu le suivre. En chemin, il avait rencontré les séminaristes, auxquels Mandrin avait rendu la liberté et qui s'étaient remis en route vers Chalon. La peur les tenait encore saisis[50]. Fischer arriva à Autun, avec ses chasseurs, à onze heures de la nuit. Il avait gagné trois heures sur les bandits. Un cavalier de la maréchaussée vint annoncer que ceux-ci étaient campés à une lieue et demie, aux environs d'un village nommé Brion[51]. Dès le lendemain, vendredi 20 décembre 1754, à quatre heures du matin, comme il faisait encore nuit noire, Fischer se mit en route avec sa petite armée. On se hâte. Les chevaux sont pressés à coups de canne et d'éperon ; mais à Brion on ne trouve pas l'ombre d'un brigand. Personne dans le pays ne consentait à servir de guide contre Mandrin. Fischer en était réduit à suivre la trace laissée par les chevaux des contrebandiers sur la route trempée de neige, qu'il faisait éclairer avec des brandons. Cette trace, écrit l'officier, me mena d'abord sur le chemin de Montigny, et ensuite me jeta, par la traverse, dans des bois presque inaccessibles, d'où j'arrivai à une montagne, sur la croupe de laquelle est situé le village de Gueunand[52]. Gueunand — se prononçait Gunan — s'élève à mi-côte d'une montagne couverte d'une épaisse forêt de chênes, mêlés de hêtres, et dont la crête arrondie trempe dans les nuages par les temps couverts. C'est le mont de Gueunand. A ses pieds s'étend la plaine où l'Arroux trace son cours sinueux. Les prés disparaissaient sous la neige. De-ci, de-là, des touffes d'arbres, des haies qui séparent les finages et donnent à la campagne un air de jardin à la française ; des bouquets de saules gris aux bords des ruisseaux étroits ; et, par endroits, ce sont comme des pans de murs hauts et raides, formés par les lignes de peupliers. A droite, au premier plan, sur une motte, le château du Pignon-Blanc, façade carrée, presque lumineuse sur les masses sombres, dont l'entoure, en forme de croissant, une hêtraie effeuillée. Et plus loin, se tirant hors du grand drap blanc dont l'hiver a couvert la plaine, l'admirable panorama que dessinent les contreforts du Morvan, d'un bleu pile, de plus en plus pâle à mesure que les plans s'éloignent, d'un bleu clair et léger — à l'horizon ce n'est plus que do l'atmosphère durcie, — où se dresse la pointe aigue du Bouvray. En approchant de Gueunand, Fischer vit une trentaine de contrebandiers A cheval qui vaguaient. Mandrin était rejoint. On l'aperçut sans veste, qui sortait de la maison d'un certain Moley, où il avait passé la nuit. Sur-le-champ, l'officier disposa ses hommes pour l'attaque. Celle ci présentait de grandes difficultés. Les Mandrins occupaient les maisons du village, et le lieu avait été habilement choisi pour nue défense avinée. La droite en était inabordable, protégée qu'elle était par un bastion que fournissait la nature, un mamelon gazonné. Fischer, qui le vit couvert de neige, écrit que c'est un rocher. La gauche, où s'étalaient les maisons, était coupée de courtils clos de palissades. Celles ci étaient formées par des pieux plantés à la distance respective d'une aune ut dont la remplissure était faite de bois d'épine. Puis des vergers, où croissaient des poiriers, des châtaigniers, des noyers séculaires, entourés de haies d'épine et de mûriers, et des chemins creux bordés de buissons. Enfin chaque maison, basse, aux murs épais, sans autre ouverture qu'une porte étroite flanquée d'une unique fenêtre, était d'une facile défense. Sur le derrière, des halles, où les contrebandiers avaient attaché leurs chevaux à la longe. Pour entrer dans le village, une seule route, dont nos compagnons étaient les maîtres. Mandrin l'avait rapidement hérissée de barricades, formées de chariots et de charrettes entremêlés de brassées de branches d'épine, et il y avait mis sur affût quatre pièces de campagne A la biscaïenne. Fischer avait sous ses ordres, outre ses chasseurs, quarante dragons du régiment de Beaufremont, deux compagnies de grenadiers suisses du régiment de Courten et des cavaliers de la maréchaussée commandés par le lieutenant Balot. Il mit ses propres troupes, pour une grande partie des Allemands et des Suisses, sur le devant, pour qu'il ne fût pas dit que, pour acquérir de la gloire, il avait sacrifié des sujets nationaux[53]. Fischer commença par envoyer ses chasseurs soutenus par les dragons de Beaufremont, pour couper la retraite aux contrebandiers, mais déjà Mandrin, avec une hardiesse inouïe, avait commencé l'attaque. Telle a toujours été sa conduite, du feu dans l'imagination, de la célérité dans l'exécution[54]. Jamais sa valeur guerrière ne parut avec plus d'éclat que dans cette affaire de Gueunand. Il avait immédiatement reconnu l'impossibilité de triompher de ces troupes nombreuses, disposant des meilleures armes, commandées par un chef expérimenté. Il n'avait avec lui que quatre-vingt-dix hommes, parmi lesquels il en choisit dix-huit, des plus résolus. A la tête de cette poignée de braves, il tint tête aux soldats de Fischer, tandis que les autres battaient en retraite, à travers les vignes, les halliers et les chemins creux. Dans le débraillé de la surprise matinale, sans chapeaux ni vestes, en bras de chemises, tout en se retirant, ils ne cessaient de faire feu sur leurs adversaires, pareils à des sangliers furieux qui font respecter leurs défenses aux chasseurs dont ils sont poursuivis[55]. Du haut des maisons qu'ils occupaient et où ils avaient pratiqué des canardières[56], les dix-huit compagnons, qui avaient assumé la tâche de couvrir la retraite de leurs camarades, faisaient pleuvoir des balles meurtrières sur les chasseurs de Fischer qui s'efforçaient de dissimuler, derrière les haies vives ou dans le creux des chemins, leurs pelisses rouges et les cocardes blanches de leurs bonnets. L'un des Mandrins, Antoine Chalcat, du lieu de Serre en Dauphiné, eut dans ce moment la main gauche emportée, son fusil lui avant éclaté entre les doigts[57]. Fischer sentait ses troupes fléchir. Enfin il parvint à mettre le feu dans une ferme où Mandrin avait posté neuf de ses compagnons. Dans la grange s'entassaient jusqu'au faite les bottes de foin sec. En quelques instants l'incendie fut effroyable : les nappes de flammes, battues par le vent, montaient dans les airs. Les neuf contrebandiers se laissèrent brûler vifs plutôt que de se rendre, fidèles à la consigne du chef, de tenir jusqu'au bout pour assurer la retraite du gros de la bande ; — et, de leurs mains calcinées, ils tiraient encore des coups de fusil. Fischer perdit sept grenadiers, cinq hussards, deux officiers et un maréchal des logis. Il eut cinquante-sept blessés[58]. Les contrebandiers perdirent leurs neuf compagnons brûlés ; cinq autres furent faits prisonniers, parmi lesquels il y en avait deux qui étaient blessés assez grièvement. On les transporta à Autun. J'ai vu les dragons de Beaufremont, écrit un témoin oculaire, rentrer dans Autun le jour de l'attaque emmenant trente-quatre chevaux qu'ils avaient pris sur l'ennemi ; suivaient en même temps deux chars, sur lesquels étaient traînés quatre — lisez : cinq — Mandrins, dont deux étaient mortellement blessés, à l'escorte de la maréchaussée[59]. L'un des prisonniers, qu'on nommait dans la bande le Curé, mourut le 5 janvier 1755, de ses blessures[60]. Mandrin avait perdu dans la bataille son fameux chapeau galonné d'or ; il avait été atteint de deux coups de fusil. Les mémoires justificatifs qui furent rédigés, d'une part par le colonel Fischer, de l'autre par ses officiers, présentent le combat de Gueunand sous un jour qui leur est favorable. Le marquis d'Argenson, bien renseigné sur ces faits, écrit au contraire : Fischer a été battu à plate couture[61]. C'est une exagération, mais la relation de M. Duchemain, l'entreposeur d'Autun, donne bien l'impression de l'échec éprouvé par les royaux[62]. L'entreposeur accuse Fischer d'avoir compromis le succès de la campagne par sa trop grande ambition, dans la crainte de devoir partager le mérite d'avoir battu Mandrin, en attendant les renforts qu'il savait faire diligence pour le rejoindre. Fischer ne put trouver personne, après le combat de Gueunand, qui consentit à lui servir de guide pour la poursuite des brigands. Il se mit cependant à cheval, avec ceux de ses hommes qui étaient assez dispos pour continuer la campagne ; mais ses chasseurs, pour lestes qu'ils fussent, n'étaient pas hommes à gagner les Mandrins de vitesse. Chacun dut rendre hommage à la valeur que les contrebandiers avaient déployée dans ce combat contre des troupes d'élite, commandées par un officier éprouvé et qui leur étaient trois ou quatre fois supérieures en nombre. Au cours de l'action, disait-on, les contrebandiers n'étaient ni des hommes ni des soldats, c'étaient des diables[63]. Le correspondant de la Gazette de Hollande[64] écrit : La conduite des Mandrins à Gueunand passera pour un véritable prodige militaire. Et Fischer lui-même dut proclamer que Mandrin s'était battu en brave homme et entendait très bien le métier de la guerre[65]. En se retirant devant les troupes nombreuses, qui le poursuivaient et auxquelles arrivaient d'heure en heure des renforts, Mandrin fil dix-sept lieues dans la seule journée qui suivit le combat de Gueunand. Il franchit l'Arroux, la Loire et la Besbre. Dans cette course folle, il emportait ses compagnons blessés, chargés comme des ballots sur des chevaux de bât. Lui-même était blessé. On aurait pu le suivre à la trace, le chemin par lequel il s'est retiré étant marqué de sang. Il passa la Loire le 20 décembre, jour du combat, sur les six heures et demie du soir. On se fera une idée de la rapidité de sa marche en songeant que, dans le même temps, les chasseurs de Fischer, qui le poursuivaient, ne firent que quatre lieues[66]. Mandrin, atteint de deux balles, était harcelé, poursuivi par des troupes légères, et de toute part arrivaient contre lui des renforts frais et dispos[67]. D'autre part, depuis le 18 décembre, les volontaires de Flandre, placés sous les ordres du capitaine Diturbide-Larre, avaient quitté leurs quartiers d'hiver dans le Dauphiné et se dirigeaient vers le Forez, pour couper la retraite aux contrebandiers, ainsi qu'il a été dit[68]. Mandrin divisa à nouveau ses forces en deux tronçons. Il se jeta lui-même dans le Forez, car il ignorait la marche des troupes commandées par le capitaine Diturbide. L'autre colonne remonta la Loire. C'était la troisième fois qu'il revenait en Auvergne. Des mouvements populaires, occasionnés par la cherté des vivres, agitaient le pays. Le marquis d'Argenson écrit dans ses Mémoires, que les hobereaux, à la tête de leurs paysans, allaient piller les greniers des monopoleurs. Mandrin faisait école. La relation que Fischer a laissée de l'affaire de Gueunand signale deux ou trois cents vauriens qui, dans le Forez, attendaient le moment de se joindre à Mandrin. Nous savons que celui-ci, à son départ de Suisse, comptait trouver en Auvergne un renfort d'hommes résolus : les deux ou trois cents vauriens, sans doute, dont parle Fischer. Bien qu'il fût sorti à son honneur du combat de Gueunand, celui-ci avait été pour Mandrin un coup terrible. Les relations contemporaines notent sa tristesse durant les jours qui suivent. Lui, si gai, est devenu morne, sombre ; lui, si expansif, est devenu silencieux. Il se tient à l'écart de ses propres compagnons. En sa pensée simple, sans connaissance des conditions de son temps, sans lectures, il croyait n'avoir fait que partir en guerre contre une compagnie de financiers qui exploitaient sa patrie — puisque ce dernier mot revient sur ses lèvres. Gueunand est le rude choc qui le réveille en lui montrant la réalité. Réveil douloureux. La réalité il ne la soupçonnait pas. Son élan en est brisé. Son rêve de voir ses forces grandir par la puissance même de la cause qu'il défend, est détruit. Détruite aussi l'illusion qu'il avait conservée et qui faisait son prestige aux yeux du peuple, qu'il ne se battait que contre les troupes de la Ferme et que le roi ne lui était pas hostile. A Gueunand, il a lutté en bataille rangée contre son souverain. Nous allons voir des gens du peuple refuser de lui servir de guides, ce qui n'était jamais arrivé. Mandrin commence à comprendre qu'il n'est pas sur le chemin menant à la gloire et à l'affranchissement d'un peuple où il avait cru s'engager. Sa nature fruste et rude, portée aux enthousiasmes et aux exaltations excessives, retombe lourdement sur elle-même. Dans les premiers jours qui suivent le coup violent, c'est enfin une tragique dépression. Spectacle dramatique, dans ce moment, que l'effondrement de ce caractère si fortement bâti. Pour la première fois dans sa vie, il se désespère. Or nul moins que lui, n'était fait pour le désespoir. Lui qui, jusqu'alors, avait tenu à demeurer exceptionnellement sobre, durant ces campagnes où tant de responsabilités pesaient sur lui, lui que nous avons vu hésiter à boire un verre de Bourgogne afin de conserver la clarté de sa pensée, — s'enivre durant les jours qui suivent le combat de Gueunand. Sa peine est trop brutale et la nature rudimentaire qu'est la sienne ne trouve à l'adoucir que dans l'ivresse brutale du vin. Ses compagnons doivent l'emporter hissé sur un cheval[69]. L'ivresse du bandit dans ce moment est poignante. En son âme rude et primitive, durant ces premiers jours, seules les fumées du vin peuvent tenir la place de son rêve évanoui. Après l'affaire de Gueunand et le dédoublement de sa troupe, les forces de Mandrin se trouvent réduites à une cinquantaine d'hommes. Il est lui-même blessé. Il n'en continue pas moins à répandre la terreur. Ceux qui ont la mission de le poursuivre, s'affolent. A Autun, un soldat du régiment de Bourbonnais est tué dans un cabaret par des chasseurs de Fischer qui le prennent pour un contrebandier[70] ; aux yeux des gardes qui scrutent l'horizon du haut des remparts aux portes closes, les troupeaux de moutons qui passent au tournant de la route deviennent des contrebandiers[71] ; à Dijon, que défendent 8.000 soldats, l'alarme est si vive qu'on ne laisse ouverte qu'une seule des portes de la ville, encore y place-t-on un corps de garde nombreux[72] ; à la barrière d'Auxerre, l'abbé de l'Isle, grand-vicaire de M. de Condorcet, évêque de Gap, promu à Auxerre, — délégué pour venir prendre en son nom possession du siège épiscopal, — est arrêté, fouillé, questionné : c'est un espion, dit-on, un espion de Mandrin qui a coutume de se faire précéder, comme à Autun, d'émissaires en habits ecclésiastiques ; et M. le vicaire général est retenu dans une morgue jusqu'au soir[73]. A Strasbourg, les gapians veillaient aux barrières des faubourgs. Arrive un individu bien armé, bien monté, avec un porte-manteau bourré d'effets. C'est un contrebandier isolé, un simple porte-col. Il veut entrer par la barrière des Gobelins. Les gapians l'arrêtent. Ce porte-manteau ? — Des étoffes prohibées, mais n'y touchez pas. Les employés veulent se saisir de l'insolent, mais celui-ci, après avoir donné un coup de sifflet strident : Je suis Mandrin ; vous allez avoir beau jeu, mes gens arrivent. En un instant le poste est vide, et notre homme d'entrer tranquillement dans la ville, tandis que les employés des Fermes ont été se blottir au fond d'une cave, derrière des amoncellements de futailles, d'où l'on eut toutes peines du monde à les tirer. Ces pauvres gens furent révoqués[74]. En Bourbonnais, en Beaujolais, en Lyonnais, en Auvergne et en Forez ; les lettres circulaires des gouverneurs et des intendants stimulent les officiers municipaux : on bouche les brèches des vieux murs, les portes sont réparées, les enceintes sont refaites et des couleuvrines y sont installées[75]. Les milices bourgeoises sont tenues en éveil. Elles ont ordre de faire des rondes, de monter la garde nuit et jour. Le commandant de la gendarmerie de Billom les avait postées aux entrées de la ville. Il s'en vient faire son inspection à trois heures du matin. Les postes étaient abandonnés, car il faisait un froid noir et les bourgeois en sentinelle étaient allés se mettre au lit[76]. A Brioude, les officiers des milices bourgeoises sont élus par les soldats. C'est déjà la garde nationale. Ils sont extrêmement nombreux. Le tiers des citoyens de Brioude sont officiers[77]. Et ils ont, sans aucun doute, des uniformes magnifiques. Des postes sont établis tout le long de la rivière d'Allier, depuis le port de Chazeuil jusqu'à celui de Charmeil. Et puis il arrive que de mauvais plaisants s'amusent à faire des peurs aux gens. Ils accourent sur la place hors d'haleine : Voilà les Mandrins ! Le tocsin retentit, les magasins se ferment, des femmes se trouvent mal ; tandis que, ferme et résolu, le commandant de la milice bourgeoise boucle son ceinturon. Le subdélégué à Roche-Savine fit mettre en prison un de ces gais farceurs, pour l'exemple, écrit-il à l'Intendant[78]. Mandrin passa l'Arroux à La Boulaye, et la Loire à Saint-Aubin. Il arriva au port Saint-Aubin le 21 décembre à quatre heures du matin. lei, pour la seconde fois, il divisa en deux tronçons ce qui lui restait de troupes, conservant le commandement du premier, avec Joseph Bertier pour lieutenant, et donnant le commandement du second à un contrebandier du nom de Jacques Michard, dit le Camus[79], fils d'un serrurier du Pont-de-Beauvoisin. C'était un jeune homme de vingt-quatre ans, solide, bien que de petite taille, les cheveux noirs, le visage grêlé de petite vérole. Mandrin passa le mètre jour à Dompierre-sur-Besbre, où il prit, à quatre cavaliers de la maréchaussée, leurs chevaux, leurs armes et tout leur fourniment. Ses compagnons exaspérés par le combat de Gueunand, voulaient les massacrer, niais Mandrin s'y opposa. Il en repartit à deux heures du soir. Il était à N'amas vers sept heures et alla coucher à Servilly. Le 22, Mandrin et sa bande, au nombre de 35 hommes, arrivaient au Breuil, près de La Palisse. Ils se proposaient de passer debout, quand ils entendirent une femme qui criait : — Voici les contrebandiers, il faut aller chercher la brigade de Vichy qui est chez Arpaja ! — cabaretier du village. Au fait, les contrebandiers allèrent chercher ladite brigade. Ils massacrèrent deux gapians qui buvaient au cabaret. Ils en tuèrent deux autres dans un champ voisin. Le capitaine de la brigade fut blessé grièvement. Le texte du jugement prononcé dans la suite contre Mandrin porte que plusieurs de ces employés lui demandaient à genoux de leur laisser la vie. Mandrin était ivre[80]. Les contrebandiers, en emmenant bon gré mal gré un paysan du Breuil, qui dut leur servir de guide, continuèrent leur route par Arfeuilles et Châtel-Montagne. A Châtel-Montagne, ils firent panser plusieurs de leurs blessés et achetèrent deux chevaux. Mandrin ne pouvait plus se tenir d'ivresse et voulait s'arrêter. La troupe dut l'emporter de force[81]. Nos compagnons avaient en effet les royaux sur leurs talons. Fischer venait d'être renforcé par les soldats de Beaufremont que lui avait amené M. de Clamoux. Il divisa à son tour ses forces en deux troupes pour la poursuite des margandiers. A Toulon-sur-Arroux, il fut rejoint par M. d'Espinchal, qui, de Nolay, était arrivé ventre A terre avec de nouveaux renforts[82]. M. de Clamoux, placé à la tête du second corps, vint coucher à Luzy[83]. Ces détachements, l'un et l'autre, serraient les Mandrins de près. A Châtel-Montagne et à Noirétable, où ils vont arriver, Clamoux ne les manqua que de quelques heures. Néanmoins, avec une rapidité qui continuait de faire l'étonnement des hommes de guerre, les Mandrins gagnaient les royaux de vitesse[84]. Le même jour encore, 22 décembre, à Saint-Clément, les contrebandiers assassinèrent un meunier et sa femme qui refusaient de leur indiquer les maisons, où ils croyaient devoir se trouver des employés des Fermes, et aussi de leur servir de guide jusqu'à Saint-Priest-la-Prugne[85], où ils arrivèrent le même jour. Mandrin, épuisé par ses blessures, se tenait avec peine sur son cheval. Durant les journées qui suivirent Gueunand, c'est Bertier qui eut, en réalité, la direction de l'expédition. Ainsi s'expliquent ces excès. En passant par Saint-Priest et par Saint-Just, les Mandrins arrivèrent à Cervières dans la nuit du 22 au 23, entre onze heures et minuit. La femme du receveur du grenier à sel, Mme Barge, dut leur remettre 46 louis en échange d'un reçu[86]. Avec ses cent cinquante cavaliers de Montmorin, M. de Clamoux comptait les rejoindre d'un montent à l'autre. Les contrebandiers dirent à Mine Barge qu'ils voulaient se rendre dans les Cévennes, où la population protestante leur était dévouée et où ils espéraient pouvoir se cacher. Ils quittèrent Cervières le 23 décembre, sur les dix heures du matin. A Noirétable, le receveur des tailles, M. Perdigeon, dut leur verser 88 livres. Ici encore ils se mirent à la recherche des gapians et comme ils découvrirent la maison où ceux-ci logeaient et où ils s'étaient enfermés, ils en firent le siège. La femme du brigadier fut malheureusement blessée d'une balle, au moment où elle ouvrait la porte. La pauvre femme en mourut le lendemain. Au témoignage de M. de Clamoux, Mandrin était toujours dans un complet état d'ivresse et ne dirigeait rien[87]. Les Mandrins couchèrent dans la nuit du 23 au 24 décembre à la Paterie, commune de Marat[88]. C'était un relai de diligence. Ils emmenèrent deux filles de l'auberge, qui n'ont pas été forcées, suivant toute apparence[89]. C'est la première fois qu'il est question de femmes dans l'histoire de Mandrin ; encore n'est-il pas (lit que l'une ou l'autre de ces filles d'auberge ait été emmenée à son intention. Dans cette course, qui pouvait paraître une fuite, les Mandrins ne laissaient pas de faire des recrues, principalement en colporteurs, tant était fort le mouvement d'opinion qu'ils avaient déterminé[90]. Ln longeant les rives de la Dore, les Mandrins arrivèrent, le 21 décembre, sur les dix heures du matin, en vue d'Ambert. Hommes et chevaux étaient très fatigués ; ils se reposèrent environ deux heures sur le chemin de Marsac, à une demi-lieue au-dessus d'Ambert, où ils n'osèrent pas pénétrer, parce que j'avais fait mettre, à tout événement, les armes à la bourgeoisie, écrit l'intendant d'Auvergne à son confrère du Languedoc[91]. La bourgeoisie était soutenue par les gendarmes, et le tocsin de la ville avait retenti à l'approche des brigands[92]. Ceux-ci poussèrent donc jusqu'à Marsac, où Mandrin entra à la tête de sa bande, monté sur un cheval gris pommelé[93]. Il était drapé dans un manteau écarlate[94]. Les brigands obligèrent mi riche industriel de la ville, M. Dupuy de la Grand'Rive, fabricant de papier, à leur fournir de l'avoine pour leurs chevaux. Précipitamment, ils firent manger cette avoine à leurs montures après l'avoir répandue sur leurs manteaux de gros drap bleu doublé de rouge, qu'ils déployèrent à terre[95]. Puis, sans rien réclamer d'autre, sur les trois heures de l'après-midi[96], ils prirent la route d'Arlanc, à l'exception de Mandrin lui-même, qui resta à Marsac avec deux camarades, sans doute pour s'enquérir de la marche des chasseurs de Fischer qui le poursuivaient ventre à terre[97]. A Marsac encore on fut frappé de la tristesse de Mandrin, faisant contraste avec la gaîté qu'il avait montrée au cours de sa précédente expédition[98]. De jour en jour il sentait plus distinctement que la réalisation de ses desseins lui échappait. Elle était au-dessus de ses forces ; au-delà des forces humaines, dira Bjœrnstjerne Bjœrnson. La bande, qui avait continué sa route, traversa Ariane, sur les quatre heures du soir, au galop, d'un trait. Un poissonnier d'Arlanc envoie ses observations au subdélégué d'Issoire. Il compta exactement 42 hommes et 4.6 chevaux. Les contrebandiers étaient vêtus misérablement à l'exception de trois chefs qui marchaient en tête. Plusieurs des hommes avaient le bras en écharpe, enveloppés dans des linges sanglants. Hommes et chevaux paraissaient las. Plusieurs des chevaux étaient blessés. Les chefs pressaient continuellement leurs compagnons de hâter leur allure[99]. Les Fischer les serraient toujours de près. Un corps de cent vingt hussards et dragons arriva à Ambert, sur les huit heures du soir, le jour même où les Mandrins y avaient passé ; ils en repartirent le lendemain à quatre heures du matin[100]. Fischer et ses hommes étaient, eux aussi, exténués, mais ils activaient la poursuite. Ils prirent un guide avec eux, qui les conduisit à Marsac. Les Mandrins, sans leur chef, firent halte à la Chaise-Dieu, où ils entraient pour la seconde fois. Ils y arrivèrent le 21 décembre sur les sept heures du soir. La petite ville se groupe au sommet de la colline, en s'abritant au pied de la magnifique basilique lourde et massive, qui, du haut de son large escalier, la domine de son formidable carré de pierre, et semble vraiment, pour reprendre une comparaison souvent usitée, la poule qui veille sur ses poussins. Du bas de la colline jusqu'en haut, jusqu'aux premières maisons du bourg, ce ne sont que prairies. Elles se superposent, Par étages, soutenues par des terrassements. Les paysans y laissent paître librement leurs vaches et leurs cochons. Tout autour, ondulant à l'horizon, les hautes collines du pays vellave — des montagnes si l'on veut. Elles sont couvertes de forêts de pins et de sapins. Les Mandrins les virent couvertes de neige, d'une neige éclatante et blanche, mais qui bleuissait par nuances insensibles, avec l'éloignement, clans la pureté de l'air. Les Mandrins montèrent par la route rocailleuse, entre les murs formés de blocs de rochers posés l'un sur l'autre, sans ciment, sous les hautes rangées de frênes et de peupliers. La Chaise-Dieu n'a pas d'enceinte et cependant elle a l'aspect des villes féodales, où chaque maison est une forteresse : des tours massives reliées par des courtines, de vieux murs percés de meurtrières, des échauguettes et des mâchicoulis, des tourelles à poivrières et des fenêtres défendues par de lourdes grilles de fer. A la Chaise-Dieu, en l'absence de Mandrin, demeuré à Marsac, on va constater une fois de plus quelle était la conduite de nos contrebandiers quand ils n'étaient pas sous la direction de leur jeune capitaine. Ce sont assurément les mêmes procédés, ceux qu'il leur a appris, mais appliqués avec une brutalité qu'il ne tolérait pas. Puis l'allure joyeuse, voire élégante que Mandrin donnait à ses déprédations, l'ampleur de son geste ont disparu[101]. Arrivés à sept heures du soir, les Mandrins commencèrent par s'emparer des avenues de l'église pour empêcher qu'on ne sonnât le tocsin ; puis ils furent se loger, avec leurs chevaux, chez Jacques Pouzol, à l'hôtel du Cheval-Blanc, et chez la veuve Moulin, à l'Écu-de-France ; les hôteliers n'ayant pu résister à la force des contrebandiers intrépides, redoutables et armés, pour reprendre l'expression du procès verbal dressé par le notaire Jean Pouzol. Le buraliste, Joseph Richard, désireux de se soustraire aux mauvais traitements dont son fils, Jean, avait été victime, de la part de la même bande, deux mois auparavant, s'était enfermé chez lui. On vient de dire que les maisons de la Chaise-Dieu constituaient par elles-mêmes de petites forteresses ; aussi les Mandrins ne purent-ils forcer celle du buraliste, et se retirèrent-ils en proférant des menaces et des jurons, après avoir, dans leur colère, brisé les contrevents des fenêtres et cassé des carreaux à coups de fusils. Mais ils surprirent un autre buraliste, marchand de tabac en détail, Jean Michaud. Ils entrèrent chez lui sourdement, tandis qu'il était assis, devisant avec sa femme, au coin de l'âtre. Les uns le mirent en joue, les autres le menacèrent de la pointe de leurs baïonnettes. Il leur fallait 10.000 livres. Michaud et sa femme prient et supplient. Jamais ils n'ont disposé de somme pareille. Et tandis que les uns bourraient le malheureux buraliste de coups de crosse, d'autres enfonçaient les armoires de la maison, forçaient les tiroirs où il ne se trouva en dernier compte que 70 livres que nos compagnons refusèrent de recevoir. Ils exigeaient que la femme Michaud allât emprunter de l'argent chez ses amis et connaissances, et comme la malheureuse disait qu'elle ne savait personne qui pût lui prêter de l'argent, les contrebandiers entraînèrent le mari à l'Écu-de-France, où coups et menaces recommencèrent à pleuvoir sur lui. Enfin Mme Michaud parvint à réunir 110 livres, pour lesquelles elle reçut une quittance informe de l'un des contrebandiers nommé Prêt-à-boire. Un récépissé sans signature, au bas duquel trois lettres que l'on ne peut distinguer, à l'exception de celle du milieu qui est un P avec un accent circonflexe au-dessus, et un petit trait au-dessous. Encore, après avoir encaissé la somme, les bandits ne voulurent-ils pas donner la liberté à Michaud, disant qu'ils avaient été informés que l'on avait envoyé quérir des troupes à Craponne pour les combattre, et que Michaud demeurerait entre leurs mains, comme otage. Ce Prêt-à-boire était un homme de vingt-huit à trente ans, beau garçon, les yeux gris, avec de longs cheveux châtain clair. Il s'appelait de son vrai nom Antoine Roche. Il était de Saint-Martin-de-Volans, en Vivarais. Il était d'assez bonne famille, puisque son grand-père avait été notaire et qu'il était marié à Marie Chantaloube, fille du fermier de la dîme de Cheylas en Vivarais. Les jeunes époux demeuraient au Pont-de-Beauvoisin, partie Savoie. Prêt-à-boire était l'un de ceux qui avaient pris part, le 23 juillet 1153, au fameux coup de main du Pont-de-Beauvoisin, où quelques contrebandiers avaient enlevé, des prisons du roi de France, un de leurs camarades, Gabriel Degat, dit le Frisé. Dans la suite, Prêt-à-boire fut pris, condamné par jugement du 19 janvier 1758 et rompu vif à Valence le 24- janvier suivant[102]. Un autre buraliste, débitant de tabac, Grégoire Richard, était parvenu à se sauver de chez lui avec toute sa famille, à l'exception de sa servante, Marguerite Martin. La pauvre fille, entre les mains des margandiers, fut littéralement rouée de coups de crosse et ces brutes menaçaient de l'assommer entièrement si elle n'allait quérir ses maîtres. Enfin, en assurant qu'elle les allait chercher, elle parvint à se tirer de leurs mains et s'enfuit pour ne plus revenir. Les Mandrins l'attendirent quelques instants et, comme elle ne reparaissait pas, ils se mirent à briser les portes du logis, à défoncer la banque ; ils s'emparèrent de tout l'argent qui s'y trouvait, et prirent en outre cinq douzaines de bagues d'argent. A ce dernier trait encore, on voit que Mandrin n'était pas là. Le 24 décembre, passé minuit, celui-ci rejoignit ses compagnons à la Chaise-Dieu. Dans l'instant même il y acheta quelques chevaux, rendit la liberté au malheureux Michaud et fit décamper tout son monde[103]. Guidés à travers les fourrés profonds du Bois-Noir, par un homme du pays, un certain Landau[104], les margandiers arrivèrent à Fix-Saint-Geneix, où ils descendirent chez la veuve Fontaine, cabaretière, en cette veillée de Noël, au moment même où l'on sortait de la première messe de minuit[105]. Les chasseurs de Fischer, qui arrivaient ventre à terre, au nombre de cent cinquante à deux cents, ne les manquèrent à la Chaise-Dieu que de trois heures. Les royaux ne s'arrêtèrent que pour obliger les consuls de la ville à leur fournir des guides et des chevaux, et repartirent dans la direction que les Mandrins avaient prise. Et, à ce moment même, arrivaient dans le pays, sous le commandement du capitaine Diturbide-Larre, les dragons de La Morlière dont il a été question. Le capitaine Diturbide venait d'atteindre Le Puy et se dirigeait, lui aussi, dans la direction où les Mandrins venaient de lui être signalés. Du Nord et du Sud les contrebandiers étaient menacés : ils allaient être pris entre deux feux. Bien qu'il fût pressé et qu'il connût le danger si instant, Mandrin voulut s'arrêter une heure, en cette nuit de Noël, sur ces hauteurs couvertes de neige, pour entrer, à Fix-Saint-Geneix, dans l'église pleine de lumières et y entendre les chants en l'honneur du Dieu des pauvres gens. Il assista avec ses bandits à la seconde messe de la nuit[106]. Quelles furent, dans ce moment, ses pensées ? Quelles émotions s'agitèrent en lui, durant cette heure de recueillement ? Que ne donnerait-on pas pour avoir une peinture vivante de ces bandits en haillons et en armes, entassés parmi des paysans tranquilles, parmi les femmes inclinées sous leurs coiffes blanches, dans cette petite église perdue sur les hauteurs, lumineuse dans la nuit, dans la vague clarté de la neige, entre les masses de sapins noirs, — et toute bourdonnante de vieux noëls ? La messe entendue, les Mandrins firent joyeux réveillon ; et c'est ainsi que, malgré les ennemis qui les talonnaient, nos compagnons restèrent à Fix-Saint-Geneix jusqu'à onze heures du matin. Conduits par plusieurs guides, ils longèrent les bois de Vazeilles, de Ninirolles, de Saint-Jean-de-Nay[107], et arrivèrent ainsi jusqu'à Beyssac, petit village sur la paroisse Saint-Jean-de-Nay, où ils s'arrêtèrent encore à se rafraîchir. Jour de Noël, joyeuse fête. De Beyssac, ils montèrent vers la Sauvetat, village écarté, dominant les hauteurs, sur la route de Pradelles. Deux chemins y conduisaient. Les contrebandiers prirent le plus mauvais, sans doute pour dérouter les soldats attachés à leur poursuite, et ils atteignirent ainsi la Sauvetat, sur les cinq heures du matin. Leur jeune capitaine s'est ressaisi. De ce moment, nous allons le retrouver sans faiblesse nouvelle, tel que nous l'avons connu jusqu'à ce jour, présidant avec fermeté à la destinée de sa bande. Les Mandrins arrivèrent donc à la Sauvetat en Velay, le jeudi 26 décembre sur les cinq heures du matin ; or le capitaine Diturbide-Larre, avec les cavaliers de La Morlière, y était depuis une heure. Au moment même où les Mandrins avaient quitté Beyssac, Diturbide y était arrivé avec ses cavaliers. Il y avait pris ses informations, et un paysan lui avait dit que les contrebandiers s'étaient engagés dans les sentes qui conduisaient à la Sauvetat[108]. Il y avait tout aussitôt poussé sa troupe, faisant presser les chevaux à coups d'éperons et de plats de sabre. Des deux chemins, il prenait naturellement le plus court, ignorant que les bandits avaient pris le plus long. Le capitaine Diturbide comptait donc trouver Mandrin à la Sauvetat, mais il avait fait si grande diligence qu'il y était arrivé avant lui, à trois heures et demie du matin. L'obscurité était complète. Immédiatement, le capitaine Diturbide avait fait fouiller le village et, n'y trouvant aucun de ceux qu'il cherchait, il s'était imaginé les avoir manqués et que Mandrin déjà était reparti. Il avait alors fait entrer les chevaux dans les écuries du village, pour leur faire donner de l'avoine et du foin, et avait permis à ses hommes de se répandre pour boire dans les cabarets et dans les maisons de ceux des paysans qui consentiraient à les recevoir[109]. La Sauvetat en Velay est un pauvre village, presque à la crête d'une masse volcanique ; il est à cinq lieues au sud du Puy. Du sommet de la montagne, où des quartiers de roc saillent de terre, on domine la contrée : un premier plan de mamelons, recouverts comme d'une calotte par des bois de sapins noirs ; plus loin la dentelure azurine des mont aigus, dont les flancs cerclent l'horizon comme les gradins (l'un cirque gigantesque. Les maisons de la Sauvetat sont construites en blocs de lave fauve, et les rues sont couvertes de sable roux, où, par endroits, la roche volcanique parait à fleur de terre. Chaque maison est isolée de la voisine, comme en une farouche défiance, basse, massive, regardant d'un air louche, de sa petite fenêtre unique sur le flanc de la porte étroite. Le rude aspect de chaque demeure est rendu plus sombre encore par la cour dont elle est entourée, protégée d'une muraille à hauteur d'épaule, muraille formée par des blocs de lave rouge, énormes, qui ont été entassés l'un sur l'autre et se tiennent librement sans mortier ni ciment. Les portes des cours sont faites de lourdes palissades de bois à peine équarri. Le fumier est entassé sur le devant, entre des blocs de lave. Constructions âpres et sauvages, dont chacune est comme un bastion fortifié, et que l'on dirait avoir été faites pour servir d'aire à un vol de brigands. Voilà donc les Mandrins qui arrivent sur les cinq heures du matin à la Sauvetat. Ils étaient trente-six[110]. Le village est tout bondé des cavaliers de La Morlière — cent cinquante environ — et nul des Mandrins ne s'en cloute. Il fait nuit noire et le froid est d'une rigueur affreuse. Trois contrebandiers sur leurs chevaux se présentent à la porte d'une écurie. Une sentinelle crie : Qui vive ! Le premier des trois contrebandiers, sans répondre, tire son pistolet, presse sur la gâchette, mais le coup rate. La sentinelle riposte et le contrebandier tombe de cheval, frappé à la cuisse[111]. C'était l'un des principaux de la bande, Louis Levasseur, dit le Normand. Au bruit, les La Morlière, qui faisaient manger de l'avoine à leurs chevaux ou buvaient dans les auberges, brident au plus vite, ils se précipitent sur leurs armes Dans la nuit, Mandrins et volontaires de Flandre se fusillent à bout portant. Un maréchal des logis de La Morlière, Dominique Pinaty, qui était demeuré dans la maison d'un paysan, nommé Belut[112], fut dans ce moment tué d'un coup de fusil qu'un Mandrin lui tira par la fenêtre. Il était assis tranquillement près d'une table où brûlait une chandelle. Protégé par l'obscurité de la rue le contrebandier le tira à bout portant. Épuisés, réduits à une poignée d'hommes, les Mandrins ne pouvaient que battre en retraite. Ils s'échappèrent par petits groupes dans des directions différentes. Leur chef emmena quelques compagnons dévoués. Il ne laissait entre les mains du capitaine Diturbide que deux chevaux. Outre le maréchal des logis, de qui il vient d'être question et qui fut tué, les volontaires de Flandre avaient eu un cavalier de blessé[113]. Les Mandrins se sauvèrent d'autant plus aisément que les soldats de La Morlière, craignant d'être fusillés dans rob-cuité, qui était complète, s'étaient empressés de rentrer dans les maisons, dès après que l'alarme eut été donnée. Les contrebandiers trouvèrent un premier asile dans les forêts épaisses et profondes des environs. La plupart d'entre eux avaient abandonné leurs armes apparentes : quelques-uns les avaient même jetées dans un étang voisin. Au reste, ils étaient protégés par la sympathie du peuple qui partout favorisa leur fuite. Le capitaine Diturbide-Laine ramena son détachement au Puy. Il était résolu d'y laisser à tous ses hommes quelques jours de repos, quand, le 27 décembre, le lendemain de l'échauffourée, on lui vint dire que, dans les villages voisins de la Sauvetat, se trouvaient quelques Mandrins blessés. Il partit avec trente cavaliers de la maréchaussée et deux de ses maréchaux de logis qu'il avait travestis en margandiers, après leur avoir fait donner des ballots de tabac par l'entrepôt du Puy, que naguère Mandrin avait si brillamment assiégé, rue du Consulat. Lé capitaine Diturbide ne se faisait aucune illusion, comme on voit, sur la popularité dont les défenseurs des fermiers généraux jouissaient parmi les populations ; il comptait exploiter au contraire la bienveillance qu'elles témoignaient aux Mandrins. Et l'événement justifia sa conduite : les paysans, en voyant arriver les maréchaux de logis, sous leurs grands chapeaux de feutre noir, chargés de carottes et d'andouilles de tabac, les prirent pour des margandiers et s'empressèrent de leur révéler la retraite des Mandrins blessés à la Sauvetat. C'est ainsi qu'ils furent conduits dans la maison où Levasseur, dit le Normand, qui avait été désarçonné le 26 décembre d'un coup de pistolet à la cuisse, se trouvait dans l'impossibilité de se mouvoir. Les cavaliers s'emparèrent du pauvre diable. C'était le 29 décembre. Le Normand, écrit l'intendant du Languedoc, était fort accrédité et fort craint dans la troupe, et le confident de Mandrin. Diturbide-Larre essaya de le faire parler. Le Normand feignit d'entrer dans ses vues. Il se plaignit beaucoup de Mandrin et, finalement, il dit au capitaine Diturbide que Mandrin, le Major, le Canonnier — plusieurs des contrebandiers portèrent ce nom, c'étaient les gardes particuliers de Mandrin —, enfin le Camus, avec leurs domestiques et leurs chevaux, avaient rétrogradé vers l'Auvergne, afin de s'y réfugier dans un château près d'Ambert, où ils avaient des intelligences : ce château avait quatre tours, il était au bord d'une forêt impénétrable et à deux lieues d'une Chartreuse. Le Normand ne savait d'ailleurs le nom, ni du château, ni de la forêt, ni de la Chartreuse. Le capitaine Diturbide, très naïf, n'en partit pas moins, avec vingt de ses hommes, à franc étrier, pour Ambert, où il arriva le 2 janvier[114]. Le renseignement, comme bien on pense, était faux. Le Normard servait ses camarades. Il fut envoyé à Valence, et traduit, le 21 février 1755, devant la commission spéciale qui était établie pour juger les délits de contrebande. II fut condamné à être rompu vif et exécuté le 26 du même mois[115]. Le capitaine Diturbide était revenu d'Ambert assez penaud. Il ne pouvait plus être question de poursuivre la bande dispersée et il renvoya ses cavaliers en Dauphiné, y reprendre leurs quartiers d'hiver. Après l'affaire de la Sauvetat, on vit de divers côtés plusieurs petits groupes de contrebandiers qui fuyaient et cherchaient à se dérober ; surtout on crut en voir. Car s'il nous fallait additionner ici tous les Mandrins qui, dans les jours suivants, furent signalés sur différents points de la France, il leur faudrait attribuer de formidables effectifs. Il n'était pas de vagabond, ni surtout de faux-saunier, qui, dans l'imagination des braves gens, ne se transformât en un Mandrin, et, le plus souvent, en Mandrin lui-même[116]. M. Madur, subdélégué à Ambert, signala, le 3 janvier, une bande de neuf contrebandiers à cheval, cherchant à guéer la Dore. Rebutés par les glaces, ils avaient couru au pont d'Ambert, d'où ils avaient pris la route de Saint-Amand Roche-Savine, allant fort vite, comme s'ils étaient poursuivis. Celui qui était au centre de la troupe, ajoute M. Madur, a été reconnu pour Mandrin, portant un manteau écarlate et monté sur un cheval gris pommelé qu'on lui avait vu à Marsac[117]. C'était peut-être le cheval de Mandrin, peut-être aussi son manteau, mais ce n'était pas Mandrin lui-même. M. de Saint-Roman, lieutenant-colonel du régiment de Vatan, au Puy, écrit plus justement à M. de Saint-Seine, secrétaire de l'intendant d'Auvergne, en date du 16 janvier 1755 : Il est bien surprenant qu'on ait vu Mandrin neuvième dans vos cantons ; on me mande du Vivarais l'avoir vu dans le même temps ; quelqu'un de sa troupe, ou bien Mandrin, a le don de se reproduire[118]. Durant son passage à Bourg, Mandrin disait à un ecclésiastique que s'il pouvait gagner sûrement le Vivarais, il n'avait plus rien à craindre, qu'il en connaissait les montagnes et que le pays était pour lui[119]. Au fait, les relations entre les contrebandiers et les
protestants du Vivarais étaient anciennes. Dès j'année 1732, l'intendant
Fontanieu en écrivait : On a vu que ces scélérats
— les contrebandiers — s'étaient formé des habitudes
dans un canton du Vivarais, nommé les Boutières, composé de vingt ou
trente paroisses, toutes de religionnaires ; que, lorsqu'ils y arrivaient,
ils tiraient leurs armes en l'air, pour marquer qu'ils s'y regardaient comme
en sûreté[120]. C'est en effet de ce côté qu'il chercha refuge après la tempête. L'arrivée des Mandrins en Vivarais est encore signalée de Lyon, le 27 décembre, et plus tard par M. de Saint-Priest, intendant du Languedoc[121]. L'itinéraire exact, que le capitaine général des contrebandiers suivit pour regagner la Savoie, est donné par le registre des délibérations de la communauté de Gex. On sait les rapports entre les contrebandiers, établis dans le nord de la Savoie et en Suisse, avec les habitants du pays de Gex, leurs voisins. Les indications fournies par le registre sont d'ailleurs confirmées par une correspondance adressée de Chambéry, le 30 janvier 1755, à la Gazette de Hollande, qui l'inséra dans son numéro du 14 février suivant : Du Vivarais, Mandrin passa en Provence, après avoir franchi le Rhône ; par le comté de Nice et le col de Tende il se rendit en Piémont et, par la route de Turin, il revint en Savoie, regagnant la frontière suisse, son point de départ. Le 24 janvier 1755, il était de retour à Carouge, au Lion-d'Argent, chez son fidèle ami Gauthier, où il trouva le repos, comme à la suite de sa dernière campagne, quand il était revenu blessé au bras après le combat livré dans la rue du Consulat au Puy[122]. Ses camarades le rejoignirent, sous des déguisements divers, par petites bandes, dont une seule fit parler d'elle, en passant le Guiers vif, où elle tira sur un poste de huit hommes des volontaires de Flandre[123]. Cette sixième campagne avait mis le comble à la renommée de Mandrin. Ses adversaires, eux-mêmes, parlaient de lui avec étonnement. Durant les six derniers jours qui avaient précédé l'affaire de la Sauvetat, il avait franchi avec ses compagnons plus de cent lieues, en plein hiver, dans des pays de montagnes aux sentiers perdus sous les neiges ; souvent dans l'obscurité de la nuit, et dans le froid de la saison la plus rigoureuse qu'on eût, jamais vue, un hiver plus dur et plus froid que le fameux hiver de 1709 lui-même[124].
|