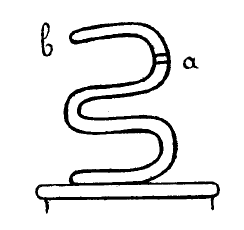NAPOLÉON III
Enfance - Jeunesse
LIVRE SIXIÈME. — SECOND SÉJOUR À LONDRES - L'ÉCHAUFFOURÉE DE BOULOGNE - HAM.
|
Le prince Louis arrivait à Londres avec une suite composée de sept personnes, parmi lesquelles M. Fialin de Persigny, les colonels Vaudrey et de Montauban et le docteur Conneau, Charles Thelin, auquel la reine Hortense, sur son lit de mort, avait recommandé de ne jamais quitter son fils, et Fritz Rickenbach, qui demeuraient ses serviteurs. Il a pour amis le duc de Bedford, Somerset, Beaufort, Montrose, Hamilton, le marquis de Londonderry, les comtes d'Eglinton, d'Evroll, de Scarborough, de Durham et de Chesterfield ; lord Fitz-Harris, dont il fut l'ami jusqu'à la mort ; les Grey, les Glengall, les lords Hugent, Carington, Combez, etc. Gore House devient le rendez-vous des beaux esprits du temps : le comte d'Orsay, M. Disraëli, sir Lytton Bulwer, sir Henry Holland, Dr Quin, Walker Savage, Laudas, Albany, Foulbanque. Le duc de Wellington a pour lui des attentions particulières, et les miladies se le disputent. Le Court Circular, le Morning Post, le Courrier, le Times, se font l'écho de ses succès en 1839 et 1840. Un jour, c'est le duc et la duchesse de Somerset qui donnent un grand dîner à Wimbledon Park en l'honneur de Son Altesse Royale le prince de Capoue et du prince Napoléon. Quand il va visiter la tour de Londres avec les colonels Vaudrey et Bouffet de Montauban, la garde est sur pied. A l'arsenal de Woolwich, les honneurs lui sont faits par lord Bloomfield et ses officiers. Visite-t-il la province ? Mêmes réceptions. A Legmington, le lord-lieutenant du château de Warwick organise à son intention des fêtes ; à Birmingham, à Manchester, à Liverpool, il est fêté avec toutes les marques du plus vif intérêt. Le prince est attendu aujourd'hui à Londres, où il assistera à l'ouverture du Parlement. Partout où il va, il est reçu par les notabilités. A Gore House l'attendent le comte de Durham, le comte de Scarborough, lord Carington, sir Lytton Bulwer, et un vieil ami, Alfred de Vigny, tous invités par le comte d'Orsay. (The Courrier.) Le prince habite d'abord Feuton's Hôtel, puis un hôtel situé à Waterloo Place, puis une maison appartenant à lord Cardigan : Carlton House, située dans un des plus beaux quartiers de Londres, sur une magnifique place entourée de jardins, entre Saint-James Park et Regent street, dans le voisinage des clubs United Service, Athœneum et Travellers. Carlton House a été construit sur l'emplacement de la célèbre demeure où se déroula longtemps la politique qui devait envoyer un jour l'Empereur à Sainte-Hélène. Avant la construction de Carlton House, ce fut sur son emplacement que l'on dressa la fameuse tente que l'on montre encore à Woobwich, et sous laquelle fut donnée, en 1815, la fête à laquelle assista l'empereur de Russie, fête qui n'avait d'autre but, pour la sainte alliance, que de célébrer le désastre de Waterloo. La pièce principale est un salon où l'on voit un buste de l'Empereur, de Canova, un portrait de l'impératrice Joséphine par Guérin, un autre de la reine Hortense, un médaillon en velours noir, renfermant les portraits de tous les princes et princesses de la famille impériale ; puis enfin, comme reliques : l'écharpe tricolore que le général en chef Bonaparte portait à la bataille des Pyramides, écharpe en cachemire, donnée par Napoléon à sa belle-fille à son retour d'Egypte ; l'anneau du couronnement que le pape Pie VII passa au doigt de l'Empereur pendant la cérémonie du sacre, anneau monté d'un magnifique rubis enchâssé lui-même dans un gros anneau d'or ; la bague que l'Empereur passa au doigt de l'impératrice Joséphine pendant la même cérémonie, composée de deux cœurs joints, l'un en saphir, l'autre en diamants, avec ces mots gravés à l'intérieur : Deux font Un ; les ordres que portait l'Empereur, la plaque de la Légion d'honneur, la croix de la Légion d'honneur — croix de simple soldat —, la croix de la couronne de fer ; un médaillon orné de deux portraits en miniature. celui de Napoléon d'un côté et celui de Marie-Louise de l'autre, tous deux peints par Isabey ; enfin le fameux talisman de Charlemagne, trouvé dans son tombeau à Aix-la-Chapelle, et remis par le clergé de la cathédrale qui, paraît-il, n'avait pas précisément le respect des tombes, à l'Empereur, au mois d'août 1804, lors du voyage qu'il fît dans l'ancienne capitale de l'empereur d'Occident. Il y restera jusqu'au mois de décembre 1839, époque à laquelle il acceptera l'hospitalité du comte de Ripon, à Carlston Gardens. Son personnel se compose alors de seize personnes. Il a une paire de chevaux de trait, un cheval pour son cab et deux chevaux de selle. Il conduit ou monte à cheval tout le jour, et Fritz remarque que son petit tigre fait la joie de son entourage. Parmi les fêtes où figura le prince, et dont il fut le plus parlé, on n'a pas oublié le fameux tournoi donné par le comte d'Eglinton, et que les pamphlétaires d'alors reprochèrent si longtemps au neveu de l'empereur. Nous devons signaler le duel qu'il faillit avoir avec le comte Léon. Le comte Léon, fils illégitime de l'Empereur, s'était rendu à Londres dans l'intention, dit-il dans son mémoire, de réclamer au roi Joseph l'exécution des dispositions faites par le cardinal Fesch en sa faveur. Il se présenta chez le comte de Sanillieu, chez le prince de Montfort et chez le prince Louis ; tous trois refusèrent de le recevoir. Piqué de l'insuccès de ses démarches, le comte écrivit au prince : Mon petit cousin, Il faut avouer que si j'ai mis bien de la patience à chercher à vous voir, vous avez mis, par contre, une impolitesse bien basse à ne pas me recevoir. Vous vous êtes permis d'interpréter en mauvais termes à mon désavantage, et sans m'avoir entendu, le refus de mon oncle Joseph de me voir. Je vous ai laissé plusieurs fois ma carte, et vous avez cru pouvoir vous abstenir de m'envoyer la vôtre. Ne pensez-vous pas, monsieur mon cousin, que votre conduite à mon égard soit offensante pour moi ? J'ai pu regarder les mauvais procédés et les écrits de MM. mes oncles Joseph et Jérôme comme malicieux, perfides et méchants ; à leur âge on se croit tout permis ; mais au vôtre, mon petit cousin, croyez-vous qu'il puisse en être de même ? Comme vous vous dites Français, vous devez sentir que mon honneur se trouve offensé de tant de déloyauté, et qu'il m'en faut une juste réparation. J'attendrai tant que vous vous voudrez, ou tant qu'il le faudra ; mais je vous jure, sur les cendres de l'empereur Napoléon, mon père, que vos mauvais procédés envers moi auront un jour leur châtiment. Si je me trompais, si vous n'avez pas une goutte de sang français dans les veines, par respect humain, vous devez me faire le renvoi de cette lettre ou en abuser à votre fantaisie ; je me résigne à tout. Sur ce, monsieur mon petit cousin, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Comte LÉON. Londres, 29 février 1840. P.-S. Je garde copie de cette lettre, et l'imprimerai avec beaucoup d'autres en temps utile. Le prince envoya le lendemain le commandant Parquin auprès du comte Léon pour lui faire savoir les raisons qui empêchaient la famille de l'Empereur d'avoir aucun rapport avec lui, et pour lui dire qu'aucune réponse n'était due à sa provocation, d'autant plus qu'elle ne reposait sur aucun fait personnel du prince, mais sur une résolution adoptée par toute la famille. A la suite de cette entrevue, le comte adressa cette seconde lettre au prince : Monsieur mon cousin, Un gros et grand monsieur, du nom de Parquin, sort de mon hôtel, après m'avoir dit, de votre part, que la lettre que je vous avais écrite avant-hier motivait bien votre refus de ne pas me voir. Vous comprenez que je ne devais rien répondre à un semblable langage, ce qui fît beaucoup rire les personnes qui étaient avec et à côté de moi. Vous abusez étrangement de ma lettre ; j'avais prévu cela ; aussi je suis obligé de vous répéter que la conséquence naturelle de cette bouffonne visite, est que vous n'avez pas une goutte de sang français dans les veines. Si un semblable messager se représente, je prierai M. Guizot, ambassadeur de France, de m'accompagner chez le magistrat. Je vous salue. Comte LÉON. Londres, le 2 mars 1840. Le prince Louis ne répondit pas davantage à cette seconde lettre, et il eut raison. Le lendemain, le lieutenant-colonel Ratcliffe, commandant le 6e dragons, officier estimé de l'armée anglaise, s'étant présenté pour renouveler la provocation, le prince n'hésita plus. La rencontre fut décidée pour le lendemain. Les témoins du prince furent MM. le comte Alfred d'Orsay et le commandant Parquin ; ceux du comte, le colonel anglais et une autre personne. Dans la soirée, MM. d'Orsay et Parquin eurent une entrevue avec les témoins de M. le comte de Léon. Il fut alors réglé par le colonel Ratcliffe et par moi, dit M. Parquin, dans une lettre publiée par le Capitole, que le prince, ayant été provoqué, avait le choix des armes ; et, après avoir fixé l'heure et le lieu du combat, nous nous séparâmes vers minuit. Le lendemain, nous étant rendu, avec le prince, à sept heures du matin, à Wimbleton Commons, et le colonel Ratcliffe ayant déclaré que le prince avait le choix des armes, le prince choisit l'épée. Je présentai donc deux épées aux deux adversaires ; mais le comte Léon refusa cette arme. Étonné de son refus, je lui demandai s'il ne savait pas tirer l'épée, il me répondit qu'il savait tirer, qu'il ne voulait pas se battre à l'épée, mais au pistolet. Cette circonstance éleva une contestation assez longue, dans laquelle je ne cachai pas à M. Léon les sentiments que me faisaient éprouver son refus. Voulant cependant arriver promptement à un résultat, le comte d'Orsay et moi nous proposâmes de tirer au sort le choix des armes. Le colonel Ratcliffe nous remercia de la générosité de notre proposition ; mais le comte Léon la repoussa encore. Dans un tel état de choses, nous ne pouvions ni ne devions faire de nouvelles concessions ; mais le prince Napoléon nous déclara qu'ennuyé de ce refus, il préférait accepter le pistolet plutôt que de prolonger une telle discussion ; c'est après de longs délais, et lorsqu'on allait charger les pistolets, que la police intervint et mit fin à cette affaire, qui, sans les refus successifs du prince Léon, eût eu des résultats différents ; car si M. Léon se fût rendu aux décisions des témoins, on aurait eu tout le temps de se battre. Conduits chez les magistrats de police, adversaires et témoins durent fournir caution pour conserver leur liberté. Malgré les distractions qui. l'entouraient, le prince Louis ne perdait pas de vue le but qu'il poursuivait. Outre ses camarades de plaisirs, étaient ses amis politiques, qui l'eussent, au besoin, rappelé à l'ordre. C'est à leurs conseils qu'il cède en publiant, au commencement de 1840, les Idées Napoléoniennes, dont le but était de défendre la mémoire de l'Empereur par ses écrits, d'éclairer l'opinion en recherchant la pensée qui avait présidé à ses conceptions, de rappeler ses projets, tâche, disait-il, qui sourit encore à mon cœur et qui me console de l'exil. Un extrait suffira pour donner une idée de l'ensemble de l'œuvre. L'Empereur Napoléon a contribué plus que tout autre à accélérer le règne de la liberté, en sauvant l'influence morale de la Révolution et en diminuant les craintes qu'elle inspirait. Sans le Consulat et l'Empire, la Révolution n'eût été qu'un grand drame qui laisse de grands souvenirs, mais peu de traces. La Révolution se serait noyée dans la contre-révolution, tandis que le contraire a eu lieu, parce que Napoléon enracina en France et introduisit partout en Europe les principaux bienfaits de la grande crise de 89, et que, pour nous servir de ses expressions, il débrouilla la Révolution, affermit les rois et ennoblit les peuples. Il débrouilla la Révolution, en séparant les vérités qu'elle fît triompher des passions qui, dans leur délire, les avaient obscurcies ; il raffermit les rois en rendant le pouvoir honoré et respectable ; il ennoblit les peuples, en leur donnant la conscience de leur force, et ces institutions qui relèvent l'homme à ses propres yeux. L'Empereur doit être considéré comme le Messie des idées nouvelles. Il rétablit la religion, mais sans faire du clergé un moyen de gouvernement. Aussi le passage de la République à la Monarchie et le rétablissement des cultes, au lieu d'éveiller des craintes, rassurèrent les esprits, car, loin de froisser aucun intérêt, ils satisfaisaient à des besoins politiques et moraux et répondaient au vœu du plus grand nombre. En effet, si ces transformations n'eussent pas été dans les sentiments et les idées de la majorité, Napoléon ne les aurait pas accomplies, car il devinait juste, et son pouvoir moral il voulait l'augmenter et non l'affaiblir. Aussi jamais de si grands changements ne se firent avec moins d'efforts. Napoléon n'eut qu'à dire : Qu'on ouvre les églises ! et les fidèles s'y précipitèrent à l'envi. Il dit à la nation : Voulez-vous un pouvoir héréditaire ! et la nation répondit affirmativement par quatre millions de votes. Quelques personnes veulent révoquer en doute la légitimité d'une telle élection ; mais elles attaquent ainsi toutes les constitutions de la République, car ces constitutions n'obtinrent pas même une sanction aussi forte. Constitution de 1791, non soumise à l'acceptation du peuple :
Le prince offrit un exemplaire des Idées Napoléoniennes à Bulwer Lytton, lequel exemplaire est dans la bibliothèque de Knebworth. On lit sur le titre : A Sir Bulwer Lytton. Souvenir de la part de l'auteur. Napoléon-Louis B. A cette époque, le roi Louis-Philippe, auquel on reprochait d'aimer exagérément la paix — les peuples ont parfois la nostalgie des abattoirs —, chargea M. Thiers d'organiser un ministère de combat. Il s'agissait de faire revivre l'épopée napoléonienne — excusez du peu ! — et de débuter par une descente en Angleterre. Restait le moyen d'engager la lutte. Le gouvernement imagina de réclamer les cendres de Napoléon Ier. L'Angleterre, peu facile à amuser, fut prise d'une gaieté folle et décidée de répondre plaisamment à une réclamation qu'elle avait — étant données les circonstances — tout lieu de considérer comme une plaisanterie, prévint les réclamants qu'elle tenait à leur disposition le corps du prisonnier de Sainte-Hélène. Victime de l'humour de lord Palmerston, Louis-Philippe dut se résigner à tomber dans son propre piège. La légende napoléonienne avait tout à gagner dans la circonstance. Le 12 mai, la Chambre des députés reçut l'avis officiel qu'un des fils du roi, le prince de Joinville, partait pour Sainte-Hélène et qu'il ramènerait en France le cercueil du grand homme. L'Angleterre y ayant mis cette bonne volonté, à la grande colère des légitimistes et des républicains, le gouvernement espéra compliquer les choses en s'arrangeant de façon à ce que l'on ne s'entendît pas sur l'endroit où serait déposé le cercueil. Battu encore sur ce terrain, et ayant appris que le roi Joseph voulait que certaines reliques du grand homme, ayant appartenu au général Bertrand, fussent offertes à la nation, Louis-Philippe fit entendre que lui seul devait en rester possesseur. C'est ainsi que le comique peut intervenir dans les actions des hommes, même quand elles ont pour origine les plus glorieux souvenirs. Le Roi l'ayant emporté, le roi Joseph envoya une protestation à laquelle le Prince Louis — ne perdant pas une occasion de s'adresser à l'opinion — s'associa dans les termes suivants : Je m'associe du fond de l'âme à la protestation de mon oncle Joseph. Le général Bertrand, en remettant les armes de ma famille au roi Louis-Philippe, a été la victime d'une étrange illusion. L'épée d'Austerlitz ne doit pas être en des mains ennemies ; il faut qu'elle puisse être encore tirée au jour du danger pour la gloire de la France ! Qu'on nous prive de notre patrie, qu'on retienne nos biens, qu'on ne se montre généreux qu'envers les morts, nous savons souffrir sans nous plaindre, tant que notre honneur n'est pas attaqué ; mais donner à un heureux de Waterloo les armes du vaincu, c'est trahir les devoirs les plus sacrés, c'est forcer les opprimés de dire aux oppresseurs : Rendez-nous ce que vous avez usurpé. LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Londres, 9 janvier 1840. L'argument ne manquait pas de grandeur. Le prince dont la révolte avait, cette fois, sa raison d'être, réunit tous ses amis. Il leur explique l'impossibilité de laisser passer mi tel défi sans vengeance. L'année précédente il avait en vain subventionné — le château d'Arenenberg en avait payé les frais — un journal intitulé : le Capitole. Ce qu'il fallait, c'était recourir aux actes, comme à Strasbourg. L'entourage du prince est de son avis. Le neveu de l'Empereur, loue à la société commerciale de Londres, un bateau à vapeur, le Château d'Edimbourg, sous prétexte d'une excursion sur les côtes d'Ecosse. Il s'embarque à Londres, le 4 août. Le 5, il est devant Boulogne. La suite est trop connue pour que nous y insistions. Voilà donc les conjurés arrêtés au nombre de soixante-quinze. Le prince Louis proteste contre son enlèvement, comme il avait déjà fait à Strasbourg, et la protestation ne manque pas d'une certaine gaieté. Le gouvernement commet la sottise, au lieu de livrer le prince à la justice ordinaire du pays, de le traduire devant la Chambre des Pairs, transformée en haute cour de justice. Le prince est écroué au château de Ham. Le 15, on le transfère à Paris et on le dépose provisoirement à la préfecture de police. Devant un second échec, on juge de la colère des oncles toujours pétitionnant auprès du roi Louis-Philippe. Tandis que le prince Jérôme s'en ouvrait à M. Thiers, les journaux publiaient la lettre suivante : Florence, 24 août 1840. Monsieur, Permettez que je vous prie de recevoir la déclaration suivante : Je sais que c'est un singulier moyen et peu convenable que celui de recourir à la publicité ; mais quand un père affligé, vieux, malade, légalement expatrié, ne peut venir autrement au secours de son fils malheureux, un semblable moyen ne peut qu'être approuvé par tous ceux qui portent un cœur de père. Convaincu que mon fils, le seul qui me reste, est victime d'une infâme intrigue et séduit par de vils flatteurs, de faux amis et peut-être par des conseils insidieux, je ne saurais garder le silence sans manquer à mon devoir et m'exposer aux plus amers reproches. Je déclare donc que mon fils Napoléon-Louis est tombé pour la troisième fois dans un piège épouvantable, dans un effroyable guet-apens, puisqu'il est impossible qu'un homme qui n'est pas dépourvu de moyens et de bon sens, se soit jeté de gaieté de cœur dans un tel précipice. S'il est coupable, les plus coupables et les véritables sont ceux qui l'ont séduit et égaré. Je déclare surtout avec une sainte horreur que l'injure que l'on a faite à mon fils en l'enfermant dans la chambre d'un infâme assassin, est une cruauté monstrueuse, antifrançaise, un outrage aussi vil qu'insidieux. Comme père profondément affligé, comme bon Français éprouvé par trente années d'exil, comme frère, et, si j'ose le dire, élève de celui dont on redresse les statues, je recommande mon fils égaré et séduit à ses juges et à tous ceux qui portent un cœur français et de père. Louis DE SAINT-LEU. Nous avons reproduit cette lettre en entier, parce qu'elle donna lieu à bien des commentaires. Les uns se demandèrent à quels conseils insidieux avait bien pu céder le prince, et mirent en avant le nom de M. de Persigny ; les autres affirmèrent que le roi Louis faisait allusion au général Magnan. Pendant un mois, les suppositions allèrent leur train. La vérité est que la lettre de Louis de Saint-Leu était une lettre apocryphe. Le fait nous a été affirmé par des intimes de Napoléon III. Aussi bien, il existe une preuve, c'est la lettre suivante — actuellement en possession de l'Impératrice Eugénie — adressée au roi Louis par son fils, et rédigée dans un sens démontrant suffisamment que le prince n'ajoutait pas foi au document inventé par un mystificateur ou un ami maladroit. A la Conciergerie, 6 septembre 1840. Mon cher père, Je ne vous ai pas encore écrit, parce que je craignais de vous affliger. Mais aujourd'hui que j'ai appris l'intérêt que vous m'avez témoigné, je viens vous en remercier et vous demander votre bénédiction comme la seule chose à laquelle j'attache du prix maintenant. Dans mon malheur, ma plus douce consolation est d'espérer que vos pensées se tournent quelquefois vers moi. Je supporterai jusqu'au bout avec courage le sort qui m'attend fier de la mission que je me suis imposée, je me montrerai toujours digne du nom que je porte et digne de votre affection. A quelle peine s'attendait le prince Louis ? L'autorisation lui ayant été accordée de garder avec lui son valet de chambre, il y avait des chances pour qu'il eût au moins la vie sauve. On affirme que l'espérance lui en avait été donnée par le président de la Cour de Paris, durant les premiers interrogatoires à huis clos. Quant à liberté de fuir en Amérique, comme la première fois, il ne fallait plus y songer. Aussi, dès le mois d'août, prenait-il ses précautions, ainsi que le démontre la lettre suivante, écrite par Ch. Thélin, lettre actuellement en possession de M. B. Jerrold : Paris, à la Conciergerie, 21 août 1840. Mon cher Fritz, Tu as dû remettre à M. Farquhart la lettre que le prince t'a laissée en partant. Elle contenait ses instructions pour tout vendre. Il faut en excepter les effets de toilette de S. A. et de chacune des personnes qui en ont laissé. Quant au cabriolet avec le cheval et les deux harnais et le fusil de chasse, M. Farquhart t'aura sans doute déjà dit que le prince lui en avait fait cadeau. Le prince pense aussi que les filles de chambre et de cuisine ont été congédiées et qu'elles ont eu un mois de gratification. Tu resteras seul jusqu'à nouvel ordre dans la maison avec la fille de chambre de lord Ripon. Le prince t'accorde 4 livres sterling par mois en plus de tes appointements, pour ta nourriture. Tu conserveras tous les journaux anglais depuis le départ du prince, pour les lui remettre lorsqu'il les demandera. Sur les effets des personnes qui étaient logées en ville, mets les noms sur les malles ou paquets et conserve-les dans la maison. Arrange les effets de chacun de manière à pouvoir les envoyer dès que tu en recevras l'ordre. Tu feras en, sorte que les logements de ces messieurs soient payés. Préviens aussi tous les fournisseurs de la maison, de s'adresser à M. Farquhart pour ce qui peut leur être dû. Tu achèteras deux malles en cuir du prix de 3 livres sterling l'une. Tu y placeras tout de suite tous les effets que tu trouveras dans l'armoire de la chambre à coucher de Son Altesse, avec les deux paires de draps, les deux taies d'oreiller et les serviettes de la même chambre qui sont marquées d'un N couronné. Tu y joindras aussi les deux petits nécessaires de toilette, tous les rasoirs, les paletots, les bottes, souliers, etc. Les deux malles doivent être prêtes pour partir au premier ordre. Tu prendras pour toi le vieil habit de chasse rouge, la culotte de peau et les culottes blanches, les grandes bottes, la grosse redingote verte, le pantalon pareil, et les souliers de chasse, la grosse redingote brune, les deux vieilles du matin et les chapeaux. Tu en trouvera (sic) un tout neuf dans le Dressing-room. J'ai laissé dans ma chambre une malle en cuir qui contient mes effets. Tu trouveras dans un tiroir de commode une petite boîte où sont renfermés des papiers et autres choses auxquelles je tiens beaucoup. Prends-en bien soin. J'ai aussi dans mon armoire de la toile pour chemises. Conserve-moi mon paletot, les pantalons s'il y en a, et mon petit nécessaire. Fais du reste ce que tu voudras. Adieu, mon cher ami, le prince se porte bien. Ch. THÉLIN. Pendant ce temps, la procédure avançait. La Cour se réunit, sous la présidence du chancelier Pasquier, pour se constituer, recevoir l'ordonnance royale, entendre le réquisitoire de M. Persil, et nommer une commission d'instruction. Le chancelier avait délégué pour l'assister MM. le duc de Cazes, le comte Portalis, le baron Giraud (de l'Oise) et le maréchal Gérard. La Cour dé Paris se réunit de nouveau pour entendre la lecture de M. Persil. Nous passons le procès, dont les détails ont été cent fois racontés, pour nous en tenir au discours du prince. Pour la première fois de ma vie, il m'est enfin permis d'élever la voix en France et de parler librement à des Français. Malgré les gardes qui m'entourent, malgré les accusations que je viens d'entendre, plein des premiers souvenirs de ma première enfance, en me trouvant dans les murs du Sénat, au milieu de vous que je connais, messieurs, je ne peux croire que j'aie ici besoin de me justifier, ni que vous puissiez être mes juges. Une occasion solennelle m'est offerte d'expliquer à mes concitoyens ma conduite, mes intentions, mes projets, ce que je pense, ce que je veux. Sans orgueil, comme sans faiblesse, si je rappelle les droits déposés par la nation dans les mains de ma famille, c'est uniquement pour expliquer les devoirs que ces droits nous ont imposés à tous. Depuis cinquante ans que le principe de la souveraineté du peuple a été consacré en France par la plus puissante révolution qui se soit faite dans le monde, jamais la volonté nationale n'a été proclamée aussi solennellement, n'a été constatée par des suffrages aussi nombreux et aussi libres que pour l'adoption des constitutions de l'Empire. La nation n'a jamais révoqué ce grand acte de sa souveraineté, et l'Empereur l'a dit : Tout ce qui a été fait sans elle est illégitime. Aussi, gardez-vous de croire que, me laissant aller aux mouvements d'une ambition personnelle, j'ai voulu tenter en France, malgré le pays, une restauration impériale. J'ai été formé par de plus hautes leçons, et j'ai vécu sous de plus nobles exemples. Je suis né d'un père qui descendit du trône, sans regret, le jour où il ne jugea plus possible de concilier, avec les intérêts de la France, les intérêts du peuple qu'il avait été appelé à gouverner. L'Empereur, mon oncle, aima mieux abdiquer l'Empire que d'accepter par des traités les frontières restreintes qui devaient exposer la France à subir les dédains et les menaces que l'étranger se permet aujourd'hui. Je n'ai pas respiré un jour dans l'oubli de tels enseignements. La proscription imméritée et cruelle qui pendant vingt-cinq ans a traîné ma vie des marches du trône sur lequel je suis né, jusqu'à la prison d'où je sors en ce moment, a été impuissante à irriter comme à fatiguer mon cœur ; elle n'a pu me rendre étranger un seul jour à la dignité, à la gloire, aux droits, aux intérêts de la France. Ma conduite, mes convictions s'expliquent. Lorsqu'en 1830, le peuple a reconquis sa souveraineté, j'avais cru que le lendemain de la conquête serait loyal, comme la conquête elle-même, et que les destinées de la France étaient à jamais fixées ; mais le pays a fait la triste expérience des dix dernières années. J'ai pensé que le vote de quatre millions de citoyens qui avaient élevé ma famille, nous imposait au moins le devoir de faire appel à la nation, et d'interroger sa volonté ; j'ai cru même que si au sein du congrès national que je voulais convoquer, quelques prétentions pouvaient se faire jour, j'aurais le droit d'y réveiller les souvenirs éclatants de l'Empire, d'y parler du frère aîné de l'Empereur, de cet homme vertueux qui, avant moi, en est le digne héritier, et de placer en face de la France aujourd'hui affaiblie, passée sous silence dans le congrès des rois, la France d'alors si forte au dedans, au dehors si puissante et si respectée. La nation eût répondu : République ou monarchie, empire ou royauté. De sa libre décision dépend la fin de nos maux, le terme de nos discussions. Quand à mon entreprise, je le répète, je n'ai point eu de complices. Seul j'ai tout résolu ; personne n'a connu à l'avance ni mes projets, ni mes ressources, ni mes espérances. Si je suis coupable envers quelqu'un, c'est envers mes amis seuls. Toutefois, qu'ils ne m'accusent pas d'avoir abusé légèrement de courages et de dévouements comme les leurs. Ils comprendront les motifs d'honneur et de prudence qui ne me permettent pas de révéler à eux-mêmes combien étaient étendues et puissantes mes raisons d'espérer un succès. Un dernier mot, messieurs. Je représente devant vous un principe, une cause, une défaite. Le principe, c'est la souveraineté du peuple ; la cause, celle de l'empire ; la défaite, Waterloo. Le principe, vous l'avez reconnu ; la cause, vous l'avez servie ; la défaite, vous voulez la venger. Non, il n'y a pas de désaccord entre vous et moi, et je ne veux pas croire que je puisse être dévoué à porter la peine des défections d'autrui. Représentant d'une cause politique, je ne puis accepter comme juge de mes volontés et de mes actes une juridiction politique. Vos formes n'abusent personne. Dans la lutte qui s'ouvre, il n'y a qu'un vainqueur et un vaincu. Si vous êtes les hommes du vainqueur, je n'ai pas de justice à attendre de vous, et je ne veux pas de votre générosité. L'arrêt fut prononcé. Il condamnait : Le prince Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, à l'emprisonnement perpétuel dans une forteresse située sur le territoire continental du royaume ; Jean-Baptiste-Charles Aladenize, à la peine de la déportation ; Charles-Tristao, comte de Motholon, Denis-Charles Parquin, Jules-Barthélemy Lombard, Jean-Gilbert-Victor Fialin, dit de Persigny, Chacun à vingt années de détention ; Séverin-Louis Le Duff de Mésouan, à quinze années de détention ; Jean-Baptiste Voisin, Jean-Baptiste-Théodore Forestier, Napoléon Ornano, Chacun à dix années de détention ; Hyppolyte-François-Athale-Sébastien Bouffet, Montauban, Martial-Eugène Bataille, Joseph Orsi, Chacun à cinq années de détention ; Henri Conneau, à cinq années de détention ; Etienne Laborde, à deux années d'emprisonnement. Les autres accusés étaient absous. Un seul pair, M. d'Alton-Shée, avait voté la mort. Avant de quitter Paris, le prince remercia son' défenseur, M. Berryer, en ces termes : Paris, 6 octobre 1840. Mon cher monsieur Berryer, Je ne veux pas quitter Paris, sans vous renouveler tous mes remerciements pour les nobles services que vous m'avez rendus pendant mon procès. Dès que j'ai su que je serais traduit devant la Cour des Pairs, j'ai eu l'idée de vous demander de me défendre, parce que je savais que l'indépendance de votre caractère vous mettait au-dessus des petites susceptibilités de parti, et que votre cœur était ouvert à toutes les infortunes, comme votre esprit était apte à comprendre toutes les grandes pensées, tous les nobles sentiments. Je vous ai donc pris par estime ; maintenant, je vous quitte avec reconnaissance et amitié. J'ignore ce que le sort me réserve, j'ignore si jamais je serai dans le cas de vous prouver ma reconnaissance, j'ignore si vous voudrez en accepter des preuves ; mais, quelles que soient nos positions réciproques, en dehors de la politique et de ses désolantes obligations, nous pouvons toujours avoir de l'estime et de l'amitié l'un pour l'autre ; et je vous avoue que si mon procès ne devait avoir eu d'autres résultats que de m'attirer votre amitié, je croirais encore avoir immensément gagné et je ne me plaindrais pas de mon sort. Adieu, mon cher Berryer ; recevez l'assurance de mes sentiments d'estime et de reconnaissance. LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Quelques jours après, le prince partait pour Ham ; trois personnes devaient partager sa captivité, le général Montholon, le docteur Conneau et Charles Thélin, son valet de chambre. Nous avons retrouvé la façon dont le prince Louis organisa son existence. Il se lève, lisons-nous dans une note en possession d'un de ses anciens intimes, à six heures et travaille jusqu'à l'heure du déjeuner, fixée à dix heures. Ce repas terminé, il se promène sur les remparts, puis reprend ses travaux jusqu'à dîner. Partie de whist ou d'échecs. Coucher. Ajoutons qu'il avait à sa disposition tous les livres qu'il demandait — nous en aurons la preuve tout à l'heure — et qu'il était autorisé à correspondre avec ses amis, des hommes d'Etat, des savants, des littérateurs : MM. Odilon et Ferdinand Barrot, Chateaubriand, maréchal Soult, Cormenin, Lamartine, Béranger, Belmontet, Georges Sand, etc. Nous avons sous les yeux la correspondance qu'il écrivit alors et qui est demeurée la propriété de l'Impératrice Eugénie. Il nous suffira de la reproduire par ordre chronologique pour tenir le lecteur, mieux que quiconque ne saurait le faire, au courant des occupations du prisonnier. Ham, le 13 janvier 1841. Mon cher monsieur Vieillard, Comme pour me faire passer le temps, je m'occupe de trente-six mille choses à la fois, je viens vous prier de me rendre un service. Vous savez qu'une des questions les plus difficiles à résoudre pour les fusils à percussion, c'est de trouver la façon d'amorcer d'une manière facile et simple, et comme je crois avoir trouvé cette manière, je vous prierai de m'envoyer environ deux cents capsules de fusils de guerre — non de celles de chasse ; elles sont trop petites —. Les capsules de guerre ont environ quatre lignes de diamètre... Ham, 20 février 1841. Mon cher monsieur Vieillard, Je vous remercie bien des capsules que vous avez eu la bonté de m'envoyer. J'ai maintenant terminé le peu d'expériences que je pouvais faire, et j'ai rédigé un mémoire que je compte envoyer au Ministre de la guerre... Ce qui m'occupe maintenant beaucoup, et ce qui a avantageusement remplacé les capsules, c'est le jardinage. J'ai pu sur une courtine, labourer un petit espace de terre, et j'y plante forces graines et arbustes. Ce plaisir que je trouve à remuer quelques mètres cubes de terre, me fait penser que notre nature a bien des ressources et des consolations inconnues à ceux qui furent toujours heureux. Quand nous perdons un sens, la Providence a voulu que sa perte nous fût compensée par la perfection qu'acquièrent les sens qui nous restent. De même, celui qui a perdu sa liberté, retrouve dans les murs de sa prison, au dedans de son étroite atmosphère, des sources de jouissances qu'il méprisait lorsque libre il foulait, indistinctement sous ses pieds, les germes de peine comme les germes de bonheur. J'apprends que ce bon M. Dupaty est gravement malade. Ayez la bonté d'aller demander de ses nouvelles de ma part et de lui dire, si vous pouvez le voir, combien je m'intéresse à sa santé. Ham, le 20 mars 1841. Il est décidé que chaque fois que je vous écrirai, je vous entretiendrai d'un nouveau sujet, et que ce sujet sera pour le moment le but principal de mes pensées. J'ai mis de côté les idées militaires ; mon jardin est planté et je me suis fourré dans l'histoire d'Angleterre, sur laquelle je fais un travail qui m'intéresse beaucoup. J'ai lu Hume et Smollet, Guizot, Villemin et Boulay de la Meurthe ; mais je voudrais maintenant une histoire plus détaillée du règne de Guillaume III. Tâchez, je vous prie, de me la procurer, mais, si vous ne pouvez y parvenir, ayez la bonté de rechercher à quelle époque le procès de lord Stafford, exécuté sous Charles II, a été annulé ; et si la mémoire de Sidney et de lord Russel, mis à mort à la même époque, fut réhabilitée par les Parlements suivants. Je voudrais avoir aussi la copie textuelle du discours d'ouverture de Guillaume III au Parlement du 13 décembre 1701... J'ai besoin de ces renseignements pour le travail que je fais et auquel je me livre avec ardeur, comme à tout ce que j'entreprends avec plaisir. Ici la correspondance avec M. Vieillard s'interrompt pour laisser place à une lettre de protestation contre les rigueurs de l'autorité. Citadelle de Ham, 22 mai 1841. Pendant les neuf mois que j'ai passés dans les mains du gouvernement français, je me suis patiemment soumis à ses indignes traitements en tous genres, je ne veux pas, cependant, garder un plus long silence qui semblerait une adhésion aux mesures oppressives dont je suis l'objet. Ma position doit être considérée sous deux points de vue : l'un moral, l'autre légal. Quant au premier, le gouvernement qui a reconnu le légitimé du chef de ma famille, est forcé de me reconnaître comme prince et de me traiter comme tel. La politique a des droits que je ne prétends pas contester : que le gouvernement agisse à mon égard comme envers un ennemi, qu'il me prive des moyens de lui nuire, je n'aurai pas à me plaindre ; mais sa conduite sera inconséquente s'il me traite comme un prisonnier ordinaire, moi, fils de roi, neveu d'un empereur et allié à tous les souverains de l'Europe... Quand j'en appelle aux alliances étrangères, je n'ignore pas qu'elles n'ont jamais protégé le vaincu, et que le malheur brise tous les nœuds ; mais le gouvernement français devrait reconnaître le principe qui m'a fait ce que je suis, car c'est par ce principe qu'il existe lui-même. La souveraineté du peuple a fait mon oncle empereur, mon père roi, et m'a fait prince français par ma naissance. N'ai-je donc pas droit au respect et aux égards de tous ceux pour qui la voix d'un grand peuple, la gloire et l'infortune sont quelque chose ? Si, pour la première fois de ma vie, je m'appuie sur le hasard qui a présidé à ma naissance, c'est que la fierté convient à ma position actuelle, et que j'ai acheté les anciennes faveurs du sort, au prix de vingt-sept ans de souffrances et de chagrins. En ce qui touche ma position légale, la Cour des Pairs a créé pour moi une pénalité exceptionnelle. En me condamnant à un emprisonnement perpétuel, on n'a fait que légaliser le décret du destin, qui voulait que je fusse prisonnier de guerre. On a essayé d'adoucir la politique par l'humanité, en m'affligeant la peine la moins dure pour le plus long temps possible. Durant les premiers mois de ma captivité, toute espèce de communication avec le dehors m'était interdite, et, au dedans, j'étais astreint à l'isolement le plus complet. Depuis que plusieurs personnes ont été autorisées à me voir, ces mesures restrictives d'intérieur ne peuvent plus avoir d'objet, et c'est cependant lorsqu'elles sont devenues inutiles qu'on affecte d'en augmenter la rigueur. Tout ce qui sert à mon usage personnel, chaque jour, est soumis à l'examen le plus minutieux. Le zèle de mon unique et fidèle serviteur, qui a été autorisé à me suivre, est entravé par des obstacles de toutes espèces. Un tel système de terreur a été mis en œuvre dans la garnison et parmi les employés du château, au point que nul n'ose lever les yeux sur moi, et qu'il faut à un homme beaucoup de courage pour être simplement poli. Comment en serait-il autrement, lorsqu'un regard est considéré comme un crime, et que ceux qui voudraient adoucir ma position, sans manquer à leur devoir, sont dénoncés à l'autorité et menacés de perdre leur place ? Au milieu de cette France que le chef de ma famille a rendue si grande, je suis traité comme l'était un excommunié au XVIe siècle. Chacun fuit à mon approche, et l'on semble redouter mon contact comme si mon souffle même était contagieux. Cette insultante inquisition qui me poursuit même jusque dans ma chambre, qui s'attache à mes pas lorsque je vais respirer l'air dans un coin du fort, ne s'arrête pas à ma personne ; elle veut encore pénétrer jusqu'à mes pensées. Les effusions de mon cœur, dans les lettres que j'adresse à ma famille, sont soumises au plus sévère contrôle ; et si quelqu'un m'écrit en caractères trop sympathiques, la lettre est confisquée, et son auteur dénoncé au gouvernement. Par une foule de moyens trop longs à énumérer, il semble que l'on prenne à tâche de me faire sentir ma captivité a chaque minute du jour, et de faire retentir à mes oreilles ce cri funèbre et incessant : Malheur aux vaincus ! On remarquera qu'aucune des mesures dont je parle n'a été pratiquée à l'égard des ministres de Charles X, dont j'occupe aujourd'hui le triste appartement. Et cependant, ces ministres n'étaient pas nés sur les marches d'un trône ; ils n'avaient pas été condamnés à un simple emprisonnement, leur suprême sentence paraissait devoir les destiner à un sort plus rigoureux que le mien. Enfin, ils ne représentaient pas une cause que la France entoure d'un souvenir de vénération. Le traitement que j'endure est donc à la fois injuste, illégal et inhumain. Si l'on croit arriver ainsi à me réduire, on se trompe. Ce n'est pas l'outrage, c'est la bienveillance qui subjugue les cœurs de ceux qui savent souffrir. LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. On fit droit en partie à la réclamation du prince. Sa prison fut restaurée. M. de Rémusat, ministre de l'intérieur, mit, à cet effet, à la disposition du commandant-directeur de la prison, la somme de 600 francs. C'était, en bonne justice, tout ce qu'il pouvait faire. La plupart des travaux du prisonnier parurent dans le Progrès du Pas-de-Calais, journal d'opposition, qui, durant le règne de Louis-Philippe, fut vingt-neuf fois poursuivi. Le rédacteur en chef, dit M. A. Morel, était M. Frédéric Degeorge, républicain énergique, homme de conviction profonde, et qui, dans la suite, désespéré d'avoir soutenu la candidature de Louis-Napoléon à la présidence, éperdu, humilié, outré de voir réussir le coup d'Etat de 1851, perdit la raison. Le Progrès, le Journal de Maine-et-Loire, le Guetteur, lui ouvrirent également leurs colonnes. La Revue de l'Empire publia l'Idéal, imité de Schiller ; L'Adresse aux mânes de l'Empereur, A quoi tiennent les destinées des empires, Réponse à monsieur de Lamartine. Le prince Louis semblait infatigable. Parurent successivement : L'Exil, Quelques mots sur Joseph-Napoléon Bonaparte, qui venait de mourir à Florence ; Fragments historiques (1688 et 1830), où il établit la cause de la Révolution qui, vers la fin du XVIIe siècle, a remplacé les Stuarts par une autre dynastie, et où il examine si une révolution analogue, opérée en France au XIXe siècle, nous aurait procuré des avantages analogues. Après la publication des Fragments historiques, il songe à une étude sur Charlemagne. Ma chère filleule, écrit-il à Mme Cornu, en date du 8 juin 1841, c'est-à-dire quelques jours après la publication des Fragments historiques, j'ai maintenant en tête un grand projet : c'est d'écrire la vie de Charlemagne. Il la prie de faire demander au professeur Schlosser, à Heidelberg, la liste des ouvrages allemands ou des chroniques qu'il faudrait rassembler pour un pareil ouvrage. En date du 30 juillet, il signale son enchantement à propos de l'histoire anglaise de Charlemagne du docteur James. Le 8 août il revient sur son sujet. Vous n'avez pas deviné mon intention sur l'histoire de Charlemagne. Je persiste toujours à l'écrire. Si j'avais trouvé dans celle de James mon but accompli, il est clair que j'aurais abandonné mon ouvrage, mais la pensée qui me dirige est bien différente. C'est un grand exemple politique et philosophique que je veux montrer comme preuve d'une grande vérité. D'ailleurs j'ai eu tort de dire que l'histoire du Dr James était superbe ; elle est très bien écrite ; elle est remplie d'idées profondes et vraies ; l'auteur fait preuve d'une grande érudition et d'une grande perspicacité, mais il y a une absence complète de réflexions et de déductions philosophiques. Ce ne sont pas seulement les actions d'un grand homme qu'il importe de connaître, c'est surtout l'influence de ces actions sur les contemporains et sur l'époque qui l'a suivi. Mon histoire de Charlemagne se résumera dans la situation des questions suivantes : 1° Quel était l'état de l'Europe avant Charlemagne ? — 2° Quelles furent les modifications qu'y apporta Charlemagne ? — 3° Quelle influence ce grand homme exerça-t-il sur les générations qui le suivirent ? Je ne puis traiter des questions d'histoire moderne qu'en disant la vérité ; or, cette vérité choque toutes les opinions, car on déteste toute vérité qui choque votre système de prédilection. Il est donc plus politique de me rejeter dans un passé qui n'excite plus ces passions... Quelques jours plus tard il demande à Mme Cornu de lui rapporter d'Allemagne tous les renseignements qu'elle pourra trouver sur Charlemagne. N'oubliez pas de consulter surtout M. Schlosser. Je voudrais aussi savoir une chose. Vous savez que Charlemagne conçût le projet d'unir le Rhin au Danube, en réunissant les eaux de la Reidnitz et de l'Atmühl par un canal. Ce projet, dit James, semblait offrir de grandes facilités, car l'état du Danube, à cette époque, était bien différent de ce qu'il est maintenant. En quoi consiste cette différence ? Voilà ce que je voudrais savoir. Son site a-t-il donc changé du côté de Bamberg ? Le 5 janvier 1842 il la prie de lui acheter : Einhardi viti Caroli Magni, édition Ideler, de Berlin ; Leben and Wandel Karls des Grossen, Hamburg, bei Perthes, 1839 ; Alcuin's Leben, von fr. Lorentz, Halle, 1839 ; Dippolt, Leben Kaiser Karls des Grossen, Tabingen, 1812 ; Ellendorff, Die Karolinger und die Hierarchie ihrer Zeit, Essen, 1838. Le prince Louis ne poursuit pas son projet. Il a maintenant en tête des travaux de chimie. Ham, 17 décembre 1841. Je vous remercie bien de l'empressement que vous avez mis à me procurer les renseignements que je vous demandais ; ils m'ont fait grand plaisir. Je ne regrette que la peine que vous vous êtes donnée. Ayez la bonté de m'envoyer à la même adresse, les tableaux dont vous me parlez, et lorsque vous me répondrez, dites-moi encore une chose : combien y avait-il dans le tube que vous avez vu, de gaz acide carbonique liquide ? c'est-à-dire combien ce liquide occupait-il d'espace environ. Supposons le tube placé perpendiculairement sur une table comme ceci :
Le gaz liquide occupait-il en hauteur dans le tube l'espace d'un pouce ? Etait-il dans un angle comme en a ou bien répandu dans la partie b, tout le long du tube ? Il est, je le sais, très léger, et flotte sur la surface du liquide générateur ; mais ce liquide occupe-t-il les ²/₃ du tube, et dépasse-t-il le troisième coude a ? Ne craignez point d'accidents ; je prendrai toutes mes mesures pour qu'il n'y ait pas d'explosion ; mais j'agirai comme s'il devait nécessairement y en avoir une. Mon but n'est pas de chercher une nouvelle force motrice ; c'est une simple observation sur la condensation du gaz. Voici bientôt l'année qui finit. Recevez mes vœux pour l'année 1842. Je vous souhaite, ainsi qu'à Mme Vieillard, tout ce qu'un ami souhaite à un ami. Quant à moi, ne me plaignez pas ; je n'ai pas le droit d'accuser le sort ; mes malheurs sont mon ouvrage et les déplorer serait me révolter contre moi-même. Adieu ; merci encore mille fois de votre empressement à me faire plaisir. En relisant le commencement de ma lettre je m'aperçois d'un immense attroupement de que, mais vraiment c'est un peu le défaut de la langue. Je voudrais que la loi du que retranché fût une vérité chez nous. En allemand et en anglais on dit par exemple : Je voudrais il vint, au lieu de : Je voudrais qu'il vînt. Mais, hélas, je le prévois, 500.000 lois viendront enrichir nos codes — je dis enrichir, parce que vous êtes législateur, sans cela je dirais : encombrer — avant qu'on mette le que hors la loi. Il est inviolable comme le Roi ; c'est peut-être pour cela qu'on l'aime tant ? Au commencement d'avril 1842, il songe à écrire une brochure sur le sucre de betterave. Ham, 10 avril 1842. ... Je regrette beaucoup de ne pouvoir aider la publication dont vous me parlez, mais mes moyens ne me le permettent pas. J'ai un devoir sacré à remplir, c'est de soutenir tous ceux qui se sont dévoués pour moi, et malheureusement les pensions que je paye sont au-dessus de l'état de ma fortune. Je soulage aussi autant que je le peux les malheureux qui m'entourent, et pour faire face à tout cela, je me retranche moi-même sur mes plaisirs, car j'ai vendu mon cheval et je crois que je n'en rachèterai pas. J'écris une brochure sur le sucre de betterave... P.-S. — Conneau a perdu la femelle d'un Galfa, ou Calfa, oiseau gris et noir de Sainte-Hélène, que M. Saulnier lui avait envoyée. Si vous voulez lui en renvoyer une, vous lui ferez plaisir et j'en serai heureux. Le 29 mai 1842, il prie Mme Cornu de demander de sa part à M. Fouquier d'Hérouël de lui prêter tous les documents pour ou contre la fabrication du sucre de betterave, que le gouvernement a fait remettre à tous les membres du Conseil d'Agriculture et du Commerce. Vous me rendrez le plus grand service de me les envoyer le plus tôt possible, car je m'occupe maintenant de cette question avec un vif intérêt... Il a vu M. d'Hérouël. Il ne perd pas de temps parce qu'il faut que son travail soit fini le 18 août et nous sommes au 3. Il fait une liste à sa chère Hortense de ce qu'il lui faut savoir : Quel est le nombre total des hectares laissés en jachères ? Quel est le total du produit brut de ces jachères ? Quelle est l'étendue en hectares qu'occupe le lin ? etc., etc. M. Mocquart lui a envoyé tout ce qui avait rapport aux colonies, mais un embarras se présente. La statistique agricole m'a jeté dans une cruelle perplexité. Voilà tous mes calculs dérangés, voilà les statisticiens qui m'ont précédé enfoncés, pardonnez l'expression. Au lieu de 20.000 hectares cultivés en betteraves, j'ai trouvé 57.000 ! Deux mois après il songe à fonder une publication périodique : Ham, le 10 juin 1842. Mon cher monsieur Vieillard, je commencerai par vous dire combien la fin tragique de votre pauvre Finette m'a fait de la peine. Personne plus que moi ne comprend combien la perte d'un chien qu'on aime peut attrister, car j'ai été bien longtemps à me consoler d'avoir perdu un chien que j'avais à Rome. Mais enfin, il faut en prendre son parti !... Votre lettre m'a fait de la peine. Elle m'a prouvé ce que, hélas, je ne sais que trop, c'est que dans toutes les démarches que je croirai utiles ou nécessaires je ne puis compter que sur moi seul, et que, même les amitiés aussi solides que la vôtre, me feraient défaut alors qu'il s'agirait d'exécuter un projet qui vient de moi. On m'a déjà donné le nom d'entêté, mais je vous déclare que cela est complètement faux. J'écoute tous les avis et après les avoir pesés dans mes balances — chacun a ses propres mesures —, je me décide. Et s'il n'en était pas ainsi, que serais-je donc devenu, moi qui n'avais devant moi aucun chemin tracé ? Mes amis, au lieu de recevoir l'impulsion de moi, qui eût été unique, voulaient tous me la donner, et si j'y avais consenti, j'aurais été tous les jours tiré par deux cents forces contraires ; et il ne me serait pas resté un seul lambeau de moi-même. C'est cette nécessité de choisir et de m'arrêter à un choix qui m'a formé le caractère. Maintenant vous me dites que je veux faire avancer ma cause par des effets puérils. Eh ! mon Dieu ! le succès dépend d'un nombre d'infiniment petits qui, à la fin seulement, parviennent à faire corps et à compter pour quelque chose. Si vous voyiez un homme abandonné, seul, dans une île déserte, vous lui diriez : Ne tâchez pas de former avec des troncs d'arbre, un esquif que la tempête fera sombrer, attendez que le hasard amène près de vous un navire libérateur. Moi je lui dirais : Employez tous vos efforts à vous créer des instruments avec lesquels vous parviendrez à vous construire un navire. Cette occupation soutiendra votre moral et vous aurez toujours un but devant les yeux. Elle développera vos facultés par les objets que vous aurez à vaincre, elle prouvera, si vous réussissez, que vous êtes au-dessus de la destinée. Lorsque votre navire sera terminé, jetez-vous-y hardiment. Si vous parvenez à toucher le continent, vous ne devrez votre succès qu'à vous-même. Si vous succombez, eh bien, vous aurez trouvé une fin meilleure que si vous vous étiez laissé dévorer par les animaux sauvages ou par l'ennemi. Non, il n'y a rien de puéril dans des efforts, quelque faibles qu'ils soient, quand ils partent toujours du même mobile et qu'ils vont tous au même but. J'ai écrit, en 1832, une brochure sur la Suisse pour gagner d'abord dans l'opinion de ceux avec lesquels j'étais obligé de vivre. Ensuite, je me suis appliqué, pendant près de trois ans, à un ouvrage d'artillerie que je sentais être au-dessus de mes forces, afin d'acquérir par là quelques cœurs dans l'armée et de prouver que si je ne commandais pas, j'avais au moins les connaissances requises pour commander. J'arrivai par ce moyen à Strasbourg. Depuis, je fis publier la brochure Laity, non seulement pour me défendre, mais pour donner au gouvernement un prétexte pour me faire renvoyer de Suisse. Cela ne manqua pas et l'hostilité du gouvernement me rendit mon indépendance morale, que j'avais pour ainsi dire perdue par une mise en liberté forcée. A Londres, je publiai contre l'avis de tous, les Idées napoléoniennes, afin de formuler les idées politiques du parti et de prouver que je n'étais pas seulement un hussard aventureux. Par les journaux, je tentai de préparer les esprits à l'événement de, Boulogne. Mais ce n'était pas l'affaire des rédacteurs. Ils voulaient vivre de la polémique et voilà tout ! Moi, je voulais m'en servir. Ici j'échouai déjà ; mais je n'y pouvais rien. Boulogne fut une catastrophe épouvantable pour moi, mais enfin je m'en relève, par cet intérêt qui s'attache toujours au malheur, et par cette élasticité inhérente à toutes les causes nationales, qui, bien que comprimées souvent par les événements, reprennent avec le temps leur première position. Mais enfin que reste-t-il de tous ces enchaînements de petits faits et de petites peines ? Une chose immense pour moi. En 1833, l'Empereur et son fils étaient morts. Il n'y avait plus d'héritiers de la cause impériale. La France n'en connaissait plus aucun. Quelques Bonaparte paraissaient, il est vrai, çà et là, sur l'arrière-scène du monde, comme des corps sans vie, momies pétrifiées ou fantômes impondérables ; mais pour le peuple la lignée était rompue ; tous les Bonaparte étaient morts. Eh bien, j'ai rattaché le fil ; je me suis ressuscité de moi-même et avec mes propres forces, et je suis aujourd'hui, à vingt lieues de Paris, une épée de Damoclès pour le gouvernement. Enfin, j'ai fait mon canot avec de véritables écorces d'arbres, j'ai construit mes voiles, j'ai élevé mes rames et je ne demande plus aux Dieux qu'un vent qui me conduise. Pour en revenir à ma publication, je me suis décidé parce que je n'y vois aucun inconvénient. L'auteur n'étant pas connu, je ne descends pas dans l'arène de la politique ; je fais ce que tout le monde peut faire à ma place : j'émets mes idées. J'ai commencé une revue semblable à Londres et cela n'a point pris. D'un autre côté, je puis réussir, quoique vous en disiez. En résumé, savez-vous la différence qu'il y a entre vous et moi dans l'appréciation de certaines choses ? C'est que vous procédez avec méthode et calcul. Moi, j'ai la foi, cette foi qui vous fait tout supporter avec résignation, qui vous fait fouler aux pieds les joies domestiques, l'envie de tant de monde, cette foi enfin qui seule est capable de remuer les montagnes. Certes, ils paraissaient bien aveugles, ces hommes qui, enfermés dans les prisons de Rome, croyaient avec quelques préceptes humanitaires renverser le pouvoir des Césars, et cependant ils l'ont renversé... J'admets sans peine qu'il y a des écrivains à Paris plus habiles que moi. Mais demandez à Bastide, à Louis Blanc, à George Sand, à tous enfin, s'ils ont jamais, en développant leurs idées politiques, touché assez leurs lecteurs pour leur arracher des larmes. Eh bien, je suis sûr que cela n'a jamais eu lieu, tandis que j'ai vu et en mille exemples que mes écrits ont produit ce résultat. Et pourquoi ? C'est que la cause napoléonienne va à l'âme ; elle émeut, elle réveille des souvenirs palpitants, et c'est toujours par le cœur qu'on remue les masses, jamais par la froide raison. En résumé, je vais commencer ma revue et je vous compte comme mon premier abonné. Je me passerai des noms que je voulais mettre en tête, le chapeau sera facile à reconnaître. Quant au nom de l'auteur, on peut l'avouer, mais il ne faut pas le proclamer. Voilà une bien longue lettre. Je tiens trop à vos conseils, j'éprouve trop de peine à être en désaccord avec vous, même sur des choses secondaires, pour ne pas m'efforcer de vous convaincre. Ai-je réussi ? Je l'ignore. Mais ce dont je suis sûr, c'est que vous rendrez justice aux sentiments qui m'ont dicté cette lettre. Paraissent successivement : La Traite des nègres, Opinion de l'Empereur sur les rapports de la France avec les puissances de l'Europe, la Paix, De l'Organisation militaire en France, Des Gouvernements et de leurs soutiens, L'Extinction du paupérisme, brochure à propos de laquelle, interpellé par le rédacteur du Journal du Loiret, il répondit : Fort de Ham, 21 octobre 1843. Monsieur, Je réponds sans hésiter, à la bienveillante interpellation que vous m'adressez dans votre numéro du 8 : Je n'ai jamais cru, je ne croirai jamais que la France soit l'apanage d'un homme ou d'une famille, je n'ai jamais revendiqué d'autres droits que ceux de citoyen français, et je n'aurai jamais d'autre désir que celui de voir le peuple entier choisir en toute liberté la forme de gouvernement qui lui convient. Issu d'une famille qui doit son élévation à la volonté nationale, je mentirais à mon origine, à ma nature et presque au bon sens, si je ne reconnaissais pas la souveraineté du peuple comme la base de toute organisation politique. Jusqu'ici mes actions et mes prétentions s'accordent avec cette manière de voir. Si l'on ne m'a compris, c'est qu'on ne cherche pas à expliquer les défaites, mais plutôt à les dénaturer. C'est vrai, j'ai recherché une haute position, mais publiquement ; j'avais une haute ambition, mais : je la pouvais avouer : l'ambition de réunir autour de mon nom populaire tous les partisans de la souveraineté du peuple, tous ceux qui voulaient la gloire et la liberté. Si je me suis trompé, l'opinion publique doit-elle m'en vouloir ? La France peut-elle m'en punir ? Croyez-bien, monsieur, que, quel que soit le sort que me réserve la destinée, on ne pourra jamais dire de moi que, dans l'exil ou dans ma prison, je n'ai rien appris et rien oublié. Agréez l'assurance de ma considération. LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. La lettre fit écrire à M. Degeorge cette phrase : Louis-Napoléon n'est plus à nos yeux un prétendant, mais un membre de notre parti, un soldat de notre drapeau, et à George Sand : Le Napoléon d'aujourd'hui personnifie les douleurs du peuple comme l'autre personnifiait ses gloires. Le prince Louis se remit à la chimie dans le but de revoir et faire réimprimer son Manuel d'artillerie, dont il devait faire un ouvrage absolument nouveau. Avec un peu de cuivre, de zinc et d'eau acidulée, j'oublie mon chagrin, et pendant plusieurs heures je suis le plus chaleureux des mortels. A propos de sa brochure sur la question des sucres, nous avons reproduit une lettre du prince à madame Cornu[1] où il lui demande des détails dont la technicité était bien capable d'effaroucher une femme. Mme Cornu, sa sœur de lait, apparaît dans cette étude, comme la personnification de l'amitié la plus pure et la plus absolue ; l'histoire a rarement l'occasion d'enregistrer tant de fidélité et tant d'abnégation, et nous sommes heureux de saluer une pareille figure au passage. C'est Mme Cornu qu'il va prendre pour collaboratrice à propos de son Manuel d'artillerie. Il en abusera sans qu'elle songe à s'en plaindre, mais il l'en remerciera aussi, parfois en termes assez touchants pour démontrer que la reconnaissance du prisonnier n'a cessé de demeurer à la hauteur de l'inaltérable dévouement de l'amie. Ham, le 3 juin 1843. Ma chère Hortense, Des maux de tête, des visites et un travail assidu m'ont empêché de vous écrire plus tôt, mais ne m'ont pas empêché de songer souvent à vous. J'ai été très aise de la lecture faite par M. Arago de ma lettre et de son insertion au Bulletin de l'Académie. Je voudrais bien pouvoir vous dire que mon ouvrage sur l'artillerie est bientôt fini ; mais plus j'avance, plus je recule. Quand vous verrez les épreuves, vous comprendrez tout ce qu'il faut de patience pour mener à bien un semblable travail. Il n'est pas au bout, en effet, il voudrait consulter le Dictionnaire des batailles depuis l'invention de la poudre jusqu'en 1815. Il voudrait savoir qui gagna la bataille de Tougres, en 1408, des Flamands ou du duc de Bourgogne. Le 6 octobre 1843, il s'interrompt pour suivre une autre piste. Il a fait une découverte se rapportant au grand problème de mettre les machines en mouvement par l'électricité. Le 11 novembre, il est découragé de son invention et reprend son Manuel que nécessite l'envoi d'un résumé des expériences faites sur le tir des bouches à feu de campagne dans les écoles d'artillerie de 1838 ; le Dictionnaire des sièges et batailles, etc. Le 14 décembre 1843. ... Puisque vous êtes si bonne artilleuse, je vous prierai de demander au maréchal Vallée : Les effets des obusiers de 12 de montagne, en Algérie. C'est-à-dire : 1° A-t-on pu vérifier combien d'hommes ou de chevaux ont été mis hors de combat par l'explosion d'un obus et à quelle distance ? 2° A-t-on jamais incendié quelque construction en Algérie, et s'il en a été ainsi, combien a-t-il fallu d'obus, et à quelle distance les a-t-on tirés ? 6 janvier 1844. ... Maintenant, je vais vous dire une grande nouvelle : Hört was ich will euch sagen[2]. L'introduction à mon Manuel est devenue un livre plus intéressant que le Manuel même ; aussi, j'y travaille sans relâche et je le ferai paraître à part et avant le Manuel. Pour cela, je n'ai besoin que de livres. Mais, hélas ! ma chère Hortense, j'ose à peine vous envoyer la liste ci-jointe. 25 janvier 1844. Ma chère Hortense, Je vous ai déjà dit que l'ouvrage que je fais maintenant et qui, par la nature des choses que je traite, se développe de plus en plus, sera beaucoup-plus intéressant et me fera plus d'honneur que mon Manuel. Mais il me faut absolument une main habile qui aille fouiller pour moi les manuscrits. Or, je ne veux pas absorber, à moi seul, tout votre temps, à moins que vous ne consentiez à faire un traité avec moi : c'est de vous associer à mon travail de corps et d'esprit, en me promettant de faire les recherches nécessaires et ensuite de partager fraternellement avec moi le bénéfice que j'en retirerai, car je veux le vendre au libraire. Vous acceptez, n'est-ce pas ? L'offre donne mieux que l'auteur ne saurait le faire l'idée de la fraternelle amitié établie entre le prisonnier et sa. sœur de lait. La tâche était lourde. Il s'agissait tout simplement de remuer des mondes. Mme Cornu l'accepte. Dans les conditions proposées par le prince ? Non : Ma chère Hortense, lui écrit-il, quelques semaines après, je voulais vous traiter en sœur, vous ne voulez être traitée qu'en amie. Soit ! Je vous embrasse malgré cela. Et les livres d'affluer à Ham : le Livre des faits d'armes et de chevalerie, par Christine de Pisan, Alain Chartier, Paul Jove, André de la Vigne ; les Chroniques du roi Charles VIII, Froissart, Villani ; le Traité des Armes, de Gaya, Monstrelet ; les Mémoires de Bourgogne, le Traité d'Artillerie, de Catherino, etc., etc. 3 mai 1844. Puisque je ne peux pas avoir la planche de l'ouvrage anglais, je voudrais bien les calques de tout ce qui démontre bien la forme des canons de l'époque, et, à ce propos, il y a dans le portefeuille Grignières trois dessins que je voudrais bien avoir. L'un représente deux canons très longs et très minces, sur roues ; le second, deux gros canons cerclés en fer, qui ont l'air de deux colonnes torses ; le troisième est un chariot de munitions portant des tonneaux de poudre... Mme Cornu passe ses journées à la Bibliothèque, à finer des dessins. L'année 1844 y sera presque exclusivement employée, et l'année 1845 aussi. Leurs correspondances équivalent à des catalogues. 20 avril 1845. Je vous remercie d'avoir pensé qu'il y a bientôt trente-six ans que nous nous connaissons, car nul lien n'est aussi puissant que celui qui commence à la naissance. L'amitié, comme la plante, a ses racines, et les nôtres sont bien profondes... Quoique je ne crois pas à l'amnistie, je voudrais surtout avoir les manuscrits que je ne pourrai me procurer plus tard ; ainsi, envoyez-moi, je vous prie : Fonds Colbert, 40, 7133, 2687. Le Miroir des armes et instructions des gens de pied, dédié à François Ier. Fonds Béthune, 9436. Compte de la recette et de la dépense faite par M. Arnould Bouchet, trésorier, 1390-1392. Etc., etc. Et Mme Cornu se fait toujours plus alerte et toujours plus dévouée. Il lui arrive de se tromper. L'amitié, si profonde qu'elle soit, surtout l'amitié d'une femme, peut se tromper en artillerie. Elle a oublié la mesure des arbalètes. Les calques sont trop petits : Vous ne m'avez donné que la projection verticale ; il en est de même pour le système Zoller, auquel il manque encore la partie la plus essentielle : l'avant-train. En date du 26 septembre 1845 : J'ai reçu les petits dessins que vous m'avez copiés, mais ce n'est pas encore là ce que je désire. Les bastilles étaient destinées à l'attaque, comme celles dont vous me parlez et qui représentent le siège de Brest. Les boulevards étaient des ouvrages non en plancher, mais en terre, soutenus par de grosses poutres et disposés surtout devant les portes de la ville. 12 novembre 1845. Il y a une chose dont je veux vous parler et qui m'inquiète beaucoup, parce que tout changement m'inquiète. Mon père vient d'écrire à plusieurs personnes influentes du gouvernement pour les charger d'obtenir du roi ma mise en liberté, disant qu'il était très malade et qu'il n'avait personne pour lui fermer les yeux, Or, qu'en adviendra-t-il ? Moi, je suis passif dans cette question et je dois l'être. Mais peut-être viendra-t-on me faire des propositions, me demander des garanties. Et voilà la difficulté. Vous comprendrez la situation sans que j'aie besoin de vous l'expliquer davantage. La perspective de sortir peut-être d'ici dans un mois ou deux me fait hâter démesurément mon travail. J'y passe des nuits pour terminer le premier volume avant cette époque... 24 décembre 1845. Comme, pour mon ouvrage, le style n'est pas le premier mérite, je crois qu'il suffira de vous envoyer les épreuves, ce qui, d'ailleurs, vous fatiguera moins. ... Maintenant, ma chère Hortense, je vous embrasse de tout mon cœur pour le jour de l'an, vous savez combien je désire tout ce qui peut tendre à votre bonheur. Je vous envoie comme souvenir un canon, il vous rappellera tout le mal que vous vous donnez pour me rendre service, et je connais assez votre amitié pour moi pour savoir que ce souvenir vous sera agréable. 7 janvier 1846. ... Il m'est impossible pour le moment de travailler avec suite. Je suis tiraillé en sens divers par une foule d'avis, d'exigences, d'opinions opposées. Mon père m'écrit qu'il n'a personne pour lui fermer les yeux, que mon devoir est de tout faire pour aller auprès de. lui. D'un autre côté, on tient la dragée haute et plus on me sait embarrassé, plus on se montre exigeant. 21 janvier 1846. Voilà en quoi la négociation a consisté : Mon père a écrit ; on a refusé. J'ai proposé d'aller sur parole à Florence, m'engageant à revenir dès qu'on le voudrait. J'ai adressé ma lettre au ministre qui m'a fait dire de l'adresser au roi. Et voilà où en sont les choses. On ne m'a fait aucune proposition ni directe ni indirecte. Il ne m'a donc pas été difficile de refuser ce qui ne m'a pas été offert. Quant à moi, je désire vivement arriver encore à temps pour voir mon père, et je ferai dans ce sens tout ce que je crois pouvoir faire sans manquer à ce que je me dois. ... Buré[3] vous dira que tout est rompu. On m'a indignement trompé. Je ne sortirai de Ham que pour aller aux Tuileries ou au cimetière. Ham, 3 février 1846. Ma chère Hortense, j'ai encore une lutte pénible à soutenir. Lorsque le refus si brutal du ministre me parvînt, j'écrivis aux députés les plus influents. La conduite du gouvernement les indigna et ils convinrent de faire en corps une démarche en ma faveur auprès des ministres. Mais les éteigneurs survinrent avec leur pompe à incendie et, à leur tête, M. Odilon Barrot ; ce dernier, sans que je l'en priasse, formula, avec M. Duchâtel, un nouveau projet de lettre au Roi, et il me l'envoya en m'écrivant une lettre très aimable pour m'engager de signer, et huit ou dix députés paraphèrent la même lettre. J'ai répondu hier à M. Odilon Barrot par un refus catégorique et je vous enverrai ma réponse. Je lui dis que j'ai demandé au Roi d'aller près de mon père, parce que mon devoir de fils m'appelle auprès de lui, mais que je ne veux pas demander grâce et que je resterai plutôt toute ma vie en prison que de m'abaisser. Cette démarche intempestive de M. Barrot va diviser les députés et m'ôte l'appui moral qu'il eût été si avantageux de conserver. Je crois que vous serez contente de ma lettre ; elle est trop longue pour que je vous l'envoie aujourd'hui. 19 février 1846. Je vois par votre dernière lettre que vous pensez encore à ma mise en liberté. Moi, je n'y pense plus depuis longtemps ; le nouveau refus ne m'a donc nullement désappointé et je travaille à force à mon ouvrage. J'ai envoyé à Dumaine le troisième chapitre, 198 pages. Je retouche maintenant le quatrième. Ayez la bonté de m'envoyer encore trois manuscrits. Quel beau temps il fait. J'espère que je vous reverrai à Pâques. Voilà bientôt une année de passée. Quand j'aurai terminé mon quatrième chapitre, j'aurai encore terriblement à travailler. 24 mai 1846. Ma chère Hortense, je vous renvoie la feuille 28 approuvée, mais il y a comme une fatalité pour mon ouvrage. Voilà qu'il m'est survenu mal aux yeux, de sorte qu'il faut que pendant quelques jours je ne me fatigue nullement. J'écris à Dumaine de vous envoyer toutes les épreuves avec la copie, et de ne plus rien m'envoyer directement. Je vous prierai alors, pour quelques jours, de ne m'envoyer que la seconde épreuve corrigée. C'est une dilatation de la pupille qui m'est venue, mais ce ne sera pas grand'chose, j'espère. J'ai reçu de mauvaises nouvelles de mon père. Le moral comme le physique ne vont pas trop bien. Adieu, je vous embrasse tendrement et vous renouvelle l'assurance de ma sincère amitié. NAPOLÉON. Cette dernière est datée de la veille de l'évasion du prince Louis du fort de Ham. Les travaux du prisonnier étaient surtout interrompus par un souci — le plus poignant de tous pour lui — la maladie de son père. L'amour du prince pour sa mère et son père est un des traits caractéristiques de son caractère. Depuis plusieurs mois, le comte de Survilliers, déjà brisé par la paralysie, se sentait atteint d'une affection dont la gravité faisait craindre pour ses jours. Le chagrin qui dominait ses souffrances physiques était de ne pouvoir espérer que son fils lui fermerait les yeux. En l'an 1845, il écrit à ce fils une longue lettre dans laquelle il lui fait part de sa tendresse, de son désir de l'embrasser, de son intention de demander au gouvernement l'autorisation de jouir d'une suprême entrevue. L'Impératrice Eugénie possède l'original de la réponse du prince à son père : Fort de Ham, 19 septembre 1845. Mon cher père, J'ai éprouvé hier la première joie réelle que j'aie ressentie depuis cinq ans, en recevant la lettre amicale que vous avez bien voulu m'écrire. M. Silvestre Poggioli a pu parvenir jusqu'à moi, et enfin j'ai pu causer avec quelqu'un qui nous est entièrement dévoué et qui vous a vu il n'y a pas longtemps. Combien je suis heureux de savoir que vous me conservez toujours votre tendresse et que l'occasion se présentant de m'en donner une preuve par une voie sûre, vous l'avez saisie avec empressement. Je suis bien de votre avis, mon père ; plus j'avance en âge, plus j'aperçois le vide autour de moi, et plus je puis me convaincre que le seul bonheur dans ce monde consiste dans l'affection réciproque des êtres créés pour s'aimer. Ce qui, dans votre lettre, m'a le plus touché, le plus remué, c'est le désir que vous manifestez de me revoir. Ce désir est pour moi un ordre et dorénavant je ferai tout ce qui dépendra de moi pour rendre possible cette réunion que je vous remercie de désirer, car elle a toujours été le vœu le plus ardent de mon cœur. Avant-hier encore j'étais décidé à ne rien faire au monde pour quitter ma prison. Car où aller ? Que faire ? Encore seul en pays étranger, loin des siens ? Autant valait le tombeau dans sa patrie. Mais aujourd'hui, un nouvel espoir luit sur mon horizon ; un nouveau but s'offre à mes efforts : c'est d'aller vous entourer de mes soins et de vous prouver que si, depuis quinze ans, il a passé bien des choses à travers ma tête et mon cœur, rien n'a pu en déraciner la piété filiale, base première de toutes les vertus. J'ai bien souffert. Les souffrances ont abattu mes illusions, ont dissipé mes rêves, mais heureusement elles n'ont point affaibli les facultés de l'âme, ces facultés qui vous permettent de comprendre et d'aimer tout ce qui est bien. Je vous remercie bien, mon père, des démarches que vous faites en ma faveur. Dieu veuille qu'elles puissent réussir. De mon côté, je vous le répète, je ferai tout — pourvu que cela ne soit pas contraire à ma dignité —, pour arriver à un résultat que je désire autant que vous. Je termine ma lettre avec une impression toute différente de celle que j'avais naguère en vous écrivant ; car aujourd'hui je puis exprimer l'espoir de vous revoir. Recevez donc, mon cher père, avec bonté, la nouvelle assurance de mon sincère et inaltérable attachement. Votre tendre et respectueux fils, NAPOLÉON L.-B. Le roi Louis écrit à MM. de Montalivet, intendant de la liste civile de Louis-Philippe ; Molé, ancien président de conseil, et Decaze, grand référendaire. Le prince joint ses sollicitations aux siennes. Fort de Ham, 25 décembre 1845. Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Mon père, dont la santé et l'âge réclament les soins d'un fils, a demandé au gouvernement qu'il me soit permis de me rendre auprès de lui. Les démarches sont restées sans résultat. Le gouvernement, m'écrit-on, exige de moi une garantie formelle. Dans cette circonstance, ma résolution ne saurait être douteuse , je dois faire tout ce qui est compatible avec mon honneur, pour pouvoir offrir à mon père les consolations qu'il mérite à tant de titres. Je viens donc, monsieur le ministre, vous déclarer que, si le gouvernement français consent à me permettre d'aller en France remplir un devoir sacré, je m'engage sur l'honneur à revenir me constituer prisonnier dès que le gouvernement m'en témoignera le désir. Recevez, monsieur le ministre, l'expression de ma haute estime. NAPOLÉON-LOUIS BONAPARTE. Le conseil des ministres s'assembla de nouveau le 2
janvier 1846 et décida : qu'on ne pouvait admettre
sa demande, parce qu'elle était contraire aux lois, et que ce serait accorder
une grâce pleine et entière sans que le roi en eût le mérite. Cette
décision fut transmise au commandant du fort de Ham avec ordre d'en donner
connaissance à son prisonnier. Le prince décida de s'adresser directement au
roi. Sire, Ce n'est pas sans une vive émotion que je viens demander à Votre Majesté, comme un bienfait, la permission de quitter, même momentanément, la France, moi qui ai trouvé depuis cinq ans, dans l'air de la Patrie, un ample dédommagement aux tourments de la captivité ; mais aujourd'hui, mon père malade et infirme, réclame mes soins ; il s'est adressé, pour obtenir ma liberté, à des personnes connues par leur dévouement à Votre Majesté ; il est de mon devoir de faire, de mon côté, tout ce qui dépend de moi pour aller auprès de lui. Le conseil des ministres n'ayant pas cru qu'il fût de sa compétence d'accepter la demande que j'avais faite d'aller à Florence, en m'engageant à revenir me constituer prisonnier dès que le gouvernement m'en témoignerait le désir, je viens, Sire, avec confiance, faire appel aux sentiments d'humanité de Votre Majesté, et renouveler ma demande, eh la soumettant, Sire, à votre haute et généreuse intervention. Votre Majesté, j'en suis convaincu, appréciera comme elle le mérite une démarche qui engage d'avance ma reconnaissance ; et, touchée de la position isolée sur une terre étrangère, d'un homme qui mérita sur le trône l'estime de l'Europe, elle exaucera les vœux de mon père et les miens propres. Je prie, Sire, Votre Majesté, de recevoir l'expression de mon profond respect. NAPOLÉON-LOUIS BONAPARTE. Fort de Ham, 14 janvier 1846. Cette lettre fut remise directement au roi par le prince
de la Moskowa. Louis-Philippe parut touché de la démarche du prince, et,
avant de décacheter la lettre, déclara au fils du maréchal Ney, qu'il
trouvait suffisante la garantie précédemment offerte par le prisonnier de
Ham. Ces mots semblaient ne plus laisser de doute sur l'issue de la demande
du prince. Il en fut autrement. Le commandant de Ham, à la demande du prince
avait fait transmettre au président du conseil, copie de la lettre au roi. M.
Duchâtel répondit au prince, le 23 janvier, que le
conseil de la délibération était que ce serait la grâce par voie indirecte.
Or, pour que la clémence du roi pût s'exercer, il fallait que cette grâce fût
méritée et par conséquent franchement avouée. Ce refus du gouvernement
surprit tout le monde. Plusieurs députés, entre autres M. Odilon Barrot,
crurent devoir intervenir officieusement auprès de M. Duchâtel, pour le faire
revenir sur cette décision. Leurs demandes restèrent infructueuses. M. Odilon
Barrot rédigea alors au préfet une lettre que M. Duchâtel annota de sa main,
en déclarant cette fois que si le prince consentait à la signer, le
gouvernement accepterait peut-être sa demande de mise en liberté. Le prince
remercia M. Odilon Barrot, et pria ses amis de cesser toute démarche[4]. Il avait un projet d'évasion, et le lundi 25 mai il était libre. L'histoire de cette évasion est connue. Nous renverrions au besoin le lecteur aux nombreux volumes qui ont été publiés à ce sujet, parmi lesquels Le Prisonnier de Ham, paru à Paris en 1849 et écrit presque en entier sous la dictée du fugitif. |