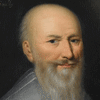ÉTUDE BIOGRAPHIQUE SUR SULLY
CHAPITRE VII. — DEPUIS LA MORT DU MARÉCHAL DE BIRON JUSQU'À L'ÉRECTION DE LA TERRE DE SULLY EN DUCHÉ-PAIRIE.
|
1602-1606 Henri IV étant à Nancy écrivit à M. de Rosny, le 10 avril 1603, la lettre suivante : Mon ami, j'ai eu avis de la mort de ma bonne sœur, la reine d'Angleterre, qui m'aimait si cordialement, et à laquelle j'avais tant d'obligation. Or, comme ses vertus étaient grandes et admirables, aussi est inestimable la perte que moi et tous les bons Français y avons faite ; car elle était ennemie irréconciliable de nos irréconciliables ennemis[1], et tant généreuse et judicieuse, qu'elle m'était un second moi-même, en ce qui regardait la diminution de leur excessive puissance, contre laquelle nous faisions elle et moi de grands desseins, ce que vous savez aussi bien que moi, vous y ayant employé. J'ai donc fait cette perte irréparable — au moins selon mon avis — au temps que je me pensais davantage prévaloir de sa magnanimité et constante résolution, et que mes affaires s'en allaient les mieux disposées pour me conjoindre efficacieusement avec elle ; ce qui me comble d'un ennui et déplaisir extrême, n'osant me promettre de trouver autant de générosité, de cordiale affection envers moi, et de ferme résolution à diminuer nos ennemis communs, en son successeur ; vers lequel me résolvant d'envoyer pour sentir ses inclinations et essayer de le disposer à imiter sa devancière, j'ai aussitôt jeté les yeux sur vous, comme celui de tous mes bons serviteurs par lequel je puis le plus confidemment traiter avec lui de choses si importantes, tant à cause de l'amitié que chacun sait que je vous porte, de la religion que vous professez, que pour vous être acquis envers lui la réputation d'avoir de la franchise et d'être homme de foi et de parole. Préparez-vous donc à faire ce voyage, et disposez en sorte mes affaires qu'elles puissent avoir leur cours ordinaire pendant votre absence, sans aucun mien préjudice. Soyez-moi toujours loyal, car je vous aime bien et suis fort content de vos services. Adieu, mon ami. HENRY. Quelque temps après, le Roi eut avec son ministre un long entretien sur les projets qu'il avait formés avec la feue reine, pour, avec l'aide de Venise, de la Hollande et des protestants d'Allemagne, travailler à la diminution de la maison d'Autriche, par la libération des Etats et peuples qui désireraient s'y soustraire. Mais le nouveau roi d'Angleterre, Jacques Ier, étant d'un caractère mou et pacifique, plus théologien que soldat, Henri IV ne savait pas s'il continuerait la politique d'Elisabeth, et Rosny avait pour mission de connaître son opinion à ce sujet. Muni des instructions et des lettres du Roi, Rosny allait partir pour l'Angleterre, lorsque Henri IV tomba malade, à Fontainebleau[2]. Il fit venir auprès de lui son fidèle Rosny, qui arriva et trouva le Roi hors de danger. Marie de Médicis était assise à son chevet, tenant une des mains du Roi entre les siennes. Après avoir dit à Rosny de venir l'embrasser, il se tourna vers la Reine et lui dit : Mamie, voilà celui de mes serviteurs qui a le plus de soin et d'intelligence des affaires du dedans de mon royaume, et qui vous eût le mieux servi, et mes enfants aussi, s'il fût arrivé faute (manque) de moi. Je sais bien que son humeur est un peu brusque et quelquefois trop libre à un esprit fait comme le vôtre, et que force gens sur cela lui eussent rendu de mauvais offices auprès de mes enfants et de vous, afin de l'en éloigner. Mais si jamais telles occasions se présentent, et que vous vous serviez de tels et tels (qu'il lui nomma tout bas à l'oreille), en croyant absolument leurs conseils, et ne suiviez ceux de cet homme-là, vous ruinerez les affaires de l'Etat, et peut-être le royaume, mes enfants et vous-même. Or, l'avais-je mandé tout exprès, afin d'aviser, avec vous et lui, aux moyens pour empêcher tels accidents ; mais, grâces à ce bon Dieu, je vois qu'il ne sera point encore besoin de telles précautions, me sentant quasi du tout soulagé, tellement que j'aurai du temps pour y penser et vous bien instruire de mes affaires et de mes intentions. Henri IV heureusement rétabli, Rosny partit enfin pour Londres ; outre ses instructions officielles, il emportait une instruction secrète, dont il devait présenter les articles comme venant de lui seul. Il était chargé de proposer au roi d'Angleterre une alliance offensive et défensive entre les deux pays, alliance resserrée par le mariage des enfants des deux rois et dont le but était de réduire la puissance de l'Espagne et de l'Autriche. Pour y arriver, Rosny devait faire quatre propositions. La première, que la France, l'Angleterre, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas[3], à frais communs et néanmoins proportionnés aux puissances d'un chacun, essayassent de se saisir des Indes, ou à tout le moins des îles qui sont sur le chemin des flottes d'Espagne, afin d'en empêcher le trajet, et ce, par le moyen de trois armées navales de 8.000 hommes chacune, lesquelles se rafraîchiraient de huit mois en huit mois, afin de remplacer ce qui serait devenu défectueux en icelles. La seconde, d'arracher de la maison d'Autriche
l'hérédité de l'empire d'Allemagne et des Etats et royaumes de Hongrie,
Bohême, Moravie, Silésie, Lusace, Autriche, Carinthie, Styrie et Tyrol,
conviant à ce dessein tous les princes d'Allemagne, avec assurance que toutes
les distributions s'en feraient à leur avantage et non d'autres, et faire le
semblable touchant les Etats de Clèves, Juliers, Berg, la Mark, Ravensberg et
Ravenstein lorsqu'ils viendront à vaquer[4]. La troisième, d'attaquer les Pays-Bas[5] en se saisissant des rivières de Meuse et Moselle, et des bords du Rhin d'un côté, des côtes de la mer de l'autre, et des frontières de France de l'autre, afin d'empêcher que nuls vivres ni marchandises n'y puissent plus entrer, et, par ce moyen, de réduire les peuples d'iceux en nécessité de toutes choses. Et la quatrième, plus grande et plus générale, par la réduction de toute la maison d'Autriche dans le seul continent des Espagnes, essayant d'intéresser en la dissipation, dispersion et distribution de leurs autres Etats, non seulement la France, l'Angleterre, les rois de Danemark et de Suède, les Provinces-Unies des Pays-Bas, mais aussi les princes et villes impériales d'Allemagne, Venise, la Savoie et autres potentats, voire même le Pape, en leur distribuant toutes lesdites provinces dont ils (les Espagnols) seraient spoliés, selon la commodité d'un chacun, sans aucune portion pour les rois de France, d'Angleterre, de Danemark et de Suède ; mais toujours avec charge, ajoute Sully, de ne faire ces propositions que comme de moi-même, faisant semblant de ne les avoir pas voulu faire au Roi, mon maître, sans avoir vu comment elles seraient reçues par ces trois grands rois du Nord et les Provinces-Unies des Pays-Bas[6]. Parti de Paris au commencement de juin 1603, Rosny
s'embarqua à Calais, accompagné de plus de 200 gentilshommes ou qui se disaient tels. A peine en mer, il lui
arriva une aventure, que le cardinal de Richelieu[7] raconte en ces
termes : Ce duc (Sully) choisi par Henri le Grand pour faire une ambassade
extraordinaire en Angleterre, s'étant embarqué à Calais dans un vaisseau
français qui portait le pavillon de France au grand mât, ne fut pas plus tôt
à mi-canal, que, rencontrant une roberge qui venait pour le recevoir, celui
qui la commandait fit commandement au vaisseau français de mettre le pavillon
bas. Ce duc, croyant que sa qualité le garantirait d'un tel affront, le
refusa avec audace ; mais ce refus étant suivi de trois coups de canon tirés
à boulets, qui, perçant le vaisseau, percèrent le cœur aux bons Français, la
force le contraignit à ce dont la raison le devait défendre, et quelque plainte
qu'il pût faire, il n'eut jamais d'autre raison du capitaine anglais, sinon
que comme son devoir l'obligeait à honorer sa qualité d'ambassadeur, il
l'obligeait aussi à faire rendre au pavillon de son maître l'honneur qui
était dû au souverain de la mer. Si les paroles du roi Jacques furent plus
civiles, elles n'eurent pourtant pas d'autre effet que d'obliger le duc à
tirer satisfaction de sa prudence, feignant être guéri lorsque son mal était plus
cuisant et que sa plaie était incurable. Rosny avait fait la leçon à tous ceux qui l'accompagnaient, surtout aux jeunes gens et marjolets[8] de Paris, et leur avait donné ses ordres sur la forme de vivre qu'ils avaient à tenir à Londres. Mais le soir même de l'arrivée des Français, quelques marjolets se prirent de querelle avec un Anglais et le tuèrent. Le peuple du quartier se souleva et menaça de tuer tous les gentilshommes de l'ambassade, qui se réfugièrent dans le logis de M. de Rosny. Une centaine de ces gentilshommes se trouvaient dans la salle où était Rosny, lorsqu'il fut instruit de ce qui venait d'arriver : il les fit ranger, et, prenant un flambeau, il les regarda au nez pour savoir qui avait commis le meurtre. Il en prit un par le poing et lui dit : Pardieu, je connais bien à votre mine et à vos paroles que c'est vous qui avez tué cet homme, n'est-il pas vrai ? Il le voulut nier ; mais Rosny le tourna de tant de côtés qu'enfin il le confessa. C'était un jeune homme, M. de Combault, fils unique, fort riche et parent de M. de Beaumont, ambassadeur ordinaire du roi de France en Angleterre. M. de Beaumont essaya de protéger son parent contre le mécontentement de Rosny, lequel lui dit en colère : Pardieu, monsieur, je ne m'étonne plus s'il y a du malentendu entre vous et les Anglais, puisque votre humeur est de préférer le particulier au public et l'intérêt de vos parents au service du Roi. Mais je veux bien que vous sachiez que je n'en userai pas ainsi, et le sauverai bien mieux que vous ; car je vous jure, qu'après lui avoir fait faire une belle confession de ses péchés il aura la tête tranchée ; car je ne veux pas que le service de mon maître, ni tant de gentilshommes de bonne maison pâtissent pour un petit godelureau de ville, tout écervelé. — Comment, monsieur, répliqua M. de Beaumont, faire trancher la tête à un de mes parents, qui a vaillant 200.000 écus[9] et est fils unique à son père ! Ce serait une mauvaise récompense de la peine de la dépense en quoi il s'est mis pour vous accompagner. — Je n'ai que faire de telle compagnie que celle-là, dis-je ; et puisque vous le prenez si haut, je vous prie vous retirer en ma chambre ; car je suis résolu d'assembler les plus vieux et les plus sages de cette compagnie, et avec leur bon avis de le condamner, car il mérite la mort. M. de Rosny envoya prévenir le maire de Londres du meurtre commis et de la punition réservée au coupable, le priant de tout faire préparer, archers et bourreau, pour le supplice. Le maire supplia Rosny d'user d'une moindre rigueur, et finalement Rosny lui proposa de se charger de M. de Combault et de lui infliger le châtiment qu'il jugerait à propos : ce qui fut accepté, et, grâce aux sollicitations de M. de Beaumont, M. de Combault fut délivré. Rosny put s'applaudir de s'être habilement tiré d'un aussi fâcheux embarras. Le roi d'Angleterre donna sa première audience à l'ambassadeur extraordinaire de Henri IV dans son palais de Greenwich et le reçut avec une grande solennité. Des compliments excessifs et quelques discussions théologiques, ce dont le roi Jacques ne pouvait se passer, remplirent cette audience, après laquelle Rosny eut une entrevue avec les ministres du Roi, au sujet d'Ostende, grande place forte des Pays-Bas espagnols. Cette ville était occupée par les Hollandais et assiégée par les Espagnols. Le récit des audiences accordées par Jacques Ier et les discussions avec ses ministres, tel que nous le trouvons dans les Mémoires de Sully, est long et fatigant : nous le résumerons en quelques mots. Rosny capta la confiance du roi d'Angleterre par les éloges continuels qu'il fit des vertus, de la capacité politique du roi, et par l'admiration qu'il témoigna de son zèle pour le protestantisme, et il amena Jacques Ier à signer un traité d'alliance offensive et défensive avec le roi de France et les Hollandais contre l'Autriche et l'Espagne, c'est-à-dire à continuer la politique d'Elisabeth (25 juin 1603). Rosny avait montré, pendant ces négociations difficiles, une grande habileté : il avait obtenu aussi qu'Ostende fût secouru par 6.000 Écossais, soldés par la France. Toutes les conventions faites avec Elisabeth furent confirmées. Revenu en France, en juillet, Rosny trouva le Roi à Villers-Cotterêts, d'où S. M. lui avait écrit le billet suivant : Mon ami, j'ai su votre embarquement, et par ainsi croyant que cette lettre vous trouvera deçà la mer, je vous fais ces trois lignes, par lesquelles je vous dis derechef : Venez, venez, venez, et le plus tôt que faire se pourra me sera le plus agréable ; car je vous attends avec impatience pour être éclairci de tout ce que vous m'écrivez par vos deux dernières lettres. A son arrivée, Rosny donna au Roi et aux personnes qui l'entouraient, le comte de Soissons et les ministres, quelques détails sur le roi d'Angleterre et sur la négociation, puis on fit lecture du traité. Henri IV ayant demandé au comte de Soissons ce qu'il pensait de ce traité, M. le Comte répondit que ce traité ne signifiait rien, n'étant qu'un simple projet d'espérances et de belles paroles, sans aucune assurance que l'exécution s'en suive. Le Roi prit la défense de Rosny et dit justement au malveillant critique qu'il n'y avait rien de si aisé à faire qu'à trouver à redire aux actions d'autrui. A quelque temps de là, voyant qu'à cause du bon ordre mis par Rosny dans les finances, il était fort difficile d'obtenir de S. M. de grandes libéralités, le comte de Soissons supplia le Roi, raconte Sully, de lui accorder, à son profit, une certaine imposition de 15 sols pour ballot de toile entrant ou sortant du royaume[10], dont on lui avait donné avis, et qui pouvait valoir quelque 8 ou 10.000 écus par an. Le Roi lui répondit qu'il lui donnait de très bon cœur, moyennant qu'elle n'excédât point 50.000 livres par an, que cela n'apportât point trop grande vexation au peuple et n'altérât point le trafic et le commerce, qu'il voulait favoriser de tout son pouvoir. Le soir même, Henri IV écrivit à Rosny pour avoir son avis sur cette affaire, mais sans nommer le comte de Soissons. Rosny alla trouver le Roi et lui dit que ce nouvel impôt, bien établi dans tout le royaume, vaudrait au moins 300.000 écus[11], mais ruinerait le commerce ainsi que la culture du lin et du chanvre dans les provinces de Bretagne, Normandie et Picardie. Sur quoi S. M. tout étonnée, écrit Sully, me dit : Je vois bien maintenant que j'aurais fait une grande faute d'accorder ainsi légèrement une telle demande sans m'être consulté avec vous sur la valeur et conséquence d'icelle, qu'il faut néanmoins que vous m'aidiez à réparer bien secrètement, de peur que cela ne vous devienne l'occasion d'une forte brouillerie avec mon cousin le comte de Soissons, auquel j'ai accordé cet avis, m'en ayant tellement pressé, qu'il en a eu l'édit signé et scellé, dont il faudra empêcher la vérification aux cours souveraines[12], auxquelles, comme vous savez, j'ai défendu d'entrer en l'enregistrement d'aucuns édits s'ils n'avaient des lettres de ma propre main ou de la vôtre, quelques jussions qu'elles reçussent, ou lettres de cachet qui leur fussent adressées. Quelques jours après, le comte de Soissons étant venu à l'Arsenal prier M. de Rosny d'arranger l'affaire à son gré, et Rosny ayant refusé, il s'en alla furieux ; puis la marquise de Verneuil, favorite du Roi, qui devait avoir sa part dans la nouvelle imposition, vint aussi auprès de M. de Rosny. Elle le trouva se disposant à aller au Louvre et ayant un petit agenda roulé autour du doigt ; elle lui demanda ce que c'était : A quoi je lui répondis comme en colère, dit Sully : Ce sont de belles affaires, madame, ès quelles[13] vous n'êtes pas des dernières. Et en le déployant, je lui lus une liste de 20 ou 25 édits que l'on poursuivait à la foule[14] et oppression du peuple, avec les noms de ceux qui étaient intéressés en iceux, dont elle était la sixième en ordre. Eh bien, ce dit-elle, que pensez-vous faire de tout cela ? — Je pense, lui dis-je, à faire des remontrances au Roi en faveur du pauvre peuple, qui s'en va ruiné, si telles vexations sont approuvées, et peut bien le Roi dire adieu à ses tailles, car il n'en recevra plus. — Vraiment, ce dit-elle, il serait bien de loisir de vous croire, et de malcontenter tant de gens de qualité pour satisfaire à vos fantaisies ; et que voudriez-vous donc que le Roi fît, si ce n'était pour ceux qui sont dans ce billet, lesquels sont tous ses cousins et parents ou ses favorites ? — Tout ce que vous dites serait bon, Madame, si S. M. prenait l'argent en sa bourse ; mais de lever cela de nouveau sur les marchands, artisans, laboureurs et pasteurs, il n'y a nulle apparence, étant ceux qui nourrissent le Roi et nous tous, et se contentant bien d'un seul maître, sans avoir tant de cousins, de parents et de favorites à entretenir. Toute mutinée, madame de Verneuil s'en alla de ce pas chez le comte de Soissons et lui débita toutes sortes de méchants propos contre Rosny, entre autres qu'il avait dit que le Roi avait trop de parents, et que ses peuples seraient bien heureux s'ils en étaient débarrassés. Le comte de Soissons, en proie au mécontentement le plus violent contre Rosny, alla se plaindre au Roi, et lui déclara que pour l'apaiser il lui fallait la vie du surintendant. Henri IV eut beaucoup de peine à calmer son cousin, à lui montrer que Rosny n'était pas coupable, et que toute cette querelle venait de la méchanceté de madame de Verneuil. Toutefois il engagea Rosny à se faire si bien accompagner que l'on ne pût facilement entreprendre sur sa personne, c'est-à-dire le tuer dans un guet-apens. Bientôt Henri IV partit pour la Normandie, et afin de prouver une fois de plus à son ministre qu'il l'aimait autant que jamais, il lui annonça qu'il irait coucher à Rosny, où il voulait que le maître du lieu traitât les princes et princesses et le connétable. Ce qui fut fait. La province de Poitou, dans laquelle les Huguenots étaient fort nombreux, était toujours agitée par les menées de MM. de Bouillon et de la Trimouille. Henri IV résolut de donner le gouvernement du Poitou à M. de Rosny. Un jour qu'il était venu au Louvre voir S. M., il trouva le roi se promenant dans une galerie avec M. de Montpensier, le cardinal de Joyeuse et le duc d'Epernon. Sur un signe que le Roi lui fit, Rosny s'approcha, et S. M. lui dit : Or devinez sur quoi nous en étions, ces trois hommes ici et moi, lorsque vous êtes entré. — Sire, dis-je, les discours et conceptions de trois si grands personnages, représentés à V. M., pourraient être tant relevés qu'ils surpasseraient ma capacité et mon imagination ; et partant me serait-il impossible de les deviner. — Or bien, dit le Roi, laissant les cajoleries à part, je vous dirai que nous parlions de vous, et que sur l'avis, qui me venait d'être donné, des pratiques et menées de MM. de la Trimouille et du Plessis en Anjou, Poitou et Saintonge, et ce que me disait M. de Montpensier des mauvais propos qu'il avait ouï tenir au premier, en présence de M. le Grand et du comte du Lude — qui, à la vérité, faisaient les malcontents et ne m'épargnaient pas non plus, ni vous aussi, afin de le faire parler —, ils me conseillaient de vous donner le gouvernement de Poitou, Chatelleraudois et Loudunois. L'eussiez-vous bien cru, eux étant si bons catholiques, et vous si opiniâtre Huguenot ? Je croirai toujours bien, Sire, dis-je, que ces Messieurs, qui vous aiment grandement, n'auront pas manqué de vous donner ce conseil, s'ils ont estimé qu'il vous fût agréable et utile à votre service. — Or, dit le Roi, devinez encore sur quoi nous fondions cette résolution ainsi prise. — Je crois, Sire, dis-je, que le principal sujet d'icelle a été votre bienveillance envers moi, ma loyauté au service de V. M. et de son Etat ; car d'autres mérites en moi, il y en a bien peu. — Oui da, ce dit le Roi, tout ce que vous dites là en peut bien avoir été en partie cause ; mais la principale est que vous êtes Huguenot, et que vous, gouvernant en ces provinces, et surtout avec les Huguenots, avec prudence et suivant les instructions que je vous donnerai, et faisant passer par votre entremise toutes les gratifications qu'ils tireront de moi, vous prendrez toute la créance et la ferez perdre à tous les Bouillons et brouillons, surtout en leur faisant bien comprendre que mes intentions sont très bonnes en leur endroit, voire de tout ce qu'ils appellent leurs Eglises, et des particuliers aussi, tant qu'ils auront la prudence et la modestie requise pour se conduire et comporter ainsi que de bons sujets et loyaux serviteurs doivent faire envers un sage roi et un bon maître, tel que je leur ai toujours été par effet, et veux aussi leur demeurer à l'avenir, si par imprudence et mauvaises procédures, ils ne contraignaient mon naturel d'en user autrement ; et partant qu'ils ne sauraient faire une meilleure union qu'avec moi, choisir une plus assurée protection que la mienne, ni avoir de plus défendables[15] places de sûreté, voire y fût la Rochelle, que mes bonnes grâces, ma bienveillance, ma foi et ma parole, auxquelles je ne manquerai jamais, voulant incessamment demeurer en égalité d'affections, de faveurs et de bienfaits ; gardant toujours néanmoins les proportions dues aux qualités, capacités et services d'un chacun, seul roi et seul protecteur des catholiques et des Huguenots. Car, quand bien je n'aimerais pas la religion des derniers, comme à la vérité je ne l'approuve plus et désirerais qu'ils fussent tous de la mienne (ce qu'il disait, je crois, à cause de ceux qui étaient présents ; car, outre les premiers, étaient là encore survenus pendant tous ces discours MM. de Brissac, d'Ornano et de Roquelaure), je ne laisse pas d'aimer leurs personnes, comme les services que j'en ai reçus m'y obligent, ayant tant de fois hasardé leur vie pour la défense de la mienne ; voire encore que la Rochelle, Bergerac et Montauban me fassent parfois des escapades qui me déplaisent, néanmoins je ne me saurais empêcher d'aimer ces trois villes-là, et même de leur donner tous les ans quelque peu de chose pour leurs fortifications et leurs collèges, tant pour ce que je sais qu'en effet ils aiment ma personne et qu'ils ne se jetteront jamais aux extrémités contre moi, que pour ce qu'apparemment Dieu s'est servi d'icelles pour me sauver la vie et garantir d'oppression lorsque le feu Roi, le roi d'Espagne, le Pape et toute la Ligue ont essayé de me détruire, m'ayant envoyé tant de grandes armées sur les bras, contre l'effort desquelles j'ai toujours trouvé l'affection et loyauté de ces peuples très entières en mon endroit, et en leurs murailles une si assurée retraite à ma vie et à ma personne, que l'on ne m'y a jamais osé attaquer. Mais, quand tout cela ne serait point, je dis que la prudence acquise par une si longue expérience, que les cheveux me sont blanchis en icelle, me conseille de les bien traiter et de n'entreprendre jamais de les vouloir ruiner, parce que je n'y saurais parvenir sans rejeter mon royaume et mes peuples, que j'aime comme mes enfants, dans les désordres, confusions et désolations par lesquelles j'ai passé, les en ayant retirés avec beaucoup de périls, de pertes, de peines et de dépenses, et de joindre à la destruction de ces opiniâtres celle de mon Etat, ou, pour le moins, le voir affaiblir de telle sorte que lui et moi deviendrions la proie de nos anciens et irréconciliables ennemis. Ce propos me faisant souvenir des belles preuves d'amitié que Taxis et Stuniga me voulaient rendre au nom de leur maître[16], lorsqu'ils insistaient à me faire abandonner ses sujets hérétiques et rebelles des Pays-Bas, qui étaient de m'offrir toutes ses forces et ses moyens pour m'aider auparavant — afin que je connusse qu'il y procédait sincèrement — à détruire entièrement tous mes sujets hérétiques, entre lesquels ils savaient bien, disaient-ils, y en avoir plusieurs et des plus qualifiés, lesquels ne m'aimaient guère et enviaient mes prospérités, voire ne désiraient rien plus que de pouvoir troubler mon Etat ; en quoi leur maître ne les avait jamais voulu assister, quelque instance qui lui en eût été faite de leur part, tant il estimait dangereux pour tous les rois et potentats catholiques l'accroissement de cette secte, laquelle n'affectait rien tant que l'état populaire et la république ; desquelles offres et discours, quoique grandement spécieuses et pleins d'artifices, la caption et la malice ne me furent pas fort difficiles à découvrir, se conformant, comme il me sembla aussitôt, à ce que j'avais ouï dire que l'empereur Charles-Quint répondit à la Roche du Maine, lors son prisonnier de guerre, se plaignant du malheur des Etats et sujets de lui et du Roi son maître, lequel il n'estimait procéder que du peu d'amitié qu'il y avait toujours eu entre les personnes de Leurs Majestés, lui disant que pour son regard il s'abusait bien fort, pour ce que tant s'en fallait qu'il haït le roi de France, qu'il souhaiterait qu'au lieu d'un seul il y en eût une vingtaine. Et partant, par toutes ces raisons d'Etat et de prudence, suis-je résolu de maintenir le dedans de mon royaume en repos et tranquillité, bien assuré que par ce moyen, par ma vigilance, la bienveillance des gens de bien, qui excèdent en nombre infini les autres, mes armes et mon argent, j'empêcherai que toutes ces nuées de brouilleries n'éclatent, à quoi la résolution que j'ai prise, par l'avis de ces Messieurs ici, de vous bailler le gouvernement de Poitou, me servira grandement. Le 16 décembre 1603, Rosny recevait les provisions du gouvernement de Poitou. Il avait acheté cette charge 20.000 écus (360.000 fr.) au gouverneur et à son survivancier, et il avait donné 2 ou 3.000 écus (54.000 fr.) à ceux qui les gouvernaient. M. de Rosny, ami et confident de son maître, se trouve sans cesse mêlé à tous les chagrins, projets et affaires du Roi. Dans cette période de son règne, Henri IV s'abandonne volontiers à son goût pour la chasse, pour les bâtiments, pour les belles manufactures et pour le jeu. Quand il priait le surintendant d'augmenter ces diverses dépenses sur l'état des finances, ou sur le budget comme nous dirions aujourd'hui, Rosny manifestait son mécontentement en haussant les épaules et en se grattant la tête. Le Roi alors lui disait : Je vois bien que vos fantaisies et les miennes ne se rencontrent pas trop bien sur cette augmentation de dépenses, en quoi vous avez tort de ne vous accommoder pas volontairement à ce que je désire ; car, quand vous viendriez à considérer par quels périls et travaux de corps et d'esprit il m'a fallu passer depuis mon enfance jusques à présent il me semble que vous ne me devriez point plaindre ce qui est de mes petits passe-temps. A quoi Rosny répondait que si S. M. n'avait plus d'autre but que d'achever le cours de ses ans doucement et en repos, abandonnant les généreux desseins qu'il avait formés autrefois, lui, Rosny, avait tort, et qu'au lieu de contester sur ce qui était de la dépense des plaisirs du Roi, il devait la faciliter de tout son pouvoir ; mais que s'il voulait achever son œuvre en châtiant les brouillons et les méchants qui se découvriraient dans le royaume, lutter contre l'Espagne, soutenir ses alliés et accomplir les projets conclus avec le roi d'Angleterre, il était impossible de concilier les deux manières de vivre. Sur lesquels discours, S. M. me regarda longtemps depuis que je me fus tu, sans répliquer aucune chose, diverses passions faisant un conflit de jurisdiction dans son esprit, lequel aucunement modéré, il me dit, comme tout en colère : C'est une chose étrange que, d'autant plus que je vous aime et prends bonne opinion de votre esprit et de votre capacité, il semble que vous la preniez mauvaise de moi depuis quelque temps, comme si j'étais si peu judicieux que de vouloir préférer mes passe-temps à ce qui est de ma gloire et de l'accroissement et prospérité de mon royaume, pour lesquels j'ai tant travaillé et hasardé tant de fois ma vie, chose qui ne m'entra jamais en l'esprit, comme je le vous ferai bien paraître, m'assurant même que vous en pensez tout autrement, et n'avez dit tout cela que pour m'embarrasser et me faire tomber à votre point ; et néanmoins, afin que le tort ni les défauts ne me soient pas imputés, je vous remets en votre disposition d'en user comme bon vous semblera sur toutes ces dépenses que je vous ai commandées, et je connaîtrai par l'effet quel soin vous aurez apporté à ce qui est de mon contentement. Rosny déclara au Roi le déplaisir et l'ennui qu'il avait de trouver S. M. de mauvaise humeur et ne se souvenant plus de la résolution qu'elle avait prise de vouloir dorénavant constituer ses principaux plaisirs et toutes ses délices en l'exaltation de son nom glorieux et ravalement de la fierté des Espagnols, puis il fit au Roi un exposé général de la politique à suivre pour arriver à ce ravalement, et des ressources en hommes, en armes et en argent dont le Roi pouvait disposer. Je me doutais toujours bien, lui dit le Roi, que toutes ces grandes entreprises par vous imaginées seraient des ouvrages de longues années, lesquelles pourront être interrompues durant le cours d'icelles par une milliasse d'accidents, comme déjà moi-même reconnais tant de difficultés en l'exécution finale d'icelles, que j'appréhende bien que nous laissions les choses présentes et assurées pour nous jeter à l'essor[17] — comme fit l'autre jour un de mes oiseaux que je n'ai jamais pu recouvrer depuis — après celles de l'avenir et bien fort incertaines, et néanmoins je ne laisserai pas de les avoir toujours en l'esprit, et de favoriser tous vos ménages, pratiques et faciendes[18] que vous jugerez à propos pour les avancer ; et ne vous nierai point que je ne sois voirement[19], comme vous l'avez bien reconnu, en fort mauvaise humeur ce matin. Les causes de cette mauvaise humeur étaient les intrigues des brouillons politiques, et surtout les querelles domestiques que le Roi avait constamment avec la Reine et la marquise de Verneuil. Cette dernière s'étant permis d'appeler Marie de Médicis la grosse banquière de Florence[20], Henri IV eut la pensée, dit-il, de lui donner sur la joue. Les intrigues de cette femme, même avec l'Espagne, sa méchanceté, son insolence, faisaient le désespoir du Roi, qui ne pouvait se passer de sa conversation vive et amusante, et de ses bons mots qui le faisaient rire. Quant à Marie de Médicis, elle n'avait pour Henri IV aucune complaisance, et ne lui témoignait que de la froideur et du dédain. Le portrait que Saint-Simon a fait de cette méchante femme, quoique sévère, est encore encore de la vérité : Impérieuse, jalouse, bornée à l'excès, toujours gouvernée par la lie de la Cour et de ce qu'elle avait amené d'Italie, Marie de Médicis a fait le malheur continuel d'Henri IV et de son fils et le sien même, pouvant être la plus heureuse femme de l'Europe sans qu'il lui en coûtât quoi que ce soit que de ne s'abandonner pas à son humeur et à ses valets[21]. Et plus loin : Italienne, Espagnole, sans connaissance aucune et sans la moindre lumière, dure, méchante par humeur et par impulsion d'autrui, et toujours abandonnée à l'intérêt et à la volonté de gens obscurs et abjects, qui pour dominer et s'enrichir lui gâtaient le cœur et la tête, la rendaient altière, jalouse, impérieuse, intraitable, inaccessible à la raison et toujours diamétralement opposée à son fils[22] et aux intérêts de la Couronne ; de plus, changeante, entreprenante selon qu'elle changeait de conducteurs et de gens qui la gouvernaient, selon leurs caprices et leurs nouveaux intérêts. D'ailleurs, sans discernement aucun, et comptant pour rien les troubles, les guerres civiles, le renversement de l'Etat, en comparaison de l'intérêt et des volontés de cette lie successive de gens qui disposaient tour à tour absolument d'elle[23]. Saint-Simon, si bien informé par son père, n'hésite pas à
écrire ce qui suit, à propos de la mort de Henri IV : Personne n'ignore avec quelle présence d'esprit, avec quel dégagement,
avec quelle indécence la Reine et ceux qui la possédaient reçurent une
nouvelle si funeste et qui devait les surprendre et les accabler comme le
reste de la Cour, de Paris, du royaume ; et on n'ignore pas non plus les plus
que soupçons répandus à leur égard sur ce crime, ni les mesures avec
lesquelles Ravaillac fut interrogé, gardé, exécuté[24]. Jusqu'à la mort du Roi, Rosny assista souvent aux querelles des deux époux, ou il écoutait le récit que lui en faisait Henri IV. Avec son bon sens ordinaire, il donnait au Roi le conseil le plus sage : renvoyer la favorite et chasser de la Cour et de la France les favoris italiens de la Reine, Concini et la Léonore. Bien que le malheureux Roi jugeât exactement quels ennemis il avait en ces Italiens qui entouraient Marie de Médicis, et qu'il ait dit un jour à Rosny : Ces gens-là me tueront, ce qui arriva, il n'eut pas la force de sortir de cette situation, et il aima mieux conserver au Louvre Concini que d'en chasser Madame de Verneuil. M. de Rosny ne se mêlait à ces querelles que le moins possible, et malgré lui, bien que le Roi l'envoyât querir à toute heure de jour et de nuit, et lui écrivît de nombreuses lettres à ce sujet. Il en parle peu dans ses Mémoires, par respect pour Leurs Majestés[25]. Si, pendant le voyage de Blois[26], Rosny empêcha Henri IV de chasser Concini, il dut, plus tard, s'en repentir amèrement. En juin 1604, M. de Rosny, gouverneur du Poitou, alla visiter son gouvernement : Partout il fut reçu avec des honneurs extraordinaires et une grande bienveillance par les peuples, la noblesse et même par les ecclésiastiques. A la Rochelle surtout, la réception fut très brillante, avec force protestations de dévouement et d'obéissance au Roi. Rosny démentit tous les bruits malveillants que l'on faisait courir sur l'achat des marais salants par le Roi, sur l'établissement de la gabelle dans les provinces qui étaient exemptes de cet impôt, — l'établissement de nouvelles taxes établies sur les denrées vendues en détail, — la création de nombreux officiers en toutes sortes de juridictions, — les mauvais desseins attribués au Roi à l'endroit des Huguenots. M. de Rosny réussit à souhait et déjoua toutes les machinations des alliés de l'Espagne. En finissant la lettre dans laquelle il rendait compte à Henri IV du succès de son voyage, il lui disait[27] : Je puis assurer V. M. que les pratiques et menées des brouillons sont grandement affaiblies ; que plusieurs qui n'étaient point marris d'entendre leurs propositions fuient à présent, comme la peste, ceux qui les veulent entamer, et que, quant à leur dessein de former des défiances de V. M. en mon esprit, que cela est hors de leur puissance, connaissant trop bien la grande prudence, sagesse et bon naturel de Votre Majesté. Pendant l'absence de Rosny les cabales avaient recommencé : le comte d'Entragues, père de la marquise de Verneuil, le comte d'Auvergne, frère de ladite marquise, le duc de Bouillon et M. de la Trimouille devaient enlever le Roi, le tuer, s'emparer de la Reine et du Dauphin, et mettre sur le trône, avec l'aide de l'Espagne, le fils de la marquise de Verneuil. Il paraît qu'une nuit Henri IV fut attaqué par une bande de spadassins, qu'il mit en fuite à force de bravoure et de vaillants coups d'épée. Les conjurés devaient aussi livrer à l'Espagne Blaye et Bayonne, Narbonne et Leucate[28], Marseille et Toulon. Pour beaucoup le but de ce complot était de venger le maréchal de Biron. Le 2 juillet 1604, le comte d'Auvergne fut arrêté et mis à la Bastille ; le duc de Bouillon se sauva à l'étranger ; M. de la Trimouille mourut sur ces entrefaites ; le comte d'Entragues et sa fille furent arrêtés. Le Parlement condamna à mort les comtes d'Entragues et d'Auvergne, et ordonna que la marquise de Verneuil serait enfermée dans un monastère (1er février 1605). Malgré l'avis du Conseil, Henri IV eut la faiblesse de commuer en prison perpétuelle la peine prononcée contre le comte d'Entragues et le comte d'Auvergne, et il pardonna à la marquise de Verneuil, il faut bien le dire, à des conditions honteuses pour lui. Une partie des ministres, anciens ligueurs, était opposée à l'alliance anglaise, dont Rosny était le défenseur, et pressaient Henri IV de s'allier avec l'Espagne. L'un d'eux, M. de Villeroy, avait un premier commis qui trahissait le Roi, faisait disparaître certaines dépêches et communiquait les autres au cabinet de Madrid. Son crime découvert, il se sauva et, en traversant la Marne, il se noya fort à point pour éviter un procès, qui aurait été certainement compromettant pour les complices de cette trahison, qui restèrent inconnus. La grande faveur dont jouissait Rosny était faite pour exciter contre lui toutes les haines. Ses Mémoires divisent ses ennemis en sept sortes : les princes et grands officiers de la Couronne, — les favorites et leurs séquelles, — les partisans de l'alliance espagnole, — les marjolets, brelandiers, baguenaudiers et fainéants de Cour, — les factieux, séditieux, mutins et faiseurs de menées contre l'Etat, — tous ceux qui étaient accoutumés à s'enrichir en pillant, saccageant et brigandant le Roi, le royaume et les particuliers. La septième sorte était formée d'un ramas de toutes ces canailles et sangsues de partisans, rapporteurs, dénonciateurs, mouches de Cour et donneurs d'avis pour trouver de l'argent à la surcharge du peuple. Desquels l'audace, le caquet et l'effronterie n'étaient pas quelquefois mal reçus du Roi même, entre lesquels paraissaient comme les plus impudents un Juvigny... voire même Sancy, sa profession l'ayant réduit là..., desquels je rejetais quasi toujours toutes les propositions et rabrouais de telle sorte les personnes, que me haïssant à toute extrémité, aucuns d'iceux étaient pratiqués pour mettre en avant, et présenter au Roi même, sous leurs noms, des libelles diffamatoires, que les plus envenimés et haut huppés de mes ennemis, qui ne voulaient ou n'osaient pas se déclarer tels ouvertement, faisaient fabriquer contre moi, accusant mes desseins et projets d'extrême ambition... Et surent toutes ces diverses sortes de personnes bandées contre ma fortune, manier si dextrement (adroitement) leur dessein, et dire, les uns en une occasion, les autres en une autre, tant de bien de moi[29], se louer des courtoisies qu'ils recevaient de moi, faire si grand cas de l'excellence de mon esprit et grandeur de courage, et vanter tellement le grand nombre d'amis que j'acquérais journellement par une nouvelle forme de conduite pleine de douceur et civilité que j'avais prise, et assaisonnant tout cela, pour y donner la pointe, des importantes intelligences et correspondances que j'entretenais tant dedans que dehors le royaume, qu'enfin le Roi, ayant les oreilles rebattues, de tant de divers endroits, de toutes ces impostures, il ne se put empêcher d'y ajouter quelque créance, de s'en émouvoir en son esprit, d'en parler et faire des plaintes[30] à tant de personnes, que j'en fus aussitôt averti de trois ou quatre endroits. De quoi étant merveilleusement affligé pour voir une rémunération si peu convenable à ma loyauté sans reproche, à tant de périls que j'avais courus pour la défense de ce prince, et de travaux que je prenais tous les jours pour exalter sa gloire, amplifier sa domination, faire prospérer ses affaires et enrichir son royaume, après avoir quelque temps disputé en moi-même sur les remèdes propres à tels accidents, je résolus de commencer par une lettre pleine de soumissions, plaintes et justifications tout ensemble[31]. Henri IV reçut cette longue lettre à Chantilly, chez le connétable, son compère, dans les bois duquel il chassait volontiers. Il répondit, le 15 mars, à la lettre de Rosny, par la suivante : Mon cousin, j'aurais besoin de plus de temps et de loisir que je n'en ai maintenant, pour répondre au discours, raisons et plaintes de votre lettre du 13 de mars ; c'est pourquoi je remettrai à vous en parler à la première vue et loisir. Et ce pendant je vous conseillerai de prendre le même conseil que vous me donnez lorsque je me mets en colère de ceux qui blâment mes actions, qui est de laisser dire et parler le monde, sans vous en tourmenter, et faire toujours de mieux en mieux ; car par ce moyen vous montrerez la force de votre esprit, ferez paraître votre innocence et conserverez ma bienveillance, de laquelle vous pouvez être autant assuré que jamais. Adieu, mon cousin. HENRY. M. de Rosny fut, avec raison, affecté de cette lettre. Cette lettre, dit-il, beaucoup moins étendue, particulière et familière que je ne l'avais espérée, plus circonspecte, retenue et considérée que le Roi n'avait accoutumé de m'écrire, et ce qu'il usait du terme de mon cousin au lieu de mon ami, m'écrivant de sa propre main, me firent croire que son cœur n'était pas encore bien satisfait, ni son esprit entièrement épuré des fantaisies dont l'on m'avait donné avis ; et néanmoins je résolus de ne lui en parler plus s'il n'entamait le propos, et de faire semblant d'être fort content de ce qu'il m'avait écrit, afin de voir par où il commencerait à me parler de tout cela, ne doutant point, connaissant son humeur comme je faisais, qu'il ne s'y trouvât bien empêché. Tellement que, continuant à vivre et faire comme javais accoutumé, quelques jours après le Roi s'en revint à Paris, sur les lettres que je lui écrivis touchant plusieurs affaires que je lui mandais requérir sa présence, où il séjourna huit jours seulement pour prendre résolution sur tout ce qui se présentait, sans qu'il me parlât de ma lettre. S'il est difficile aujourd'hui à nos ministres de vivre avec un Parlement, il n'était pas facile à Sully, on le voit, de vivre en pleine sécurité, à l'abri de la confiance d'un roi tout-puissant, contre les cabales d'un nombre infini d'ennemis. A la lecture attentive des Mémoires de Sully, on ne peut s'empêcher de blâmer Henri IV de ses soupçons continuels contre le surintendant, soupçons résultant de cette méfiance extrême qu'il avait envers tous ses ministres. A peine la brouille dont nous venons de parler semblait-elle apaisée qu'un nouveau mécontentement éclata. Crillon, colonel du régiment des Gardes, était sans cesse absent, allant résider souvent et longtemps dans le Comtat-Venaissin, son pays. Henri IV désira lui donner un successeur et le pria de se défaire de sa charge, ce qui ne lui plaisait pas. D'un autre côté, le duc d'Epernon, colonel général de l'infanterie française, allant en Guyenne, à ce moment, pria Rosny de ne laisser faire le changement qu'à son retour, ce que Rosny lui promit. Informé de la cause de l'opposition de son ministre au projet de mettre Crillon à la retraite, le Roi fut si mécontent qu'il éclata en plaintes publiques contre Rosny. Il alla jusqu'à dire à MM. de Villeroy, Sillery, La Varenne et au Père Cotton, auxquels il racontait ses prétendus griefs, et qui ne répondaient rien : Hé quoi, vous ne dites mot ! Mais pardieu, j'en jure, tout ceci ne vaut rien ; car, puisque l'eau et le feu se sont si facilement accordés et liés d'amitié ensemble, il faut qu'il y ait de bien plus hauts desseins, au moins d'un côté, que je ne me fusse jamais pu imaginer ; mais j'y donnerai bon ordre. Et là-dessus se mit à décliquer[32] tout ce que la promptitude de son esprit, le déplaisir de penser voir aliéner de lui un serviteur de telle confiance, duquel il recevait tant de soulagement, le ressouvenir des impostures et calomnies que l'on avait forgées contre moi — auxquelles il ajoutait lors quelque foi — et le feu de sa colère pouvaient lui suggérer, lequel ceux auxquels il en parlait, avec un grand artifice allaient attisant, tant plus ils louaient ma suffisance, capacité, intelligence, et grande créance (crédit), tant dedans que dehors le royaume ; auxquels il répondait que, d'autant plus qu'il reconnaissait toutes ces choses véritables, et les tenait chères (précieuses) si je lui demeurais fidèle et loyal, comme j'avais accoutumé, autant les appréhendait-il si l'ambition me dominait et si j'avais de mauvais desseins, auxquels il ne doutait point que je ne fusse secondé par tant de gens ; que j'étais homme, si le dépit et l'avertin (le vertige) me prenaient, à faire plus de mal à l'Etat que n'avait jamais fait l'amiral de Coligny ; et se laissa si bien emporter au courroux, qu'il en discourait avec tous ceux qu'il rencontrait. De quoi je fus aussitôt averti, premièrement par tous ceux de la maison de Lorraine, qui se venaient offrir à moi comme à leur parent et meilleur ami, blâmant le Roi de se douloir (plaindre) si publiquement de moi, et après, plusieurs autres seigneurs et gentilshommes que j'avais obligés, lesquels n'en faisaient pas moins. Tellement que le Roi ayant été averti que chacun désapprouvait une telle promptitude contre moi, qui l'avais si bien et si longuement servi, il commença, comme il me le confessa depuis, d'y avoir regret lui-même, et, se souvenant de la longue lettre que je lui avais écrite, il eût voulu retenir les paroles qu'il avait laissé échapper en plainte de mes intentions, sans s'en être auparavant éclairci comme je l'en suppliais ; et pour découvrir quels pouvaient être mes sentiments sur toutes ces choses, il m'envoya visiter par La Varenne, d'Escures et Béringhen, sous ombre d'autres affaires ; mais n'en ayant pu rien apprendre, pour ce que je ne leur en dis pas un seul mot, ils s'en retournèrent comme ils étaient venus. Pendant son accès de mauvaise humeur, Henri IV avait laissé son esprit aller jusqu'à ajouter foi à un libelle diffamatoire, qui courait manuscrit et qui avait pour titre : Discours d'Etat pour faire voir au Roi en quoi Sa Majesté est mal servie. L'auteur, Juvigny, signalait, disait-il, les grands desseins de Rosny et dévoilait tous les moyens qu'il avait de nuire à la personne du Roi et à son Etat. Après la visite de Béringhen, Rosny en reçut bientôt une autre. Peu après, dit-il, MM. de Villeroy et de Sillery me vinrent aussi voir, sous prétexte d'une dépêche du sieur Ancel[33], qui était près l'Empereur ; en laquelle voyant qu'il n'y avait rien de si grande conséquence qui pût requérir un tel soin, je me doutai aussitôt que quelque autre sujet les y amenait ; comme de fait, ils retombèrent enfin sur la personne et les humeurs du Roi, et les difficultés qu'il y avait à bien servir les princes à leur goût, lesquels se licenciaient souventes fois à parler en mauvais termes de leurs meilleurs et plus loyaux serviteurs, ce qui était fort fâcheux à supporter aux bons courages et aux gens de bien. Ce qu'ils disaient, comme je m'en doutai soudain, plutôt pour me faire parler, trouver de quoi gloser sur mes paroles et m'y rendre de mauvais offices, que non pas pour me consoler et apaiser noise : tellement que je leur répondis qu'il se pouvait trouver des maîtres tels qu'ils disaient, mais que le Roi avait trop de prudence et de bonté pour faire appréhender choses semblables aux gens de bien et qui avaient toujours vécu sans reproche, comme j'avais fait, et que j'avais tellement cette opinion en l'esprit, que quand j'aurais ouï de mes oreilles dire quelque mot de travers à mon désavantage, je croirais que sa langue aurait circonvenu son cœur. Il se passa encore plusieurs autres propos de pareille substance, où chacun disait tout le contraire de ce qu'il pensait ; tellement que ces messieurs, sans pouvoir rien profiter sur mes paroles, s'en retournèrent trouver le Roi, auquel ils dirent seulement qu'ils m'avaient trouvé si discret et circonspect, qu'ils n'avaient quasi pu tirer une seule parole de moi, ce qui n'était pas ma coutume. Le reste de la journée se passa de la sorte, plusieurs personnes me venant faire des contes et tâcher à me faire parler ; à quoi ils ne gagnèrent rien. Et, suivant ma première résolution de ne parler au Roi de toutes ces intrigues, ni d'en faire le moindre semblant s'il n'en entamait le propos auparavant, je me résolus de m'en retourner à Paris[34], comme j'avais, le jour de devant, dit au Roi qu'il y avait des affaires qui requéraient ma présence, afin qu'il ne vît aucun changement en moi. M'en étant donc allé, le matin, à son lever pour prendre congé de lui, je le trouvai dans son cabinet, assis dans sa chaire (chaise), qui se bottait pour aller à la chasse, ayant déjà une jambe bottée, tenant ses petits rouleaux d'ivoire à la main, lesquels il battait l'un sur l'autre. Comme il me vit entrer tout botté, il se leva à demi, m'ôta son chapeau et me donna le bonjour en m'appelant monsieur, qui étaient tous signes d'un esprit ou fort en peine ou fort fâché ; car il m'avait accoutumé de m'appeler, quand il était en bonne humeur, sinon mon ami Rosny, ou Grand Maître. Moi, lui ayant fait aussi une grande révérence, avec plus de profonde humilité que de coutume cela, comme il me le confessa depuis, lui attendrit de sorte le cœur, qu'il pensa dès l'heure m'aller embrasser. Sur quoi s'étant mis à rêver, il dit au sieur Béringhen[35] qu'il ne faisait pas assez beau pour aller à la chasse, et qu'il le débottât. Sur quoi Béringhen lui ayant répliqué que le temps était fort beau, il lui répondit, comme en colère : Non fait[36], il ne fait pas beau temps, et ne veux point monter à cheval ; débottez-moi. Ce qui ayant été fait, il se mit à parler aux uns et aux autres de choses sur lesquelles il croyait me donner sujet de parler ; mais, voyant que je n'en faisais rien, il prit M. de Bellegarde par la main, et lui dit : M. le Grand, allons nous promener, car je veux parler à vous, afin que vous partiez dès aujourd'hui pour vous en aller en Bourgogne, car il y avait quelque malentendu aussi entre eux... Comme le Roi fut sur la porte du petit degré qui descend au jardin de la Reine, il appela Lozeray et lui dit — ainsi que je le sus depuis de lui-même — qu'il prît garde si je le suivais, et qu'il ne faillit de l'avertir, si j'allais ailleurs. Et ainsi s'en étant allé aux jardins de la Conciergerie, parlant toujours à M. le Grand, et jetant de fois à autre les yeux sur moi, sitôt que M. le Grand eut fait ses adieux et qu'il eut quitté le Roi, je m'avançai et lui dis : Sire, vous plaît-il me commander quelque chose ? — Et où allez-vous ? répondit-il. — Je m'en vais à Paris, Sire, lui répondis-je, pour les affaires dont vous me parlâtes il y a deux jours. — Eh bien, allez, me dit-il, c'est bien fait, je vous recommande toujours nos affaires, et que vous m'aimiez bien. Et ainsi lui ayant fait la révérence, et lui m'ayant embrassé comme de coutume, je repris le chemin que j'étais venu. Mais comme je fus à trois cents pas de là, j'ouïs crier mon nom par plusieurs fois ; à quoi ayant tourné la tête, je vis venir La Varenne, qui d'assez loin me dit : Monsieur, le Roi vous demande. Lequel étant retourné sur le chemin du Chenil, sitôt qu'il me vit il m'appela, puis étant près de lui, il me dit : Venez çà, n'avez-vous rien du tout à me dire ? A quoi lui ayant répondu que non pour le présent, il me repartit : Or si, ai bien moi à vous. Et là-dessus, m'ayant pris par la main, il me mena dans les allées des mûriers blancs, qui sont tous environnés de canaux, à l'entrée desquels il fit mettre deux Suisses qui ne parlaient point français, où nous nous promenâmes près de quatre heures ensemble, sans cesser de discourir, lire et entremontrer papiers... Après m'avoir embrassé par deux fois à la vue d'un chacun, il me dit : Mon ami, je ne saurais plus souffrir — des expériences et connaissances de vingt-trois ans nous ayant suffisamment témoigné l'affection et sincérité l'un de l'autre —, les froideurs, retenues et dissimulations dont nous avons usé depuis un mois ; car, pour en dire la vérité, si je ne vous ai pas dit toutes mes fantaisies ainsi que j'avais accoutumé, je crois que vous m'avez aussi celé beaucoup des vôtres ; et seraient telles procédures autant dommageables à vous qu'à moi, et pour aller journellement en augmentant — par la malice et l'artifice de ceux qui envient autant ma grandeur qu'ils sauraient faire votre faveur près de moi —, si je n'y apportais les remèdes convenables. Et pour cette cause ai-je pris résolution de vous dire entièrement tous les beaux contes que l'on m'a faits de vous, les artifices dont l'on a usé pour vous brouiller avec moi, et ce qui m'en est resté sur le cœur : vous priant de faire le semblable, sans craindre que je trouve rien mauvais de toutes les libertés dont vous pourrez user, puisque c'est chose que je veux et vous commande absolument, et ne me taire nuls des rapports que l'on vous a faits de ce que j'ai pu dire ou faire où vous ayez intérêts, ni des fantaisies qui vous sont venues en l'esprit là-dessus, ni même nulles de mes vérités ; car je veux que nous sortions d'ici, vous et moi, le cœur net de tous soupçons, et contents l'un de l'autre, ne doutant point comme parmi quelques vérités que l'on m'a pu dire, l'on y a mêlé mille mensonges et faussetés, l'on n'ait fait le semblable en votre endroit ; et partant, comme je vous veux ouvrir mon cœur, je vous prie de ne me déguiser rien de ce qui est dans le vôtre. De quoi faire ayant tiré ma foi et ma parole, il me nomma tous ceux qui avaient essayé de l'aliéner de l'amitié qu'il me portait, entre lesquels se trouvèrent bien mêlés la plupart de ces diverses sortes de personnes dont j'ai ci-devant fait mention et plusieurs autres, ajoutant qu'ils s'étaient durant quelques années servi de l'artifice des blâmes et des plaintes, et en cette-ci de celui des louanges des bonnes parties qui étaient en moi, et de la douceur dont j'usais envers un chacun, ce qu'il ne me voulait point nier lui avoir grandement touché l'esprit ; s'étant mis en fantaisie que, changeant ainsi soudainement de procédures et usant (ce qu'il savait bien être du tout contre mon humeur) de flatteries, cajoleries, recherches et gratifications envers un chacun, comme ils le publiaient, il fallait bien que j'eusse pris un autre dessein que celui de sa gloire, accroissement de sa domination, amélioration de ses revenus et soulagement de ses peuples, comme je lui avais toujours protesté, et que j'en aimasse d'autres autant ou plus que lui, puisque je préférais leur utilité et contentement au sien. Et afin, me dit-il, que vous n'estimiez pas que j'aie inventé tout cela, pour chercher un prétexte à m'aliéner de vous, je vous ferai voir les divers avis et mémoires qui m'en sont tombés entre les mains, dont j'en ai trouvé les uns tantôt par terre sous ma table, que je faisais ramasser — car, encore que cela me dépitât, si ne laissais-je pas d'avoir la curiosité de les voir —, les autres sous le tapis de ma chambre, les autres que j'avais pris de gens inconnus, lesquels me les présentaient comme si c'eût été des requêtes, les mettant dans mes pochettes, les autres sous le chevet de mon lit, et les autres tout ouvertement, comme celui que, par mon commandement exprès, Juvigny[37] me bailla, il y a dix ou douze jours, lequel m'en bailla un qu'il me dit avoir trouvé par terre dans ma chambre, et qu'il semble qu'en icelui ait été rassemblé tout ce qui était en tous les autres. Je serai bien aise que vous le lisiez devant moi, et que nous en discourions, pour voir si, par le style, nous ne devinerons point qui le peut avoir fait ; car, à mon avis, il y a des inventions qui surpassent l'esprit et la capacité de celui qui me l'a baillé. Lequel me l'ayant mis en main, je le lus tout du long, sans dire aucune chose. Nous savons déjà à peu près tout ce que contenait le libelle. Après l'assurance du dévouement de ses auteurs au service du Roi et les éloges dus à S. M., on commençait l'attaque contre Rosny, qui, disait-on, publiait partout que les affaires de S. M. ne marchaient que grâce à lui, à sa capacité et à ses soins. Venait ensuite le catalogue des favoris des rois, d'abord très dévoués et qui, parvenus au comble de la faveur, étaient devenus traîtres à leur maître ; d'où l'on concluait à la nécessité de se méfier de ces grands esprits devenus tout puissants. On insistait ensuite sur le changement d'humeur survenu dans l'esprit de M. de Rosny, sa douceur, sa libéralité à distribuer les bienfaits du Roi, d'où le grand nombre d'amis qu'il s'était fait récemment au dedans et au dehors du royaume : princes de Conty et de Montpensier, princes de Lorraine, duc d'Epernon, MM. de Montbazon, de Ventadour, de Fervaques, d'Ornano, de Saint-Géran, etc., le roi d'Angleterre, qui ne pouvait se lasser de louer le surintendant, les Etats de Hollande, plusieurs princes allemands, les Suisses. La plus grave de toutes ces faussetés était que Rosny, sous prétexte d'achat d'armes et munitions pour les magasins du roi en France, faisait de pareils achats pour lui hors de France, et que, sous prétexte d'envoyer de l'argent, au compte de S. M., au roi d'Angleterre, aux Pays-Bas, aux Suisses et aux princes d'Allemagne, Rosny rassemblait une grande quantité d'argent à l'étranger, pour faire, un jour, des levées de Suisses, Reîtres et Lansquenets, de telle sorte que les joignant à ses amis de France, il pourrait recommencer à jouer le rôle de l'amiral de Coligny. Le Roi ayant vu que j'avais lu ce libelle tout du long, sans dire un seul mot, changer de couleur ni témoigner la moindre émotion du monde, me dit : Hé bien, que vous en semble de tous ces beaux contes ? — Mais vous-même, Sire, lui répondis-je, qui les avez lus et relus, et si longtemps gardés, quelle opinion en avez-vous ? Car pour moi je ne m'étonne pas tant de toutes ces bagatelles, qui ne sont en effet que fadaises et niaiseries de gens sots et malicieux, comme je fais de voir qu'un si grand Roi, plein d'esprit, de jugement, de courage et de bonté, et qui m'a connu par tant de louables expériences, a pu avoir la patience de les lire, de les garder si longtemps, de me les faire lire tout du long en sa présence, et de me demander ce qu'il m'en semble. Car quelle autre opinion en saurais-je avoir que celle que la prudence vous oblige d'avoir, et que je crois que vous avez en effet, m'assurant que vous avez usé de force à votre bonne inclination et doux naturel pour vous faire écouter toutes ces impostures et calomnies, sans vous en mettre en colère et faire faire une curieuse recherche des auteurs d'icelles, pour en faire une punition exemplaire et très rigoureuse ? Mais afin de ne demeurer pas renclos dans une contradiction universelle et défense générale, je vous supplie très humblement, Sire, de trouver bon que je reprenne toutes ces particulières suppositions, afin de les examiner par les règles de la prudence, de la raison, de la possibilité et des judicieuses lumières de votre esprit. Rosny commença alors une assez longue réfutation de cet immonde libelle, par la perfidie duquel Henri IV avait eu tort de laisser son esprit se toucher ; chacun des cinq points, le dernier surtout, provoqua une protestation indignée contre les calomnies qui s'y étalaient avec tant d'impudence, puis il s'écria : Hé ! vrai Dieu, Sire, si j'avais la moindre fantasquerie de toutes ces sottes imaginations en la cervelle, tâcherais-je journellement à vous élever l'esprit aux choses pleines de gloire ? Aurais-je essayé de conjoindre à ce dessein le roi d'Angleterre et tous les autres princes et républiques avec lesquelles je puis entrer en communication ? Aurais-je tant de fois essayé à vous retirer des dépenses que vous faites tous les ans, pour... vos bâtiments, jeux, chiens, oiseaux et autres plaisirs, en hasard d'encourir votre disgrâce, afin de mettre au trésor toutes ces sommes, qui ne montent guère moins, selon le calcul que j'en ai fait, de 1.200.000 écus[38], somme plus que suffisante pour entretenir 15.000 hommes de pied ? Et qui plus est, vous aurais-je assemblé tant de trésors, d'armes, d'artilleries, boulets et munitions, qu'elles vous rendent formidable aux plus grands monarques ? De toutes lesquelles choses je vous ferai voir, quand il vous plaira, que vous avez plus que vous ne pensez, nonobstant le dire de votre beau libelle ; et partant, Sire, au nom de Dieu, revenez en vous-même ; ôtez-vous de l'esprit toutes ces chimères de cerveaux creux et dépravés ; fermez entièrement les oreilles à tels imposteurs et impostures, calomniateurs et calomnies, mettez-vous le cœur en repos ; reprenez la même confiance que je vous ai vu avoir de ma personne, diligence et probité ; et vous assurez que la vôtre royale, votre gloire, votre honneur, votre contentement et le bien de vos affaires, me seront à jamais aussi chers et précieux que ma vie et mon honneur ; ce que je vous jure sur mon Dieu, mon âme et mon salut ; et me permettez, pour confirmer toutes ces vérités, que je me jette à vos pieds et vous embrasse les genoux, comme à mon Roi bien aimé, unique maître et bienfaiteur. Ce que voulant exécuter, il me retint et me dit : Non, ne le faites pas, car je ne voudrais pour rien du monde que ceux qui nous regardent crussent que vous eussiez commis aucune faute qui méritât une telle soumission ; car ce serait vous faire tort, puisque je vous tiens pour homme de bien et du tout innocent, voire pour le plus loyal et utile serviteur que je saurais avoir, ne me pouvant imaginer que vous n'eussiez eu copie de ce malheureux libelle qui m'a tant agité l'esprit, d'autant qu'autrement vous eût-il été impossible d'y répliquer si suffisamment et le convaincre si facilement de faux par des raisons invincibles, que j'ai honte en moi-même d'avoir seulement écouté telles fadaises, auxquelles je vous donne ma foi et ma parole de ne penser jamais, et de vous aimer et chérir plus cordialement que je n'ai point encore fait. Et sur cela me vint embrasser, me commanda de faire le semblable en son endroit ; et puis ayant repris ses papiers, qu'il me promit de brûler, il me prit par la main et sortîmes de ces allées de mûriers, à l'entrée desquelles ayant trouvé quasi toute la Cour, chacun attendant de voir quelle serait la fin de si longs discours, que l'on se doutait bien avoir pour sujet les mécontentements que le Roi avait quasi tout publiquement témoignés contre moi ; et sur ce qu'ayant demandé quelle heure il était, on lui avait répondu qu'il était près d'une heure, et qu'il n'en était que neuf lorsqu'il était entré dans ces canaux ; il répondit : Je vois bien que c'est ; il y en a auxquels il a plus ennuyé qu'à moi ; et partant, afin de les consoler, je vous veux bien dire à tous que j'aime Rosny plus que jamais, et qu'entre lui et moi, c'est à la mort et à la vie. Et vous, mon ami, ce me dit-il, allez-vous-en dîner, et m'aimez et servez comme vous avez toujours fait, car j'en suis content. Et sur cela, m'ayant encore embrassé, il s'en alla vers le château, et moi vers mon pavillon. Pour terminer le récit de cette brouillerie, M. de Crillon, qui en avait été la cause bien involontaire, consentit à prendre 30.000 écus (540.000 fr.) de récompense de sa charge de mestre de camp du régiment des Gardes et à s'en démettre en faveur de M. de Créqui, gendre de Lesdiguières, qui se confondirent en protestations de reconnaissance et de dévouement envers Rosny, lesquels, plus tard, après la mort de Henri IV, lui rendirent les plus mauvais services. Le lendemain de l'entier raccommodement du Roi avec Rosny, S. M. l'envoya querir de grand matin, et lui dit tout haut devant une infinité de personnes : Mon ami, vous ne sauriez croire comme j'ai dormi de bon somme toute cette nuit, pour m'être ainsi bien éclairci et déchargé le cœur avec vous. Or, dites-moi de votre part, en vérité, si vous n'avez pas l'esprit plus content que vous ne l'aviez eu depuis longtemps. De quoi l'ayant assuré avec mille belles paroles, accompagnées de serments et protestations trop longues à réciter, il me dit : Or bien, je me réjouis de vous voir ainsi content de moi, comme je veux témoigner et faire connaître à un chacun que je le suis aussi bien fort de vous, et que je m'y confie plus que jamais ; car encore que vous soyez ferme huguenot, si n'en veux -je point choisir d'autre que vous pour envoyer de ma part en l'assemblée de Châtellerault, pour y ménager toutes les affaires qui s'y traiteront, sachant bien que nul autre n'y saurait être si propre, ni ne m'y servirait si dextrement et à mon gré : et partant, préparez-vous, et vous disposez à faire ce voyage ; dressez des mémoires et articles de toutes les affaires sur lesquelles vous estimerez qu'il vous soit nécessaire de savoir mon intention, et vos instructions par écrit, et vous en retournez à Paris pour mettre fin aux trois affaires dont nous parlâmes il y a trois jours, et toutes les autres en si bon ordre, qu'elles puissent souffrir votre absence sans aucune altération. Je voulus essayer de m'exempter de cette charge, lui remontrant qu'il serait impossible qu'il ne se passât quelque chose entre tant de diverses affaires de telle nature, que les malins ne relevassent malicieusement, pour tâcher de me calomnier encore et rendre de mauvais offices près de S. M., comme ils m'avaient souvent fait. Sur quoi il me repartit : Mon ami, n'avez point de crainte de cela ; car j'ai trop reconnu ce que je dois croire de votre loyauté ; c'est pourquoi je vous prie de ne penser plus aux choses passées, mais seulement à m'aimer, me bien servir et user de vos diligences accoutumées. Ce que lui ayant promis de faire, il m'embrassa par deux fois et me dit : Adieu, mon ami, aimez-moi bien, car je suis fort content de vous. Rosny exécuta les ordres du Roi à sa satisfaction. Ainsi s'évanouirent les justes inquiétudes que l'on avait eues sur les menées des brouillons huguenots coïncidant avec les pratiques des brouillons alliés de l'Espagne. Bouillon, Duplessis-Mornay et Lesdiguières étaient les directeurs du mouvement des Huguenots qui cherchaient à établir en France une république protestante à peu près indépendante de la royauté ; quelques troubles étaient à craindre. M. de Rosny calma les esprits en accordant aux Huguenots qu'ils conserveraient encore pendant quatre ans les places de sûreté que l'édit de Nantes ne leur accordait que jusqu'en 1606[39]. Libre de ses mouvements, Henri IV, avec un petit corps d'armée, se rendit dans le Limousin, où le duc de Bouillon possédait la vicomté de Turenne. Le duc se hâta de se soumettre et livra toutes ses forteresses. Un tribunal extraordinaire, les Grands Jours, tint ses assises solennelles dans le Limousin, condamna à mort et fit exécuter plusieurs personnes convaincues de trahison avec les Espagnols. Du Limousin, le Roi alla assiéger Sedan, place forte importante possédée par le duc de Bouillon, qui se soumit à l'arrivée des troupes royales et des 50 pièces de canon qui les accompagnaient (avril 1606). Au commencement de l'année 1606, le Roi ordonna à M. de Rosny de choisir une de ses terres pour la faire ériger en duché pairie, ajoutant qu'il commanderait à M. de Villeroy d'en préparer aussitôt les lettres. Rosny ayant désigné la terre de Sully, le 12 février 1606, Henri IV signait les lettres qui faisaient son ministre duc de Sully. Elles furent enregistrées au Parlement le dernier jour de février. Allant au Palais, dit Sully, je fus merveilleusement bien accompagné ; car, hormis M. le comte de Soissons, il n'y eut prince du sang, ni autre, ni personne de qualité de la Cour qui ne me fît l'honneur de m'accompagner et assister en une action tant célèbre ; et se trouvèrent les cours, galeries, salles et grande chambre si emplies de monde, que l'on ne s'y pouvait quasi tourner. Au sortir du palais je priai (invitai) des plus qualifiés environ soixante, de venir dîner à l'Arsenal, où j'avais fait préparer un magnifique festin de chair et poisson. Mais j'y eus un grand surcroît d'honneur, car j'y trouvai le Roi, qui me cria de loin : Monsieur le Grand-Maître, je suis venu au festin sans prier, serai-je mal dîné ? — Cela pourrait bien être, Sire, lui répondis-je, car je ne m'attendais pas à un honneur tant excessif. — Or, je vous assure bien que non, dit le Roi, car j'ai visité vos cuisines, en vous attendant, où j'ai vu les plus beaux poissons qu'il est possible, et force ragoûts à ma mode, et même, pour ce que vous tardiez trop à mon gré, j'ai mangé de vos petites huîtres de chasse, les plus fraîches que l'on saurait manger, et bu de votre vin d'Arbois, le meilleur que j'aie jamais bu. Et sur cela furent les tables servies, où toutes sortes de joyeux propos furent tenus. |