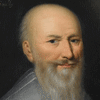ÉTUDE BIOGRAPHIQUE SUR SULLY
CHAPITRE VI. — DEPUIS LA PAIX DE LYON JUSQU'À LA MORT DU MARÉCHAL DE BIRON.
|
1601-1602 L'événement principal de l'année 1601 fut la découverte de la trahison du maréchal de Biron, sa condamnation et son exécution. Henri IV avait appris, pendant la campagne de Savoie, une partie du complot ourdi par Biron avec Charles-Emmanuel. A Lyon même, dans le cloître des Cordeliers, il avait eu avec le maréchal un long entretien. Il lui avait demandé de lui faire connaître le complot tout entier, lui promettant d'avance son pardon. Le maréchal fit quelques aveux, et dit que si le Roi ne lui avait pas refusé le gouvernement de la citadelle de Bourg, il ne se serait jamais écarté de son devoir. Henri IV l'embrassa et lui dit : Bien, maréchal, ne te souvienne jamais de Bourg, et je ne me souviendrai jamais aussi de tout le passé. Le Roi avait une grande reconnaissance pour les services que le premier maréchal de Biron lui avait rendus, et il avait pour le fils une amitié réelle ; il lui avait sauvé la vie, en risquant la sienne, dans plusieurs combats, notamment à Fontaine-Française. Mais le second maréchal de Biron n'avait pas hérité de la loyauté et du noble caractère de son père, l'un des plus grands capitaines du temps. Au lieu de renoncer à ses intrigues criminelles et d'accepter le pardon trop généreux que Henri IV lui accordait, il continua ses pratiques, malgré le mécontentement que le Roi, averti, se contentait de lui montrer. Biron écrivit à Rosny une lettre hypocrite pour lui demander d'intervenir en sa faveur auprès de Sa Majesté : Monsieur, lui disait-il, l'assurance que vous m'avez donnée de vos bonnes grâces et amitié fait que librement je m'adresse à vous, afin que par votre moyen je puisse sortir de la peine où je suis. Si je reçois ce bon office de vous, je vous serai obligé, pour le moins n'espéré-je en recevoir de mauvais, car je tiens vos paroles pour trop vraies, et aussi vous ai-je voué tout humble et dévotieux service. Or, Monsieur, tous ceux qui m'écrivent de la Cour ou qui parlent à de mes amis, me mandent que le Roi témoigne à un chacun une très mauvaise volonté pour moi ; je ne sais d'où procède cela, car je ne crois pas, ni en mes faits ni dits, depuis l'avoir vu au fort Sainte-Catherine, en avoir donné sujet, ains (au contraire) avoir ménagé et régi mes actions pour donner tout contentement à S. M. Si cela n'est, je suis bien trompé. Je vous supplie donner un demi-quart d'heure d'audience à M. Prévost sur ces sujets-là. On me mande que le voyage que je désire faire à Dijon, que le Roi croit que c'est pour faire le malcontent ; je vous jure que cela n'est point et n'y ai pensé, et si n'était la nécessité de mes affaires, je n'y irais ; je serai de retour dans douze jours. Enfin on me dit tant de diverses choses, que je ne sais quels remèdes y apporter ; car recherchant de près mes intentions et volontés, je les trouve telles que les doit avoir un bon sujet et fidèle serviteur ; si je faux (manque), c'est par imprudence. Monsieur, une tête à preuve (l'épreuve) du canon comme la vôtre se troublerait, jugez que peut la mienne, qui n'est ni posée, ni solide. Or donc, je vous supplie que le Roi me prescrive, ordonne et commande ses volontés, et comme il veut que mes paroles et actions aillent ; et si je faux, que je sois blâmé. Mais, depuis le plus grand jusques au plus petit, un chacun discourt et parle des propos que le Roi tient de moi, qui ne sont à mon avantage ; je ne les en crois la plupart toutefois, car je crois n'avoir fait le pourquoi. A jointes mains je vous supplie que je reçoive cet office de vous, vous offrant ma vie et tout ce qui est à moi pour vous faire service, et suis, etc. BIRON. A Mâcon, ce 3 janvier 1601. Malgré ses protestations d'innocence, le maréchal continua ses trames. A quelque temps de là, Henri IV étant allé à Calais visiter la place, la reine d'Angleterre vint à Douvres et écrivit au Roi une lettre dans laquelle elle lui annonçait qu'elle avait quelque chose de considérable à lui communiquer qu'elle ne pouvait écrire ni confier à personne. Ne sachant pas de quoi il pouvait être question, Henri IV envoya Rosny à Londres, où Elisabeth était retournée. Il s'agissait pour elle de savoir si le roi de France était prêt à commencer la guerre, de concert avec l'Angleterre, contre la Maison d'Autriche, ainsi qu'elle avait proposé ce grand dessein dès l'année 1598. Sur quoi Rosny lui dit : Madame, encore que, depuis ce temps-là le Roi ait eu de grandes affaires à démêler, tant à cause de la guerre de Savoie que de plusieurs menées et mauvaises pratiques dans son royaume, desquelles il n'était pas encore exempt, tous lesquels démêlements d'affaires l'avaient constitué en de fort grandes dépenses, que néanmoins je n'avais laissé de si bien ménager ses revenus et toutes autres choses, que j'avais amassé bonne quantité d'artillerie, munitions de guerre et de bouche, voire même d'argent ; mais que tout cela ne serait pas suffisant, néanmoins, pour lui conseiller de porter seul le faix d'une guerre ouverte contre toute la Maison d'Autriche, qui était si puissante qu'il ne se fallait point mêler de l'attaquer à demi ; voire vous semblait-il que la seule association de lui, d'elle et des Etats[1] n'était pas encore suffisante pour commencer un si grand ouvrage, mais qu'il était nécessaire d'essayer à faire une bonne union et confédération avec tous les autres rois, princes, potentats, républiques et peuples qui appréhendaient leur tyrannie, ou qui voudraient profiter de leur diminution. La reine se montra fort satisfaite de connaître l'opinion de Rosny sur cette affaire, pensant bien qu'il connaissait les intentions de son maître sur cette grave question. Elle dit qu'il était bon de s'entendre et de régler les intérêts des alliés à l'avance et de proportionner les désirs d'un chacun ; et en vraie Anglaise elle déclara qu'elle ne pourrait supporter l'acquisition des Pays-Bas espagnols[2] par le roi de France son bon frère. Là-dessus Rosny, la regardant attentivement, tout pensif et sans rien répliquer, Elisabeth reprit la parole et dit : Hé quoi ! M. de Rosny, n'avez-vous pas bien compris mes opinions, ou ne les approuvez-vous pas, comme votre silence me donne sujet d'en croire quelque chose ? — Madame, lui dis-je, tant s'en faut que ce soient ces causes-là qui m'aient retenu de parler aussitôt, que tout au contraire c'est l'admiration en laquelle je suis entré de l'excellence de votre esprit, de la grandeur de votre courage, de votre prévoyance et de votre jugement, ne vous niant point que je n'aie souvent entamé de semblables propos au Roi mon maître, et que je ne l'aie vu en disposition de prendre des conclusions conformes à celles que vous me déclarez maintenant. Après plusieurs discours, on termina par une conclusion sur cinq points, qu'il était jugé nécessaire d'obtenir. Le premier : délivrer les princes et villes de l'Allemagne de la domination tyrannique de la Maison d'Autriche ; les rétablir dans leurs anciens droits et libertés, et surtout en celui de la libre élection de l'empereur et du roi des Romains. — Le second : délivrer les 17 provinces des Pays-Bas[3] et en former un seul corps de république indépendante. — Le troisième : former avec les cantons suisses et leurs alliés, et avec l'Alsace, la Franche-Comté et le Tyrol une autre république. — Le quatrième : chercher les moyens de faire subsister dans ces nouveaux Etats la liberté des divers cultes. — Le cinquième : essayer à rendre tous les rois de la chrétienté les plus approchants qu'il se pourra d'une même grandeur en l'Europe, tant en étendue de pays, que richesse et puissance. Ce projet paraît être la première idée du grand dessein de Henri IV, dont on reparlera plus loin. Après le retour de Rosny à Calais, Henri IV et Elisabeth convinrent des moyens et procédures qu'ils devraient employer l'un et l'autre pour réaliser les projets susmentionnés, et retournèrent ensuite dans leurs capitales. Henri IV était alors fort irrité contre les Espagnols qui ne cessaient de cabaler en France avec Biron, le duc de Bouillon, le comte d'Auvergne, le prince de Joinville et autres, et qui, de plus, venaient d'insulter gravement son ambassadeur à Madrid. Aussi disait-il un jour à Rosny : Je vois bien que ces gens-là ne me laisseront jamais en repos tant qu'ils auront moyen de me troubler, et que les diverses jalousies de gloire et d'honneur et les intérêts d'Etat sont trop difficiles à faire compatir[4] entre ces deux couronnes, et qu'il faut prendre d'autres fondements qu'une simple confiance en la foi et parole donnée pour subsister avec sûreté, tant qu'enfin ils me contraindront à des choses où je n'avais point eu de dessein. Mais, pardieu, j'en jure, si je puis avoir une fois mis mes affaires en bon ordre, assemblé de l'argent et le surplus de ce qui est nécessaire, je leur ferai une si furieuse guerre, qu'ils se repentiront de m'avoir mis les armes à la main. Trente-quatre ans plus tard, Louis XIII et le cardinal de Richelieu réalisaient la pensée de Henri IV. Revenu à Paris, Henri IV reçut de nouveaux et de nombreux avis sur les menées du maréchal de Biron. Toujours bon, trop bon, le Roi essaya de regagner par de nouveaux bienfaits cet esprit dévoyé et méchant ; il lui fit donner par Rosny 30.000 écus (540.000 fr.) Lorsque Biron vint remercier le surintendant des finances, il lui dit qu'il savait bien que c'était à lui seul qu'il devait cette gratification et non pas au Roi, qui ne s'était jamais guère soucié de lui, sinon lorsqu'il avait eu affaire de son courage et de son épée, sans lesquels il ne fût jamais parvenu si facilement à la couronne. En vain Rosny essaya-t-il de le calmer, et lui donna-t-il les meilleurs conseils ; le maréchal continua à se répandre en plaintes, rodomontades, menaces, jactances et vanités. De quoi le Roi, prévenu par Rosny, lui dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter de ces langages du maréchal, et, poussant la bonté à l'extrême, il l'envoya en Angleterre en qualité d'ambassadeur extraordinaire pour lui faire part de son mariage avec Marie de Médicis. Sans nul doute Elisabeth avait été avertie des machinations de Biron, car elle lui dit une parole fort grave qui aurait dû lui donner à réfléchir. Le comte d'Essex, favori de la reine d'Angleterre, avait trahi sa souveraine, qui lui avait fait trancher la tête : Si j'étais à la place du Roi mon frère, dit-elle un jour au maréchal, il y aurait des têtes coupées à Paris comme à Londres. Dieu veuille toutefois qu'il se trouve bien de sa clémence ! Pour moi, je n'aurais jamais pitié de ceux qui troublent un Etat. Revenu d'Angleterre, Biron fut envoyé en Suisse, toujours en qualité d'ambassadeur extraordinaire, pour le renouvellement de l'alliance de la France avec les Cantons. Pendant ce temps, Rosny obtenait pour son frère la charge d'ambassadeur à Rome, malgré la mauvaise volonté de deux autres ministres, MM. de Villeroy et de Sillery, jaloux à l'extrême de l'influence de Rosny. Il y eut à ce sujet, et devant le Roi, une querelle assez vive entre tous ces Messieurs, dans laquelle la raideur du caractère de Rosny se montre si à nu, que nous croyons devoir en reproduire les détails. Nous étant mis à nous entrepicoter, chacun essayant de mettre en avant ce qu'il estimait le plus valoir en soi et le moins en autrui, et m'étant persuadé, par les discours qu'ils tenaient, qu'ils voulaient faire aller leurs services du pair avec les miens, je leur répondis, demi en colère, que toutes comparaisons étant toujours tenues pour odieuses entre toutes personnes, elles seraient incessamment réputées telles entre les nôtres, eu égard à la diversité des naissances, professions, qualité et quantité de services ; et comme ils voulaient répliquer, et surtout le petit M. de Villeroy, fier comme un aspic, ayant les joues bouffies et les yeux rouges de dépit, le Roi leur imposa silence, et nous dit à tous trois, avec démonstration de colère, qu'il ne trouvait nullement bonnes ces picoteries, contestations et reproches mal fondés ; qu'il nous défendait d'en user jamais, surtout en sa présence, et qu'il nous tenait tous trois pour bons et utiles serviteurs, de quoi diverses actions lui avaient rendu des preuves notables. Sur quoi le dépit me faisant passer mesure, je repartis, et, m'adressant au Roi même, lui dis que puisqu'il approuvait ainsi également les services des uns et des autres, que je n'avais plus rien à répliquer, d'autant que son opinion et sa créance (ce qu'il croyait), en telles matières, devaient être les juges souverains et décisifs de ce différend ; mais que si j'avais à débattre cette cause avec un autre que mon roi et mon maître, les volontés duquel me seraient toujours pour lois inviolables, je penserais lui faire bien reconnaître par vives et solides raisons, — sans mettre même en avant que j'avais incessamment couru sa fortune, quelque délabrée qu'elle eût été longues années, que je n'avais jamais eu d'autre maître ni assisté ses ennemis[5] et que j'avais plus reçu de plaies qu'ils n'avaient taillé de plumes, et plus répandu de sang pour son service qu'ils n'avaient mis d'encre dans leurs écritoires, — qu'il y avait grande différence entre les services des gentilshommes et gens de guerre, et ceux des gens de robe longue et d'écritoire, les vacations et emplois de ceux-ci étant de telle nature qu'ils ne pouvaient jamais déplaire, désobéir, contredire, ni manquer à faire ce qui leur était commandé s'ils ne voulaient, leurs charges ne consistant qu'à prôner, caqueter, faire la mine, écrire et sceller, qui sont toutes choses qui résident en la volonté ; au lieu que ceux-là qui faisaient le métier de la guerre et s'employaient aux finances étaient obligés à produire des réalités, des substances et des effets qui ne dépendaient pas de leur vouloir, l'argent ne se trouvant pas, les places ne se fortifiant, attaquant ni défendant pas, les combats ne se faisant pas, les pièces d'artillerie ne s'exploitant pas, les batailles ne se donnant pas, les victoires ne s'obtenant pas avec des mains de papier, des peaux de parchemin, des coups de ganivet (canif), des traits de plumes, des paroles vaines, des sceaux et de la cire ; bref avec des imaginations, fantaisies, mines et simagrées : ce que je ne doutais point que S. M. ne reconnût encore mieux que je ne l'avais représenté, la suppliant néanmoins de m'excuser si le mépris que l'on faisait de mon frère et de moi avait été cause de l'excès dont l'on pourrait accuser mes paroles, et de leur accorder un pardon convenable à l'offense. A quoi le Roi répondit brusquement et comme si la continuation de tels langages lui eût déplu : Bien ! bien ! je vous le pardonne et aux uns et aux autres, et considère vos paroles comme il faut ; mais à la charge toutefois que vous ne rentrerez plus en telles picoteries, et que quand l'un d'entre vous désirera favoriser quelqu'un de ses amis près de moi, les autres ne s'y opposeront plus avec aigreurs et animosités, mais s'en remettront doucement à mon choix, lequel je fais, pour le présent, en faveur du sieur de Béthune, duquel j'estime la maison, l'esprit, la prud'homie (sagesse), même la capacité, l'ayant employé en diverses affaires de paix et de guerre, desquelles il s'est dignement acquitté ; et afin que vous n'estimiez pas, dit-il, adressant sa parole à M. de Villeroy, que je préfère Béthune à ceux que vous projetiez de me nommer pour la charge d'ambassadeur à Rome, dès à présent je vous promets de la leur réserver au retour de Béthune, avec lequel, ce pendant, je vous ordonne de vivre en bonne amitié et parfaite correspondance, afin que mon service n'en reçoive dommage. Et sur cela nous ayant derechef commandé à tous trois de nous comporter avec affection et respect, les uns avec les autres, il quitta le promenoir où il avait été plus de deux heures avec nous, à cause de nos disputes, et s'en alla dîner. Quelque temps après la naissance du Dauphin[6], Henri IV, appuyé avec Rosny sur le balcon de la grande allée de l'Arsenal, où il était venu se promener et voir les magasins qui commençaient à se bien remplir d'armes, annonça au grand-maître qu'il avait reçu de divers côtés des avis certains que le maréchal de Biron continuait ses pratiques criminelles ; que, malgré le pardon qui lui avait été accordé à Lyon, malgré les serments qu'il avait faits de ne retomber jamais de sa vie en pareils crimes, malgré les faveurs qu'il avait reçues depuis, le maréchal avait renouvelé son alliance avec la Savoie, l'Espagne, le comte d'Auvergne et le duc de Bouillon, et qu'il cherchait à entraîner avec lui quelques princes et les plus grands officiers, et à soulever les villes et les peuples du Poitou, du Limousin et de la Guyenne, mécontents de certains impôts. Le principal agent de Biron auprès de Charles-Emmanuel et du comte de Fuentès[7] était un gentilhomme bourguignon, Jacques de la Fin, qui, mal satisfait du maréchal, s'était retiré récemment chez lui. Le Roi résolut de le pratiquer, le fit venir à Fontainebleau, lui promit un pardon complet, et apprit, par ses aveux, tout le détail de la conspiration. La France devait être démembrée et transformée en monarchie élective, à la façon de l'empire d'Allemagne, chaque grand seigneur devenant prince héréditaire dans son gouvernement ; Biron devenait duc souverain de la Bourgogne, et épousait une fille du duc de Savoie ; Henri IV devait être assassiné. Quelques temps après, le Roi écrivit à Rosny le billet suivant : Mon ami, venez me trouver en diligence pour une chose qui importe à mon service, votre honneur et le commun contentement de nous deux. Adieu. Je vous aime bien. Aussitôt Rosny prit la poste, et, arrivé à Fontainebleau, il trouva S. M. à cheval et partant pour la chasse. Lors, ayant mis pied à terre, je lui vins embrasser la botte, et il me serra la tête contre son cœur, selon sa coutume, puis me dit : Mon ami, il y a bien des nouvelles ; toutes les conspirations contre moi et mon Etat, dont nous ne faisions que nous douter, sont maintenant découvertes, voire le principal des négociateurs d'icelles m'est venu demander pardon et me tout confesser. Il y embrasse beaucoup de gens et des plus grands et des plus obligés à m'aimer. Mais c'est un grand menteur et suis résolu de ne rien croire de lui que sur bonnes preuves ; entre autres il y en met que vous ne penseriez jamais : or, devinez qui ? — Jésus ! Sire, dis-je, deviner un homme qui soit traître, c'est ce que je ne ferai jamais. Et après qu'il m'eut dit deux ou trois fois : mais encore, devinez, et que je lui eus toujours répondu que je ne devinerais jamais cela, il me dit : M. de Rosny en est ; le connaissez-vous bien ? Lors je me mis à rire et lui dis : Hé quoi ! Sire, les autres n'en sont-ils point plus que moi ? Si ainsi est, vous ne vous devez pas mettre en beaucoup de peine ; car l'effet vous justifiera la sincérité de mon cœur. — Or bien, dit le Roi, aussi n'en ai-je rien cru, et pour vous le montrer, j'ai commandé à Bellièvre et à Villeroy de vous aller trouver et vous porter toutes les accusations, tant contre vous que contre tous les autres, et faire voir les preuves ; et même j'ai dit à La Fin, qui est celui qui m'a découvert la menée, que je voulais qu'il vous vît, et vous parlât de tous ces desseins. Rosny s'entretint longuement avec La Fin, puis avec MM. de Bellièvre et de Sillery ; et tous les trois réunis en conseil avec le Roi convinrent de ne rien faire contre les conjurés jusqu'à ce que l'on eût trouvé le moyen de faire venir Biron à la Cour, où l'on s'assurerait de sa personne. Le Roi avait érigé au mois d'août 1601 la baronnie de Rosny en marquisat[8] ; au commencement de 1602, il nomma Rosny capitaine de la Bastille, afin de lui prouver la grande confiance qu'il avait en lui, et afin que s'il avait des oiseaux à mettre en cage et tenir sûrement, lui dit-il, il pût s'en reposer sur sa prévoyance, diligence et loyauté. Car, ajouta le Roi, pour vous en dire la vérité, voyant tant de gens enveloppés dans ces pratiques et menées, je ne vois que vous qui ayez toutes les parties requises pour me bien servir en une si importante occasion. Henri IV entretenait dans toutes les provinces éloignées[9] des serviteurs dévoués, bien affidés, pour l'avertir toujours de tout ce qui s'y passait. A ce moment on le prévint que partout une grande quantité de gens, tant d'une que d'autre religion, pratiqués par quatre ou cinq grands seigneurs, décriaient son gouvernement et cherchaient à le rendre odieux et le mettre en la haine universelle. Henri IV partit pour le Poitou afin d'apaiser la fermentation des peuples. Arrivé à Blois, le Roi trouva les ducs d'Epernon et de Bouillon, et chercha à connaître les dispositions de leur esprit ; ils protestèrent de leur fidélité, et le Roi se contenta pour le moment de leurs promesses. Puis il tint un conseil, dans lequel on examina si l'on devait arrêter le comte d'Auvergne et les ducs d'Epernon et de Bouillon. Rosny fut seul d'avis qu'il fallait les laisser en liberté ; lorsque ce fut son tour à opiner, il dit au Roi : Sire, je me trouve en ceci bien empêché, car je ne vois encore aucunes preuves bien certaines contre MM. d'Epernon et de Bouillon, et partant je ne saurais être d'avis de les arrêter sur de simples conjectures et opinions, s'y rencontrant plusieurs inconvénients et difficultés, d'autant que si vous les prenez comme accusés de trahison, en premier lieu vous effaroucherez les vrais coupables, et ne pouvant rien vérifier (prouver) contre ceux-ci qui seront pris, vous justifierez les autres, et faudra qu'il s'en ensuive sur les captifs plusieurs rigueurs mal convenables à votre humeur si pleine de clémence ; car telles personnes ainsi offensées sont de dangereuse réconciliation. Et pour moi, je ne vois point qu'il y ait plus de preuves contre ces deux-ci que contre moi ; que La Fin, sous prétexte de deux lettres de civilité au maréchal de Biron, par lesquelles je le faisais ressouvenir des conseils que je lui avais donnés et de lier ensemble une amitié inaltérable au cas qu'il les voulût suivre absolument, voulait faire croire que j'étais de son intelligence et défection, étant bien assuré que je ferai croire le contraire par la suite de l'issue de cette affaire, et connaître qu'un innocent n'est pas toujours garanti de la calomnie et des langues envieuses et médisantes. Le Roi adopta l'avis de Rosny, qui, en sortant du château pour aller dîner en son logis, fut abordé par beaucoup de gens, comme on fait les favoris. M. d'Epernon l'accosta aussi et lui dit que ces conseils si longs et si secrets mettaient beaucoup de gens en alarme ; mais que pour lui il n'y entrait nullement, d'autant que sa conscience le rassurait : C'est le meilleur refuge de tous, Monsieur, lui répondit Rosny, principalement au règne où nous sommes ; car le Roi n'a nulle inclination à la violence ni à la sévérité ; mais tout au contraire il est si bénin que, quand quelqu'un aurait attenté contre lui et contre son Etat, s'il savait qu'il s'en repentît à bon escient[10], il lui pardonnerait aussitôt et l'aimerait comme auparavant. Je vois force gens qui s'éloignent de la Cour, mais ceux qui ont la conscience nette ne le doivent pas faire, car ils n'ont rien à craindre. — Or, je suis de ce nombre-là, dit M. d'Epernon, et ne partirai pas de la Cour tant que ces ombrages dureront. — Vous ne sauriez mieux faire, Monsieur, dis-je, et ferai valoir cette résolution où il faut. Le Roi avait recommandé à Rosny de dîner en soldat, c'est-à-dire de manger trois morceaux et de boire deux coups, et de revenir aussitôt le trouver. Rosny obéit, suivant sa coutume, et vint raconter à S. M. ce que d'Epernon lui avait dit. Il m'en a dit autant, répliqua le Roi, et, en effet, je crois bien que M. d'Epernon n'est point de toutes ces menées par actes visibles ; il est trop habile homme et craint trop de perdre son bien et ses charges pour s'embarrasser parmi tous ces esprits brouillons, avec lesquels aussi bien il n'y a rien à gagner pour lui, et même n'y saurait jamais vivre ni compatir[11] ; et puis il ne voit pas grand fondement à tout cela, vu l'état où sont maintenant mes affaires. Je ne dis pas qu'en son petit cœur il ne fût peut-être bien aise que quelqu'un me traversât, afin que j'eusse d'autant plus affaire de lui ; mais difficilement se mettra-t-il jamais d'autre parti que celui du Roi ; ayant éprouvé de combien de difficultés tels desseins sont ordinairement accompagnés ; néanmoins il le vous faut maintenir en cette bonne disposition ; voyez aussi MM. de Bouillon et de la Trimouille, et leur parlez de demeurer à la Cour, pour voir ce qu'ils vous diront ; néanmoins, attendez que nous soyons à Poitiers, car entre ci et là nous serons éclaircis de beaucoup de choses. Mais le duc de Bouillon et M. de la Trimouille, malgré leurs protestations, ne jugèrent pas à propos de demeurer auprès du Roi, et les Huguenots intransigeants, dont la conspiration était permanente et parallèle à celle de Biron, s'en allèrent également, indiquant ainsi leur mauvais vouloir. Henri IV continua son voyage, força les peuples du Poitou, du Limousin et de la Guyenne à se soumettre à l'impôt qui les avait mécontentés, et aussitôt il le révoqua. Les peuples satisfaits et apaisés, il revint à Fontainebleau. Biron, décidé par les conseils du président Jeannin et par les mesures que prit M. de Rosny, vint aussi à Fontainebleau, espérant tromper encore une fois Henri IV. Quelque temps auparavant, Rosny avait enlevé à Biron toute l'artillerie et les poudres qui se trouvaient en Bourgogne, dont le maréchal était le gouverneur. Rosny lui avait fait croire qu'il était utile de refondre les canons et de renouveler les poudres, et que l'arsenal de Lyon allait lui remplacer immédiatement ce qu'on lui enlevait : en effet, on chargea sur la Saône canons et poudres, et Biron consentit à laisser partir son artillerie. Mais par l'industrie de Rosny, on fit descendre les bateaux qui apportaient à Lyon l'artillerie du maréchal, et l'on arrêta ceux qui devaient lui porter la nouvelle. Il fut bien obligé alors de se soumettre, le baron de Lux, son confident[12], lui ayant représenté, dit Sully : Qu'il n'était rien resté dans ses places de quoi se défendre, et que si le Roi venait à lui la tête baissée, avec ses diligences accoutumées, il serait contraint de quitter le royaume et n'apporter aux ennemis qu'un esprit ulcéré et une fortune ruinée : de quoi il fut en une telle furie contre moi, qu'il ne s'en pouvait taire, jusques à user de menaces de me poignarder, disant que je l'avais affiné ; de quoi le Roi ayant eu avis, il m'en avertit, et même fit commandement de me bien accompagner. Lux avait aussi représenté au maréchal que l'argent qu'on lui avait promis pour faire la guerre n'était pas encore arrivé ; que ses traités avec l'Espagne et la Savoie n'étaient pas encore définitivement conclus ; que le Roi ne savait rien, et qu'on le tromperait encore cette fois comme on l'avait déjà endormi à Lyon. Sitôt que Biron fut arrivé à Fontainebleau, Henri IV écrivit un mot de sa main à Rosny, qui était allé se promener à Moret. Mon ami, notre homme est venu, qui fait fort le retenu et le prudent. Venez en diligence, afin que nous avisions à ce que nous avons à faire. Adieu, je vous aime bien. Aussitôt Rosny monta à cheval, arriva au galop et trouva le Roi qui se promenait et qui lui dit : Mon ami, voilà un malheureux homme que le maréchal, c'est grand cas[13]. J'ai envie de lui pardonner, d'oublier tout ce qui s'est passé, et lui faire autant de bien que jamais. Il me fait pitié, et mon cœur ne se peut porter à faire du mal à un homme qui a du courage, duquel je me suis si longtemps servi et qui m'a été si familier. Mais toute mon appréhension est que, quand je lui aurai pardonné, qu'il ne pardonne ni à moi, ni à mes enfants, ni à mon Etat ; car il ne m'a jamais rien voulu confesser, et vit avec moi comme un homme qui a quelque chose de malin[14] dans le cœur. Je vous prie, voyez-le ; il est votre parent et fait mine d'être votre ami, encore qu'en son âme il vous haïsse merveilleusement, d'autant qu'il dit que vous l'avez affiné par vos belles paroles. Ne laissez pas néanmoins de parler à lui comme à cœur ouvert, mais avec discrétion et en sorte qu'il ne puisse pas juger que nous savons tout et que nous avons des preuves contre lui, suffisantes pour le convaincre ; car il croit que nous ne savons rien, d'autant que La Fin lui a dit à l'oreille en arrivant : Mon maître, courage et bon bec ; ils ne savent rien. Néanmoins s'il s'ouvre à vous sur les discours que vous lui tiendrez et certitude de ma bienveillance que vous lui donnerez, assurez-le qu'il peut en toute fiance me venir trouver, faire confession de tout ce qu'il a pensé, dit et fait, moyennant qu'il ne me cèle rien, et que je lui pardonne de bon cœur, comme je vous en donne ma foi et ma parole. Sur cela je m'en allai au château et trouvai le maréchal en la chambre du Roi, assis au chevet de son lit, parlant à M. de la Curée[15] ; et comme à mon arrivée il ouit le bruit de ceux qui me saluaient et faisaient place, parce que j'étais fort accompagné, il s'avança et me vint saluer, mais fort froidement. Je l'embrassai avec gaieté et témoignage d'affection, et lui dis : Hé ! quest-ce que ceci, Monsieur ? vous me saluez en sénateur et non pas à l'accoutumée. Ho, ho, il ne faut pas faire ainsi le froid ; embrassez, embrassez-moi encore une fois, et allons causer ; car si vous me voulez croire tout ira bien. Là-dessus nous étant tous deux assis au chevet du lit du Roi, je lui dis : Hé bien, Monsieur, quel homme êtes-vous ? avez-vous salué le Roi ? quelle chère[16] vous a-t-il faite ? que lui avez-vous dit ? Vous le connaissez bien ; il est libre et franc, et veut que l'on vive de même avec lui. L'on m'a dit que vous aviez fait le froid et le retenu avec lui ; cela n'est pas de saison, ni selon son humeur et la vôtre. Je suis votre parent, votre serviteur et votre ami : croyez mon conseil, et vous vous en trouverez bien ; dites-moi librement ce que vous avez sur le cœur, et pour certain j'y apporterai remède, et ne craignez point que je vous trompe. Lors il me dit : J'ai fait la révérence au Roi, avec le respect et l'honneur que doit un serviteur et sujet envers son maître et son Roi. Je lui ai répondu sur tout ce qu'il m'a enquis ; mais ce n'ont été que propos communs et paroles générales ; aussi n'avais-je rien davantage à lui dire. Or, Monsieur, dis-je, ce n'est pas comme il faut procéder envers cet esprit vraiment royal : ouvrez-lui votre cœur et lui dites tout, ou à moi si vous voulez, et devant qu'il soit nuit, je vous réponds que vous demeurerez contents l'un de l'autre. — Je n'ai rien à dire au Roi, ni à vous, plus que j'ai fait ; mais si S. M. a quelque défiance ou mécontentement de moi, que lui ou vous me le disiez librement, sur quoi et que c'est, et lors j'y répondrai de même. — Ce qui fâche le plus l'esprit du Roi, dis-je, ce sont vos froideurs ; car d'autres particularités, il n'en sait point de précises. Mais que votre conscience vous juge vous-même, et conduisez-vous tout ainsi que si vous croyiez que nous sussions tout ce que vous avez fait, dit et pensé de plus secret ; car je vous jure en ma foi que c'est le vrai moyen d'obtenir du Roi tout ce que vous sauriez désirer. Pour moi, quand j'ai fait quelque peccadille, je lui reconnais être pour un grand péché, et c'est alors qu'il fait tout ce que je veux ; je ne vous donne point d'autre conseil que celui que je prends ordinairement pour moi-même. Hé ! pardieu (vous me faites jurer), si vous le voulez suivre, vous et moi gouvernerons la Cour et les affaires. — Je veux bien vous croire, me répondit-il, mais je ne sais rien et n'ai à confesser péché ni peccadille ; car j'en sens ma conscience fort nette depuis ce que j'ai confessé au Roi à Lyon. Après quelques autres propos de compliments, il s'en alla en son logis. Quasi aussitôt le Roi arriva ; auquel ayant conté tout ce que dessus, il me dit : Vous avez été un peu bien avant, voire assez pour le mettre en soupçon et le faire en aller, et vous voyez que vous n'en avez rien su tirer : c'est ce que je vous ai toujours dit, qu'il est résolu de ne me point pardonner, quelque pardon, bien et honneur que je lui fisse, s'étant trop laissé emporter à ses espérances pleines de vanité, et à vouloir devenir souverain. Entrez dans cette galerie et m'y attendez ; car je veux parler à ma femme et à vous ensemble, et qu'il n'y ait personne que nous trois. Peu après, il arriva avec la Reine, et ayant fermé la porte de la galerie au verrou, il me dit : Hé bien ! ne reconnaissez-vous pas bien maintenant quelle est la résolution du maréchal ? Elle est de troubler mon Etat, que j'ai eu tant de peine à pacifier, et de m'ôter le moyen de soulager mes sujets de tant de tailles et subsides dont ils sont oppressés et de leur faire voir que je ne suis pas seulement leur Roi mais aussi leur père. Or, avisons donc le moyen d'étouffer tant de pernicieux desseins à leur naissance, dont je n'en vois point de plus propres que de se saisir du comte d'Auvergne et du maréchal ; et le tout consiste maintenant à savoir comme il le faut faire. J'en ai pensé un moyen, qui est de faire investir cette nuit les logis où ils seront couchés et les faire prendre au lit. Que vous en semble ? A quoi je répondis : Sire, je n'ai pas tant songé à cette exécution que l'importance d'icelle le mérite ; mais, selon ce qui m'est le premier venu en l'esprit, V. M. m'excusera si je réprouve entièrement la forme par elle proposée, et vous dis qu'il n'y en a point de meilleure que de les amuser ce soir dans votre chambre et cabinet, et là se saisir d'eux, lorsque la plupart du monde, s'ennuyant de ces longueurs, se sera retiré ; car, par ce moyen, cela se fera facilement, sans rumeur et à petit bruit. Lors le Roi me dit : Je ne vois point d'apparence à ce que vous dites, si je ne veux remplir de sang ma chambre et mon cabinet, car ils mettront l'épée au poing et se défendront ; et si cela se doit faire ainsi, je ne veux point que ce soit en ma présence ni dans mon logis, mais dans le leur. Je contestai toujours là-dessus, et néanmoins le Roi s'opiniâtra au contraire, et me dit : Je suis résolu en cela et ne m'en parlez plus ; allez-vous-en à votre logis souper, puis, vers les neuf heures, bottez-vous et tous vos gens, faites seller tous vos chevaux, attendez de mes nouvelles, et vous tenez prêt de partir si je le vous mande. Ainsi je m'en vins à mon pavillon, qui était tout vis-à-vis celui du maréchal, et après souper je me bottai, fis botter tous mes gens, seller mes chevaux et apprêter mon bagage, puis me retirai dans ma petite chambre, qui avait vue sur le pavillon du maréchal, m'attendant d'heure à autre de le voir attaquer, me promenant et quelquefois lisant. J'ouis sonner neuf, dix, onze et douze heures. Lors je sortis à la grande chambre, où je trouvai tous mes gens, les uns jouant, les autres causant et les autres dormant, et je leur dis : Il y en pourra bien avoir eu qui n'auront pas bien pris leurs mesures, et qui, pour ne pas croire conseil, auront laissé échapper des oiseaux qui ne se réclameront pas aisément et qui leur étaient aisés à retenir. Que l'on aille brider mes chevaux et charger mon bagage pendant que je m'en irai dans ma chambre pour écrire un mot ; où je n'eus pas été demi-heure, que j'ouis rabâter à la porte de mon pavillon, et en même temps crier : Monsieur, le Roi vous demande. Et ayant mis la tête à la fenêtre, j'ouis parler La Varenne, qui me dit : Monsieur, venez tôt, le Roi veut parler à vous, et vous envoyer à Paris donner ordre à tout ; car MM. de Biron et comte d'Auvergne sont arrêtés prisonniers. — Et où ont-ils été pris, dis-je ? — Dans le cabinet du Roi, me dit-il. — Or, Dieu soit loué, que le Roi ait suivi bon conseil[17]. En même temps je l'allai trouver qui me dit : Nos gens sont pris, montez à cheval, allez leur préparer leur logis à la Bastille ; je les enverrai par bateau à la porte de l'Arsenal, du côté de l'eau. Faites-les-y descendre, qu'il ne s'y trouve personne, et les menez sans bruit, par vos cours et jardins, où il faut ; puis, après que vous aurez tout ordonné et même devant qu'ils arrivent — car ce ne sera pas longtemps après vous —, allez au Parlement et à l'Hôtel-de-Ville, et leur faites entendre ce qui s'est passé, dont ils sauront les causes et les raisons, à mon arrivée, lesquelles je m'assure qu'ils trouveront justes. Un complot fut organisé pour délivrer les prisonniers ; un autre, pour enlever Rosny et en faire un otage, sa vie allant pour la leur. Henri IV, averti par sa police vigilante, en prévint Rosny. Biron fut jugé, condamné et exécuté à la Bastille, le 31 juillet 1602. Dans ces temps-là, on savait punir un maréchal de France traître envers la Patrie. Biron décapité, Henri IV pardonna à ses complices. Quelques-uns, des plus qualifiés, et que Rosny ne nomme pas, se repentirent, avouèrent et se conduisirent dès lors en gens d'honneur. Deux autres, le comte d'Auvergne, continua ses menées avec l'étranger ; Bouillon refusa tout accommodement. Quelques jours après l'exécution du maréchal, Henri IV vint voir Rosny en son cabinet de l'Arsenal et lui dit : Hé bien ! vous voyez comme ceux auxquels j'ai fait le plus de faveurs, de biens et d'honneurs ont été ceux qui m'ont donné le plus de traverses, et ont le plus envié ma grandeur et la prospérité de mes affaires. Car que n'ai-je point fait pour le comte d'Auvergne, les ducs de Biron et de Bouillon, et trois autres que vous savez et que je ne veux plus nommer, puisqu'ils se sont repentis ? Voire, que n'ai-je point souffert d'eux et de leurs extravagantes fantaisies, ambitions déréglées et avarices insatiables ?... Or, vous dis-je tout ceci non pour soupçonner que vous ayez besoin de cette leçon, ni que vous soyez de si mauvais naturel que de me rendre le mal pour le bien ; mais je serai bien aise de vous faire entendre clairement mes intentions, et que vous me disiez aussi franchement les vôtres, afin que nous convenions ensemble de la forme de vivre que nous aurons à prendre et tenir pour durer longuement unis ensemble, persistant : moi, à être incessamment bon roi et bon maître ; et vous, toujours bon sujet, loyal et utile serviteur, comme nous nous sommes entre-éprouvés tels l'un l'autre jusques à présent. Ma résolution est donc de continuer à vous aimer plus que nul autre, d'élever et enrichir votre maison, que je sais bien être ancienne, de vous faire des honneurs et des biens. Mais je veux tellement assaisonner[18] tout cela, que non seulement il ne donne occasion à personne de haine ou d'envie contre vous, par sa promptitude et son excès, qui ne vous puisse donner à vous-même ni le moyen ni le désir de vous méconnaître, de vouloir faire votre fortune sans moi, ni par autre voie que celle de mes bonnes grâces et vos utiles services, mais aussi exempte mon esprit — lequel rebattu de tant d'infidélités devient vieux et par conséquent plus défiant que de coutume — de toutes causes et occasions d'ombrages et de soupçon contre vous, à qui pour ces raisons je veux bien bailler, lorsque les occasions naîtront et que l'état de mes affaires le pourra requérir, des charges et des dignités, comme pairie, offices de la Couronne et gouvernement de province, vous donner le premier lieu de faveur et de crédit au maniement des affaires. Mais ne vous attendez point que je vous baille de grandes villes et fortes places, par le moyen desquelles et de votre grand crédit et capacité, vous joignant ou aux Huguenots ou à d'autres factions, vous puissiez vous passer de moi, voire troubler le repos de mon esprit et la paix de mon royaume quand bon vous semblerait. Je veux donc, en vous faisant des biens et des honneurs, qui ne seront pas petits, je le vous promets ainsi, et vous en donne ma foi et ma parole, ils soient néanmoins tels qu'ils dépendent toujours de ma bienveillance, et qu'icelle vous venant à manquer, ils ne puissent, par quelque dépit vous porter à me nuire, et moi donner mauvais exemple aux miens, faisant pour un serviteur plus que ne doit un bon Roi, qui a soin de son honneur, de sa réputation, de son Etat, et du soulagement, bien et repos de ses peuples. Donc, outre vos états et appointements, qui sont assez grands pour vous nourrir et tout votre train, je vous veux encore donner tous les ans d'extraordinaire 50 ou 60.000 livres (300 ou 360.000 fr.), d'autant que cela joint avec votre revenu que vous épargnerez entièrement — car je sais, et c'est une des choses qui m'a autant confirmé à me servir de vous aux finances, que vous ne l'emploierez ni en festins, ni en chiens, ni en oiseaux, ni en chevaux, ni en habits —, sera suffisant pour meubler et bâtir vos maisons, et acquérir quelques terres tous les ans, afin de partager vos enfants, auxquels, quand vous les marierez, je ferai encore voir ma libéralité et combien je vous aime ; voire j'ai déjà quelque chose en l'esprit — que je ne vous dirai pas à présent, mais en temps et lieu — dont vous aurez sujet d'être content et de dire que vous serez plus que n'aviez espéré. C'est maintenant à vous à me faire savoir et me déclarer librement votre opinion sur toutes ces choses, et vous en prie, comme étant votre bon maître et ami particulier. Lors ayant pris la parole, je lui dis : Sire, votre personne, votre prudence, votre courage et votre bon naturel se rendent plus qu'admirables, et ne saurais assez les louer ni estimer, tant pour ce qui regarde votre personne royale, vos enfants et votre Etat, que moi-même, qui trouve déjà en ce qu'il vous a plu me proposer, non seulement de quoi me contenter et y trouver l'entier accomplissement de mes désirs, mais aussi de quoi confesser que c'est beaucoup plus que mes services, mes mérites ne pouvaient attendre, voire même mes espérances ne pouvaient concevoir. J'accepte donc avec honneur, humilité et joie indicible, les sacrées paroles de V. M., protestant de n'avoir de ma vie, ni ambition, ni convoitises de richesses, ni passions, ni affections que celles qui me seront suggérées par V. M. même ; et encore, si j'en reconnaissais quelqu'une qui, par excès de votre bienveillance, me fût apprêtée, et qui pût être préjudiciable à vous et à votre Etat, de la refuser absolument, ne vous suppliant de plus que d'une seule chose, qui est de n'ajouter point foi aux calomnies et faux rapports que l'on vous pourrait faire de moi, et juger de mes intentions par mes effets et par mes services, et non du tout par mes paroles, craignant que la promptitude de mon esprit ne m'en pût faire échapper quelquefois quelqu'une mal à propos. Quant aux accusations, je ne les redoute point, ni ne désire nullement que vous les rejetiez ; car un prince sage et judicieux doit tout écouter, et ne se confier jamais du tout en un seul serviteur, mais bien qu'il vous plaise n'y ajouter aucune foi sans m'avoir ouï sur icelles, et vu quelles seront mes œuvres. Le Roi fut fort satisfait de ma réponse, et après quelques autres propos de réciproques assurances nous nous séparâmes. Peu après l'exécution du maréchal, Henri IV envoya des troupes en Bourgogne, qui entrèrent sans coup férir dans toutes les places ; il donna le gouvernement de la province au Dauphin et la fit gouverner par un lieutenant général ; il somma le baron de Lux, gouverneur du château de Dijon, de venir le trouver, avec assurance de la vie s'il avouait tout, ce qu'il se hâta de faire. Lux découvrit ainsi plusieurs desseins, accusa plusieurs personnes, qui n'en surent jamais rien et auxquelles le Roi ne fit jamais mauvais visage, et que Rosny, avec sa loyauté de discrétion, ne nomme pas dans ses Mémoires. |