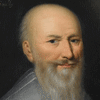ÉTUDE BIOGRAPHIQUE SUR SULLY
CHAPITRE III. — VIE MILITAIRE DEPUIS L'AVÈNEMENT DE HENRI IV JUSQU'À L'ENTRÉE DU ROI À PARIS, ET LA SOUMISSION DE ROUEN.
|
1589-1594 Abandonné par un grand nombre de nobles[1] qui servaient Henri III, le nouveau roi de France se retira à Dieppe, à portée de recevoir les secours qu'allait lui envoyer Elisabeth, reine d'Angleterre, son alliée contre l'Espagne, ou de se réfugier en Angleterre en cas de défaite de sa petite armée de fidèles serviteurs, huguenots ou catholiques. Henri IV à ce moment était dans une sorte de misère dont on se fait difficilement l'idée : il manquait de tout, non seulement comme roi, mais même comme simple gentilhomme ; il manquait de chemises. Le 8 juin, il écrivait à M. Malet, son trésorier, en lui envoyant un garçon de sa garde-robe : Armagnac[2] dit que je n'ai point de chemises, envoyez-m'en. Rosny avait suivi son maître, qui avait pris position à Arques, où il avait établi un camp fortifié, dans lequel il attendait le duc de Mayenne et son armée, forte de 25.000 hommes de pied et de 8.000 chevaux. Henri IV n'avait que 7.000 hommes. Mayenne croyait déjà tenir le Béarnais ; il l'écrivait à tous les princes étrangers. A Paris, on louait toutes les fenêtres du faubourg Saint-Antoine, pour le voir passer quand on le conduirait à la Bastille. Pendant quinze jours Henri IV résista à toutes les attaques des Ligueurs[3], et, malgré Mayenne, reçut dans son camp 12.000 hommes amenés par le comte de Soissons, le duc de Longueville et le maréchal d'Aumont, 4.000 Anglais, 2.000 Écossais, des munitions et de l'argent envoyés par Elisabeth. Rosny se battit à Arques comme il avait l'habitude de le faire, et fit de vigoureuses charges contre la cavalerie de Mayenne. Aussitôt après la retraite des Ligueurs, Henri IV se porta sur Paris. Il en prit les faubourgs, qui furent livrés au pillage ; mais il échoua dans son attaque contre la ville, et devant l'arrivée de Mayenne il décampa (3 novembre) et se retira à Tours. A Paris, M. de Rosny gagna 2 ou 3.000 écus au pillage du faubourg Saint-Germain. Quand on attaqua la ville même, Rosny et une vingtaine des siens, trouvant la porte de Nesle ouverte, entrèrent dans la ville, arrivèrent jusqu'au Pont-Neuf, et peu s'en fallut que Paris ne fût pris ou ne se rendît. Une seconde bataille entre Henri IV et Mayenne s'engagea en 1590, à Ivry[4]. Le Roi avait écrit à M. de Rosny la lettre suivante, le 13 mars 1590, veille de la bataille : Mon ami, je ne pensai jamais mieux voir donner une bataille que ce jour d'hui. Mais tout s'est passé en légères escarmouches, et d'essayer de se loger chacun à son avantage. Je m'assure que vous eussiez eu regret toute votre vie de ne vous y être trouvé. Parlant, je vous avertis que ce sera pour demain ; car nous sommes si près les uns des autres, que nous ne nous en saurions plus dédire. Amenez tout ce que vous pourrez, et surtout votre compagnie et les deux compagnies d'arquebusiers à cheval de Badet et Jammes, que je vous ai laissées. A Dieu. Au moment de combattre, Henri IV fit à ses troupes une allocution bien connue, mais qu'il faut toujours relire : Vous êtes Français ; je suis votre roi ; voilà l'ennemi ! Puis, montrant son casque, orné de plumes blanches : Enfants, gardez bien vos rangs. Si l'étendard vous manque, voici le signe du ralliement ; suivez mon panache[5], vous le verrez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. Quant à la bataille, on lira avec plaisir le récit fait par Henri IV lui-même et envoyé à divers grands personnages. LETTRE CIRCULAIRE SUR LA BATAILLE D'IVRY 14 mars 1590 Il a plu à Dieu de m'accorder ce que j'avais le plus désiré : d'avoir moyen de donner une bataille à mes ennemis ; ayant ferme confiance que, en étant là, il me ferait la grâce d'en obtenir la victoire, comme il est advenu ce jour d'hui. Vous avez ci-devant entendu comme, après la prise de la ville de Honfleur, je leur vins faire lever le siège qu'ils tenaient devant la ville de Meulan, et leur y présentai la bataille, qu'il y avait apparence qu'ils dussent accepter, ayant dès lors en nombre deux fois autant de force que j'en pouvais avoir. Mais pour espérer le pouvoir faire avec plus de sûreté, ils voulurent différer jusqu'à ce qu'ils eussent joint 1.500 lances que leur envoyait le prince de Parme[6], comme ils ont fait depuis quelques jours. Et dès lors publièrent partout qu'ils me forceraient au combat, en quelque lieu que je fusse, et en pensaient avoir trouvé une occasion fort avantageuse, de me venir rencontrer au siège que je faisais devant la ville de Dreux. Mais je ne leur ai pas donné la peine de venir jusque-là ; car, sitôt que je fus averti qu'ils avaient passé la rivière de Seine, et qu'ils tournaient la tête devers moi, je me résolus de remettre plutôt le siège que de faillir de leur venir au-devant. Et ayant su qu'ils étaient à 6 lieues dudit Dreux, je partis lundi dernier, 12 de ce mois, et vins loger à la ville de Nonancourt, qui était à 3 lieues d'eux, pour y passer la rivière. Le mardi, je vins prendre les logis qu'ils voulaient pour eux, et où étaient déjà arrivés leurs maréchaux des logis. Je me mis en bataille dès le matin en une fort belle plaine, où ils parurent aussitôt avec leur armée, mais si loin de moi, que je leur eusse donné beaucoup d'avantage de les aller chercher si avant, et me contentai de leur faire quitter un village proche de moi, duquel ils s'étaient saisis. Enfin la nuit nous contraignit chacun de se loger ; ce que je fis aux villages les plus proches. Ce jour d'hui, ayant fait de bon matin reconnaître leur contenance, et m'ayant été rapporté qu'ils s'étaient représentés, mais encore plus loin qu'ils n'avaient fait hier, je me suis résolu de les approcher de si près, que par nécessité il se faudrait joindre, comme il est advenu entre les dix et onze heures du matin, que les étant allé chercher jusques où ils étaient plantés, dont ils n'ont jamais avancé que ce qu'ils ont fait de chemin pour venir à la charge, la bataille s'est donnée, en laquelle Dieu a voulu faire connaître que sa protection est toujours du côté de la raison. Car, en moins d'une heure, après avoir jeté toute leur colère en deux ou trois charges qu'ils ont faites et soutenues, toute leur cavalerie a commencé à prendre parti[7], abandonnant leur infanterie qui était en très grand nombre. Ce que voyant, leurs Suisses ont eu recours à ma miséricorde, et se sont rendus les colonels, capitaines, soldats et tous leurs drapeaux. Les Lansquenets et Français n'ont point eu le loisir de prendre cette résolution, car ils ont été taillés en pièces, plus de 1.200 des uns et autant des autres ; le reste prisonnier et mis en route[8] dans les bois, à la merci des paysans. De leur cavalerie, il y en a de 900 à 1.000 de tués, et de 4 à 500 de démontés et prisonniers, sans comprendre ce qui s'est noyé au passage de la rivière d'Eure, qu'ils ont passée à Ivry, pour la mettre entre eux et nous, qui sont en grand nombre. Le reste, des mieux montés, s'est sauvé à la fuite, mais ç'a été avec très grand désordre, ayant perdu tout leur bagage. Je ne les ai point abandonnés qu'ils n'aient été près de Mantes. Leur cornette blanche m'est demeurée, et celui qui la portait prisonnier ; 12 ou 15 autres cornettes de leur cavalerie, deux fois davantage de leur infanterie, toute leur artillerie, infinis seigneurs prisonniers, et de morts un grand nombre, même de ceux de commandement, que je ne me suis pas encore amusé de faire reconnaître. Mais je sais que entr'autres, le comte d'Egmont[9], qui était général de toutes les forces qui leur étaient venues de Flandre, y a été tué. Leurs prisonniers disent tous que leur armée était de 4.000 chevaux et de 12 à 13.000 hommes de pied, dont je crois qu'il ne s'en est pas sauvé le quart. Quant est de la mienne, elle pouvait être de 2.000 chevaux et de 8.000 hommes de pied. Mais de cette cavalerie il m'en arriva, depuis que je fus en bataille, le mardi et mercredi, plus de 600 chevaux ; même de la dernière troupe de la noblesse de Picardie, qu'amenait le sieur de Humières, qui était de 300 chevaux, arriva, qu'il y avait demi-heure que le combat était commencé. C'est un œuvre miraculeux de Dieu, qui m'a premièrement voulu donner cette résolution de les attaquer, et puis la grâce de la pouvoir si heureusement accomplir. Aussi à lui seul en est la gloire ; et, de ce qu'il en peut, par sa permission, appartenir aux hommes, elle est due aux princes, officiers de la Couronne, seigneurs et capitaines, et à toute la noblesse qui s'y est trouvée, et y accourut par telle ardeur et s'y est si heureusement employée, que leurs prédécesseurs ne leur ont point laissé de plus beaux exemples de leurs générosités[10], qu'ils laisseront, en ce fait, à leur postérité. Comme j'en suis grandement content et satisfait, j'estime qu'ils le sont de moi, et qu'ils ont vu que je ne les ai voulu employer en lieu dont je ne leur aie aussi ouvert le chemin. Je suis toujours à la poursuite de la victoire avec mes cousins les prince de Conty, duc de Montpensier, comte de Saint-Paul, maréchal d'Aumont, grand-prieur de France[11], la Trimouille, les sieurs de la Guiche et de Givry, et plusieurs autres seigneurs et capitaines. Mon cousin le maréchal de Biron est demeuré au corps de l'armée, pour y attendre de mes nouvelles, qui iront, comme j'espère, toujours prospérant. Vous entendrez, par ma prochaine dépêche, qui de bien près suivra celle-ci, plus amplement les particularités de cette victoire, dont je vous ai bien voulu ce pendant donner ce mot d'avis, pour ne vous différer plus longuement le plaisir que je sais que vous en recevrez. Je vous prie aussi en faire part à tous mes autres bons serviteurs de par delà, et surtout d'en faire rendre grâce à Dieu, lequel je prie, M. de..., vous maintenir en sa sainte garde. Du camp de Rosny, ce XIVe jour de mars 1590. HENRY. Rosny et sa compagnie avaient été placés par le Roi dans le corps de son escadron. A une première charge, son cheval fut blessé et tomba, et Rosny reçut trois blessures : un coup de lance au mollet, un coup de pistolet à la hanche, un coup d'épée à la main. Remonté sur un autre cheval, Rosny chargea de nouveau, eut encore son cheval tué, reçut un coup de pistolet dans la cuisse et un coup d'épée à la tête. N'ayant plus ni cheval, ni casque, il erra sur le champ de bataille, et, pour échapper à un ennemi, Rosny se réfugia sous un poirier, qui, dit-il, avait les branches si basses et si étendues, qu'il ne me pût approcher ; et ainsi, après m'avoir tournoyé longtemps, il me quitta. L'ennemi parti, Rosny sortit de son refuge et acheta à l'un des gentilshommes de l'armée un courtaud[12] 50 écus, qu'il avait en poche, et se dirigea sur le château d'Anet, mal équipé, blessé et le visage tout tantouillé[13] de sang et de boue. Je vis venir à moi, dit Rosny, sept des ennemis, dont l'un portait la cornette blanche et générale de M. de Mayenne[14] lesquels se suivaient à la file, qui me crièrent qui vive. Je leur dis mon nom ; lors le premier d'iceux me dit : Nous vous connaissons bien tous ; nous voulez-vous faire courtoisie et nous sauver la vie ? — Comment ! dis-je ; vous parlez comme des gens qui ont perdu la bataille. — Est-ce tout ce que vous en savez ? répondirent-ils. Oui, nous l'avons perdue, et si sommes trois qui ne nous saurions retirer, car nos chevaux sont comme morts. Aussi y en avait-il deux qui n'allaient qu'à trois jambes ; et l'autre, les tripes lui sortaient du ventre. J'acceptai ce parti ; et ainsi MM. de Châtaigneraye, de Sigongne, de Chanteloup et d'Aufreville se rendirent à moi, avec la cornette blanche, que Sigongne me mit en la main avec force belles paroles. Les autres, qui étaient MM. de Nemours, chevalier d'Aumale, et Trémont, voyant les troupes du Roi s'avancer vers moi, crièrent : Adieu, monsieur, adieu : nous nous sauverons bien encore, car nos chevaux ont bonnes jambes et bonne haleine ; mais nous vous recommandons ces quatre gentilshommes. Rosny continua sa route avec ses quatre prisonniers et un page de Henri IV qu'il avait rencontré, et auquel il avait donné en garde la cornette blanche. Une bande de gens de guerre de l'armée du Roi, commandés par M. de Thorigny, rencontra le groupe où se trouvait M. de Rosny, et à la vue de la cornette blanche, ils crurent faire une belle capture ; mais on reconnut Rosny, qui continua sa marche, trouva enfin un chirurgien pour lui panser sa grande plaie de la hanche, par laquelle il perdait tout son sang, et du vin qui empêcha l'évanouissement où il allait entrer. Enfin il arriva à Anet, où il apprit que Henri IV, après avoir poursuivi l'ennemi, était allé coucher au château de Rosny. Sitôt que je fus arrivé dans le château d'Anet, dit Sully, le concierge me fit apprêter une chambre et un bon lit, où peu après M. le maréchal de Biron, qui passait par ce lieu pour suivre le Roi avec sa troupe de réserve, me vint visiter, m'usa de plusieurs compliments, et voulut, pendant qu'il se faisait apporter la collation, voir mettre le premier appareil à mes plaies ; et voyant mes prisonniers dans ma chambre et la cornette blanche des ennemis au chevet de mon lit, me dit en s'en allant : Adieu, monsieur mon compagnon, vous ne devez point plaindre vos plaies ni votre sang répandu, puisque vous remportez une des plus signalées marques d'honneur que saurait désirer un cavalier le jour d'une bataille, et que vous avez là des prisonniers qui vous fourniront de quoi payer vos chevaux tués, faire panser vos blessures et boire de bon vin pour faire de nouveau sang. D'Anet, Rosny s'en alla, dès le fin matin, par eau, à Pacy[15], où il trouva sa garnison et ses domestiques de Rosny. Le lendemain il se mit en marche pour retourner chez lui. L'écuyer de Rosny, M. de Maignan, le fils de l'un des plus braves serviteurs du roi de Navarre, avait donné à cette marche, à ce cortège, un air de triomphe, qui plaisait à sa vanité et qui ne déplaisait pas à Rosny, assez glorieux de sa nature. On plaça le blessé sur un brancard fait de branches d'arbres non pelées, et accommodé de cercles de futailles, et le cortège fut ainsi disposé. Ses Mémoires en donnent la description suivante : Premièrement marchaient deux de mes grands chevaux menés en main par deux de mes palefreniers, puis mes deux pages montés sur deux autres de mes grands chevaux, le premier desquels était mon grand coursier gris, sur lequel j'avais combattu la première fois, et qui avait trois pieds de long de la peau de l'épaule droite et des côtes fendus, du coup de lance qui m'avait emporté la botte et un morceau du mollet de la jambe, et une arquebusade qui lui avait traversé le nez et une partie du col, et lui était venu sortir dans la crinière près des panneaux de la selle ; lequel, après s'être relevé sans selle, s'en allait courant par le champ de bataille, et enfin, par un grand heur[16], avait été repris par trois de mes arquebusiers qui avaient servi d'enfants perdus[17] au combat. Ce page avait vêtu ma cuirasse et portait la cornette blanche des ennemis ; et l'autre mes brassards et mon casque au bout d'un bris de lance, d'autant que, pour être tout fracassé et effondré de coups, il était impossible de le porter en tête. Après ces pages venait M. de Maignan, mon écuyer, ayant la tête bandée et un bras en écharpe, à cause de deux plaies, lequel était suivi de mon valet de chambre, Moreines, monté sur ma haquenée anglaise, lequel portait ma casaque de velours orangé à clinquant d'argent sur lui, et, en la main droite, comme un trousseau de trophées, tout cela lié ensemble, divers morceaux de mes épées, pistolets et panaches que l'on avait ramassés. Après cela je venais dans mon brancard, couvert d'un linceul[18] seulement ; mais, par-dessus, pour parade des plus magnifiques, mes gens avaient fait étendre les quatre casaques de mes prisonniers, qui étaient de velours ras noir, toutes parsemées de croix de Lorraine sans nombre, en broderie d'argent, sur le haut d'icelles les quatre casques de mes prisonniers, avec leurs grands panaches blancs et noirs, tous brisés et dépenaillés de coups ; et contre les côtés des cercles étaient pendus leurs épées et pistolets, aucuns brisés et fracassés. Après lequel brancard marchaient mes trois prisonniers, montés sur des bidets, dont l'un, à savoir M. d'Aufreville, était fort blessé : lesquels discouraient entre eux de leurs fortunes et des succès contraires aux espérances que M. de Mayenne et le comte d'Egmont avaient données à un chacun, ne parlant deux jours devant la bataille que d'assiéger la ville où le Roi se retirerait, ne s'attendant nullement que le Roi se dût résoudre au combat, attendu l'inégalité de ses forces. Après ces prisonniers, marchait le surplus de mes domestiques ; puis M. de Vassant, qui voulut en arrivant porter ma cornette[19], et à sa suite ma compagnie de gens d'armes, et les deux compagnies d'arquebusiers à cheval des sieurs Jammes et Badet, qui avaient servi d'enfants perdus devant l'escadron du Roi, lors du combat ; tout cela fort diminué de nombre — car j'en avais perdu plus de cinquante, tant des uns que des autres —, mais grandement augmentés de gloire, aucuns d'eux se faisant porter dans des brancards comme moi, d'autres ayant les têtes bandées, ou les bras et les jambes en écharpe. Chemin faisant, on aperçut, du sommet d'un coteau, la plaine d'alentour toute couverte de gens de cheval et de chiens qui chassaient. C'était le Roi, qui s'approcha du brancard, et, tout en approuvant cette espèce d'ovation, ne laissa pas que de dire un mot de légère raillerie à M. de Maignan. S'adressant ensuite à M. de Rosny : Mon ami, lui dit-il, je suis très aise de vous voir avec un beaucoup meilleur visage que je ne m'attendais pas, et aurai encore une plus grande joie si vous m'assurez que vous ne courrez point fortune de la vie, ni de demeurer estropié — car pour les autres coups ce ne sont qu'autant d'accroissements de gloire, et par conséquent de contentements, lesquels font supporter patiemment toutes les douleurs des plaies, comme je l'ai moi même éprouvé — ; d'autant que le bruit courait que vous aviez eu deux chevaux tués entre les jambes, été porté par terre, saboulé et pétillé aux pieds des chevaux de plusieurs escadrons, et matrassé[20] et charpenté de tant de coups, que ce serait grande merveille si vous en échappiez, ou pour le moins ne demeuriez mutilé de quelque membre. Auxquelles aimables paroles Rosny répondit ainsi : Sire, V. M. m'apporte autant de consolation qu'elle m'honore excessivement, de témoigner un si grand soin de moi ; aussi n'ai-je point de paroles proportionnées à mes sentiments, ni d'une valeur égale aux louanges que méritent vos vertus. Et partant, laissant les choses à moi impossibles, je lui dirai, pour réponse à ce qu'elle désire savoir : que j'ai reconnu une si visible assistance de la main paternelle de Dieu, parmi tant de diverses fortunes, et bonnes et mauvaises, qui m'ont été occurrentes pendant la bataille, que la délivrance des uns et la gloire des autres en appartient à lui seul, qui m'a conduit favorablement les coups que j'ai reçus, m'a tiré d'entre les pieds de plus de 2.000 chevaux qui m'ont passé sur le ventre ; et, cela je le crois, planté un poirier, dans cette campagne, avec les branches si basses, qu'elles m'ont garanti d'un coup, duquel j'ai vu tuer le pauvre Feuquières, et puis m'a fait tomber ès mains non seulement trois des principaux gentilshommes de l'armée — dont en voilà deux derrière mon brancard, qui paieront les chirurgiens et mes chevaux tués —, mais aussi une marque fort exquise et spéciale d'un honneur non commun, qui est la cornette blanche du général de l'armée ennemie, que j'estime plus que tout le reste. Et quant à mes plaies, elles sont, grâces à Dieu, en si bon état, combien qu'elles soient fort grandes, et surtout celle de la hanche, que j'espère dans deux mois au plus tard me trouver assez fort et dispos pour en aller encore chercher autant pour votre service, avec telle affection que je voudrais être assuré d'en recevoir autant à même prix. Sur quoi le Roi repartit et me dit : Brave soldat et vaillant chevalier, qui sont, à mon avis, les titres les plus glorieux que l'on puisse donner à un homme d'honneur faisant profession des armes, j'avais toujours eu très bonne opinion de votre courage et conçu de bonnes espérances de votre vertu ; mais vos actions signalées en une si importante occasion, et votre réponse grave et modeste qui attribue tout à Dieu, a surmonté mon attente, ayant bien jugé, comme c'est aussi mon avis, qu'il n'y a rien si malséant à un homme de qualité, que d'user de vaines jactances pour les choses signalées qu'il peut avoir faites, ès quelles son honneur et sa profession l'obligeaient : et partant, en présence de ces princes, capitaines et grands chevaliers qui sont ici près de moi, desquels les âmes généreuses, la fermeté de leurs cœurs, la force et la vigueur de leurs bras et l'affilé tranchant de leurs épées, sont appuis qui maintiennent et illustrent ma personne et ma couronne, vous veux -je embrasser des deux bras, et vous déclarer à leur vue, vrai et franc chevalier, non tant de l'accolade, tel que je vous fais à présent, ni de Saint-Michel, ni du Saint-Esprit, que de mon entière et sincère affection, laquelle jointe aux longues années de vos fidèles et utiles services, me font vous promettre, comme je fais aussi aux illustres vertus de tous ces braves et vaillants hommes qui m'écoutent, que je n'aurai jamais bonne fortune ni augmentation de grandeur que vous n'y participiez ; et, craignant que le trop parler préjudiciât à vos plaies, je m'en retourne à Mantes ; et partant, adieu mon ami, portez-vous bien, et vous assurez que vous avez un bon maître. Et sur cela, sans me donner le loisir de le répliquer, il prit le galop et s'en alla continuer sa chasse dans ma garenne d'entre Rosny et Mantes. M. de Rosny n'entendait pas se contenter des belles et chevaleresques paroles du Roi ; il lui fallait une récompense positive. Quelque temps après, le Roi se trouvant au château de Rosny, il lui demanda le gouvernement de la ville de Mantes, que Henri IV lui refusa, de peur de mécontenter MM. de Nevers et d'O, catholiques. Rosny, irrité, eut de grosses paroles avec le Roi, jusques à lui reprocher la longueur de ses services, tant de dépenses faites, de plaies reçues et de sang épandu. Ici, dit Sainte-Beuve[21], nous avons encore un autre trait du caractère de Rosny : il est fidèle, il est dévoué, mais il n'est pas désintéressé, et ne se pique pas d'une certaine délicatesse. Si M. de Rosny est impatient d'obtenir une faveur, il faut convenir qu'il n'a pas tout à fait tort, et qu'il lui faudra attendre jusqu'en 1596 pour entrer au conseil des finances, et jusqu'en 1601 pour devenir grand-maître de l'artillerie. Il est pressé. Quelque temps après le refus de Mantes, il demanda le gouvernement de Gisors qu'il avait contribué à reprendre. Nouveau refus, et toujours afin de ne pas porter ombrage à MM. de Nevers et d'O, et à quelques autres seigneurs catholiques : Rosny se fâcha. A tous ces reproches, le Roi ne répondit jamais autre chose sinon : Je vois bien que vous êtes en colère à cette heure ; nous en parlerons une autre fois, et s'en alla d'un autre côté ; puis, me voyant avoir fait de même, il dit à ceux qui le suivaient : Il le faut laisser dire, car il est d'humeur prompte et soudaine, et a même quelque espèce de raison ; néanmoins il ne fera jamais rien de méchant ni de honteux, car il est homme de bien et aime l'honneur. A peine remis de ses blessures, et marchant encore à potences, c'est-à-dire avec des béquilles, M de Rosny rejoignit Henri IV qui assiégeait Paris, après avoir pris Corbeil, Melun, Lagny et Saint-Denis, afin d'investir complètement Paris et d'empêcher les vivres d'entrer dans la ville par la Seine et la Marne. Malgré les grosses paroles qui avaient été dites, le Roi fit le meilleur accueil à Rosny ; il lui commanda de se loger près de lui, de n'aller en nul lieu qu'avec lui, l'assurant qu'il lui ferait tout voir. En effet, ayant résolu d'enlever les faubourgs de Paris, Henri IV partagea son armée en dix corps, et chacun d'eux fut chargé de s'emparer de l'un des faubourgs, Saint-Antoine, Saint-Martin, Saint-Denis, Montmartre, Saint-Honoré, Saint-Germain, Saint-Michel, Saint-Jacques, Saint-Marceau et Saint-Victor. Par une nuit très noire, tous les faubourgs furent attaqués à la fois et enlevés. Le Roi avait conduit Rosny à l'abbaye de Montmartre, et le fit asseoir à ses côtés. Il assista à la bataille, qu'il a ainsi décrite : L'escopeterie (nous dirions aujourd'hui la fusillade) commença sur la minuit, et dura deux grandes heures, avec telle continuation qu'il semblait que la ville et les faubourgs ussent tout en feu, tant ces peuples tiraient, la plupart du temps sans besoin, et cela néanmoins fort également ; réservé (excepté) vers la porte Saint-Antoine, où l'attaquement se fit de plus loin et plus lentement, et la défense de même, à cause qu'il n'y a autre faubourg que Saint-Antoine des Champs[22]. Mais, quoi que ce soit, nous croyons que qui pourrait faire faire un tableau de cette nuit-là, où le bruit des voix et des coups d'arquebuse se pût représenter aussi bien que tant de bluettes de feu qui paraissaient, il n'y aurait rien au monde de si admirable. Et succéda (réussit) ce dessein si heureusement, que tous les faubourgs furent quasi pris en même temps, et toutes les portes de la ville si bien bloquées, qu'il n'y pouvait plus rien entrer ni en sortir, ce qui causa de grandes nécessités au pauvre peuple, qui mériteraient bien d'être récitées. Le prince de Parme ayant fait lever le siège de Paris, et se retirant aux Pays-Bas, Henri IV le poursuivit pendant sa retraite. Rosny accompagna le Roi et se trouva, des yeux seulement, à tous les combats qui lui furent livrés. En se rendant à Chartres, qu'assiégeait Henri IV[23], Rosny fut encore blessé d'un coup de pistolet dans une embuscade : une balle lui coupa la lèvre supérieure, entra dans la bouche et sortit par le col[24]. Chartres pris, Henri IV alla assiéger Rouen (1591), qui fut défendu par un habile capitaine, M. de Villars-Brancas. Le siège de Rouen était une affaire si grave, que, pour l'entreprendre, le Roi avait dû rassembler 40.000 hommes, dont : 20.000 Français, 6.000 Suisses, 6.000 Reîtres et Lansquenets, 4.000 Anglais, 4.000 Hollandais et 50 bâtiments de guerre fournis aussi par la Hollande. Rosny et sa compagnie étaient au siège ; mais il fut plus spécialement attaché à la personne du Roi, qui, tous les quatre jours, était de garde aux tranchées avec 3 ou 400 gentilshommes. On choisit mal le point d'attaque, et le maréchal de Biron, qui imposa sa volonté, fut soupçonné de ne vouloir pas que la ville se prît, parce que le Roi lui avait refusé le gouvernement de Rouen quand on l'aurait pris. Plusieurs autres seigneurs manifestèrent beaucoup de mauvaise volonté ; aussi, malgré les efforts de Henri IV, le siège traîna en longueur, et le prince de Parme put revenir encore une fois des Pays-Bas pour délivrer Rouen (1592). Henri IV alla au-devant de lui, et lui livra un premier combat à Folleville. Il nous avait ordonnés (réunis) une trentaine de ceux qu'il connaissait de longue-main et avait éprouvés en maintes occasions, pour avoir l'œil sur sa personne, et ne l'abandonner en aucune façon sans son exprès commandement. Il vit donc, et moi aussi, car j'étais du nombre des trente, faire deux ou trois fort belles charges par les sieurs baron de Biron[25], de Laverdin, Givry, Saint-Géran, Chanlivaut, la Curée, Harambure et autres, dans lesquelles ils se trouvèrent plus rudement enfoncés qu'ils n'avaient estimé, et tellement embarrassés, Laverdin et quelques autres ayant été portés par terre, que le Roi fut contraint d'aller à la charge avec nous autres et 200 chevaux pour les dégager, voire de mander à tout le gros de ses 6.000 chevaux, où commandait M. de Nevers, de s'avancer en diligence. Quelques jours après, eut lieu un combat à Bures, dans lequel le duc de Guise, qui commandait l'avant-garde du prince de Parme, fut battu et perdit sa cornette verte[26]. Enfin, le 5 février, un nouveau combat s'engagea à Aumale, sur la Bresle. Henri IV, qui n'avait que 4 à 500 chevaux d'élite et autant d'arquebusiers à cheval, n'hésita pas à attaquer l'armée ennemie, forte de 18.000 hommes de pied et de 6 à 7.000 chevaux. Rosny faisait encore partie des trente compagnons d'élite chargés de la garde de la personne du Roi. Les Espagnols s'avançant, Henri IV s'avança également, au grand déplaisir de tous ces cavaliers de le voir se hasarder sans besoin, comme un cheval-léger ; ils ne purent s'empêcher d'en grommeler tout haut et prièrent Rosny de lui en vouloir parler. Sire, dit-il, ces messieurs qui vous aiment plus que leur vie, m'ont prié de vous dire, qu'ils ont appris des meilleurs capitaines et de vous plus souvent que de nul autre, qu'il n'y a point d'entreprise plus imprudente et moins utile à un homme de guerre, que d'attaquer étant faible à la tête d'une armée. A quoi il me répondit : Voilà un discours de gens qui ont peur ; je ne l'eusse pas attendu de vous autres. Il est vrai, sire, repartis-je, mais seulement pour votre personne qui nous est si chère ; que s'il vous plaît vous retirer avec le gros qui a passé le vallon, et nous commander d'aller pour votre service, ou votre contentement, mourir dans cette forêt de piques, vous reconnaîtrez que nous n'avons point de peur pour nos vies, mais seulement pour la vôtre. Ce propos, comme il me l'avoua depuis, lui attendrit le cœur, tellement qu'il me dit : Je le crois, et encore choses plus généreuses, de vos courages ; mais aussi croyez de moi que je ne suis pas si étourdi que vous estimez (croyez) ; que je crains autant ma peau qu'un autre, et que je me retirerai si à propos qu'il n'arrivera aucun inconvénient. L'action commença. Le prince de Parme ne s'engagea qu'avec beaucoup de prudence, croyant que la troupe qui venait l'attaquer était soutenue à quelque distance. Il la fit charger et la força à battre en retraite. Le Roi resta des derniers pour faire exécuter la retraite en bon ordre. Il se battit avec une incomparable bravoure, fut blessé légèrement aux reins, et perdit seulement 50 ou 60 des siens. Si le prince de Parme avait lancé plus de monde contre Henri IV, celui-ci était perdu, pris ou tué. Le prince donna pour raison de sa conduite par trop prudente, qu'il n'avait pu croire que le Roi se fût aventuré comme un carabin[27]. Pendant ce temps, Villars faisait une sortie, mettait en déroute les Lansquenets qui gardaient le parc d'artillerie du Roi et enlevait 6 pièces et toutes les poudres. Le maréchal de Biron était encore la cause de ce revers ; mais Henri IV n'osait rien dire, craignant que le maréchal ne fît quelques brigues avec certains seigneurs catholiques, et qu'ils ne quittassent l'armée, car ils ne se gênaient pas pour montrer avec quel dépit ils supportaient la domination d'un roi huguenot. Le duc de Mayenne, après bien des lenteurs, ayant joint le prince de Parme, celui-ci voulait attaquer Henri IV, espérant l'écraser ; mais Mayenne ne voulait pas livrer la France à l'Espagne : il aimait mieux la prendre pour lui, s'il pouvait. Il s'opposa à la bataille, et l'on dit même qu'il négocia avec le Béarnais, lui promettant, s'il se faisait catholique, de le reconnaître pour roi de France. En attendant, le prince de Parme ravitaillait Rouen, et forçait Henri IV à lever le siège (20 avril). Menacé à Caudebec par son infatigable adversaire, le prince de Parme y traversa la Seine (12 mai), se dirigea sur Paris à marches forcées, traversa la rivière et retourna en Flandre. Henri IV aurait pu l'attaquer pendant sa route ; le mauvais vouloir de quelques-uns de ses généraux, du maréchal de Biron entre autres, l'empêcha de donner suite à ses projets et sauva le prince de Parme. Après la levée du siège de Rouen, M. de Rosny retourna chez lui. Il s'était remarié à une veuve, madame de Châteaupers, et vivait à Rosny occupé de sa femme, et soignait la blessure qu'il avait reçue en se rendant à Chartres, et qui n'était pas encore guérie. Mécontent de son maître, qui lui avait promis une lieutenance de roi qu'il n'avait pu lui expédier devant l'opposition persistante de MM. de Nevers et d'O, Rosny passait son temps à rédiger ses Mémoires, à jardiner, herboriser, faire des extraits des meilleurs livres et à ménager ou administrer ses biens, adoucissant ses plaies et ses dépits. A la nouvelle d'une prochaine entrée en France du prince de Parme, Henri IV convoqua ses partisans ; et l'un d'eux, M. de Buhy, frère de Duplessis-Mornay, étant venu à Rosny, fit connaître à son hôte les lettres du Roi, par lesquelles il mandait à M. de Buhy de marcher en diligence (rapidement) pour le venir trouver et amener avec lui toute la noblesse du pays, et pria Rosny de vouloir bien être de la partie. A quoi demi en colère, je lui répondis qu'il y avait longtemps que je savais aller tout seul, et partant que je n'avais plus besoin d'être mené ; que le Roi avait accoutumé de m'écrire quand il avait besoin de mon service ; que si je recevais de ses lettres, j'y aviserais et ferais toujours mon devoir. Et sur cela nous nous séparâmes assez mal satisfaits l'un de l'autre. Averti de ce qui se passait, le Roi dit : Il a donc bien changé d'humeur, car il n'a jamais manqué de se trouver aux occasions semblables à celle qui se prépare ; néanmoins, quoiqu'il s'excuse sur ses plaies, je connais bien où il lui tient : il est en colère contre moi, voire peut-être avec raison, et voudra dorénavant faire le philosophe ; mais lorsque je le verrai, je saurai bien accommoder tout cela, car je le connais. Tous lesquels discours m'ayant été rapportés un jour que j'étais à table, donnant à dîner au président Séguier, lequel m'était venu voir à Rosny, je dis en branlant la tête : Il est vrai, je suis en colère de ce que le Roi, de crainte de déplaire à des gens qui ne l'aiment point et qui lui en joueront d'une, s'il n'y prend garde, dénie les récompenses méritées à ceux qui l'aiment plus qu'eux-mêmes et qui ont tant de fois répandu leur sang et hasardé leur vie pour garantir la sienne, et qui feront toujours mieux que ceux que l'on essaye de contenter à leur préjudice, comme, si ce que l'on dit est vrai, il en fera bientôt l'expérience. Après quelques mois de repos et de soins, la blessure étant guérie, Rosny, qui haïssait l'oisiveté, se mit, avec une cinquantaine de compagnons, à courir sur les chemins de Paris à Dreux et à Verneuil, espérant y trouver quelque bonne aubaine. En effet, un jour, il rencontra une bande d'une dizaine d'hommes, paysans, marchands de poulailles, et valets de grands seigneurs, dont l'un était au duc de Mercœur, ou de Mercure, comme l'on disait alors, l'un des grands chefs de la Ligue. A la vue de la troupe de Rosny, la bande se dispersa, mais on prit deux pauvres diables qui, moyennant quelques pièces d'or, apprirent à Rosny que les laquais avaient jeté des papiers dans le creux d'un chêne. On y trouva, en effet, deux boîtes de fer-blanc et un petit sac de coutil, dans lesquels il y avait des commissions du duc de Mayenne pour lever des troupes, des lettres chiffrées et la copie du traité conclu entre le duc de Mayenne et les Espagnols. La copie était de la main du président Jeannin, négociateur de ce traité, qui livrait la France à l'Espagne et faisait de Mayenne l'agent de l'Espagne en France, agent largement payé pour jouer ce rôle. Quant aux lettres chiffrées, elles apprenaient bien des intrigues inconnues, ourdies par des gens dont le Roi ne se méfiait nullement. Oubliant ses mauvaises humeurs, M. de Rosny alla trouver le Roi à Compiègne, où il attendait le prince de Parme, s'il venait en France. Après m'avoir embrassé et fait fort bon visage, dit Rosny, il me demanda pourquoi j'étais venu si tôt, puisque mes blessures m'avaient empêché de venir avec les autres. A quoi je lui répondis, me souvenant encore de ce que l'on m'avait mandé qu'il avait dit au sieur de Buhy : Sire, je vous viens apporter trois plats de ma philosophie. M. de Rosny remit au Roi lesdits papiers, resta trois jours à Compiègne, et le Roi voyant que la plaie de la bouche n'était pas encore guérie, il le renvoya chez lui. En partant, il lui dit : Adieu, mon ami, ayez toujours l'œil au guet ; servez-moi bien, et assurez-vous (soyez sûr) de mon amitié. En février 1593 Henri IV eut avec Rosny une importante conférence sur le sujet le plus grave. Jusqu'alors Henri IV avait pu croire qu'il serait reconnu comme roi sans se faire catholique ; il devenait évident que cette espérance était impossible à réaliser, tout au moins qu'elle ne se réaliserait qu'avec beaucoup de temps et de difficultés telles que le royaume risquait de périr, tandis que tous les membres influents de la Ligue étaient prêts à le reconnaître roi s'il se faisait catholique. Mais alors il se trouvait en présence des chefs du parti huguenot, qui le menaçaient de l'abandonner s'il les abandonnait. Henri IV voulut avoir l'avis de M. de Rosny, qui a inséré dans ses Mémoires le récit de l'entretien du 15 février. Le Roi m'ayant envoyé querir un soir fort tard, car aussi trouvai-je Sa Majesté au lit, qui avait déjà donné le bonsoir à un chacun ; lequel, sitôt qu'il me vit entrer, me fit approcher un carreau (coussin) et mettre sur icelui à genoux contre son lit, et puis me dit : Mon ami, je vous ai envoyé querir ainsi tard, pour vous parler des choses qui se passent, et entendre vos opinions sur icelles, car j'avoue que je les ai souvent trouvées meilleures que celles de beaucoup d'autres qui font bien les entendus, ne vous en voulant pas parler souvent ni longuement devant le monde, parce que cela vous concite (suscite) de l'envie, et à moi de la haine et des reproches de diverses sortes de personnes, des uns parce que vous êtes de la religion, et des autres parce qu'ils appréhendent toujours que je vous emploie en mes principales affaires, croyant que j'ai opinion qu'ils ont plus en recommandation leurs intérêts que les miens, et pense bien qu'il en est quelque chose, ce que je n'ai point encore aperçu en vous ; que si vous continuez en me laissant le soin de ce qui vous touche, et prenez celui continuel de ce qui regarde mes affaires, c'est sans doute que nous nous en trouverons bien mieux tous deux ; car je ne vous veux plus céler qu'il y a longtemps que j'ai jeté les yeux sur vous, afin d'employer votre personne en mes plus importantes affaires, et surtout en celles de mes finances, car je vous tiens pour loyal et laborieux. Or, ce que j'ai pour le présent à vous dire est touchant ce grand nombre de personnes de tous partis, de toutes qualités et de bien diverses humeurs qui se font de fête et fort les endemenés (qui se démènent beaucoup) pour s'employer aux entremises de la pacification du royaume, car j'en reçois lettres et instances de tous côtés, lesquels tous me proposent de grandes félicités, voire un infaillible rétablissement d'affaires d'Etat, principalement si je me résous à quelque accommodement pour ce qui regarde la religion. Mais, lorsque je viens à bien approfondir toutes leurs propositions, j'y vois bien de belles et fastueuses paroles ; mais jusques ici peu de solides raisons pour m'en faire croire la facilité, et encore moins d'apparences d'expédients bien certains pour concilier tant de divers esprits qui se veulent intéresser en cette pacification, en sorte qu'il se puisse conclure quelque chose à l'avantage des peuples de mon royaume, et du vrai et absolu rétablissement de l'autorité royale, sans lesquelles deux conditions je suis bien résolu de n'entendre à négociation ni traité quelconque ; en laquelle opinion je me suis davantage confirmé par les discours conformes à cela que j'ai su que vous tenez souvent à part avec les uns et les autres qui vous mettent sur ce propos, et par les froidures dont vous usez lorsque je vous en parle devant le monde ou en présence de ceux de mon conseil ; à quoi néanmoins je suis bien résolu, nonobstant toutes les belles espérances que plusieurs me veulent faire prendre de leurs entremises, qui sont toutes personnes diverses en humeurs, desseins, intérêts, factions et religions. Sur toutes lesquelles choses, et celles que vous en avez pu apprendre d'ailleurs, je vous ordonne de bien méditer ; car aussi bien est-ce votre coutume sur tout ce que je vous propose, de me demander du temps pour y penser avant que de m'en vouloir dire votre avis ; et puis dans trois ou quatre jours je vous enverrai encore querir pour m'en dire ce qu'il vous en aura semblé. Alors le Roi congédia Rosny, et trois jours après il le renvoya chercher. Henri IV était au lit, comme la première fois ; il fit mettre Rosny à genoux, et lui dit : Or sus, contez-moi à présent, et bien à loisir, toutes vos folles fantaisies — car c'est ainsi que vous avez toujours nommé tous les meilleurs conseils que vous m'avez donnés — sur les questions et propositions que je vous fis l'autre soir, d'autant que je vous veux écouter tout du long sans vous interrompre. Dans un discours bien étudié et bien divisé, mais long, Rosny démontra de la façon la plus évidente que le Roi ne devait pas traiter d'un seul coup avec les chefs et meneurs de la Ligue : le Pape, l'Empereur, le roi d'Espagne, les ducs de Savoie et de Lorraine, le cardinal de Bourbon, le comte de Soissons, les ducs de Mercœur, de Guise, de Mayenne, d'Aumale, d'Elbeuf, de Nemours, de Nevers, et de tant d'autres grands personnages. Car en signant un seul traité avec tous, S. M. formerait un bloc d'associés, qui serait plus fort que lui et finirait par détruire le royaume. Il dit qu'il fallait continuer la guerre, diviser l'ennemi, négocier et traiter séparément avec chacun d'eux. Son discours fini, Rosny proposa au Roi de l'écrire et de le lui remettre. A quoi Henri IV répliqua soudain que c'était inutile, et que le sujet lui était assez familier pour n'avoir pas besoin d'écrits plus amples que ce qu'il venait de lui dire : Et afin, me dit-il, que vous jugiez que j'ai bien pris vos opinions, je vous dirai qu'elles se résolvent quasi en un seul point, lequel consiste à me garder bien de rien traiter avec qui que ce puisse être, en sorte qu'il s'établisse quelque apparence de liaison, faction, société, ni corps entre plusieurs qui aient la moindre apparence du monde de pouvoir subsister et se maintenir par eux-mêmes ou leurs associés dans une partie des dépendances de mon royaume, tel qu'il m'est venu de succession ; d'autant que, comme vous avez très bien remarqué, ce serait former une royauté dans la mienne, et me bailler un roi ou plusieurs rois pour compagnons, capables d'y en attirer encore d'autres : voire même suis-je bien résolu de ne souffrir jamais qu'il se démembre aucun des droits royaux de l'Etat, tant pour le spirituel que pour le temporel. Et afin de vous faire encore mieux juger que je comprends fort bien toutes vos imaginations et représentations, c'est qu'il nous faudra un jour essayer de faire le semblable pour ce qui regarde tous ceux de la religion ; voire pensé -je avoir déjà en l'esprit un expédient par lequel j'y parviendrai fort facilement et sans mécontenter personne. Les conférences se continuèrent. La mort du prince de Parme et la dissolution de son armée permirent à Henri IV de se rapprocher de Paris et de s'établir à Mantes. Un jour il envoya chercher M. de Rosny, et le fit asseoir au chevet de son lit : il lui demanda son avis sur la manière de mettre fin à la situation déplorable et dangereuse où il se trouvait, et lui dit : Dites-moi librement ce que vous feriez si vous étiez en ma place. Sire, lui répondis-je, V. M. sait bien que je fais toujours ce que je puis pour ne lui donner jamais conseil en chose d'importance que je n'aie fort médité sur icelle. Or, usant de même forme en ce qui me regarde, je vous puis bien assurer que je n'ai encore jamais pensé à ce que je devrais faire pour être roi, m'ayant toujours semblé que je n'avais pas tête capable ni destinée à porter couronne. Mais quant à V. M., c'est un autre discours, à laquelle (à V. M.) ce désir est non seulement louable, mais nécessaire, n'y ayant nulle apparence que le royaume puisse être rétabli en sa grandeur, opulence et splendeur, que par le seul moyen de votre éminente vertu et courage vraiment royal... mais quelque droit que vous ayez au royaume, et quelque besoin qu'il ait de votre courage et vertu pour son rétablissement, toutefois, m'a-t-il toujours semblé, que vous ne parviendrez jamais à l'entière possession et paisible jouissance d'icelui, que par deux seuls expédients et moyens : par le premier desquels, qui est la force et les armes, il vous faudra user de fortes résolutions, sévérités, rigueurs et violences, qui sont toutes procédures entièrement contraires à votre humeur et inclination, et vous faudra passer par une milliasse de difficultés, fatigues, peines, ennuis, périls et travaux, avoir continuellement le... sur la selle, le halecret[28] sur le dos, le casque en la tête, le pistolet au poing et l'épée en la main ; mais, qui plus est, dire adieu repos, plaisirs, passetemps, amours, jeux, chiens, oiseaux et bâtiments ; car vous ne sortirez de telles affaires que par multiplicité de prises de villes, quantité de combats, signalées victoires et grande effusion de sang. Au lieu que par l'autre voie, qui est de vous accommoder, touchant la religion, à la volonté du plus grand nombre de vos sujets, vous ne rencontrerez pas tant d'ennuis, peines et difficultés... Aussi est-ce à V. M. à y prendre une absolue résolution d'elle-même, sans la tirer d'autrui, et moins de moi que de nul autre, sachant bien que je suis de la religion, et que vous me tenez près de vous, non pour théologien et conseiller d'Eglise, mais pour homme de main et conseiller d'Etat, puisque vous m'avez donné ce titre, et de longue main (depuis longtemps) employé pour tel. Sur quoi s'étant pris à rire et mis sur son séant, sur son lit, après s'être plusieurs fois gratté la tête, il me répondit : Je connais bien que tout ce que vous me dites est vrai ; mais je vois tant d'épines de tous côtés, qu'il sera fort difficile que quelques-unes d'icelles ne me piquent bien serré. Car, d'une part, vous savez assez que mes cousins les princes du sang et MM. de Nevers, de Longueville, Biron, d'O, Rieux, Vitry, Entragues, Sourdis et beaucoup d'autres, mais surtout Epernon, qui fut si hardi que de me déclarer tout haut qu'il ne reconnaîtrait jamais roi, ni lui ni tous ses amis, qui fût d'autre religion que la sienne, me pressent incessamment de me faire catholique, ou qu'ils formeront un tiers parti et se joindront à la Ligue. D'ailleurs, je sais de certain que MM. de Turenne, de la Trémoille et leur séquelle sollicitent journellement de toutes parts, afin que si je me fais catholique, il soit demandé une assemblée pour ceux de la religion, pour faire résoudre (établir) un protecteur et un établissement de conseils, subsistant par les provinces, toutes lesquelles choses je ne saurais supporter ; et s'il me fallait leur déclarer la guerre pour l'empêcher, ce me serait le plus grand ennui et déplaisir que je saurais jamais recevoir, mon cœur ne pouvant souffrir de faire mal à ceux qui ont si longtemps couru ma fortune, et employé leurs biens et leur vie pour défendre la mienne, voire y en ayant grand nombre, et de la noblesse et des villes, qu'il n'est pas en ma puissance de me garder d'aimer toujours. M. de Rosny se jeta à genoux, lui baisa les mains, les yeux découlant de larmes de joie, se réjouissant de voir le Roi si bien intentionné envers ceux de la religion, son appréhension ayant toujours été que si le Roi venait à changer de religion, comme il voyait bien que c'était chose qu'il lui faudrait faire, on le persuadât de les haïr et maltraiter. Peu de temps après ces curieux entretiens, Henri IV alla assiéger Dreux, et Rosny fut chargé de rassembler les canons et munitions nécessaires. La ville fut prise en avril 1593 ; mais le château et une grosse tour continuaient à résister. M. de Rosny fit pratiquer une mine sous la tour, et quelques jours après on y mit le feu. On ne vit d'abord qu'une grande fumée accompagnée d'un grand bruit, et il se passa près d'un demi-quart d'heure sans qu'il y eût d'autre résultat. Beaucoup de gens qui lui portaient envie se moquaient, disant tout haut : La mine de M. de Rosny ! La mine de M. de Rosny ! Et même le Roi ne put s'empêcher de dire : Il a bonne volonté ; mais il est si étourdi, qu'il veut que tout cède à ses imaginations. J'étais marri, honteux et en colère tout ensemble, dit Sully, et déjà chacun commençait à se séparer, lorsque l'on vit sortir de la tour une beaucoup plus grosse fumée que la première, et icelle se fendre par la moitié depuis le haut jusqu'en bas, dont l'une d'icelles[29] se renversa par terre en une infinité de morceaux, emportant avec elle une quantité d'hommes et quelques femmes et enfants, qui furent tous écrasés et brisés à sa chute ; et l'autre moitié demeurant debout, l'on vit sur quelques restes de voûtes et de planchers, et dans des embrasures et renfoncements de portes et de fenêtres, d'autres hommes, femmes et enfants, tous à découvert, sans se pouvoir cacher, tendant les mains et criant miséricorde. Il se faisait lors une si grande huée de toute l'armée que l'on ne pouvait rien entendre, et quelques soldats commençant à les tirer comme à l'affût, il en fut tué cinq ou six, et eussent les autres couru même fortune, sans le Roi qui en prit pitié, fit cesser ceux qui les tiraient, et envoya un exempt[30] de ses gardes avec douze soldats pour les aller querir et les lui amener : ce qui ayant été fait, il leur fit donner à chacun un écu et leur permit d'aller où bon leur semblerait. Il y eut quelque dispute pour ce gouvernement que j'estimais ne me pouvoir être refusé, tant à cause que j'avais été un des principaux promoteurs du siège et de la prise de la tour, que parce que la ville était proche de mes terres ; mais les zélés catholiques s'y opposèrent selon leur bonne coutume, et M. d'O l'emporta par dessus tous, au grand regret du Roi qui m'en fit des excuses en ces propres termes : Mon ami, me dit-il, c'est à mon grand regret et déplaisir que je ne vous ai pu bailler ce gouvernement, car vous le méritez mieux que nul autre, à cause du bon devoir que vous avez fait en ce siège ; mais vous voyez comme tous ces gens ici me gênent en toutes mes actions, jusqu'à me forcer en celles dont ils ne voudraient pas que je leur fisse la moindre instance du monde, ne craignant point de dire tout haut, voire de me menacer de m'abandonner et se joindre aux ennemis de l'Etat et de moi, si je ne change de religion. Vous avez ouï parler des belles conditions que le sieur de Villeroy a mises en avant, de la part de M. du Maine, moyennant lesquelles il offre de me reconnaître pour roi ; mais j'aimerais mieux être mort que de les avoir acceptées, à cause du désavantage qu'en recevrait l'Etat et tous mes anciens et plus loyaux serviteurs. Que s'il me faut faire quelque passe-droit pour mettre ce royaume en paix et sortir de la tyrannie de ces gens qui me travaillent ainsi, croyez qu'il n'y aura que moi seul qui en pâtisse ; mais aussi vous pouvez vous assurer que, si je puis un jour être roi et maître absolu, je ferai du bien et de l'honneur à ceux qui, comme vous, m'auront bien et utilement servi. Partant, prenez patience, aussi bien que moi, et continuez à bien faire. Pendant ce temps les Etats Généraux de la Ligue se tenaient à Paris ; la volonté du roi d'Espagne de devenir le maître de la France s'affichait hautement dans cette bizarre assemblée. Sans tenir compte de la Loi salique, Philippe II entendait qu'on reconnût pour reine de France, sa fille, héritière de la Couronne, disait-il, comme descendant d'Elisabeth de France, fille de Henri II, mariée à Philippe II en 1559 : on la marierait ensuite à un archiduc d'Autriche. Il y eut un soulèvement général, même chez bon nombre de Ligueurs, quand on connut les prétentions du roi d'Espagne. Le Parlement, par son arrêt du 2 8 juin 1593, maintint formellement la Loi salique, qui, en ce jour, conserva à la France son indépendance. Philippe II essaya de réparer son échec en déclarant que ce serait un Français, le duc de Guise, qui épouserait sa fille : l'opinion était enfin éclairée sur la valeur réelle de la Ligue et des secours qu'elle recevait de l'Espagne. Par patriotisme, ou par jalousie de n'être pas proposé pour roi, Mayenne se prononça pour le maintien de la Loi salique. Henri IV n'avait qu'à se convertir au catholicisme pour devenir roi de France reconnu à peu près par tout le monde. Des conférences s'ouvrirent à Saint-Denis, après lesquelles il se déclara convaincu et fit son abjuration, le 24 juillet 1593, entre les mains de l'archevêque de Bourges, Renaud de Beaune, du cardinal de Bourbon et de neuf évêques. Le 25, il entendait la messe dans la vieille basilique de Saint-Denis. Une de trois mois avait été signée, et, malgré les défenses de la Ligue, la population de Paris accourait à Saint-Denis pour voir le Béarnais assister à la messe, pour admirer sa bonne mine et crier : Vive le Roi ! ou : Dieu le bénisse et le veuille bientôt amener en faire autant dans notre église Notre-Dame ! lui donnant mille louanges, et priant Dieu pour sa prospérité, bonne et longue vie. Sur quoi, dit Sully, je pris occasion de m'arrêter, d'autant que je marchais devant le Roi, pour lui dire : Hé bien ! Sire, que vous en semble de ce peuple que l'on disait ne vouloir pas vous accorder la qualité de Roi ; ne reconnaissez-vous pas bien maintenant qu'il n'y a jamais pensé, puisque, si librement, il vous la donne par acclamations publiques, bénédictions et larmes de joie. Ce qui lui en causait une si grande en lui-même, que quasi les larmes lui en venaient aux yeux. Et continuèrent les visites de ces Parisiens, tant que le Roi fut à Saint-Denis. Il fallait profiter de la situation ; il fallait que le Roi se fît sacrer, qu'il entrât dans Paris et dans Rouen. Henri IV se chargea de Paris ; Rosny fut chargé de Rouen et de négocier avec Villars. Reims étant encore au pouvoir de la Ligue, le Roi fut sacré à Chartres, le 27 février 1594, par l'évêque de cette ville, M. de Thou. Parti pour Rouen avec les pouvoirs les plus étendus[31], pour traiter avec Villars, Rosny trouva un homme qui entendait se faire payer cher sa défection. Il exigeait du Roi des conditions exagérées : gouvernement de Rouen et du Havre, charge d'amiral de France, revenus de six grandes abbayes, 1.200.000 livres[32] de dettes payées, 60.000 livres[33] de pension, etc. Rosny crut devoir en référer au Roi, qui lui écrivit (8 mars) la lettre suivante, témoignage de la familiarité avec laquelle le Roi traitait son ami. Mon ami, vous êtes une bête d'user de tant de
remises et apporter tant de difficultés et de ménage (économie) en une affaire de laquelle la conclusion m'est de
si grande importance pour l'établissement de mon autorité et le soulagement
de mes peuples. Ne vous souvient-il plus des conseils que vous m'avez tant de
fois donnés, m'alléguant pour exemple celui d'un certain duc de Milan[34] au roi Louis XI,
au temps de la guerre nommée du Bien public, qui était de séparer par
intérêts particuliers tous ceux qui étaient ligués contre lui, sous des
prétextes généraux, qui est ce que je veux essayer de faire maintenant,
aimant beaucoup mieux qu'il m'en coûte deux fois autant, en traitant
séparément avec chaque particulier, que de parvenir à mêmes effets par le
moyen d'un traité général fait avec un seul chef — comme vous savez bien des
gens qui me le voulaient ainsi persuader —, qui pût, par ce moyen, entretenir
toujours un parti formé dans mon Etat : partant, ne vous amusez plus à faire
tant le respectueux pour ceux dont il est question, lesquels nous
contenterons d'ailleurs, ni le bon ménager, ne vous arrêtant à de l'argent ;
car nous paierons tout des mêmes choses que l'on nous livrera, lesquelles s'il
fallait prendre par la force nous coûteraient dix fois autant. Comme donc je me fie du tout (complètement) en vous et vous aime comme un bon serviteur, ne doutez (craignez) plus aussi à user absolument et hardiment de votre pouvoir que j'autorise encore par cette lettre en tant qu'il en pourrait avoir besoin, et concluez au plus tôt avec M. de Villars. Mais assurez si bien les choses qu'il n'y puisse arriver d'altération, et m'en mandez promptement des nouvelles ; car je serai toujours en doute et en impatience jusques à ce que j'en aie reçu. Puis, lorsque je serai Roi paisible, nous userons des bons ménages dont vous m'avez tant parlé, et pouvez vous assurer que je n'épargnerai travail, ni ne craindrai péril pour élever ma gloire et mon Etat en leur plus grande splendeur. Adieu, mon ami. De Senlis, ce huitième de mars 1594. HENRY. Le traité fut enfin conclu et signé, mais ne fut pas encore rendu public. Rosny en prévint aussitôt le Roi, qui lui écrivit le 14 mars 1594 : Mon ami, j'ai vu, tant par votre dernière lettre que par vos précédentes, les signalés services que vous m'avez rendus pour la réduction entière de la Normandie en mon obéissance, lesquels j'appelerais volontiers des miracles, si je ne savais bien que l'on ne donne ce titre aux choses tant journalières et ordinaires que me sont les preuves par effet de votre loyale affection, laquelle aussi je n'oublierai jamais. Je serai très aise de pouvoir faire promptement le voyage auquel vous me conviez, car la personne et l'ouvrage le méritent ; mais une autre de non moindre importance me retient ici attaché, à laquelle même je serai bien aise que vous participiez : partant, je vous prie, après néanmoins que vous aurez si bien affermi votre traité que votre absence n'y puisse apporter d'altération, venez me trouver, vers le vingtième, à Senlis, ou le vingt-unième de ce mois, à Saint-Denis, afin que vous veniez aider à crier : Vive le Roi ! dans Paris, et puis nous en irons faire autant à Rouen. Montrez cette lettre au nouveau serviteur que vous m'avez acquis, afin qu'il voie que je me recommande à lui, sache que je l'aime bien, et que je sais priser et chérir les braves hommes comme lui. Adieu, mon ami. De Senlis, ce quatorzième mars 1594. HENRY. Aussitôt que j'eus reçu cette lettre, dit Sully, je la portai à M. de Villars, qui en reçut un si grand contentement, qu'il me dit : Pardieu, ce prince est trop gentil et courtois de se souvenir de moi et d'en parler en si bons termes ; aussi m'en ressenté-je tellement obligé, que j'en rendrai des témoignages arrivant près de lui : et quant aux sûretés pour ce que vous avez traité avec moi, n'en cherchez point d'autres que celle de ma foi que je vous ai donnée, et n'ayez crainte qu'il y soit rien changé par votre absence. Parti de Rouen, Rosny arriva à Saint-Denis et trouva Henri IV sur le point de s'acheminer vers Paris, dont il avait acheté l'une des portes au comte de Cossé-Brissac, gouverneur de la ville, qui se vendit pendant qu'il méritait encore d'être acheté. Paris ne restait à la Ligue que grâce à la garnison espagnole, qui commençait même à n'être plus assez forte pour maintenir la population parisienne. Aussi Mayenne avait-il quitté Paris et était-il allé à Soissons presser le comte de Mansfeld d'arriver avec les troupes qu'il commandait. Brissac profita de l'absence de Mayenne pour ouvrir au Roi, le 22 mars 1594, la Porte-Neuve, sur la rive droite de la Seine, entre le Louvre et les Tuileries, à peu près à la hauteur de la rue de Beaune. Brissac s'était fait bien payer : il obtint pour lui : le bâton de maréchal, les gouvernements de Mantes et de Corbeil, 200.000 écus et une pension de 20.000 livres[35] ; — pour son parti : l'amnistie, l'interdiction du culte calviniste à Paris, la liberté de se retirer pour le Légat, l'ambassadeur d'Espagne et les troupes étrangères. M. de Brissac ayant dit au Prévôt des marchands de Paris, Jean Lhuillier, qu'il était juste de rendre à César ce qui était à César, le Prévôt lui répliqua : Il faut lui rendre, et non pas lui vendre. Henri IV rendit compte au marquis de Pisani, son ambassadeur à Rome, de l'entrée à Paris ; nous reproduisons sa lettre. Monsieur le marquis, le long temps qu'il y a que j'ai eu avis de votre partement (départ) d'Italie pour vous en venir me retrouver, et l'incertitude où j'étais que mes lettres ne vous rencontrassent en chemin, est cause que je ne vous en ai fait aucune depuis quelque temps ; mais à présent je n'ai voulu, pour cette difficulté, laisser de vous faire celle-ci, au hasard, pour vous donner avis que, après le partement du duc du Maine de cette ville (Paris), m'en étant approché pour exécuter une entreprise que j'y avais par l'intelligence du sieur comte de Brissac, de la Cour de Parlement, échevins et autres chefs de ladite ville, Dieu m'y a tellement favorisé, par sa sainte grâce, que ce jour d'hui[36] matin j'y suis entré par la Porte-Neuve, qui m'a été livrée sans effusion de sang, sinon de quelques Lansquenets[37], qui étaient en un corps de garde près de ladite Porte-Neuve, qui voulurent empêcher ceux qui favorisaient l'entrée des miens, car pour le reste de la ville, la plupart des habitants prirent les armes pour moi ; les autres, desquels on se défiait, avaient eu commandement de ne bouger de leurs maisons. Quant aux Espagnols, ils se sont retirés en une maison, et leur ayant envoyé faire offrir, par des hérauts, de les laisser aller avec leurs armes et bagage, comme j'ai aussi fait au duc de Feria et à don Diego, qui était chose désirée et réservée par ceux qui ont dressé et conduit la pratique (négociation), ils l'ont accepté, et sont sortis de cette ville, après dînée, les faisant conduire jusques sur ma frontière ; de sorte que, sur les huit heures, après m'être promené partout, et voyant que rien ne se remuait en nul endroit, je suis allé en la grande église Notre-Dame, faire chanter le Te Deum, où il y eut tant de peuple, que ladite église n'était assez grande, témoignant une si grande allégresse de me voir, que je n'ai occasion de douter à présent de leur affection[38]. Aussi n'ont-ils reçu aucun déplaisir, car pas un des soldats ne s'est débandé pour piller ; à quoi j'avais donné bon ordre. Il ne reste que la Bastille, laquelle j'espère avoir bientôt, s'il Dieu plaît[39]. Je m'assure que vous serez bien aise de cette bonne nouvelle, etc. Le lendemain de cette journée de triomphe, Henri IV envoya M. de Rosny à Rouen ; et, le 27 mars, dans l'abbaye de Saint-Ouen et devant une nombreuse assemblée, Villars se mit l'écharpe blanche au col, et, toujours grossier dans son langage, il s'écria tout haut : Allons, morbieu, la Ligue est f...inie, que chacun crie : Vive le Roi ! Et alors, dit Sully, il se fit une telle acclamation, que tout l'air en retentissait, laquelle entendue et un signal préparé tout exprès, donné du clocher au fort Sainte-Catherine, aux vaisseaux du port et autres lieux où il y avait du canon et des gens de guerre, il se fit une salve de pièces et d'arquebuses qui dura fort longtemps, qui faisait trembler les maisons de la ville. Puis, les cloches retentissant de toutes parts, je pris M. de Villars par la main et lui dis : Monsieur, ce son de cloches, et surtout Georges d'Amboise[40], nous appelle à Notre-Dame, pour y aller rendre grâces à Dieu et chanter le Te Deum : à quoi il se disposa aussitôt. A quelque temps de là, M. de Villars vint à Paris avec un grand train et un magnifique équipage, ayant à sa suite plus de cent gentilshommes. Faisant la révérence au Roi, il poussa l'humilité jusqu'à se mettre à genoux ; mais il fut aussitôt relevé par S. M. avec ces paroles : Monsieur l'Amiral, c'est devant Dieu qu'il faut user de cette submission et non devant un roi de France, qui ne désire nulle qualité plus haute que de père envers ses sujets et de vrai ami entre ses vrais serviteurs. |