|
I. — DIOCLÉTIEN ET MAXIMIEN OU LA DYARCHIE (281-295).
Dioclès, qui, après son avènement, donna à son nom grec
une désinence romaine et plus sonore, Diocletianus[1], était un Dalmate
des environs de Scutari dont le père avait été esclave. Entré jeune au
service, il se fit remarquer de ses chefs, moins par des actions d’éclat que
par son esprit pénétrant et délié : qui trouvait toujours la mesure la plus
sage à prendre et les meilleurs moyens de l’exécuter[2]. A la mort de
Claude le Gothique, il avait, vingt-cinq ans, l’âge qui convenait pour
profiter des leçons de la grande école militaire d’Aurélien et de Probus[3]. En ces temps
troublés, l’avancement était rapide ; il arriva promptement aux grades
supérieurs, fut consul substitué, gouverneur de la Mœsie et comte des
domestiques, poste de confiance qui le mettait très haut dans la hiérarchie.
Pour donner à croire qu’en égorgeant Aper il avait exécuté un arrêt du ciel,
Dioclétien raconta qu’une druidesse de Tongres, dans la Belgique, lui avait
promis qu’il serait empereur quand il aurait jeté à terre un sanglier. Depuis ce jour, disait-il, j’en ai cherché partout et j’en ai beaucoup tué, mais
d’autres les mangeaient. Aurélien, en effet, puis Probus, Tacite,
Carus, montaient au trône, et lui restait dans le rang. Le 17 septembre 284,
le sanglier fatal[4]
tombait enfin sous ses coups, et le fils de l’esclave dalmate était empereur.
 Les rares documents que nous possédons sur Dioclétien ne
donnent pas ces détails intimes qui permettent de pénétrer jusqu’au fond de
l’âme des personnages de l’histoire. Cependant, malgré les lacunes et les
obscurités, on entrevoit qu’il fut plus qu’un soldat de fortune. Mais ce
parvenu ne sortait point d’une de ces riches et intelligentes cités où les
Antonins avaient appris les élégances de la société romaine. Aussi, n’ayant
pas, pour tenir la foule à distance, leur distinction naturelle ou acquise,
il s’entourera de pompes solennelles et froides, réglées par une sévère
étiquette. Dans les arts, il aimera les constructions massives, la lourde
ornementation des époques de décadence, et, tandis que la villa d’Hadrien à
Tibur nous a conservé quantité de chefs-d’œuvre, du palais de Dioclétien, à
Salone, vaste amoncellement de marbre, de granit et de porphyre, pas un ne
nous est venu. Les rares documents que nous possédons sur Dioclétien ne
donnent pas ces détails intimes qui permettent de pénétrer jusqu’au fond de
l’âme des personnages de l’histoire. Cependant, malgré les lacunes et les
obscurités, on entrevoit qu’il fut plus qu’un soldat de fortune. Mais ce
parvenu ne sortait point d’une de ces riches et intelligentes cités où les
Antonins avaient appris les élégances de la société romaine. Aussi, n’ayant
pas, pour tenir la foule à distance, leur distinction naturelle ou acquise,
il s’entourera de pompes solennelles et froides, réglées par une sévère
étiquette. Dans les arts, il aimera les constructions massives, la lourde
ornementation des époques de décadence, et, tandis que la villa d’Hadrien à
Tibur nous a conservé quantité de chefs-d’œuvre, du palais de Dioclétien, à
Salone, vaste amoncellement de marbre, de granit et de porphyre, pas un ne
nous est venu.
Il semble avoir eu plus de goût pour les lettres. Nous
savons qu’il dota Nicomédie d’une école d’enseignement supérieur, où il
appela Lactance, le plus éloquent des rhéteurs de ce temps[5] ; qu’il dispensa
les étudiants, jusqu’à leur vingt-cinquième année, des charges municipales[6] ; qu’il avait
pris pour modèle Marc Antonin le Philosophe[7], un plus grand
homme que lui, mais un moins grand prince ; qu’enfin il fit rédiger des
biographies d’empereurs[8]. Malheureusement,
les leçons qu’il prit dans l’histoire, tout en lui révélant les vraies
nécessités du gouvernement, ne lui enseignèrent pas la douceur. Il sera
impitoyable pour les insurrections armées, même pour celles qui ne le seront
pas, et, s’il eut dans sa retraite beaucoup de philosophie pratique, il ne
parait pas avoir jamais eu une grande curiosité d’esprit : à Salone, son
jardin l’occupera plus que les livres. Sa religion était celle du paysan :
pour ses infirmités, un dieu guérisseur, Esculape ; pour sa fortune, un dieu
protecteur, Jupiter, et la voix des oracles mieux écoutée, en certains cas,
que celle de la sagesse humaine.
Mais il posséda les qualités qui font le prince : la
connaissance des hommes, l’intelligence des besoins de l’État et le ferme
propos de donner sans relâche sa pensée et sa personne aux soins du
gouvernement. On pourrait s’imaginer que ce créateur de la cour byzantine fut
un efféminé ; il eut, pour ses provinces, les frontières et les armées, la
sollicitude virile d’Hadrien. Comme cet infatigable voyageur, il sera
constamment sur les grands chemins de l’empire. Il pèsera mûrement ses
desseins ; il les arrêtera de loin, afin d’avoir le temps d’en assurer le
succès, et il exécutera avec énergie ce que la prudence aura préparé. Son
buste, au Capitole, montre bien cette ténacité patiente. A voir ce front
large et carré, ce visage tranquille et froid, on reconnaît l’homme maître de
lui-même, ce qui est la première condition pour devenir maître des autres.
Lactance l’accuse de lâcheté et d’avarice. Singuliers
reproches adressés au soldat qui avait conquis ses grades sur les champs de
bataille, et au prince économe qui ne fut le plus fastueux des empereurs que
parce qu’il crut ce faste nécessaire à la monarchie nouvelle qu’il fondait.
Nous ne croirons pas davantage Lampride, quand il l’appelle le Père du siècle d’or[9] ; le quatrième
siècle n’a aucun droit à ce titre. L’histoire de son règne qui, sauf à un
moment, donna à la société romaine une longue paix intérieure, à l’empire
quarante ans de sécurité, nous le fera mieux connaître que les paroles
suspectes de ses ennemis et de ses flatteurs.
L’élu de l’armée d’Orient avait un dangereux compétiteur,
Carin, qui, fier d’un brillant succès sur les Jazyges, n’entendait pas
abandonner l’héritage de son père. Mais, détesté du sénat[10], chose, il est
vrai, de peu de conséquence, Carin était méprisé pour sa luxure par les rudes
compagnons d’armes des derniers princes et redouté des soldats à cause de sa
cruauté ; cette désaffection de l’armée était grave pour un prince qui avait
à combattre un compétiteur.
Des deux côtés, on mit plusieurs mois à préparer la lutte.
Carin renversa d’abord Julien, gouverneur de la Vénétie,
qui avait pris la pourpre, et il remporta quelques avantages partiels sur
l’avant-garde de Dioclétien. En mars ou avril 285, les armées se
rencontrèrent pour l’action décisive, à Margus sur la Morawa, non loin du
confluent de cette rivière avec le Danube. Comme toujours les légions
asiatiques fléchirent sous le choc des légions d’Europe ; mais Carin fut tué
par un de ses officiers dont il avait déshonoré la femme[11].
Cette mort semble avoir ôté pour tout le monde une
délivrance. De la part du vainqueur, point de confiscations ni d’exils ;
chacun garda sa place, même les préfets de la ville et du prétoire :
Dioclétien prit l’un d’eux pour collègue dans le consulat. C’est à croire
qu’une secrète entente s’était faite avant la bataille et que les officiers de
l’empereur d’Occident l’avaient vendu à son compétiteur. Eutrope (IX, 20) dit qu’il fut
trahi, ou tout au moins abandonné. On verra de même, dans les armées de
Vétranion, de Magnence, de Maxime et d’Eugène, des défections probablement
préparées par l’or de Constance et de Théodose. En ce temps où Rome n’avait
plus pour soldats que des mercenaires, la meilleure des machines de guerre
était une caisse bien remplie.
Cette grande commotion avait ébranlé l’empire, encouragé
les Barbares et diminué la fidélité des sujets que Rome protégeait mal et que
le fisc ruinait. Les impôts étaient lourds par eux-mêmes et à raison de
l’épuisement des sources de la production[12]. Ce que nous
avons dit des misères de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, de la
disparition des petits propriétaires, de l’abandon des campagnes, même dans
les plus fertiles régions, fait comprendre qu’au milieu de ces populations
effarées par le malheur, Gallias efferatas
injuriis[13], il ait éclaté
des insurrections. Celle des Bagaudes[14] fut un instant
formidable. Esclaves fugitifs, colons pressurés par leurs maîtres, paysans
sans feu ni lieu, débiteurs insolvables, s’étaient faits brigands et finirent
par former une armée qui se donna deux césars, Ælianus et Amandus (285). Nous avons
des monnaies frappées pour ces empereurs des paysans[15] ; au revers de
l’une se lit le mot : Expérance.
Se faisant de toute une arme, ils se jetèrent avec la sauvage ardeur des
mauvais instincts, lorsqu’ils sont déchaînés, sur les bourgs, sur les villes
ouvertes, saccageant, brûlant et tuant[16]. Autun, naguère
l’orgueil de la Gaule,
fut une seconde fois dévastée[17]. Les chefs de
brigands sont souvent populaires : la guerre qu’ils font aux riches semble
aux pauvres des représailles légitimes. Les Bagaudes restèrent dans la mémoire
du peuple comme les défenseurs des malheureux. Une tradition qui se forma aux
siècles suivants voulut même que la Bagaudie eût été une insurrection chrétienne[18]. Il n’y aurait
pas à s’étonner que tics chrétiens eussent été dans leurs rangs, comme il s’en
était trouvé dans les bandes gothiques qui avaient ravagé l’Asie-Mineure. Eux
aussi n’étaient-ils pas des opprimés, et l’esprit de vengeance, interdit aux
saints, ne pouvait-il armer contre une société qui les écrasait ceux qui
avaient plus de colère que de résignation[19] ? Pendant que le
nord de la Gaule
était en feu, les Saxons couraient la mer du Nord et la Manche dont ils
dévastaient les rivages ; les Francs s’agitaient sur le Rhin, d’autres
Germains sur le Danube, les Maures en Afrique, les Perses derrière le Tigre :
toute la ligne des frontières était menacée, et l’empire chancelait.
Dioclétien passa douze ans à raffermir sur sa base le colosse ébranlé.
Il avait vu les princes les plus vaillants, les sauveurs
de l’empire, égorgés par leurs soldats ; d’autres tombés victimes des
machinations de leurs généraux. Les violences de la soldatesque, les
trahisons des ambitieux et les attaques du dehors étaient le triple péril
qu’il fallait conjurer. Si, pour arriver au souverain pouvoir, il n’y avait
qu’un homme à renverser, plusieurs tenteraient encore l’aventure ; mais il
serait difficile d’abattre deux empereurs à la fois, et cette difficulté
devait arrêter les impatients. Dans l’intérêt de l’empire et de lui-même,
Dioclétien avait donc besoin d’un collègue qui, n’ayant plus d’ambition,
l’aiderait à contenir celle des autres, en même temps qu’il contiendrait les
Barbares. Dès le premier siècle de l’empire, on avait reconnu cette nécessité
: Pison avait été adopté par Galba, Trajan par Nerva ; au temps de Marc
Aurèle, de Sévère, des Gordiens, de Valérien, de Carus[20], on avait vu
plusieurs empereurs à la fois, et l’histoire des Trente Tyrans, que
Dioclétien se faisait raconter, lui avait montré que l’empire vieillissant
était exposé à trop de dangers pour qu’une seule main pût parer tous les
coups. C’était la solution de l’avenir, celle qui était imposée par la
géographie, laquelle est une grande force ; par la division naturelle de
l’empire en deux moitiés, l’une grecque, l’autre latine ; par la faiblesse
enfin d’un État qui, ne sachant plus conquérir, était réduit à se défendre.
Entouré de Barbares qu’il n’avait pas voulu, au temps de sa force, soumettre
et civiliser, il restait comme une proie au milieu de loups dévorants. Le
temps était donc venu d’organiser une vigoureuse défensive en rendant, par la
division du pouvoir, l’action impériale présente et active dans toutes les
provinces. Quant aux légionnaires rebelles, aux généraux usurpateurs, on
réussirait peut-être à prévenir leurs révoltes en faisant soi-même la part
des plus ambitieux ou des plus habiles.
 Dioclétien eut cette vue nette des besoins publics qui, en
politique, dénote l’homme supérieur. Le 1er mai 285, il revêtit de
la pourpre, non pas un parent, mais un de ses compagnons d’armes, Maximien
et, à cette occasion, il prit encore un nom nouveau, Jovius, qu’on pourrait traduire par voué à Jupiter. Il avait une dévotion
particulière pour ce dieu dont le nom commençait le sien[21] ; il en mit
l’image sur ses monnaies, la statue sur la colonne au pied de laquelle il
revêtira Galère des insignes impériaux ; il lui bâtit un temple dans son
palais de Salone et il s’étudia à en représenter dans les cérémonies
publiques la calme majesté. A Maximien, qu’il adopta comme fils[22], il donna le nom
d’Herculius, en souvenir de
l’assistance prêtée par le fils d’Alcmène à son père, le maître de l’Olympe,
durant la guerre des Géants[23]. Ces
appellations étaient bien choisies pour caractériser le rôle réservé aux deux
princes : l’un devant être la pensée qui conçoit ; l’autre, la force qui
exécute. Maximien n’était pas proclamé auguste ; son titre de césar marquait
un degré de subordination, et le surnom qu’il avait accepté lui faisait un
devoir de l’obéissance filiale. Dioclétien eut cette vue nette des besoins publics qui, en
politique, dénote l’homme supérieur. Le 1er mai 285, il revêtit de
la pourpre, non pas un parent, mais un de ses compagnons d’armes, Maximien
et, à cette occasion, il prit encore un nom nouveau, Jovius, qu’on pourrait traduire par voué à Jupiter. Il avait une dévotion
particulière pour ce dieu dont le nom commençait le sien[21] ; il en mit
l’image sur ses monnaies, la statue sur la colonne au pied de laquelle il
revêtira Galère des insignes impériaux ; il lui bâtit un temple dans son
palais de Salone et il s’étudia à en représenter dans les cérémonies
publiques la calme majesté. A Maximien, qu’il adopta comme fils[22], il donna le nom
d’Herculius, en souvenir de
l’assistance prêtée par le fils d’Alcmène à son père, le maître de l’Olympe,
durant la guerre des Géants[23]. Ces
appellations étaient bien choisies pour caractériser le rôle réservé aux deux
princes : l’un devant être la pensée qui conçoit ; l’autre, la force qui
exécute. Maximien n’était pas proclamé auguste ; son titre de césar marquait
un degré de subordination, et le surnom qu’il avait accepté lui faisait un
devoir de l’obéissance filiale.
Depuis Claude II, l’Illyricum, la
région de l’empire où se livraient le plus de combats, était en possession de
fournir des empereurs[24], comme
l’Espagne, la Gaule,
l’Afrique et la Syrie
en avaient successivement donné. Maximien était fils d’un colon pannonien des
environs de Sirmium. Brave soldat et général expérimenté, mais de mœurs
grossières et d’esprit inculte, au point de ne connaître, lui qui reprit
Carthage, ni Annibal, ni Scipion, ni Zama, il se sentait inférieur à
Dioclétien et ne s’en irritait pas. L’auguste s’était donc choisi moins un
collègue qu’un lieutenant docile.
Carus avait pris Ctésiphon, mais les Perses ÿ étaient bien
vite rentrés, de sorte que Rome comptait une victoire de plus et pas un
ennemi de moins. Retenu en Asie par leurs dispositions hostiles, Dioclétien
chargea le césar d’aller rétablir l’ordre en Gaule et la sécurité sur les
frontières occidentales. La
Seine et la
Marne forment à leur confluent une presqu’île que les
Bagaudes avaient coupée par de larges fossés (Saint-Maur-les-Fossés) : c’était leur
forteresse et leur camp de refuge ils y entassaient le produit de leurs
pillages et s’y croyaient inexpugnables. Mais leurs bandes mal armées, plus
mal disciplinées, ne tinrent pas devant les légions : en quelques semaines,
cette Jacquerie refoulée sur le camp de Saint-Maur y fut étouffée[25].
La pacification de la Gaule valut au césar le titre d’auguste (286)[26]. Dioclétien
n’avait pas voulu courir le risque que l’armée victorieuse, en donnant à son
chef la dignité suprême, fit de lui un rebelle. Mais à cette élévation il mit
la condition que Maximien Hercule déposerait la pourpre lorsque lui-même en
donnerait l’exemple ; un serment solennel sur l’autel de Jupiter consacra cet
engagement[27].
Le nouvel auguste avait déjà, comme césar, la puissance
tribunitienne et proconsulaire ; il reçut le titre de grand pontife, qui
n’avait encore été partagé qu’une fois, entre Pupien et Balbin. Il eut son
préfet du prétoire, son armée, son trésor, et il promulgua des rescrits
partout exécutoires, quoiqu’il ne fût chargé que de l’administration des
provinces occidentales. L’unité de l’empire était maintenue par la déférence
que Maximien avait promise à son collègue ; elle était attestée à tous les
yeux par l’unité de la législation, les édits étant rendus au nom des deux
princes, et par celle de la monnaie qui était la même, des rives de
l’Euphrate à celles du Rhin. Les inscriptions commémoratives de travaux
publics exécutés par l’un d’eux portaient leurs noms réunis[28] ; en un mot,
l’administration était divisée, le gouvernement ne l’était pas : Dioclétien
en tenait seul les rênes[29]. Dans les actes,
son nom précédait celui de Maximien comme plus tard Constance sera toujours
nommé avant Galère. Cet ordre invariable prouve que, dans le système de
Dioclétien, une certaine prééminence était réservée au premier auguste.
Pour l’expédition contre les Bagaudes, les postes du Rhin
avaient été dégarnis ; les Germains voulurent en profiter : les Hérules et
les Chavions au nord[30], les Burgondes
et les Alamans au sud, franchirent le fleuve. Mais ils arrivaient trop tard ;
Maximien avait ramené ses troupes à Mayence, et de cette forte position il
observait les mouvements des Barbares. Les Burgondes et les Alamans lui
semblèrent trop nombreux pour qu’il osât les attaquer de front ; il les
laissa s’enfoncer dans les provinces désolées, où la famine et la maladie les
décimèrent ; lorsque leurs bandes diminuées reparurent à sa portée, il en eut
facilement raison. Les Hérules, moins dangereux, avaient été arrêtés dès les
premiers pas et rejetés de l’autre côté du fleuve. Ce n’étaient point de glorieuses
victoires ; mais on s’inquiétait peu des ruines faites par les Barbares ; il
suffisait alors à la dignité romaine que l’empereur pût dire : L’ennemi n’est plus dans l’empire.
Trèves était devenue la Rome des Gaules. Elle avait un palais pour le prince,
des arsenaux et des manufactures pour les armées, un cirque et un forum pour
le peuple. Aux calendes de janvier 238, une solennité y avait attiré une
foule nombreuse : Maximien prenait pour la seconde fois les faisceaux
consulaires. Selon l’usage, il allait du haut de la tribune adresser une
harangue à l’assemblée, quand soudain une clameur partit des remparts : Les Barbares sont aux portes ! L’empereur jette
sa toge consulaire, prend la cuirasse et court à l’ennemi. C’étaient des
cavaliers germains qui s’étaient glissés entre les postes légionnaires et qui
pillaient[31].
Telle était la vie sur cette frontière.
Pour donner la chasse aux pirates saxons et francs qui
désolaient les côtes de la
Bretagne et de la
Gaule, Maximien avait réuni à Boulogne, sous un de ses
lieutenants, le Ménapien Carausius, une flotte qui devait fermer le détroit.
Ce Carausius, ancien rameur dans la chiourme des galères impériales, n’avait
pas élevé ses sentiments avec sa fortune : il s’arrangea pour piller les
pillards qui étaient pour lui des compatriotes. Ceux-ci passaient librement,
mais au retour ils étaient arrêtés et contraints de partager leur butin avec
l’amiral. Il ramassa de cette manière assez d’or pour acheter ses officiers
et ses équipages ; et quand Maximien prononça contre lui une sentence de
mort, il ne se trouva personne qui voulût l’exécuter. Carausius se mit hors
d’atteinte, en gagnant la
Bretagne dont il débaucha les troupes, et il prit le titre
d’auguste (287).
Avec une remarquable intelligence des ressources que lui offrait la
possession de l’île, il organisa une marine puissante, qui fit respecter ses
enseignes jusqu’aux colonnes d’Hercule, et son alliance avec des Saxons et
des Francs assura le recrutement de sa flotte et de son armée. Plusieurs
villes du littoral gaulois conservèrent leurs vieilles et fructueuses
relations de commerce avec la
Bretagne : Boulogne resta même dans ses mains. Carausius
était donc maître de son île et de la mer, et Maximien ne pouvait rien contre
lui. Il fit cependant une tentative pour lui disputer l’une et l’autre : une
flotte fut construite aux embouchures des fleuves gaulois, et, à la fête des
Palilies (21 avril 289),
le panégyriste officiel[32] célébra dans
Trèves la chute prochaine du chef des pirates.
On ignore les détails de la lutte, mais on sait que le brigand passa empereur légitime, en vertu d’un
traité qui lui reconnut le titre d’auguste et lui laissa le royaume qu’il
s’était donné (290).
Les monétaires bretons frappèrent des monnaies à l’image d’Hercule conservateur des trois augustes ; sur d’autres,
on lit les mots : Carausius et ses frères.
Ce traité était un aveu d’impuissance, mais Dioclétien le
considérait comme un armistice nécessaire pour attendre des jours propices.
Il ne voulait pas que Maximien détournât son attention et ses forces de la Germanie ; lui-même
avait dû se rendre en Syrie pour surveiller l’Égypte, où la turbulente
Alexandrie inspirait des craintes, et les Perses, dont la mort de Carus avait
ranimé le courage. Le séjour prolongé de l’empereur et d’une armée si près de
la frontière persane, et une guerre civile, suscitée par un compétiteur,
décidèrent le roi Bahram à éviter toute complication avec les Romains. Ses
ambassadeurs vinrent au-devant de Dioclétien lorsqu’il approcha de l’Euphrate
; ils lui offrirent des présents de la part de leur maître et sollicitèrent
son amitié.
L’empereur n’en demandait pas, pour le moment, davantage,
préoccupé qu’il était d’une affaire plus importante pour la sécurité de
l’empire qu’une nouvelle victoire sur des cavaliers insaisissables. Depuis
vingt-sept ans l’Arménie était une province persane, et depuis Auguste, même
depuis Pompée, la politique traditionnelle des Romains avait été de retenir
ce pays sous leur influence. Un héritier de la couronne d’Arménie, Tiridate,
vivait à la cour impériale, où il avait gagné, par son commerce aimable,
l’affection des principaux personnages, et par son courage, par sa force et
son habileté dans tous les exercices, l’estime et le respect des soldats. Ce
prince était un instrument précieux pour l’exécution d’un dessein que le
spectacle de l’anarchie qui régnait en Perse avait fait naître dans l’esprit
de Dioclétien : livrée à tous les maux d’une domination étrangère, l’Arménie
avait été blessée dans ses croyances et dans son patriotisme ; les statues de
ses rois étaient brisées, les objets de son culte profanés, sa noblesse
exclue des charges : une haine violente couvait dans les cœurs. Tout était
donc prêt pour une révolution, et les troubles de la Perse promettaient le
succès. Tiridate partit avec les instructions et les vœux de Dioclétien, mais
sans assistance ostensible. Elle n’était point nécessaire, et elle eût été
une violation de l’amitié récemment promise au roi Bahram. Dès que le
prétendant parut, les défections se produisirent de toutes parts. Tiridate
remonta sur le trône de ses pères et garda pour Rome cette grande forteresse
d’Arménie, qui protégeait contre les Perses l’Asie Mineure et une partie des
provinces syriennes (287).
Cette victoire sans larmes, gagnée par la politique, était
un important succès. Pour éviter toute réclamation du Grand Roi, Dioclétien
s’était éloigné de la Syrie
avant le départ de Tiridate. Un rescrit nous le montre en Thrace au milieu
d’octobre 286
[33]
; il se rendait en Pannonie, que des bandes sarmates ravageaient, et dans la Rætie, où il était
nécessaire de montrer les enseignes. A l’exemple des grands empereurs, il
visitait les frontières pour ramener, avec le respect du nom romain, la
sécurité ; et partout il relevait la ligne des défenses qui s’étaient
écroulées sous les pas des Barbares[34].
Maximien était venu de la Gaule à la rencontre de son collègue ; dans
leur conférence furent sans doute arrêtées, contre Carausius, les mesures que
l’habile usurpateur sut déjouer l’année suivante. Les documents rares et
confus de cette époque ne permettent pas d’en reconstituer la vie[35] ; nous sommes
réduits à recueillir, dans les panégyriques ou les pamphlets, deux sources
bien troubles, des faits isolés, sans pouvoir établir entre eux cette liaison
de cause à effet qui forme la trame solide de l’histoire. Les rescrits rendus
par les empereurs montrent bien les villes où ils se trouvaient en les
écrivant, mais ne disent pas l’intérêt qui les avait appelés en ces lieux ;
on ne parvient à le soupçonner qu’en rapprochant des dates inscrites à ces
décrets une légende de monnaie ou un mot échappé aux mauvais écrivains du
temps. Ainsi nous trouvons, en février 294, Maximien à Reims, à Trèves et
dans le pays des Nerviens, où, continuant la fâcheuse politique d’Auguste et de
Tibère, il établissait comme colons des prisonniers francs[36]. En janvier 290
Dioclétien est, à Sirmium, en février à Andrinople, en avril à Byzance, en
mai à Antioche. Il chasse de la
Syrie les Sarrasins qui étaient venus y piller, et nous le
retrouvons à Sirmium au milieu de juillet. C’était l’activité de César[37]. On n’est pas
habitué à reconnaître cette diligence et cette vie laborieuse au prince qui
établit, à la cour impériale, la sévère étiquette dont la suprême expression
sera l’immobile majesté des empereurs byzantins.
Ce qui rappelait Dioclétien en si grande hâte aux bords du
Danube. où il demeura jusqu’à la fin de cette année 290, c’est que de grands
mouvements de peuples agitaient, la Germanie. De sanglants combats avaient lieu :
les Goths se ruaient sur ceux des Burgondes qui les avaient suivis dans l’Est
; les Taïfales et les Thervinges sur les Gépides et les Vandales[38] ; on ne savait
ce qui pouvait sortir de cette confusion : peut-être une invasion nouvelle ?
Mais les empereurs veillaient à la frontière, rien ne passa.

II. — LA TÉTRARCHIE.
Au commencement de l’année 294, les deux augustes
franchirent les Alpes en plein hiver pour avoir une nouvelle conférence à
Milan[39]. Dioclétien
roulait dans sa pensée le plan d’une réorganisation de l’État. La division du
pouvoir faite en 286 n’avait qu’à moitié réussi, parce que la part de chaque
empereur était encore trop grande pour que l’action du gouvernement fût
partout efficace et prompte. Les périls croissaient. A l’Orient, le pacifique
Bahram allait mourir et les Perses redevenir menaçants. Au Nord, la barbarie
poussait vers le Rhin et. le Danube ses turbulentes tribus. Des Chamaves, des
Frisons, avaient occupé, aux embouchures du Rhin, la Batavie, domaine
incertain de la terre et de l’Océan, possession plus incertaine encore des
Germains et de l’empire. En ce moment tout le littoral de la mer du Nord,
depuis la Meuse
jusqu’au Jütland, était bordé de peuples qui couraient la mer, à la chasse
des trafiquants gaulois. A l’intérieur, de vastes provinces se détachaient de
l’empire : l’Égypte allait se donner un empereur, la Bretagne avait déjà le
sien, ce qui signifiait que toutes deux prétendaient à l’indépendance ; et
les Maures d’Afrique réclamaient leur liberté les armes à la main. Dioclétien
jugea utile de compléter son système politique ; il décida que les deux
augustes s’adjoindraient, sous le titre de césars, deux lieutenants, leurs
héritiers nécessaires. Il espérait que l’empire serait ainsi mieux gardé, les
ambitions subalternes plus sûrement contenues, et la question si grave de la
succession au trône résolue, sans que les soldats eussent désormais à
intervenir avec leurs caprices et leurs exigences. Le 1er mars
295, Constance et Galère furent proclamés césars[40].
 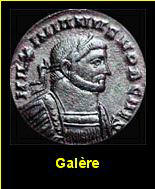 Théoriquement, cette conception était heureuse ; avec
Dioclétien, elle pouvait réussir, grâce à l’autorité que lui donnait sa
sagesse, prouvée par dix années de succès et de ferme gouvernement ; et c’est
avec raison que les contemporains ont célébré l’union qu’il sut maintenir
entre des princes de caractères si différents. Mais, dans ce système, il
n’était pas tenu compte des rivalités qui éclateraient inévitablement après
lui, de l’ambition impatiente des césars, de la jalousie mutuelle des
augustes qui remplaceront les fondateurs de la tétrarchie. Ce plan a eu le
sort de tant d’autres projets, inspirés par la sagacité politique, et que la
passion ou des circonstances contraires ont fait échouer. Cependant,
lorsqu’on ajoutera à cette réforme dans la constitution du pouvoir celle que
fera Dioclétien dans l’administration, on sera forcé de reconnaître à ce
prince une intelligence supérieure et de le mettre au premier rang des
empereurs romains. Le nom de Charlemagne est resté bien grand, quoique son
œuvre aussi ait échoué ; il est vrai qu’elle a duré plus longtemps[41]. Théoriquement, cette conception était heureuse ; avec
Dioclétien, elle pouvait réussir, grâce à l’autorité que lui donnait sa
sagesse, prouvée par dix années de succès et de ferme gouvernement ; et c’est
avec raison que les contemporains ont célébré l’union qu’il sut maintenir
entre des princes de caractères si différents. Mais, dans ce système, il
n’était pas tenu compte des rivalités qui éclateraient inévitablement après
lui, de l’ambition impatiente des césars, de la jalousie mutuelle des
augustes qui remplaceront les fondateurs de la tétrarchie. Ce plan a eu le
sort de tant d’autres projets, inspirés par la sagacité politique, et que la
passion ou des circonstances contraires ont fait échouer. Cependant,
lorsqu’on ajoutera à cette réforme dans la constitution du pouvoir celle que
fera Dioclétien dans l’administration, on sera forcé de reconnaître à ce
prince une intelligence supérieure et de le mettre au premier rang des
empereurs romains. Le nom de Charlemagne est resté bien grand, quoique son
œuvre aussi ait échoué ; il est vrai qu’elle a duré plus longtemps[41].
Galère était un Dace qui, dans sa jeunesse, avait gardé
les troupeaux et dont la famille, fuyant devant l’invasion des Carpes,
s’était réfugiée près de Sardica (Sophia), dans la Dacie d’Aurélien. De pâtre
il s’était fait soldat. C’était un autre Maximien, rude et grossier, comme
lui encore obéissant et fidèle, sans lettres, mais non sans courage, de
nature violente et cruelle, bon au second rang à condition d’y être contenu,
détestable au premier[42]. Avec Constance,
au contraire, reparaissaient des qualités que depuis longtemps on ne trouvait
plus dans les princes : des mœurs élégantes et douces, un esprit cultivé, un
caractère aimable et, ce qui importait toujours au milieu de ces parvenus,
une noble origine : sa mère était nièce de Claude le Gothique et son père
descendait d’une vieille famille macédonienne. Sous Aurélien, il s’était
distingué en battant les Alamans près de Windisch (274), et Carus avait songé,
disait-on, à l’adopter. La pâleur de son visage le fit appeler par les Grecs
le Chlore ou le Jaune, et, pour se rattacher à sa race, tous les empereurs,
jusqu’à Théodose, prirent son nom de famille, Flavius[43], comme Sévère et
ses successeurs avaient pris ceux des Antonins. Nommé césar avant Galère,
Constance devait succéder à l’auguste qui disparaîtrait le premier de la
scène politique ou du monde.
Constance et Galère étaient mariés : ils répudièrent leurs
femmes, dont l’une, Hélène, unie à Constance par le mariage de second ordre
que les Romains appelaient le concubinat[44], est restée fameuse
comme mère de Constantin et zélée chrétienne. Après ce sacrifice fait à la
politique, les césars épousèrent les filles des deux augustes : Galère, celle
de Dioclétien dont il allait être le lieutenant ; Constance, celle de
Maximien sous l’autorité duquel il fut placé. Chacun d’eux était subordonné
au prince dont il compensait les défauts ou complétait les qualités par des
qualités contraires : l’énergie guerrière à côté de la sagesse, la douceur
près de la force. Dioclétien prit avec lui le jeune Constantin, alors âgé de
dix-neuf ans. C’était un gage de la fidélité du père, garantie inutile avec
un homme tel que Constance, mais précaution depuis longtemps usitée à la cour
impériale[45].
Dioclétien s’était réservé l’administration de l’Orient
avec l’Égypte, la Libye,
les îles et la Thrace
; Galère dut veiller sur les provinces Danubiennes et sur l’Illyricum avec la Macédoine, la Grèce et la Crète. En
Occident, Maximien garda le gouvernement de l’Italie, de l’Afrique et de
l’Espagne. Constance eut la
Gaule et la Bretagne[46].
Les césars investis de la puissance tribunitienne[47] et de l’imperium militaire étaient traités de majestés
et portaient le diadème[48] ; leurs noms se
trouvaient souvent avec ceux des augustes en tète des édits, tuais ils n’en
rendaient point ; et lorsqu’il s’agissait d’une constitution faite pour une
partie de l’empire gouvernée par un césar, l’acte portait bien, avec les noms
des deux augustes, celui du césar intéressé à l’exécution, mais on n’y
trouvait point celui de l’autre. La puissance législative restait indivise
entre les deux augustes, comme elle l’avait été entre Sévère et Caracalla,
entre Valérien et Gallien, ou plutôt elle était abandonnée à celui qui était
l’âme de ce gouvernement, à Dioclétien[49]. Les augustes
entraient quand bon leur semblait dans les provinces césariennes, et ils y
exerçaient l’autorité suprême. Ainsi Maximien gardera la frontière du Rhin
durant une absence du césar des Gaules, et Dioclétien ne sortira pas de son
domaine impérial, lorsqu’il viendra résider à Sirmium : la plupart de ses
rescrits sont datés de l’Illyricum ou
de la Thrace. Le
césar reçoit de l’auguste des ordres, même des réprimandes. On verra
Dioclétien appeler Galère en Orient et le traiter, après une défaite, avec la
sévérité des anciens temps[50]. Il semble que
reparaissent, sous d’autres noms et avec une grande différence dans la durée
des pouvoirs, l’ancien dictateur et son maître de la cavalerie.
Chacun des quatre princes se choisit une capitale. Les
deux césars prirent position sur la frontière : Galère à Sirmium, centre
de la défense dans la vallée moyenne du Danube ; Constance à Trèves ou à
York, pour couvrir la Gaule
et la Bretagne. Les
deux augustes se placèrent en seconde ligne : Maximien à Milan[51], en arrière des
Alpes, mais à portée des Germains, qui faisaient effort pour s’établir dans la Rhétie et la haute
vallée du Rhin ; Dioclétien à Nicomédie, au bord de la mer de Marmara, d’où
il surveillait à la fois le Tigre, le bas Danube et l’Euxin, qui avaient
laissé passer tant d’invasions désastreuses. Du reste, aucun d’eux ne
s’enferma dans la ville dont il avait fait sa principale résidence ; sans
cesse ils furent en mouvement le long de la frontière, qui se trouva bien
gardée ; et si les Barbares ne reculèrent pas, du moins ils n’avancèrent
plus.
Constance fut chargé de reprendre contre Carausius
l’expédition avortée en 289. Le traité, signé à la suite de cet échec, avait
été rompu par l’alliance de l’usurpateur avec les Francs, auxquels il promit
l’île des Bataves et tout le littoral jusqu’à l’Escaut ; le pillage de la
côte gauloise avait sans doute aussi recommencé[52]. Carausius
tenait une garnison et une escadre à Boulogne ; Constance ferma le port de
cette ville par une digue et obligea navires et garnison à se rendre. Avant
de tenter une descente en Bretagne, il alla chercher les Francs au milieu de
leurs marais, entre le Wahal, le Rhin et le lac Flevo, terres noyées dont la
défense est facile, mais que les Barbares défendirent mal[53]. Il les refoula
dans la Germanie
et distribua ses nombreux captifs à titre de colons sur certaines parties des
territoires d’Amiens, de Beauvais, de Troyes et de Langres, où les Bagaudes
avaient fait le désert[54].
Carausius fut assassiné, en 293, par son préfet du
prétoire Allectus, qui prit sa place et la garda trois ans : mais le nouveau
maître de la Bretagne
n’avait ni les talents ni l’autorité de l’archi-pirate[55]. Le préfet du
prétoire, Asclépidote, ayant réuni une flotte à l’embouchure de la Seine, surprit le passage
un jour de brouillard et débarqua dans le sud de l’île ; pour augmenter la résolution
de ses soldats, il brûla ses vaisseaux. Allectus attendait à l’île de Wight
l’attaque de Constance, qui avait une autre flotte à Boulogne. Troublé par la
nouvelle de la descente du préfet, il courut en désordre au-devant de lui,
fut battu et tué ; et lorsque Constance arriva sur les côtes du pays de Kent,
la population, heureuse d’être débarrassée de ces empereurs qui depuis dix
ans l’isolaient du reste de l’empire, l’accueillit comme un sauveur (296).
La cité de Londres était déjà le plus grand marché de
l’Angleterre. Les auxiliaires barbares d’Allectus y avaient couru pour la
piller. Une partie de la flotte de Constance, égarée par le brouillard, avait
donné dans la Tannise
; poussée par la marée, elle arriva devant la ville assez tôt pour la sauver
: service qui valut au césar la reconnaissance des habitants[56].
Maximien avait quitté Milan, sa résidence habituelle, et
était venu montrer aux Barbares, durant l’éloignement de Constance, la
pourpre impériale, afin de leur ôter l’envie de profiter du départ des
troupes pour se jeter sur la
Gaule. L’expédition terminée, il partit pour l’Afrique, et
le césar revint monter à sa place la garde au Rhin, die Wacht am Rhein. Cette vigilance ne pouvait
être interrompue un instant, car les Alamans ne résistaient jamais à la
tentation de faire un bon coup dans les provinces gauloises. En 301, ils
franchirent le Rhin, l’Ill, les Vosges, et faillirent enlever Constance prés
de Langres. Il n’eut que le temps, tout blessé qu’il était, de se faire
hisser avec des cordes sur le haut du rempart[57]. Des troupes
étaient dans le voisinage ; elles accoururent et chassèrent ces maraudeurs,
dont Eutrope fait une immense armée. Il parle de 60.000 morts et d’un nombre
énorme de prisonniers. Eusèbe réduit les morts à 6.000 : c’est encore
beaucoup. Les captifs furent livrés ; à titre de colons ou de lètes, aux
propriétaires lingons et trévires. Ils occupèrent ainsi, du consentement de
l’empire, la rive gauche du Rhin, où, excepté dans les villes, ils firent
prédominer le sang et la langue germaniques[58]. Eumène en vit passer
à Trèves, même à Autun, suivis de leurs femmes,
de leurs enfants, et mornes, désespérés, ou agitant avec frénésie leurs fers
; mais qui s’adoucissaient peu à peu, fécondaient le sol que naguère ils
dévastaient et, à l’appel des généraux, couraient avec joie reprendre leurs
armes, courber le dos sous le cep du centurion, combattre et mourir pour ceux
qui les avaient ravis aux forêts paternelles.
Cet Eumène dont nous avons les œuvres fut l’ami et le
secrétaire de Constance : émule malheureux de Cicéron, il écrivit des
panégyriques où la rhétorique et l’hyperbole tiennent plus de place que
l’éloquence et la vérité. On y trouve pourtant quelques détails intéressants
sur les écoles d’Autun. Constance faisait sortir cette ville de ses ruines ;
il en relevait les thermes, les temples, l’aqueduc qui y amena des eaux
abondantes ; il voulait reconstruire aussi la cité morale, en rendant la vie
et l’éclat à ses écoles, où jadis la jeunesse gauloise accourait en foule, et
il écrivit à Eumène, pour lui en donner la direction, une lettre qui lui fait
grand honneur : Nos Gaulois méritent que nous
prenions soin de leurs enfants, et quoi de meilleur à leur offrir que la
science, seule chose que la fortune ne puisse ni donner ni ravir ? Aussi
avons-nous résolu de te mettre à la tête de ces écoles, que nous voulons
rendre à leur ancienne splendeur. Tu y dirigeras l’esprit des jeunes gens
vers l’étude d’une vie meilleure. Ne crains pas qu’en acceptant tu déroges
aux honneurs que tu as acquis. Afin que tu comprennes bien que notre estime
pour toi est proportionnée à tes mérites, ton traitement sera de 600000 sesterces
payés par la république[59]. Il faut tenir
compte à ce prince d’avoir eu, dans la décadence de la société romaine, le
goût des nobles choses et des récompenses magnifiques pour ceux qui
entretenaient les restes du l’eu sacré, si près de s’éteindre.
Eumène fut digne de son maître ; il consacra ses 600.000
sesterces à la reconstruction des écoles, dont l’ouverture se fit avec une
grande solennité. Le gouverneur de la province présida la fête, et Eumène y
prononça son meilleur discours. On y trouve des paroles émues et à certains
moments éloquentes, lorsqu’il s’écrie, par exemple, en montrant de loin, au
gouverneur, les ruines du gymnase qu’on allait relever : Tu as vu, sur les murs de ces portiques, la terre figurée
avec ses nations, ses villes et ses fleuves ; avec ses continents que l’Océan
enveloppe comme d’une ceinture, qu’il sépare ou qu’il creuse de ses flots impétueux.
C’est devant ces peintures que nous expliquerons l’univers, en racontant
l’histoire de nos princes invincibles. Quand des messagers de victoire nous
apprendront qu’ils visitent la
Libye aride ou la
Perse aux fleuves jumeaux, les rives du Nil ou celles dit
Rhin, nous dirons à la jeunesse réunie autour de nous : Voyez-vous a cette
terre, c’est l’Égypte châtiée par le bras de Dioclétien et qui se repose de
ses fureurs. Voilà Carthage et l’Afrique où Maximien extermina les Maures
révoltés. Cette terre est la
Batavie ; cette île, la Bretagne aux sombres forêts, qui montre
au-dessus des flots sa tête inculte ; Constance les tient sous sa main
redoutable, Là-bas, Galère foula aux pieds les arcs et les carquois des
Perses. C’est plaisir d’étudier une représentation du monde où ne se trouve
rien qui ne nous appartienne[60]. Nous pensions
avoir inventé l’enseignement par les yeux ; les Romains le pratiquaient il y
a deux mille ans[61].
L’expédition d’Afrique dont parle Eumène avait eu lieu en
297. Cinq puissantes nations maures avaient pris les armes. C’étaient, disent les écrivains du temps, les plus féroces des peuples africains. Comme
les tribus du Sahara, toujours prêtes à une razzia sur nos oasis algériennes,
ces Maures avaient souvent brûlé les fermes des colons romains. Un lieutenant
de Dioclétien avait eu déjà fort à faire avec eux[62]. En 293 ils
recommencèrent leurs courses et jetèrent dans toute la province une
inquiétude dont il semble qu’un usurpateur du nom de Julien (?) ait profité en
prenant la pourpre dans Carthage. Cette usurpation rendait la situation assez
grave pour que l’auguste des provinces occidentales se crût obligé de se
montrer en Afrique. Après des échecs que nous ne connaissons pas, Julien se
donna la mort ; les Maures vaincus furent poursuivis dans les retraites les
plus inaccessibles de l’Atlas, et les captifs faits sur eux transportés en
d’autres provinces. Pour étouffer les derniers restes de cet incendie, un
instant redoutable, Maximien demeura en Afrique jusqu’au milieu de l’année 298.
A ces succès du césar et de l’auguste des provinces
occidentales répondaient ceux de Galère sur le Danube moyen dont il avait la
garde. Les Jazyges furent battus, et une partie de la nation des Carpes
transportée en Pannonie (295).
Quelques années plus tard, en 299, des Sarmates et des
Bastarnes furent aussi contraints d’émigrer sur la rive droite du Danube[63]. Ce système,
commencé aux premiers jours de l’empire, était donc toujours suivi ;
Constantin, Valens et Théodose le continueront, et les provinces frontières
se peupleront d’ennemis secrets qui commenceront par en chasser la
civilisation romaine, puis en ouvriront les portes à d’autres envahisseurs.
Les empereurs croyaient leur empire éternel ; ils pensaient avoir le temps de
romaniser ces colons étrangers, et ce sont les Barbares qui, de l’Escaut à la Save, ont germanisé la zone
de colonisation qu’on leur livrait et qui ont peuplé de Slaves la péninsule
des Balkans.
Dioclétien s’était tenu durant ces années dans la Pannonie, la Mœsie et la Thrace, visitant les
défenses du Danube[64], inspirant aux
Barbares qui en bordaient la rire gauche une crainte salutaire, et, malgré ce
séjour prolongé à l’extrême frontière, restant en quelque sorte présent sur
tous les points de l’empire par l’attention qu’il donnait à ses besoins. Une
multitude de rescrits datés de ces régions montrent son activité législative[65]. Sous l’action
puissante de ce grand prince, l’empire se relevait, la sécurité était rendue
aux provinces, et il avait suffi à ce corps immense, qui enfermait toute la
vie civilisée du monde, qu’une main ferme tint les Barbares éloignés et les
soldats soumis pour que la prospérité reparût.
Il était un pays pourtant où elle ne renaissait pas : la
turbulente Égypte. Dans sa capitale grouillait une immense population
d’hommes de toutes races, de toutes conditions, de toutes croyances, et sous
ce soleil implacable les têtes fermentaient. Adorateurs de Sérapis, de
Jéhovah ou de Jésus, sceptiques et illuminés, philosophes à la recherche de
l’absolu et néophytes croyant l’avoir trouvé, tous se détestaient et se
méprisaient. La haine amenait l’émeute, l’émeute la révolte ; dés qu’un avait
frappé, tous frappaient ; les rues se remplissaient de cadavres et, dans le
port, la mer devenait rouge de sang[66]. Il n’y a pas un chrétien, disait l’évêque
Dionysios, qui ne soit engagé dans l’un ou
l’autre parti. Le jour de Pâques son église resta vide, les
fidèles étant aux barricades. Les égorgements dont parle l’évêque dataient du
règne de Gallien ; mais l’esprit de révolte avait continué de souffler sur la
grande ville. On a vu Aurélien et Probus obligés d’y venir renverser des
usurpateurs ; Achilleus osa y prendre encore la pourpre sous le règne de
Dioclétien.
Cette rébellion était un ennui pour Rome, dont elle gênait
l’approvisionnement ; elle n’était pas un péril pour l’empire, parce qu’il ne
pouvait pas sortir d’Égypte un ennemi dangereux. Les empereurs, ne résidant
plus dans leur vieille capitale, n’entendaient pas les cris faméliques de sa
populace qui demandait bien des jeux et du pain,
mais ne faisait pas d’émeutes. La nouvelle insurrection d’Alexandrie ne les
détourna donc pas des sains plus importants qui les retenaient sur la
frontière du Nord. Celle-ci pacifiée, Dioclétien se dirigea vers l’Égypte, où
il arriva au milieu de l’année 295. Alexandrie résista huit mois à tous ses
efforts ; il n’y entra qu’après avoir coupé les aqueducs qui conduisaient
dans la cité l’eau de la branche Canopique. Pour en finir avec ces éternelles
révoltes qui étaient d’un dangereux exemple, il livra la ville à une
exécution militaire ; elle fut mise à sac, et le sang coula à flots. Coptos et
Busiris eurent le même sort[67]. Le pays fut
ensuite réorganisé. Eutrope, qui vivait près d’un siècle plus tard, dit que
cette réorganisation dont il ne donne pas le détail subsistait encore de son
temps[68]. Comme Auguste,
Dioclétien respecta la religion égyptienne ; mais dans ce pays des prodiges
et de la crédulité, partout circulaient des livres de sciences occultes ; il
les lit saisir et brûler[69]. Il rendit un
autre service à l’Égypte en la protégeant contre les Blemmyes qui pillaient
les caravanes venant des ports de la mer Bouge et infestaient la Thébaïde
par leurs brigandages. Au lieu de perdre son temps et ses forces à les
poursuivre au milieu de leurs déserts, il rappela les petites garnisons
éparses dans la Nubie
inférieure, entre la première et la seconde cataracte, où elles étaient trop
faibles pour rien empêcher. C’était un mouvement de recul ; mais l’empire se
fortifiait en se concentrant. Une nombreuse garnison occupa file de Philæ et
s’y couvrit de retranchements ; une autre fut établie en seconde ligne à
Maximianopolis, qui s’éleva sur les ruines de Coptos ; et une muraille se
rattachant aux défenses de l’île barra toute la vallée : on en voit encore
les restes. Afin de ne négliger aucun moyen d’assurer la sécurité de cette
frontière, il traita aven les Blemmyes, qui, moyennant une subvention
annuelle, s’engagèrent à rte pas troubler le commerce égyptien. La convention
fut consacrée par des solennités religieuses dans le temple d’Isis. Les
Blemmyes étaient de fervents adorateurs de la déesse égyptienne ; ils
réclamèrent le libre accès de son temple et le renouvellement de la vieille
loi qui autorisait leurs prêtres[70] à venir chaque
année prendre dans file son image, pour la garder un certain temps en leur
pays. Dans une inscription qui paraît être du temps des Antonins, on lit : Sur le Nil, j’ai vu les barques rapides qui rapportaient
les temples sacrés de la terre des Éthiopiens. Ces temples étaient
des édicules, le plus souvent dorées, qui renfermaient une statuette d’Isis.
Dioclétien n’aurait pas consenti à laisser ainsi courir une divinité latine ;
le souverain pontife de Rome ne s’inquiétait pas des aventures d’Isis, et, puisque
les Blemmyes attachaient de l’importance à ces pèlerinages, il trouvait
habile de s’y prêter.
Il avait écrit son nom avec du sang sur les murailles
d’Alexandrie, mais il réorganisa pour les pauvres de la ville l’institution
alimentaire[71]
; et l’oublieuse cité vit sans colère le préfet Pompeius dresser une colonne
surmontée de la statue de Dioclétien, avec une inscription en l’honneur du prince invincible. La statue n’existe plus, et
la colonne toujours debout ne porte même pas le nom du très saint empereur, génie tutélaire d’Alexandrie[72] ; longtemps on
l’a prise pour un monument du vaincu de Pharsale et on l’appelle encore la
colonne de Pompée[73].
 En 294, Narsès, second fils du pacifique Bahram, avait
ceint dans Ctésiphon la tiare du grand roi. C’était un vaillant prince qui
mit ses soins à réveiller l’ardeur guerrière de son peuple ; Dioclétien était
alors au fond de l’Égypte, et Galère dans la Pannonie ; le Perse
crut l’occasion favorable pour se jeter sur l’Arménie, d’où il chassa le
protégé des Romains, et, au commencement, de l’année 296, il passa le Tigre
avec une nombreuse armée. Il rêvait la fortune de Sapor, et il espérait la
porter plus loin, la soutenir plus longtemps[74]. Averti par le coup
frappé sur Tiridate, Dioclétien avait déjà appelé en Syrie le césar des
provinces orientales, et lui-même se rapprochait de la Palestine, sans hâte,
comme il convenait au prince dont la majesté calme n’était jamais troublée
par d’impétueux mouvements. En 294, Narsès, second fils du pacifique Bahram, avait
ceint dans Ctésiphon la tiare du grand roi. C’était un vaillant prince qui
mit ses soins à réveiller l’ardeur guerrière de son peuple ; Dioclétien était
alors au fond de l’Égypte, et Galère dans la Pannonie ; le Perse
crut l’occasion favorable pour se jeter sur l’Arménie, d’où il chassa le
protégé des Romains, et, au commencement, de l’année 296, il passa le Tigre
avec une nombreuse armée. Il rêvait la fortune de Sapor, et il espérait la
porter plus loin, la soutenir plus longtemps[74]. Averti par le coup
frappé sur Tiridate, Dioclétien avait déjà appelé en Syrie le césar des
provinces orientales, et lui-même se rapprochait de la Palestine, sans hâte,
comme il convenait au prince dont la majesté calme n’était jamais troublée
par d’impétueux mouvements.
Galère savait-il comment et pourquoi Crassus avait péri ?
Sans le calomnier, on peut en douter ; mais la délaite de Valérien était
assez récente pour qu’il en eût gardé le souvenir : elle ne lui servit pas de
leçon. Il franchit l’Euphrate et mena ses légions dans cette plaine de
Carrhes où le sable cachait à peine tant d’ossements romains. Les scènes
d’autrefois se renouvelèrent : sa cavalerie ne put résister au choc des cataphractaires,
et sa pesante infanterie, accablée par la chaleur et la soif, aveuglée par la
poussière, au milieu des rapides escadrons qui tourbillonnaient autour
d’elle, en la criblant de leurs flèches, éprouva le sort des légionnaires de
Crassus. On dit que Tiridate n’échappa qu’en traversant l’Euphrate à la nage,
tout chargé de son armure. Galère aussi sauva sa personne et de faibles
débris de ses troupes. En avant d’Antioche, il rencontra Dioclétien, qui le reçut
avec un visage sévère et refusa de le laisser monter sur son char. On vit
l’orgueilleux césar, couvert de son manteau de pourpre et la honte au front,
marcher à pied, durant l’espace d’un mille, devant le char de l’auguste
irrité[75].
Dioclétien tira rapidement des troupes des camps du
Danube, enrôla des Barbares, surtout des Goths[76], et refit une
armée syrienne, qui semble avoir été très fortement constituée. Il la divisa
en deux corps : avec l’un, il prit position sur l’Euphrate pour en défendre
au besoin les passages ; il mit Galère à la tête de l’autre, en lui traçant
un plan de campagne où se révèle l’expérience militaire de l’ancien
lieutenant de Probus. Il lui fit reprendre, dans la saison favorable, la route
autrefois suivie par Antoine à travers les monts d’Arménie, et il lui donna
certainement pour guide, en ce pays, le roi Tiridate. A leur approche les
populations se soulevaient ; les vivres, les renseignements, affluaient au
camp ; les légions avaient tous les avantages que donne à une armée
d’invasion la complicité des habitants. Les Persans allèrent à leur rencontre
sur ce terrain de combat qui ne leur convenait point ; et remplis de confiance
par leur récente victoire, ils se gardaient si mal, que Galère put arriver
avec deux cavaliers seulement jusqu’à leur campement, pour en reconnaître la
position. Par une attaque de nuit poussée à fond, il jeta parmi eux la
terreur et en fit un grand carnage. Narsès blessé échappa à grande peine,
mais ses femmes, ses enfants, furent pris, avec les richesses entassées dans
les tentes royales (297).
Depuis la victoire d’Alexandre à Issus, six siècles auparavant, la barbarie
orientale n’avait pas subi un pareil affront.
A la nouvelle de ce brillant succès, Dioclétien entra en
Mésopotamie et rejoignit Galère à Nisibe. Le césar parlait de recommencer
l’expédition d’Alexandre. Le prince macédonien n’avait pas commis une trop
grande témérité lorsqu’il avait jeté la ruasse de ses forces sur l’empire de
Darius et qu’il s’était enfoncé dans l’Orient jusqu’à l’Indus parce qu’il
n’avait rien à craindre des peuples qu’il laissait derrière lui. Les Romains,
qui avaient à garder, à l’ouest, au nord et au sud, une ligne immense de
frontières toujours menacées, ne pouvaient inciter cette aventureuse
entreprise. Dioclétien calma la trop bouillante ardeur de Galère et eut pour
ses captifs des égards qui n’étaient point dans les habitudes de ce temps.
Lorsque Narsès, gagné par cette conduite, fit des ouvertures de paix, il les
accueillit avec empressement. La première condition réclamée par les Romains
fut pourtant rejetée[77]. Ils voulaient
que les Perses s’engageassent il faire passer par Nisibe tout leur commerce
avec l’empire, sans doute pour simplifier le service de la douane impériale,
et concentrer les relations entre les deux États sur un seul point facile à
surveiller[78].
Narsès s’y refusa, et cette clause fut abandonnée ; mais il reconnut aux
Romains la possession de la Mésopotamie septentrionale dont la limite, au
sud, semble pouvoir être marquée par la forte place de Circésium, près de
l’embouchure du Chaboras dans l’Euphrate, et par Singare, assise au pied
d’une montagne, en une région aride qui rendait l’attaque difficile, mais
difficile aussi le secours. Ninive, sur le Tigre, où depuis deux siècles se maintenait,
sans qu’on le puisse comprendre, une colonie romaine[79], marque
peut-être l’extrémité orientale de cette ligne. Le grand roi céda dans la
haute vallée du Tigre cinq provinces arméniennes que Sapor Ier avait conquises,
et qui, dans les mains de Rome, allaient couvrir une partie de l’Arménie et
de l’Asie Mineure contre les Persans[80]. Tiridate recouvrait
son royaume, accru d’une partie de la Médie Atropatène,
et les princes d’Ibérie, dans le bassin du Kour, retournèrent de la vassalité
de la Perse à
celle de Rome (297).
C’était un glorieux traité qui valait mieux que la conquête des drapeaux de
Crassus par Auguste, car il donnait pour alliés à l’empire des peuples
riverains de la Caspienne
et du Caucase, en même temps que des garnisons romaines s’établissaient dans
la région montagneuse située au nord de la Mésopotamie,
par où toute attaque contre l’Asie Mineure et la Syrie pouvait être arrêtée
de front ou prise de flanc. La victoire de Galère et la politique de
Dioclétien allaient valoir à l’Asie romaine une paix que de nombreuses
forteresses, élevées le long de la frontière orientale, garantirent durant
quarante années[81].
L’auguste avait bien mérité le triomphe ; le sénat le lui décerna, mais il
attendit six ans pour le célébrer à Rome.

III. — RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET LÉGISLATION.
C’est dans la
Fable seulement que Minerve sort tout armée du cerveau de
Jupiter. Dans l’histoire, les créations politiques sont préparées par le
travail des siècles, et celles-là seulement sont durables.
Plus d’un empereur avant Dioclétien avait senti la
nécessité de prendre un collègue, de diviser les grands gouvernements, même
de partager l’empire[82], et d’affaiblir
les prétoriens ; plus d’un s’était laissé nommer seigneur ou dieu[83], et des monnaies
de Trajan et d’Antonin le Pieux représentent avec la couronne radiée. Les
monétaires de Trajan n’entourent encore du nimbe sacré, que porteront les
empereurs chrétiens, que la tête de l’oiseau fabuleux qui, en Égypte,
renaissait de ses cendres ; mais ceux d’Antonin lui donnent déjà ce symbole
de l’immortalité. Les peuples ne s’indignaient ni de ces titres ni de ces
couronnes, car la religion officielle leur faisait un devoir d’adorer
l’empereur vivant, et ils élevaient des temples à l’empereur mort.
Un siècle et demi avant Dioclétien, Hadrien avait fait de
son consilium le rouage principal de
l’administration ; et Caracalla, Gratien, avaient séparé les fonctions
civiles des fonctions militaires en ne souffrant pas la présence d’un
sénateur à l’armée[84]. Les comtes, les
correcteurs et les ducs étaient fort anciens ; on avait vu, au troisième
siècle, des maîtres de la milice, et le préfet du prétoire avait depuis
longtemps des attributions de justice et de finance. Le système des
concessions de terres faites aux soldats, à charge de service militaire,
était un vieil usage républicain (colonies) conservé par Auguste, peut-être réglementé
par Alexandre Sévère ; et deux des maux qui finiront par tuer l’empire : la germanisation
des provinces frontières et celle de l’armée, avaient commencé avec lui.
César eut des Germains clans son armée des Gaules, et Tacite montre, autour
des premiers empereurs et dans les auxiliaires des légions, des étrangers de
toute race[85].
La vanité des titres était bien vieille à Rome : on a vu
le classement rigoureux des personnes fait par Auguste. Dès les premiers
jours de l’empire, il fallait saluer les sénateurs du nom de clarissimes ; les chevaliers de naissance
portaient celui d’illustres, et sous
Marc-Aurèle les éminentissimes et les perfectissimes avaient des privilèges qui
duraient trois générations. Un procurateur de Commode est qualifié egregius ; ceux de Sévère portaient tous ce
titre, et dès le troisième siècle, même auparavant, il existait une sorte
d’hérédité pour les curiales. La nomenclature nobiliaire était déjà faite[86].
La langue, les mœurs, les nécessités de la défense,
avaient préparé la séparation du monde romain en deux empires. Plusieurs fois
l’Asie avait eu des gouverneurs investis de pleins pouvoirs : Agrippa et C.
César sous Auguste, Germanicus sous Tibère, Corbulon sous Néron ; et Marc
Aurèle, Valérien, Carus, avaient abandonné à tin collègue une moitié des
provinces.
Depuis longtemps les pères conscrits n’étaient plus rien,
et la chancellerie impériale était tout. Le réveil du sénat au temps des
Gordiens et de Probus n’avait été que la dernière agitation d’un corps d’où
la vie s’échappait ; tout se faisait dans les bureaux du sacré palais[87], parce que là
était la seule force qui pût mettre en mouvement l’immense machine. Enfin les
corporations industrielles et le colonat agricole avaient commencé, dans le
monde du travail, une transformation profonde.
Dioclétien n’a donc pas créé de toutes pièces un nouvel
édifice politique et social ; au fond, il n’accomplit qu’une grande réforme
administrative. Mais les apparences républicaines si soigneusement prises par
Auguste, conservées par beaucoup de ses successeurs et que Carus gardait
encore, tombèrent ; rien ne cacha plus le maître, el
rey netto, et la république autocratique d’Auguste revêtit sa
forme dernière, celle d’une monarchie orientale[88].
On a déjà vu la plus importante des mesures de Dioclétien,
l’établissement de la tétrarchie. Prévenir les révolutions, en assurant la
succession régulière à l’empire par voix de sélection ; rendre vaines les
intrigues des ambitieux et les émeutes de la soldatesque, en divisant les
commandements, les armées et le trésor public, telle avait été sa conception
théorique. Comme moyens d’exécution, il avait décidé que l’empire, partagé en
deux moitiés égales, aurait deux augustes, dont l’un garderait la prééminence
sur l’autre, et deux césars qui, subordonnés aux augustes, en seraient les
héritiers nécessaires. Cette forme de gouvernement était une nouveauté
considérable, parce que Dioclétien faisait une règle de ce qui n’avait été
qu’un accident temporaire, et parce qu’au lieu de princes régnant ensemble à
Rome, où leur action n’étant point divisée se contrariait, chacun des
augustes et des césars eut d’une manière permanente sa part de provinces à
gouverner et de Barbares à contenir.
Après le partage de l’empire et de l’autorité, celui des
provinces[89].
La république avait peu changé les limites des nations : son domaine n’était
divisé qu’en quatorze gouvernements ; à l’avènement d’Hadrien on en compta
quarante-cinq. L’augmentation provenait des conquêtes d’Auguste, de Claude et
de Trajan, mais surtout du démembrement des anciennes provinces. Depuis
Vespasien, les empereurs avaient reconnu que des commandements qui
s’étendaient à des régions aussi vastes que des royaumes donnaient
d’ambitieux désirs et des tentations mauvaises. Plus qu’aucun de ses
prédécesseurs, Dioclétien eut le sentiment de ce péril ; et comme il avait
divisé l’empire pour le mieux défendre, il augmenta les divisions
provinciales pour le mieux gouverner. A son avènement, il existait
cinquante-sept provinces ; sous son règne, on en trouve quatre-vingt-seize,
formant trente-sept gouvernements nouveaux[90], et ce dernier
chiffre justifie le mot de Lactance : provinciæ
in frusta concisæ, mais ne justifie pas l’intention haineuse qui
l’a dicté, puisque la mesure était excellente. Dioclétien groupa ces
quatre-vingt-seize provinces en douze diocèses, administrés par des vicaires
qui eurent la charge de surveiller les consulaires, correcteurs[91] et présidents ou
juges envoyés dans les provinces. Deux ou trois pays, à raison de leur
vieille renommée, l’Afrique carthaginoise, la Grèce et l’Asie,
furent gouvernés par des proconsuls qui rendaient compte directement à
l’empereur[92].
Ainsi, au sommet, les augustes ; au-dessous, les césars ; plus bas, les
vicaires ; après ceux-ci, les présidents. Cette construction politique, où
les assises d’en haut pesaient de tout leur poids sur les assises
inférieures, semblait capable de résister aux assauts du dehors et de comprimer
les mouvements de l’intérieur. Pour plus de sûreté, l’ordre militaire était rigoureusement
séparé de l’ordre civil ; les gouverneurs de province, dont les services
réglèrent l’avancement, furent réduits aux fonctions juridiques et
administratives.
Anciennement, les provinces étaient partagées entre le
sénat et le prince ; on a vu, aux règnes de Tacite et de Probus, quelles
étaient encore, à ce sujet, les prétentions des pères conscrits. Dans
l’organisation nouvelle, toutes les provinces dépendirent de l’empereur ; et
le ressort de beaucoup d’entre elles étant moins étendu, la surveillance par
les gouverneurs fut plus efficace, la justice plus prompte, les affaires
étudiées de plus près et les solutions données plus vite[93]. De sévères
règlements établirent la responsabilité de ces officiers : Il les enchaîna, dit Aurelius Victor, par les lois les plus justes[94].
Une inscription du temps de Dioclétien, celle de Cœlius
Saturninus, prouve que subsistait toujours l’usage essentiellement romain de
faire passer les serviteurs de l’État par les emplois les plus différents et
de ne les laisser que peu d’années dans chaque fonction. Saturninus en
remplit vingt, depuis la charge d’avocat du fisc jusqu’à celle de préfet du
prétoire, toutes d’ordre civil ; par où l’on voit que la règle des milices
équestres, établie par Auguste, maintenue encore au temps de Sévère et des Gordiens,
n’était plus observée[95]. Les princes
absolus aiment à prendre leurs serviteurs partout, même très bas. Ces
fonctionnaires, qui n’avaient point l’illustration de la naissance, s’en
consolaient par la pompe des titres : des charges modestes étaient devenues
des maîtrises sacrées, stipendia cognitionum sacrarum
aut palatii magisteria[96]. La séparation
des fonctions civiles et des fonctions militaires, commencée depuis
longtemps, fut si rigoureusement maintenue par Dioclétien, que le service de
l’armée, déjà interdit à la noblesse de l’empire, le fut encore à la noblesse
des cités. Il ferma les légions aux décurions, à leurs fils et à tous ceux
qui par leur fortune pouvaient être appelés aux charges municipales[97]. Les corps se
recrutèrent même chez les Barbares, et il n’y aura plus d’esprit militaire
chez ce peuple qui, par lui, avait accompli de si grandes choses.
Nous montrerons plus tard, dans son ensemble, ce qu’on
appela la divine hiérarchie, mais nous
devons, dès à présent, parler d’une nouveauté importante : la formation d’une
cour asiatique qui encombra cette demeure que les Nerva et les Trajan
appelaient le palais public.
Dioclétien se plaisait dans l’Orient ; il en aimait les coutumes royales et
en copia le cérémonial pompeux. Il remplaça par des vêtements de soie et d’or
la casaque militaire, sur laquelle ses prédécesseurs jetaient simplement un
manteau écarlate ; il mit sur son front le bandeau royal qu’Aurélien avait
déjà porté, et sur ses brodequins de pourpre, des pierres précieuses. A l’imperator, que tous, soldats et citoyens, venaient
librement saluer, succéda le roi-dieu caché dans une ombre mystérieuse, au
fond d’un palais dont les avenues furent gardées par une armée d’eunuques et
d’officiers. Qui obtenait du magister officiorum
une audience impériale y était mené par un maître des cérémonies et introduit
par les admissionales invitatores. Dès
qu’il avait franchi la porte gardée par trente silentiaires, il se prosternait
et adorait le visage sacré, osant à
peine lever les yeux sur cette majesté immobile et redoutable[98]. Ceux mêmes à
qui leur rang donnait les entrées étaient
soumis à ce cérémonial servile[99]. Tout devint
sacré, le palais du prince comme sa personne, ses paroles et ses actes.
Jamais, dans notre Occident, l’homme n’avait autant usurpé sur la divinité.
Ce n’était pas pour satisfaire une vanité puérile que
Dioclétien se mettait en dehors de la vie commune et se condamnait à un
fastueux ennui. L’homme qui avait dit que le meilleur prince, le plus
prudent, le plus sage, risque toujours d’être vendu par ses courtisans[100], n’ignorait pas
l’utilité des libres communications entre le souverain et les sujets ; mais
il crut qu’il y aurait dans l’État moins de révolutions, quand il y aurait
plus de respect pour le prince ; que la Majesté impériale imposerait davantage dans le
demi-jour où il la voulait tenir , que la servilité des paroles et des
attitudes garantirait pour le repos public celle des âmes ; qu’enfin
l’obéissance serait mieux assurée par la pompe des cérémonies et par les
formes sévères de l’autorité. Calcul vrai pour les vieilles dynasties, objet
de la vénération publique, pour un clergé parlant au nom du ciel et
religieusement écouté ; mais faux calcul de la part de ceux qui demandent à
l’étiquette officielle une force que les circonstances historiques ne lui
accordent pas. Dioclétien, parti de si bas et monté si haut, avait assez
d’expérience pour savoir ce que valaient ces respects apparents ; quelle
charge imposerait au trésor cette cour somptueuse copiée par l’autre auguste
et par les césars ; quelle action délétère elle allait exercer sur des âmes
déjà bien efféminées, en un temps qui eût demandé qu’on travaillât à les
rendre plus viriles. Mais la servilité des races asiatiques et d’un empire en
décadence lui faisait croire aux heureux effets de ces dehors pompeux.
Dioclétien supprima la fiction de la délégation du pouvoir
faite par le peuple à l’empereur. Il n’avait rien voulu tenir des anciennes puissances :
les citoyens, le sénat, l’armée ; et, de l’autorité que lui avaient donnée
les généraux, il faisait une sorte de droit divin qu’il communiquait
librement au collègue et aux successeurs choisis par lui seul. La
souveraineté se déplaçait encore une fois. Du forum et de la curie, elle
était passée dans les camps ; maintenant elle s’enfermait au palais[101]. La cour de
Dioclétien fut l’importation dans le monde occidental de coutumes dont
certaines royautés européennes ont hérité. Elle a créé ce milieu factice où
l’esprit s’aiguise et s’affine, où la politesse et l’élégance donnent à la
société les plus charmants dehors ; mais où trop souvent les mœurs se
corrompent, où les caractères s’abaissent, où la vie est faite de flatteries,
de secrètes trahisons et de mendicité. Sous Dioclétien, aucun de ces maux ne
paraîtra encore, parce qu’il imposera à ses courtisans le respect de la loi
en même temps que de lui-même ; mais, après lui, s’ouvriront ces bouches voraces par qui Constantin laissera
ronger son peuple[102], et les
splendeurs de Constantinople ruineront les finances de l’empire, comme les
folles magnificences de notre vieille monarchie épuiseront les ressources de la France.
En face de ces nouveautés, d’anciennes choses
languissaient un mouraient. Rome cessait d’être la capitale du monde ; rien
n’y venait plus et tout en sortait : les grandes affaires, la vie bruyante et
folle, les émeutes de caserne, les tragédies de palais. Extérieurement le
théâtre subsistait, tel à peu près qu’Auguste l’avait dressé. Si l’on ne
voyait plus les empereurs au Palatin, les consuls et les préteurs siégeaient
toujours sur leurs chaises curules, les sénateurs sous leur laticlave,
assemblée de morts, dans une ville qui commençait son nouveau rôle, celui du
plus grand musée de l’univers.
Il n’y avait point de place pour des rois orientaux clans
une cité pleine des souvenirs de la république sénatoriale et de l’empire
populaire. La liberté de parole, les habitudes de familiarité avec les
princes, que son peuple avait gardées, eussent été de graves infractions à
l’étiquette de la nouvelle cour. A l’époque de la conférence de Milan, Rome, dit le Panégyriste, avec son mauvais goût habituel, Rome regarda du haut de
ses collines, pour tâcher d’apercevoir dans le lointain ses empereurs[103]. Elle ne vit
rien venir. Les augustes restèrent aux affaires de l’empire et, sans
s’inquiéter de Rome, retournèrent à la garde des frontières.
Dioclétien avait pris la pourpre à Nicomédie de la main de
ses frères d’armes ; il la gardait sans avoir demandé au sénat la
confirmation de, son titre. Incessamment, il légiférait : on tonnait de lui
douze cents rescrits, et pas un ne fut préparé par le corps qui avait été le
grand conseil de l’empire ; cette assemblée avait paru jusqu’alors faire les
élections consulaires : pure formalité, chère cependant à des vanités peu
exigeantes ; Dioclétien nomma seul les consuls. Faire ainsi tomber les voiles
qui cachaient le néant de son autorité était un public outrage ; le sénat en
conçut une irritation légitime : il y eut des paroles imprudentes, peut-être
des complots, certainement des exécutions. Dioclétien ne fit pas à ces
ambitions séniles l’honneur de s’occuper d’elles : il chargea du soin de les
punir Maximien, à qui convenait pareille besogne[104].
Le préfet du prétoire, l’homme que jadis on appelait
l’épée du roi, resta un personnage très considérable, mais il cessa d’être
dangereux. Son autorité militaire fut à peu près supprimée par la formation
de quatre armées distinctes ; par la nomination régulière et non plus
accidentelle de maîtres de la milice, qui ne lui laissèrent que le
soin des vivres et de la solde[105] ; enfin, par la
suppression du corps des frumentaires, qui mettaient à sa discrétion la
fortune et la vie des principaux personnages des provinces. Dans le haut
empire, on n’aimait pas à multiplier le personnel administratif, et cependant
bien des fonctionnaires étaient indispensables pour la conduite de l’État, en
particulier pour la police qui, nécessaire en tout pays civilisé, l’est
principalement en pays monarchique. L’armée servit à cela. Dés les premiers
jours de l’empire, elle avait fourni des officiers pour veiller aux intérêts
de Rome en des cités libres, comme Byzance, ou chez des alliés turbulents,
comme les Bataves et les Maures ; plus tard elle donna des soldats et des
centurions qui furent mis à Rome en subsistance, frumentarii, sous l’autorité du préfet du
prétoire. Après avoir été dressés à leur nouveau métier, ils étaient envoyés
dans les provinces, pour voir, écouter et dire ensuite ce qu’ils avaient
appris[106].
Par leurs rapports, les frumentarii
provoquaient souvent des accusations, même contre des gouverneurs de
province. De là leur détestable réputation et la joie que leur suppression
causa. Avec son nouveau personnel administratif, Dioclétien n’avait plus
besoin de ce vaste système d’espionnage qui avait donné aux préfets du prétoire
une arme si redoutable[107]. Il attachait
tant d’importance à ce que l’on sût que tous pouvaient compter sur la justice
de l’empereur que, dans le rescrit ayant pour titre : De ceux qui, par peur
du juge, n’ont point osé former appel, il dit : Si
tu n’as pas appelé du jugement prononcé contre toi, c’est que tu l’as
accepté, car dans notre cour sacrée tu n’avais rien à craindre[108].
Quant aux prétoriens, leur nombre fut peu à peu diminué
par le renvoi des mécontents dans les légions, et l’orgueilleuse troupe qui
avait fait et défait tant d’empereurs descendit sans résistance à la
condition d’une garde de police urbaine, comme ce sénat, qui avait gouverné
le monde, était réduit à n’être plus que le conseil municipal de Rome : les
deux vieilles puissances, si longtemps ennemies, mouraient ensemble. —
L’effectif des cohortes urbaines, qui relevaient du préfet de la ville, fut
aussi réduit[109].
Les augustes remplacèrent près de leur personne les
prétoriens par deux légions levées dans les provinces illyriennes. Ces
soldats prirent les noms des empereurs : on les appela les Joviens et les
Herculiens. Tout fiers d’avoir pour maîtres des compatriotes, ils leur montrèrent
un absolu dévouement[110].
Le Dalmate, qui se souciait si peu du peuple que tant
d’empereurs avaient courtisé, voulut cependant que les Romains vissent dans
leur ville un monument de son ostentation. Il fit construire sur le Viminal,
avec une dédaigneuse magnificence, des thermes plus vastes que ceux de Titus
et de Caracalla[111].
Rome n’était plus qu’une ville ordinaire ; l’Italie ne fut
plus qu’une province. Jusqu’alors elle avait été chargée seulement de fournir
les vivres nécessaires au palais et aux soldats stationnés dans la capitale
ou dans la péninsule, Italia annonaria.
Dioclétien la soumit à l’impôt foncier, que, depuis Auguste, elle n’avait
point payé. Il effaçait ainsi un privilège blessant pour le reste de
l’empire, plutôt qu’il ne se créait des ressources financières, car la taxe
fut d’abord modérée. La campagne romaine jusqu’à 100 milles des murs (148 kilomètres),
urbicaria reqio, resta exempte
des prestations en nature que devait l’Italie annonaire[112].
Le consilium, déjà
réformé par Hadrien, devint le consistoire sacré, sorte de conseil d’État, où
entrèrent les principaux personnages de l’empire et qui tint dans le
gouvernement la place laissée vide par le sénat. Il délibérait, en présence
de l’empereur, sur les affaires que le prince lui renvoyait[113] ; il l’assistait
dans l’exercice de sa juridiction, et une partie ou la totalité des membres
le suivait dans ses voyages et dans ses résidences à Nicomédie, à Antioche, à
Sirmium. Enfin on a vu qu’il fit une réforme de la police générale de
l’empire.
Nous mentionnerons en passant l’achèvement de l’évolution
judiciaire, préparée depuis le commencement de l’empire : la cognitio extra ordinem, substituée à la
procédure formulaire ; au criminel, l’inquisitio
ou information, autrefois attribuée à l’accusateur, faite maintenant d’office
par le magistrat ; au civil, la double instance suivie devant le préteur, in jure, puis devant le juge, in judicio, remplacée par l’instance unique
d’un juge, fonctionnaire de l’État[114]. L’institution
judiciaire de la république, conservée par Auguste, ne pouvait convenir à la
nouvelle monarchie impériale. Autrefois, le magistrat n’intervenait au procès
que par la judicis datio ;
désormais il interviendra en tout et partout ; et les juges étant, à titre de
fonctionnaires publics, les délégués de l’empereur, le prince pourra réviser
leurs sentences, soit directement, soit par des vice sacra judicantes, qui feront en son nom une seconde
instruction dont il acceptera ou réformera les conclusions. Toute la justice
civile et criminelle se trouvera ainsi dans la main de l’empereur. Autre
conséquence : quand la vénalité du dernier siècle de là république reparaîtra
dans le Bas-Empire, la justice en sera souillée comme l’administration,
puisque les deux choses seront alors confondues[115].
La loi municipale de César avait ordonné pour l’Italie un recensement
quinquennal. L’opération appliquée à l’empire entier était difficile ; aussi,
du temps d’Ulpien, n’avait-elle lieu que tous les dix ans. La description
minutieuse qu’Ulpien nous en a laissée montre quel soin scrupuleux les
Romains mettaient à répartir équitablement l’impôt[116]. A l’expiration
de chaque période décennale, il se faisait une nouvelle évaluation des
terres, sur la déclaration des possesseurs, que le censitor contrôlait. Lactance parle de cette révision
nécessaire en termes effarés qui ont trompé les écrivains postérieurs : on a
cru qu’il révélait d’abominables exactions, commencées par Dioclétien,
continuées par Galère[117], lorsqu’il ne
fallait voir dans cette mesure qu’une des plus vieilles coutumes de
l’administration impériale. Dioclétien, qui multipliait les fonctions et
couvrait toutes les frontières d’ouvrages défensifs, a dû créer des
ressources pour tant de dépenses. Des impôts ont été certainement accrus ;
peut-être fut-ce lui qui généralisa le droit de 12 ½ pour 100 auparavant
perçu sur les seuls objets de luxe[118] ; et s’il
supprima le 1/20
sur les héritages et sur les affranchissements, dont on ne voit plus trace
après lui[119],
il augmenta le droit de 1/100
sur les ventes, dont il est parlé plus tard comme d’un impôt très onéreux[120] ; mais le
rétablissement de l’ordre et du travail empêcha de sentir le poids des
charges publiques ; Aurelius Victor nous a déjà dit que sous Dioclétien elles
furent légèrement portées.
Un document récemment découvert attribue à ce prince une
simplification curieuse dans l’administration financière[121].
Comme Auguste, il fit une répartition des terres en
plusieurs catégories : vignobles, plantations d’oliviers (deux classes),
terres à blé (trois
classes) et prairies, qui furent taxées à raison de leur produit présumé.
Pour rendre la perception plus facile, il forma une unité imposable, jugum ou caput,
comprenant des terres de nature diverse et d’inégale étendue, dont l’ensemble,
ayant même valeur, 900.000
sesterces ou 1000 aurei (15.000 francs ?), devait à l’État la même contribution[122]. Ainsi 5 jugera
de vignes ou 20 jugera de champs labourables de première qualité faisaient un
capot. Il en fallait 40 de la seconde classe ou 60 de la troisième, 225
oliviers en plein rapport ou 450 oliviers de montagne, in monte, pour constituer
la même unité imposable[123]. Le jugum ou le caput
était donc une division fiscale et non pas géométrique. Chaque
circonscription financière en comprit un certain nombre, et ce nombre
déterminait le chiffre de la somme due par toute la circonscription. Suivant
ses besoins, l’État élevait ou abaissait le montant de la taxe, indicebat,
d’où indiction, comme nous le faisons avec nos centimes additionnels. Quand
le gouvernement consentait à dégrever un propriétaire ou une ville, il
diminuait le nombre des capita pour
lesquels cette cité ou cet homme était inscrit aux registres du cens[124]. De là cette
requête inspirée par le souvenir classique des travaux d’Hercule : Regarde-nous comme des Géryons, le tribut est le monstre ;
pour que je vive, coupe-moi trois têtes[125].
Le chiffre de la somme imposée par l’État à la
circonscription financière était notifié aux décurions de la ville, lesquels
répartissaient la taxe entre les possessores[126], en opéraient
le recouvrement et versaient aux agents du fisc la somme demandée par le
prince. S’il y manquait quelque chose, on le prenait sur leurs biens : c’est
dire qu’ils étaient responsables de l’impôt[127]. Les citoyens
le sont toujours, puisque les déficits du budget ne peuvent être comblés que
par eux. Mais, chez les modernes, c’est la masse entière des contribuables
qui parfait la recette ; dans l’empire, c’était une classe particulière, et
cette responsabilité l’écrasera.
Malgré ces précautions, les impôts ne rentraient pas
toujours avec facilité, parce que, les Romains demandant leurs principaux
revenus à la propriété, des charges accablantes pesaient sur elle. Aussi se
trouvait-il des possessores insolvables,
des curiales ruinés[128], des
propriétaires qui, afin de mieux vendre leur fonds, avaient gardé à leur
compte le payement de l’arriéré dont l’immeuble était grevé, et qui ne le
payaient pas : perte sèche pour le trésor, puisqu’ils ne possédaient plus
rien pour répondre au fisc de leur dette[129]. Alors
s’accumulaient des arriérés, reliqua,
dont l’avocat du fisc poursuivait le recouvrement, d’ordinaire, sur la
dénonciation d’un delator dont
l’industrie était encouragée par une prime du quart des sommes retrouvées, quadruplator. De loin en loin, la politique
conseillait au prince de renoncer à ces arriérés. Ainsi avaient fait
Domitien, Trajan, Hadrien, Antonin, Marc-Aurèle, Aurélien ; ainsi fera
Constantin[130].
Les documents ne parlent point de pareille mesure prise par Dioclétien ; la
remise que Constantin accorda en 310 ne porta que sur les reliqua des cinq années précédentes[131] : ce qui
permettrait de supposer que son grand prédécesseur n’en avait point laissé.
Dioclétien confirma tous les privilèges précédemment
reconnus aux décurions[132] et l’autorité
des lois municipales auxquelles les gouverneurs ne purent déroger[133] ; il exempta
même de la capitation les artisans des villes, plebs
urbana, pour les petits biens qu’ils possédaient aux champs[134]. Mais,
préoccupé comme ses prédécesseurs d’assurer tous les services des cités, il
tint la main à ce que les possessores
ne pussent se soustraire aux devoirs municipaux[135], tout en
faisant cesser à cinquante-cinq ans l’obligation pour eux des munera personalia[136]. S’il n’accorda
point la dispense de la capitation à la population rurale, c’est que cette
faveur n’aurait profité qu’aux grands propriétaires, responsables vis-à-vis
du fisc pour leurs colons[137] ; les paysans
restèrent donc soumis à la capitation, à l’annone, aux corvées et fournitures
supplémentaires ; mais la constitution Ne rusticani ad ullum obsequium
devocentur[138] les garantit
contre tout autre impôt ou redevance ; et quand les villes voulurent rejeter
sur les campagnes les superindictions, sous prétexte qu’elles étaient des
tributs extra ordinem, il établit
nettement qu’elles seraient payées par les possessores[139]. Enfin, par une
autre constitution, il déclara que le colon qui aurait satisfait aux termes
de son contrat ne serait pas tenu des dettes de celui dont il cultivait le
champ[140].
Nous avons vu se former une nouvelle condition sociale, celle des colons ;
voici un autre partage qui se fait entre les habitants de l’empire : les urbani, exemptés de la capitation ; les rusticani, qui la payent. Ces divisions
annoncent l’approche du moyen âge ou des temps de l’inégalité et de la misère
rurale.
Lorsqu’il supprimait la capitation pour la plebs urbana,
Dioclétien favorisait les petites industries. Il essaya de venir en aide au vrai
commerce par deux autres mesures, l’une excellente, l’autre détestable : une
réforme monétaire que Constantin achèvera et l’établissement d’un maximum pour
le prix des denrées. On a vu quels maux avait causés la crise monétaire
durant la seconde moitié du troisième siècle. Avec la pensée que, pour donner
à un morceau de métal n’importe quelle valeur, il suffisait d’y graver le nom
du prince, on avait fini par mettre en circulation des pièces d’argent et
d’or qui ne contenaient ni or ni argent. Mais lorsque l’acheteur offrait à un
négociant, en échange de ses denrées, un lingot de cuivre recouvert d’une
feuille d’étain, il était naturel que celui-ci exigeât, pour livrer sa
marchandise, beaucoup de ce cuivre, quelque nom que l’autorité publique lui
eût donné. La cherté résultait donc de l’altération des monnaies, et tout
l’État était trouble par une mauvaise conception économique. Dioclétien vit
bien la cause du mal ; mais il crut pouvoir le guérir par un coup d’autorité.
Chacun sait, dit-il dans le préambule
de son édit, que les objets de commerce et les
denrées ont atteint des prix exorbitants, quatre fois, huit fois leur valeur
et même davantage ; de sorte que, par l’avarice des accapareurs,
l’approvisionnement de nos armées devient impossible. Aussi avons-nous résolu
de fixer, non pas le prix des denrées, ce qui serait injuste, mais le maximum
que, pour chacune d’elles, on ne pourra dépasser. Plusieurs
fragments de cet édit ont été retrouvés ; en voici quelques articles :
|
|
fr.
|
|
c.
|
|
Seigle, l'hectolitre
|
21
|
|
54
|
|
Avoine, l'hectolitre
|
10
|
|
75
|
|
Vin ordinaire, le litre
|
|
|
92
|
|
Huile ordinaire, le litre
|
1
|
|
58
|
|
Viande de porc, le kilogramme
|
2
|
|
28
|
|
Viande de bœuf, le kilogramme
|
2
|
|
28
|
|
Viande de mouton et de chèvre, le kilogramme
|
1
|
|
52
|
|
Lard de 1ère qualité, le kilogramme
|
3
|
|
04
|
|
Une paire de poulets
|
3
|
|
72
|
|
Une paire de canards
|
2
|
|
48
|
|
Un lièvre
|
9
|
|
30
|
|
Un lapin
|
2
|
|
48
|
|
Huîtres, le cent
|
6
|
|
20
|
|
Œufs, le cent
|
6
|
|
20
|
|
A l'ouvrier de campagne, nourri : par jour
|
1
|
|
55
|
|
Au maçon, charpentier, nourri : par jour
|
3
|
|
10
|
|
Au peintre en bâtiment, par jour
|
4
|
|
65
|
|
Au peintre décorateur, par jour
|
9
|
|
30
|
|
Au berger
|
1
|
|
24
|
|
Au barbier, par personne
|
|
|
12
|
|
Au maître de lecture, par enfant et par mois
|
3
|
|
10
|
|
Au maître de calcul, par enfant et par mois
|
4
|
|
65
|
|
Au maître d'écriture, par enfant et par mois
|
3
|
|
10
|
|
Au maître de grammaire, par enfant et par mois
|
12
|
|
40
|
|
Au rhéteur ou sophiste, par enfant et par mois
|
15
|
|
50
|
|
A l'avocat, pour une requête
|
12
|
|
40
|
|
A l'avocat, pour l'obtention du jugement
|
62
|
|
00
|
|
Au garçon de bains, par baigneur
|
|
|
12
|
|
Souliers de muletier ou de paysan, sans clous
|
7
|
|
44
|
|
Une bride de cheval avec le mors
|
6
|
|
20
|
|
Une outre pour l'huile
|
6
|
|
20
|
|
Location d'une outre, par jour
|
|
|
13
|
|
Un bât de bardeau
|
21
|
|
70
|
|
Un bât d'âne
|
15
|
|
50
|
|
Un bât de chameau
|
21
|
|
70
|
|
Un
peigne de femme, en buis
|
|
|
87
|
Dans leur ensemble, ces prix
différent peu des prix de nos jours dans les villes ; la cherté du vin
ordinaire est peut-être ce qu’il y a de plus remarquable, d’autant plus que
le vin était abondant en presque toutes les provinces de l’empire ; peut-être
payait-il au fisc un droit élevé, compris dans le droit de vente[141].
Dioclétien venait de commettre une faute économique que
nous n’avons pas le droit de lui reprocher durement ; car, quinze siècles après
lui, nos Conventionnels ont encore fait une loi du maximum. L’événement lui
montra qu’aucune volonté ne peut prévaloir, en ces matières, contre la force
des choses. Les marchands, obligés de vendre à plus bas prix qu’ils n’avaient
acheté, cachèrent leurs denrées ; la cherté s’accrut ; des rixes éclatèrent,
où le sang coula, et il fallut laisser tomber la loi[142].
Mais ce que l’édit ne put faire par ordre, la réforme
monétaire, qui se place entre 296 et 301, le fit peu à peu. Dioclétien frappa
des argentei dont on tailla 96 à la
livre et qui pesèrent en moyenne 3,40 gr.[143] ; des aurei de 60 à la livre, pesant par conséquent
5,42 gr., ce qui leur donnait une valeur intrinsèque de 17 fr. 78 c.[144] ; enfin des deniers de cuivre ou follis, valant la 288e partie de l’aureus, ou 06c.,2
[145]. Ce dernier
chiffre est malheureusement incertain[146] ; aussi
convient-il de faire des réserves au sujet du tableau que nous venons de
présenter, où les calculs sont établis d’après la valeur assignée aux denaria de cuivre, 06c.,2. Mais si cette liste
ne donne pas les prix véritables, elle est du moins intéressante en ce
qu’elle permet de saisir les rapports de valeur qui existaient alors entre
les denrées ou pour la rémunération des services. Quant à l’effet produit par
la réforme monétaire, il était inévitable : à mesure que la circulation de la
bonne monnaie s’accrut, la cherté diminua.
Nous avons déjà signalé l’activité législative de
Dioclétien. Les Codes ont conservé de lui douze cents prescrits. La plupart
sont des règlements administratifs établis pour régulariser les mouvements de
la grande machine qu’il venait de monter. Ceux qui se rapportent à la
législation civile ne sont souvent que la répétition de dispositions
anciennes, mais rappeler de bonnes mesures et leur rendre la force légale est
encore un mérite. Dans ces actes dominent les sentiments élevés et l’esprit
de justice qui avaient marqué les décisions des Antonins. Il ne souffre pas
que l’enfant refuse des aliments à ceux dont il tient le jour, qu’un fils
soit appelé en témoignage contre son père, un esclave contre son maître, un
frère contre son frère, un pupille contre celui qui l’a recueilli et élevé.
Un père se plaint des embûches que son fils lui a tendues. Tu as le droit, répond le prince, de demander justice si les sentiments que tu dois avoir
pour un fils ne t’arrêtent pas[147] ; et il déclare
qu’un fils ne peut être vendu ou donné en gage par son père[148].
Il rappelle que le colon n’est pas tenu des dettes de son
propriétaire[149],
et il charge les juges de rappeler la loi aux plaideurs[150], même de
suppléer aux lacunes des plaidoiries, si quid
minus fuerit dictum.
Comme Ulpien, il n’aimait pas la torture et voulait que le
juge n’y recourût qu’après avoir épuisé tous les autres moyens de parvenir à la
vérité[151]
; et s’il appelait les mathématiques appliquées à l’astrologie un art
damnable, il déclarait les géomètres d’utiles serviteurs de l’État[152]. Sa justice
était égale pour tous : il repoussait les sollicitations faites à son
autorité supérieure par ceux qui tentaient de se soustraire à une obligation
légale. Il n’est pas dans nos habitudes,
écrit-il, d’accorder un avantage qui nuise à
autrui[153]. Et une autre
fois : Un rescrit impérial ne peut défaire ce qui
a été fait selon la loi[154].
Sous ce prince vieilli dans les camps, le soldat ne leva
pas trop haut la tête et la voix. A des demandes intéressées, Dioclétien
répondait : Cela ne convient pas à la gravité
militaire[155]. Des soldats
prétendaient garder comme esclaves des citoyens tombés aux mains de l’ennemi
et délivrés par eux. Les captifs,
écrit Dioclétien, doivent rentrer en possession
de leurs anciens droits ; car ils n’ont pas été pris, ils ont été recouvrés ;
nos soldats ne sont pas leurs maîtres, ils ont été leurs défenseurs[156].
Ses édits ont de très vertueux préambules. L’un reproche
aux hommes leur avarice ; l’autre rappelle que ce sont les dieux qui ont fait
la fortune de Rome et qu’ils la soutiendront tant que les Romains mèneront
une vie chaste et pieuse[157]. Ce ne sont là
que lieux communs auxquels se plaisent parfois les plus débauchés, mais rien
ne prouve qu’il n’ait pas eu de bonnes mœurs et nous savons par ses lois qu’il
proscrivit les mauvaises[158].
Il reste beaucoup de règlements édictés par Dioclétien
pour garantir la sûreté des personnes et des propriétés, pour empêcher les
fraudes dans le commerce et protéger l’ingénu, le mineur, l’esclave, même le
débiteur, qu’il ne permet pas de tenir en servitude[159], enfin pour
tout régler, dans son vaste empire, selon la justice et l’humanité[160].
Il y avait à craindre que la division de l’empire ne
détruisît l’unité de la législation et de la jurisprudence. Pour faciliter
l’œuvre des tribunaux, il fit rédiger par un de ses jurisconsultes une compilation
des lois impériales[161]. Le Code
Grégorien s’ouvrait, croit-on, par une constitution d’Hadrien. C’est
aussi à ce prince, son précurseur dans les grandes réformes administratives,
que Dioclétien fit commencer l’Histoire Auguste[162]. Il voulait
mettre sous les yeux de ses sujets la vie politique et constitutionnelle de
l’empire durant les deux derniers siècles, et cette idée avait à la fois la
grandeur et l’utilité qui sont le caractère de tous les actes de son
gouvernement, un seul excepté, celui dont il nous reste à raconter la sombre
histoire.
Lactance reproche au fondateur de la tétrarchie ses
constructions[163] : Trajan et
Hadrien en avaient fait bien d’autres ; le faste dont il s’entoura, luxe en
effet inutile qu’il eut le tort de croire nécessaire ; enfin les dépenses
imposées par l’entretien de quatre cours et par l’augmentation du personnel
administratif[164]. Mais le
bien-être d’un État ne se mesure pas au chiffre des contributions qu’il paye.
De faibles impôts sont très lourds pour des pays troublés, de gros impôts
sont légers pour un pays prospère.
Or, du vivant de Dioclétien, ses dépenses avaient rapporté
déjà beaucoup de sécurité[165], et elles en
eussent rapporté davantage si son système avait duré ; car, toutes les forces
productives se développant au sein de la paix, l’empire aurait vu renaître la
prospérité du siècle des Antonins. Elle fut grande durant les vingt années de
son règne ; les contemporains l’attestent, même Lactance qui vante la suprême félicité de ce temps, et l’évêque de
Césarée qui s’écrie : Comme l’empire était alors
florissant ! Sa puissance croissait tous les jours et il jouissait d’une paix
profonde ![166]
La paix ! tout était là ; Dioclétien avait su la garantir,
et ses successeurs l’eussent conservée, si, demeurés fidèles à son système,
ils avaient, à l’exemple des quatre premiers princes, formé comme un chœur de musique rangé autour du maître
d’harmonie qui réglait les mouvements et la mesure[167].
|
 Les rares documents que nous possédons sur Dioclétien ne
donnent pas ces détails intimes qui permettent de pénétrer jusqu’au fond de
l’âme des personnages de l’histoire. Cependant, malgré les lacunes et les
obscurités, on entrevoit qu’il fut plus qu’un soldat de fortune. Mais ce
parvenu ne sortait point d’une de ces riches et intelligentes cités où les
Antonins avaient appris les élégances de la société romaine. Aussi, n’ayant
pas, pour tenir la foule à distance, leur distinction naturelle ou acquise,
il s’entourera de pompes solennelles et froides, réglées par une sévère
étiquette. Dans les arts, il aimera les constructions massives, la lourde
ornementation des époques de décadence, et, tandis que la villa d’Hadrien à
Tibur nous a conservé quantité de chefs-d’œuvre, du palais de Dioclétien, à
Salone, vaste amoncellement de marbre, de granit et de porphyre, pas un ne
nous est venu.
Les rares documents que nous possédons sur Dioclétien ne
donnent pas ces détails intimes qui permettent de pénétrer jusqu’au fond de
l’âme des personnages de l’histoire. Cependant, malgré les lacunes et les
obscurités, on entrevoit qu’il fut plus qu’un soldat de fortune. Mais ce
parvenu ne sortait point d’une de ces riches et intelligentes cités où les
Antonins avaient appris les élégances de la société romaine. Aussi, n’ayant
pas, pour tenir la foule à distance, leur distinction naturelle ou acquise,
il s’entourera de pompes solennelles et froides, réglées par une sévère
étiquette. Dans les arts, il aimera les constructions massives, la lourde
ornementation des époques de décadence, et, tandis que la villa d’Hadrien à
Tibur nous a conservé quantité de chefs-d’œuvre, du palais de Dioclétien, à
Salone, vaste amoncellement de marbre, de granit et de porphyre, pas un ne
nous est venu. Dioclétien eut cette vue nette des besoins publics qui, en
politique, dénote l’homme supérieur. Le 1er mai 285, il revêtit de
la pourpre, non pas un parent, mais un de ses compagnons d’armes, Maximien
et, à cette occasion, il prit encore un nom nouveau,
Dioclétien eut cette vue nette des besoins publics qui, en
politique, dénote l’homme supérieur. Le 1er mai 285, il revêtit de
la pourpre, non pas un parent, mais un de ses compagnons d’armes, Maximien
et, à cette occasion, il prit encore un nom nouveau, 
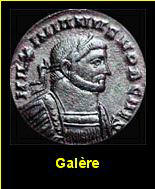 Théoriquement, cette conception était heureuse ; avec
Dioclétien, elle pouvait réussir, grâce à l’autorité que lui donnait sa
sagesse, prouvée par dix années de succès et de ferme gouvernement ; et c’est
avec raison que les contemporains ont célébré l’union qu’il sut maintenir
entre des princes de caractères si différents. Mais, dans ce système, il
n’était pas tenu compte des rivalités qui éclateraient inévitablement après
lui, de l’ambition impatiente des césars, de la jalousie mutuelle des
augustes qui remplaceront les fondateurs de la tétrarchie. Ce plan a eu le
sort de tant d’autres projets, inspirés par la sagacité politique, et que la
passion ou des circonstances contraires ont fait échouer. Cependant,
lorsqu’on ajoutera à cette réforme dans la constitution du pouvoir celle que
fera Dioclétien dans l’administration, on sera forcé de reconnaître à ce
prince une intelligence supérieure et de le mettre au premier rang des
empereurs romains. Le nom de Charlemagne est resté bien grand, quoique son
œuvre aussi ait échoué ; il est vrai qu’elle a duré plus longtemps
Théoriquement, cette conception était heureuse ; avec
Dioclétien, elle pouvait réussir, grâce à l’autorité que lui donnait sa
sagesse, prouvée par dix années de succès et de ferme gouvernement ; et c’est
avec raison que les contemporains ont célébré l’union qu’il sut maintenir
entre des princes de caractères si différents. Mais, dans ce système, il
n’était pas tenu compte des rivalités qui éclateraient inévitablement après
lui, de l’ambition impatiente des césars, de la jalousie mutuelle des
augustes qui remplaceront les fondateurs de la tétrarchie. Ce plan a eu le
sort de tant d’autres projets, inspirés par la sagacité politique, et que la
passion ou des circonstances contraires ont fait échouer. Cependant,
lorsqu’on ajoutera à cette réforme dans la constitution du pouvoir celle que
fera Dioclétien dans l’administration, on sera forcé de reconnaître à ce
prince une intelligence supérieure et de le mettre au premier rang des
empereurs romains. Le nom de Charlemagne est resté bien grand, quoique son
œuvre aussi ait échoué ; il est vrai qu’elle a duré plus longtemps En 294, Narsès, second fils du pacifique Bahram, avait
ceint dans Ctésiphon la tiare du grand roi. C’était un vaillant prince qui
mit ses soins à réveiller l’ardeur guerrière de son peuple ; Dioclétien était
alors au fond de l’Égypte, et Galère dans
En 294, Narsès, second fils du pacifique Bahram, avait
ceint dans Ctésiphon la tiare du grand roi. C’était un vaillant prince qui
mit ses soins à réveiller l’ardeur guerrière de son peuple ; Dioclétien était
alors au fond de l’Égypte, et Galère dans 