|
I. — CLAUDE Il (208-870) ; LA PREMIÈRE INVASION
REPOUSSÉE.
Les conjurés du camp de Milan ne ressemblaient pas aux
prétoriens qui avaient mis jadis l’empire aux enchères. C’étaient de
vaillants soldats, résolus à en finir avec la honte de Rome par le
rétablissement de la discipline et en menant vigoureusement la guerre contre
les Barbares. Ils choisirent celui d’entre eux qui paraissait le plus
expérimenté et qui était le plus en vue, le Dalmate Claude[1]. Les flatteurs de
Constance Chlore, son petit-neveu, donneront à Claude pour aïeul le Troyen
Dardanus ; mais il avait fait lui-même sa noblesse. Dèce l’avait déclaré
indispensable à la république ; Valérien le tenait en haute estime, et
Gallien redoutait son jugement.
 Sous Valérien, Claude avait eu le gouvernement de l’Illyricum et le commandement des troupes
répandues des Alpes à l’Euxin, avec les appointements du préfet d’Égypte, les
honneurs du proconsul d’Afrique et une suite aussi nombreuse que celle de
l’empereur[2]
: par où l’on voit que le faste des cours orientales avait gagné celle de
Rome et transformait, même en ces temps malheureux, le comitatus sévère des anciens proconsuls en un
cortège royal, ruineux pour les finances publiques. La mollesse de Gallien
l’irritait : il en revint quelque chose au prince, qui se hâta d’écrire à un
de ses officiers une humble lettre où se révèle la misérable condition de ces
augustes qui ne savaient ni commander ni se faire obéir : Sous Valérien, Claude avait eu le gouvernement de l’Illyricum et le commandement des troupes
répandues des Alpes à l’Euxin, avec les appointements du préfet d’Égypte, les
honneurs du proconsul d’Afrique et une suite aussi nombreuse que celle de
l’empereur[2]
: par où l’on voit que le faste des cours orientales avait gagné celle de
Rome et transformait, même en ces temps malheureux, le comitatus sévère des anciens proconsuls en un
cortège royal, ruineux pour les finances publiques. La mollesse de Gallien
l’irritait : il en revint quelque chose au prince, qui se hâta d’écrire à un
de ses officiers une humble lettre où se révèle la misérable condition de ces
augustes qui ne savaient ni commander ni se faire obéir :
Rien ne m’a été pénible comme
d’apprendre par votre rapport que Claude, notre parent et notre ami, est très
irrité contre moi pour des bruits, la plupart faux, qui lui ont été répétés.
Je vous prie, mon cher Venustus, si vous voulez me montrer de l’attachement,
d’engager Gratus et Herennianus à l’apaiser. Mais que tout se passe à l’insu
des soldats daces, de peur que, déjà mécontents, ils ne se portent à quelque
fâcheuse extrémité. Je lui envoie des présents : faites qu’il les reçoive
avec plaisir ; mais qu’il ne se doute pas que je connais ses
dispositions à mon égard, car, s’il me croyait du ressentiment contre lui, il
pourrait prendre un parti violente[3].
Gallien espérait payer ainsi sa rançon : j’estime que
Claude n’en eut que plus de mépris pour lui. Quand les conjurés l’eurent
proclamé empereur, les soldats marquèrent quelque mécontentement, afin de se
vendre plus cher. Vingt pièces d’or distribuées à chacun d’eux levèrent tous
les scrupules. Ils déclarèrent Gallien tyran ; le sénat agit de même avec un
empressement plus réel. Il fit traîner aux gémonies les serviteurs de celai
qui s’était inquiété de trouver chez les sénateurs un reste de patriotisme,
et l’on conte que, dans la curie même, un des officiers du trésor eut les
yeux arrachés[4],
supplice lâche qui annonce l’approche du Bas-Empire. Claude arrêta ces
exécutions, et les pères conscrits, repentants, mirent Gallien au nombre des divi, ce qui équivalait au maintien de ses
actes.
Lorsqu’ils apprirent l’élection de Claude, ils la
confirmèrent par ces acclamations répétées qui nous semblent si contraires à
la gravité sénatoriale, mais qui n’étonnaient personne : Auguste Claude, que les dieux vous accordent à nos vœux !
(répété soixante
fois) ; Claude auguste, c’est vous, ou un
prince qui vous ressemblât, que nous avons toujours souhaité (quarante fois) ; Claude auguste, les vœux de la république vous appelaient
au trône (quarante
fois) ; Claude auguste, vous êtes le
modèle des frères, des pères, des amis, des sénateurs et des princes
(quatre-vingts fois)
; Claude auguste, délivrez-nous d’Aureolus
(cinq fois) ; Claude auguste, délivrez-nous des Palmyréens (cinq fois) ; Claude auguste, délivrez-nous de Zénobie et de Victoria
(sept fois) ; Claude auguste, que Tetricus ne soit rien (sept fois)[5].
Claude, en effet, se trouvait en face de trois
adversaires. Mieux inspiré que le sénat, il en négligea deux, qui se
trouvaient aux extrémités de l’empire, se délit rapidement du troisième,
Aureolus, qu’un jugement des soldats condamna à mort, et s’occupa des
préparatifs d’une grande guerre contre les Barbares. L’affaire de Tetricus, avait-il répondu aux
sénateurs, ne regarde que moi, celle des Goths intéresse la république[6].
Depuis trente années ces Barbares ravageaient les
frontières romaines ; le butin s’y faisant rare, l’idée leur vint de se
transporter en corps de nation dans l’intérieur de l’empire, dont ils
connaissaient le climat plus tempéré que celui des plaines scythiques, où des
froids et des chaleurs extrêmes rendent la vie si dure. Des messagers
coururent des rives du Dniester à celles de la Morava (March) ; des
conseils furent tenus chez les Tervinges, ou Goths de l’Ouest, chez les
Gépides, les Mérules, les Peuciniens, et une vaste coalition se forma pour
seconder l’invasion des Goths de l’Est, ou Gruthunges, par une série
d’attaques sur le Danube moyen. Les Scordisques, d’origine celtique,
entrèrent dans la ligue ; les Alamans et leurs voisins les Juthunges[7], sans doute
instruits de ces projets, se promirent d’en profiter pour retourner faire
leur main dans la riche vallée du Pô. Ils furent même les premiers prêts :
sans attendre leurs alliés, ils se jetèrent, dés l’année 268, dans les
défilés des Alpes, qu’ils avaient souvent pratiqués, et descendirent sur les
bords du lac de Garda. Claude les y reçut avec une armée sur laquelle il
avait déjà su prendre de l’empire, et la moitié des Barbares tomba sous
l’épée des légionnaires. C’était de bon augure pour une lutte plus sérieuse.
Durant l’hiver de 268, la cognée ne cessa de retentir dans
les forêts sarmates ; les arbres abattus étaient roulés au bord des fleuves,
que couvrirent au printemps deux mille barques[8], où s’entassèrent
des guerriers éprouvés. La horde, composée de trois cent vingt mille combattants[9], sans compter les
femmes, les enfants et les esclaves, se mit en marche dans la direction de
l’Ouest, avec d’innombrables troupeaux[10] et de grands
chars qui, dans les campements, servaient d’enceinte[11]. L’armée et la
flotte suivirent la côte à quelque distance du rivage, l’une à cause des
marécages que ces fleuves paresseux laissent à leur embouchure, l’autre à
raison des bas-fonds que les alluvions forment assez loin en mer[12]. La traversée du
Danube se fit avec l’assistance des vaisseaux, et quelques journées de marche
amenèrent les Goths en vue de Tomi. Les invasions précédentes avaient fait
sentir à toutes les villes de ces régions la nécessité de relever leurs murs
et de se mettre en état de défense. Tomi ferma ses portes, les habitants
garnirent leurs murailles, et les Goths ne furent point en état d’y faire
brèche. Ne pouvant non plus s’arrêter dans ces plaines de la Dobroudja, où il est
si difficile de vivre, ils firent route vers les Balkans dans la direction de
Marcianopolis (à 18
milles à l’ouest de Varna). Cette ville, bâtie par Trajan, fut digne
de son fondateur : elle repoussa toutes les attaques. Les Barbares conçurent
alors un plan habile : ils se séparèrent. La flotte fit voile vers la Propontide, menaça
Byzance et Cyzique, puis, malgré une tempête qui lui causa une grande perte
d’hommes et de navires, elle gagna la péninsule de l’Athos, où ceux qui la
montaient se partagèrent encore. Les uns assiégèrent Cassandrée, l’ancienne
Potidée, et la grande ville de Thessalonique, pour s’ouvrir la Macédoine. Les
autres ravagèrent la
Grèce, les Cyclades, la Crète, Rhodes, Chypre, et l’orage, épuisant sa
force en avançant, alla se perdre sur les tûtes de la Pamphylie.
Pendant que le bruit de ces pillages retenait inactives
dans le sud de l’empire les forces romaines qui se trouvaient autour de la
mer Égée, l’attaque principale se prononçait au nord : les Goths traversaient
la Mœsie et
arrivaient dans la vallée du Margus (la Morava
du sud), sentant bien qu’ils ne trouveraient un établissement
tranquille sur la rive droite du Danube qu’après avoir détruit l’armée
impériale. Jamais Rome, depuis les Gaulois et Annibal, ne s’était trouvée
dans un si grand péril. Claude écrivit au sénat : Je
vous dois, pères conscrits, la vérité : trois cent vingt mille Barbares ont
envahi le territoire romain. Si j’en triomphe, vous reconnaîtrez que nous
avons bien mérité de la patrie ; si je ne suis pas vainqueur, souvenez-vous à
qui je succède. La république est épuisée, et nous combattons après Valérien,
après Ingenuus, après Regalianus, après Lælianus, après Postumus, après
Celsus, après mille autres que le mépris inspiré par Gallien avait détachés
de la république. Nous n’avons plus de boucliers, plus d’épées, plus de
javelots. Tétricus est maître des Gaules et des Espagnes qui sont les forces
de l’empire, et, ce que j’ai honte d’écrire, tous nos archers servent sous
Zénobie. Si peu que nous fassions, nos succès seront assez grands[13].
Claude prit de sages mesures. Il ne marcha pas droit à la
rencontre de cette masse énorme. Laissant son frère Quintillus, à la tête de
forces considérables, autour d’Aquilée, pour tenir fermée cette porte de
l’Italie, il traversa l’Illyrie, entra en Macédoine par la passe de Scupi et
s’arrêta dans la haute vallée de l’Axios. Il se plaçait ainsi entre la flotte
des Goths et leur armée de terre. Couvert contre celle-ci par le mont
Orbelos, il pouvait, par l’Axios, qui débouche au fond du golfe Thermaïque,
surveiller ce qui se passait à la côte. Si les machines, que les Barbares
avaient fait construire par des transfuges, avaient raison de la résistance
des habitants de Thessalonique, l’empereur était en état d’empêcher les
vainqueurs de s’étendre dans la Macédoine et de rejoindre leurs frères. Cette
position lui permettait donc d’attendre son heure pour frapper le coup
décisif.
Mais les Goths ne savaient pas prendre de vive force une
ville bien défendue et n’avaient pas la patience nécessaire pour la réduire
par la famine[14].
A la nouvelle de l’approche de Claude, ils marchèrent audacieusement à sa rencontre
; Aurélien, qu’il avait nommé maître de la cavalerie, les arrêta par un
combat dans lequel les cavaliers dalmates se signalèrent. Trois mille Goths
furent tués ; on en prit bien davantage, et Claude, rendu libre de ses
mouvements au nord, par le désarroi de l’ennemi au sud, passa les monts pour
aller chercher la grande armée dans la vallée du Margus. La bataille eut lieu
près de Naïssus (Nissa)
; elle fut longue et sanglante. Un corps, qui put opérer par une route non
gardée, tourna l’ennemi et le prit à dos. Cette manœuvre fut désastreuse pour
les Barbares : cinquante mille restèrent sur la place (269)[15] ; les autres,
coupés de la vallée du Danube, se jetèrent en diverses bandes sur la Macédoine et la Thrace. Les légions
se divisèrent pour les suivre ; la guerre s’éparpilla, et il devint
impossible de renouveler le coup frappé à Naïssus. De temps en temps, les
Barbares s’arrêtaient derrière l’enceinte de leurs chariots, fortification
mobile d’où, plus d’une fois, ils firent des sorties heureuses contre ceux
des Romains qui s’aventuraient en trop petit nombre dans leur voisinage.
Cependant, décimés par ces continuelles attaques, par la faim, par les
maladies, ils périssaient en foule. Une troupe assez nombreuse parvint à se
réfugier dans les Balkans. Les Romains survinrent encore et occupèrent les
issues de la montagne, où, durant un hiver rigoureux, les vivres manquèrent.
Pour en finir, Claude entra dans les défilés et les y força (270).
L’empereur rédigea son bulletin de victoire avec une
emphase que cette fois on pardonne : Nous avons
détruit cent vingt mille Goths et coulé deux mille navires. L’eau du fleuve
se cache sous les boucliers qu’elle roule, les rivages sous les épées et les
lances brisées, les champs sous les os des morts. Tous les chemins sont
encombrés par l’immense bagage qu’ils ont abandonné[16].
La flotte impériale avait eu raison, elle aussi, de ce
qu’il restait des navires sortis du Dniester[17] ; de sorte que,
de cette multitude immense, bien peu revirent les lieux qu’ils avaient
quittés une année auparavant, si pleins d’audace et d’espérance. Ceux qui
n’avaient pas péri allèrent cultiver comme esclaves ou colons les terres des
vainqueurs, tandis que leurs femmes étaient distribuées entre les soldats
romains. Un certain nombre de jeunes Barbares furent enrôlés dans les
cohortes ; d’autres envoyés à Rome pour les jeux de l’amphithéâtre. La
capitale, sans doute, ne fut pas seule honorée d’un présent de gladiateurs. Claude dut accorder la
même faveur à plusieurs cités, afin que toute l’Italie vit servir à ses
plaisirs ces Goths qui, durant une génération entière, lui avaient inspiré
tant de terreur[18].
La large saignée faite à la nation gothique allait assurer
un siècle de tranquillité à la Mœsie[19]. Mais le prince
qui avait repoussé cette première et formidable invasion tomba dans son
triomphe. La peste l’avait aidé à délivrer les provinces : elle l’emporta
lui-même à Sirmium (avril
270). Il n’avait que cinquante-quatre ans, et sa verte vieillesse
promettait à l’empire un règne réparateur : car il aimait la justice, il
voulait la discipline et il était de ceux qui savent la maintenir. Au milieu
de ces ambitieux surnoms que tant d’empereurs reçurent pour de réelles, plus
souvent pour de problématiques victoires, l’historien doit mettre à la place la
plus honorable celui de Claude le Gothique. Les peuples gardèrent sa mémoire
; sous Constantin, Eumène disait encore : Que
n’est-il resté plus longtemps le sauveur des hommes et devenu plus tard le
compagnon des dieux ![20]
A la nouvelle de la mort de Claude, les légions d’Aquilée
proclamèrent son frère, M. Aurelius Quintilius, que le sénat se hâta de
reconnaître. Les soldats de Pannonie avaient mieux choisi en prenant Aurélien[21], que, suivant
certains récits, Claude lui-même avait désigné pour son successeur. Telle
était la renommée de ce chef, que son rival n’essaya pas même une lutte avec
lui. Après un règne de trois semaines, selon les uns, de quelques mois, selon
d’autres[22],
Quintilius se tua, ou fut mis à mort par les soldats que sa sévérité
irritait.

II. — AURÉLIEN[23]
(370-375).
Après les cérémonies de la fête
de Cybèle, dit Vopiscus, le préfet de la
ville, Junius Tiberianus, me fit monter dans sa voiture, qui nous mena du
Palatin aux jardins de Varus, et nous causâmes, entre autres choses, de
l’histoire des empereurs. Comme nous arrivions au temple du Soleil, consacré
par Aurélien, Tiberianus, qui tenait à la famille de ce prince, me demanda si
l’on avait écrit sa vie : Des Grecs l’ont fait, lui dis-je, mais
pas un Latin. — Eh quoi ! s’écria ce vertueux personnage[24], un Thersite, un Sinon, et tous les monstres de
l’antiquité, nous les connaissons, la postérité les connaîtra comme nous, et
Aurélien, ce vaillant prince, qui a rendu à Rome son univers, sera ignoré de
nos descendants ! Cependant nous avons ses éphémérides, où il avait ordonné
de consigner ses actes de chaque jour[25]. Je vous ferai donner ces livres, qui sont dans la
bibliothèque Ulpienne, afin que vous montriez Aurélien tel qu’il fut.
C’étaient de riches matériaux que le magistrat suprême
offrait à l’historien. Vopiscus, petit esprit et pauvre écrivain, n’a pas su
les mettre en œuvre. Mais les pièces officielles qu’il tira des archives
sont, à divers titres, intéressantes ; nous en avons déjà profité et nous en
profiterons encore.
Claude avait détruit la grande armée gothique, sauf
quelques bandes réfugiées çà et là dans les montagnes, qui reparurent un
moment aux environs d’Anchialos et de Nicopolis, où les gens du pays
suffirent à les disperser[26]. Mais, d’après
le plan concerté, il devait y avoir une seconde invasion par la Pannonie ; les
Vandales, les Juthunges et les Alamans s’agitaient. C’était pour arrêter ces
nouveaux assaillants que Claude avait fait route au nord et cantonné ses
troupes à Sirmium, forte place non loin de l’embouchure de la Save dans le Danube, et
centre de la défense dans cette, région.
 Aurélien s’y trouvait quand la mort de Claude lui valut
l’empire. Il était né en 214
[27], aux environs de
cette ville, d’un colon du sénateur Aurelius, dont l’affranchi, suivant
l’usage, avait pris le nom, et qui faisait valoir une petite ferme de son
patron[28]. Sa mère était
prêtresse du Soleil dans la bourgade qu’ils habitaient, et il garda toujours
une dévotion particulière pour ce dieu. Nous connaissons son courage, ses
exploits et les hautes charges qu’il avait remplies. Comblé d’honneurs par
Valérien, il avait été, sur les instances de ce prince, adopté comme fils ou
comme gendre par Ulpius Crinitus, un des grands personnages de l’empire, qui
prétendait appartenir à la famille de Trajan. Le fils du paysan pannonien
devenait l’héritier du culte, du nom et des biens de la plus illustre maison
de Rome[29]. Aurélien s’y trouvait quand la mort de Claude lui valut
l’empire. Il était né en 214
[27], aux environs de
cette ville, d’un colon du sénateur Aurelius, dont l’affranchi, suivant
l’usage, avait pris le nom, et qui faisait valoir une petite ferme de son
patron[28]. Sa mère était
prêtresse du Soleil dans la bourgade qu’ils habitaient, et il garda toujours
une dévotion particulière pour ce dieu. Nous connaissons son courage, ses
exploits et les hautes charges qu’il avait remplies. Comblé d’honneurs par
Valérien, il avait été, sur les instances de ce prince, adopté comme fils ou
comme gendre par Ulpius Crinitus, un des grands personnages de l’empire, qui
prétendait appartenir à la famille de Trajan. Le fils du paysan pannonien
devenait l’héritier du culte, du nom et des biens de la plus illustre maison
de Rome[29].
Très sévère pour la discipline, très exigeant pour le
service, Aurélien exerçait pourtant un grand empire sur les troupes, parce
qu’elles avaient vu maintes fois leur général se battre en soldat, ce qui,
dans les guerres anciennes, ajoutait au prestige du chef. On parlait de
nombreux ennemis tués par lui, et, dans les camps, il était appelé Aurélien à la main de fer[30]. Étant le plus
brave, il put être le plus ferme. Un soldat outrage la femme de son hôte :
Aurélien le fait attacher à deux arbres courbés de force en sens contraire et
qui le déchirent en se redressant. Un autre jour, il écrit à un officier : Si tu veux être tribun, si tu veux vivre, tiens le soldat.
Que personne ne dérobe un poulet, un mouton, même une grappe de raisin, ou
n’exige de l’huile, du sel et du bois. Il faut se contenter de sa ration : ce
que l’État donne suffit ; le butin se prend sur l’ennemi et ne doit pas
coûter de larmes aux provinces. Veille à ce que les armes, les habits, les
chaussures, soient toujours en bon état ; les chevaux de bât bien pansés, le
mulet de compagnie[31] soigné par chacun à tour de rôle et tout le fourrage
employé, afin qu’on n’en détourne pas pour le vendre. Fais soigner
gratuitement les soldats par les médecins et empêche-les de perdre leur
argent dans les tavernes ou avec les aruspices ; exige qu’ils se conduisent
décemment dans les quartiers ; les querelleurs seront battus.
Septime Sévère avait ainsi parlé, et cette fermeté avait valu à l’empire un
règne glorieux ; elle eut, sous Aurélien, les mêmes effets.
Comme le grand Africain, Aurélien était de mœurs austères
et dédaigneux du plaisir ; comme lui encore, il ne se pressa pas d’aller
recevoir les banales acclamations du sénat. Il battit les Juthunges qui
menaçaient la Rhétie
et régla les affaires de cette frontière, ce qui l’occupa quelques mois.
Lorsqu’il fit enfin le voyage de Rome, il parla fièrement dans le sénat : J’ai de l’or pour mes amis, dit-il, et du fer pour mes ennemis[32]. On verra que
ces ennemis ne furent pas toujours aux frontières. Pour n’avoir rien à
craindre en Italie des anciennes troupes de Quintillus, il était venu de
Pannonie bien accompagné. Les Juthunges et les Vandales trouvèrent l’occasion
propice pour envahir cette province. Aurélien y revint en toute hâte, se
faisant précéder de l’ordre qu’on rentrât le grain et le bétail dans les
forteresses. Le choc fut rude et la victoire indécise ; pourtant, la nuit
venue, l’ennemi recula, et Aurélien manœuvra de manière à lui couper la route
du Danube. Menacés de la famine dans un pays ruiné, les Barbares ouvrirent
des négociations. Leurs députés cachaient la crainte sous l’arrogance ;
l’empereur remit l’audience au lendemain. Il les reçut assis sur son
tribunal, entouré d’une pompe militaire et menaçante : à ses côtés, ses
principaux officiers à cheval ; derrière lui, les aigles d’or des légions,
les images des princes, les piques d’argent qui portaient en lettres dorées
le nom des différents corps, puis l’armée comme prête au combat et rangée en
demi-cercle sur une éminence qui la laissait voir tout entière[33]. Moins habiles
que l’Indien des prairies à cacher leurs sentiments, les Juthunges, en face
de cet imposant spectacle, restèrent un moment interdits ; mais l’audace leur
revint vite : Nous ne demandons pas la paix en
vaincus, dit leur interprète, mais en
anciens amis des Romains et en hommes qui savent qu’une bataille perdue par
surprise peut être suivie d’une victoire. Notre seule nation compte quarante
mille cavaliers, le double de fantassins, et l’Italie, que nous avons courue
presque entière, sait bien quelle est notre valeur. Avec notre alliance, tu
n’auras à craindre aucun ennemi. Donne-nous donc les présents accoutumés, les
subsides que nous recevions avant la guerre, et la paix est faite.
Dexippos, qui raconte cette scène, est un contemporain, mais il place dans la
bouche d’Aurélien une bien longue réponse ; nous n’en retiendrons que la fin.
Puisque vous avez violé les traités pour piller
nos campagnes, vous n’avez nulle grâce à demander, et dans l’état ois vous
êtes, c’est à vous d’accepter la loi du vainqueur. Vous savez ce qu’il est
advenu des trois cent mille Goths qui s’étaient jetés sur l’empire : le même
sort vous attend. Je vais passer le Danube et punir, chez vous-mêmes, votre
infidélité. Les Juthunges, cette fois intimidés, promirent de
rentrer en leur pays. Quelques mois après, nouvelle invasion des Vandales et
des Jazyges et nouveau succès d’Aurélien qui, pour rendre leur retraite plus
prompte, leur donna des vivres. Ils avaient livré en otages les fils de leurs
chefs et deux mille cavaliers, qui prirent rang parmi les auxiliaires des
légions[34].
Aurélien, de son côté, faisant un sacrifice qui devait coûter à son orgueil,
quoiqu’il ne coûtât rien à l’empire, leur céda la Dacie en offrant des
terres, au sud du Danube, à ceux des colons romains qui voudraient quitter la
province. Cet abandon était nécessaire, car, débordée sur ses deux flancs et
envahie au cœur, la Dacie
n’était plus tenable. S’il y restait des Romains, et il y en a encore qui
forment un peuple nombreux et brave, il n’y restait plus d’administration
romaine, excepté dans la
Transylvanie, où quelques cohortes défendaient sans doute
les mines d’or de ce pays, que les Romains exploitaient depuis un siècle et
demi. Afin de donner à croire qu’on n’avait rien perdu, on fit d’une portion
de la Mœsie
une Dacie nouvelle, et le nom de la conquête de Trajan resta sur la liste
officielle des provinces de l’empire. Mais, au lieu de la Dacie des montagnes, vraie
forteresse qui eût été imprenable si l’on avait su en fermer la porte sur le
bas Danube, ce fut la Dacie
du rivage, Dacia Repensis[35], qui ne couvrait
plus rien. Enfin le dieu Terme reculait. Pour un victorieux, cette condition
était dure ; Aurélien semble avoir voulu se couvrir du consentement de ses
soldats, comme représentants du peuple romain. Du moins il consulta l’armée
sur la question de la paix avec les Vandales[36], et le rappel
des garnisons daciques dut être la conséquence tacitement acceptée de la
convention que l’armée approuva. Dans l’état de l’empire et du monde barbare,
le Danube paraissait la meilleure frontière, et les grands succès de Claude,
ceux mêmes d’Aurélien, prouvent que, si le fleuve n’interdisait point aux
envahisseurs le passage, il gênait le retour.
Nous ne dirons pas aussi facilement que l’empereur un
adieu définitif à cette vaillante population romaine de la Dacie Trajane.
Digne de son origine et de celui qui lui avait donné ses premières cités,
elle a joué dans les Carpates le rôle de Pélage et de ses compagnons dans les
Asturies, bravant, du haut de cette forteresse inexpugnable, toutes les
invasions ; regagnant pied à pied, tandis qu’elles s’écoulaient vers le sud
ou l’ouest, le terrain perdu, et reconstituant, après seize siècles de
combats, une Italie nouvelle, Tzarea
Roumanesca, dont les peuples de race latine saluent
l’avènement au rang des nations libres[37].
Aurélien s’était résigné à laisser ce triste souvenir
s’attacher à son nom, à cause d’une nouvelle invasion des Alamans et des
Juthunges en Italie. Dans l’espérance d’exterminer ou de prendre la horde
entière, il voulut imiter la manœuvre de Claude à Naïssus : faire attaquer de
front les envahisseurs par la plus grande partie de son armée, dans la plaine
du P0, tandis que lui-même, avec les prétoriens et les auxiliaires, leur
couperait la retraite. Cette division des forces romaines amena un désastre.
Les Barbares sortant sur le soir d’épaisses forêts, où ils s’étaient cachés,
surprirent, près de Plaisance, les Romains, qui se gardaient mal. Beaucoup de
ceux-ci périrent, et une partie de la Cisalpine fut livrée à la plus épouvantable
dévastation. Des Alpes au détroit de Messine, on trembla un moment, comme on
avait tremblé naguère dans la péninsule des Balkans, à l’approche de la
grande armée gothique.
Pour calmer ces frayeurs, on recourut aux expiations
religieuses. Aurélien, qui savait quel parti on peut tirer, pour mener les
foules, de l’intervention des dieux et de l’appareil des vieilles superstitions,
écrivit au sénat la lettre suivante que le préteur urbain lut dans la curie :
Je m’étonne, vénérés Pères, que vous ayez hésité
si longtemps à ouvrir les livres sibyllins : on vous croirait réunis dans une
église de chrétiens et non dans le temple de tous les dieux. Agissez enfin,
et, par la sainteté des pontifes, par les solennités de la religion, aidez le
prince qui est aux prises avec de dures nécessités. Il n’est jamais honteux
de vaincre par l’assistance des immortels. C’est ainsi que nos aïeux ont
entrepris et terminé tant de guerres.
Avant l’arrivée de cette lettre, même proposition avait
été faite dans le sénat, mais les esprits forts et les courtisans du prince
en avaient ri. Aurélien suffira à tout,
disaient-ils. Le message impérial changea naturellement ces dispositions, et
le premier sénateur à qui le consul en charge demanda son avis reprocha aux
pères conscrits de songer si tard au salut de la
république et d’avoir été si lents à recourir aux livres du destin, à
profiter des bienfaits d’Apollon[38]. Allez donc, saints pontifes, allez, vous qui êtes purs,
irréprochables et sacrés ; allez dans un pieux costume et dans de saintes
dispositions ; montez au temple, préparez-y les sièges ornés de lauriers ;
ouvrez de vos mains respectables les livres de la religion ; cherchez-y les
destinées éternelles de la république ; apprenez à des enfants qui aient leur
père et leur mère l’hymne qu’ils doivent chanter. Nous déterminerons la
dépense nécessaire à cette cérémonie ; nous ordonnerons l’appareil des
sacrifices, et nous fixerons le jour de la lustration des champs[39]. (Séance du 10 janvier 271.)
On purifia la ville, on chanta les hymnes saints, on fit
une procession autour de Rome et l’on promit aux dieux d’en faire une autour
des champs ; enfin l’on accomplit des sacrifices aux lieux déterminés par le
livre sacré, pour empêcher les Barbares de les franchir[40]. Vopiscus ne dit
pas que ces expiations furent des sacrifices humains ; mais Aurélien avait
offert des captifs de toute nation[41], et ce ne
pouvait être qu’afin de renouveler l’antique coutume d’enterrer vivants les
hommes dont l’ombre irritée devait arrêter la marche de leurs compatriotes.
Tout en se mettant en règle avec les dieux, Aurélien
prenait ses mesures contre les Barbares. Ceux-ci, partis en guerre pour le
butin bien plus que pour la conquête, s’étaient divisés afin d’étendre plus
loin leurs déprédations. Ils semblent s’être avancés jusqu’au Métaure, ce qui
annoncerait leur intention de marcher sur Rome, suprême ambition de tous ces
pillards. On a, du moins, une inscription[42] où les cités de
Pesaro et de Fano rendent des actions de grâces à Hercule Auguste, collègue de l’invincible Aurélien,
sans doute pour quelque exploit de guerre accompli dans leur voisinage.
Aurélien suivait ces bandes, les détruisant l’une après l’autre ; près de
Pavie, il eut affaire au gros de l’armée barbare et lui infligea un grand
désastre. De ceux-là encore, bien peu revirent la hutte paternelle cachée
dans les grands bois du Neckar et du Mein.
Que s’était-il passé à Rome durant cette campagne ? Sans
doute ou y avait joué de la langue contre le Pannonien qui laissait le
peuple-roi avoir si grande peur. On avait peut-être renversé ses statues, tué
quelques-uns de ses gens ou de ses soldats. Il y eut certainement de grands
désordres, puisque Vopiscus parle de séditions violentes[43]. Le vaillant
soldat qui avait passé sa vie à combattre pour le salut de l’empire regarda
comme une trahison cette émeute faite à l’approche de l’ennemi et en punit
sévèrement les auteurs ; des sénateurs même périrent[44].
Depuis longtemps Rome, dans la sécurité que lui donnaient
sa fortune et son empire, avait franchi son enceinte, et le mur de Servius
disparaissait sous les maisons et les jardins qui couvraient l’immense
remblai et le pied de l’agger[45]. L’ennemi se
rapprochant, Aurélien se résolut à revenir aux précautions des anciens jours.
C’était un aveu humiliant, mais nécessaire. Il donna à Rome une seconde
enceinte qui enveloppa la première et que Probus achèvera : elle eut environ
11 milles, ou 16
kilomètres, de tour[46] (271). Cette
nouvelle ligne de fortifications est encore marquée par le mur dit
d’Honorius, à cause des réparations que ce prince y fit.
Les Barbares repoussés et Rome mise à l’abri d’un coup de
main. Aurélien songea aux deux compétiteurs qui tenaient en dehors de son
autorité l’orient et l’occident de l’empire, Zénobie et Tetricus. Celui-ci
était le plus proche, irais il paraissait le moins dangereux, et Aurélien
avait déjà des raisons particulières pour ne le point redouter[47] ; il dirigea ses
premiers coups contre la reine de Palmyre.
Vainqueur de Sapor, dont il avait insulté deux fois la
capitale en plantant ses flèches dans les portes de Ctésiphon, Odenath avait
été investi par Gallien du commandement de toutes les forces romaines en
Orient, et associé rhème à l’empire. Il s’apprêtait à délivrer l’Asie
Mineure, des Goths, lorsque, en 266-267, il tomba victime d’une de ces
tragédies fréquentes dans les maisons royales de l’Orient[48]. Un jour, dans
une chasse royale, son neveu Mæonios lança le premier trait sur la bête, au
débucher ; et la tua. C’était contraire à l’étiquette, qui réservait ce coup
au prince, et Odenath l’en reprit avec colère. Mæonios ne tint pas compte de
l’avertissement. L’ambition d’être renommé le plus habile chasseur du désert
lui ôtait toute prudence : deux fois encore ses flèches partirent avant
celles du roi. L’insulte était publique : Odenath lui retira son cheval, ce
qui équivalait à une dégradation, et le bouillant jeune homme s’emportant en
menaces, il le fit jeter en prison. Délivré, grâce aux prières d’Hérodès,
fils allié du roi, l’Arabe garda au cœur une haine violente et, avec l’aide
de quelques complices, assassina, au milieu d’un festin, Odenath et Hérodès[49].
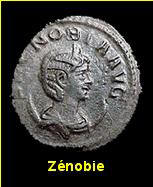 Zénobie avait partagé le pouvoir et les travaux de son
époux[50]. Elle prétendait
descendre des rois macédoniens d’Égypte, ce qui avait fait d’elle la plus
noble femme de l’Orient ; on la disait aussi la plus belle, et elle en était
la plus chaste[51].
L’ambition et l’amour de la gloire avaient étouffé en elle les vices que
nourrit le harem. Elle savait toutes les langues parlées de Palmyre à Athènes
et d’Athènes à Memphis, même le latin[52] ; elle lisait
Homère et Platon ; avec Longus, le douteux auteur du traité du Sublime,
mais le sage qui sut bien mourir, elle discutait des questions de philosophie
et de littérature ; avec le fameux archevêque d’Antioche, Paul de Samosate,
des questions de théologie, et elle donna à ses deux fils aînés de si habiles
maîtres, qu’on a dit de l’un d’eux, Timolaos, que, s’il avait vécu plus
longtemps, il aurait mis son nom à côté de ceux des grands orateurs latins.
Le désert avait, comme Athènes et Rome, son académie de beaux esprits ; mais
on n’y avait pas tous les goûts du monde occidental, car, dans Palmyre, il ne
se trouve aucune trace de ces amphithéâtres que les cités vraiment romaines
se hâtaient de bâtir. Zénobie avait partagé le pouvoir et les travaux de son
époux[50]. Elle prétendait
descendre des rois macédoniens d’Égypte, ce qui avait fait d’elle la plus
noble femme de l’Orient ; on la disait aussi la plus belle, et elle en était
la plus chaste[51].
L’ambition et l’amour de la gloire avaient étouffé en elle les vices que
nourrit le harem. Elle savait toutes les langues parlées de Palmyre à Athènes
et d’Athènes à Memphis, même le latin[52] ; elle lisait
Homère et Platon ; avec Longus, le douteux auteur du traité du Sublime,
mais le sage qui sut bien mourir, elle discutait des questions de philosophie
et de littérature ; avec le fameux archevêque d’Antioche, Paul de Samosate,
des questions de théologie, et elle donna à ses deux fils aînés de si habiles
maîtres, qu’on a dit de l’un d’eux, Timolaos, que, s’il avait vécu plus
longtemps, il aurait mis son nom à côté de ceux des grands orateurs latins.
Le désert avait, comme Athènes et Rome, son académie de beaux esprits ; mais
on n’y avait pas tous les goûts du monde occidental, car, dans Palmyre, il ne
se trouve aucune trace de ces amphithéâtres que les cités vraiment romaines
se hâtaient de bâtir.
 Zénobie suivait son époux à la chasse et à la guerre :
elle vainquit avec lui les Perses et essaya, sans lui, de conquérir l’Égypte.
Quelques-uns l’accusent d’avoir été du complot qui coûta la vie au césar de
Palmyre. On peut en douter. Elle avait, d’un premier mariage, un fils, à qui
Hérodès fermait la route du pouvoir et que sa mort ferait roi. La mère se
l’est dit, sans doute : peut-être l’a-t-elle espéré ; mais participer au
complot contre Odenath eût été conspirer contre elle-même. Mæonios avait
assassiné son oncle par vengeance, pour prendre sa place et non pour la
laisser à la reine. Il n’avait pas été non plus nécessaire de le pousser à se
défaire d’Hérodès, qu’Odenath avait associé à l’empire[53] : le
premier crime rendait le second nécessaire, et nous accordons que la
belle-mère du jeune prince dut voir sans chagrin cette mort, qui délivrait
son fils d’un concurrent. La tragédie accomplie, elle souleva contre le meurtrier
les soldats qui l’avaient proclamé roi et qui, sans doute pour un peu d’or,
portèrent sa tête aux pieds de Zénobie ; après quoi ils saluèrent du titre
d’auguste son fils aîné Waballath et de celui de césar les deux autres[54]. Elle les montra
au peuple, à l’armée, revêtus de la pourpre romaine, et elle garda la réalité
du pouvoir avec le titre de basilissa,
reine, l’équivalent sans doute, pour les Palmyréens, du nom d’augusta. Zénobie suivait son époux à la chasse et à la guerre :
elle vainquit avec lui les Perses et essaya, sans lui, de conquérir l’Égypte.
Quelques-uns l’accusent d’avoir été du complot qui coûta la vie au césar de
Palmyre. On peut en douter. Elle avait, d’un premier mariage, un fils, à qui
Hérodès fermait la route du pouvoir et que sa mort ferait roi. La mère se
l’est dit, sans doute : peut-être l’a-t-elle espéré ; mais participer au
complot contre Odenath eût été conspirer contre elle-même. Mæonios avait
assassiné son oncle par vengeance, pour prendre sa place et non pour la
laisser à la reine. Il n’avait pas été non plus nécessaire de le pousser à se
défaire d’Hérodès, qu’Odenath avait associé à l’empire[53] : le
premier crime rendait le second nécessaire, et nous accordons que la
belle-mère du jeune prince dut voir sans chagrin cette mort, qui délivrait
son fils d’un concurrent. La tragédie accomplie, elle souleva contre le meurtrier
les soldats qui l’avaient proclamé roi et qui, sans doute pour un peu d’or,
portèrent sa tête aux pieds de Zénobie ; après quoi ils saluèrent du titre
d’auguste son fils aîné Waballath et de celui de césar les deux autres[54]. Elle les montra
au peuple, à l’armée, revêtus de la pourpre romaine, et elle garda la réalité
du pouvoir avec le titre de basilissa,
reine, l’équivalent sans doute, pour les Palmyréens, du nom d’augusta.
Au milieu de la confusion où l’on vivait depuis bientôt
quarante ans, nul ne s’étonnait que tant de césars sortissent d’une ville
arabe : il en était venu de pires lieux. Mais ce qui devait paraître étrange,
c’était de voir ces enfants du désert, qui ont toujours retenu la femme dans
une condition inférieure, courber la tête sous cette main douce et ferme.
L’Orient, il est vrai, avait tant de déesses régnant au ciel, qu’il pouvait,
sans trop grande résignation, laisser régner des femmes sur la terre[55], et ses légendes
lui parlaient toujours de Sémiramis, la puissante souveraine de Babylone, de
Didon, la glorieuse Carthaginoise, et de cette reine de Saba qui avait voulu
contempler dans sa splendeur le roi des Juifs, fondateur de Tadmor. Zénobie
se plaisait elle-même à rappeler le souvenir de Cléopâtre, dont elle avait la
beauté et la puissance, mais dont elle n’eut peut-être pas, à la dernière
heure, la résolution virile[56]. Sa cour fut
calquée sur celle des empereurs, avec des adorations orientales empruntées à la Perse, que Dioclétien
allait imiter, et le diadème royal, qu’il porta. Le bras nu, le casque en
tête, elle haranguait ses troupes d’une voix mâle et sonore, faisait route
avec elles, habituellement à cheval, quelquefois à pied, et tenait tête à ses
généraux en de longs festins, où pourtant elle gardait son rang et sa
dignité. Aurélien lui rendit justice : Ceux
qui disent que je n’ai vaincu qu’une femme ne savent pas quelle était cette
femme, ni combien elle était prudente dans les conseils, persévérante dans
les décisions, ferme avec les soldats et, suivant les circonstances, libérale
ou sévère. C’est par elle qu’Odenath a vaincu les Perses, et c’est par
crainte de ses armes que les Arabes, les Sarrasins et les Arméniens se sont
tenus en repos[57].
Zénobie était donc un sérieux adversaire. Elle s’était
proposé d’ajouter à son empire oriental deux régions qui devaient en être les
postes avancés et les boulevards : l’Égypte, où elle envoya une armée qui
s’empara d’Alexandrie, et l’Asie Mineure, dont les peuples, qui ne savaient pas dire non, acceptèrent sa
domination. Les Bithyniens seuls s’y refusèrent, et ce refus compromettait
tout : car la Bithynie,
baignée par la Propontide
et le Bosphore, était la grande route des armées pour passer d’Europe en
Asie, et cette route restait ouverte à Aurélien.
L’affaire d’Égypte eut de brillants commencements.
L’historien Zosime parle d’une armée de soixante-dix mille hommes qui se
serait emparée du pays, ou tout au moins des provinces du Nord. Un général du
nom de Probus[58]
avait eu la charge de courir sus aux pirates qui, à la suite du désordre
produit par la grande invasion gothique, infestaient les eûtes de l’Asie
Mineure et de la Syrie
; il débarqua, avec ce qu’il avait de troupes, dans le Delta, où les
Palmyréens n’avaient laissé qu’une garnison de cinq mille hommes, grossit sa
petite armée de quelques volontaires, et allait avoir raison des troupes de
Zénobie, quand il se laissa surprendre près de Memphis. Tombé aux mains de
l’ennemi, il se tua[59], et la reine
resta maîtresse de la basse Égypte.
Des monnaies alexandrines portent les têtes d’Aurélien et
du fils de Zénobie, comme s’ils eussent été deux collègues, et la plus
récente, où est marquée la septième année du règne de Waballath, montre que
cette situation dura jusqu’en 272
[60].
Au printemps de cette année, Aurélien quitta l’Italie avec
une puissante armée, pour aller régler les affaires d’Asie. Chemin faisant,
il nettoya l’Illyrie, la
Thrace et la
Mœsie des bandes gothiques qui s’y trouvaient encore, ou
qui y étaient rentrées ; il en poursuivit une au delà du Danube, et se fit
livrer en otage un certain nombre de jeunes filles nobles, qu’il interna à
Périnthe. Il écrivit au légat de la
Thrace de fournir pour leur entretien une certaine somme,
mais de les réunir en communautés de sept personnes, pour que la dépense fût
moins onéreuse à la république, tout en permettant à ces jeunes filles de
vivre plus à l’aise. On a vu comment ces otages servaient la politique
impériale : une d’elles épousa un général romain ; les autres firent sans
doute de même : l’empereur fournissait la dot.
Dans la
Bithynie, Aurélien fut reçu en libérateur ; les hostilités
commencèrent chez les Galates, où il fallut prendre Ancyre de vive force. Une
des principales villes de la
Cappadoce, Tyane, qui couvrait la passe cilicienne dans le
mont Taurus, aurait fait une longue résistance si un de ses plus riches
citoyens n’avait indiqué un point mal fortifié et mal gardé. Aurélien fit
mourir le traître, sans toutefois confisquer ses biens, vertu rare chez les
princes de ce temps. Les soldats s’attendaient au pillage de cette riche cité
: l’empereur le leur refusa. Apollonius de Tyane avait encore ses dévots ; le
biographe d’Aurélien en était un, et il prétend qu’une apparition du héros
empêcha le prince de détruire la ville. La politique conseillait cette
modération, et Aurélien comprenait que, dans ces temps troublés, il fallait
de l’indulgence envers ceux qui ne savaient de quel côté était le droit et où
devait aller l’obéissance[61]. Quand il eut
raconté qu’Apollonius interdisait le sac de sa ville natale, les soldats, qui
auraient peut-être résisté au prince, n’osèrent résister à l’homme divin, et un heureux mensonge sauva
une grande cité.
Les passes du Taurus n’étaient point gardées[62], les légions
descendirent en Cilicie, contournèrent le golfe d’Issus, et, arrivées aux
Pyles Syriennes, découvrirent à leurs pieds le lac d’Antioche, la ville
elle-même, mollement couchée au bord de l’Oronte, et Daphné, le sanctuaire
des dévotions licencieuses. Zénobie s’y tenait avec une partie de sa
cavalerie. Une action, qui ne semble pas avoir été bien sanglante[63], livra la ville
aux Romains ; ils y entrèrent, tandis que les Palmyréens se retiraient dans
la direction de Chalcis. Aurélien continua son système de clémence. Beaucoup
d’habitants d’Antioche, craignant d’être traités en partisans de la reine, avaient
suivi l’armée arabe ; une proclamation leur garantit la vie et les biens :
presque tous rentrèrent.
Dans une autre affaire, à laquelle on a donné beaucoup de
retentissement, il montra le même esprit de conciliation. Paul de Samosate
cumulait à Antioche les fonctions d’évêque et d’intendant des finances pour
le compte de Zénobie[64]. La ville
contenait beaucoup de juifs et de chrétiens ; parmi les derniers se
trouvaient des hommes qui, tout en admettant l’Évangile, rejetaient la
divinité du Christ, ou du moins qui l’entendaient autrement que l’Église.
Selon eux, Jésus n’était qu’un homme en qui l’Esprit de Dieu, le Logos, était descendu comme il avait été envoyé
à Moïse et aux prophètes[65]. Ils
reconnaissaient donc l’union du Verbe divin et de l’humanité dans le Christ,
et accordaient qu’il méritait d’être appelé Dieu. Niais cette tentative
d’explication rationnelle ruinait le dogme du Dieu fait homme et diminuait la
fécondité religieuse du christianisme. Paul pensait comme eux. En 264 sa foi
avait déjà paru suspecte ; cependant un nombreux synode d’évêques asiatiques,
de prêtres et de diacres, s’étant réuni pour examiner sa doctrine, n’avait pu
y trouver d’hérésie. Cinq ans après, ses adversaires convoquèrent une autre
assemblée où vinrent soixante-dix évêques, qui le retranchèrent de la
communion des fidèles. Une lettre synodale, adressée aux évêques de Rome et d’Alexandrie, à tous les évêques,
prêtres et diacres formant l’Église qui est sous le ciel, leur
annonça la déposition de l’évêque d’Antioche. Paul, soutenu par Zénobie, n’en
conserva pas moins la maison épiscopale. La cause fut portée devant Aurélien,
qui, avec un bon sens dont il faut lui tenir compte, se garda de prononcer
lui-même, encore moins de se rappeler, à propos de ces disputes, qu’il existait
des édits impériaux contre les chrétiens. Ce sont
affaires d’évêques, dit-il : que
celui-là conserve la maison épiscopale avec qui les évêques de Rome et
d’Italie resteront en communion. Le frère de Sénèque, le tribun de
Jérusalem, avait aussi répondu, au sujet de saint Paul, accusé par les juifs
: Je ne suis pas juge de ces sortes de choses.
L’honnête et vaillant soldat dont nous écrivons l’histoire avait de lui-même
retrouvé cette vérité de bon sens que tant d’empereurs ont méconnue et
méconnaîtront encore[66]. Il en
recueillit aussitôt le fruit. Les amis de l’évêque avaient été, comme lui,
les partisans de la reine ; sans les frapper, Aurélien les punissait, et, du
même coup, il se conciliait la communauté chrétienne, qui était nombreuse
dans cette grande cité.
On a voulu voir, dans le renvoi qu’il prononça, une
reconnaissance par le prince de la primauté du siège romain. Il était naturel
qu’Aurélien, ayant à faire décider un point de doctrine entre les chrétiens,
s’adressât aux évêques de la métropole de l’empire, et qu’il constituât les
chefs des communautés chrétiennes d’Italie arbitres du différend, sans
attacher à cette affaire d’autre importance. Son jugement n’en constituait
pas moins un précédent fort utile pour l’autorité pontificale.
Toutes choses réglées à Antioche, Aurélien se mit à la
poursuite de l’ennemi. Il en atteignit l’arrière-garde non loin de Chalcis et
la délogea d’une hauteur où elle s’était établie. Les Palmyréens ne
s’arrêtèrent plus que sous les murs d’Émèse ; Zénobie y avait réuni soixante-dix
mille hommes, appuyés à une place qui avait été certainement fortifiée, et
ayant devant eux une large plaine propre aux charges de leur cavalerie. La
bataille, cette fois, fut acharnée. Chez les uns, la vieille gloire de Rome ;
chez les autres, la gloire récente de Palmyre, animaient tous les cœurs. Un
moment Aurélien put craindre de voir ses légions fléchir sous le choc : sa
cavalerie fut presque détruite ; mais une charge vigoureuse, qu’il mena
lui-même contre le centre de la ligne, trop étendue, de l’ennemi, décida de
la victoire. Elle avait été si chèrement achetée, que les Romains ne furent
pas en état de poursuivre les vaincus. Au plus fort du combat, Aurélien avait
voué un temple au Soleil, et l’on raconta dans la suite que le dieu avait été
vu au milieu. des légions, raffermissant leurs lianes ébranlées. Le Soleil
était la grande divinité de Palmyre : il avait donc abandonné son peuple ;
mais les dieux se mettent toujours du côté des gros bataillons et, par un
sentiment fait à la fois d’orgueil et d’humilité, les victorieux se plaisent
à transformer en assistance divine l’aide qu’ils ont trouvée dans leur
courage[67].
Dans un conseil de guerre que Zénobie avait tenu à Émèse,
la retraite sur Palmyre avait été décidée. On comptait que la lourde armée
romaine ne pourrait pas traverser le pays de la
soif, ou du moins qu’elle y vivrait difficilement, exposée qu’elle
serait aux continuelles attaques des nomades. Les brigands
de Syrie, comme Vopiscus les appelle, firent en effet beaucoup de
mal aux Romains, mais ne les empêchèrent pas d’arriver devant la capitale du
désert. Elle était environnée d’un fossé profond et d’une muraille couverte
d’innombrables machines de guerre, qui lançaient incessamment des flèches,
des dards et des feux[68]. L’empereur ne
s’était pas attendu à une aussi énergique défense. En arrivant en vue de la
place, il avait écrit à la reine : Aurélien,
empereur du monde romain et vainqueur de l’Orient, à Zénobie et à ceux qui
sont engagés dans sa cause. Vous auriez dû faire de vous-mêmes ce que je vous
prescris par cette lettre. Je vous ordonne de vous rendre, sous la promesse
de vous laisser vivre. Vous, Zénobie, vous vous retirerez, avec votre
famille, dans l’endroit que je vous désignerai, d’après l’avis du vénérable
sénat. Vous abandonnerez au trésor de Rome ce que vous aurez de pierreries,
d’or, d’argent, de soie, de chevaux et de chameaux. Les Palmyréens
conserveront leurs droits[69].
La réponse fut aussi fière : Zénobie,
reine de l’Orient, à Aurélien auguste. Jamais personne n’a osé demander ce
qu’exige votre lettre. C’est le courage qui décide de tout à la guerre. Vous
voulez que je me rende, comme si vous ne saviez pas que la reine Cléopâtre a
mieux aimé mourir que d’être redevable de la vie à un maître. J’attends
incessamment les secours des Perses ; j’ai pour moi les Sarrasins et les
Arméniens. Des voleurs de Syrie ont battu votre armée, Aurélien ; que sera-ce
lorsque nous aurons reçu les renforts qui nous viennent de tous les
côtés ? Alors vous quitterez ce ton superbe avec lequel vous exigez ma
soumission, comme si vos armes étaient partout victorieuses[70].
Après cet échange de paroles irritantes, il ne restait
qu’à forcer la ville ou à la réduire par la famine. L’armée romaine investit
la place. Zénobie comptait sur la
Perse, mais la
Perse venait, en trois ans, de changer trois fois de
monarque, au milieu de conspirations des grands et de querelles religieuses
qui agitaient les peuples. Le vainqueur de Valérien, Sapor, était mort en
271. Son fils, Hormisdas, un pacifique, régna quatorze mois, et son
successeur, Bahram, le bienfaisant, moins de quatre années. D’Hormisdas on
raconte un trait digne des Mille et une nuits. Soupçonné de s’être mis
d’intelligence avec des satrapes, mécontents de ne pas voir finir le règne de
Sapor qui durait depuis trente ans, il se coupa la main et l’envoya à son
père en signe de sa fidélité. La coutume ne voulait pas qu’un prince mutilé
pût régner ; Sapor l’oublia pour honorer le courage de son fils, qu’il appela
au trône après lui. Cette légende a protégé la mémoire d’Hormisdas : à Bain
Hoormuz, qu’il avait bâti, les Persans montrent encore un oranger planté par
lui, disent-ils et qui est l’objet de leur vénération[71].
Bahram régnait quand Aurélien parut devant Palmyre. Mais
le royaume était troublé par les prédications de Manès, qui cherchait à
fondre en une seule doctrine la religion du Christ et celle de Zoroastre. Les
peuples, la cour même, se divisaient entre l’ancien et le nouveau culte.
Sapor avait banni le sectaire ; Hormisdas le favorisa. Les mages, inquiets
pour leur autorité religieuse, reprirent leur empire sur l’esprit de Bahram,
qui condamna Manès à être écorché vif, et fut, peu de temps après, assassiné
par un partisan du réformateur. Cette double tragédie est postérieure au
siège de Palmyre ; mais ces divisions expliquent la prudente attitude de ceux
qui, naguère, tenaient un empereur romain prisonnier. Ils se contentèrent
d’envoyer du côté de Palmyre quelques faibles secours, qui furent
interceptés. Pour l’Arménie, nous avons dit ailleurs les raisons qui lui
faisaient, de l’amitié de Rome, une nécessité. Quant aux Arabes et aux
Sarrasins, ils furent intimidés ou achetés, et il n’y fallut ni beaucoup de
force ni beaucoup d’or.
Zénobie resta donc seule. Lorsqu’elle sut qu’elle n’avait
plus à compter sur ceux qu’elle croyait ses alliés, et qu’elle vit les vivres
diminuer rapidement, elle se résolut à fuir chez les Perses, dans l’espoir de
les amener à faire un effort vigoureux, tandis que ses guerriers tenaient
encore. Montée sur un dromadaire rapide, elle se dirigea sur l’Euphrate et
elle allait en toucher le rivage, quand les cavaliers lancés à sa poursuite
l’atteignirent. Cette triste nouvelle jeta la confusion dans Palmyre.
Quelques-uns voulaient résister encore, le plus grand nombre jeta ses armes
et ouvrit les portés. Aurélien ne changea rien aux conditions qu’il avait
d’abord proposées ; il traita la ville avec douceur, lui laissa ses droits et
se contenta de prendre les trésors de Zénobie.
De retour à Émèse, on les troupes purent se dédommager
avec les ressources d’une riche province des privations qu’elles venaient de
souffrir, l’empereur constitua un tribunal pour juger Zénobie et ses
ministres. Dans sa première entrevue avec Aurélien, elle n’avait pas démenti
sa fierté. Comment as-tu osé, lui
demanda-t-il, outrager la majesté des empereurs
romains ? Et elle lui répondit : Je te
reconnais pour empereur, toi qui sais vaincre ; mais les Gallien, les Auréole
et les autres ne l’étaient pas. La flatterie ne dépassait pas la
juste mesure. On dit cependant qu’au tribunal elle rejeta lâchement sur ses
conseillers la responsabilité de la guerre. Ce doit mètre une calomnie des
vainqueurs ou une habileté d’Aurélien. Les soldats voulaient du sang, et il
était bien résolu à ne pas verser celui de la reine, car il n’entendait pas
que la nouvelle Cléopâtre manquât à, son triomphe. Les juges s’arrangèrent
pour ne trouver coupables que les serviteurs : ils furent envoyés à la mort.
Parmi eux était Longin, qui marcha au supplice avec la sérénité d’un sage (275).
La chute de la reine de l’Orient avait eu un grand
retentissement, et l’abandon où l’avaient laissée tous ses alliés montrait la
crainte qu’inspirait l’empire ressuscité. Aurélien avait donc quitté la Syrie l’esprit libre de
toute inquiétude, et déjà il avait traversé l’Asie Mineure, même une partie
de la Thrace,
quand la nouvelle lui arriva que les Palmyréens s’étaient soulevés, que la
garnison romaine et son chef Sandarion étaient égorgés, qu’enfin un certain
Antiochus avait été proclamé empereur[72]. Palmyre n’avait
pu se résigner à retomber, du rang de cité impériale, dans son ancienne
condition de ville marchande. Elle avait bu un moment à la coupe des
grandeurs, elle en était encore enivrée, et dans ses rêves revenait toujours
l’image de ses conducteurs de caravanes passés césars de Rome. L’acte de
folie qu’elle venait de commettre fut cruellement expié. La colère d’Aurélien
était terrible : on a déjà vu sa sévérité à Rome ; à Palmyre, il fut d’autant
plus impitoyable qu’il y avait été plus clément. Nous ne savons rien de
l’expédition qu’il chargea de sa vengeance ; on voit par une de ses lettres
que ce fut comme l’exécution de tout un peuple. Aurélien
auguste à Ceionus Bassus. Il ne faut pas que les soldats fassent plus
longtemps usage de leurs glaives : on a assez tué, assez exterminé de
Palmyréens. Nous n’avons pas fait grâce aux mères ; nous avons tué les
enfants, égorgé les vieillards, massacré les habitants des campagnes. A qui
laisserons-nous désormais le pays ? A qui laisserons-nous la ville ? Il faut
épargner le petit nombre de ceux qui sont restés et les supposer corrigés par
la vue de tant de supplices. Je veux qu’on rétablisse tel qu’il était le
temple du Soleil, pillé par le porte-aigle de la troisième légion, par les
porte-étendards, par le draconnaire[73] et par ceux qui donnent du cor et du clairon. Vous avez,
dans les cassettes de Zénobie, 300 livres pesant d’or ; vous en avez 4.800
d’argent, provenant des biens des Palmyréens ; enfin vous avez les pierreries
royales. Faites servir toutes ces richesses à l’ornement du temple ; vous
ferez ainsi une chose agréable aux dieux immortels et à moi. J’écrirai au
sénat d’envoyer un pontife pour faire la dédicace de ce temple[74].
Palmyre ne s’en releva pas. Les familles qui avaient fait
sa fortune avaient sans doute péri dans le massacre, et ceux des habitants
qui survécurent ne surent pas les remplacer. Le commerce s’habitua à prendre
d’autres routes ; les sables envahirent l’oasis dépeuplée, et, durant dix
siècles, on ignora jusqu’au lieu où la reine de l’Orient avait bâti ses
palais de marbre ; mais une source qui coule encore a peut-être gardé, à
travers les âges, le nom de celui qui fit cette grande ruine[75].
Après la tragédie d’Émèse, Aurélien s’était hâté de
regagner l’Europe, sans descendre en Égypte, d’où un aussi vaillant homme que
lui-même, Probus, avait chassé les Palmyréens. Croyant ce pays pacifié, il
n’avait pas jugé à propos de s’y montrer ; mais, lorsqu’on sut qu’il était en
route pour la Gaule,
un négociant enrichi dans le commerce du papyrus d’Égypte et des denrées de
l’Inde, le Grec Firmus, que la fortune politique des cheiks de Palmyre avait
ébloui, voulut jouer leur rôle. Il acheta le secours des Blemmyes et des
Sarrasins, souleva Alexandrie toujours prête pour une émeute, et arrêta la flotte
frumentaire, ce qui était grave. Il avait pris la pourpre au moment où
Palmyre se révoltait, doit l’on peut conclure que les deux mouvements avaient
été combinés[76].
Aurélien n’eut point de peine à enfermer l’usurpateur dans un des trois
quartiers d’Alexandrie, le Bruchium, qu’un mur séparait du reste de la ville
et où César avait si longtemps bravé toutes les forces de l’Égypte. C’est là
qu’étaient le palais des Ptolémées, le Muséum, qu’un long portique, construit
avec les marbres les plus précieux, réunissait à la résidence royale, et le
temple des Césars, bâti au lieu où s’élevaient naguère les deux obélisques
appelés les aiguilles de Cléopâtre[77]. Aurélien n’entreprit
pas de forcer cette place d’un genre particulier ; mais la faim lui livra
Firmus, qu’il fit mettre en croix ; il démantela le Bruchium, le palais des
rois et tout ce qui aurait pu servir d’abri à une nouvelle émeute, pour que
l’approvisionnement de Rome ne restât pas à la merci de cette séditieuse cité[78]. Cette fois, du
moins, sa colère porta plus sur les monuments que sur les hommes[79] ; mais il
augmenta d’un douzième l’impôt frumentaire de l’Égypte et lui imposa un
nouveau tribut annuel : l’envoi à Rome d’une certaine quantité de verre, de
papyrus, de lin, de chanvre et d’autres produits du pays[80].
Zénobie captive, le brigand
Firmus expirant sur la croix et la populace d’Alexandrie contenue
par une garnison romaine, l’ordre allait renaître dans l’Orient, deux fois
parcouru en quelques mois par une grande armée victorieuse. De toutes parts
affluaient les ambassades, les protestations d’amitié et les présents, entre
autres, comme don du roi de Perse, un manteau de pourpre qui semble avoir été
l’aïeul de nos cachemires de l’Inde[81]. Rien ne
retenait donc Aurélien de ce côté, et il était libre de tourner enfin son
attention vers les provinces de l’Occident, où Tetricus régnait depuis plus
de cinq ans[82].
Victoria, la mère des camps, était morte[83], et son âme
virile ne soutenait plus le courage chancelant du débonnaire sénateur qu’elle
avait fait empereur des Gaules. Établi à Bordeaux, pour ne pas être troublé
dans son repos par les bruits de la frontière et les cris des légions, il
attendait qu’Aurélien le débarrassât de sa royauté. Des médailles le
représentent vêtu, non pas de la cuirasse, mais de la toge, et portant d’une
main un sceptre, de l’autre une branche d’olivier où une corne d’abondance.
Lorsque, en touchant leur solde. les soldats voyaient l’empereur figuré sur
les monnaies avec les attributs de la paix et une légende signifiant que la
modération dans le succès fait la grandeur des princes, ils devaient
considérer ce pacifique comme ne méritant pas de commander à des hommes. Ils
le gardaient pourtant leur orgueil se plaisait à conserver cet empire des Gaules
qui était leur ouvrage. Eux et leurs chefs avaient dans ces provinces leurs
habitudes, leurs intérêts, et ils se disaient que ce n’était pas Tetricus qui
troublerait cette tranquille existence, en les menant il l’autre bout de
l’empire contre les Perses ou les Blemmyes. D’ailleurs la Gaule était aussi leur
domaine ; ils s’y conduisaient en maîtres, avec l’insolence d’une soldatesque
commandant à ses chefs. Pour résister à leurs exigences, Autun ferma ses
portes ; ils l’assiégèrent pendant sept mois, sans que Tetricus fit rien pour
mettre un terme à cette guerre étrange. Claude, qu’Autun implora, était trop
occupé par les Goths pour entendre ces plaintes lointaines ; la malheureuse
ville fut mise à sac[84], et beaucoup de
ses citoyens périrent (269).
Un d’eux s’enfuit jusqu’au pied des Pyrénées, à Tarbes que traverse l’Adour et qui entend au loin mugir l’Océan
irrité ; il s’y maria et fut l’aïeul du poète Ausone, une des
dernières renommées littéraires de l’empire[85]. D’autres cités
pensaient comme Autun : une inscription de Barcelone atteste la fidélité de
cette ville à Claude et à l’empire[86].
Le dévouement intéressé des légions gauloises ne rassurait
point leur prince. On peut croire qu’il avait par de secrets messages recherché
la confiance de Claude, et nous savons qu’il écrivit à Aurélien en citant Virgile
: Héros invincible, délivre-moi de ces méchants[87]. L’entente
s’établit aisément entre deux hommes, dont l’un ne voulait pas de collègue
tandis que l’autre aspirait à redevenir sujet. Quand les armées se
rencontrèrent près de Châlons-sur-Marne, Tetricus communiqua son ordre de
bataille à Aurélien et, au moment de l’action, abandonna ses troupes, qui se
débandèrent[88].
L’empire entier se trouva réuni sous un seul chef (274) ; il y avait vingt-et-un ans
que cela ne lui était arrivé.
Aurélien célébra ce grand événement par un triomphe, où il
essaya de surpasser la magnificence de ces anciennes solennités, que depuis
longtemps Rome n’avait pas revues[89]. Lentement
passèrent, sous les yeux de la foule éblouie d’innombrables couronnes d’or offertes
par les villes romaines ; vingt éléphants, des girafes, des bêtes fauves
apprivoisées ; le char d’un roi des Goths traîné par quatre cerfs, celui de
la reine de Palmyre fait d’argent et d’or ciselés, où brillaient mille
pierres précieuses ; des tableaux représentant les batailles gagnées, les
cités prises et l’image des nations vaincues. Puis venaient le sénat, les
magistrats et les pontifes ; le peuple en toges blanches et les collèges, ou
corporations, précédés de leurs bannières ; l’armée avec ses enseignes ; les
cataphractaires aux pesantes armures et les soldats couverts de leurs
décorations militaires ; enfin huit cents couples de gladiateurs destinés aux
jeux, suivis de la foule des captifs de toutes les nations limitrophes de
l’empire, les uns enchaînés, les autres portant les dépouilles conquises, et,
parmi eux, des femmes de race gothique qui avaient été prises combattant au
milieu de leurs pères et de leurs époux. Mais tous les regards étaient pour
Tetricus et son fils, qui marchaient vêtus d’une chlamyde écarlate et portant
les braies gauloises pour qu’on reconnût bien les empereurs de la Gaule. Zénobie
les suivait chargée de pierreries, une chaîne d’or aux pieds, une autre aux
mains, une troisième au cou ; et, suprême dérision, c’était un bouffon persan
qui soutenait ces chaînes dont le poids l’accablait, pour rappeler à la reine
déchue en quel vain espoir elle s’était confiée. Aurélien jouissait
brutalement de sa victoire. Du moins, plus clément que Marius et que César,
il ne fit point, lorsqu’il monta au Capitole, le signe fatal qui eût été
l’ordre de conduire les captifs au Tullianum, où Jugurtha avait précédé
Vercingétorix[90].
La fête terminée, il rendit à Tetricus ses honneurs, lui
donna un palais sur le mont Cælius et le nomma correcteur de la Lucanie[91], en lui disant
que mieux valait gouverner une province italienne que de régner au delà des
Alpes, ce à quoi l’ancien auguste ne contredisait pas. Il l’appelait souvent
son collègue, quelquefois son compagnon d’armes, même imperator, et ces distinctions autorisèrent le
sénat à placer Tetricus, après la mort d’Aurélien, parmi les divi[92]. Vercingétorix
avait autrement fini ; mais il avait autrement vécu.
A Zénobie, Aurélien donna aussi une villa près de Tibur,
au voisinage de celle d’Hadrien. Elle y vécut comme une grande dame romaine ;
ses filles entrèrent dans les plus illustres maisons, et, deux cents ans plus
tard, de nobles personnages se disaient descendants de la reine de Palmyre ;
parmi eux l’on compte un contemporain de saint Ambroise, saint Zénobe, évêque
de Florence[93].
Le triomphe avait été la fête du prince, le peuple eut
ensuite les siennes : représentations scéniques, jeux du cirque, grandes
chasses, naumachies, combats de gladiateurs et distributions gratuites.
Aurélien décida que, à l’avenir, les citoyens recevraient chaque jour un pain
de fleur de farine et de la viande de porc. Toutes les distributions furent
augmentées d’une once, c’est-à-dire d’un douzième. Il voulait même acheter
dans l’Étrurie des terres qu’il aurait fait planter de vignes, afin de donner
chaque jour au peuple une mesure de vin, comme on lui donnait une mesure
d’huile. Un conseiller, plus sage que l’empereur, combattit ce projet. Après cela, dit le préfet du prétoire, il ne nous restera qu’il leur donner aussi des poulets et
des oies. Aurélien céda, mais fit vendre par le fisc du vin à prix
réduit, ce qui était d’une économie politique presque aussi mauvaise. Après
la nourriture, le vêtement : il distribua des tuniques de lin d’Afrique et
des bandes d’étoffes pour qu’aux jeux ils pussent
marquer, en les agitant, leur faveur aux héros du cirque[94].
Il faut remarquer encore, au sujet de ces gratifications,
qu’elles n’étaient pas un acte de basse adulation pour captiver le populaire.
La force d’Aurélien était aux armées, elle n’était pas à Rome, et, malgré ses
libéralités aux Romains, il s’inquiétait peu de leur bon ou de leur mauvais
vouloir. On a vu, dans tout le cours de cette histoire, que la plèbe n’exerça
sous l’empire aucune action politique, et Aurélien ne faisait que continuer,
en le développant, un usage républicain. Après la conquête de la Macédoine, le
sénat avait supprimé l’impôt foncier ; après la reconstitution de l’empire,
Aurélien augmentait les rations de vivres. C’était, sous deux formes
différentes, le même avantage pour les citoyens, seulement la première mesure
avait été surtout favorable aux riches, et la seconde l’était aux pauvres.
Puisqu’on gardait la fiction que les citoyens habitant la capitale
représentaient le vieux peuple romain, et qu’on ne pouvait ; comme aux premiers
jours de la république, leur donner des terres par une loi agraire, ou leur
donnait l’équivalent en vivres, et, dans la réalité, on leur donnait moins.
A Émèse, Aurélien avait retrouvé le dieu de sa mère, et il
lui avait attribué sa victoire. Les extravagances d’Élagabal n’avaient pas
discrédité cette divinité ; elle était en grand honneur, et c’était naturel :
les païens penchant de plus en plus vers la croyance il l’unité divine, le
soleil, qui répand la lumière, la chaleur et la vie au sein de la nature
entière, leur semblait l’auteur de tous ces biens[95]. Aurélien lui
avait offert dans Émèse de pompeux sacrifices ; à Rome, il créa en son
honneur un nouveau sacerdoce[96] ; il lui bâtit
un temple, qui passa, aux yeux des contemporains, pour le plus magnifique de
Rome, et il l’était surtout par les richesses qui y furent déposées : une
grande quantité de pierres précieuses et 15.000 livres pesant
d’or. Par crainte de la jalousie des autres dieux, Aurélien fit des dons dans
chacun de leurs temples.
Tant de prodigalités, sans parler de l’argent donné au peuple
et aux soldats, ni de la dépense pour les fortifications de Rome, pour le
curage du Tibre, pour les quais, qu’il éleva sur certains points, le long du fleuve,
pour la construction de thermes sur sa rive droite, pour celle d’un forum à
Ostie, pour l’augmentation de la flottille qui apportait à Rome le blé des
provinces frumentaires, forcent d’admettre que les guerres heureuses qu’il
avait conduites avaient mis de grandes ressources dans ses mains. Les historiens
ne citent que le pillage de Palmyre ; mais Alexandrie a dû fournir un riche
butin ; Antioche, Ancyre, Tyane, les villes de Syrie, alors si prospères, de
grosses rançons ; et la Gaule
a certainement payé, comme l’Égypte, sa rentrée dans l’empire, par un accroissement
d’impôt.
L’économie d’Aurélien lui procura d’autres ressources. Il
vivait simplement et voilait qu’autour de lui on vécût de même. Il obligea
ses esclaves à garder la tenue modeste qu’ils avaient avant son avènement, et
l’impératrice à veiller aux soins du palais ; il lui refusa un manteau de
soie, parce qu’une livre de soie se vendait alors une livre d’or, et il
faisait à ses amis des cadeaux qui leur donnaient l’aisance, mais ne leur
donnaient pas la fortune, afin que l’envie n’eût pas de prise contre eux[97]. Lui-même n’eut
jamais un vase d’argent qui pesât plus de 50 livres ; les dieux
héritèrent des présents qu’on lui fit : toutes les magnificences étalées à
son triomphe furent portées dans les temples, comme aux anciens jours de la
vertu républicaine, afin de servir de ressources en cas de péril extrême.
Les règlements somptuaires étaient une maladie romaine ;
il en fit beaucoup[98]. Ainsi, pour
parer à la pénurie des métaux précieux, il interdit l’emploi de l’or sur les
meubles et les vêtements. Son biographe va jusqu’à prétendre qu’il renouvela
le sénat de femmes auquel Élagabal avait donné la charge de régler la
toilette des matrones : puérilité que ce soldat aurait dû laisser au Syrien
efféminé. Mais il déployait une grande pompe dans les solennités, où il se
montrait avec une couronne sur la tête et les vêtements couverts d’or et de
pierreries. Ce faste oriental était le goût du jour, et cette mode se
retrouve jusque dans les œuvres d’art dont elle marque la décadence ;
Dioclétien la portera bien plus loin encore. Ces deux princes croyaient
qu’ils seraient plus respectés si un cérémonial imposant marquait davantage
aux yeux la distance du sujet au prince.
Ce faste, souvent regardé comme nécessaire, et qui l’est
dans un certain état social, n’a jamais protégé que ceux qui se protégeaient eux-mêmes
par leur valeur personnelle, ou que la foi des peuples enveloppait d’une
garde invisible et sûre. A ce compte, Aurélien aurait pu s’en passer,
puisqu’il avait pour lui le peuple et les soldats ; mails un prince absolu
n’est jamais l’abri d’une conspiration, et il allait s’en former une dans son
entourage.
La fête magnifique qu’il venait de donner aux Romains
précéda seulement de quelques mois sa mort.
Il employa ce temps à consolider l’œuvre de restauration
qu’il avait si énergiquement poursuivie durant cinq années. Une sédition en
Gaule le ramena dans ce pays[99]. On ignore ce
qu’il y fit. Il est question d’un succès de Probus sur les Francs, vers les bouches
du Rhin, et d’une victoire gagnée sur les Alamans, près de Vindonissa (Windisch), par
Constance Chlore, le jour même où naissait son fils Constantin. Des
traditions postérieures lui attribuent la reconstruction de Dijon et celle de
Genabum, qui aurait pris son nom, Civitas Aurelianorum. C’étaient deux
importantes positions pour le commerce et la guerre : à Orléans, le centre
géographique de la Gaule,
aboutissaient les principales voies militaires du pays, et Dijon était la
grande étape entre la vallée du Rhône et celle de la Seine. Fréjus
et la province Viennoise lui durent peut-être aussi quelque faveur ; des
inscriptions qu’on y a trouvées célèbrent le restaurateur de l’univers.
Aurélien revit sans doute les bords du Rhin, théâtre de
ses premiers succès ; puis il visita ceux du haut Danube, car on le trouve
ensuite dans la
Vindélicie et l’Illyricum. Il voulait s’assurer de l’état
de cette frontière naguère si troublée et où il était bon de montrer de temps
à autre la pompe impériale, surtout lorsque c’était un victorieux qui la
conduisait. Aurélien se proposait de faire davantage et d’aller, jusque dans
Ctésiphon, venger sur les alliés de Zénobie les injures de l’empire. Une
conspiration l’arrêta avant qu’il eût, atteint Byzance.
Les auteurs ecclésiastiques prétendent que la justice
divine prévint ses mauvais desseins contre l’Église[100]. Sa conduite
dans l’affaire de Paul de Samosate, la paix dont les chrétiens jouirent sous
son Revers d’une monnaie règne, ne donnent pas lieu de penser qu’il songeât à
une persécution, et, pour expliquer sa fun, il n’est pas besoin d’user du
moyen avec lequel, dans tous les temps, on a expliqué les catastrophes
soudaines. A l’exemple de Septime Sévère, qu’il semble avoir pris pour
modèle, il maintenait la discipline dans l’administration comme dans l’armée
; il surveillait les agents impériaux dans les provinces et punissait
rigoureusement les concussionnaires, jusqu’à les faire mettre en croix. Ayant
pris en faute un de ses secrétaires, Mnesthée, il le menaça d’un châtiment.
L’affranchi savait que le prince ne parlait jamais en vain. Il contrefit
l’écriture de l’empereur, dressa une liste de personnes connues pour n’être
point dans la faveur d’Aurélien, se plaça lui-même sur cette liste, pour
qu’on y donnât créance, et la communiqua à ceux qui s’y trouvaient inscrits, comme
un ordre de mort qu’il avait surpris et arrêté. Pour prévenir le supplice
auquel ils se croyaient réservés, les prétendus condamnés assassinèrent
l’empereur (en
janvier ou mars 275). Il n’était âgé que de soixante et un ans et en
avait régné cinq.
Il y eut, sous ce règne, une sédition d’un caractère
particulier. On a vu combien, en ce temps-là, les monnaies d’or et d’argent
avaient été altérées. Le chef des monétaires de Rome, Felicissimus, avait
voulu entrer en partage des profits que les princes croyaient faire par cette
détestable opération. On lui donnait bien peu d’or et d’argent pour les
pièces qu’il avait à frapper ; il en mettait moins encore, et il avait sans
doute associé, pour une part dans les bénéfices, ceux qui étaient chargés de
la fabrication. Autrement on ne comprendrait pas comment une sédition éclata
quand Aurélien voulut faire cesser l’abus[101]. Cette révolte
fut terrible : les industriels intéressés au commerce des métaux précieux,
les argentiers, orfèvres, banquiers et tous les manieurs d’argent menacés de
réformes qui changeaient apparemment les conditions du marché, auront fait
cause commune avec les monétaires, et le peuple, comme toujours, s’y mêla,
par haine des gardes de police. Une vraie bataille se livra dans Rome, sur le
mont Cælius ; sept mille soldats y périrent, ce qui suppose un grand carnage
des rebelles.
Nous connaissons fort mal cette affaire[102]. Le sénat y
fut-il mêlé ? Peut-être : car les anciens mentionnent l’exécution
de plusieurs de ses membres sans nous en dire les motifs, et il perdit ce
jour-là le droit, qu’il exerçait depuis Auguste, d’émettre la monnaie de
bronze. Du moins n’en trouve-t-on plus, après Aurélien, portant les lettres S. C. :
preuve que les ateliers sénatoriaux furent réunis, depuis cette année 274, à
ceux du prince[103]. Le biographe
d’Aurélien ajoute que l’empereur fit ensuite frapper de la meilleure monnaie
et retira la fausse de la circulation. Aurélien n’eut pas le temps de mener à
bonne fin cette double opération, que Tacite reprit[104] et qui devint
une des préoccupations de leurs successeurs, nais ne s’acheva que sous
Dioclétien et Constantin.
Ces mesures prouvent la résolution d’Aurélien de mettre
l’ordre en tout. Le même esprit de gouvernement se retrouve en d’autres
actes. Il fit brûler sur le forum de Trajan, comme Hadrien l’avait déjà fait,
les registres contenant les comptes des débiteurs de l’État : mauvaises
créances, pour la plupart irrécouvrables, mais qui faisaient peser sur bon
nombre de particuliers la crainte perpétuelle d’une exécution judiciaire. Les
délations pour infractions aux lois fiscales furent abolies. Les quadruplateurs, toujours si nombreux à Rome, ne
disparurent pas du coup, mais leur industrie détestable cessa d’être
encouragée. Il ne se peut pas que, pour remplir son trésor, l’auteur de ces
mesures ait fait tuer des sénateurs coupables seulement d’être riches.
Cependant on accuse Aurélien de cruauté, et, au quatrième
siècle, ce reproche pesait déjà sur sa mémoire. Assurément il n’était point
doux ; mais de pareils temps ne comportaient pas la douceur, et, dans le
prince chargé de la tranquillité d’un empire, l’indulgence à l’égard des
coupables est une trahison envers les innocents. Pour confirmer le reproche
qu’on lui fait, il faudrait connaître les noms et le nombre de ses victimes,
les motifs ou les prétextes de leur condamnation ; car nous avons appris,
dans le cours de cette histoire, par plus d’un exemple, combien il reste peu
de chose de ces accusations vagues, souvent même contradictoires, quand on
les examine de près. Vopiscus, qui avait conversé avec des contemporains de
l’empereur dont il écrivait la vie, n’ose rien affirmer. On dit, raconte-t-il, que, pour se débarrasser de plusieurs sénateurs, il leur
imputa des projets de révolte ; mais, d’après Jean d’Antioche et
Suidas, de nobles personnages furent condamnés sur les révélations de
Zénobie, ce qui donne à penser que, durant la guerre d’Orient, il s’était
formé à Rome des complots, comme on en avait vu au temps de Sévère, durant la
guerre de Gaule[105]. Un fait
justifiera nos hésitations. Il est certain qu’une catastrophe eut lieu dans
la famille impériale, dont un membre fut mis à mort. Quel était-il ? Ceux-ci
disent la nièce, ceux-là le neveu du prince, et plusieurs soutiennent que
l’un et l’autre périrent. Suivant une quatrième version, la condamnée aurait
été la bru d’Aurélien[106]. Si ce dernier
récit était le vrai, il en faudrait conclure que, par cette exécution,
Aurélien voulut effacer quelque tache faite à l’honneur de sa maison. Dans
tous les cas, ce fut une tragédie domestique dont les motifs durent être
sérieux, Aurélien n’étant point de ces fous qui ensanglantent leurs pénates
pour un caprice.
Titus n’est pas pour nous l’idéal du prince ; aussi ne
reprocherons-nous pas à Aurélien d’avoir frappé des prévaricateurs, comme les
complices de Felicissimus, ou des fauteurs de révolutions, comme ceux qui
avaient noué sans doute des intrigues avec la reine de Palmyre. Nous
l’approuverons d’avoir livré ses affranchis et ses esclaves au juge
ordinaire, quand ils étaient coupables, parce que la domesticité impériale
avait toujours besoin d’être sévèrement tenue, pour ne pas abuser des
nombreux moyens de nuire dont elle disposait ; et nous nous en tiendrons au
jugement de l’empereur Julien, qui n’était pourtant pas favorable à un prince
dont la gloire éclipsait celle de Claude, le chef de sa maison. Dans les
Césars, lorsque Aurélien paraît devant l’aréopage olympique pour y être jugé,
le Soleil prend sa défense : L’accusé,
dit-il aux dieux, est quitte avec la Justice, ou vous avez oublié
mon oracle de Delphes :
On
doit souffrir les maux que l’on a fait souffrir[107].
Ce jugement semble même trop sévère ; car, à côté du droit
rigoureux, Aurélien plaça souvent la clémence pour les égarés. On l’a vu
accorder grâce entière aux habitants d’Antioche et aux Palmyréens après le
premier siège ; arrêter les massacres après le second ; et à Alexandrie,
laisser sortir du Bruchium une partie de ceux qui y étaient assiégés, bien
que leur départ dût permettre de prolonger la résistance. Sa conduite à l’égard
de Tetricus, de Zénobie et d’Antiochus[108] tranche avec
celle de ses prédécesseurs, et il renia bien plus encore les coutumes
romaines lorsqu’il proclama une amnistie pour les délits politiques[109]. C’était
achever dignement la restauration de l’empire que d’effacer les traces de
vingt années de guerres civiles, durant lesquelles il y avait eu, cette fois,
bien plus de malheureux que de criminels.
|