HISTOIRE DES ROMAINS
ONZIÈME PÉRIODE — LES PRINCES AFRICAINS ET SYRIENS (180-235).
CHAPITRE LXXXVIII — COMMODE, PERTINAX, DIDIUS JULIANUS ET LES GUERRES DE SÉVÈRE (180-211).
I. — COMMODE (180-192).Le 31 août fut un jour deux fois néfaste pour l’empire, car ce jour-là naquirent Caligula et Commode. Depuis deux cent dix ans que Rome avait des empereurs, celui-ci était le premier qui eût vu le jour dans la pourpre, porphyrogénète[1] ; mais son règne ne sera point fait pour recommander aux Romains le système de l’hérédité. Il n’avait pas dix-neuf ans quand Marc-Aurèle mourut[2]. Son père lui avait donné les meilleurs maîtres ; une nature ingrate rendit leurs soins inutiles : a l’âge de douze ans, il trouva un jour que son bain n’était pas assez chaud et commanda de jeter le baigneur au four. Le pouvoir absolu dont il hérita si jeune acheva de le perdre, car ceux qu’un ancien appelle les instituteurs de cour[3] prirent bien vite dé l’empire sur ce faible esprit. Ses bustes et ses médailles le représentent avec le regard hébété d’un homme dont jamais l’intelligence n’a été traversée par une pensée virile. Tout à la fois méchant et craintif, il sera cruel quand un mot, un signe, suffiront pour le délivrer de ceux qui lui feront peur. L’empire n’était pas héréditaire, mais les empereurs
voulaient toujours qu’il le fût, et, en l’absence de grandes institutions de
gouvernement, c’était inévitable. Les fils de princes trouvaient donc dans leur
berceau les titres et les honneurs dont quelques-uns eussent été, pour un
citoyen, la récompense d’une longue vie de services publics. A cinq ans,
Commode avait été fait césar ; à quatorze, membre de tous les collèges
sacerdotaux et prince de
L’empire put croire alors que sa domination, ou son
influencé incontestée, régnait sur les deux versants de la vallée du Danube,
depuis la mer Noire jusqu’à Ce fut la dernière fois qu’il parut à la tête des troupes. Heureusement les grandes traditions de guerre n’étaient pas encore perdues, et il restait à Rome des généraux tels que Marcellus, Niger, Pertinax, Albinus et Septime Sévère, qui firent bonne garde contre les Barbares[11]. Il rentra dans Rome le
Les écrivains qui nous ont conservé l’histoire de ce
principat la remplissent de monotones récits d’exécutions sanglantes. On n’y
trouve, pour ce règne de douze années, ni bonne mesure de gouvernement ni
rescrit qui améliore la législation ; rien qui montre le souci de l’intérêt
public ; Commode n’acheva même pas les constructions commencées par son père.
Cependant l’empire tient debout par son propre poids, mole sua stat. Les marchands trafiquent, les
marins naviguent, les ouvriers travaillent, et les gouverneurs veillent sur
les provinces, comme si un prince sage présidait aux destinées de l’empire.
Le fisc accorde encore des subventions pour relever Nicomédie ruinée par un
tremblement de terre[15], pour construire
un gymnase à Antioche, divers monuments à Alexandrie et constituer à Carthage
une flotte africaine, classis Africana,
afin de parer avec les blés d’Afrique à l’insuffisance des récoltes que la
flotte d’Égypte devait apporter à Ostie[16]. Enfin les
soldats continuent de prêter leurs bras pour les travaux publics. Ceux de
Dalmatie relèvent un pont écroulé sur Mais on voit aussi apparaître les symptômes inquiétants. Sous la main faible et violente qui tient les rênes, la discipline romaine se relâche dans tous les ordres[18]. Au milieu de la ville, des émeutes éclatent ; le règne des soldats s’annonce par des séditions ; la guerre religieuse, par des désordres nés auprès des temples, et l’anarchie qui menacera bientôt, de dissoudre l’empire se montre par les insolents succès d’un bandit pillant impunément plusieurs provinces. Enfin l’esprit militaire s’affaiblit : les sénateurs désertent les emplois où il faut prendre l’épée. Un d’eux obtient de Commode d’être dispensé du service militaire[19]. Aux frontières, point de guerre sérieuse durant ces douze
années. Une garnison romaine établie à demeure sur le Kour, dans une
forteresse que Vespasien avait bâtie en ces pays lointains, tenait en respect
les peuples du Caucase et couvrait contre eux l’Arménie[20]. Niger et
Albinus, qui, tous deux, devaient goûter au pouvoir[21] et en mourir,
semblent avoir eu à défendre Commode n’entendit même pas l’écho de ces bruits d’armes lointains. Laisser le souci des affaires publiques à son préfet du prétoire, sauf à lui envoyer, au premier soupçon, un ordre de mort ; afin de n’avoir rien à craindre des provinces, retenir en otages les enfants des gouverneurs[22], et assurer sa sécurité à Rome en accordant toute licence aux prétoriens : c’est à cela qu’il réduisit la science du gouvernement. Quant aux finances, il avait repris le système de battre monnaie avec des condamnations, une sentence capitale entraînant toujours, d’après les plus vieilles lois romaines, la confiscation des biens du condamné ; ou, comme en 188, il annonçait son prochain départ pour un voyage lointain, et, sous ce prétexte, il puisait à pleines mains dans l’ærarium. Ces précautions prises, il s’abandonnait en toute quiétude à sa passion pour les courses du cirque, les chasses et les luttes de l’amphithéâtre. Chacun des tyrans de Rome eut sa folie particulière ou son
vice dominant. Caligula se croyait un dieu ; Néron, un incomparable chanteur.
Dans la bande infâme, Vitellius fut le Silène ; Commode sera le gladiateur.
Il combattit sept cent trente-cinq fois dans l’arène : combats ruineux pour
le trésor, qui payait chacune de ces représentations princières 250.000
drachmes[23]
; combats aussi sans péril, car tout était disposé pour que Mais comme il était facile que la tête tournât à un jeune prince étourdi par cette épaisse fumée d’encens ! Le sénat n’est pas seul à épuiser tout le vocabulaire de la servilité ; le peuple, les soldats, font comme lui, et Commode peut entendre les acclamations des provinces répondant à celles de Rome. Les jeunes gens de Népète se cotisent pour consacrer un monument à Commode le Victorieux. Une monnaie d’Éphèse lui donne, comme autrefois à Hadrien, le surnom d’Olympios[25], et une inscription l’appelle le plus noble, le plus heureux des princes. Dans une autre, l’offrande est faite à l’Hercule romain. Aussi le dieu[26], ne respecte rien sur la terre : il ôte aux mois de l’année leurs noms, pour leur imposer les siens ; il change même ceux de Rome et de Jérusalem, qui deviennent des Colonies Commodiennes. Son règne est l’âge d’or ; du moins l’on date ainsi ses lettres impériales, ex sæculo aureo, et son jour de naissance doit être fêté par tout l’empire. Mais la fête est pour lui seul, car ce jour-là, raconte Dion, il nous faut, nous, les sénateurs, nos femmes et nos enfants, lui donner chacun deux aurei, et les décurions de toutes les villes lui doivent cinq deniers. (LXXII, 16) Sa plus haute ambition était de ressembler au fils d’Alcmène,
qui, pour lui, n’était que le dieu de la force brutale. On portait devant lui,
parles rues, la massue et la peau de lion du vainqueur de l’hydre ; à l’amphithéâtre,
on les posait sur une estrade dorée, et parfois il s’en servait. Dion raconte
que, ayant réuni bon nombre d’estropiés et d’infirmes pris au hasard dans
Rome, il les fit affubler en monstres de Nous voilà donc encore une fois en présence d’un fou à qui l’ivresse de la jeunesse et du pouvoir a donné l’ivresse du sang. Néron valait mieux, car, dans cet artiste grotesque, il y avait du moins une étincelle d’art, et ses fêtes babyloniennes arrivaient, dans l’infamie, à une certaine grandeur. Commode n’avait que de bas instincts et ne cherchait que de vulgaires ou hideux plaisirs. C’est pourquoi il n’y a point à s’étonner de la légende qui lui donnait pour père un héros de l’arène. La populace est peu difficile sur le choix de ses favoris : là où elle vote, ce sont les déclamations violentes qui lui plaisent ; lorsqu’elle n’a que le droit d’applaudir, ce qu’elle aime, c’est l’adresse et la force physique. Aussi les exploits de carrefour de son empereur, qui scandalisaient les sages, la charmaient. Elle chérissait cet homme, qui lui jetait de l’or et ne quittait pas l’amphithéâtre ; qui lui donnait un autre spectacle, la terreur des grands ; et, comme intermède, de temps à autre, un cadavre à traîner par les rues. Mais la noblesse s’indignait de trembler sous un prince qui lui paraissait singulièrement petit à côté des grands empereurs de l’âge précédent. Il n’y avait plus dans le sénat, ainsi qu’au premier siècle, des rancunes de républicains ou des ambitions patriciennes. On savait à présent combien un empereur véritable était nécessaire à l’empire ; combien il fallait, dans le rang suprême, de vigilance, d’habileté, de ferme résolution pour maintenir, avec la grandeur de l’État, la sécurité de chacun et la vraie liberté de tous. Ces sentiments se montreront quand, pour remplacer le dernier des Antonins, tout le monde s’accordera dans la curie à mettre la pourpre des Césars sur les épaules du fils d’une affranchie. Dès la troisième année du règne, une conspiration se forma dans le palais même ; Lucilla en fut l’âme. Commode, sans doute, tenait à l’écart cette femme ambitieuse et jalouse de l’impératrice, qui lui ôtait le premier rang. Elle pensa qu’en remplaçant son frère par son gendre ou par Quadratus, jeune et riche sénateur qui s’était associé à ses projets, elle aurait une meilleure part du pouvoir. Pour être bien sûre de l’exécution, ce fut son gendre, un familier du prince, qu’elle chargea du coup. Comme l’empereur passait par un couloir sombre qui menait à l’amphithéâtre, le meurtrier se jeta sur lui avec un poignard, en s’écriant : Voilà ce que le sénat t’envoie. Il fut désarmé avant d’avoir frappé (183). Son imprudente parole était une sentence de mort pour nombre de sénateurs. De ce jour, les anciens amis de Marc-Aurèle ne parurent plus à son fils des censeurs silencieux, mais des ennemis dont il fallait prévenir les coups. Les beaux jours des délateurs reparurent, et les meurtres commencèrent pour ne plus s’arrêter. Lucilla, son gendre, le père de celui-ci, Quadratus et bien d’autres périrent. Un des préfets du prétoire, Tarrutenius Paternus, savant légiste qui a mérité de prendre place parmi les jurisconsultes des Pandectes, ne put être convaincu d’avoir participé au complot. Mais Pérennis, son collègue, voulait être seul chef des gardes. Il le fit nommer sénateur pour lui ôter la préfecture du prétoire, puis il l’accusa de trahison ; Paternus fut condamné avec le petit-fils du grand jurisconsulte d’Hadrien. Ce Salvius Julianus était, à l’avènement de Commode, à la tête d’une puissante armée et fort aimé de ses troupes ; il n’avait pas voulu disputer l’empire au fils de Marc-Aurèle, mais il l’aurait pu : c’était assez pour qu’il fût coupable, puisqu’il passait pour dangereux. La liste des victimes du tyran est longue ; Dion assure que, de tous ceux qui avaient joui de quelque crédit dans l’État au, temps de Marc-Aurèle, trois seulement, sous Commode, échappèrent à la mort. Comme Caligula, il ne prit souvent les têtes que pour prendre les biens et apurer ses comptes ; plusieurs femmes périrent à cause de leurs richesses. Le sort des Quintilius frappa l’imagination des
contemporains, quelque habitués et endurcis qu’ils fussent à ces scènes de
meurtre : c’étaient deux frères, Troyens d’origine, renommés pour leurs richesses,
leur savoir, leurs talents militaires, et qui ne s’étaient jamais séparés.
Les princes, se plaisant à honorer cette amitié fraternelle, leur avaient
fait courir ensemble la carrière des charges publiques : ils avaient été en même
temps consuls, chefs d’armée et gouverneurs d’Achaïe, l’un servant de
lieutenant è l’autre ; ils signaient tous deux les dépêches, et Marc-Aurèle
sanctionnait cette illégalité touchante, en adressant à tous deux un rescrit
qui se lit encore au Digeste. Commode les réunit aussi, mais dans la mort[29]. On voit encore,
dans la campagne de Rome, les grandes ruines de leur palais qu’au moyen âge
on appelait Durant la guerre de Bretagne, Pérennis avait remplacé par des chevaliers les sénateurs qui commandaient les légions en ce pays. Les soldats, dit-on, s’irritèrent de ce qu’on diminuât ainsi l’éclat des grades militaires. Cette sollicitude, dans les camps de Bretagne, pour les privilèges des pères conscrits, m’est fort suspecte. Il doit y avoir eu d’autres motifs de mécontentement. On parle vaguement d’une grande sédition que Pertinax apaisa[30], après y avoir couru risque de la vie ; d’un empereur, Priscus ou Pertinax lui-même, que ces légions voulurent nommer et qui refusa. Les soldats envoyèrent quinze cents d’entre eux porter leurs plaintes à l’empereur. Inquiet à l’approche de députés si nombreux qui semblaient apporter des ordres bien plus que des prières, Commode sortit de Rome à leur rencontre : Qu’est-ce cela, camarades, leur demanda-t-il, et quel dessein vous amène ? — Nous sommes venus, répondirent-ils, parce que Pérennis conspire contre toi ; il veut faire son fils empereur. Sans plus d’informations, le lâche prince livra son fidèle serviteur[31]. On le battit de verges longtemps, puis on lui coupa la tête, et sa femme, sa sœur, ses deux fils, furent égorgés (185). Les soldats venaient de défaire un ministre ; bientôt ils feront et déferont des empereurs. On ne sait où placer la singulière histoire de Maternus[32] ; Hérodien la
raconte après la chute de Pérennis. Ce soldat, ayant déserté avec quelques
hardis compagnons, courut la campagne en pillant les villages. Sa troupe,
organisée militairement et grossie des bandits, des condamnés auxquels il
ouvrait les portes des prisons, se trouva assez forte pour s’attaquer aux
villes, dont plusieurs furent mises à sac et incendiées. Il parcourut ainsi l’Espagne
et Rien n’autorise à dire que l’audacieux bandit ne pouvait pas réussir. Dans un État où il ne se trouve entre les ambitieux et le souverain pouvoir aucune institution vivace et forte qui mette le prince à l’abri d’une surprise, un coup de poignard suffit à changer une dynastie. Nous avons déjà vu de ces catastrophes et nous en verrons bien d’autres. A cet égard, la divinité impériale n’était pas sans analogie avec le sacerdoce du temple de Diane Aricine dont le grand prêtre devait avoir tué son prédécesseur. Un ancien portefaix devenu chambellan de Commode, l’affranchi Cléander, remplaça Pérennis dans la faveur du prince. Il avait gardé tous les vices dé la servitude, en y ajoutant l’âpreté au gain. Il vendit les charges, les provinces, les jugements : on vit plusieurs préfets des gardes en une semaine et jusqu’à vingt-cinq consuls en un an[33]. Avec une partie de cet argent, il achetait les maîtresses de Commode et Commode lui-même. Les prétoriens suivront bientôt cet exemple, mais c’est l’empire qu’ils mettront à l’encan. Les gouvernements récoltent ce qu’ils sèment. Burrus, beau-frère de Commode, voulut l’éclairer sur ces indignités, Cléander l’accusa d’aspirer au principat et obtint contre lui un ordre de mort qui s’étendit à beaucoup de sénateurs. Il prit alors la préfecture du prétoire, qu’il consentit à partager avec deux collègues. Cet affranchi, qu’on appelait le ministre du poignard, aurait pu continuer impunément à décimer la noblesse ; mais il laissa la populace avoir faim : elle le précipita. Depuis quelques années il y avait disette ; le prix du blé montait et les distributions étaient suspendues. Commode voulut contraindre les marchands à vendre les vivres à meilleur compte ; les denrées se cachèrent et le mal, augmenta. Un immense incendie qui rappela celui de Néron, une épidémie, qui, dans Rome seulement, enlevait deux mille personnes par jour[34], portèrent au comble l’exaspération populaire. Ces fléaux ne paraissaient pas naturels ; le peuple réclama une victime. On prétendait que Cléander amassait des blés. Nous connaissons le sort de ceux qu’en temps de disette la populace accuse d’être accapareurs. Comme on célébrait les jeux du cirque, une bande d’enfants s’élancèrent dans l’arène, avec de grands cris, ayant à leur tête une virago de taille élevée et d’aspect farouche, qui, sans doute, disparut dans la bagarre, ce qui permit aux niais et aux ennemis de Cléander de prétendre ensuite qu’une divinité avait tout conduit. Aux clameurs des enfants se joignent celles des spectateurs ; l’émotion gagne tout le monde ; on quitte les jeux et on court hors de la ville au palais Quintilien, oit Commode se trouvait. Cléander, pour arrêter cette multitude, la fait charger par des cavaliers de la garde germaine ou prétorienne ; plusieurs personnes sont tuées, d’autres blessées, et l’immense cohue est refoulée sur la ville. Afin d’en achever la dispersion, les cavaliers s’engagent dans les rues. Assaillis par une grêle de tuiles et de pierres qui tombent du haut des toits, attaqués par les soldats des cohortes urbaines qui font cause commune avec le peuple, ils reculent en désordre, et la foule revient vers la demeure impériale, mêlant à ses cris de mort contre Cléander des vœux de prospérité pour le prince. Une concubine de Commode lui montre l’émeute qui approche, le péril qu’il peut courir, le moyen de le conjurer. Commode fait tuer son favori et livre le corps à la populace. Longtemps celle-ci promena dans la ville, au haut d’une pique, la tête du tout-puissant ministre et traîna par les rues son cadavre. Son fils, un enfant en bas âge qu’on élevait à la cour, fut broyé sur le pavé. Ceux qui avaient partagé la fortune du favori partagèrent l’ignominie de sa mort ; après avoir servi de jouet à la tourbe abjecte, ils finirent aux gémonies (189)[35]. Au dernier jour des jeux, Commode, avant de descendre dans l’arène, avait remis sa massue a Pertinax. On s’en souvint plus tard et l’on y vit un signe. L’expiation, en effet, approchait. Le fils de Marc-Aurèle, que son biographe appelle plus cruel que Domitien, plus impur que Néron, était une bête fauve qui ne pouvait manquer d’être un jour ou l’autre abattue. Dans l’héritage d’une de ses victimes, Commode avait trouvé une femme à laquelle il s’attacha passionnément et dont il fit sa concubine. Cette union, sorte de mariage morganatique que la société romaine reconnaissait[36], permit à Marcia de recevoir presque tous les honneurs réservés aux impératrices[37]. Cette femme, qui paraît n’avoir manqué ni d’étendue d’esprit ni de résolution, avait pris un grand ascendant sur l’âme amollie de cet histrion imbécile : ses médailles, qui sont peut-être des portraits, annoncent un caractère viril, et l’on a vu sa décision dans l’affaire de Cléander. Elle était chrétienne[38], autant que le pouvait être une maîtresse de Commode ; du moins elle favorisa les chrétiens qui lui durent la paix dont ils jouirent sous ce règne. Mais, à faire le vide autour de leur trône, ces tyrans insensés finissent par tourner contre eux-mêmes les instruments de leur tyrannie et de leurs plaisirs. Marcia, le chambellan Eclectus, Lætus, le préfet des gardes, se sentirent menacés. Commode surprit-il quelques paroles imprudentes ? On ne sait ; mais il crut à un complot, qu’il provoqua, s’il n’existait pas encore. Hérodien raconte d’une manière trop dramatique peut-être le dernier incident qui ne fit sans doute que décider le jour de l’exécution. La veille des Saturnales, Commode se mit en tête d’aller
passer la nuit dans une école de gladiateurs, d’où il sortirait le lendemain,
pour la fête du jour, armé de pied en cap et précédé de tous ses compagnons
de l’arène. En vain sa femme et ses confidents firent les plus vives
instances pour qu’il renonçât à cet indigne dessein ; il les congédia avec
colère, et, pour en finir avec cette opposition à ses volontés, il écrivit
sur des tablettes les noms des nouvelles victimes qui devaient périr la nuit prochaine :
en tête étaient ceux de Marcia, de Lætus et d’Eclectus. Lorsqu’il sortit de
sa chambre pour se rendre au bain, il mit ses tablettes sous le chevet de son
lit. Un enfant dont les jeux amusaient l’empereur et qui errait librement partout
le palais, entra dans cette chambre, aperçut les tablettes et les prit pour
un jouet. Marcia le rencontra et lut la liste funèbre ; elle prévint, en
toute hâte, ceux que Commode lui donnait nécessairement pour complices. Ils
convinrent qu’après le bain elle présenterait au prince un breuvage
empoisonné ; et, comme le poison ne produisit qu’un vomissement, ils le
firent étrangler par un jeune et vigoureux athlète ( Commode a contre lui trop de choses détestables pour que nous ne lui tenions pas compte d’une bonne : il donna la paix aux chrétiens et ouvrit les prisons où son père les avait jetés[40]. A un point de vue plus général, son principat commence, pour l’histoire de l’empire, une période nouvelle. C’est la fin des temps heureux et le commencement des jours de malheur. Un seul règne avait suffi pour développer le germe funeste qui se trouvait au sein de la monarchie impériale, la prépotence des soldats. Ce mal avait déjà fait explosion à la mort de Néron, et l’empire avait failli en être brisé ; la main ferme de Vespasien, de Trajan et d’Hadrien l’avait une première fois étouffé. Il éclata de nouveau lorsque les hasards de la naissance ou de l’émeute firent arriver à la tête des légions, au lieu de princes glorieux et respectés, un gladiateur tel que Commode et un Syrien affolé de luxure comme Élagabal. Du jour où le soldat vit de près la honte de ses princes et les lâches adulations du sénat, l’autorité du commandement et de la loi civile tomba. Dans les camps, le voisinage de l’ennemi maintenait quelque reste de l’ancienne discipline ; mais, à Rome, au milieu des séductions de la grande ville, les prétoriens avaient pris beaucoup de besoins qui exigeaient beaucoup de licence. Pertinax se les aliéna en leur défendant d’injurier et de maltraiter les citoyens. Commode, au contraire, dont ils étaient la seule défense contre la noblesse, qu’il décimait, avait pour eux des complaisances funestes, et ses défiances a l’égard des grands l’obligeaient a donner l’épée du prétoire à des parvenus, même à un affranchi. Ces généraux d’aventure prenaient à leur tour des précautions contre l’empereur. Ils cherchaient à s’assurer de leurs cohortes, et, pour cela, les composaient de gens auxquels ils pouvaient tout demander, parce que eux-mêmes ne leur refusaient rien. Ils appelaient dans les rangs, autrefois ouverts aux seuls Italiens, puis aux plus braves des provinciaux, jusqu’à des Barbares : le chef de la bande qu’on verra se ruer sur le palais de Pertinax sera un Tongrien. De tels soldats devaient s’inquiéter bien moins de l’honneur du nom romain que des avantages à tirer de la crainte qu’ils inspiraient. Ainsi l’empire n’est pas encore ébranlé ; mais, en face d’un sénat que le prince avilit et de magistrats devenus impuissants, une soldatesque turbulente et avide fera, dans l’intérêt de sa cupidité, des révolutions qui ruineront les provinces et ouvriront les frontières aux Barbares. L’ordre militaire l’emportera bientôt sur l’ordre civil. Les Antonins avaient pris leur point d’appui dans le sénat, leurs successeurs vont le prendre dans les légions, et, durant un siècle, tous, si l’on en excepte trois, seront les serviteurs plutôt que les maîtres des soldats. Les officiers, à leur tour, plieront devant les hommes qui feront les empereurs : de sorte que le pouvoir politique des armées aura pour conséquence nécessaire la perte de la discipline et, par suite, la ruine de la grande institution militaire d’Auguste et d’Hadrien[41]. II. — PERTINAX ET DIDIUS JULIANUS (193).Les meurtriers de Commode se hâtèrent de choisir un empereur, Publius Helvius Pertinax, vieux général qui, dans sa verte vieillesse[42], paraissait conserver assez de vigueur pour qu’on n’eût pas à craindre de voir succéder aux excès de la jeunesse l’impuissance de la sénilité. Lætus le conduisit au camp des prétoriens.
Avec Commode, nous avons vu qu’un fils de prince était
tout arrivé ; Pertinax nous montre comment de petites gens arrivaient. Fils d’un
affranchi, marchand de charbon à Alba Pompeia, en Ligurie, Pertinax avait
cherché d’abord à gagner sa vie en enseignant la grammaire ; le métier n’allant
pas, il demanda et obtint, par le crédit d’un patron, le grade de centurion.
Son mérite l’éleva rapidement aux premiers rangs dans l’armée, par suite dans
l’État. Il devint préfet d’une cohorte en Syrie, commandant, d’un escadron en
Bretagne et, dans Il n’avait pas vu Rome depuis sa nomination au sénat. Lorsqu’il y rentra, on lui reprocha d’avoir gagné de grands biens dans ses divers emplois. Il n’avait pas cru qu’il exit le devoir de s’y ruiner, et une économie sévère suffit sans doute à mettre la fortune dans sa maison[44]. Relevons deux traits à sort honneur : il garda sa mère près de lui dans ses divers commandements, et, lorsqu’il éleva de beaux édifices dans sa ville natale, il y encadra la boutique de son père, le charbonnier. Pérennis le fit exiler ; mais Commode, à la mort de ce préfet, le rappela et le mit à la tête de la turbulente armée de Bretagne. Plus tard, il le chargea de surveiller les approvisionnements de Rome, præfectus frumenti dandi, lui donna le proconsulat d’Afrique[45] et, ce qui était le suprême honneur, la préfecture de la ville. Ces grandes charges avaient mût son expérience. Par nature, il était honnête, sans ambition et quelque peu avale, comme ceux qui ont fait difficilement leur fortune ; mais, dévoué au bien public, il aurait pris rang parmi les meilleurs princes, si on l’avait laissé vivre ou s’il avait su se défendre. Le pouvoir l’effrayait ; il n’y avait nul goût[46]. Dans le sénat, il offrit l’empire à Pompeianus, qui avait protégé ses débuts[47], à Glabrion, qu’on disait descendant d’Énée : c’étaient des sages ; ils préférèrent lui laisser le fardeau et les périls. Quelques jours après, un autre sénateur s’étant aventuré au milieu des prétoriens, ceux-ci voulurent le faire empereur. Échappé à grande peine de leurs mains, la toge en lambeaux, il vint se réfugier au palais de Pertinax, et, pour fuir plus sûrement l’empire, s’éloigna de Rome. Ces désintéressements révèlent une situation pleine d’anxiété. Pertinax refusa pour sa femme le titre d’augusta, pour son fils celui de césar. Il sera temps de le lui donner, dit-il, quand il l’aura mérité[48]. Tous les siens,
parents et serviteurs, furent retenus dans la modestie de leur condition : il
leur abandonna ses biens personnels, et lui-même resta simple dans sa vie
privée. A la nouvelle de son avènement, ses compatriotes des montagnes de Mais cet ordre, cette économie, ne faisaient le compte ni
des prétoriens ni du peuple. Aux premiers, il avait eu l’imprudence de
défendre le port d’armes dans les rues[51], les brutalités
aux passants, et de leur dire : Dans notre
siècle, il s’est introduit beaucoup de désordres, qu’avec votre concours nous
corrigerons, et son premier mot d’ordre avait été : militemus, combattons. Dans ces paroles, ils
avaient vu l’intention de les ramener à l’ancienne discipline et au service
de guerre. Au peuple, il supprima les distributions de blé que, depuis
Trajan, les enfants recevaient à partir de neuf ans. Enfin il se montra peu
disposé à se laisser conduire par Lætus, qui regarda cette défiance comme un
présage de disgrâce et travailla dès lors en secret les cohortes
prétoriennes. Une conspiration se forma, ou du moins un consulaire, Falco,
fut accusé d’aspirer à l’empire ; le sénat allait le condamner, quand
Pertinax jura que jamais un sénateur ne serait mis à mort sous son règne. Un
esclave ayant accusé plusieurs prétoriens de complicité avec Falco, Lætus les
fit tuer et rejeta sur le prince l’odieux de l’exécution. Mal payés et se
sentant suspects, ils résolurent de se débarrasser de tout souci et d’un
empereur avare. Trois cents d’entre eux se rendirent en armes au palais ; il
s’y trouvait assez de soldats pour repousser cette poignée de factieux ; mais
toute la domesticité, ceux que Dion appelle les césariens et qu’un prince
économe ruinait ouvrirent les portes aux assassins. Pertinax crut les arrêter
en allant sans armes au-devant d’eux. La vue du prince les contint un
instant, et déjà quelques épées rentraient au fourreau, quand un Tongrien s’élança
sur lui et le blessa. Aussitôt l’hésitation cesse ; tous frappent, et sa tête,
mise au bout d’une pique, est portée au camp des prétoriens. Electus seul avait
essayé de le défendre et était mort avec lui. Il avait régné quatre-vingt-sept
jours (
Quoique l’empire eût été souvent acheté, il n’avait pas encore été vendu à la criée : Rome allait voir cette honte. Pour calmer les prétoriens, Pertinax avait envoyé à leur camp son beau-père, Sulpicianus, le préfet de Rome. Ce sénateur était encore une de ces médiocrités vulgaires qui, ignorant les obligations du pouvoir, ne voient de lui que ce qui brille. Quand on lui montra la tête de Pertinax, il proposa sur l’heure aux meurtriers de leur acheter la pourpre trempée dans le sang de son gendre. Le bruit s’en répandit bien vite, et Julianus courut lui faire concurrence. Alors commença une scène sans nom et heureusement sans exemple. Julianus était sur le haut du mur, Sulpicianus dans l’intérieur, et chacun d’eux enchérissait sur l’autre. Du mur d’enceinte au prétoire allaient des messagers disant à celui-ci : Il donne tant ; qu’y ajoutes-tu ? Et à celui-là : L’autre offre plus d’argent ; promets-tu davantage ? On arriva à 5.000 drachmes ou 20.000 sesterces, et, les offres se balançant, le soldat attendait, bien sûr de tirer meilleur parti de sa marchandise ; à la fin, Julianus déconcerta son adversaire par une surenchère hardie de 1.250 drachmes. Il criait la somme du haut du mur ; il la comptait sur ses doigts pour que ceux qui ne l’entendaient pas pussent le comprendre, et il leur jetait ses tablettes où il avait écrit qu’il rétablirait la mémoire de Commode, tandis que Pertinax serait certainement vengé par Sulpicianus. Celui-ci n’osa pousser plus loin. Chaque prétorien allait donc recevoir environ 6.000 francs. Jadis, le sénat avait proclamé la vente d’un morceau du territoire de la république : c’était celle du champ où campait Annibal[53]. Nous avons raison de trouver cette scène indigne ; il faut pourtant bien avouer que ce donativum, dont on a vu l’origine, était un usage auquel un empereur n’aurait pu se soustraire. Ce qui est odieux, ce n’est pas la somme, mais l’enchère. Marc-Aurèle avait donné presque autant[54], et chez des nations très libres, même très fières, on achète encore une portion de pouvoir, sinon aux prétoriens, qui fort heureusement n’existent plus, du moins aux électeurs. L’adjudication faite, les soldats apportèrent une échelle pour que l’acquéreur pût descendre au camp et prendre livraison des serments de ses nouveaux gardes et des ornements impériaux. Ils lui firent nommer deux préfets du prétoire, qu’ils avaient eux-mêmes choisis, puis ils ouvrirent les portes et, en ordre de bataille, les enseignes déployées, conduisirent au sénat leur nouveau chef, qu’ils saluaient du nom menaçant de Commode. Pourtant ils eurent l’attention de lui faire jurer qu’il ne garderait pas rancune à son compétiteur. Il ne fallait pas décourager ceux qui pourraient être tentés de recommencer cet honnête commerce. Beaucoup de sénateurs tremblaient, à commencer par notre historien, Dion, qui, dans ses plaidoiries, avait eu plusieurs fois occasion de prendre Julianus à partie. Ils aimaient Pertinax, ils trouvaient son successeur ridicule et avaient horreur du marché qui venait de se conclure. Mais les alentours de la curie, la curie elle-même, étaient remplis de soldats. On se hâta de sourire au prince, de trouver fort éloquentes les niaiseries qu’il débita, et de faire les acclamations accoutumées. Julianus monta ensuite au palais ; y trouvant le souper préparé pour Pertinax, il se moqua de la simplicité des mets, en envoya chercher d’autres, et joua aux dés à quelques pas du cadavre de son prédécesseur[55] ; mais, dés le lendemain, allaient lui venir les terribles soucis d’un pouvoir contesté et, au bout de quelques jours, les angoisses d’une mort inévitable et prochaine. Il n’avait rien promis au peuple, qui se trouva blessé
dans sa dignité par cet oubli offensant. Lorsqu’il se présenta le lendemain à
la curie, la foule l’accueillit avec de grands cris, l’appelant usurpateur et
parricide. Il prit d’abord la chose doucement et leur assura qu’il donnerait
de l’argent. Nous n’en voulons pas, s’écrièrent-ils,
saisis d’un désintéressement inaccoutumé, nous ne
l’acceptons pas ! Alors il les fit charger par les soldats, qui en
tuèrent plusieurs ; les autres se sauvèrent par la ville et se réfugièrent au
Cirque. Dion prétend qu’ils y restèrent une nuit entière et le jour suivant,
invoquant les dieux et, ce qui eût été lus sûr, les chefs militaires, surtout
Pescennius Niger ou le Noir, qui était alors bien loin au fond de Cependant On revit alors ce qui s’était passé d la mort de Néron. Deux de ces armées, celle de Pannonie et de Syrie, proclamèrent leurs chefs (avril 193), et la troisième en eût fait autant sans d’habiles négociations de Sévère avec Albinus. En même temps que Sévère s’assurait la neutralité de l’armée de Bretagne, il gagnait l’assistance des légions voisines de son commandement, de sorte qu’en peu de jours il se trouva avoir dans les mains près de la moitié des forces militaires de l’empire[57]. II avait donc déjà cause gagnée quand il prit la route de Rome, précédé de la déclaration qu’il y portait la vengeance de Pertinax[58]. De secrets émissaires avaient fait sortir ses enfants de la ville avant que la nouvelle de son élévation à l’empire y parvînt. Julianus le fit déclarer ennemi publie par le sénat et commença des préparatifs. On se mit à remuer de la terre pour creuser un fossé en avant de Rome ; on fit venir les gladiateurs de Capoue, gens de sac et de corde, sur lesquels il ne fallait pas compter ; on appela les soldats de la flotte de Misène, qui prêtèrent à rire par leur maladresse à manier le javelot, et on arma en guerre les éléphants du Cirque, qui jetaient à terre les tours dont on voulait les charger. Julianus fit môme barricader le palais impérial, en signe de la résistance désespérée qu’il opposerait à l’ennemi jusque dans Rome forcée. Les prétoriens auraient dû donner l’exemple ; mais ils étaient riches, habitués à vivre mollement et payaient pour qu’on fit leur besogne, tout en insultant le peuple dont ils étaient la terreur[59]. En gage du maintien de son alliance avec eux, Julianus fit tuer Lætus et Marcia, les meurtriers de Commode. En même temps il consultait les magiciens, immolait des enfants pour lire l’avenir dans leurs entrailles et dépêchait des assassins à Sévère[60], des sénateurs à son armée pour la débaucher, et le préfet du prétoire à Ravenne, afin de mettre en état de défense cet avant-poste de Rome où stationnait la flotte de l’Adriatique. Mais Sévère se gardait bien et avançait vite. Proclamé à Carnuntum, près de Vienne, le 13 avril, il avait dû employer dix ou douze jours à négocier avec les légions de la haute Germanie et à mettre son armée en mouvement. Cependant il arriva aux environs de la capitale avant le 1er juin, de sorte que ses troupes eurent à faire, de Vienne à Rome, en moins de sept semaines, 266 lieues, ou 6 lieues et demie par étape, sans s’arrêter un seul jour. Cette marche rapide d’une armée nombreuse entrant à l’improviste en campagne prouve l’abondance des provisions que l’agriculture et le commerce pouvaient instantanément réunir, le bon état des chemins et la soumission des provinces, c’est-à-dire la prospérité et le calme de l’empire durant les orages de Rome. Elle prouve aussi la discipline maintenue par Sévère dans ces légions auxquelles il pouvait imposer de telles fatigues sans qu’elles fissent entendre un murmure. Cette rapidité déjouait toute résistance. Sévère franchit, sans trouver d’obstacles, les Alpes, l’Adige et le Pô, entra dans Ravenne avant le préfet envoyé de Rome, et fit passer les députés du sénat de son côté. Ainsi Julianus voyait se resserrer chaque jour l’étroit espace où il lui était encore permis de régner et de vivre. Les dernières nouvelles le firent tomber dans l’accablement. Inquiet, irrésolu, il demandait des conseils, que le sénat se gardait de lui donner ; il offrit l’empire à Pompeianus, qui répondit : Je suis trop vieux, et ma vue est trop faible. Réduit au misérable espoir de se concilier son terrible adversaire en lui mendiant la vie et une part de pouvoir, il voulait, comme autrefois Vitellius, qu’on envoyât les vestales au-devant de Sévère, puis qu’on le nommât son collègue[61]. Les Pères se hâtèrent cette fois de déférer à son désir, et il fit porter le sénatus-consulte au nouvel Auguste par un des préfets du prétoire qu’on soupçonna de méditer, sous ces apparences de paix, un assassinat. Le décret qu’il apportait fut dédaigneusement rejeté et lui-même mis à mort. Cependant, afin d’éviter d’ensanglanter Rome par un grand
combat comme au temps de Vespasien, Sévère y préparait un mouvement en sa
faveur. Il écrivait aux magistrats ; il envoyait des édits, qu’on affichait ;
il nommait un préfet du prétoire, que Julianus tremblant reconnaissait, et il
faisait annoncer aux prétoriens qu’il leur promettait le pardon s’ils
livraient les meurtriers de Pertinax. Aussi lâches que leur prince, les
gardes se saisirent des trois cents, puis vinrent dire au consul Messalla que
leurs camarades étaient enchaînés : c’était la fin. Aussitôt, dit Cassius, Messalla nous réunit et nous exposa ce que les soldats
avaient fait. Alors nous décrétâmes la mort de Julianus ; nous donnâmes les
droits impériaux à Sévère et les honneurs divins à Pertinax. Julianus
fut tué dans son lit. Il ne dit que ces mots : Quel
mal ai-je fait ? ( III. — SÉVÈRE ; GUERRES CONTRE NIGER, ALBINUS ET LES PARTHES.Enfin nous retrouvons un homme ! Mais cet homme, dur aux autres et à lui-même, justifiera son nom par d’inexorables sévérités : ce sera un justicier à la façon de Tibère et de Louis XI.
A Rome, il étudia le droit sous un jurisconsulte éminent, Q. Scævola. La gravité de son caractère se montra par l’affection qu’il conçut dans cette école fameuse pour un autre élève de Scævola, qui devait éclipser le maître. Cette liaison dura toute la vie des deux condisciples, et l’amitié de Papinien protège près de nous la mémoire de Sévère. Trois de ses oncles avaient été consuls ; l’un d’eux lui fit obtenir la questure, par conséquent l’entrée au sénat (172). C’était la carrière des honneurs qui s’ouvrait pour lui à vingt-sept ans ; nous ne l’y suivrons pas : ce cursus honorum est connu, et le prince seul nous intéresse. Disons seulement qu’il fut consul suffectus sous Commode en 189. Pendant que Julianus mourait à Rome, Sévère approchait de cette ville. Le sénat envoya au-devant de lui jusqu’à Interamna, à 20 lieues de Rome, cent de ses membres pour lui renouveler son serment de fidélité. Il les reçut entouré de six cents de ses plus dévoués soldats qui avaient charge de veiller sur les suspects. Introduits au milieu de ce cortége menaçant, les députés durent se laisser fouiller, afin qu’on s’assurât qu’ils ne cachaient pas d’armes. Après cet affront, chacun d’eux fut, il est vrai, gratifié de 80 pièces d’or (plus de 2.000 francs), mais cette première rencontre du sénat et du prince n’inaugurait pas un règne de mutuelle confiance ; on verra que les rivaux de Sévère trouveront toujours des partisans parmi les pères conscrits. Les meurtriers de Pertinax étaient déjà décapités ; aux
autres prétoriens, Sévère ordonna de venir à sa rencontre jusqu’à un lieu
indiqué où les légions d’Illyrie les entourèrent en silence, pendant qu’une
autre troupe allait, par des chemins détournés, occuper la vraie citadelle de
Les cohortes prétoriennes étaient licenciées. Mais Sévère se hâtera de les reconstituer en les composant autrement. Avant lui, elles se recrutaient surtout en Italie[68] ; il décidera qu’on y appellerait, à titre d’avancement et de service d’honneur, les soldats d’élite de toutes les légions. Cela était bon ; les gardes des souverains modernes sont ainsi formées. Puisque, depuis un siècle, les provinciaux donnaient à Rome des empereurs, il était naturel qu’ils lui donnassent aussi des prétoriens. Sévère emploiera les nouvelles cohortes dans toutes ses guerres, mais il leur laissera le caractère de garnison permanente de Rome ; le danger restera donc le même. Nous verrons s’il l’augmenta en portant, comme on l’a dit, le nombre des prétoriens à quarante mille. Aux portes de la ville, écrit Dion Cassius, Sévère descendit de cheval et quitta l’habit de guerre pour entrer dans Rome ; mais toute son armée le suivait. Ce fut le plus magnifique spectacle que j’aie jamais contemplé. Dans la ville entière, on ne voyait que couronnes de fleurs et de laurier ; les maisons, ornées de tapis de diverses couleurs, resplendissaient du feu des sacrifices et de l’éclat des flambeaux. Les citoyens, vêtus de blanc, poussaient de joyeuses acclamations, et les soldats s’avançaient dans un ordre martial, comme s’ils accompagnaient un triomphe. Pour nous, nous marchions en tête du cortége, avec les ornements de notre dignité[69]. En même temps, des agents du prince, répandus dans, les groupes populaires, racontaient tous les signes qu’il avait eus de sa grandeur future. Les soldats sont fatalistes et ont besoin de l’être ; Sévère croyait fermement aux présages, mais il voulait surtout qu’on crût à ceux qui lui étaient favorables. Dans les Mémoires de sa vie, que nous avons perdus, il avait rapporté avec complaisance les signes célestes, les songes, les oracles, qui lui avaient prédit la fortune, et il les fit représenter en des tableaux qu’il exposa dans Rome, afin de montrer au monde que les dieux eux-mêmes avaient annoncé, et par conséquent voulu, l’avènement de la nouvelle dynastie impériale. Dion a raison de nous donner l’entrée de Sévère à Rome comme un triomphe. C’était, en effet, la victoire définitive, et, cette fois, sans voiles, du pouvoir militaire ; mais, à l’honneur de Sévère, c’était aussi une victoire sans larmes : un petit nombre de coupables avaient seuls péri[70]. Le caractère du nouveau règne se révéla bientôt. Sévère eut beau se montrer au sénat fort civil[71], déclarer qu’il prendrait Marc-Aurèle et Pertinax pour modèles, faire solennellement la promesse de ne jamais mettre à mort un membre de la haute assemblée, la licence des soldats prouva ce que valaient ces paroles. Sentant qu’ils étaient les vainqueurs du jour, ils traitaient Rome en ville conquise. Ils s’établissaient dans les temples, sous les portiques, dans les palais, comme en des hôtelleries, prenaient chez les marchands ce qui était à leur convenance et, à toute demande de payement, montraient l’épée. Pendant que Sévère, entouré de ses amis en armes, haranguait les Pères à la curie, ils vinrent avec cris et menaces réclamer du sénat 10.000 sesterces pour chacun d’eux. C’était ce qu’avaient eu les soldats d’Octave, et ils croyaient avoir gagné une nouvelle bataille d’Actium qui leur méritait pareille récompense. Quoique Sévère leur eût déjà donné beaucoup[72], il eut peine à obtenir qu’ils se contentassent de 1.000 sesterces. Quelques jours après, on célébra les funérailles de Pertinax. Sévère avait ordonné qu’il lui serait élevé un sanctuaire, qu’il aurait, au Cirque, une statue d’or, et qu’on invoquerait son nom dans toutes les prières, dans tous les serments. Sur le Forum, on construisit un édifice avec péristyle orné d’ivoire et d’or, au milieu duquel on plaça sur un lit couvert de tapis d’or et de pourpre l’image de Pertinax en costume triomphal. Comme s’il n’eût été qu’endormi, un jeune et bel esclave écartait les mouches de son visage de cire avec des plumes de paon. Le prince et nous, les sénateurs, avec nos femmes, tous en habits de deuil, nous vînmes prendre place, les femmes assises sous les portiques, nous à découvert, et le défilé commença. D’abord passèrent les statues des Romains qu’on vénère depuis les plus vieux temps ; des chœurs d’enfants et d’hommes qui chantaient un hymne funèbre ; des bustes d’airain représentant tous les peuples soumis avec leurs costumes nationaux. Parurent ensuite les bustes de ceux qui s’étaient distingués par leurs découvertes, et les bannières des corporations[73], l’infanterie, la cavalerie, les chevaux du Cirque, enfin un autel doré, garni d’ivoire et de pierres précieuses. Après ce défilé pompeux, Sévère monta sur la tribune aux harangues et lut un éloge de Pertinax, que nous interrompîmes souvent par nos acclamations. Nous redoublâmes, quand il eut fini, en laissant éclater nos gémissements et nos sanglots. Les magistrats en charge enlevèrent alors le lit funéraire et le remirent aux chevaliers, pour qu’il fût porté au Champ de Mars, où s’élevait le bûcher. Une partie d’entre nous marchaient en avant ; quelques-uns se frappaient la poitrine ; d’autres chantaient au son des flûtes un chant funèbre l’empereur venait le dernier. Le bûcher, en forme de tour à trois étages, orné d’or, d’ivoire et de statues, portait au sommet un char doré que Pertinax conduisait. Le lit y ayant été placé avec tout ce qu’il est d’usage de déposer auprès du mort, Sévère et les parents de Pertinax embrassèrent son image. Alors les magistrats avec leurs insignes, l’ordre équestre, la cavalerie et l’infanterie, défilèrent autour du bûcher (decursio) ; puis les consuls y mirent le feu, et un aigle s’en échappa, prenant son essor vers les cieux. C’est ainsi que Pertinax fut mis au rang des immortels[74]. Dion est un mauvais écrivain. Nous lui avons pris cependant cette page, comme tableau des coutumes romaines. On voit que, dans ces funérailles impériales, les sénateurs jouaient le rôle des pleureuses à gages dans les cérémonies ordinaires. Ce peuple grave aimait les cris, les gestes, l’expression forcée de la douleur et de la joie, même lorsque ni l’une ni l’autre n’était sincère ; et ses descendants les aiment encore.
Le respect des adversaires n’était pas une vertu antique ;
les empereurs rivaux s’insultaient, comme les héros d’Homère, avant le
combat. Ce n’est qu’un bouffon d’Antioche,
avait dit Sévère de son rival. Au fond, il l’estimait fort[76] et le tenait
pour un adversaire redoutable. Niger, en effet, soldat de fortune, avait
passé par les grades en méritant les éloges de Marc-Aurèle, de Commode et de
Sévère lui-même. C’était un gardien vigilant de la discipline. Un jour il lit
lapider deux tribuns qui s’étaient ménagé des profits sur la nourriture des
troupes[77],
et, sans les prières de l’armée, il eût fait décapiter des soldats qui
avaient volé une poule. Une autre fois, ses légionnaires demandaient du vin. Vous avez de l’eau, leur dit-il, n’est-ce pas assez ? Jamais, sous lui, le
soldat n’exigea des provinciaux du bois, de l’huile ou des corvées. Dans
Rome, où l’on se souvenait qu’il était Italien, il comptait des partisans[78], et ses manières
affables l’avaient fait aimer partout où il avait commandé. Dion prête sans
doute à la foule ses sentiments et ceux d’une partie du sénat, lorsqu’il
montre le peuple, à la suite d’une rixe avec les soldats de Julianus,
appelant Niger au secours de la république. Dans tous les cas, les vœux du peuple-roi
ne valaient pas une bonne épée, et, s’ils ont été exprimés, ils ont irrité
Sévère sans servir Pescennius. On a reproché son indolence au gouverneur d’Antioche
et des molles provinces de Syrie ; mais, avant même que son rival eût quitté Rome,
de promptes et habiles mesures lui avaient assuré l’Asie et l’Égypte, ouvert
l’Europe, garanti la neutralité des Arméniens, le secours des princes et des
chefs arabes de Sévère avait chargé ses lieutenants d’organiser la
résistance dans Cinq siècles auparavant, Alexandre avait conquis, non loin de ces lieux, l’Asie Mineure. La double défaite de Niger le rejeta, comme Darius l’avait été après la bataille du Granique, jusqu’au delà du Taurus. Il éleva dans les gorges de la montagne, aux portes Ciliciennes, des retranchements qu’il crut inexpugnables ; un torrent grossi par un violent orage y fit une brèche par où les Illyriens passèrent. Dans la troisième action, engagée prés d’Issus, les légions asiatiques, malgré l’avantage du nombre et d’une position dominante, ne purent soutenir le choc et perdirent vingt mille hommes. Niger s’enfuit à Antioche, et il allait demander aux Parthes un asile, lorsqu’il fut pris et décapité. Sa tête, portée au camp devant Byzance, fut exposée aux regards des assiégés, et cette vue ne les intimida pas (194). Comme dans presque toutes les batailles entre les légions d’Europe et d’Asie, celles-ci avaient été vaincues. Sévère semble n’avoir été présent à aucun de ces combats, non par crainte, mais par confiance en ses généraux, et sans doute afin de rester à portée des courriers d’Italie et de Gaule qui pouvaient lui apporter la nouvelle de quelque orage se formant à l’Occident[83]. Plusieurs villes d’Orient s’étaient mêlées à cette guerre
civile pour satisfaire les passions locales et ces jalousies invétérées dont
toute l’histoire dépose. Ainsi Nicée, Laodicée, Tyr et Samarie avaient pris
le parti de Sévère, parce que Nicomédie, Antioche, Béryte et Jérusalem s’étaient
déclarées pour son rival. Dans Ainsi en arrivait-il chaque fois que l’autorité impériale se divisait. Sans Rome et l’unité de commandement, le monde serait retombé dans le chaos : vérité qu’il ne faut jamais perdre de vue dans l’histoire de l’empire romain et qui est sa justification devant l’histoire. Niger vaincu, ses partisans furent punis, ses adversaires récompensés ; c’était dans l’ordre habituel et c’est dans l’esprit de tous les temps. Antioche, qui avait frappé des médailles en l’honneur de l’imperator asiatique, perdit ses privilèges et son titre de métropole, dont Laodicée hérita pour toute la durée du règne de Sévère[84]. Cette ville, Tyr, Héliopolis ou Baalbek, d’autres encore, obtinrent le titre de colonies avec le jus Italicum[85]. Cependant Sévère pardonna aux Juifs qui s’étaient prononcés pour Niger[86] ; mais Naplouse perdit son droit de cité, tandis que Samarie obtenait le rang et les privilèges d’une colonie romaine. Le siège de Byzance, qui dura près de trois ans[87], est resté aussi fameux que ceux de Tyr et de Carthage, de Rhodes et de Jérusalem. Dion décrit la puissante enceinte de la ville, ses tours garnies d’engins redoutables, son port fermé par une chaîne et dont le courant du Bosphore rendait l’attaque difficile, ses navires enfin à double gouvernail qui, changeant de route sans évoluer, tombaient soudainement sur les galères romaines qu’ils avaient paru fuir, et les brisaient de leur éperon. La supériorité de la défense sur l’attaque était alors si grande, que cette ville, entourée d’une armée nombreuse et menacée par toutes les flottes de l’empire, ne put être forcée. Il fallut attendre que, la famine fit tomber les armes de ces braves gens. Un grand nombre d’entre eux périrent en essayant, au dernier jour, de s’échapper ; le reste, après s’être nourri d’objets immondes, même de chair humaine, ouvrit les portes. Les chefs, les soldats, furent égorgés, les murailles abattues, et Byzance, déchue de son rang de cité libre, devint un simple bourg du territoire de Périnthe. Un compatriote de Dion, l’ingénieur Priscus, avait dirigé cette belle défense. Il fut, comme les autres, condamné à mort ; mais Sévère le gracia pour l’attacher à son service. Les amis du prétendant partageaient donc son malheur comme ils auraient partagé sa bonne fortune. Niger n’aurait pas été plus clément ; car, après la bataille de Cyzique, il avait fait mettre à sac, par ses cavaliers maures[88], des villes qui s’étaient prononcées pour le vainqueur. Du moins Sévère, fidèle encore à son serment, ne fît mourir aucun de ceux qui étaient de rang sénatorial[89] : ils furent dépouillés de leurs biens et relégués dans les îles. D’autres, qui avaient fourni de l’argent, payèrent une amende du quadruple. Dion accuse Sévère d’avoir suscité des délateurs et condamné des innocents. Son texte, très mutilé en cet endroit, ne permet pas de discuter ce fait, qui d’ailleurs n’aurait pas étonné un peuple habitué, par un long usage, aux vengeances politiques. Mais il y a une autre conclusion à tirer du trait suivant. Un sénateur, Cassius Clemens, cité au tribunal du prince, dit pour sa défense : Je ne te connaissais pas plus que Niger ; me trouvant pris dans son parti, j’ai obéi à la nécessité, non pour te combattre, mais pour renverser Julianus. Je poursuivais donc le même but que toi. Si, plus tard, je n’ai pas abandonné le chef que les dieux m’avaient donné, toi, non plus, tu n’aurais pas voulu qu’aucun de ceux que voilà près de toi, pour me juger, te trahit en passant à ton rival. Examine donc bien la chose en elle-même. Tout ce que tu décideras contre moi sera décidé contre toi et tes amis, car la postérité dira que tu nous as fait un crime d’une conduite semblable à la tienne. Sévère, charmé de cette hardiesse, lui ôta seulement le quart de ses biens : demi justice qui parut une grande indulgence. Durant la lutte, on lui avait entendu dire qu’il pardonnerait à Niger si celui-ci prévenait sa défaite par une abdication ; et il n’est pas certain qu’il n’eût pas tenu cet engagement, car, après la victoire, il se contenta d’exiler la femme et les enfants du malheureux prince ; à Rome, il respecta ses statues et leurs fastueuses inscriptions. Si ces éloges sont véridiques, dit-il à ceux qui lui conseillaient de les effacer, et ils le sont, on saura quel ennemi nous avons vaincu. Enfin, il accorda une amnistie aux soldats et en ramena ainsi un grand nombre qui s’étaient réfugiés chez les Parthes. Sévère n’était donc pas toujours l’homme sans entrailles que l’histoire habituelle nous montre. Il finit même par accorder des faveurs à cette ville de Byzance qui avait si longtemps tenu sa fortune en échec. La position en, était trop belle pour qu’un prince intelligent n’y laissât que des ruines[90]. Il aida à la relever, y bâtit des thermes, un temple du Soleil, un autre d’Artémis, un amphithéâtre, un hippodrome, etc., en avant soin, dit un ancien, d’acheter aux propriétaires les maisons et les jardins dont il avait besoin pour ses constructions[91]. Il lui accorda des subventions sur son trésor militaire et lui permit de prendre le nom de son fils. Jusqu’à la mort de Caracalla, Byzance fut la cité Antonine[92]. Le justicier impitoyable des alliés de Niger se faisait le bienfaiteur de sujets redevenus fidèles. Philostrate[93] donne une autre preuve de son esprit de justice, et ce fut un Byzantin qui en profita. Le siège de la ville durait encore, quand un de ses habitants, acteur renommé, mérita aux jeux Amphictyoniques le prix de déclamation tragique. Les juges n’osèrent le lui donner ; on réclama auprès de Sévère, qui le lui adjugea. La chose est petite, mais, pour des anciens, la sentence ne l’était pas. Pendant le siège de Byzance, Sévère avait réglé les affaires de Syrie et puni les gens de l’Osrhoène, quoiqu’ils se vantassent d’avoir égorgé les fugitifs d’Issus, réfugiés chez eux. L’empire entretenait quelques garnisons au delà de l’Euphrate. Pour raffermir en ces pays l’autorité impériale ébranlée
par la guerre civile et punir les alliés que Niger y avait trouvés, il mena
ses légions dans la haute Mésopotamie, où, depuis la grande expédition de
Cassius en 165, aucune armée romaine n’avait paru. Il lança encore en avant
ses généraux, qui eurent aisément raison, sur les deux rives du Tigre, des
Arabes et des Adiabéniens. Il lui convenait d’étouffer le bruit des batailles
civiles par le retentissement de victoires remportées sur l’étranger. Mais il
était trop prudent pour s’engager à fond clans ces lointaines régions avant d’avoir
réglé les affaires des provinces occidentales. De sa personne il s’arrêta
dans Nisibe, place de sûreté donnée par les Parthes aux Juifs, nombreux dans
ces contrées et que ceux-ci avaient fortifiée avec soin[94]. Située sur les
dernières pentes du mont Masius, à mi-chemin de l’Euphrate et du Tigre, Nisibe
allait être le centre de la défense de cette région et le boulevard à la fois
de Cette guerre n’avait pas pris de trop grandes proportions[95], et, quoi que pense Dion de l’occupation de Nisibe qui coûte plus qu’elle ne rapporte, cette politique était sage. Finir ainsi une guerre civile à la veille d’une autre qu’on pouvait aisément prévoir, c’était agir en prince préoccupé avant tout des intérêts de l’État. Sévère était encore en Mésopotamie au printemps de 196, quand l’annonce de la reddition de Byzance lui arriva. Cette nouvelle décida son retour en Europe, où le rappelaient d’ailleurs les soucis qu’Albinos commençait à lui causer. Il l’avait adopté comme fils[96], lui avait reconnu le titre de césar[97], c’est-à-dire d’héritier présomptif, et l’avait désigné pour prendre, avec lui-même, possession du consulat l’année suivante. On frappait en son honneur des monnaies avec ce titre ; on lui dressait des statues, et les sacrifices étaient offerts au nom des deux empereurs[98]. Avant de partir pour l’Orient, il lui avait écrit : L’État a besoin d’un homme tel que toi, d’une naissance illustre et dans la force de l’âge. Moi, je suis vieux, attaqué de la goutte, et mes fils sont encore des enfants[99]. Mais, depuis trois ans, Albinus était laissé en dehors de toutes les affaires sérieuses. Sévère avait gardé pour lui seul la plénitude du pouvoir, même dans les plus petites choses. Il se peut qu’une inscription relatant des travaux ordonnés par lui, du fond de l’Asie, dans une obscure cité du Latium, soit fausse[100] ; mais nous avons le texte d’un rescrit qu’il envoya des bords de l’Euphrate au sénat de Rome touchant la tutelle des biens des pupilles[101]. Ainsi un autre conquérant se plaisait à dater ses décrets de Varsovie ou de Moscou, à 600 lieues de sa capitale et de son gouvernement. Albinus, réduit à d’inutiles honneurs, voyait grandir les fils de Sévère, et il ne lui fallait pas beaucoup de prévoyante pour s’assurer que ces enfants devenus hommes lui seraient de redoutables compétiteurs. Ses trois légions de Bretagne lui étaient dévouées ; celles des Gaules et de l’Espagne[102], qui seules n’avaient point fait d’empereur, devaient être désireuses de s’associer à la fortune d’un nouveau prince. A Rome, les anciens amis de Pescennius, tous ceux que Sévère inquiétait, avaient reporté sur Albinus leurs espérances. On vantait sa naissance illustre, on opposait la douceur du César à la dureté de l’Auguste, on croyait qu’avec lui le sénat reprendrait son autorité[103], et quelques-uns des sénateurs les plus considérables l’engageaient à profiter des embarras de Sévère en Orient pour mettre la main sur Rome et sur l’Italie. Les lettres trouvées plus tard dans les papiers d’Albinus révélèrent ces secrètes intrigues. Des médailles donnent même à penser qu’un certain nombre de pères conscrits allèrent rejoindre Albinus, et qu’il en composa un contre sénat, comme autrefois Pompée avait fait en Grèce, Scipion en Afrique, et comme Postumus fera plus tard en Gaule[104]. Sévère ne pouvait ignorer ces dispositions de la noblesse romaine, et il devait être depuis longtemps en défiance, bien qu’Albinus lui eût encore envoyé en 195 de grandes sommes pour l’aider à secourir les villes d’Asie ruinées par Niger. Comme il regagnait l’Italie par la vallée du Danube, il lui arriva, près de Viminacium, des nouvelles de Bretagne et de Rome qui le décidèrent à brusquer l’inévitable rupture[105] : sans doute l’annonce qu’Albinus avait pris le titre d’auguste et se préparait à descendre en Gaule. Sévère venait de sortir victorieux de deux guerres et de traverser deux fois les plus riches provinces de l’empire ; il avait donc donné à ses soldats de la gloire, et il pouvait leur donner de l’or. Aussi eut-il peu de peine à leur faire déclarer Albinos ennemi public et proclamer son fils aisé césar et prince de la jeunesse sous le nom d’Aurèle Antonin[106]. Lui-même avait déjà pris le titre de fils de Marc-Aurèle[107]. Enfin il a trouvé un père, disaient ceux que blessait cette fortune d’un parvenu[108]. Mais ce n’était pas une simple usurpation de nom. Il avait dû être procédé à une véritable adoption, accomplie suivant les formes légales, car Sévère tenait à ce qu’elle eût tous ses effets civils. Il manquait naturellement à la cérémonie son principal acteur, le père adoptif, mort depuis quinze ans. Mais, d’une manière ou d’une autre, l’omnipotence impériale leva cette difficulté, comme Galba l’avait fait pour Pison, qu’il adrogea[109] sans assemblée curiate, en vertu de sa charge de souverain pontife, comme Nerva l’avait fait pour Trajan absent, quoique la présence et le consentement de l’adopté fussent nécessaires. Sévère était aussi grand pontife, et ce qui avait été légal au sujet d’un absent le fut à l’égard d’un mort. Dès lors, dans les inscriptions de Sévère, on plaça au-dessus de tous ses titres sa descendance des Antonins[110], et son urne sépulcrale sera déposée dans leur tombeau. Cette étrange conduite avait un double motif. Sévère se proposait de faire rejaillir sur sa maison l’éclat de la plus illustre des dynasties impériales, ces glorieux Antonins que les poètes élevaient maintenant au-dessus des dieux[111] ; mais il voulait du même coup mettre la main sur les innombrables domaines que cinq générations d’empereurs, tous héritiers les uns des autres, avaient légués à Commode. A la mort de ce prince, une immense fortune était passée à ses trois sœurs encore vivantes ; Sévère, que tant de richesses aux mains de particuliers effrayaient, s’en attribuait une partie sur l’heure, comme héritier politique ; le reste, à courte échéance, comme héritier civil, en se disant fils adoptif de Marc-Aurèle. Du jour au lendemain le plus pauvre des empereurs en devenait le plus riche[112]. Cet acte eut de graves conséquences. Tant que Sévère ne porta que le nom de Pertinax, qui était cher au sénat, cette assemblée, tout en ayant quelque défiance à l’égard du rude, soldat, laissa les événements se dérouler sans chercher, même par ses vœux, à en modifier le cours. Mais se dire le frère du prince que les Pères avaient en exécration et réhabiliter sa mémoire maudite, c’était justifier ses actes et prendre aussi comme héritage sa haine contre les grands. De ce jour, la peur et la colère agitèrent sourdement la curie, et l’on conspira en pensée pour Albinus. La rupture fut-elle précédée, comme on l’a dit, d’une tentative d’assassinat[113] ? Tout le monde pensait alors qu’un coup de poignard était un bon moyen de simplifier une question difficile, et, à cet égard, Sévère pensait certainement comme tout le monde. Mais ceux qui étaient exposés à de telles surprises avaient l’habitude de se bien garder, et le procédé attribué à l’empereur était si facile à découvrir, qu’on peut douter qu’il l’ait employé. Spartien et Dion Cassius ne parlent pas de ces émissaires, envoyés avec de fausses lettres et du poison, qui, d’après les aveux que la torture arrache toujours, devaient attirer Albinus à une conférence secrète et l’y poignarder, ou gagner son cuisinier, afin qu’il mêlât du poison à ses mets. Le César breton était trop intéressé à faire courir de tels bruits pour qu’ils ne soient pas suspects. Sévère ordonna tout pour la prochaine campagne avec sa
promptitude ordinaire. Des troupes allèrent garder les défilés des Alpes,
tandis que le gros de ses forces, continuant à remonter la vallée du Danube,
tournait les montagnes au nord et entrait en Gaule par la province de la
haute Germanie. Lui-même gagna Rome d’une course rapide[114], y fit
confirmer par le sénat la déclaration de son armée contre Albinus et l’élévation
de son fils au rang de césar ; puis il revint se mettre à la tête de ses
soldats, qui s’avancèrent divisés en deux corps. Une députation envoyée
quelque temps après par les sénateurs trouva Caracalla dans Dion rapporte un fait curieux. Un petit grammairien de Rome, pris tout à coup d’ardeur guerrière, ferma son école et se rendit en Gaule. Il se donna pour un membre du sénat chargé par l’empereur de lever une armée, rassembla des troupes et battit plusieurs corps de cavalerie albinienne. Sévère, le croyant réellement sénateur, lui écrivit pour le féliciter. Numerianus, c’était son nom, courut tout le pays, rançonna les villes ennemies et ramassa jusqu’à 17.750.000 drachmes, qu’il envoya au prince. La guerre finie, il vint le trouver et lui avoua sa ruse. Il pouvait tout obtenir ; il refusa même d’entrer au sénat et n’accepta qu’une petite pension dont il alla vivre aux champs. Voilà un maître d’école à la fois homme d’action et philosophe ; mais son histoire montre l’immense désordre causé par ces guerres civiles. A en croire Dion, trois cent mille hommes, cent cinquante raille de chaque côté, allaient se heurter en Gaule. Rome, suivait d’un regard mélancolique ces événements lointains. Tandis que l’univers était ébranlé par ce grand choc, dit l’historien, nous autres sénateurs, nous restions tristement inactifs. Le peuple, même dans les fêtes accoutumées, montrait sa douleur. Aux jeux du Cirque, je vis une immense multitude ; mais son attention n’était point aux courses : pas un cri, pas un encouragement aux cochers. Tout à coup, après un grand silence, une seule clameur s’éleva : La paix pour le salut du peuple ! Le sénat et Rome, sans force contre ces ambitieux, ne demandaient que le repos avec n’importe quel maître. C’était, sous une autre forme, le mot d’Asinius Pollion avant Actium : Je serai le butin du vainqueur. Un engagement où les troupes d’Albinus eurent l’avantage
sur le lieutenant de Sévère précéda l’action principale, qui se liera sur les
bords de Mais le moment où Sévère gagnait cette gloire est aussi celui où il mit sur son nom une tache de sang. A l’annonce des premiers succès remportés par Albinus, le sénat, croyant l’empereur perdit, s’était empressé de faire frapper une monnaie d’argent au nom du nouvel auguste, et d’accorder des honneurs à son frère et à ses proches[117]. De la part de gens si avisés, c’était une bien grande imprudence, qui ne s’explique que par l’arrivée de quelque bulletin menteur d’Albinus. Sévère leur avait aussitôt écrit : Rien ne peut m’être plus pénible, pères conscrits, que de voir vos préférences pour Albinus. Après avoir largement pourvu aux approvisionnements de Rome, j’ai soutenu pour la république plusieurs guerres, et par la mort de Niger je vous ai délivrés de la tyrannie. Ah ! vous avez bien reconnu et dignement récompensé mes services ! Vous êtes allés prendre un aventurier d’Hadrumète, qui se prétend de la famille des Ceionius, et, moi vivant, vous en avez fait un empereur ! Vous manquait-il, ô noble sénat, quelqu’un que vous deviez aimer ? Mais vous attendiez de cet homme des consulats, des prétures, des commandements. Un fourbe, habile à soutenir toutes les impostures, voilà celui que vous m’avez préféré. Il ne vous restait qu’à décerner le triomphe à cet illustre capitaine, comme à mon vainqueur. J’en rougis vraiment ; vous l’avez pris pour un lettré, lui qui n’a jamais occupé son esprit que de contes absurdes et qui a vieilli entre les Milésiennes d’Apulée, son digne ami, et toutes les niaiseries littéraires[118]. Avant de l’avoir vaincu, Sévère voulait rendre Albinus ridicule, en lui ôtant les aïeux qu’il s’était donnés et les talents qu’on lui prêtait, deux vanités dont lui-même était possédé. Après la bataille de Lyon, arriva un message plus terrible : la tête d’Albinus, plantée au bout d’une pique, en face de la curie, et ces mots qui terminaient une lettre menaçante : Voilà comment je traite qui m’offense. Bientôt Sévère lui-même parut au milieu du sénat (juin 197). Il loua la sévérité de Sylla, de Marius et d’Auguste, qui les avait sauvés, et blâma la douceur de Pompée et de César, qui les avait perdus. Puis il fit l’apologie de Commode, reprochant aux sénateurs de l’avoir noté d’infamie[119], eux qui, pour la plupart, vivaient d’une manière plus infâme. Si l’on trouve étrange, nous dit-il, qu’il ait tué des bêtes de sa main : hier et avant-hier, l’un de vous, vieillard consulaire, ne jouait-il pas en public avec une courtisane qui imitait la panthère ? Par Jupiter ! Vous dites qu’il s’est battu en gladiateur. Aucun de vous ne fait donc ce métier ? Mais alors pourquoi ses boucliers et ses casques d’or ont-ils trouvé des acheteurs ? A la suite de ce discours qui fit grande peur au sénat[120], un procès capital fut intenté à soixante-quatre sénateurs accusés d’avoir soutenu le parti d’Albinus : trente-cinq, trouvés innocents reprirent leur siège, et Dion, qui n’aime point Sévère, constate que, dans la suite, il se conduisit avec eux comme s’ils ne lui avaient jamais donné de doute sur leur fidélité ; vingt-neuf, condamnés à mort, furent exécutés[121]. Parmi eux se trouva ce Sulpicianus qu’on avait vu, après le meurtre de Pertinax, marchander l’empire et baiser les mains couvertes du sang de son gendre. Des partisans de Niger jusqu’alors épargnés, sa femme, ses enfants et six de ses proches périrent : Sévère réglait en une fois tous ses comptes. Ces sévérités trouvent non pas leur excuse, mais leur
explication dans les dangers que l’empereur venait de courir : en face, un
redoutable adversaire soutenu par les forces des provinces occidentales ;
derrière, en Italie, des trahisons ; en Orient, une invasion des Parthes et
une révolte militaire, celle de la légion IIIa Cyrenaïca
qui, de ses cantonnements d’Arabie, pouvait mettre encore Les Gaules, l’Espagne, eurent leurs proscrits. Tous ceux qui avaient aidé Albinus payèrent de leur tête ou de leur fortune la faute de n’avoir pas su prévoir quel serait le vainqueur. Un de ces proscrits suppliait l’empereur de l’épargner. Si le sort des armes, ô César, t’avait été contraire, que ferais-tu dans l’état où je suis ? — Je me résignerais à souffrir ce que tu vas souffrir. Et il le fit tuer. Qui veut détruire les factions, disait-il, doit être cruel un jour, afin d’être clément le reste de sa vie[124]. Il y eut des résistances isolées[125], surtout dans la péninsule ibérique, où Sévère envoya un de ses meilleurs généraux, Tib. Claudius Candidus, le vainqueur de Nicée, pour combattre sur terre et sur mer les rebelles de la Citérieure[126]. Une autre inscription parle d’un tribun qui servit dans la campagne entreprise pour écraser la faction gauloise[127]. Lyon avait souffert de cette grande lutte livrée à ses portes ; mais elle en effaça bien vite les traces et se hâta de se montrer fidèle au vainqueur. Deux mois et demi après la bataille, un taurobole y fut offert pour le salut de l’empereur, du césar son fils, premier empereur désigné, de l’impératrice Julia Domna, la mère des camps, et de toute la maison divine. Durant quatre jours la religion déploya ses pompes les plus imposantes pour cette solennité qui scellait la réconciliation de la dynastie africaine avec les populations gauloises[128]. A Rome, tandis que vingt-neuf familles sénatoriales pleuraient leurs morts, la populace et les soldats étaient en liesse. Ceux-ci avaient eu de larges gratifications, celle-là un congiaire, des fêtes et des combats de gladiateurs[129], pour la dédommager de n’avoir pas joui du spectacle de tant de milliers de Romains tombés dans les batailles de la guerre civile. Sévère pouvait se reposer. Le monde romain, deux fois
parcouru et pacifié ; l’Euphrate et le Tigre franchis ; le Rhin et le Danube
roulant leurs flots paisibles sous les enseignes romaines : tout invitait le
prince à tourner son infatigable activité vers les travaux pacifiques. Mais,
durant la guerre des Gaules, le roi des Parthes, Vologèse IV, avait envahi Pour les Romains de ce temps-là ; l’ennemi c’était surtout
le Parthe. Successeur de Cyrus et d’Alexandre, l’héritier des Akhéménides
pouvait seul, dans l’univers connu, jeter une ombre sur la majesté impériale.
Les déserts qui protégeaient ce peuple, la mort de Crassus, les vains efforts
d’Antoine et jusqu’aux succès éphémères de Trajan, tout faisait de lui un
voisin incommode et odieux. Le vaincre était la grande ambition des chefs
militaires de Rome. Nous avons dit plusieurs rois pourquoi cette victoire
définitive était impossible. Sévère résolut d’infliger au moins une honte au
grand empire oriental, et de lui fermer les approches de Avec les bois que lui fournit une forêt voisine de l’Euphrate, il construisit une flotte pour porter son gros bagage, tandis que les soldats suivaient sur la rive. Il arriva ainsi à Babylone et à Séleucie, qui n’avaient plus de grand que leur nom, et s’empara de la cité royale des Parthes, d’où il emmena cent mille captifs. C’était la troisième fois en ce siècle que les Romains entraient dans Ctésiphon. Le retour par la vallée du Tigre fut difficile à cause de la pénurie des vivres et des pâturages. Comme Trajan, Sévère assiégea la forte ville d’Atra[133] (El-Hadhr), dont le roi s’était allié à Niger, et il échoua comme son glorieux prédécesseur, malgré les machines de l’ingénieur Priscus. Au milieu de ce désert sans eau, on ne pouvait recourir à un blocus, le grand moyen des anciens pour réduire une place. Après vingt jours de vives attaques, il leva le siège et rentra, par la haute Mésopotamie, dans les provinces syriennes, à la fin de 198 ou au commencement de l’année suivante. Durant ce siège, où l’armée endura de grandes souffrances, il y avait eu un moment d’indiscipline, et il fallut faire un exemple. Un tribun du prétoire avait cité et sans doute commenté dans des conciliabules les paroles que Virgile met dans la bouche du lâche Drancès, le partisan de la paix à tout prix : On ne tient nul compte de nous, et nous périssons par l’ambition d’un homme. Sévère l’avait fait mettre à mort, châtiment extrême, mais peut-être mérité. Ces gens d’épée qui désespèrent, quand ils ont le devoir d’espérer même contre toute espérance, perdent les causes qu’ils sont chargés de défendre, en jetant le découragement dans le cœur des soldats. Ainsi, devant Atra, l’empereur, craignant de n’être pas obéi de l’armée[134], avait renoncé à une dernière attaque qui semblait devoir réussir. Est-ce à ce moment que périt Lætus[135] ? A la bataille de Lyon, Lætus, qui commandait la cavalerie, n’avait chargé qu’après avoir appris que l’empereur paraissait mortellement blessé, et cette charge avait décidé la victoire. Sévère mort, Albinus vaincu, Lætus aurait pris leur place[136] ; mais l’empereur vivait : ce qui peut-être avait été une trahison devint l’habile manœuvre d’un grand capitaine. Sévère le crut, ou le laissa dire : Dion prétend que, né pouvant frapper sur l’heure celui qui paraissait l’avoir sauvé, il attendit, et que, en Mésopotamie, il fit tuer Lætus dans un tumulte de soldats[137]. Il n’y eut probablement ni trahison de l’un, ni émeute militaire suscitée par l’autre. Dion était bien loin des lieux où cette tragédie s’accomplissait. Il n’a donc pu recueillir que les bruits qui arrivèrent à Rome. Or deux choses sont absolument contraires au caractère connu du prince : cette longue hésitation à frapper l’homme dont il avait, dit-on, résolu la mort, et le dangereux moyen qu’il aurait employé, une émeute militaire, qu’on n’est jamais sûr d’arrêter au point voulu. Il est certain que Lætus fut tué par les soldats, et nous savons qu’à ce moment des désordres se produisaient dans l’armée : il aura laissé sa vie en voulant les apaiser. A Ctésiphon, l’empereur avait abandonné tout le butin à ses soldats. Pour remercier leur chef en flattant sa faiblesse paternelle, ceux-ci avaient salué Bassianus du nom d’auguste et proclamé Geta césar. Au titre du premier, Sévère attacha la puissance tribunitienne (198). Caracalla, bien qu’il ne fût encore que dans sa onzième année, était donc associé à l’empire : honneurs prématurés et funestes à celui qui en était l’objet. Dans cet empire électif la tendance à l’hérédité était irrésistible. Le père cédait toujours à ce sentiment naturel, et toujours aussi on acceptait sa volonté. Cependant, Titus excepté, l’hérédité n’avait donné que de mauvais princes, Caligula, Domitien et Commode. L’empereur désigné ajoutera bientôt à cette liste un des noms les plus odieux de l’histoire[138]. Malgré la vaine tentative sur Atra, Sévère venait de frapper un grand coup en Orient. La chute de Ctésiphon avait retenti jusqu’au fond des provinces les plus lointaines, et l’on célébrait partout le grand vainqueur des Parthes, Parthicum Maximum. L’empire n’avait pas été considérablement agrandi, chose inutile ; mais une crainte salutaire était inspirée à ceux qui avaient violé sa frontière, et elle les fit tenir en repos pendant dix-huit années. Sévère méritait donc le titre qu’il reçut de propagator imperii. On lui en donna bien d’autres[139], pacator orbis, fundator pacis, etc., car la force qu’attestait une fortune si constamment heureuse avait excité un enthousiasme à la fois servile et reconnaissant. D’innombrables a inscriptions, surtout dans les provinces helléniques et africaines, en portent témoignage. Athènes, qui avait à se faire pardonner de n’avoir pas su prévoir la fortune du futur empereur, se signala par la ferveur de son zèle[140], et mille cités offrirent le sacrifice triomphal du taureau. Par sa femme, Julia Domna, Sévère était à moitié Syrien. Avant son avènement à l’empire, il avait commandé en Syrie la quatrième légion scythique (182-184) ; après la mort de Niger, il y resta plus de deux ans, quatre encore après celle d’Albinus. Il connaissait donc bien ces pays et tous leurs besoins. Mais à quoi servirent ces longs séjours, surtout depuis la fin de la guerre Parthique ? Ce ne fut certainement pas le plaisir qui le retint dans les provinces orientales. La mollesse était sans prise sur un tel homme, qui avait l’ambition des grandes choses, et par conséquent le mépris des petites. Son biographe dit, à propos d’une de ses provinces, que Sévère y fit beaucoup de règlements, dont l’inepte écrivain se garde de rapporter un seul. Soyons assurés qu’il employa ses loisirs à mettre la discipline dans les légions, tous les moyens de résistance dans les places avancées, l’ordre dans le pays, la sécurité sur les routes, et qu’il développa au sein de ces populations la vie romaine, afin de pouvoir mieux compter sur leur fidélité. Un petit nombre de faits révélés par des témoins irrécusables, les médailles et les inscriptions, nous permettront de soupçonner tous ceux que l’histoire officielle nous cache. D’abord, entre l’Euphrate et le Tigre, il organisa Au nord-ouest de la province, le roi de l’Osrhoène lui avait livré ses enfants en otage et donné d’habiles archers pour la campagne contre les Parthes[143] ; au nord, le roi d’Arménie avait été maintenu dans sa fidélité à l’empire ; au sud, la garnison de Zaitha imposait aux chefs arabes l’obéissance, et, à l’est, le passage du Tigre était assuré par l’occupation de Ninive, où Trajan avait établi des vétérans et où Sévère doit en avoir laissé, pour bien défendre cet extrême avant-poste de l’empire[144]. Il avait donc solidement établi sa domination entre les deux fleuves, eu l’adossant aux montagnes arméniennes et en l’appuyant sur tout un ensemble de forteresses et de colonies. Aussi cette province sera-t-elle, pendant des siècles, le boulevard de l’empire. Après la mort de Niger, il avait réuni Dans La région syrienne qui descend à Sur le revers oriental du Liban et au delà du Jourdain,
Rome avait eu beaucoup à faire. Avant Trajan, le Haouran (Batanée) et le
Ledja (Trachonitide)
étaient ce qu’ils sont aujourd’hui, des solitudes parcourues par des nomades
farouches. Vous vivez, leur disait le
roi juif Agrippa, comme les bêtes fauves dans
leurs tanières[152]. Trajan et Hadrien
avaient porté l’ordre et la vie dans ces pays où s’étaient élevées de grandes
et magnifiques cités : Sévère y continua leur ouvrage. Il se rendit sans
doute aussi dans la province d’Arabie dont la légion s’était naguère
révoltée. Le nom de Septimiani porté
par des décurions de Les quarante-deux blockhaus dont on croit avoir compté les
restes entre Damas et Palmyre ont-ils été construits par Sévère ou par
Hadrien, même beaucoup plus tôt[156] ? On ne le
sait. Du moins Sévère les a tenus bien garnis d’hommes et de vivres, car, si
on ne trouve pas sa trace d’une manière certaine le long de la route qui mène
à Palmyre, on la rencontre à Palmyre même. Ce grand marché du désert, avant-poste
de Les villes du désert changèrent leurs coutumes comme les
scheiks arabes changeaient leurs noms : Alors comme aujourd’hui, les nomades étaient obligés de conduire, durant l’été, leurs troupeaux aux sources de Palmyre ou aux pâturages du Djebel Haouran[162]. En occupant fortement ces points, les Romains se rendaient maîtres du désert, et ils en ont fait la police mieux que personne n’a jamais su la faire. A l’extrémité orientale du Haouran, au milieu d’une région
qui semble maudite, s’élève une montagne volcanique dont le pied porte un
camp romain avec des murailles épaisses de plus de Ainsi la vie régulière s’introduisait dans ces régions désolées. A l’abri des postes fortifiés qui bordaient le pays de la soif, des villes s’élevèrent dans les vallées, des canaux y amenèrent l’eau des montagnes[164] ; le régime municipal s’y développa, et les inscriptions nous parlent de stratèges et de décurions eu des lieux où rte retentit plus que le cri du chacal. Souvent, du haut d’un amas de ruines, le voyageur aperçoit au loin de larges dalles de basalte régulièrement disposées et encadrées d’un double cordon de pierres plus fortes qui font saillie. C’est une voie romaine qui, après quinze siècles, annonce qu’un grand peuple a passé par là[165]. Sur mille points, de ces terres bibliques, on retrouve son empreinte. Le plateau de Baalbek a porté, depuis une haute antiquité, un sanctuaire de Baal, le grand dieu des Sémites : mais les ruines magnifiques qu’on y voit aujourd’hui sont du temps des Antonins et de Sévère[166]. Il faut donc retourner le vers de Juvénal : ce n’est plus l’Oronte qui coule dans le Tibre ; au second siècle de notre ère et au commencement du troisième, c’est le Tibre qui coule au désert et qui porte l’esprit et les arts de l’empire jusque dans l’inaccessible cité de Pétra. Sévère venait de suivre jusqu’à Ctésiphon les traces de Trajan ; il suivit celles d’Hadrien en Palestine et en Égypte. Sévère était de ces hommes prêts à tout sacrifier au repos public[168]. Par malheur, il comprit les chrétiens parmi les perturbateurs des provinces. Les Juifs et les Samaritains venaient de recommencer en Palestine, les armes à la main, leur querelle séculaire. Des chrétiens s’y mêlèrent-ils : on ne sait. Mais ce bruit de combats, à propos de croyantes religieuses, irrita le prince. Les légions frappèrent quelques coups, et des exécutions rétablirent la tranquillité. Le sénat voulut donner plus tard à ces mesures de police l’importance d’une victoire. Quand l’empereur refusa de faire dans Rome une entrée triomphale pour la prise de Ctésiphon, les sénateurs, afin de ne pas priver son fils d’une flatterie et Rome d’une fête, décernèrent un triomphe juif à Caracalla. En vue d’empêcher le retour de ces désordres, Sévère, dit son biographe, fit, durant ce voyage de Palestine, beaucoup de règlements. Nous n’en connaissons qu’un renouvelé de l’ancien rescrit impérial qui défendait aux rabbins de pratiquer la circoncision sur des hommes étrangers à leur race[169] et aux chrétiens de continuer leur propagande. La même mesure était appliquée aux deux religions, non en vue de les détruire, mais afin de les empêcher de s’étendre. On verra ailleurs que cet édit eut, pour elles, des conséquences très différentes. Sévère ne voulut pourtant pas que ces Juifs enfermés par
son rescrit dans leur religion et flans leur race fussent comme des parias au
milieu de leurs concitoyens ; il leur permit d’aspirer aux honneurs municipaux
en les dispensant des obligations contraires à leur culte[170]. Mais les mœurs
seront plus fortes que la loi ; les Juifs resteront à l’écart jusqu’au temps
où Constantin, préoccupé du souci de recruter la classe épuisée des curiales,
ordonnera d’y comprendre tous ceux qui auront en biens-fonds la fortune
nécessaire pour y entrer[171]. Recrues peu
nombreuses, car les Juifs, se considérant, hors de De Au mont Casius, Sévère fit, comme Hadrien, un sacrifice funèbre sur le tombeau de Pompée et remonta le Nil par la bouche Pélusiaque[174]. Il visita curieusement les pyramides de Gizeh, plus belles ou du moins plus régulières en ce temps-là qu’aujourd’hui, parce qu’elles avaient encore leur revêtement ; le grand Sphinx, couché à leur pied, symbole solaire déjà dégradé par les vingt siècles qui avaient passé sur lui et que Sévère fit réparer ; le Serapeum de Memphis, qui conduisait aux tombeaux des Apis, qu’un des nôtres, Mariette, a retrouvés ; le Labyrinthe, les merveilles de Thèbes et de Philæ, etc. Il se fit expliquer les hiéroglyphes que l’on continuait à graver aux parois des temples[175], et Champollion a lu son nom à côté des sculptures que l’empereur commanda pour le pronaos du grand temple d’Esneh[176]. Memnon lui parla encore : ce fut pour la dernière fois. Par excès de zèle pieux, Sévère reconstitua, tel qu’on peut le voir à présent, le colosse brisé au temps d’Auguste ; mais du jour où la statue ne présenta plus au soleil levant sa large cassure à surface inégale, imprégnée de l’humidité de la nuit, le dieu cessa de faire entendre sa voix divine[177]. Curieux de toutes choses, même des plus secrètes, humaines ou divines, Sévère s’informa certainement des sources du Nil, dont les Romains s’étaient fort approchés[178]. Dion Cassius en parle à propos de ce voyage de l’empereur, qu’il lui avait peut-être entendu raconter, et, s’il se trompe en mettant l’origine du fleuve à l’extrémité de l’Atlas maurétanien, il dit presque vrai en le faisant sortir d’immenses marécages qui s’étendaient au pied d’une haute montagne couverte de neige[179]. Sévère s’était proposé de pénétrer dans la vallée supérieure du Nil ; une peste l’arrêta, et le fleuve le ramena dans Alexandrie. Il y visita le tombeau d’Alexandre, le Musée, toujours occupé de ses travaux stériles[180], et la bibliothèque fameuse du Serapeum dont la colonne dite de Pompée, encore debout, ornait une des cours. Il se plut dans cette ville ou crut politique de lui témoigner sa faveur. Les Alexandrins avaient pris parti pour Pescennius et mis sur leurs portes : Cette ville appartient à Niger notre maître. Quand Sévère arriva, ils lui dirent : Oui, nous l’avons écrit, mais en croyant bien que toi tu étais le maître de Niger[181]. L’empereur n’en demandait pas davantage pour pardonner. Il leur rendit le sénat et les magistrats municipaux qu’Auguste leur avait ôtés, révisa leurs lois[182], restreignit à la juridiction volontaire les fonctions du juridicus romain, qui depuis plus de deux siècles était le juge suprême dans Alexandrie, et, pour marquer sa confiance à cette province, il leva la règle établie par le premier empereur que l’Égypte n’aurait pour gouverneur qu’un préfet d’ordre équestre[183] ; enfin il dota la ville d’un gymnase et d’un grand temple qu’il appela, comme celui d’Agrippa à Rome, le Panthéon[184]. Sévère était, à l’exemple de Trajan et d’Hadrien, un grand bâtisseur, et l’Égypte n’était point faite pour lui ôter le goût des constructions monumentales. L’étrange pays avait fait sur l’impérial voyageur l’impression accoutumée. Dans la suite, Sévère revenait volontiers à ses souvenirs d’Égypte et se plaisait à rappeler les merveilles de la terre des Pharaons. Le culte de Sérapis, dont il avait partout rencontré les sanctuaires[185], l’attira particulièrement. Il fut frappé de cette puissante synthèse de doctrines différentes par laquelle les païens essayaient de donner satisfaction aux idées alors dominantes d’unité divine et de salut par le dieu maître de la lumière et de la nuit ; de la vie et de la mort. Macrobe a conservé cette réponse d’un oracle de Sérapis : Qui je suis : je suis le dieu que je vais dire : la voûte du ciel est ma tête ; la mer, mon ventre ; la terre, mes pieds ; la région éthérée, mes oreilles, et, pour œil, j’ai le brillant flambeau du soleil qui porte partout ses regards[186]. D Sérapis représentait donc le dieu en qui tous les autres se confondaient ; uni à Isis, la déesse aux mille noms, il était la force qui féconde et la nature qui conçoit ; mais il était aussi le dieu qui assurait le salut sur la terre et au ciel. Les pèlerins encombraient ses temples, dont les parois disparaissaient sous les ex-voto, et l’on ne parlait que de ses cures miraculeuses, tandis que les vieilles déités restaient mornes et silencieuses auprès de leurs autels désertés. Sévère et les siens paraissent avoir été gagnés à ce culte[187]. Caracalla, du moins, lui consacra plusieurs temples jusque dans Rome, notamment prés du Colisée, un sanctuaire d’Isis et de Sérapis qui donna son nom à cette région de la ville[188] ; et lorsqu’on voit Sévère élever un Panthéon dans Alexandrie, on est disposé à croire qu’il fut conduit par une idée de syncrétisme religieux à donner le nom de tous les dieux au temple que, dans sa pensée, il dédiait au seul principe divin. Ainsi se précisait ce paganisme nouveau que nous avons montré en voie de formation au siècle précédent et qui préparait les voies au Jéhovah mosaïque[189]. Malgré ses préoccupations religieuses, Sévère ne fut pas en Égypte plus favorable qu’il ne l’avait été en Palestine aux disputes théologiques. Il enleva de tous les sanctuaires les livres contenant les doctrines secrètes, celles dont se nourrissent les associations qui vivent dans l’ombre et d’où sortent parfois les menées séditieuses. Ces livres, il ne les détruisit pas, mais il les enferma dans le tombeau d’Alexandre, afin que personne ne pût les lire. C’était un vrai Romain, un de ces hommes d’épée et de gouvernement qui n’aiment pas les choses que l’épée ne tranche jamais et dont les gouvernements s’inquiètent toujours. Mais c’était aussi un esprit élevé. Parmi ces livres, il en est un qu’au lieu de proscrire il admira certainement, le Livre des Morts, que nous retrouvons avec les momies dont il était comme la voix par delà le tombeau. On y lit des paroles telles que celles-ci : Quand l’intelligence, principe divin, entre dans une âme humaine, elle essaie de l’arracher à la tyrannie du corps et de l’élever jusqu’à soi.... Souvent elle triomphe ; alors les passions dominées deviennent des vertus, l’âme dégagée de ses liens aspire au bien et devine les splendeurs éternelles, à travers le voile de la matière qui obscurcit sa vue. Quand l’homme est mort à la terre, son âme comparaît devant Osiris, et ses actions sont pesées dans la balance infaillible. Si elle est reconnue coupable, elle est livrée aux tempêtes et aux tourbillons des éléments conjurés, jusqu’à ce qu’elle puisse rentrer dans un corps qu’à son tour elle torture, qu’elle accable de maux et précipite au meurtre et à la folie. Le méchant est un damné qui expie les fautes d’une première existence. Mais le ciel s’ouvre pour l’âme qui a pu dire à son juge : J’ai suivi la justice et dit la vérité ; jamais une plainte ne s’est élevée contre moi ; j’ai chéri mon père et ma mère ; j’ai été la joie de mes frères et l’amour de mes serviteurs. Je n’ai commis aucune fraude, aucune abomination. L’ouvrier n’a pas, chaque jour, exécuté pour moi plus de travaux qu’il n’en devait faire. Je n’ai ni desservi l’esclave auprès de son maître, ni chassé le troupeau du pâturage, ni commis l’adultère ou la fornication. Je suis pur ! Je suis pur ! Et encore : Je n’ai ni menti ni fait le mal, et j’ai semé la joie, donnant le pain à l’affamé, l’eau à l’altéré, le vêtement à qui était nu. Alors cette âme pure s’élance à travers les espaces inconnus. Sa science s’accroît, sa puissance augmente, elle parcourt les demeures célestes et accomplit dans les champs d’Aalu le labourage mystique. Enfin le jour de la bienheureuse éternité se lève pour elle ; elle se mêle à la troupe des dieux dans l’adoration de l’Être parfait ; elle voit Dieu face à face et elle s’abîme en lui[190]. Ce que la vieille Égypte avait si longtemps gardé pour elle seule se répandait sur le monde. Ce pays, dont Bossuet, jugeant sur les apparences, a dit que tout y était dieu, excepté Dieu même, enseignait l’unité divine, le jugement des morts et les béatitudes éternelles gagnées par les mérites de la vie terrestre. De Memphis, de Jérusalem et de Palmyre, de plus loin encore, partait un courant d’idées, à certains égards analogues, qui en rencontrait un autre sorti d’Athènes et de Rome et se mêlait avec lui. Sur leurs eaux confondues allait voguer, d’abord discrètement et sans bruit, puis à pleines voiles, la barque de saint Pierre portant la croix triomphante. |
 Commode prit le pouvoir sans opposition. On lui
conseillait de profiter de l’épuisement des Barbares pour les accabler. Mais
de jeunes nobles, ennuyés de ces combats sans gloire dans les marécages de
Commode prit le pouvoir sans opposition. On lui
conseillait de profiter de l’épuisement des Barbares pour les accabler. Mais
de jeunes nobles, ennuyés de ces combats sans gloire dans les marécages de 
 Laissant le soin des affaires à Pérennis, préfet des
gardes
Laissant le soin des affaires à Pérennis, préfet des
gardes Renommé pour sa sévérité, Pertinax ne pouvait plaire à des
soldats qui regrettaient Commode, mais ils n’avaient sous la main personne à
qui mettre la pourpre sur les épaules, de sorte qu’entre le prince qui ne
pouvait plus rien pour eux et celui qui promettait un
Renommé pour sa sévérité, Pertinax ne pouvait plaire à des
soldats qui regrettaient Commode, mais ils n’avaient sous la main personne à
qui mettre la pourpre sur les épaules, de sorte qu’entre le prince qui ne
pouvait plus rien pour eux et celui qui promettait un  Il se trouvait en ce moment à Rome un sénateur, Julianus
Il se trouvait en ce moment à Rome un sénateur, Julianus Depuis l’extinction de la maison des Césars, on a vu des
empereurs italiens, espagnols et gaulois ; le tour des Africains est venu.
Lucius Septimius Severus était né à Leptis, le
Depuis l’extinction de la maison des Césars, on a vu des
empereurs italiens, espagnols et gaulois ; le tour des Africains est venu.
Lucius Septimius Severus était né à Leptis, le 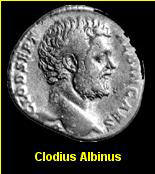
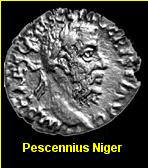 Des
deux compétiteurs du nouveau prince, Albinus et Niger, l’un avait été
retenti dans l’inaction par de trompeuses promesses ; l’autre, à la tête de
neuf légions et de nombreux auxiliaires, s’était fait reconnaître par toute
l’Asie romaine, et, dans les villes grecques, il faisait frapper
des monnaies avec des légendes latines qui lui promettaient la victoire et l’éternité,
Des
deux compétiteurs du nouveau prince, Albinus et Niger, l’un avait été
retenti dans l’inaction par de trompeuses promesses ; l’autre, à la tête de
neuf légions et de nombreux auxiliaires, s’était fait reconnaître par toute
l’Asie romaine, et, dans les villes grecques, il faisait frapper
des monnaies avec des légendes latines qui lui promettaient la victoire et l’éternité,
