|
I. LA LITTÉRATURE DE
CE TEMPS NEST PAS LEXPRESSION DE LA VIE GÉNÉRALE.
Les précédents chapitres ont montré quelles idées le peuple
romain avait sur la constitution de la famille, de la cité et du
gouvernement, par conséquent, sur les droits et les devoirs du père, du
magistrat et du prince. Cétaient, pour la plupart, de vieilles idées,
auxquelles se mêlaient, de jour en jour davantage, par le seul effet du temps
et du développement de la vie civilisée, des conceptions qui étaient
nouvelles pour ce monde si dur de lantiquité. Lesprit déquité élargissait
les formules étroites du droit quiritaire ; la famille sorganisait plus librement
: lesclave devenait une personne ; la charité prenait place dans
ladministration de lempire et des cités, les bons sentiments dans le
commerce habituel des citoyens ; et à lidée des privilèges de race se
substituait celle de la fraternité humaine. Cétait le commencement de la
plus grande révolution que le monde eût encore vue.
Que nous dira maintenant la littérature ? Quelle a été sa
part dans ce mouvement de rénovation ?
On prétend que les écrivains sont les fidèles
représentants de létat intellectuel dun peuple. Ils montrent bien les
courants supérieurs qui traversent la société et parfois lentraînent, mais
qui, souvent aussi, nexistent quà la surface ; et ils nindiquent pas
toujours les courants profonds par lesquels se déterminent les mouvements
décisifs au sein de la masse entière de la nation. Cela est vrai, surtout
pour la littérature qui succède à celle du siècle dAuguste.
Après avoir eu, de Plaute à Lucrèce, la rudesse, la force,
quelquefois léclat et les audaces de la jeunesse ; après sêtre épanouie, de
Cicéron à Ovide, en une sereine beauté, la littérature romaine arrivait à la
sénilité. Elle avait perdu le don charmant de créer qui nappartient quaux
époques privilégiées ; et au lieu dêtre lexpression de la vie nationale,
elle servait aux jeux desprit de poètes nécessiteux essayant de distraire
des sénateurs ennuyés. Elle devenait une industrie et lon en faisait métier.
La politique, qui est la science des réalités, étant interdite, on sétait
jeté dans le monde des chimères. En tout on forçait le ton : lart se faisait
colossal, ne pouvant se faire harmonieux, et il salourdissait dune
ornementation pesante. Les poètes enflaient la voix, surchargeaient la phrase
de mots qui dépassaient lidée, et, prenant le clinquant pour de lor pur,
couraient après lesprit, qui ne vaut que lorsquil vient tout seul ajouter
la grâce à la force. Quand le présent avait une vie si pleine, cette
littérature samusait aux fables mythologiques ; lorsque la société cherchait
à se purifier des souillures du siècle de Néron, elle se plaisait à remuer
celle lange. Aussi en est-elle justement punie : alors que tout prospère,
elle décline.
Ce nest point quon ne sache tous les genres décrire,
tous les procédés de style, toutes les figures de rhétorique, et quon ne les
emploie selon les règles de lécole. Comme un poète dramatique qui soccupe
bien plus dagencer savamment des machines de théâtre que de nous émouvoir
par la pitié ou la terreur, les écrivains de ce temps prennent laccessoire
pour le principal. Ce qui doit rester le commencement, de la vie littéraire
en est devenu le but et la fin : travail stérile qui occupe des esprits sans
ailes pour sélever vers les hautes régions. Aussi peut-on, sans injustice,
passer rapidement a côté deux.
Voyez les grands poètes du temps : Silius Italicus et
Stace. Ils ont bien limagination de détail ; ils nont ni dans lâme la
puissance créatrice, ni dans le cur les sentiments profonds qui donnent à
luvre du poète une vie immortelle ; ce sont des archéologues écrivant en
vers. Silius, sénateur prudent et avisé, qui lut consul sous Néron et
peut-être consul encore sous Domitien, tout en restant à peu près honnête
homme, échappait aux dangers de tels règnes, en même temps quaux soucis de
la vieillesse, en écrivant chaque jour tranquillement quelques hémistiches,
qui finirent par faire un poème de dix mille vers, que lhistorien consulte,
mais que le poète ne lit guère.
Stace, au contraire, est un improvisateur. Il tient à
avertir la postérité quil faisait vite, comme Pline voulait quon sût quil
pouvait plaider longtemps : Pas une de mes sylves,
dit-il, ne ma coûté plus de deux jours, et
quelques-unes mont coûté beaucoup moins. Il a chanté les exploits
des sept chefs devant Thèbes, ce qui devait fort ennuyer déjà les Romains de
son temps. Valerius Flaccus remonte plus haut encore, jusquaux Argonautes :
poèmes mythologiques et sans vie, plaisir dun moment pour les oisifs lettrés
et que le peuple ne pouvait comprendre. Martial, à qui lon fait vraiment trop
dhonneur, nen sait pas si long et est plus de son temps : Ma muse, dit-il, ne
se drape pas avec orgueil dans lextravagant manteau des tragiques. Eux, tout
le monde les loue et les admire, je le confesse, mais cest moi quon lit[1]. Et il a malheureusement
raison de sen vanter. On lisait partout, même, à len croire, en de chastes
maisons, ses quinze cents épigrammes, petites pièces, dont la plus longue ne
va pas à cinquante vers : On y trouve de lesprit, quelquefois du naturel, la
concision, qui est le principal mérite où il vise, et lhabileté à lancer le
trait de la fin. Mais cet écrivain à lhaleine si courte ne relève plus pour
nous un talent de troisième ordre en le prostituant dans tous les mauvais lieux.
Poète mendiant, il adule le dieu Domitien
pour tirer de lui quelques écus, et, sil promène sa muse court-vêtue dans
toutes les fanges de Rome, cest autant par calcul que par goût : il tient à bien vendre ses livres et
sassure la clientèle de tous les débauchés. Mes
vers sont licencieux, dit-il, mais ma vie est irréprochable[2]. Tu te trompes,
Martial, ta vie nest pas honnête, puisque tu spécules sur le vice pour vivre[3].
Perse déclame avec concision et obscurité sur des
sentences morales ; Juvénal, avec énergie sur les vices de Rome ; Lucain,
avec éclat sur les guerres civiles. Le premier est une noble nature, et son
livre, sorte de catéchisme de la doctrine stoïque, est plein de cette
philosophie qui porta quelques âmes si haut et que nous allons retrouver tout
à lheure. Cur virginal, esprit viril, il a de grandes pensées, de beaux
vers[4], serrés et pressants, une vie sans tache, et il
est mort à vingt-huit ans ; honorons-le :
Manibus
date lilia plenis.
Nous savons tout ce quil y a, dans Lucain, de superficiel
et de forcé, à côté de beautés éclatantes. Ses vers écrits pour quelques
jeunes gens qui, en face des orgies du despotisme, séchauffaient à limage
dune république idéale, ne répondaient pas au sentiment public. Dès le temps
des Antonins, ils étaient passés de mode[5]. Lucain regarde
en arrière ; nous naurions donc rien à lui demander pour le présent., encore
moins pour lavenir qui approche, si, dans ses vers où règne la doctrine du
Portique, alors dominante, on ne retrouvait quelques échos de son temps :
lidée de la cité universelle, du genre humain posant les armes pour
remplacer la guerre entre les peuples par une amitié fraternelle, celle même,
que les philosophes nexprimaient pas, des travaux féconds de la paix
transformant la face du monde. Après avoir montré limmense effort de César
pour envelopper dans ses lignes les troupes de Pompée, il sécrie :
Quel
labeur inutile !
Tant
de bras auraient pu joindre Abyde et Sestos,
Par
un sol rapporté, dHellen briser les flots,
Ou,
séparant Pélops de Corinthe isolée,
Épargner
aux vaisseaux le détour de Malée[6].
Lorsque larmée républicaine arrive dans loasis dAmmon,
Labienus demande à Caton de consulter loracle. Quest-il besoin, répond
celui-ci, de linterroger ?
Un
dieu vit dans nos curs, il nous parle sans voix.
En
nous donnant le jour il nous dit une fois
Tout ce quil faut savoir[7].
Ce dieu-là est celui dÉpictète, et à cette heure, saint
Paul, presque dans les mêmes termes, annonçait à laréopage dAthènes le Dieu
inconnu[8].
Juvénal fait autorité pour les murs de cette époque. Que
vaut pourtant son témoignage ? Il nous importe de le marquer, et sa vie, sa
manière décrire, nous lapprendront. Fils ou pupille dun affranchi, il ne
semble pas avoir eu une existence facile. Du moins, il ne sut réussir ni au
barreau, puisquil resta pauvre, lorsque tant dautres sy enrichissaient,
ni à larmée, puisquil ne put sélever au-dessus du grade de commandant
dune cohorte, et il déclama longtemps sans avancer davantage sa, fortune. Ce
fut sur le tard quil se mit à la poésie, dans les années où limagination
est déjà refroidie, mais lorsquil reste encore assez de chaleur au sang pour
la colère. Par sa naissance, son talent et la médiocrité de son bien[9], il était, comme
Martial, ce que nous appellerions un déclassé ; mais le poète de Bilbilis,
joyeux de caractère, aimait à rire, même dans la gêne. Juvénal, au contraire,
un de ces hommes que la nature ou leur condition rend moroses, voyait en noir
et peignit tout de cette couleur. Il ne connaît pas les nuances et sirrite
autant dun travers que dun crime. La société, où il ne trouvait quune
place modeste, lui parut naturellement mal faite, et il sen lit le juge
implacable ; à moins que cette grande colère nait été un calcul et que, au
lieu de tableaux dhistoire, il faille voir dans son uvre danciennes thèses
décole versifiées avec éloquence. Lui-même nous apprend quavant décrire il
examina froidement tous les genres en vogue et que, par ennui des élégies et
des théséides, dont ses oreilles étaient rebattues, il se décida pour la
satire parce quelle était, délaissée. Mais prudemment, il fuit son temps.
Ceux quil va flageller de sa mordante hyperbole ne seront que les morts qui reposent le long de voies Latine et
Flaminienne[10], les compagnons
de Néron, du prince jeune, artiste et débauché, qui lâcha la bride à tous les
vices et rendit Rome capable de toutes les folies dont il était lui-même
possédé. Juvénal a composé seize satires, brillantes et sonores, contre les
femmes, les nobles, les hypocrites, etc. : portraits exacts peut-être pour quelques
individus, faux assurément comme représentation de la société entière. Cessez
donc de prendre Juvénal pour le peintre véridique des murs romaines, surtout
des maths du temps où il a vécu, le grand siècle des Antonins.
Les prosateurs sont plus dans la vie réelle : ont-ils
exercé une action plus sérieuse, Sénèque, dont nous parlerons plus loin,
étant mis à part ?
Pétrone, qui est à moitié poète, et Apulée, qui aurait pu
lêtre, ont écrit deux romans picaresques Où se révèle toi côté hideux des
murs romaines, mais sans avoir plus de prétention à la vérité générale que
nen ont les auteurs douvrages de ce genre. Apulée, esprit élevé qui a sa
place dans le mouvement philosophique du temps, semble avoir voulu par
gageure vivre quelques jours en mauvaise compagnie. Heureusement il en sort
dune manière qui est pour lui-même et pour son lecteur une délivrance.
Pétrone sest aussi délassé pour un moment des élégances du monde en courant
les tripots : grand seigneur ennuyé qui sencanaille pour se distraire.
Nous ne laisserions pas traîner ces livres sur nos tables
; la bonne compagnie romaine les mettait pourtant sur les siennes. Aussi
serions-nous disposés à en conclure que celle-ci cherchait des distractions
bien grossières, si nous ne savions que la haute société de notre
dix-septième siècle, comme une honnête lemme qui peut entendre bien des
choses sans que sa vertu en soit troublée, se plaisait à la lecture de
Pétrone, de même quelle ne seffarouchait pas des gros mots de Molière. Nous
avons raffiné la pudeur ; en valons-nous mieux ?
Pline lAncien a la curiosité dun savant ; il en est mort
; mais il na pas lesprit scientifique. Cest un collectionneur, ramassant
tout ce quil rencontre, le mauvais comme le bon, et disposant les faits dans
ses casiers, suivant un ordre extérieur, sans choix, sans critique et sans
les unir jamais par un lien philosophique. La science dAristote, de
Théophraste, dHippocrate et dHipparque devient pour lui un empirisme
souvent grossier. De la nature et de la vie il ne voit que la surface, tout y
est pour lui phénomènes et accidents, rien ny est harmonie ou loi générale.
Les déclamations quil. intercale çà et là dans son immense catalogue, tenues
autrefois pour très éloquentes, ne sont plus, vues de près, que très peu philosophiques.
Cependant, nous devons de la reconnaissance à cet ami de Vespasien qui,
chargé de devoirs publics, fut, comme lui, honnête au pouvoir, et qui,.comme
le prince encore, travailleur infatigable, prenait sur ses nuits pour lire et
nous conserver ce quil avait appris. Son recueil prouve une fois de plus ce
que nous appellerions, dans le style étrange daujourdhui, la tendance
réaliste de lesprit romain ; ce livre formé des débris de deux mille volumes
que nous avons perdus, est lui-même un des. plus précieux débris de
lantiquité classique et la mine abondante que doivent fouiller sans cesse
ceux qui veulent connaître les murs, lindustrie, les arts et mille faits
curieux de lhistoire du premier siècle de notre ère.
Son neveu, Pline le Jeune, dans le panégyrique de Trajan
et dans beaucoup de ses écrits perdus, croyait rivaliser avec Démosthène et
Cicéron : cest Fontanes succédant à Mirabeau. Dans ses lettres, Cicéron nous
mène à Rome et au sénat, dans les villas des grands et dans les gouvernements
de provinces ; il nous dit les intrigues qui se nouent, les ambitions qui
sagitent, les événements qui se préparent et ceux qui saccomplissent. Les
hommes dont il parle sont des figures vivantes quil dessine dun trait
ineffaçable. Dans sa correspondance, le lettré admire lesprit le plus vif et
le style le plus net ; lhistorien voit une société qui sy reflète comme en
un miroir, et le philosophe, en présence dun homme qui se livre tout entier,
trouve encore à faire sa part. Les lettres de Pline, écrites pour le public,
non sous la pression des événements et de la passion, mais pour le seul
plaisir décrire, manquent de naturel et dintérêt. Lauteur pose pour le
portrait quil veut quon fasse de lui. Aussi noublie-t-il rien de ce qui
peut relever et ennoblir son image, ni une fondation en faveur dune ville,
ni une libéralité à un ami, ou une remise à des marchands, ni ce quil considère
comme de grandes hardiesses : une visite, par exemple, dans les faubourgs de
Rome à un philosophe chassé de la ville, et certaines paroles dites au sénat,
ni ce quil estime une indifférence stoïque et méritoire, son calme en face
du Vésuve ensevelissant les villes campaniennes. Cest le défaut, sans doute,
de tous les auteurs de correspondance ; mais cette préoccupation personnelle
nest point rachetée dans ses lettres par le tableau animé, soit dune cour
brillante, soit dune société en travail dun monde nouveau. Pline reste bien
loin des grands épistoliers. Sans la correspondance officielle qui forme son
dixième livre, et où il est obligé décrire en gouverneur de province, ses
lettres nous apprendraient bien peu de chose. Elles nous laissent cependant
entrevoir une société honnête et digne, où lui-même et Tacite, sort ami,
étaient à leur place, et qui a certainement aidé lempire à vivre en
empêchant quil nappartint aux malandrins de Pétrone, aux énervés de Martial
et de Juvénal.
Tacite a une autre figure : cest un honnête homme, comme
Pline, mais, de plus, un grand écrivain qui, à certains égards, a droit de
réclamer la première place parmi les prosateurs latins. Sa pensée est
vigoureuse comme son style, quoique la profondeur en soit plus apparente que
réelle, parce que, peintre incomparable et merveilleux artiste en beau
langage, il ne fut ni un philosophe ni un politique. Bien habile qui nous
dirait ses croyances. Superstitieux, il ne sait trop sil se trouve au delà
du tombeau une sanction de la vie, et il admet la fatalité, cest-à-dire le
contraire de cette liberté quil aime tant. Tout au plus laisse-t-il à la
sagesse humaine le pouvoir de choisir, dans la voie tracée par le destin,
létroit sentier où ne se trouve ni bassesse ni péril, parce quil fait
passer ceux qui le suivent entre la résistance qui perd et la servilité qui
déshonore[11].
Sa religion, sil en a une, est sombre comme son âme. Il rte croit pas à la
bienfaisance des dieux, mais il croit à leur colère. Après avoir tracé, au commencement
de ses Histoires, le tableau des calamités que lempire a déjà
souffertes, il sécrie : Jamais plus justes
arrêts de la puissance divine ne prouvèrent au monde que si les dieux ne
veillent pas à notre sécurité, du moins ils prennent soin de nous punir.
En politique, son idéal est celui que Trajan a réalisé ;
il ne désire rien de plus quun bon prince gouvernant daccord avec le sénat,
et les tragédies quil a si admirablement racontées ne lui ont pas appris
quil faut à un grand empire des gages de sécurité qui soient indépendants
des hommes. Il ne prévoit pas que les Antonins, précédés de Domitien, seront
suivis de Commode, parce que lempire, nayant ni la règle qui se trouve dans
les institutions, ni celle que les croyances imposent, vit au hasard sans
quaucune chose y assure la perpétuité du bien ou arrête linvasion du mal.
Les livres de Tacite sont de ceux quon relit toujours.
Qui, voudra restituer à notre langue la fermeté quelle perd par les
improvisations de la tribune et de la presse devra étudier sa phrase brève et
forte, plutôt que la période cicéronienne, qui se déroule en plis larges et
somptueux quune main maladroite rend si aisément flottants et lâches.
Par son caractère, par sa vie, Tacite honore les lettres
latines, et celles de tous les temps. Mais lorsquon a montré ses
indignations qui souvent légarent et ses revendications de la liberté quil
laisse toujours dans un vague éloquent, on a tout dit de son influence sur
ses contemporains. Cependant ses livres ont certainement contribué à adoucir
le caractère du principat et à rapprocher le sénat de lempereur. Cest un
service assez grand pour que lhistoire prononce son nom avec reconnaissance.
Suétone a dû faire un excellent secrétaire impérial pour
les lettres latines. Mais cet écrivain, dont la phrase est heureuse et
lexpression toujours choisie, ne paraît pas avoir jamais pensé. Cest un
petit esprit et un pauvre historien. Il ramasse sans contrôle les faits que
les archives et les monuments contemporains lui fournissent et il les dispose
suivant un ordre apparent des matières qui nest que hasard et confusion. Son
recueil est une mine précieuse de renseignements, où il faut puiser avec
prudence, mais non une uvre vivante. Le grand art de la composition lui
manque, et tout autant la philosophie qui interprète les faits et découvre la
vérité cachée sous des apparences contraires. Il a, pour des miracles
ridicules, la foi robuste du vieux temps et il seffraye des songes. Nous
navons rien à lui demander, pas davantage à Quinte-Curce, le trop crédule
historien dAlexandre, à Justin, labréviateur de Trogue Pompée, et lon sait
déjà ce quil faut penser de Fronton, malgré lamitié de Marc-Aurèle. Columelle,
Pomponius Mela et Frontin ont laissé de précieux renseignements sur
lagriculture, la géographie, la tactique et les aqueducs ; mais leurs livres
sont de ceux qui fournissent des faits sans donner des idées[12].
Nous pouvons passer aussi, sans nous y arrêter, à côté de
lInstitution oratoire, uvre correcte et froide, mais dun goût très
pur, où Quintilien a réuni toutes les recettes de lécole pour former
lorateur. Il sait bien quaucun maître ne donnera jamais linvention qui
découvre, la logique qui enchaîne, la passion qui échauffe, les accents qui
vont éveiller un écho dans les vîmes, et que, si lart fait des rhéteurs, la
nature, les circonstances et létude des grands modèles font seules lorateur
puissant. Lhabile rhéteur a, du moins, le mérite de reconnaître que cest au
contact du génie, et non dans lécole, que la flamme du génie sallume.
En somme, Tacite mis à part, tous ces auteurs ne forment
quune littérature de second ordre, souvent précieuse et maniérée, ou prenant
lexagération pour la force, la subtilité pour le naturel, et à qui manque la
faculté créatrice.
Ce nest pas que le public ait été peu favorable aux lettres.
On avait pour elles un goût très vif, et cette société ne mettait rien
au-dessus des plaisirs de lesprit. On aimait, on recherchait les livres ; on
formait des bibliothèques qui sauvaient au moins les trésors des anciennes
littératures[13],
et, comme ce goût gagnait la province, il fut utile à la propagation des
livres par tout lempire. Il y avait des libraires à Lyon, à Autun ; nous
savons que les Épigrammes de Martial couraient la Gaule, la Bretagne, et que les vers
dOvide étaient lus partout[14]. Il existait
même des sociétés littéraires. Auguste avait fondé une académie dans le
palais impérial, Caligula, celle de Lyon ; et le musée dAlexandrie était
toujours un foyer scientifique. Le fils dAgrippine avait institué les jeux
Néroniens que Domitien renouvela, en y ajoutant le concours du Capitole (agon Capitolinus) où tous les cinq ans se disputaient
des prix de poésie, déloquence et de musique.
Mais cette société était trop heureuse, et les terres trop
riches donnent des fruits sans saveur, tandis que les parfums dArabie
naissent en des sables arides : le grand art fléchissait. Cependant, si là
tribune était muette, on trouvait presque aussi souvent dans la Rome impériale que dans la Rome républicaine
loccasion de faire de brillants discours : aux tribunaux et à la curie, aux
séances de déclamation, dans les réunions de tout genre, même à larmée où de
nombreuses médailles montrent des empereurs haranguant les soldats. Enfin une
éloquence nouvelle et puissante allait naître : celle des philosophes
essayant dattirer à eux la multitude par de vrais sermons, et celle des
docteurs de lÉglise qui vont, par la parole, conquérir le monde païen.
La presse nexistant pas, on parlait plus quon
nécrivait. Cétait une nécessité dans létat des murs. Aussi léducation
faisait, dans les écoles, une très grande place à lart oratoire, et cet art,
le gouvernement lui-même le favorisait. Les plus anciennes chaires instituées
par lui furent celles des rhéteurs, ou, comme nous les nommerions, ales
professeurs déloquence. Quintilien eut la première, et léconome Vespasien
la dota dun traitement de 100.000 sesterces. Hadrien, Antonin, Marc-Aurèle,
multiplièrent ces dotations et accordèrent aux professeurs de précieuses
immunités. Toutes les cités de quelque importance suivirent cet exemple ; on
peut dire quà aucune autre époque lart de bien dire na été plus cultivé.
Les Césars, les Flaviens, étaient eux-mêmes lettrés ; les Antonins furent
artistes ou philosophes, et jamais princes nont plus fait pour le
développement de la vie intellectuelle.
Il est vrai que la politique et lhistoire étaient
muettes, du moins sous les Césars et sous les Flaviens, car, durant le règne
de Trajan, Tacite écrivait ses redoutables livres, et Suétone, le secrétaire
dHadrien, ses biographies implacables dans leur niaise impartialité. Même en
face de Néron, Lucain chantait les vertus de Pompée, et Horace, à la cour
dAuguste, avait célébré lâme indomptable de Caton, habituellement, les
empereurs laissaient à leurs sujets une liberté philosophique et religieuse[15] que lancienne
France ne posséda pas. Alors on ne pouvait discuter, sous peine de la Bastille, les choses de la religion et de la
politique ; en histoire, il fallait une réserve prudente, et le philosophe le
plus téméraire devait contenir et voiler ses hardiesses doctrinales.
Cependant le siècle de Louis XIV est notre grand âge littéraire. Malgré le préjugé
contraire, force est donc dadmettre que la nature du gouvernement exerce
fort peu dinfluence sur les lettres et ne produit ni leur éclat ni leur
décadence. Le génie naît où il lui plait, et il ny a pas de puissance
humaine capable de faire un écrivain, quand la nature ne sen est pas mêlée.
Tout au plus peut-on dire que les circonstances favorables ou contraires
aident ou nuisent d son développement. En outre, au sein de toute nation civilisée,
il existe une masse flottante dintelligence qui, comme le numéraire
circulant, tantôt plus abondante, tantôt plus rare, sert aux besoins
journaliers de la vie sociale, et une certaine quantité de force intellectuelle
qui sapplique aux besoins supérieurs de lesprit. Celle-ci est le capital de
réserve employé aux grandes spéculations. Nais la nature de ces spéculations
change avec le temps, et les uvres peuvent différer sans que le niveau
intellectuel sabaisse. Après la constitution de lempire romain, les esprits
actifs se jetèrent du côté de ladministration et de larmée, tandis que les
esprits méditatifs étudiaient les moyens dorganiser cette immense société
selon les lois les plus justes, ou dé régler la vie privée par les meilleurs
préceptes de morale.
Le même partage sest opéré à toutes les époques. LItalie
de la renaissance a cherché et trouvé la gloire dans les arts plastiques, la France du dix-septième
siècle dans le culte des plus belles formes littéraires. Napoléon, qui aurait
voulu faire de Corneille un prince, na lait que des maréchaux, et notre
temps, qui promet au talent littéraire fortune et honneur, produit surtout
des chimistes, des physiciens, des ingénieurs et des industriels. Aux quatre
époques, à côté de genres qui dominent dans lordre de lactivité
intellectuelle, il en est dautres qui languissent. De même pour lempire au
lieu dajouter de nouveaux noms à la pléiade poétique du siècle dAuguste, il
a formé des administrateurs et des jurisconsultes, des architectes et des
philosophes, et il en a formé dexcellents. Il y eut donc alors déplacement
et non pas éclipse de lintelligence. Et nest-ce pas une compensation à
labsence (.le grands poètes que davoir eu des hommes qui ont su donner la
paix et la prospérité durant deux siècles à tant de millions dhommes, qui
ont écrit les lois les plus justes, constitué la vie civile la mieux
ordonnée, et enseigné la morale la plus pure ? La nature inclémente et les
Barbares ont fait disparaître presque tous les monuments de lépoque Antonine
; mais croit-on que, si le temple de Jupiter olympien était resté debout aux
rives de lIlissus, Palmyre au milieu de son désert, Baalbek sur les pentes
du Liban, et le Forum de Trajan non loin du Capitole avec toutes les
merveilles quil enfermait, croit-on que ce siècle, si riche duvres
magnifiques dans ladministration, le droit, lart et la philosophie morale,
ne serait pas rangé parmi les grands siècles de lhistoire ?
Et puis, lorsquil sagit de mesurer la valeur
intellectuelle de ce temps, il serait injuste de ne pas tenir compte des
auteurs qui employaient lautre grand idiome de lempire. On entendait le
grec à Rome ; toute la bonne compagnie le parlait, et il nétait pas dhomme
lettré qui ne pût lire les ouvrages composés en cette langue, lesquels
navaient pas tous pour auteurs des Grecs dorigine, témoin Marc-Aurèle,
Élien et le sophiste dArles, Favorinus, à lépoque antonine, lAfricain
Cornutus, dès le temps de Néron, et peut-être Germanicus, au siècle
dAuguste. On a admis dans le Panthéon littéraire de Rome des Gaulois, des
Espagnols, des Africains : de quel droit le fermer aux écrivains des
provinces orientales, à des consulaires comme Arrien et Dion Cassius ? Nous
savons bien quil nexiste plus de a fils de Romulus e ; que le sang latin
sest perdu dans limmense corps de lempire et que la vie éclatante ou
débile de cet être nouveau dépend de la vitalité des parties qui le
composent. Quy a-t-il de plus Romains, jentends Romains de lempire, que
les grands jurisconsultes Gaius, quon a cru Grec, Papinien, Paul et Ulpien,
tous trois originaires de la
Syrie et qui parlent si bien la langue de Cicéron ?
Linfluence des livres grecs égalait celle des livres latins. Plutarque enseigna
longtemps aux bords du Tibre ; Épictète y vécut, et Lucien, le Voltaire du
temps, y déclama. Les écrits du rieur implacable nont certainement manqué de
lecteurs dans aucune province de lempire, et ceux du moraliste de Chéronée
ont mérité de rester jusquà nos jours dexcellents ouvrages déducation. Que
de générations denfants, que de grands esprits en ont fait leur lecture
favorite ! Henri IV
ne laissait jamais Plutarque bien loin de ses yeux, et Montaigne disait de
son livre : Cest notre bréviaire. Comme
Polybe, Appien est plus historien au sens moderne du mot que Tite Live ou que
Tacite. Sans Pausanias, nous connaîtrions bien mal la Grèce ; sans Dion Chrysostome, la propagande
moraliste du temps ; sans Ælius Artistide, les rêves mystiques auxquels déjà
lon sabandonnait[16].
Arrien, homme daction et de pensée, ami des Antonins et
méritant de lêtre, dune main contenait les Barbares de lEuxin et du Caucase,
de lautre écrivait lEnchiridion dÉpictète. Ce livre, objet de
ladmiration de Pascal et où saint Borromée trouvait son édification, en suscita
un autre, le Είς
έαντόν, qui a valu à Marc-Aurèle sa
sainte renommée. Voilà suffisamment de noms illustres pour reconnaître quon
ne va pas trop loin en appelant une renaissance cette floraison nouvelle des
lettres grecques au temps des Antonins[17].
Quand le monde a-t-il été en travail de plus grandes
choses dans lordre moral ? LÉglise se glorifiait déjà de ses apologistes
latins ou grecs : Justin, Irénée, Tertullien, Minucius Félix[18], et ses docteurs
fondaient la métaphysique chrétienne, tandis que les philosophes essayaient
par un puissant effort de rajeunir et de moraliser le paganisme.
Ce siècle a aussi aimé la science, plus même quon ne
laimait du temps dAuguste, sans toutefois la pousser bien loin. Horace
aurait voulu savoir quelle force dompte la mer,
règle lannée et dirige le cours des étoiles ; mais ce nest
quune curiosité de poète. Pline, Sénèque, ont la curiosité du savant ; ils
ne se contentent pas de regarder, ils cherchent. Sénèque, qui sait quon peut
aller de lEspagne aux Indes en tournant lAfrique, a des vues prophétiques
sur lexistence de grandes terres à loccident : LOcéan,
dit-il, révélera un jour ses secrets, et Thétis
montrera de nouveaux mondes. Dans ses Questions naturelles,
il se demande sil faut faire du ciel un morne désert ; si, à part cinq
planètes dont on connaît le mouvement, le reste des étoiles demeure à la même
place comme un peuple immobile[19]. Il annonce les
comètes périodiques que notre siècle seulement a connues, et il avait le
sentiment que bien dautres vérités restaient à découvrir. Si nous consacrions tous nos efforts à la science ; si une
jeunesse tempérante en faisait son unique étude, les pères, le texte de leurs
leçons, les fils, lobjet de leurs travaux, à peine arriverions-nous au fond
de cet abîme où dort la vérité, quaujourdhui notre main indolente ne
cherche quà la surface du sol[20]. Dans les
moments où il croit à une autre vie, il promet aux bons que tous les secrets
de la nature leur seront dévoilés[21].
Deux hommes, Galien et Ptolémée, dont les doctrines ont
vécu treize siècles, jusquà la Renaissance, représentent alors, avec éclat,
lesprit scientifique. Galien fui, après Hippocrate, le plus grand médecin de
lantiquité par la sûreté de son diagnostic, par limportance quil donnait à
lanatomie et, chose nouvelle, à lexpérience[22]. Il disséquait
des singes et voulait que des démonstrations pratiques permissent de vérifier
la vérité des doctrines enseignées : cétaient les débuts bien incertains
encore, mais trop vite arrêtés, de notre méthode expérimentale. De savants
hommes croient quil fut bien prés de découvrir la circulation du sang et que
ses connaissances physiologiques font de lui le précurseur, presque sans
intermédiaires, des physiologistes de notre siècle. Ajoutons, à lhonneur de
ce grand esprit, que les historiens de la philosophie lui donnent une place
élevée parmi les philosophes de ce temps. Comme astronome Ptolémée négale
pas Hipparque[23]
; mais sil navait pas écrit sa Syntaxe mathématique, il est
probable, assure Delambre, que nous naurions eu ni Kepler, ni, par
conséquent, Newton. Je sais que je suis mortel,
fait dire une épigramme grecque à lauteur de lAlmageste, et que ma carrière ne peut être de longue durée ; mais,
quand je parcours en esprit les routes des astres, mes pieds ne touchent plus
la terre. Je suis assis auprès de Jupiter, et, comme les dieux, je me nourris
de la céleste ambroisie. Cest déjà lenthousiasme scientifique.
La
Poliorcétique dApollodore, larchitecte du grand
pont sur le Danube et du Forum de Trajan, et les immenses travaux qui
sexécutaient dans tout lempire, prouvent que les Romains, sans avoir rien
ajouté à la géométrie dArchimède et dEuclide, avaient, du moins, en
disciples intelligents, perfectionné la construction des machines[24]. Cependant le véritable
esprit scientifique manquait à cette société, et il manquera quinze siècles
encore à lhumaine raison. Par là sexplique lempire que le mysticisme
prenait sur les âmes, cest-à-dire les efforts faits pour pénétrer, par
limagination et le sentiment, les mystères de la Nature, que la science
nétait pas encore capable dinterroger sévèrement et de forcer à répondre.
Quà côté de ces hommes illustres on laisse une place pour
les préteurs, qui ont mis le vieux droit daccord avec les nouvelles idées de
justice ; pour ces jurisconsultes dont les fragments mutilés inspirent un si profond
respect ; pour ces artistes inconnus qui ont décoré Rome et les provinces de
tant de magnificences architecturales, les temples et les places publiques de
tout un peuple de statues, les palais de fresques gracieuses, les maisons particulières
de mille objets dart, meubles et vases, dont les débris trouvés à Pompéi et
à Herculanum font soupçonner lexquise élégance[25], et force sera
de dire que, sans arriver à la beauté sereine des trois ou quatre grands
siècles où lhumanité a trouvé la plus haute expression de sa puissance
intellectuelle, ce temps na pas été une époque de décadence.
Il a de singuliers rapports avec le nôtre : un grand
commerce, beaucoup dindustrie, dimmenses travaux publics, une production
dart extrêmement abondante en vers et en prose, en statuaire et en ciselure,
en temples et en villas, sans aucun de ces artistes dont lhistoire inscrit
le nom sur son livre dor. En outre, des murs douces, lesprit de
bienfaisance et une religion officielle, objet de respects extérieurs à titre
de moi en de gouvernement ; mais aussi le dogme ébranlé par le scepticisme
des philosophes, lindifférence des lettrés et les railleries des poètes,
profondément altéré par les importations étrangères, et cependant soutenu par
ladhésion intéressée des politiques et par la foi touchante des classes
inférieures ; enfin, les natures délicates cherchant leur voie entre le fier
néant des stoïciens et les folies impures de certains cultes, dérivant même
jusquau mysticisme qui leur ouvre une route éclairée de lueurs confuses où
lon croit voir des prodiges et entendre des paroles de salut.
Que nous sommes loin, avec toutes ces choses, de la
vieille Rome et que nous sommes près dune révolution, puisque la société
sort des sentiers battus par vingt générations daïeux ! Jadis le dévouement
à la cité faisait toute la morale, le respect de ses dieux toute la religion.
A présent, la dignité nest plus mise dans les consulats ni dans les triomphes,
elle est dans la vertu ; lorgueil du philosophe a remplacé celui du
patricien, et Juvénal[26] demande au
sénateur, au lieu des mérites civiques, ce quil appelle dun nom que la
république ne con-naissait pas, le sensus communis.
En face de tant dintérêts quil fallait concilier, de tant de nations quil
fallait unir, on avait pris des vues plus larges sur la société. Lhorizon des
esprits sétait agrandi, et comme du sein de la foule dés dieux se dégageait
lidée de lunité divine, du sein de cet empire devenu la cité universelle se
dégageait lidée de lhumanité. Une inscription de Trajan porte : Conservatori generis humani[27]. Les philosophes
sappellent les citoyens du monde[28] et feraient
volontiers disparaître les frontières des États. Combien
sont ridicules, sécrie Sénèque[29], ces limites marquées par les hommes ! A
lancien droit qui disait : Hospes hostis,
lennemi, cest létranger, le nouveau répond : Létranger est un frère[30]. Térence a gagné
sa cause : lhomme est trouvé.
Voilà ce que les littérateurs du temps ne montrent que
dune manière très imparfaite. Pour savoir de quel côté la société penchait,
il faut consulter dautres hommes, étudier dautres faits et se rendre
compte, fût-ce en peu de mots, du mouvement philosophique et religieux qui
entraînait ces hommes vers des cieux nouveaux.

II. LÉDUCATION, LES
JURISCONSULTES ET LES PHILOSOPHES.
Quand on écrit lhistoire du christianisme, on ne voit que
lui et lon ne fait pas attention au grand travail de rénovation qui
sopérait au sein de la société païenne. Puisque ce sont les idées et les
murs de cent millions dhommes que nous étudions dans leur diversité,
cherchons ce que les contemporains de Néron et dHadrien croyaient le
meilleur pour la conduite de la vie et comment ils lenseignaient.
Pour lenfance, léducation était encore régie par les
anciens procédés. Il ny avait ni écoles de lÉtat ni écoles du clergé.
Lenseignement restait absolument libre. Les études se divisaient, comme de
nos jouis, en ce que nous appelons classes de grammaire et classes
dhumanités. Dans les premières, on étudiait les poètes ; dans les secondes,
les orateurs : plus tard venaient les jurisconsultes et les philosophes.
En ce temps, on était affolé de poésie ou du moins de
versification. Tout le monde, même Trimalcion, faisait des vers ou en lisait
; on en gravait jusque sur les tombeaux. Ce qui était une mode dans le public
devenait une obligation dans lécole. On voulait mettre ses enfants en état
de briller un jour dans les récitations ou dans les concours du Capitole, de
gagner des couronnes, des applaudissements, de la gloire, fût-ce pour un
moment. Si le poète arrivait bien rarement à la fortune, les Mécènes étaient
nombreux, peu exigeants, et lon tirait toujours quelque chose dune silve
louangeuse, dune épigramme servant la colère ou la vanité dun patron. Mais
la poésie, cest limage, la couleur, la forme, le rythme ; les facultés
quelle met en jeu sont le sentiment et limagination : facultés à la fois charmantes
et dangereuses, si elles ne sont contenues et dirigées par dautres plus
sévères. Au service dune grande intelligence, elles font le grand poète.
Pour le vulgaire des esprits, cette étude prolongée des poètes, ces exercices
répétés dimitations prosodiques, énervent lintelligence, lattachent aux
apparences et lui font prendre, pour la pensée, la couleur qui éblouit,
lharmonie sonore qui étonne, la forme qui ne recouvre que le vide.
Dans létude de la rhétorique, on proposait, pour aiguiser
lesprit, des sujets ridicules, comme léloge de la puce et du perroquet par
lesquels débuta Dion Chrysostome[31], et des thèses
bizarres prises en dehors de la réalité ou traitées en dépit de la vérité
historique. Lélève, transporté dans un monde de fantaisie, se trouvait au
milieu de murs imaginaires et de personnages qui étaient dinsaisissables
fantômes. On ny parlait que de catastrophes impossibles, de fléaux déchaînés
par la colère des dieux, de limmolation dune victime réclamée par loracle,
et toujours revenaient les plus tragiques aventures : une ville affamée
mangeant les cadavres, un tyran forçant un fils à décapiter son père, des
vierges de noble maison livrées à dinfâmes spéculateurs, des bandits
embusqués au coin de chaque bois, des pirates sur chaque rivage, agitant dun
air terrible les fers dont ils vont enchaîner le fils dun sénateur ou les
époux surpris au milieu de la fête des fiançailles. On dit que Néron, en face
de Rome en flammes, saisit sa lyre et chanta la ruine de Troie. La chose est
douteuse, mais quantité de gens auraient été capables de cette folie.
Ces exercices assidûment pratiqués à lécole, continués
longtemps encore dans les déclamations publiques, faussaient bien des esprits
; il en restait dans la vie quelque chose dexagéré, de théâtral, qui parfois
passait des paroles aux actes. On en trouve la trace jusque dans les plus
beaux caractères.
Heureusement tous les maîtres nétaient pas aussi
insensés. Quon lise la lettre de Pline le Jeune à Corellia[32], ou le premier
livre des Pensées de Marc-Aurèle,
et lon verra quelle était, dans les grandes maisons, léducation des
enfants. Nous savons même, par les fragments de Dosithée, quil existait dans
les écoles publiques des ouvrages analogues à nos traités de morale en
action. La nature humaine est la même dans tous les temps. On peut donc être
sûr que les pères, tout en cédant au goût du jour, ne se contentaient pas,
pour leurs enfants, de ces frivolités, et que le maître, dans lexplication
des poètes et des orateurs, savait aller là où il se plaît toujours, à ces
belles sentences, à ces nobles pensées, sans lesquelles orateurs et poètes
nauraient pas vécu. Juvénal, si souvent impudique, na-t-il pas lui-même
réclamé le respect de lenfance ? Dailleurs, au sortir de lécole, le jeune
homme trouvait dautres enseignements : la vie de chaque jour, qui le
replaçait dans le grand courant de la réalité ; la Jurisprudence et
la philosophie, qui lui apprenaient les devoirs du citoyen et de lhomme.
Ce que les grands jurisconsultes, qui se succédèrent sans
interruption dHadrien à Alexandre Sévère, ont fait pour la société romaine,
nous lavons montré dans le cours de cette histoire et aux deux chapitres de
la famille et de la cité : nous ny reviendrons pas.
Leur immense travail consista surtout à remplacer par une
règle déquité une ancienne règle de droit civil quils faisaient par là tomber
en désuétude, sans que le législateur eût besoin dintervenir. Aussi peut-on
résumer leur uvre en quelques mots :
Ils ont élargi, en ladoucissant, la loi étroite et dure
dun petit peuple agriculteur et guerrier, de façon à faire de lunivers
civilisé une seule communauté, régie par de justes lois, que dictait la
raison générale et non plus lintérêt dune classe ou dune cité.
Ils ont pris en main la cause des faibles. Pour détruire
lusage invétéré de lavortement et de lexposition, ils ont déclaré que
cétait un meurtre détouffer ou de rejeter le
nouveau-né, de refuser des aliments à son enfant, et de compter sur la
commisération des autres alors que soi-même on nen avait pas[33].
Ils ont donné des droits à ceux quon avait si longtemps
regardés comme incapables den recevoir : le fils, lépouse, la mère, tous
les déshérités de la nature, de la famille et de la loi, le spurius, laffranchi, lesclave et jusquau fou
quils cherchèrent à protéger contre lui-même.
A lenfant abandonné et recueilli par un marchand
desclaves, ils ont rouvert la porte de la liberté. A celui quune adoption
ou le droit de cité avait séparé des siens, ils ont rendu sa famille
naturelle ; et lorsque Hadrien changea, pour les pueri
alimentarii, lâge de la puberté, afin de pouvoir les secourir
plus longtemps, ils justifièrent cette dérogation au droit ordinaire par le sentiment pieux qui lavait inspirée, pietatis intuitu[34].
Dans lordre administratif, ils ont fait de la cité et du collège,
cette autre cité comprise dans la grande, des personnes civiles, afin quils
pussent recevoir des donations, et ils ont imposé aux gouverneurs de province
la protection des petits.
Dans lordre judiciaire, ils nont pas suivi les philosophes
qui leur disaient : La société se défend en
punissant ceux qui violent ses lois, elle ne se venge pas ; latrocité des
peines est une cruauté inutile, et la torture une horrible absurdité.
Du moins ils ont introduit le grand principe de droit pénal qui exige
lidentité du délinquant et du condamné[35] ; ils nont pas
admis laccusation contre labsent, parce que,
mieux vaut laisser échapper un coupable que condamner un innocent[36] ; et Hadrien
défendit de recourir à la question, si ce nest quand il y avait de sérieux
motifs de croire quon narriverait pas autrement à la vérité[37]. Ulpien écrivit
même : .... la question, chose fragile et périlleuse,
qui souvent trompe le juge[38].
Dans lordre financier, ils ont voulu, dix-huit siècles
avant notre révolution, légalité à légard des charges publiques, et, par la
bouche dAntonin, ils ont déclaré que limpôt devait être proportionnel à la
fortune[39].
Dans lordre politique, ils ont aidé de leurs conseils le
gouvernement à substituer aux pillages organisés par les traitants et les
proconsuls de la république la justice que les légats impériaux mirent dans
ladministration.
Enfin cest à eux que revient léternel honneur davoir
créé la science du droit et de lavoir enseignée au monde.
Il y a sans douté beaucoup de réserves à faire au sujet de
ces codes quon a appelés la raison écrite, et de ces hommes qui se disaient
les prêtres du droit. Ainsi le grand monument des Pandectes nest souvent quun tissu de contradictions, où lon
sent leffort fait par les juristes pour sortir de lancienne loi tout en
paraissant y rester. Ils admettaient la commune origine des hommes, et ils
ont conservé lesclavage ; ils estimaient que légalité est de droit naturel,
et ils ont laissé à la société son caractère aristocratique avec datroces
pénalités contre le pauvre. Mais a-t-on le droit de leur reprocher de navoir
pas contraint les murs à se modifier suivant leurs théories ? La loi ne fait
jamais table rase quau prix de terribles convulsions, et les Romains, hommes
tout à la fois de tradition et de progrès, nont pas voulu chasser violemment
le passé du présent. En quoi ils ont eu raison.
Cette uvre de rénovation a-t-elle été accomplie en vertu
de certaines idées philosophiques ? On la dit et on a donné au stoïcisme
lhonneur de ces réformes. Il a certainement contribué à les faire. Mais les
jurisconsultes, par la nature même de leur rôle social, sont restés bien en
deçà des philosophes, et ils ont moins obéi à linfluence des doctrines quà
celle du temps. La philosophie, en effet, est plus souvent une résultante
quune cause, et elle ne devient cause à son tour, comme tous les faits
humains, quaprès avoir été conséquence. Ladoucissement des murs, les
progrès de la raison publique, la vie en commun, au sein dune paix profonde,
le besoin où chacun était de tous, par suite du développement de lindustrie
et du commerce, ont conduit les juristes à une nouvelle conception des
rapports que les hommes devaient avoir entre eux. Tous ces petits, dont on a
vu les sentiments fraternels, ne philosophaient pas, et, sils avaient
philosophé, ce nest ni Platon ni Aristote qui les eussent inspirés, car, sur
la question de lesclavage, par exemple, ces puissants esprits leur auraient
enseigné la légitimité de la servitude. Comme la lumière se lorme de rayons
épars, chaque époque a, en politique ou en religion, une pensée générale
faite dun grand nombre de pensées particulières inclinant dans le même sens.
La philosophie, qui souvent a jeté dans le monde le germe de ces idées
nouvelles, accroît, en les précisant, leur puissance et donne leur formule à
celles qui naissent spontanément des leçons de la vie. Le législateur ensuite
sen empare et une révolution pacifique est faite.
Les préteurs et les jurisconsultes de la Rome impériale ont su comprendre
ces besoins et y satisfaire dans la mesure que les murs publiques
permettaient[40].
Nous allons voir les philosophes, prédécesseurs nécessaires des légistes,
agir sur la société, par les conceptions hardies dhommes qui nayant à
compter quavec eux-mêmes, en étaient plus libres dans leurs paroles.
Toute la morale individuelle se ramène au précepte suivant
arriver au respect de soi-même par le gouvernement viril de ses passions,
sous lil attentif du juge intérieur, la conscience. Toute la morale sociale
se résume en ces mots : respecter les biens, lhonneur et la personne
dautrui, vertu négative ; mais de plus : faire à autrui ce que nous
voudrions quon nous fit à nous-mêmes, vertu active.
La philosophie a-t-elle enseigné cette morale ?
En prêchant aux hommes une loi révélée, par conséquent
dautorité divine ; le péché originel qui rend un médiateur et la rédemption
nécessaires ; le salut par la grâce, cest-à-dire la subordination de la
raison à la foi ; enfin lespérance de la vie à venir, qui fait de celle
dici-bas une épreuve pour gagner ou perdre lautre, le christianisme a
changé les pôles du monde moral. Les païens croyaient surtout à cette vie et
espéraient en trouver la règle en eux-mêmes, à force déclairer leur raison
et de rendre leur conscience exigeante. Le but de leurs efforts était donc
darriver à ce que Satan avait offert, comme une tentation perfide aux
premiers-nés du monde, la science du bien et du mal.
Ce sont deux systèmes absolument contraires, bien que se
touchant par mille points[41]. Le premier a
tué le second, mais celui-ci, avant de périr, a fait pour se sauver de nobles
efforts quon a longtemps méconnus et quil faut montrer, car ils honorent
lhumanité et ils ont préparé le triomphe du vainqueur. Que Bossuet a raison
de présenter les conquêtes de Rome comme le préliminaire indispensable des conquêtes
du Christ ! Surtout si lon ajoute aux victoires des légions, qui avaient
réuni tant de peuples sous une même loi politique, celles des philosophes qui
cherchaient, pour ces multitudes, une même loi morale. La religion de la
nature, qui, de lInde à la Grèce, dAthènes à Rome et jusquau fond de
lOccident, avait si longtemps bercé la race aryane de ses poétiques
rêveries, avait perdu son empire sur les esprits délite ; de sorte que, bien
avant que le Dieu unique des Sémites eût été révélé à la société romaine, un
grand travail sétait fait pour dégager du fond de la conscience religieuse
lidée de lunité divine, pour transformer le polythéisme et remplacer ses
légendes, si pleines de dangereuses séductions, par un enseignement moral.
Nous avons été sévère à légard de Sénèque, ministre de
Néron ; on le serait encore pour Sénèque philosophe, à cause de ses
contradictions et de ses incertitudes. Toutefois, sil ne sait trop ce quil
faut penser de Dieu, de la
Providence, de lâme humaine et de la vie future,
incertitudes que le théologien ne connaît pas, mais qui troublent la pensée
du philosophe, il sait bien ce quil faut faire en la vie présente.
Et dabord pour le perfectionnement de soi-même.
Tertullien a dit de Sénèque : Il est souvent des nôtres[42]. Dans ses
traités, dans ses lettres, on trouve, en effet, le mépris de la richesse, de
la douleur et de la mort. La vie est une peine que nous subissons ; la mort,
une délivrance. Nous avons un ulcère qui nous ronge, le péché ; avant tout,
il faut en guérir. Le commencement du salut est de reconnaître son péché,
et la guérison de lâme est la grande uvre de la philosophie[43]. On y arrive par
le développement en soi de la vie spirituelle, et en suivant les conseils de
la philosophie.
Ces préoccupations spirituelles se marquaient, dans la
conduite de la vie, par lhorreur du mal et lamour du bien, avec
quelques-unes des délicatesses et des sévérités extrêmes du christianisme.
Les stoïques, même les épicuriens et les cyniques, conseillaient, comme saint
Paul, le célibat[44] ; ils
condamnaient les ardeurs des sens, honoraient la continence, la pudeur, et
avaient pour ladultère toutes les rigueurs de lÉglise[45], pour les joies
ou les douleurs du corps un parfait dédain. Ils se plaisaient aux
abstinences, aux macérations ; on se rappelle quil fallut contraindre Marc-Aurèle,
malade, à y renoncer. La félicité,
disait Démonax[46],
nappartient quà lhomme libre, et celui-là seul
est libre qui ne craint et nespère rien.
Les cyniques ne voulaient rien posséder en propre et
mendiaient par les rues. Dautres, plus austères, attendaient laumône, comme
ce Démétrius qui avait refusé, de Caligula, 200.000 sesterces et bravé la
colère de Néron. Sénèque, qui recherchait sa conversation, disait de lui : Je ne doute pas que la nature ne lait suscité pour quil
servit, à notre âge, dexemple et de reproche vivant[47]. Quand je le vois nu et couché, peu sen faut ; sur la
paille, il me semble que la vérité a en lui, non plus un interprète, mais un témoin.
Cétait un confesseur de la philosophie[48]. Au siècle
suivant, Démonax menait à Athènes la même existence, et Lucien, si dur pour
les cyniques, fait de lui le plus grand éloge. Il
prodiguait, dit-il, son incomparable
sagesse à tous, en public et en particulier, pacifiait les querelles et
calmait les irritations populaires. Les magistrats se levaient sur son
passage, et les Athéniens lui firent des funérailles aux frais de lÉtat[49].
Tous les cyniques nétaient donc pas a des aboyeurs n. Par
leur détachement des biens temporels, ils avaient commencé contre le
sensualisme cette guerre que continueront les anachorètes chrétiens. Dès le
règne de Tibère on vit de jeunes efféminés que des philosophes convertissaient
aux rigueurs de lascétisme[50].
Toutes les précautions pour tenir à la fois lâme en éveil
et en bride étaient déjà trouvées ; par exemple : chaque jour, la prière et
la méditation dune pensée choisie, ou la lecture, pour sédifier, de la vie
dun philosophe ; chaque soir, un examen de conscience. Les pythagoriciens
avaient depuis longtemps mis en usage ce puissant moyen de réformation.
Horace en parle[51]
; Sénèque y insiste. Retiré dans sa chambre pour
le repos de la nuit, Sextius, dit-il, interrogeait
son âme : De quelle maladie tes-tu guéri aujourdhui ? Quel vice as-tu
combattu ? En quoi es-tu meilleur ? Moi aussi jexerce cette magistrature et
me cite chaque jour à mon tribunal. Quand on a enlevé la lumière et que ma
femme, qui sait mon usage, sest renfermée dans le silence, je repasse ma
journée entière et reviens sur toutes mes actions et toutes mes paroles[52]. Les Pensées de Marc-Aurèle
ne sont quun dialogue avec son âme ; et les philosophes avaient si bien
répandu cette habitude, quÉpictète, par raillerie, nous fait assister à
lexamen de conscience dun plat courtisan qui, la nuit venue, se demande
sil a bien employé sa journée ; sil a suffisamment commis de bassesses ;
sil ne doit pas mieux flatter, mieux mentir, pour mieux assurer sa fortune[53].
On pourrait même dire quils avaient leurs commandements
de Dieu, et Épictète les montrait gravés dans la conscience, livre plus sûr
quune table de pierre ou dairain, si tout le monde savait lire et se conformer
à ses préceptes. Jupiter ta donné ses ordres lorsquil
ta envoyé ici : Ne pas désirer le bien dautrui, aimer la fidélité, la
pudeur, la justice, les hommes. Suis ces commandements, tu nas pas besoin
dautre chose[54] ; ta conscience sera vraiment le temple où Dieu lui-même
est descendu[55]. Quest-ce que se réunir à Dieu ? dit encore
Épictète. Cest vouloir ce quil veut et éviter
de faire ce quil ne veut pas. Comment
y arriver ! En comprenant bien ses commandements[56]. Sénèque a dit :
Un profond repentir rend presque linnocence,
et Juvénal : Le péché quon veut commettre
est un péché commis. Ce sont paroles chrétiennes. On croyait même
à la réversibilité des fautes, à la peine du crime retombant sur un héritier
innocent :
Delicta
majorum immeritus lues[57].
Les jurisconsultes heureusement ne lappliquaient pas. Au
reste, cette morale était celle dAbraham : Tu
seras récompensé ou puni dans ta postérité jusquà la septième génération
; et il se pourrait que cette morale fût encore la meilleure, puisquelle
établirait un lien détroite solidarité entre les générations.
En morale sociale, Platon et Aristote avaient commis deux
grandes erreurs : ils acceptaient le despotisme de lÉtat et lesclavage[58]. Rome conserva
lun et lautre, mais avec de profondes modifications. LÉtat était devenu si
grand, que le citoyen sy perdit et que lhomme sy retrouva, avec le
sentiment de la dignité humaine supérieur à toute loi positive, et celui de
la vraie liberté se soumettant à la raison universelle. Alors, au-dessus de
la cité qui tenait encore ses membres étroitement asservis, il se forma une
patrie morale, où nous allons voir que plusieurs habitèrent en esprit et en
vérité.
Quant à lesclavage, les plus belles paroles touchant la
commune origine des hommes sont dans les livres de Sénèque et dans les discours
de Dion Chrysostome. Pour eux aussi la vertu nest
interdite à personne ; tous y sont appelés, libres, affranchis, esclaves....
car nous avons tous le même père, le Ciel
; et Dionysius Caton écrit : Quand tu
achètes un esclave, souviens-toi quil est homme[59].
On a vu la charité dans la vie de la cité, dans la
pratique du gouvernement et dans les sentiments exprimés par les inscriptions
funéraires ; la voici dans les thèses des docteurs : Ce nest pas assez dêtre juste, il faut être bienfaisant,
même envers les esclaves, même envers son ennemi : il faut aimer qui vous
frappe.
Entendez ce cri tout chrétien : Le malheureux est chose sacrée[60] ; il porte la livrée sainte de la misère[61]. Cest peu de chose de ne pas nuire aux autres. Oh ! la
belle louange pour un homme quon dise de lui quil est doux envers son
semblable ! Est-ce quil est nécessaire de répéter quil faut tendre la main
au naufragé, montrer son chemin à qui ségare, partager son pain avec celui
qui a faim ? A quoi bon tant de paroles, lorsquun mot suffit pour enseigner
tous les devoirs Nous sommes membres dun même corps, membres de Dieu ?[62] La rude voix de
Juvénal sadoucit en parlant des afflictions dun ami, et les larmes lui
viennent aux yeux à la rencontre du cercueil de la vierge enlevée en son printemps,
à la vue de la tombe où le petit enfant est couché sous la terre froide et
sombre. Il se demande ce qui nous sépare des bêtes, et il répond : Cest que lhomme de bien ne regarde pas les maux dautrui
comme lui étant étrangers[63].
Quelle secte,
disait encore Sénèque, en parlant du nouveau stoïcisme ; quelle secte est plus amie des hommes, plus attentive au
bien général ?[64] Et Montesquieu
pense comme Sénèque.
Le premier principe de la morale publique est lobéissance
à la loi ; personne nen a parlé en termes plus magnifiques que ces
philosophes dont on a voulu faire des révoltés contre lautorité impériale.
Quelques-uns sans doute ont conspiré, et beaucoup, comme tant dautres, ont
détesté la tyrannie. Sous Vespasien, sous Domitien, on en a vu chassés de
Rome ou même exécutés. Ce nétait pas persécution contre la liberté
philosophique, mais affaire de police à légard de mécontents quon eut le
tort de croire dangereux.
En réalité, la préférence des stoïciens était acquise au gouvernement
dun seul[65].
Sil est tout naturel que Sénèque témoigne de son respect pour les puissances[66], Épictète, de
son dédain pour les grandeurs, noublions pas quil était dans lesprit de la
secte de ne point soccuper des affaires publiques, et dans sa doctrine de
tout soumettre à la loi : sans doute à la loi révélée par la conscience et la
raison ; mais aussi à celle que la force des choses avait établie. Cest la
définition donnée par un dentre eux que Justinien a mise en tête de ses
Pandectes. La loi est la souveraine maîtresse des
choses divines et humaines, le juge du bien et du mal, la règle du juste et
de linjuste ; elle prescrit ce quil faut faire, elle empêche ce qui ne doit
pas être fait[67]. Ces nobles
paroles dépassent lidée de la justice ordinaire. Chrysippe, comme Cléanthe,
songe à la loi commune de tous les êtres[68], au Cosmos
harmonieusement ordonné qui comprend Dieu, la nature et lhomme, tous soumis
à la loi, et cette soumission
fut la foi de Marc-Aurèle. Cependant le sage couronné navait aucun doute sur
son pouvoir, lordre ici-bas lui semblant faire partie de lordre universel.
Les stoïciens ne portaient si haut la tête que parce
quils croyaient posséder une émanation de la raison universelle, une
étincelle du Verbe divin. Notre corps,
disaient-ils, nous est commun avec les animaux,
mais notre âme est une parcelle de lâme divine. Nous sommes fils de Jupiter
et un dieu est en nous[69]. Saint Paul
avait exprimé la même pensée en renversant les termes : Nous sommes en Dieu, et Malebranche la
reprendra pour en tirer toute sa philosophie[70].
Au fond, lécole stoïque, malgré les différences profondes
qui la séparent du christianisme, faisait, comme lui, prédominer lâme sur le
corps ; comme lui, elle prêchait le détachement des choses périssables, et
elle exigeait lexercice des plus austères vertus. Cétait une doctrine de
renoncement et dabstention, άνέχου
xαί άπέχου, qui, pour
idéal, avait la sérénité immobile, la plénitude de la puissance sur soi-même,
lâme supérieure à toute émotion, άταραξίς.
Mais cette doctrine virile, άνδρωδεστάτη,
si habile à tracer la théorie des devoirs, et qui porta si haut le sentiment
de la dignité humaine, dépassait le but en dépassant la nature. Elle
commandait trop de sacrifices inutiles et pas assez dactions nécessaires.
Lhomme doit à Dieu le développement de lintelligence et de lactivité quil
a reçues de lui. Le stoïcisme, propre à faire des solitaires et des martyrs,
en a fait ; il a même indirectement préparé des âmes à être martyres dune
autre cause ; mais, sil était devenu la loi de la cité, il neut point formé
de citoyens[71].
Règle excellente pour lindividu et pour la vie intérieure, cette philosophie
du dédain aurait été une règle détestable pour la société et la vie de
relation. Le christianisme a eu des institutions qui ont présenté le même
caractère et produit les mêmes effets. Cependant, si les meilleures doctrines
sont celles qui font à la fois lhomme et le citoyen, il sera bon, dans tous
les temps, quune voix, un livre, une école, nous rappelle au dédain de la
richesse, des honneurs, du pouvoir et à lestime des vrais biens, ceux de
lesprit et de la conscience.
Heureusement la nature ramène à linconséquence les
esprits révoltés contre elle, et la société reprend ses droits. Les stoïciens
de lépoque impériale nenfermèrent point leur âme dans une solitude altière.
Ils voulurent gagner le monde et allèrent à lui pour lamener à eux. Luvre
presque entière de Sénèque est une prédication continuelle, et Perse sécrie
: Accourez, jeunes et vieux ; venez apprendre de
celui qui me la enseigné le but réel de lexistence ; venez faire provision
pour le voyage de la vie[72].
Il nous reste un entretien dÉpictète avec un jeune homme
qui se préparait à cet apostolat : Avant tout,
lui dit-il, il faut que le futur précepteur du
genre humain sentreprenne lui-même, quil éteigne en lui les passions et se
dise : Mon âme est la matière que je dois a travailler, comme le
charpentier le bois, comme le cordonnier le cuir. Ainsi préparé, il doit
savoir encore quil est un envoyé de Jupiter auprès des hommes. Il faut quil
prêche dexemple et quaux déshérités qui se plaignent de leur sort il puisse
dire : Regardez-moi : comme vous, je suis sans patrie, sans maison, sans
biens, sans esclave. Je couche sur le sol nu ; je nai ni femme ni enfant, je
nai que la terre, le ciel et un manteau[73]. Aussi, pour
type divin, le stoïcisme avait choisi, parmi les maîtres du vieil Olympe,
Hercule, le destructeur des monstres, le dieu de la force, mais de la force
employée au bien. Transformé en héros moral, le fils dune mortelle et du
père des dieux devait aider les hommes de bonne volonté à détruire la bête
qui est en nous : la passion, légoïsme, la colère, la cruauté. Tu portes au dedans de toi, disait Épictète, le sanglier dÉrymanthe et le lion de Némée : dompte-les.
Cette image était familière aux prédicateurs populaires ; on la retrouve dans
un discours de Dion[74].
Ainsi, le stoïcisme avait pris avec le temps une vertu active
; il sétait animé de lesprit de prosélytisme, et, en se répandant parmi la
foule, il avait nécessairement perd de sa fausse rigueur. Ce courant de
philosophie morale qui pénétra au fond de tant dâmes y laissa comme une
alluvion féconde, un grand principe dhonneur et de salut, le respect de
soi-même et des autres, avec cette pensée qui est la religion des esprits
supérieurs : Je ne veux pas violer en ma personne
la dignité de la nature humaine. Par là, il a mérité à son tour le
respect de la postérité. En ce temps-là,
dit Montesquieu, la secte des stoïciens
sétendait et saccréditait dans lempire. Il semblait que la nature humaine
eût fait un effort pour produire delle-même cette secte admirable, qui était
comme ces plantes que la terre fait naître dans des lieux que le ciel na
jamais vus. Les Romains lui durent leurs meilleurs empereurs[75].
La morale est éternelle, mais la connaissance de la morale
ne lest pas, de sorte que le progrès consiste moins dans la découverte de
principes nouveaux, que dans le développement des principes naturels au sein
de foules de jour en jour plus nombreuses. Cest luvre que la philosophie
avait entreprise, et nous allons voir en quelle mesure elle y réussit.
La morale du Portique, transformée par lesprit nouveau de
la cité universelle, a été écrite, et, ce qui vaut mieux, pratiquée par deux
hommes dont lun fut peut-être lami dun empereur, et lautre devint
empereur lui-même. Marc-Aurèle et Épictète sont les vrais héros du stoïcisme
dont Sénèque na été que le prédicateur élégant, car tous deux ont conformé
leur vie à leur doctrine. Nous avons longuement parlé du premier et de ses Pensées,
parce quil nétait point possible de séparer sa vie morale de sa vie
politique, et lon connaît le jugement que Pascal a porté du second, dont le
livre était une de ses lectures favorites[76]. Ce grand esprit, dit-il, a si bien connu les devoirs de lhomme, quil mériterait
dêtre adoré sil avait aussi bien connu son impuissance.... Comme il était terre et cendre, après avoir si bien
compris ce quon doit, voici comment il se perd dans la présomption de ce que
lon peut. Il dit que Dieu a donné à tout homme les moyens de sacquitter de
toutes ses obligations ; que ces moyens sont toujours en notre puissance ;
quil faut chercher la félicité par les choses qui sont en notre pouvoir,
puisque Dieu nous les a données à cette fin : il faut savoir ce quil y a en
nous de libre ; que les biens, la vie, lestime, ne sont pas en notre
puissance, et ne mènent donc pas à Dieu ; mais que lesprit ne peut être
forcé de croire ce quil sait être faux, ni la volonté daimer ce quelle
sait qui la rend malheureuse ; que ces deux puissances sont donc libres, et
que cest par elles que nous pouvons nous rendre parfaits ; que lhomme peut,
par ces puissances, parfaitement connaître Dieu, laimer, lui obéir, lui
plaire, se guérir de tous ses vices, acquérir toutes les vertus, se rendre saint
et ainsi compagnon de Dieu[77].
Ces principes qui, pour Pascal, sont dune diabolique superbe, étaient pour les
païens la bonne nouvelle, car elle
leur enseignait que lhomme peut sélever par ses propres forces au plus haut
degré de perfection morale. Aussi la popularité de lEnchiridion était
immense : Tout le monde le lit, disait
Origène au troisième siècle, et saint Nil, au quatrième, en faisait la règle
de ses moines. Cétait justice, car, en recommandant le célibat aux
philosophes, Épictète avait préparé celui des moines, et son livre commençait
cette science de la vie intérieure dont le christianisme a donné les règles
dans un autre beau livre, lImitation de Jésus-Christ, qui a sauvé et
perdu tant dâmes généreuses.
Marc-Aurèle donna encore à cette philosophie déjà si pure
un autre caractère : il la rendit indulgente. Il mit la force dans la douceur
et trouvait quelque chose de mâle dans la bonté. Aime
les hommes, dit-il, dun amour
véritable, et il se reproche de ne pas encore assez les aimer. Il
ne lui suffit pas de pardonner les injures, il
faut aimer ceux qui nous offensent.... Contre lingratitude, la nature a
donné la douceur.... Si tu le peux, corrige-les ; sinon, souviens-toi que
cest pour lexercer envers eux que tu as la bienveillance, et que faire du
bien aux autres est sen faire à soi-même.
Dans le cur de Marc-Aurèle, le stoïcisme devenait une loi
damour : aussi a-t-on pu dire que, par lui, la
philosophie profane avait été conduite jusquaux confins du christianisme[78].
Lhumanité a de ces âmes qui prennent leur vol bien
au-dessus des intérêts humains. Six siècles auparavant, Çâkyamouni avait
montré dans lInde le même esprit duniverselle charité[79], fait entendre
les mêmes paroles de mansuétude et damour, et donné la pureté morale pour
unique fondement à sa religion sans dogme ni théologie, comme celle de Marc-Aurèle,
et, comme elle aussi, malheureusement impuissante.
Plutarque nétait pas du Portique ; ses attaches les plus
fortes sont avec lAcadémie. Du reste, il importe peu. Les doctrines étaient
alors si bien mêlées, que les chefs décole nauraient pu reconnaître leurs
disciples. Plutarque na pas de système, et les inania
regna de la métaphysique ont peu dattrait pour lui. Sa philosophie
se borne et se complaît aux détails de la morale pratique, et il prend de
toutes mains ce qui peut aider à bien régler la vie. Lhistoire ne lui sert
pas à autre chose : ses Vies sont une morale en action. La spéculation
pure, qui bientôt se ranimera, était pour un moment arrêtée ; mais ce moment
fut marqué par un viril effort pour mettre lhumanité dans une voie meilleure
grande entreprise dont Plutarque fut un des plus laborieux ouvriers. Sa vie
na été quun long enseignement ; par la parole, tant quil professa ; par ses
écrits, tant quil put écrire.
La philosophie,
dit-il, ne se propose pas, comme la statuaire, de
représenter des personnages qui, sur une base immobile, soient des marbres
inanimés ; elle veut donner la vie à ce quelle touche ; elle veut faire des
créatures propres à laction[80]. Comme le christianisme
le faisait déjà, il prédit limmortalité. Épicure,
dit-il, sape nos espérances ; et pourtant si
vivaces sont-elles que tous tenteraient de remplir le tonneau des Danaïdes
plutôt que dy renoncer[81]. De Chéronée
partaient incessamment des conseils, des consolations, des directions, même
pour la vie publique. Les Égyptiens,
dit-il, exposaient le malade devant sa maison,
pour que les passants lui indiquassent comment ils sétaient guéris.
Il aurait voulu que chacun fit, de même, profiter les autres de son
expérience pour la guérison des maux de lâme[82].
Ainsi, dans une petite ville de la Béotie et dans la capitale de lunivers, au
palais du prince, ou sous les lambris dorés dun ministre et dans lhumble
demeure dun philosophe, sagitaient les mêmes pensées, ici écrites en latin,
là cri grec, mais courant également le monde. Comme en toute société
civilisée se retrouve à peu près une somme égale de faiblesses humaines, cest
par lidéal quun peuple se propose, bien mieux que par les défaillantes
individuelles que se marque le niveau de la moralité dune nation. Pour lhistoire,
les responsabilités personnelles subsistent. Mais cet idéal est-il élevé ;
a-t-il une vertu qui séduise et attire : réglez en assurance votre jugement
sur lui, malgré les faits contraires. Est-ce daprès Torquemada ou daprès lÉvangile
que vous jugerez le christianisme ?
Les philosophes plaçaient haut leur idéal[83], et ils avaient
la volonté dy amener les âmes, puisquils sétaient donné la charge de faire
la haute éducation de la société romaine.
La philosophie avait, comme lÉglise aujourdhui, trouvé
quatre moyens dagir sur le monde. Elle fournissait aux grandes familles des
directeurs de conscience et des précepteurs. Pour ceux qui ne pouvaient se
donner le luge dun philosophe à demeure, elle avait des directeurs de
conscience qui attendaient quon les vînt consulter et des maîtres qui
ouvraient des écoles ; pour la foule, ses missionnaires couraient le pays,
et, dans les grandes circonstances, ses prédicateurs en renom se chargeaient
dédifier la cour et la ville. Quon ne sétonne pas de ces mots. Sils appartiennent
à la discipline de lÉglise, ce quils désignent était fort en usage dans la Rome païenne.
Le philosophe à demeure, lami,
comme le nomme une inscription[84], le monitor, le gardien de lâme[85], que parfois on
appelait mon père[86], se trouvait
dans toutes les grandes maisons, et Perse a montré en termes magnifiques
quelle influence morale il y pouvait exercer[87]. Autrefois, on
mourait, comme Caton dUtique, en lisant le Phédon. Maintenant on
avait bien le Phédon dans sa bibliothèque, mais de plus on avait près
de soi quelquun qui pût le commenter en toute circonstance, comme ce Canus
dont jai montré létrange tranquillité dâme et qui, marchant au supplice,
sétait fait accompagner de son philosophe.
Plautus, Thrasea, au moment suprême éloignent les femmes, les parents, et
sentretiennent avec un philosophe des graves questions qui occupent alors la
pensée, comme nous appelons un prêtre à notre chevet pour prendre quelque
assurance au dernier passage.
Sénèque marque bien ce caractère nouveau de la philosophie
qui évite les discussions décole[88]. Ah ! ce nest pas le temps de samuser à des jeux de
dialectique : philosophe, ce sont des infirmes et des misérables qui
tappellent. Tu dois porter secours aux naufragés, aux captifs, aux
indigents, aux malades, à ceux qui ont déjà la tête sous la hache : tu las
promis. A tous les beaux discours que tu peux débiter, ces affligés en
détresse ne répondent quune close : secours-nous. Cest vers toi quils
tendent les mains ; cest de toi quils implorent assistance pour leur vie
perdue ou qui va se perdre ; cest eu toi seul que sont leurs espérances. Ils
te supplient de les tirer de labîme où ils sagitent, et de faire luire,
devant leurs pas errants, la salutaire lumière de la vérité.
La philosophie avait même lambition glu pénétrer à la cour.
Plutarque ly poussait. Si le sage,
dit-il, dont le commerce se borne à des particuliers,
leur donne la sérénité, le calme et la douceur, celui qui mettra lâme dun
prince dans la bonne direction étendra sur tout un peuple le bienfait de sa
philosophie[89]. Longtemps avant
lui, elle avait réussi à sy produire. Auguste avait son philosophe, Arcus, le confident de toutes
ses pensées, de tous les mouvements de son âme.
Quand Livie perdit son fils Drusus, cest à lui quelle demanda des
consolations pour sa douleur[90]. Néron eut
Sénèque, qui contint quelque temps son naturel pervers, et beaucoup dautres
dont Tacite prétend quil se plaisait à exciter les disputes[91]. Nerva, Hadrien,
Antonin, Marc-Aurèle, étaient entourés de philosophes qui avaient une
position officielle, étaient comptés parmi les amis du prince (comites) et, comme eux, recevaient un traitement,
doù Lucien prend naturellement prétexte pour les accuser davidité[92]. On dirait les
aumôniers de nos rois. Il semble que sous Trajan la place ne devait pas être
fort lucrative. Cependant ce prince voulut entendre le plus illustre dentre
eux, Dion Chrysostome. Nous avons encore le discours que le philosophe lui
adressa sur les devoirs de la royauté et que le pape Nicolas V fit traduire en
latin pour son usage.
Beaucoup tenaient des écoles, que les uns faisaient
payantes, les autres gratuites[93]. Les premiers
tiraient de leur savoir un gain que trous trouvons légitime, mais que les
austères blâmaient. Ce ne sont, disait
Nigrinus, que magasins et boutiques, ces écoles
où la sagesse se vend et se débite comme marchandise[94].
Dautres, à lexemple dÉpictète et de Nigrinus, un des
rares philosophes qui aient trouvé grâce devant Lucien, se tenaient en de
pauvres demeures, philosophant tout seuls ou avec ceux que leur renommée
attirait et qui venaient leur soumettre des cas de conscience.
Aulu-Gelle, chargé par le préteur de juger un procès difficile, se trouve
fort embarrassé : les preuves manquaient ; fallait-il décider daprès
les murs bien connues des deux adversaires ? Il remet laffaire et court
consulter son maître Favorinus[95]. Ce même Favorinus
nattendait pas quon vint à lui. Un jour on lui annonce que la femme dun de
ses élèves est accouchée : il sort aussitôt et, au nom de la nature et de la
philosophie, sen va commander au mari que sa femme allaitât son enfant[96].
On les appelait dans les afflictions, et Dion se plaint
quon attende si tard. Comme on nachète les
remèdes que dans une grave maladie, ainsi on néglige la philosophie tant
quon nest pas trop malheureux. Voilà un homme riche, il a des revenus ou de
vastes domaines, une bonne santé, une femme et des enfants bien portants, du
crédit, de lautorité ; eh bien, cet homme heureux ne se souciera pas
dentendre un philosophe ; mais quil perde sa fortune ou sa santé, il
prêtera déjà plus facilement loreille à la philosophie ; que maintenant sa
femme, ou son fils, ou son frère, vienne à mourir, oh ! alors il fera venir
le philosophe ; il lappellera pour en obtenir des consolations, pour
apprendre de lui comment on peut supporter tant de malheurs[97].
Enfin la philosophie avait ses missionnaires nomades qui
la portaient avec léloquence et lardeur de lapostolat sur tous les points
de lempire, auprès des petits comme auprès des grands, même à loreille des
femmes et des esclaves[98]. Souvent on
voyait au cirque, au théâtre, dans les assemblées, un sophiste apparaître et
réclamer le silence au nom de la nature
immortelle dont il était le véridique interprète. On le croyait un messager divin, comme ces prédicateurs
chrétiens que Bossuet appelle magnifiquement a les ambassadeurs de Dieu e, et
il disait à la foule bruyante : Écoutez-moi, vous
ne trouverez pas toujours un homme qui vienne à vous avec de libres vérités,
sans souci de gloire ou dargent, sans autre mobile que sa sollicitude pour
vous et résolu à supporter, sil le faut, les moqueries, le tumulte et les
clameurs[99]. Ce nétait pas
la satisfaction dune vanité puérile que ces orateurs populaires devaient
chercher. Musonius aimait à répéter : Lorsquun philosophe
exhorte, avertit, consulte et blâme, ou donne une leçon de morale, si les auditeurs,
ravis des grâces de son style, lui jettent à la tête des louanges banales,
soyez sûr qualors tous perdent leur temps. Je ne vois plus un philosophe qui
enseigne les âmes, mais un joueur de flûte qui amuse les oreilles....
Quand la parole est utile et salutaire, on
lécoute en silence[100]. Ne dirait-on
pas les sévères exigences dun sermon chrétien ?
Les plus fameux de ces prédicateurs nomades furent Dion
Chrysostome et Apollonius de Tyane. Le dernier a mauvais renom aujourdhui :
on la appelé le don Quichotte de la philosophie,
chevauchant par le monde en quête de luttes et daventures[101], et Philostrate
a semé sa route de miracles qui nous font sourire. Mais, en débarrassant ce
personnage du merveilleux dont les générations suivantes lont enveloppé pour
lopposer au Dieu des chrétiens, il reste un illuminé peut-être, à coup sûr
un homme qui, par son ascétisme et sa moralité, se rapproche beaucoup
dÉpictète et de Marc-Aurèle. Il allait,
dit son biographe, redressant le mal sur son
passage et tenant partout des discours salutaires à ceux qui les entendaient[102].
Dion, qui navait dabord été quun rhéteur avide dapplaudissements,
une fois converti à la philosophie, la porta partout, jusque dans le palais
de Trajan, où il parla avec la fierté légitime que lui donnaient son exil, sa
vie laborieuse au milieu des Barbares et toujours militante en faveur des
vérités morales.
Ne craignez pas,
disait-il[103],
que je veuille vous flatter. Autrefois, quand
tout le monde se croyait obligé de mentir, moi seul je nai pas craint de
dire la vérité au péril de ma vie ; et maintenant quil mest permis de
parler avec liberté, je serais assez inconséquent pour renoncer à ma
franchise alors quon la tolère ! Et pourquoi mentir ? Pour obtenir de
largent, des louanges, de la gloire ? Mais de largent, je nai jamais
consenti à en recevoir, et ma fortune, je laie donnée.
Et lorsquon le voit mettre la bienfaisance au premier
rang des devoirs de la royauté, on se souvient que Trajan fut lauteur de
linstitution alimentaire, et que les Antonins ont modifié dans le sens le
plus humain toute la législation de lempire. Il nous reste quatre-vingts
discours de Dion, où se révèlent lhonnête homme, le bon citoyen, lélégant
orateur et le moraliste irréprochable.
Ulpien dira bientôt des jurisconsultes : ils sont les prêtres
du droit. Sénèque avait dit déjà des philosophes : ils sont les prêtres de la
vérité[104],
vrais prophètes[105], véritables
inspirés ; et lon tenait si bien à ce rôle, que Plutarque répétait le mot.
Est-on autorisé à penser que ce grand travail a été inutile, que ce vigoureux
effort pour entraîner la société dans une voie meilleure ne ly a point fait
marcher ? La prédication doucement commencée dans Rome par Cicéron au nom du
devoir, par Vorace au nom du bon sens, si brillamment continuée par tout
lempire, de Thrasea à Marc-Aurèle ; au nom de la dignité humaine et des
sentiments les plus élevés de notre nature, a produit la réaction morale que
tant de faits nous ont montrée. Les sermonnaires
romains des deux premiers siècles ont certainement opéré de nombreuses
conversions. Toutefois, au milieu de cette société troublée par tant de
religions différentes, le désaccord, toujours si grand entre les doctrines et
les murs, resta plus sensible quil ne la été à dautres époques où régnaient
une même croyance et une seule discipline.
Ce clergé, en effet, dune espèce particulière, sans
hiérarchie, ni règle, sans dogme ni théologie, allait à laventure, selon
linspiration et les goûts de chacun. Beaucoup de charlatans sy mêlaient, trouvant
à ce métier le moyen de vivre paresseusement[106]. On y voyait même
des illuminés, des fous comme ce Peregrinus qui, par vanité, monta sur un
bûcher à Olympie[107]. Aussi, ne
faut-il pas sétonner que les philosophes aient excité la verve de Lucien,
comme les moines celle dÉrasme et de Hutten. Un chrétien qui finit en hérésiarque,
Tatien, disait deux : Quest-ce que vos
philosophes ont de si grand ? Je ne leur vois rien dextraordinaire, si ce
nest quils laissent pousser leurs cheveux, soignent leur barbe et ont des
ongles aussi longs que les griffes des bêtes. Ils publient quils nont
besoin de personne ; il leur faut pourtant un corroyeur pour leur besace, un
tourneur pour leur bâton, un tailleur pour leur manteau, des riches et un bon
cuisinier pour leur gourmandise. Ce grand philosophe déclame avec assurance,
insulte ceux qui lui refusent, et, si on lui fait tort, se venge lui-même[108].
La satire, en, vérité, nest pas cruelle, et nous
admettons quil y a eu plus de ridicules, même de vices, que Tatien nen
montre. Lucien en a dit bien davantage[109]. Mais on ne
frappe pas les morts, et il faut que la philosophie ait été singulièrement
vivante à cette époque pour que le satirique de Samosate ait si souvent pris
les philosophes à partie. Dailleurs, il est lennemi de certains
philosophes, mais non pas de la philosophie. Il lappelle la fille de Jupiter
et lui fait dire : La plupart des hommes, le gros
du peuple, me tiennent en grand honneur et madmirent ; peu sen faut quils
ne madorent, tout en ne me comprenant pas beaucoup. Puis elle
explique quen voyant la multitude témoigner le plus profond respect à ses
véritables disciples, tolérer leur franchise, rechercher leur amitié, écouter
leurs conseils, céder à leur plus léger reproche, une
foule dhommes méprisables avaient pris le manteau des philosophes, comme si
cela suffisait pour arriver à tout[110]. Le rieur
impitoyable affirme donc lui-même limportance de cet enseignement, à la fois
populaire et relevé, qui tenait la place de celui que les prêtres ne donnaient
lias. Durant deux siècles, la philosophie a été à Rome, comme en France après
Louis XIV, la
religion de la société polie, et les empereurs en reconnaissaient si bien
lutilité, quils accordèrent aux philosophes des immunités officielles[111].
Ainsi, soit que les Romains eussent répandu parmi les
provinciaux leur esprit organisateur, soit quen lanarchie des choses
divines les peuples eussent cherché un point fixe où la conscience troublée pût
saffermir, il se trouva que la raison générale élaborée au fond de la pensée
de quelques hommes supérieurs avait dégagé de lamas des légendes et des
métaphysiques une morale, des règles de conduite, une religion tout humaine,
sans dieux bien certains, mais non sans efficacité. Un écrivain autorisé a
dit : La philosophie était devenue si pratique,
si attentive aux besoins les plus délicats de lâme, si amoureuse de
perfection intérieure, que son enseignement, malgré la diversité des dogmes,
mérite lhonneur dêtre rapproché de la direction chrétienne[112].
Les philosophes avaient donc bien vu quil fallait dabord
sattacher à luvre du perfectionnement moral de lindividu, et quon ne
pouvait améliorer la société quen commençant par améliorer les hommes[113]. Toute la
réforme sociale était pour eux, comme elle devrait lêtre pour nous, une
question déducation. Leur prédication, se combinant avec les efforts faits
dans. le même sens par les Flaviens et les Antonins, avait ramené en beaucoup
de maisons cette sévérité de murs dont Tacite atteste le retour, et qui nous
a fait retrouver une société honnête là où lon ne voulait voir que débauches
et corruption. Lhumanité cherchait donc elle-même son salut, et, de Socrate
à Marc-Aurèle, quelques-uns lavaient trouvé, ceux que leur âme naturellement chrétienne rapprochait
des sages à qui la tradition de lÉglise a promis la vie bienheureuse[114].

III.- LA RELIGION OFFICIELLE.
Lhomme est un être religieux, parce que sa raison lui
montre, sous les phénomènes, une loi ; dans la loi, une cause et une
conséquence, cest-à-dire un principe et une fin, deux choses qui se
confondent pour constituer lordre, lequel suppose un ordonnateur qui
ait fait concourir les propriétés de la matière à produire un effet
déterminé. Cet enchaînement des choses, le sauvage même le voit confusément,
niais dune manière qui simpose à son esprit, et toutes les religions
résultent de cette sorte de réflexion inconsciente. Cæli enarrant gloriam Dei, voilà le cri
involontaire de lhumanité ; toute la métaphysique des philosophes est
contenue dans ces quatre mots.
En face de lincompréhensible sest donc éveillée de bonne
heure une curiosité insatiable, comme de la mort est né leffroi de la
destruction. Dune part, lhomme a voulu savoir ; de lautre, il a voulu
survivre ; même quand il na pas eu la vue nette de cet avenir immortel, il a
encore cherché à sassurer, pour les luttes de la vie, lassistance dêtres
divins en gagnant leur faveur par le culte quil leur rendait. Les religions
sont nées, dés les premiers jours du monde, de ce besoin, de cette terreur et
de ces calculs intéressés[115]. Le sentiment du
divin, avec les espérances quil donne de salut[116] ici-bas ou dans
une autre existence, se trouve au fond de la nature humaine, et limpuissante
mais noble recherche de ce qui précède et de ce qui suit lexistence[117] est le signe
caractéristique de lhumanité. Ensemble ont commencé la douleur et la religion
; ensemble elles finiront.
Ce grand fait humain i eu deux conséquences : lune pour
la société, lautre pour lindividu. Le sentiment religieux étant fort complexe,
il sy trouve de la crainte et de lautour, du calcul et de labandon[118], de légoïsme
et du dévouement, de lorgueil et de lhumilité. Selon quun de ces éléments
a dominé, on a eu les caractères très différents quont offerts dans les
divers pays les classes sacerdotales, depuis le pénitent timoré jusquau pontife
implacable qui règle tout dans lÉtat, en prenant ses propres pensées pour
des inspirations den haut. Dautre part, lélément essentiel dune religion
est le merveilleux, puisque linconnu et linaccessible sont le domaine
réservé aux dieux. Il sen est suivi que, dans tous les temps, même en plein
âge scientifique, sous toutes les formes, même sous les plus bizarres, la fui
au surnaturel sest produite. Le grave Strabon disait : Les poètes nont pas été seuls il inventer les légendes ;
les magistrats, les législateurs, en ont aussi, dans lintérêt commun, répandu
parmi les peuples ; plus elles sont merveilleuses, plus ou les aime....
Les femmes et la foule, ne louvant être amenées à
la piété par la philosophie, sont conduites par la superstition ; et celle-ci
na defficacité que par les fables et les miracles quon y mêle[119]. Strabon se
trompe : les peuples font eux-mêmes leurs légendes, comme ils font leur
idiome, et les poètes, les inspirés, les croyants habiles, ne servent plus
tard quil les coordonner.
 Or les philosophes de lempire, qui voulaient fonder une
religion, ceux surtout de lécole dominante, manquaient absolument de ce moyen
daction. Avec son ciel désert, puisque ses dieux ne sont quune force
aveugle et fatale, avec sa virile doctrine du devoir, sans autre récompense
que celle de la conscience satisfaite, sa fière attitude en face du destin
auquel il ne demandait rien et en face du néant quil regardait sans
trembler, le stoïcisme était fait pour des âmes délite et non pour la foule.
Deux choses, disait Kant, me remplissent dune crainte respectueuse, le ciel étoilé
et le sentiment de la responsabilité morale de lhomme. De ces
deux choses, les stoïciens ne regardaient que la seconde, encore dune
certaine manière. Aussi cette morale sans dogme, cette philosophie sans
métaphysique, cette raison sans merveilleux, qui se contentait doutrer la
nature, navait pas de prise sur les esprits incultes ou paraissait
insuffisante aux âmes que tourmentait le besoin dun idéal supérieur. Saint
Paul avait dit dans lÉpure aux Romains : La foi
est la démonstration puissante des choses que lon ne voit pas, et
lon a résumé la doctrine de Tertullien en un mot profond : Credo quia absurdum[120], je crois, bien
que je ne comprenne pas. Dans le stoïcisme tout se comprenait ; il ne pouvait
donc amener le monde à lui, et., sil entrait en lutte arec une doctrine
religieuse qui ouvrit le, ciel fermé par Aristote, Épicure et Zénon, il était
davance vaincu. Or les philosophes de lempire, qui voulaient fonder une
religion, ceux surtout de lécole dominante, manquaient absolument de ce moyen
daction. Avec son ciel désert, puisque ses dieux ne sont quune force
aveugle et fatale, avec sa virile doctrine du devoir, sans autre récompense
que celle de la conscience satisfaite, sa fière attitude en face du destin
auquel il ne demandait rien et en face du néant quil regardait sans
trembler, le stoïcisme était fait pour des âmes délite et non pour la foule.
Deux choses, disait Kant, me remplissent dune crainte respectueuse, le ciel étoilé
et le sentiment de la responsabilité morale de lhomme. De ces
deux choses, les stoïciens ne regardaient que la seconde, encore dune
certaine manière. Aussi cette morale sans dogme, cette philosophie sans
métaphysique, cette raison sans merveilleux, qui se contentait doutrer la
nature, navait pas de prise sur les esprits incultes ou paraissait
insuffisante aux âmes que tourmentait le besoin dun idéal supérieur. Saint
Paul avait dit dans lÉpure aux Romains : La foi
est la démonstration puissante des choses que lon ne voit pas, et
lon a résumé la doctrine de Tertullien en un mot profond : Credo quia absurdum[120], je crois, bien
que je ne comprenne pas. Dans le stoïcisme tout se comprenait ; il ne pouvait
donc amener le monde à lui, et., sil entrait en lutte arec une doctrine
religieuse qui ouvrit le, ciel fermé par Aristote, Épicure et Zénon, il était
davance vaincu.
Le polythéisme conservait-il au moins assez de force pour
garder cette société quil avait tenue durant tant de siècles et par de si
puissantes attaches, ou son merveilleux était-il usé par ce long emploi ?
Lhellénisme avait longtemps bercé lenfance de pieux
récits ou de légendes terribles, charmé limagination et les sens par la
pompe des cérémonies, et retenu les curs par cette poésie du ciel qui répond
si bien à notre instinct. de lidéal, ou maîtrisé les esprits par les
épouvantements de lÉrèbe. Mais un moment arriva où les vagues plaisirs des
Champs élyséens parurent insuffisants, et la foudre de Jupiter bien aveugle.
Ce grand dieu de la race aryane perdait ses adorateurs, et les statues des
autres dieux chancelaient comme la sienne au parvis des temples. La solitude
et le silence se faisaient autour de ces anciens maîtres du monde, et lherbe
poussait sur les voies sacrées. Cependant, avant de passer de la vie à la
mort, une religion traverse toujours un état intermédiaire qui peut durer des
siècles. Déjà mortellement atteinte par le doute, elle semble vivre encore
dans les habitudes. Lhomme séloigne peu à peu avec sa raison, ou naccorde
plus, comme le politique, quune adhésion de convenance. La femme, qui est
tout sentiment, reste au temple avec sa foi et y retient lenfant. Dans
toutes les religions, le cur a fait des femmes les prêtresses de la première
et de la dernière heure.
Le paganisme en était là depuis longtemps pour les
lettrés, même pour le vulgaire, est
tout près de dire Juvénal[121]. Nayant pas,
comme les Juifs, une doctrine très précise enfermée dans un livre, ni, comme
lÉgypte et lInde, un clergé qui la conservât et la défendit, le polythéisme
avait vu la société nouvelle, qui demandait quon lui enseignât quelque
chose, déserter ses temples vides et froids où lon nenseignait rien. Alors
sétait produit le magnifique essor de lesprit philosophique qui ne laissa
pas, sans y entrer, une seule des voies par où lon espérait atteindre la
vérité et qui les parcourut, il faut bien le reconnaître, en toute liberté,
sans que jamais le prince se soit inquiété des témérités philosophiques. A la
fin, fatigué de tant de recherches vaines, ce puissant esprit renonça aux
théories ambitieuses, comme il avait renoncé aux croyances populaires, et il
saffaissa dans le doute. On sait quelle avait été la religion de Lucrèce, de
Cicéron, de César et ce que pensaient du culte officiel le grand pontife
Scævola et Varron. Pline lAncien est franchement athée. Pour lui, Dieu, sil
existe, est le destin, ou ce quil appelle la puissance de la nature ; et il
fait des hommes deux parts : ceux qui ne tiennent aucun compte des dieux et
ceux qui sen font une idée honteuse[122]. Le culte
touchant des morts ne peut même émouvoir cette âme aride : Notre vanité fait durer notre être par delà le tombeau ;
nous accordons le sentiment aux mânes, et nous faisons dieu ce qui a cessé
dêtre homme[123].
Juvénal[124] traite fort mal
la tourbe des dieux et certains de
leurs adorateurs. Tacite hésite entre des doctrines contraires, mais Pline le
Jeune nhésite pas, et, si son ami nous avait laissé des lettres au lieu
dhistoires qui exigeaient le langage conventionnel, nous y verrions sans
doute la même indifférence religieuse. Chose remarquable, dans les deux cent
quarante-sept lettres de Pline[125], il nest pas
une seule fois, sérieusement question des dieux. La religion, en tant
quinfluence morale, nexiste pas pour lui. Il achètera bien une statue pour
en décorer une place de Côme ; il relèvera près de ses domaines un sanctuaire
écroulé ; il bâtira un temple à Tifernum pour faire montre de sa munificence
; mais du gouvernement du monde par les dieux, du rôle de la religion dans la
vie, il ne prend nul souci, et il dirait volontiers avec Lucain : Parler de la royauté de Jupiter, cest mentir ; il nest
point de dieu qui ait le soin des affaires humaines[126]. Pline croit
aux belles-lettres, à lhonneur, à la probité, à toutes les vertus civiques,
et il laisse les immortels végéter sur lOlympe. Il ne les discute point en
philosophe ; il ne les honore pas en croyant. Pour lui, ils sont comme sils
nétaient pas, à moins quil nait quelque fonction publique à remplir, parce
que, dans ce cas, ils font partie du cérémonial traditionnel. Horace, en ses Odes,
se montre zélé païen : la piété mythologique est une des conditions du genre
; mais, quand il pense pour lui-même, ses dieux font triste figure, virant à
légard des hommes dans une paisible indifférence[127], et il voit
sans tristesse leurs vieux sanctuaires qui sécroulent[128].
 Lauteur de lArt
daimer sétait mis, en un jour de pénitence, à écrire les Fastes
; il ne peut cependant se garder de rire des dévots qui, avec quelques
gouttes deau lustrale, croient effacer leurs
parjures[129] et, pour
raconter, comme le fait Ovide, les métamorphoses des dieux, il fallait
avoir le vers bien facile et la piété bien légère. Une sorte de mystique,
Apulée, avoue que la niasse des ignorants manque de respect aux dieux, en les
révérant avec superstition, ou en montrant à leur égard un insolent dédain[130]. Pétrone va plus
loin : il sait comment on a fait les maîtres de lOlympe, et le récit en est
peu édifiant. La crainte, dit-il, fut dans lunivers lorigine des dieux. Les mortels avaient
vu la foudre, tombant du haut des cieux, renverser les murailles sous ses
carreaux enflammés et mettre en feu les sommets de lAthos ; le soleil, après
avoir parcouru la terre, revenir vers son berceau ; la lune vieillir et
décroître, pour reparaître dans sa splendeur. Dés lors les images des dieux se
répandirent partout. Le changement des saisons qui divisent lannée accrut
encore la superstition ; le laboureur, dupe dune erreur grossière, offrit à
Cérès les prémices de sa moisson et couronna Bacchus de grappes vermeilles. Palès
fut décorée par la main des pasteurs ; Neptune eut pour empire létendue des
mers, et Diane réclama les forêts[131]. Les dieux sont
donc de création humaine, et cétait de la terre quon montait au ciel. Ici,
du moins, Pétrone est brave en son impiété ; ailleurs, il est bien
irrévérencieux. Quand Eumolpe, un de ses héros, donne à la vieille dont il a
tué loie deux pinces dor, il lui dit : Avec
cela, tu pourras acheter des oies et des dieux tant que tu en voudras.
Aussi beaucoup bornaient leurs espérances à souhaiter pour eux-mêmes ce quun
homme de Macédoine souhaitait aux passants du fond de son tombeau : Vis et porte-toi bien[132]. Lauteur de lArt
daimer sétait mis, en un jour de pénitence, à écrire les Fastes
; il ne peut cependant se garder de rire des dévots qui, avec quelques
gouttes deau lustrale, croient effacer leurs
parjures[129] et, pour
raconter, comme le fait Ovide, les métamorphoses des dieux, il fallait
avoir le vers bien facile et la piété bien légère. Une sorte de mystique,
Apulée, avoue que la niasse des ignorants manque de respect aux dieux, en les
révérant avec superstition, ou en montrant à leur égard un insolent dédain[130]. Pétrone va plus
loin : il sait comment on a fait les maîtres de lOlympe, et le récit en est
peu édifiant. La crainte, dit-il, fut dans lunivers lorigine des dieux. Les mortels avaient
vu la foudre, tombant du haut des cieux, renverser les murailles sous ses
carreaux enflammés et mettre en feu les sommets de lAthos ; le soleil, après
avoir parcouru la terre, revenir vers son berceau ; la lune vieillir et
décroître, pour reparaître dans sa splendeur. Dés lors les images des dieux se
répandirent partout. Le changement des saisons qui divisent lannée accrut
encore la superstition ; le laboureur, dupe dune erreur grossière, offrit à
Cérès les prémices de sa moisson et couronna Bacchus de grappes vermeilles. Palès
fut décorée par la main des pasteurs ; Neptune eut pour empire létendue des
mers, et Diane réclama les forêts[131]. Les dieux sont
donc de création humaine, et cétait de la terre quon montait au ciel. Ici,
du moins, Pétrone est brave en son impiété ; ailleurs, il est bien
irrévérencieux. Quand Eumolpe, un de ses héros, donne à la vieille dont il a
tué loie deux pinces dor, il lui dit : Avec
cela, tu pourras acheter des oies et des dieux tant que tu en voudras.
Aussi beaucoup bornaient leurs espérances à souhaiter pour eux-mêmes ce quun
homme de Macédoine souhaitait aux passants du fond de son tombeau : Vis et porte-toi bien[132].
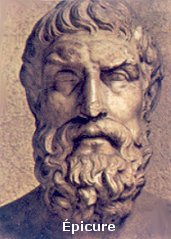 Une école considérable, celle dÉpicure, niait absolument lexistence
dêtres divins et donnait la paix à lâme en la
délivrant des frayeurs quinspirent les prodiges et les fantômes, en bannissant
les espérances chimériques et les désirs insensés[133]. Une autre,
celle de Zénon, distinguait fort mal Dieu de la nature, ou plutôt
lidentifiait avec le monde dont il était lâme invisible, et des poètes,
Manilius, dans ses Astronomiques, peut-être le pieux Virgile[134], adhéraient à
cette puissante doctrine du panthéisme qui sest produite à tous les âges du monde,
pour expliquer linexplicable problème de la métaphysique : laccord du fini
et de linfini, de la nature et de Dieu, de la liberté humaine et de la
providence divine. Hadrien sans doute en était là, lui qui bâtissait des
temples sans images et sans nom : signe de son mépris pour la mythologie
officielle, de son respect pour le dieu impersonnel répandu dans tout
lunivers, qui pourtant ne lui révéla pas, à la dernière heure, le secret du
tombeau[135].
Au fond, Platon, Aristote et toutes les philosophies avaient battu en brèche
avec plus ou moins de prudence le polythéisme officiel. Mais leurs uvres
étaient de celles qui vont aux esprits den haut ; elles ne descendent point
à ceux den bas : les petits dialogues de Lucien allèrent partout. Cet élève
dÉpicure sétait donné pour mission de poursuivre sans relâche les
charlatans, les imposteurs et les superstitieux. Lorsquil faisait si rude
guerre aux vieilles divinités qui sen allaient, comme à celles qui
prétendaient les remplacer, il était certainement un écho, et nous savons
quon lisait avidement ses livres. Il na pas la critique implacable et
froide de Kant qui ruine les systèmes et détrône Dieu respectueusement. Lucien
est de cette famille desprits audacieux et alertes qui détruisent en riant.
Écoutez ce quil fait dire à Jupiter par Timon (Timon, 4) : On ne toffre plus de sacrifices,
on ne couronne plus tes statues, si ce nest quelquefois, par hasard, à
Olympie ; encore celui qui le fait ne croit-il pas remplir un devoir
rigoureux, mais simplement payer tribut a un antique usage. Avant peu lon ne
verra en toi, qui es le plus grand des dieux, quun Saturne quon dépouillera
de tous ses honneurs. Je ne dis pas combien de fois les voleurs ont pillé tes
temples ; ils ont été jusquà porter les mains sur toi-même à Olympie, et
toi, qui fais là-haut tant de tapage, tu ne tes pas donné la peine
déveiller les chiens ni dappeler les voisins, qui, en accourant à tes cris,
eussent arrêté les voleurs faisant leurs paquets pour la fuite. Mais, en vrai
brave, toi, lexterminateur des géants, toi, le vainqueur des Titans, tu es
demeuré assis, laissant tondre tes cheveux dor par les brigands, et cela quand
tu avais une foudre de dix coudées à la main droite. Une école considérable, celle dÉpicure, niait absolument lexistence
dêtres divins et donnait la paix à lâme en la
délivrant des frayeurs quinspirent les prodiges et les fantômes, en bannissant
les espérances chimériques et les désirs insensés[133]. Une autre,
celle de Zénon, distinguait fort mal Dieu de la nature, ou plutôt
lidentifiait avec le monde dont il était lâme invisible, et des poètes,
Manilius, dans ses Astronomiques, peut-être le pieux Virgile[134], adhéraient à
cette puissante doctrine du panthéisme qui sest produite à tous les âges du monde,
pour expliquer linexplicable problème de la métaphysique : laccord du fini
et de linfini, de la nature et de Dieu, de la liberté humaine et de la
providence divine. Hadrien sans doute en était là, lui qui bâtissait des
temples sans images et sans nom : signe de son mépris pour la mythologie
officielle, de son respect pour le dieu impersonnel répandu dans tout
lunivers, qui pourtant ne lui révéla pas, à la dernière heure, le secret du
tombeau[135].
Au fond, Platon, Aristote et toutes les philosophies avaient battu en brèche
avec plus ou moins de prudence le polythéisme officiel. Mais leurs uvres
étaient de celles qui vont aux esprits den haut ; elles ne descendent point
à ceux den bas : les petits dialogues de Lucien allèrent partout. Cet élève
dÉpicure sétait donné pour mission de poursuivre sans relâche les
charlatans, les imposteurs et les superstitieux. Lorsquil faisait si rude
guerre aux vieilles divinités qui sen allaient, comme à celles qui
prétendaient les remplacer, il était certainement un écho, et nous savons
quon lisait avidement ses livres. Il na pas la critique implacable et
froide de Kant qui ruine les systèmes et détrône Dieu respectueusement. Lucien
est de cette famille desprits audacieux et alertes qui détruisent en riant.
Écoutez ce quil fait dire à Jupiter par Timon (Timon, 4) : On ne toffre plus de sacrifices,
on ne couronne plus tes statues, si ce nest quelquefois, par hasard, à
Olympie ; encore celui qui le fait ne croit-il pas remplir un devoir
rigoureux, mais simplement payer tribut a un antique usage. Avant peu lon ne
verra en toi, qui es le plus grand des dieux, quun Saturne quon dépouillera
de tous ses honneurs. Je ne dis pas combien de fois les voleurs ont pillé tes
temples ; ils ont été jusquà porter les mains sur toi-même à Olympie, et
toi, qui fais là-haut tant de tapage, tu ne tes pas donné la peine
déveiller les chiens ni dappeler les voisins, qui, en accourant à tes cris,
eussent arrêté les voleurs faisant leurs paquets pour la fuite. Mais, en vrai
brave, toi, lexterminateur des géants, toi, le vainqueur des Titans, tu es
demeuré assis, laissant tondre tes cheveux dor par les brigands, et cela quand
tu avais une foudre de dix coudées à la main droite.
Rabelais, lArioste, Cervantès, achevèrent aussi par la
moquerie le moyen âge expirant ; Voltaire et Beaumarchais, lancien régime
qui allait mourir. Venus trop tôt, ces rieurs implacables eussent été incompris,
mis au pilori ou brûlés ; arrivés à temps, ils accomplissent dans la société
la fonction que la nature confie aux ferments chargés par elle daccélérer la
décomposition des corps. Mais la vie sort de la mort : les Dialogues
de Lucien, mortels au paganisme, ont aidé à déblayer la place pour une foi
nouvelle[136].
Il ne se peut pas, en effet, que cette audacieuse
raillerie des croyances populaires ne les ait pas fortement ébranlées[137]. Les
sculpteurs, les peintres, exploitaient bien encore le vieux personnel des
légendes helléniques, parce que ces personnages, avec leurs aventures, leurs
traits, leurs costumes, se prêtaient admirablement aux représentations
plastiques : lart faisait vivre pour les yeux la foule olympienne. Les poètes,
moins heureux, ne charmaient plus personne avec les fadaises mythologiques.
Cependant on continuait à bâtir des temples, mais par raison architecturale,
pour embellir une cité ou décorer une place ; on offrait des sacrifices, et,
comme Hérode Atticus, jusquà des hécatombes, mais par gloriole et pour avoir
un prétexte de donner un festin au peuple entier ; on accomplissait les rites
anciens, mais par esprit dobéissance à la tradition. Le sceptique même, dans
une heure deffroi, reprenait pour un moment les sentiments du dévot, et, par
raison dÉtat, le politique les gardait[138].
A ces époques de rénovation, la foule des timides et des
simples forme une masse réfractaire aux nouvelles idées. Dans son dialogue, Minucius
Felix montre un interlocuteur païen qui entend rester fidèle aux coutumes
nationales, par habitude, par respect de la loi, et aussi parce que, sachant,
comme Socrate, quil ne sait rien, il ne veut pas innover en matières si
douteuses, ni raisonner sur des sujets qui se dérobent au raisonnement. Voilà
lhomme prudent. Les simples, paysans au fond des campagnes, petits bourgeois
dans les villes, pauvres diables partout, restaient fidèles à la vieille foi
nationale, à leurs pénates, témoins discrets de la vie domestique, aux mânes
protecteurs de ceux quils avaient perdus, aux anciennes et tranquilles
divinités du pays auxquelles une piété intéressée ou craintive mêlait les
Augustes, dieux nouveaux de lempire. Lorsquils passaient devant les temples
des villes, les chapelles des bourgades, les lieux saints épars le long des
chemins, que ce fût une pierre rustique ayant servi dautel, ou un arbre
consacré dont les branches portaient les toisons des agneaux immolés, ils
sarrêtaient pour faire leurs dévotions, ou, sils étaient pressés, ils
envoyaient de la main un baiser et murmuraient une prière. Les impatients,
trouvant sourds leurs dieux de bois et de pierre, se dédommageaient avec les
astrologues et les devins, engeance qui prospère au milieu des ruines, et les
exaltés, ceux quentraînait la passion du divin, allaient à des rites
étranges venus de lOrient et qui troublaient profondément les âmes.

IV. INVASION DES CULTES
ORIENTAUX.
Dailleurs, au milieu de sa prospérité, le siècle était
malade de la maladie des gens heureux qui, délivrés des soucis de la lutte
pour lexistence, ont tout loisir de songer, même à la mort. Ces hommes de
nature turbulente, faits pour laction et qui durant des siècles avaient si
terriblement agi, étaient fatigués de repos, rassasiés de bien-être et,
nagissant plus, pensaient. Longtemps absorbés par le monde extérieur où le
génie grec et romain avait vécu dans ladoration de la forme, ils se
repliaient sur eux-mêmes, dans le monde intérieur, et ils étaient troublés
par des questions dont jamais ne sétaient inquiétées les vieilles races du
Latium. Doù venons-nous ? Où allons-nous et pourquoi lexistence ? Mais
lhumanité nétait pas mûre encore pour la froide analyse de ces problèmes
redoutables. Ce nétait pas la raison maîtresse delle-même qui les posait et
qui voulait les résoudre. Restée, malgré beaucoup de révoltes, sous la
domination du sentiment religieux, la pensée vacillante, indécise, cherchait
à tâtons des dieux nouveaux. On pénétrait dans les régions vagues, dans les
ténèbres visibles, à la recherche du surnaturel. Cétait le commencement de
la rupture avec lancienne civilisation : aux relirions de la lumière et de
la joie allait succéder la religion des catacombes et des larmes. Comme
transition de lune à lautre, se place linvasion des cultes orientaux.
On est resté longtemps sans voir les transformations de la
pensée religieuse dans la société païenne, et lon ne mettait rien entre la
mythologie dHomère et le symbole de Nicée, de sorte que le monde paraissait
avoir changé de face par une révolution soudaine. Dimportants travaux sur
lhistoire des doctrines religieuses et philosophiques ont montré quaprès
les grands ébranlements causés par les conquêtes dAlexandre et de Rome, des
idées nouvelles avaient circulé dans le ciel de lAsie, de lÉgypte et de la Grèce, sy combinant incessamment en
proportions différentes et finissant par former un courant didéalisme
absolument contraire à celui qui avait porté la civilisation gréco-latine.
Cétait un âge nouveau du monde, dont les philosophes avaient été les
précurseurs : la fin des religions naturalistes et le commencement des
religions morales.
En tout temps, il avait été de la politique de Rome et
dans le caractère de sa religion de donner le droit de cité aux dieux des
vaincus, quand même le sénat le refusait à leurs adorateurs. Sous lempire,
la fréquence et la sûreté des communications facilita cette propagande
religieuse. LOlympe se peupla de divinités que Caton navait pas connues ;
les empereurs y montèrent, les génies parurent en descendre ou en occuper les
avenues, et Rome, capitale religieuse du monde, comme elle en était la
capitale politique, sappelait déjà la cité
sacro-sainte[139].
Ces nouveaux dieux, on les chercha du côté où penchait le
monde. Le commerce, les arts, les lettres, la philosophie, la langue même quon
aimait à parler, tout allait à lOrient. Lesprit religieux prit aussi cette
direction, les princes nièmes ly poussèrent ; Marc-Aurèle remplit Rome de cultes étrangers[140]. Commode,
Élagabal, Alexandre Sévère, accéléreront ce mouvement ; dans son livre des
Erreurs du paganisme, écrit sous Constance, Firmicus Maternus paraît
avoir oublié lancienne religion de Rome et ne connaître quIsis, Cybèle, la Vierge céleste[141] et Mithra. Les
dieux morts, en effet, ne renaissent pas : ils laissent à dautres leur empire.
Mais lâme de lOrient, cest le mysticisme ascétique ou
sensuel ; cest la religion née de lenthousiasme divin, de lextase et de la
foi, en dehors de toute conception rationnelle. La pensée grecque, je nose
dire romaine, sy plongea[142]. Au temps où, sur
les bords du Tibre, les dieux du Capitole conservaient encore tout leur
crédit, la Grèce, depuis longtemps, avait attaqué les
siens. Mais, comme elle avait devancé Rome dans le scepticisme, elle la
devança dans les nouvelles voies religieuses. Tous les écrivains grecs du
second siècle, Lucien excepté, sont des croyants. Plus voisine de lAsie,
elle avait été la première touchée de son souffle, et ce fut par des Grecs de
la Syrie, de
lAsie Mineure et de lÉgypte que les cultes de lOrient se répandirent dans
toutes les provinces de lempire. Les anciens dieux en furent un moment
ranimés. Des oracles depuis longtemps fermés se rouvrirent : la Pythie delphienne
recouvra la voix ; et Dioclétien consultera pieusement lApollon Didyméen. On
rechercha les honneurs sacerdotaux ; on multiplia le nombre des prêtres :
dans lalbum des décurions de Canusium pour lannée 237, on ne trouve pas un
nom de flamine ; celui de Thamugas, rédigé un siècle plus tard, en est
rempli.
Mais ces religions de lOrient arrivaient avec leur
cortège habituel dincantations, de purifications expiatoires et de dévotions
extravagantes, que la Grèce et Rome navaient point connues.
Bruyantes, théâtrales et se plaisant aux émotions tragiques, elles allaient
transformer la foi simple des provinces occidentales[143]. Tels étaient
les cultes des dieux solaires, adonis et Atys, dont la mort et la
résurrection, images du renouvellement des saisons, donnaient lieu à des
fêtes où les populations orientales portaient toutes les exagérations de la
douleur et de la joie : le jeûne, les lamentations funèbres, la flagellation,
avec une discipline dont les cordes étaient garnies dosselets ; même du
sang, des blessures, dhorribles mutilations ou des hymnes joyeux, des danses
orgiastiques et des chants obscènes ; tels encore certains rites du culte de
Cybèle et de Mithra, surtout le taurobole.
Prudence décrit[144] un de ces
sacrifices faits à la Grande Mère, Cybèle. Il montre la foule accourant
de loin à la fête, car celui qui la donnait y déployait toutes les splendeurs
que lui permettait sa fortune, et le clergé y montrait toutes ses pompes.
Dans le voisinage du temple, on creusait une fossé, et, au son des
instruments sacrés, le néophyte y descendait, revêtu dhabits magnifiques, le
front entouré de bandelettes et la tête ceinte dune couronne dor. Au-dessus
de la fosse, recouverte dun plancher à claire-voie, on amenait un taureau
dont les cornes étaient dorées et les flancs à demi cachés sous des guirlandes
de fleurs. Les servants du temple le faisaient tomber sur les genoux, et un
prêtre armé du couteau victimaire ouvrait une large plaie par où le sang
sécoulait à flots. La fosse semplissait dune chaude vapeur ; linitié, les
bras étendus, la tête renversée en arrière, tâchait que pas une goutte de ce
sang narrivât à terre avant de lavoir touché. Ses oreilles, ses yeux, ses
lèvres, sa bouche, tout son corps, devaient en être inondés. Quand il
reparaissait, ruisselant de la pluie vivifiante,
au lieu dêtre un objet de dégoût et dhorreur[145], il était
regardé comme un bienheureux régénéré pour
léternité[146]. Et lon
portait envie à ce riche, achetant par un sacrifice hideux le repos dune
conscience peut-être coupable et la faveur des dieux, quon ne gagnait plus
avec loffrande dune colombe, quelques grains dencens et une vie honnête[147].
Les prêtres de ces cultes nétaient plus, comme ceux de
Rome, des hommes chargés de prier au temple pour la république, et
redevenant, hors des temples, citoyens et magistrats. Consacrés au service du
dieu ou de la déesse, ils formaient un clergé véritable qui prétendait
navoir souci que des choses divines, et ils portaient un costume particulier
que lÉglise a imité avec la même habileté heureuse qui lui a fait conserver,
sous des noms chrétiens, tant de fêtes, de cérémonies et de coutumes païennes[148]. Après le
baptême sanglant du sacrifice taurobolique, lofficiant devenait le père
spirituel de linitié quil marquait au front dun signe pour le consacrer au
dieu[149].
LÉgypte avait déjà des cloîtres où senfermaient les serviteurs de Sérapis[150], et ceux de Mithra,
dIsis, etc., se réunissaient en confréries religieuses où lon était soumis
à des degrés divers dinitiation[151]. La vie
monacale, même érémitique, avait commencé dans les solitudes voisines du
Jourdain et du Nil : les esséniens, qui mettaient tout en commun et pratiquaient
labstinence, ne permettaient pas aux femmes lapproche de leurs demeures ;
les thérapeutes vivaient au désert dans le jeûne. la méditation et la prière,
au milieu des illuminations de lextase[152].
Cest la guerre dActium qui
recommence, sécriait plus tard un philosophe, en maudissant ces
religions dOrient avec lesquelles il confondait le christianisme. Les monstres dÉgypte osent lancer leurs traits contre les
dieux de Rome, mais ils ne prévaudront pas[153]. Le gouvernement
sinquiétait aussi de ces cultes violents qui troublaient les âmes[154] et attiraient
dautant mieux celles que la froide sévérité des anciens rites laissait
maintenant insensibles. Ces émotions, demandées par les matrones aux
nouvelles religions, on ne les leur épargnait pas : spectacles effrayants,
pompes sacrées, paroles mystérieuses, promesses infinies, même rudes
pénitences, tout remuait ces âmes craintives et les attachait. Voyez, dans
Juvénal[155],
comme elles courent aux superstitions orientales et quelle est leur docilité.
Celle-ci, au plus fort de lhiver, va, sous la
menace de ses prêtres, briser la glace du Tibre, pour sy plonger trois fois,
puis elle se traîne sur ses genoux ensanglantés, autour du champ de Tarquin
le Superbe. Celle-là, si la blanche Io lordonne, ira aux extrémités de
lÉgypte puiser dans la brûlante Méroé leau dont elle reviendra arroser,
près du berceau de Romulus, le sanctuaire dIsis. A-t-elle commis
ce que le prêtre considère comme une impiété : des larmes et certaines
paroles quelle murmure obtiennent quOsiris lui pardonne ; après quoi, elle
peut recommencer, car la rémission des fautes est promise, non pas à ce que
les chrétiens appelleront la circoncision du cur, mais à lusage de certains
exercices religieux. La dévotion prenait toutes les formes. On voyait des
rigueurs de piété qui font penser aux richis
de lInde ou à certains moines du moyen âge[156], et des danses
convulsives, comme celles des derviches tourneurs.
Dautres matrones consultent le Juif, le Chaldéen,
laugure de Phrygie. Il leur en coûte, mais elles donnent volontiers pour le
prêtre, pour le temple, pour lidole quelles décorent de somptueux habits,
sauf à la traiter, si elle nexauce pas leurs vux, comme le lazzarone
napolitain traite les saints dont il nest pas content, en les accablant
dinjures et de coups. Il y avait déjà longtemps quun personnage de Ménandre
sétait plaint, sur le théâtre dAthènes, que les dieux ruinaient les maris. A nos femmes, disait un autre, il faut jusquà cinq sacrifices par jour[157].
Pour linitiation à ces mystères, Mithra[158], le médiateur
entre le Dieu suprême et les hommes, exigeait un jeûne de cinquante jours,
plus long que le ramadan de lislam, dix-huit jours consacrés à des épreuves
ou à des pénitences diverses, et deux aux flagellations. Les prêtres de lEnyo
de Comane, pareils aux aïssaoua
dAlgérie, jonglaient avec des épées et se faisaient de cruelles blessures ;
les galles de Cybèle sémasculaient, ainsi que font aujourdhui les scoptzi russes, et une foule de vagabonds
qui se disaient prêtres de quelque divinité, mais exerçaient en réalité des
métiers suspects, mendiaient en débitant des prières, des talismans, des
philtres et de plus, comme les compagnons de Tetzel, des indulgences pour la
rémission des péchés. Jamais bande de gitanos na excité autant de dégoût que
les prêtres de la déesse syrienne dont Apulée nous a laissé la hideuse
peinture[159].
Il y avait donc alors, ce qui se voit souvent, beaucoup de
religiosité et peu de religion. Lobéissance aux prescriptions dun rituel,
surtout laccomplissement des cérémonies expiatoires, qui étaient le
principal caractère des cultes orientaux, paraissaient suffire pour
contraindre la volonté des dieux, leur donner satisfaction et calmer tous les
remords. Il en résultait que les exercices de piété ne tournaient pas
toujours au profit des murs, parce que la religion qui se borne aux
observances extérieures, au lieu daller droit à lâme, se concilie parfaitement
avec le désordre. Dans les légendes du vieux culte, les scènes de rapt ou de
surprises que lhistoire des dieux grecs raconte avec tant de complaisance,
ces récits si peu édifiants, ces représentations qui auraient exigé un autre
voile que celui du symbole, fournissaient aux impudiques des exemples sacrés
dont ils sautorisaient. Dautre part, certains cultes orientaux faisaient du
déchaînement des passions une uvre pie, de sorte quà côté de lascétisme et
des macérations on voyait les plus honteux déportements[160].
Cependant une âme vraiment religieuse trouvait un moyen de
perfectionnement moral dans la préoccupation des choses divines ; et les
extravagances ne len détournaient pas plus que nos fabliaux, la fête des
fous, celle de lâne et quelques sculptures étranges de nos églises ne
détournaient, au moyen âge, les fidèles des enseignements élevés de la chaire
catholique. Les délicats séloignaient des rites obscènes ou grossiers de
Dionysos et dAphrodite, de Sabazios et de la déesse syrienne, pour se faire initier
aux mystères où un lent travail de lesprit religieux avait épuré lidée de
la divinité, en la dégageant des anciennes conceptions naturalistes. Les
prêtres ny révélaient plus rien quon ne sût au dehors, mais ils y avaient
conservé une mise en scène qui frappait limagination et laissait dans lesprit
une impression profonde. Voyez comme Apulée devient grave après son initiation
aux mystères dIsis. Prosterné devant la déesse,
la face sur ses pieds divins, je les arrosai longtemps de mes larmes, et,
dune voix étouffée plus dune fois par les sanglots, je lui adressai cette
prière :
Divinité sainte, source
éternelle de salut, protectrice adorable des mortels, qui leur prodigues dans
leurs maux laffection de la plus douce des mères, pas un jour, pas une nuit,
pas un moment ne sécoule qui ne soit marqué par un de tes bienfaits. Sur la
terre, sur la mer, toujours tu es là pour nous tendre une main secourable,
pour débrouiller la trame inextricable des destins, et conjurer la maligne
influence des constellations. Tu es vénérée dans le ciel, respectée aux
enfers, et par toi le globe tourne, le soleil éclaire, lunivers est régi,
lenfer contenu. A ta voix, les sphères se meuvent, les siècles se succèdent,
les immortels se réjouissent, les éléments se coordonnent. Un signe de toi
fait souffler les vents, gonfler les nuées, germer les semences, éclore les
germes. Ta majesté est redoutable à loiseau volant dans les airs, à la bête
sauvage errant sur les montagnes, au serpent caché dans le creux de la terre,
au monstre marin plongeant dans labîme sans fond. Hais mon génie nest pas à
la hauteur de tes louanges, je ferai du moins ce qui est possible au cur
religieux. Ton image sacrée restera profondément gravée dans mon âme et
toujours présente à ma pensée[161].
On voit quelle direction prenait le sentiment religieux.
Sous le double effort des philosophes et des prêtres des nouveaux cultes,
poussant. la société par des voies différentes vers un but commun, il se
ranimait et se manifestait chez les uns par la violence de dévotions
charnelles, chez dautres par une piété extatique. A lancien merveilleux,
qui périssait, se substituait un surnaturel nouveau. Lair pur qui avait si
longtemps baigné lOlympe hellénique se chargeait de brouillards, le ciel bas
et lourd, mais honnête et bien réglé des divinités latines, devenait confus
et désordonné. La bigarrure que Lucien nous montre dans lassemblée des
dieux, où Anubis à tête de chien siège à côté du radieux Apollon, se
retrouvait dans les croyances. Cétait la plus étrange mêlée de doctrines, de
rites et de dévotions bizarres : anarchie au sein de laquelle, la sensibilité
religieuse surexcitée fournissait aux illuminés, aux fanatiques, aux
charlatans, les moyens dexercer leur zèle ou leur industrie. Apulée a bien
raison décrire alors le mythe gracieux et triste de Psyché. Comme la fiancée
dÉros, la société païenne, prise dune curiosité impatiente, veut percer les
ombres qui lui voilent lépoux divin. Une aspiration ardente emporte beaucoup
dâmes vers linconnu, et elles en demandent la route à ceux qui prétendent y
conduire. Tout le monde, païens, chrétiens et juifs, croyait aux magiciens[162], à commencer
par le gouvernement, qui en avait grand-peur. Contre eux la loi était atroce
: elle condamnait au feu ceux qui pratiquaient la magie ; aux bêtes ceux qui
létudiaient[163].
Sa vogue nen était que plus grande, et ses mystères, ses mensonges,
ajoutaient à la confusion des esprits. Aussi les prodiges nétaient-ils pas
moins nombreux quaux plus beaux jours de la crédulité romaine. Les plus
sceptiques traînaient après eux la superstition comme une partie de leur
propre dépouille. Pline lAncien, qui ne croit pas à Dieu, bien quil croie à
la vertu, accepte les présages, les miracles, et les raconte avec une
imperturbable gravité. On continuait donc à examiner sérieusement les entrailles
des victimes. On cherchait dans les songes les révélations de lavenir[164], et les
Chaldéens construisaient des thèmes de nativité,
qui parfois devenaient des sentences de mort, quand ils promettaient une
haute fortune à des contemporains de Tibère, de Domitien ou de Caracalla. Les
prédictions astrologiques et les vers sibyllins supposaient que le destin
avait à lavance tout arrêté ; loracle, au contraire, donnait à penser que
les dieux intervenaient librement dans les choses de ce monde. Le même homme
nen recourait pas moins, tel jour aux Chaldéens, tel autre à loracle
dAbonotichos dont Lucien nous a conservé la scandaleuse histoire[165].
Les lois immuables de la nature suivaient leur cours, et
pourtant beaucoup croyaient voir des miracles. Comme les plus recherchés
étaient ceux qui donnaient la santé, les intéressés multipliaient et ornaient
les récits qui en couraient. Et, de fait, quelques-uns semblaient réussir.
Dans les temples dEsculape, les cérémonies préparatoires, jeûnes prolongés,
purifications, sacrifices, remèdes étranges, et, en certains cas, efficaces,
enfin, la nuit passée au milieu des serpents sacrés, en présence du dieu, qui
ne manquait point dapparaître dans les songes du malade, ou de lui parler
dans le demi-sommeil, causaient à limagination un ébranlement salutaire[166]. Alors la foi,
la surexcitation nerveuse et quelque médicament mystérieux y aidant, il
survenait des phénomènes que la science de ce temps ne pouvait expliquer et
quil fallait bien alors attribuer à laction divine. Un certain Euphronios, dit Élien[167], sétait laissé prendre aux inepties dÉpicure et par là
était tombé en deux grands maux, limpiété et la scélératesse. Saisi un jour
dune maladie que les médecins ne purent guérir, il fut porté par ses proches
dans le temple dEsculape, et la nuit, durant son sommeil, il entendit une
voix qui disait : Pour cet homme, il nest quun moyen de salut, cest de
brûler des livres dÉpicure, de pétrir avec de la cire cette cendre sacrilège
et den couvrir le ventre et la poitrine. Il exécuta lordre
du dieu et fut du même coup guéri et converti. Élien raconte
imperturbablement quantité dautres cures merveilleuses[168]. Leau de la
fontaine dEsculape à Pergame était souveraine pour beaucoup de maladies, et
des ex-voto, suspendus dans les asclépiéions, mains, bras ou jambes dargile,
comme on en voit de cire dans certaines de nos églises ; des pièces dor et
dargent jetées dans les sources consacrées, attestaient les miracles[169]. Des
inscriptions nous conservent encore le souvenir reconnaissant de ceux qui,
par la faveur du dieu, avaient recouvré la santé ou la vue. Aussi la divinité
secourable avait des temples partout, même à Paris, au lieu où sest élevée
la cathédrale chrétienne, et elle semble avoir pris, dans ladoration des hommes
de ce temps, la place de Jupiter. Sérapis, à Alexandrie, était un autre grand
dieu guérisseur. Toutes les divinités, même des héros qui navaient pas été
admis aux suprêmes honneurs du ciel, possédaient ce privilège ou plutôt
lavaient reçu de leurs confiants adorateurs.
Par contre, les dieux se vengeaient en envoyant aux
sacrilèges la ruine, la maladie, les infirmités ou la mort. Isis rendait
aveugles ceux qui se parjuraient en son nom, et Ovide vit à Tomes de ces malheureux
qui erraient par la ville en confessant leur faute et le juste courroux de la
déesse[170].
Les prêtres, qui entretenaient soigneusement toutes ces
crédulités et souvent les partageaient, sattribuaient quelquefois le don des
miracles. Certains prétendaient chasser les démons et délivrer les possédés ;
dautres, par des charmes secrets, guérissaient les malades ; on disait même
que les prêtres de Sérapis ressuscitaient les morts. Quelques scènes bien
ménagées, parfois bien réussies, transformaient en prodiges des effets très
naturels : un cataleptique se réveillant était un mort quon rendait à la
vie. Alors tout devenait possible pour la crédulité du prêtre et du fidèle.
Les sages avaient cru délivrer le monde des terreurs du surnaturel, le
ramener à la froide raison, à la recherche des meilleures conditions de la
vie présente, et le monde, leur échappant, allait c à la folie du divin[171].
Le dix-huitième siècle à vu un état des esprits à certains
égards semblable : lancienne foi défaillante et, sous les yeux des
philosophes triomphants, les guérisons miraculeuses du diacre Pâris, les
visions des illuminés et le baquet magnétique de Mesmer. Dans le nôtre, en
face de la science attestant la permanence des lois générales, le
somnambulisme, les tables tournantes, les spirites, les esprits frappeurs et
leau merveilleuse de la
Salette ont trouvé dinnombrables adeptes. On vantait à
Voltaire un ouvrage ayant pour titre : Des erreurs et de la vérité. Sil est bon, répondit-il, il doit contenir cinquante volumes in-folio sur la
première partie et une demi page sur la seconde. Nous avons
allongé la demi page, mais avec quelle lenteur !

V. EFFORTS DES PHILOSOPHES POUR
DONNER SATISFACTION AU SENTIMENT RELIGIEUX.
Le temps nétait pas encore venu où lhomme devait
reconnaître que le double mystère de lessence divine et de la création est
aussi bien au-dessus de sa compréhension quil est au-dessus de ses forces de
voler an haut des airs ou de nager, au fond de lOcéan. Les philosophes ne
renonçaient donc pas à faire sortir le monde de lanarchie intellectuelle où
il se débattait douloureusement, et ils pensaient y réussir : les uns en
rejetant ces dieux qui gouvernaient si mal
; les autres en construisant une théodicée acceptable pour les esprits que
navait pas encore saisis livresse du mysticisme[172]. Nous connaissons
les premiers ; voyons les seconds sefforcer daffermir et détendre la
croyance à lunité divine et à limmortalité de lâme, à des peines et à des
récompenses en une autre vie, à des relations en celle-ci avec la divinité
par lintermédiaire des Génies.
Le monothéisme, vaguement entrevu par les peuples
primitifs, qui est au fond des Védas comme au fond de lhellénisme ; et que
les Sémites avaient naturellement conservé dans leur double désert du ciel et
de la terre dArabie, avait été, dans lInde et la Grèce, recouvert et caché sous les riches
draperies que les poètes avaient tendues à la porte des sanctuaires.
Anaxagore le retrouva dans Athènes, Cicéron à Rome. Interprète des
spéculations les plus pures de la pensée grecque, Cicéron était arrivé à
lidée de lunité divine et de limmortalité de lâme, non par suite des
déductions rigoureuses dun philosophe qui construit un système où tout
senchaîne, mais par un noble élan du cur. Les stoïciens avaient remplacé le
Dieu incompréhensible de Platon, le Dieu solitaire dAristote, par un Dieu
vivant, qui pénétrait et remplissait lunivers de sa propre vie[173], et ils
aimaient à répéter les vers magnifiques[174] où Cléanthe
montre une foi si ardente en la raison éternelle. Mais leur âme du monde, ne
se distinguant pas de lunivers, nétait quune force, et leur Providence, enchaînement
nécessaire des causes et des effets, nétait que le Destin. Or les curs
tendres demandaient un Dieu plus personnel, moins inaccessible à
limagination, à la prière, et beaucoup commençaient à le trouver. Quelle
influence a exercée lidée juive de ce Jéhovah qui ne souffrait point de
rival ? On ne saurait le dire, les Juifs se glissaient partout ; les
prosélytes de la porte, quils avaient convertis, ont dû aider à lévolution
commencée au sein du paganisme par les doctrines platoniciennes et qui menait
le polythéisme au déisme. On ne saurait sétonner que le Juif Philon, qui est
si grec, tout en restant très oriental, sépare Dieu du monde, a comme
lartiste est distinct de son uvre n ; mais un vrai païen, Plutarque,
arrivait à la même doctrine. Plutarque était alors le plus illustre
représentant de lAcadémie. Il avait reconnu les deux courants qui
entraînaient les esprits, lun à lathéisme, lautre à la superstition[175]. Il se plaça
entre les humbles et les superbes, essaya de relever ceux-là de leur lâche
abandon et de ramener ceux-ci à la conception du Dieu bon et juste du Timée
de Platon : Dieu unique, immuable, créateur des mondes quil a organisés et
quil conserve en présidant du haut des cieux à leurs révolutions. Jupiter, dit-il, na
pas été nourri dans les antres odoriférants de la Crète, et Saturne
na point dévoré une pierre au lieu de son fils. Principe et cause de son
éternelle existence, il était dès le commencement et il sera toujours. Rien
néchappe à ses regards, ni les sommets des montagnes, ni les sources des
fleuves, ni les villes, ni le sable de la mer, ni linfinie multitude des
astres. Il nous a donné tout ce qui nous appartient ; en lui sont le commencement
et la fin, la mesure et la destinée de chaque chose[176].... Enveloppée dun corps, lâme na point de commerce
véritable avec Dieu ; mais elle peut le toucher légèrement, comme en songe,
par la philosophie. Nous voilà déjà sur la route qui mène à la contemplation
et à lextase, et Numenius y tombe[177].
A la porte du sanctuaire, Platon avait écrit : Il est difficile de découvrir lauteur et le Père du
monde, et, quand on la trouvé, il est impossible de le faire connaître aux
hommes. Malgré cette désespérance, la doctrine de lunité divine
sétait peu à peu répandue hors du sanctuaire. On la voit poindre à Rome aux
derniers jours de la république ; sous lempire, elle fit beaucoup de chemin
dans les esprits. Les peuples y venaient comme les philosophes, car lunité
du principe divin se trouvait au fond des religions orientales, qui prenaient
tant dempire. LIsis dApulée[178] est la divinité
suprême quon adore sous mille noms : Isis
myrionyma[179] ; le Sérapis de
Sévère et de Caracalla[180], le Dieu-Soleil
dÉlagabal et dAurélien, le Bon, le Miséricordieux des Palmyréens,
lAhoura-Mazda des Persans, surtout Mithra, le
soleil invincible quon adore partout, sont, chacun pour ses
fidèles, le Seigneur du monde qui doit être béni
dans léternité. Aussi Maxime de Madaure sera lécho de beaucoup
dâmes païennes lorsquil écrira dans sa belle lettre à saint Augustin : a
Quel est linsensé, lhomme à ce point privé de raison, qui ne regarde pas comme
absolument certaine lexistence dun Dieu unique, qui, sans commencement et
sans avoir rien engendré de semblable à lui-même, soit néanmoins père de
toutes les grandes choses de lunivers ?[181]
 Le Romain comptait avec ses dieux. Il leur rendait un
culte, à charge pour eux de lui rendre des services. A leur égard, il avait
tau respect, de la crainte et point damour[182]. Mais
lhumanité recueille le long de la route où elle poursuit sa lente évolution
intellectuelle et morale, des idées, des sentiments, que dabord elle navait
point, ou quelle navait que confusément. Le respect, la crainte, le calcul,
ne font pas le sentiment religieux véritable. A certaines âmes détachées de
la terre par la souffrance ou la méditation, il faut le plaisir, mystérieux
que lhomme éprouve à se rapprocher par ladoration de la Toute-Puissance
et lorgueil que donne cette communion avec Dieu. Cet amour divin, les
Romains vont le connaître ; par là encore, ils sapprochent du christianisme
qui a fait de ce sentiment le gage de la foi, la garantie du salut. Un
esprit positif, un savant, le médecin Galien, disait : Pourquoi disputer avec ceux qui blasphèment ? Ce serait
profaner le langage sacré qui doit être réservé pour lhymne ait Créateur. La
piété véritable ne consiste pas à lui immoler des centaines de victimes et à
lui offrir des parfums délicieux, mais à reconnaître et à proclamer sa
sagesse, sa puissance et sa bonté.... Il
a prouvé sa bonté par les bienfaits dont il a comblé ses créatures, sa
sagesse par lordre quil a mis en toutes choses pour les faire subsister, sa
puissance en créant chaque être parfaitement conforme à sa destination.
Élevons donc nos hymnes et nos chants en lhonneur du Maître de lunivers[183]. Le Romain comptait avec ses dieux. Il leur rendait un
culte, à charge pour eux de lui rendre des services. A leur égard, il avait
tau respect, de la crainte et point damour[182]. Mais
lhumanité recueille le long de la route où elle poursuit sa lente évolution
intellectuelle et morale, des idées, des sentiments, que dabord elle navait
point, ou quelle navait que confusément. Le respect, la crainte, le calcul,
ne font pas le sentiment religieux véritable. A certaines âmes détachées de
la terre par la souffrance ou la méditation, il faut le plaisir, mystérieux
que lhomme éprouve à se rapprocher par ladoration de la Toute-Puissance
et lorgueil que donne cette communion avec Dieu. Cet amour divin, les
Romains vont le connaître ; par là encore, ils sapprochent du christianisme
qui a fait de ce sentiment le gage de la foi, la garantie du salut. Un
esprit positif, un savant, le médecin Galien, disait : Pourquoi disputer avec ceux qui blasphèment ? Ce serait
profaner le langage sacré qui doit être réservé pour lhymne ait Créateur. La
piété véritable ne consiste pas à lui immoler des centaines de victimes et à
lui offrir des parfums délicieux, mais à reconnaître et à proclamer sa
sagesse, sa puissance et sa bonté.... Il
a prouvé sa bonté par les bienfaits dont il a comblé ses créatures, sa
sagesse par lordre quil a mis en toutes choses pour les faire subsister, sa
puissance en créant chaque être parfaitement conforme à sa destination.
Élevons donc nos hymnes et nos chants en lhonneur du Maître de lunivers[183].
Ce Dieu, Épictète veut quon laime et quon célèbre
incessamment ses bienfaits : Puisque vous êtes
aveugles, vous, le grand nombre, il faut que quelquun répète pour tous
lhymne à la divinité. Si jétais le rossignol, je chanterais ; homme, je
loue Dieu. Cest ma tâche, et, cette tâche, je laccomplirai tant que je
pourrai la remplir. Dites avec moi : Dieu est grand. D Cest
lesprit de nos psaumes, Laudate Dominum[184].
Voici donc des païens qui arrivent à lidée de lunité
divine, de la Providence
et au culte dadoration qui lui est dû. Mais comment conciliaient-ils cette
idée avec leur paganisme ? Très facilement. Sénèque avait dit : Dieu a autant de noms quil accomplit dactions diverses.
Ainsi, il est Bacchus, comme père de toutes choses ; Hercule, attendu sa
puissance invincible ; Mercure, puisquil est la raison, le nombre, lordre
et la science[185]. Et trois
siècles plus tard Maxime de Madaure répète que les divinités secondaires ne
sont que les vertus du Dieu suprême, répandues à travers le monde et honorées
sous différents noms parce quon ignore le nom même du Dieu unique. En leur
adressant des prières, cest lui-même quon adore.
Une de ces vertus divines prenait de jour en jour un
caractère plus élevé. Minerve, qui, dans lancien naturalisme, avait
représenté lair et leau, la matière subtile et pure, avait ensuite
personnifié lintelligence. Après Jupiter,
dit Horace, Pallas a les premiers honneurs[186]. Pour le poète,
lOlympe est encore une cour où la déesse siège aux côtés du souverain. Les
philosophes allant plus loin dans la spiritualité, firent delle la pensée du
Dieu unique. La vierge céleste, née de Jupiter, devint la sagesse immaculée,
le Verbe du maître de lunivers. Saint Justin sen étonne, le Verbe ne pouvant être une femme[187]. Mais le
rhéteur Aristide, son contemporain, explique sans beaucoup de peine le mythe
profond où le λόγος
θεϊος, de Platon se cachait sous la
légende[188].
Jupiter se retirant en lui-même, conçut en soi la
déesse et lengendra de sa substance. Elle est sa véritable fille, dune
origine absolument identique et égale. Ne quittant jamais son père, elle vit
en lui et avec lui, comme si elle lui était consubstantielle.... Ainsi que le
soleil apparaît avec tous ses rayons, Minerve sortit de la tête paternelle
tout armée de ses dons. Dans lassemblée des dieux, sa place est la plus
voisine de Jupiter. Tous deux nont sur toute chose quune même volonté. Si
lon en conclut que Minerve est la forme de Jupiter, on ne se trompera pas,
puisque tout ce que fait Jupiter, Minerve le fait avec lui. Aussi peut-on lui
attribuer toutes les uvres de son père[189]. LIsis de
lépoque alexandrine avait le même rôle auprès dAmmon. Elle était la sagesse,
la justice, lâme de lÊtre suprême, le médiateur entre le monde et lui[190].
 Philon, dont linfluence a été si considérable sur lécole
dAlexandrie, même sur certains Pères de lÉglise, avait développé, dès le temps
dAuguste et de Tibère, la théorie du Dieu triple et cependant unique que
lÉgypte, la Chaldée,
la Perse,
lInde, la Grèce pélasgique et la Gaule avaient adoré. Du
sein de lÉternel, retiré dans les impénétrables profondeurs de son essence, était sorti, par une première
émanation, le fils aîné de Dieu et le plus ancien
des anges, que Philon appelle aussi lhomme
divin, parce que lhomme de la terre avait été créé à son image. Philon, dont linfluence a été si considérable sur lécole
dAlexandrie, même sur certains Pères de lÉglise, avait développé, dès le temps
dAuguste et de Tibère, la théorie du Dieu triple et cependant unique que
lÉgypte, la Chaldée,
la Perse,
lInde, la Grèce pélasgique et la Gaule avaient adoré. Du
sein de lÉternel, retiré dans les impénétrables profondeurs de son essence, était sorti, par une première
émanation, le fils aîné de Dieu et le plus ancien
des anges, que Philon appelle aussi lhomme
divin, parce que lhomme de la terre avait été créé à son image.
Ce premier-né du Dieu créateur de lunivers est le Verbe
intérieur ou la Sagesse
divine qui gouverne le monde. A son tour, il engendra le Verbe prononcé ois
la parole, lEsprit qui vivifie les êtres par la grâce, Vierge céleste servant de médiatrice entre Dieu qui offre
et lâme qui reçoit. Comme ce Juif platonicien, qui réveille une
des plus vieilles croyances de la race aryane, est loin du Jéhovah de Moïse,
mais aussi comme il prépare lalliance entre les hommes de lancienne loi et
ceux de la loi nouvelle[191] ! Numenius, qui
disait du grand Juif alexandrin : Est-ce
Philon qui platonise ou Platon qui philonise ? admettait une
trinité analogue, formée par émanation du Dieu suprême[192].
Le Dieu des stoïciens perdu au sein de lunivers devenait
donc le Dieu personnel, incréé, éternel, qui a tout produit et qui gouverne la
création par son Verbe, comme César gouverne lempire par sa sagesse[193] : un seul Dieu,
un seul prince, les deux croyances sattiraient ; plus tard on dira : une loi, un roi.
Cette conception quon trouve au commencement de notre ère
à Alexandrie, que proclament avec des variantes, en ce moment négligeables,
Plutarque sous les Flaviens, Aristide sous les Antonins, Maxime de Madaure
sous Théodose, les platoniciens à tous les âges, se continue donc à travers
les quatre premiers siècles de lempire. Elle peut se ramener à ces termes
qui faisaient le fond de lenseignement théologique dans lécole de Platon :
Dieu, inaccessible pour nous dans son essence, se manifeste, dans le monde
extérieur, par lharmonie de la création ; dans le cur de lhomme, par la conscience
; dans le monde des idées, par le Verbe archétype du Vrai, du Beau et du Bien,
vérité éternelle qui éclaire les hommes, médiateur divin entre lhumanité et
Dieu. En un mot, deux grandes conceptions sélevaient au-dessus des croyances
désordonnées : celle dun premier principe, le Dieu unique, et celle du λόγος, à la fois
providence de Dieu et lumière des esprits[194]. Ces idées
prenaient tant dempire, que saint Justin considérait la philosophie païenne
comme le reflet inconscient et obscur du Verbe divin, dont le Christ avait
été la révélation éclatante et complète[195]. Sous la forme
chrétienne des trois hypostases dune seule et même nature suprême : le Père,
ou lessence divine ; le Fils, ou son intelligence créatrice ; lEsprit, ou
sa puissance vivifiante, la croyance au Dieu unique et à son Verbe allait
exercer un prodigieux empire.
Ce Dieu tout-puissant, père des hommes, leur doit justice.
Pour montrer que cette justice leur était faite, il fallait admettre un autre
dogme, celui de limmortalité de lâme. Dans la Grèce dHomère et dans la Palestine des anciens
jours, cette croyance était obscure. Les morts des Grecs et des Romains
avaient, aux champs élysées, une vie moins incertaine que les réphaïm des Juifs dans leur schéol[196]. Mais, quoique
cette ombre de vie fût une misérable récompense, certains philosophes des
derniers temps de la Grèce avaient trouvé que cétait encore
accorder trop à la nature humaine. Les épicuriens, pour qui les dieux
nétaient que des fantômes, quil fallait chasser de limagination des
hommes, terminaient naturellement nos destinées ici-bas. Les cyniques
pensaient de même : Lâme est-elle immortelle ?
demandait-on à Démonax. Oui,
répondit-il, comme tout le reste ; et lon
a vu sa définition de lhomme libre : Celui qui
ne craint et nespère rien. Pline lAncien ne croyait pas à une
autre vie[197],
et son neveu faisait consister limmortalité à vivre dans la mémoire des
hommes[198].
Les péripatéticiens étaient dans le même sentiment. Lhomme quau troisième
siècle on appela le second Aristote, Alexandre dAphrodisias, soutenait que
son maître ne pensait pas autrement. Bon nombre de stoïques en étaient là, à
lexemple de Zénon, et le plus parfait dentre eux, Marc-Aurèle, ne savait
point si tout ne finissait pas à la mort[199]. Galien, qui
parle si bien du Dieu unique reste indécis sur la question de limmortalité :
Connaissance, dit-il, qui nest pas absolument nécessaire pour lacquisition de
la santé ou de la vertu. Tacite aussi voudrait croire, avec lauteur
du Songe de Scipion, quil est un lieu réservé
aux hommes vertueux et que les grandes âmes ne séteignent pas avec le corps
; cependant il ne trouve pour le suprême adieu que ces mots : Repose en paix, qui nexpriment pas, comme le Requiescat in pace des chrétiens, le repos
précurseur de la résurrection[200].
On nest jamais sûr de saisir la pensée ondoyante de
Sénèque ; il disait bien : Me défendras-tu de
chercher à pénétrer les secrets du Ciel et veux-tu que jaie toujours la tête
penchée sur la terre ? Je suis de trop bon lieu et né pour de plus grandes
choses (Epist.
65). Alors, Platon
lemportant sur ses ailes, il voit les âmes des justes séjourner quelque
temps au-dessus de nos têtes pour se purifier de toute souillure, puis
sélancer dans la sphère éthérée et se mêler à la troupe sacrée des
bienheureux qui puisent toute science à la source du Vrai (Ad Marc., 25). Par malheur, il
venait de dire dans le même traité : Persuade-toi
bien que les morts néprouvent aucune douleur. Cet enfer quon nous a peint
si terrible nest quune invention des poètes. La mort est la délivrance ;
elle nous rend au tranquille sommeil dont nous jouissions avant de naître[201].
Ces idées étaient plus répandues quon ne le pense : Tu le sais, dit Plutarque à sa femme, il en est qui persuadent au vulgaire que la mort est la
délivrance de tout mal[202]. Des
inscriptions en parlent comme du repos éternel, de léternelle sécurité[203]. Autrefois, je nétais pas ; aujourdhui, je ne suis plus ;
mais je nen sais rien et peu mimporte[204].
En voici une qui est sans doute dun lettré : Dans lHadès, on ne trouve ni barque, ni Caron, ni Éaque,
ni le portier Cerbère. Nous tous que la mort y envoie, nous ne sommes
quossements et cendres[205]. Dautres
rappellent les joies brutales de la vie et conseillent den user : Vous qui vivez encore, mangez, buvez, amusez-vous, puis
venez ici[206] ; où, dit une autre, il
ny a plus ni rire ni joie[207]. Tant que jai vécu, jai vécu ; ce que jai bu et mangé,
cela seul est maintenant avec moi[208]. Cette
inscription est dun soudard ; celle que le pape Urbain VIII fit briser était
encore plus ignoble[209]. Certains
païens navaient pas plus de pudeur dans la mort que dans la vie, et il y a
toujours de ces âmes immondes que la foi disparue laisse en proie aux plus
bas instincts.
Cependant, bien plus grand était le nombre des esprits à
qui le ciel vide et le Dieu-Nature ne suffisaient pas. Sur une stèle
funéraire, on voit dipe et le Sphinx : la vie demandant le secret de la
mort. Mais la Mort
ne livre jamais son secret, et, en face de ce néant que quelques-uns acceptaient,
dautres se révoltaient, jusquà nier la vie. Mourir,
disaient-ils après Héraclite, mourir, cest se
réveiller.
Deux écoles offraient un refuge à ces esprits amoureux de
spiritualité : le pythagorisme avec sa grande doctrine de la migration des âmes,
par conséquent, des épreuves et des purifications successives, le platonisme
avec ses espérances dimmortalité, encore incertaines chez le maître, mais
que, déjà, les disciples précisent et affirment. Toutes deux allaient se
réunir dans lécole dAlexandrie, qui sefforcera de rendre une vie nouvelle
au polythéisme : dune part, en lexpliquant par des allégories et de la
métaphysique ; de lautre, en ramenant, par un puissant effort déclectisme,
les traditions religieuses de tous les peuples sous le contrôle supérieur de
la philosophie : distinctions subtiles, interprétations ingénieuses,
rapprochements forcés, bons pour des esprits raffinés, insaisissables pour la
foule et par conséquent sans action sur elle. Mais cette école ne commence
que vers 193, avec Ammonius Saccas ; son histoire appartient donc à la
période suivante.
 Plutarque, qui procède surtout de Platon, fit un vigoureux
effort pour défendre le dogme du Dieu unique, de sa Providence et de
limmortalité de lâme. Aux épicuriens qui, pour délivrer lhomme des
terreurs de lenfer, lui ôtaient lespoir de léternité, le sage de Chéronée
répondait : Malheureux qui fermez les portes
dune autre vie ! Vous ressemblez au passager battu par la tempête, qui
disait à ses compagnons de voyage : Nous navons plus de pilote pour nous
conduire et nous ne pouvons compter sur les Dioscures pour apaiser les vents
; quimporte ! Bientôt nous serons brisés contre les écueils et engloutis
dans labîme. Un autre platonicien, Maxime de Tyr, écrivait : Lâme généreuse verra sans regret la décadence et la
dissolution du corps, comme un captif verrait sécrouler sa prison et venir
la lumière avec la liberté[210]. Plutarque, qui procède surtout de Platon, fit un vigoureux
effort pour défendre le dogme du Dieu unique, de sa Providence et de
limmortalité de lâme. Aux épicuriens qui, pour délivrer lhomme des
terreurs de lenfer, lui ôtaient lespoir de léternité, le sage de Chéronée
répondait : Malheureux qui fermez les portes
dune autre vie ! Vous ressemblez au passager battu par la tempête, qui
disait à ses compagnons de voyage : Nous navons plus de pilote pour nous
conduire et nous ne pouvons compter sur les Dioscures pour apaiser les vents
; quimporte ! Bientôt nous serons brisés contre les écueils et engloutis
dans labîme. Un autre platonicien, Maxime de Tyr, écrivait : Lâme généreuse verra sans regret la décadence et la
dissolution du corps, comme un captif verrait sécrouler sa prison et venir
la lumière avec la liberté[210].
Les curs aimants navaient pas attendu les philosophes
pour douter de cet anéantissement. Certaines inscriptions portent ces mots où
se lisent à la fois la résignation et lespérance : Pluton nest pas si méchant[211]. Quand tu meurs, tu nes pas mort, dit une autre
malheureusement très fruste[212]. Non, écrit un père sur le tombeau de son fils,
mort au fond de la Numidie,
non, tu ne descends pas au séjour des mânes, tu
télèves vers les astres du ciel[213]. A lautre bout
du monde romain[214], une mère fait
graver sur la pierre sépulcrale de son enfant : Nous
sommes accablés par une cruelle blessure ; mais toi, renouvelé dans ton être,
tu vis dans les champs élyséens. Les dieux ordonnent que celui-là revienne
sous une autre forme qui a bien mérité de la lumière du jour ; cest une
récompense que tavait acquise.... ta simplicité docile. Maintenant, dans un
pré en fleur, linitiée marquée du sceau sacré tagrége à la troupe de
Bacchus, où les naïades qui portent les corbeilles saintes te réclament comme
leur compagnon, pour conduire à la lueur des torches les processions
solennelles[215].
On peut suivre le développement de cette idée dans les
transformations successives dun mythe charmant, celui de Psyché ; lâme
humaine qui, purifiée par lamour et la douleur, devient immortelle.
La philosophie et bien des âmes étaient donc en possession
de cette double idée : lunité divine et la vie future ou la résurrection. On
pouvait reprendre alors avec plus de force la question des récompenses et des
peines et arriver à une conception plus nette de lexistence doutre-tombe.
Plutarque y consacra surtout deux traités, ceux de la Superstition
et des Délais de la justice divine,
qui comptent parmi ses meilleurs ouvrages[216]. Un mot du
dernier résume pour lui le rôle de la Providence : Tout
coupable est un prisonnier de la justice divine. Tôt ou tard,
ici-bas ou dans lautre vie, en sa personne ou dans sa postérité, il reçoit
son châtiment.
Les païens nadmettaient pas plus que les premiers
chrétiens la pure spiritualité de lâme[217]. Les ombres,
matière subtile et insaisissable, éprouvaient encore les besoins de
lhumanité, ses plaisirs et ses peines. Elles avaient faim et soif : de là
les libations et les offrandes faites près des tombeaux ; les repas funèbres
quon y célébrait, sorte de communion avec le mort[218] ; les objets
quil avait aimés, déposés près de lui ; même les sacrifices dêtres animés,
un cheval, un esclave, qui le serviraient dans son autre existence. Achille
immole des captifs pour faire à Patrocle un cortége dhonneur dans les champs
élyséens, comme on enterre le guerrier des Prairies avec ses armes et son
cheval de guerre. A côté du monde des réalités se trouvait le monde, tout
aussi réel pour le païen, des spectres et des fantômes, bienveillants ou
terribles.
Ces ombres pouvaient aussi éprouver des joies morales et
souffrir des douleurs physiques, puisque la croyance à une autre vie conduisait
ceux qui lacceptaient à admettre des peines et des récompenses.
Limagination populaire, si riche pour les tourments de lenfer, a toujours
été fort pauvre quand il sest agi des béatitudes de lÉlysée. Les bienheureux dHomère et de Virgile ont une
assez triste existence : Ne me console pas de la
mort, dit Achille à Ulysse ; jaimerais
mieux cultiver la terre au service de quelque laboureur que de régner ici sur
toutes les ombres des morts. Ceux de la foule avaient des joies
encore plus vulgaires qui se ressentaient du sensualisme païen. Pour les
maudits, on avait trouvé mieux ; mais que Plutarque, dans sa description du
séjour des damnés, reste loin de la terrible grandeur du poète florentin[219] ! A force
de vivre, lhumanité a connu plus de torturés, et ses poètes ont pu varier
les supplices des réprouvés. Malgré cette indigence relative, le mythe des
Furies vengeresses faisait trembler bien des croyants, et, tout incomplète
que fût cette sanction morale, cen était une.
Tout pécheur ne tombait pas en leurs mains redoutables.
Au-dessous de la région supérieure où les âmes vertueuses vivaient dans une
éternelle sérénité, mais au-dessus de labîme où retentissaient les cris de
douleur des damnés, sagitaient, emportées par un tourbillon perpétuel, les âmes
dont la perversité nétait pas inexpiable. Labîme avait lui-même trois
cercles, trois degrés de supplices, les uns plus doux, les autres plus
terribles. A lun présidait Pna ou le
Châtiment ; à lautre, Diké ou la Justice ; au troisième, Erinys ou la Vengeance.
Cette page du traité des Délais de la justice de Dieu
(§ 22) fait
penser à la Divine
comédie de Dante et au purgatoire des chrétiens. Le poète le plus
populaire de lantiquité romaine, Virgile, avait une doctrine analogue. Certaines âmes, dit-il (Æn., VI), sont battues
incessamment des vents, dautres sépurent par le feu. Après mille ans, elles
sont délivrées des souillures de la terre, mais cest pour revenir habiter de
nouveaux corps. La ressemblance ne va pas plus loin. Pour le
chrétien, lautre vie est la vie véritable ; pour le païen, celle-ci était la
plus sûre, et, dans la pensée du plus grand nombre, la meilleure. Aussi
beaucoup ressentaient de véritables terreurs à lapproche de ce moment où le
remords vous saisit[220]. Par
linitiation aux mystères, on cherchait à se mettre en état de grâce, et par
des purifications, des prières, on espérait saffranchir des expiations
doutre-tombe.
Il nappartient pas à lhistorien de dire ce quil peut
manquer à toutes ces philosophies de rigueur scientifique, mais il est obligé
de rechercher quelle a été leur influence sur la société. La logique ne
gouverne pas le monde, et de belles paroles, allant éveiller au fond du cur
les sentiments qui sy cachent, ont plus deffet que les syllogismes les
mieux construits : témoin Sénèque et Plutarque, qui ne sont pas de grands
philosophes et qui, pourtant, ont exercé une puissante action sur léducation
générale. Or les inscriptions des tombeaux, les images qui sy trouvent, les
représentations mythologiques quon se plaisait à y tracer : Proserpine
rendue à la lumière du jour, Alceste attendant son époux, Hercule triomphant
de la mort, et les scènes joyeuses ou la tranquille félicité de la vie
élyséenne, que reproduisaient tant de bas-reliefs funéraires[221], attestent la
préoccupation dune autre existence.
Cette croyance entraînait celle de communications
habituelles entre le monde des vivants et le monde des morts. Dans la veille
ou le sommeil, surtout la nuit ou à lombre des bois, on croyait voir
lesprit de ceux quon avait aimés, les spectres funèbres, larves ou lémures,
dont on redoutait la sinistre influence, et lâme irritée de ceux qui, ayant péri
de mort violente, navaient pu trouver un tombeau. Dans cette autre
existence, ils semblaient avoir pris un pouvoir redoutable ou bienfaisant :
aussi, pour apaiser les mânes, on célébrait chaque année trois fêtes, le 24
août, le 5 octobre et le 8 novembre, en ouvrant le mundus, fosse
profonde consacrée aux divinités infernales et par où sortait alors la troupe
des esprits silencieux[222]. Dion Cassius,
Philostrate, Pausanias, voyaient partout des spectres, et Pline le Jeune
croyait aux revenants (Lettres,
VII, 27).
Ces morts au milieu desquels on vivait, puisque les
tombeaux étaient placés à lentrée des villes, le long des grandes voies
publiques ; ces génies qui rôdaient incessamment autour des hommes, on
voulait les interroger, et, par eux, pénétrer lavenir. De là les évocations,
les charmes, les sacrifices magiques, qui parfois étaient dabominables
forfaits, comme ces immolations denfants que firent plusieurs empereurs[223] et dont on
accusait faussement les chrétiens. Le roman dApulée, qui met en action lart
infernal des sorcières de la
Thessalie, montre combien les hommes de ce temps étaient
préoccupés des mystères doutre-tombe et du monde des esprits.
Il ne faut pas chercher dans cette croyance un dogme bien
défini, quoiquelle datât de loin, puisque Platon[224] et Pythagore
lenseignaient, et quon peut la faire remonter plus haut. La répugnance à
lanéantissement et le besoin dexpliquer le mal, sans trop compromettre les
dieux, avaient peuplé le monde inférieur et lespace entre ciel et terre
dêtres innombrables[225] : âmes des
justes ou génies tutélaires, âmes des méchants ou démons malfaisants. De
cette croyance vague et flottante, mais dautant plus populaire, la
philosophie avait tiré la théorie des Génies, doctrine commode pour concilier
lidée de lunité divine avec le respect de la religion officielle.
Exécuteurs des arrêts de la
Providence, ces Génies ou démons étaient en relation
constante avec la terre, fortifiant les bons, comme les anges gardiens de
lÉglise, terrifiant les réprouvés et présidant à tous les actes de la vie
civile et religieuse[226]. Il semblait
quon pût rendre compte du bien et du mal par laction de cette armée peu
disciplinée dont le chef résidait au fond de lempyrée, tranquille en ses
desseins impénétrables. Les récriminations de la terre narrivaient plus
jusquà lui, auteur de tout bien ; elles sarrêtaient aux Génies malfaisants,
auteurs de tout mal ; et qui devaient un jour en répondre devant le juge
suprême.
Maxime de Tyr, qui fut peut-être un des précepteurs de Marc-Aurèle,
avait, comme Dion Chrysostome, beaucoup voyagé et, comme lui, beaucoup
discouru, en répandant par ses discours les préceptes dune saine morale et
la croyance à limmortalité de lâme. Il revient souvent sur cette théorie
des Génies. Les âmes, dit-il, devenues des démons, tout en conservant un triste souvenir
de leur existence passée, sont heureuses de celle quelles ont retrouvée.
Elles saffligent du sort de leurs surs qui sont encore ballottées sur les
flots de la vie, et se plaisent prés delles pour les retenir ou les relever
quand elles glissent sur la pente du mal. La divinité leur a donné la mission
de venir en aide aux bons, de secourir ceux qui souffrent et de punir ceux
qui font mal[227].
Je vais, dit-il
encore, téclaircir par une image ce que je veux
dire. Figure-toi quelque grand royaume ou quelque puissant empire, dans
lequel tout le monde conforme spontanément ses actes à la volonté dun roi
unique et supérieur à tous en pouvoir et en majesté. Les limites de cet empire
ne sont ni lHalys, ni lHellespont, ni le Palus-Méotide, ni lOcéan, mais en
haut le ciel et en bas la terre. Dans la partie la plus élevée de ce royaume,
le roi siège immobile, comme la loi et la règle souveraine ; il distribue aux
peuples. la vie et le salut qui dépendent de sa puissance. Niais ce dieu a
pour compagnons de son empire des dieux innombrables, dont les uns,
invisibles et immobiles, plus rapprochés du roi par leu : nature, se tiennent
aux portes du sanctuaire, tandis que dautres, mobiles et visibles, leur
obéissent comme des ministres, à qui dautres encore sont soumis. Tu vois
ainsi par la pensée cette hiérarchie et cette chaîne sans fin qui du ciel
descend jusquà la terre.... Oui, dans
ce conflit et cette diversité des opinions sur la nature divine, toutes les
législations et toutes les croyances de la terre conviennent en ce point,
quil y a un seul Dieu, père et maître de lunivers, et que beaucoup dautres
êtres divins lui sont subordonnés, qui sont les fils et comme les ministres
de ce roi suprême[228].
Apulée pensait de même[229]. Mais, si les
dieux honorés sous tant de noms nétaient que la personnification des forces
mises en jeu par la puissance divine, il ny avait point de raison, cette
interprétation admise, de leur refuser un hommage qui remontait à leur maître
commun. Aucune des écoles philosophiques nattaquait donc directement le
culte établi, pas plus celle dÉpicure que celle de Zénon[230]. Comme Socrate,
ses élèves, quelque nom quils prissent, sacrifiaient sur tous les autels,
et, par là, ils échappaient au péril que les chrétiens rencontrèrent. Ils ny
mettaient point dhypocrisie. Plutarque, le grand prêtre dApollon, remplissait
ses fonctions sacerdotales avec le zèle dun vieux croyant. Il y trouvait une
grande douceur, sans aucun embarras pour sa conscience. Les Génies lui
expliquaient tout ; ils sauvaient pour lui le dogme du Dieu unique et bon.
Aussi un des premiers adversaires dogmatiques des chrétiens, le philosophe
Celsus, déclarait ne voir aucune différence entre les anges de la nouvelle doctrine
et les démons de Platon[231]. Les Pères de
lÉglise accepteront même la démonologie platonicienne, mais en la retournant
contre le polythéisme ; ils expliqueront par cette puissance satanique les
oracles et les miracles dont le paganisme sautorisait[232].
On na point encore parlé des gnostiques. Il fallait
réserver pour la fils de notre revue le fait intellectuel qui caractérise le
mieux lépoque que nous étudions : la mêlée des systèmes. Grâce à la paix romaine, les peuples ne se combattent
plus ; mais les philosophies, les religions, luttent les unes contre les
autres, chacune brisant, contre un adversaire, ses formes particulières, et
toutes échangeant leurs idées, leurs rites, même le costume de leurs prêtres,
jusquau moment où presque toutes aussi se réuniront dans la catholicité,
cest-à-dire dans luniversel.
La gnose, lexpression la plus complète de cette
confusion, en fut le produit naturel. Faite déléments empruntés aux
doctrines alors dominantes dans lempire, juives, chrétiennes, polythéistes,
même aux religions de la
Chaldée, de la
Perse et peut-être de lInde, elle nétait ni une
philosophie ou un système rationnel, ni une religion, cest-à-dire, une loi,
un livre, un texte sacré. Limagination y jouait le rôle principal et y
faisait courir à lesprit toutes les aventures. Adeptes dune science
mystérieuse quils disaient une émanation directe de la divinité, les gnostiques
navaient point de corps de doctrine et nétaient par conséquent réunis ni
par le lier dun même dogme ni par la discipline dune même église : aussi la
gnose a-t-elle mille faces. A côté des pratiques les plus grossières, on y
voit la spiritualité la plus haute ; au fond, cétait une école de
mysticisme, cest-à-dire de désordre religieux, parfois dimmoralité, à
raison de son orgueilleuse indifférence pour les uvres. Ainsi Basilide
enseignait que les parfaits sétaient, à force de piété, élevés au-dessus de
toute loi et quaucun vice nétait pour eux une souillure. La gnose devait
être et elle fut la mère dhérésies nombreuses qui, après avoir troublé
lempire, reparaîtront menaçantes en plein moyen âge[233].
Voilà bien des systèmes différents ; ils, ont pourtant une
tendance commune : le mépris de la chair, le culte de lesprit et la
croyance, de jour en jour mieux affermie, dune divine Providence. Toute
philosophie tend alors à lidéalisme, toute religion au mysticisme. Le monde
marche vers lavenir par ces deux voies qui souvent se confondent ; et, parmi
les héritiers de Caton et de Fabricius, dans ce peuple de laboureurs
intéressés ou dusuriers avides, beaucoup sont déjà possédés des mystiques
ardeurs. Les populations des provinces orientales, où lexaltation religieuse
est endémique, en avaient été agitées les premières ; celles de lOccident y
cédaient peu à peu. Alors on comprend quil sera possible de faire abandonner
à ces hommes la terre, quils aimaient tant à tenir, pour le ciel qui va leur
être donné en espérance. On voit comment se faisait, par le courant du
siècle, la préparation évangélique ; comment tout sordonnait peu à peu dans
le monde païen pour le triomphe des idées spiritualistes qui sétaient fait
jour dans lenseignement dAnaxagore, de Socrate et de Platon, dune manière
philosophique ; dans les mystères, sous lenveloppe des symboles, et dont le
christianisme sera la forme religieuse, cest-à-dire populaire. Il en va
toujours de même. Dans lhistoire, pas plus que dans la nature, il ny a de
révolution soudaine. Les croyances qui meurent se rencontrent avec celles qui
arrivent à la vie. Comme les continents changent lentement leurs formes ;
lentement aussi les idées font leur chemin dans lhumanité, et ceux quune
doctrine nouvelle considère, après son triomphe, comme des ennemis, nont été
souvent que des précurseurs[234].

VI. LE CHRISTIANISME.
Si nous avions à faire lhistoire interne du
christianisme, nous devrions reconnaître et suivre dautres courants didées
qui ont contribué à former le fleuve immense. Ce nest pas impunément que les
Juifs avaient vécu parmi les sectateurs de lAvesta et quils se trouvaient
au milieu dun monde si agité par la pensée religieuse. Depuis Alexandre,
tout lOrient hellénique était en travail de renouvellement. Dans la vieille
Égypte, même en Palestine, on usait du procédé dont les philosophes grecs
sétaient servis pour lexplication des légendes religieuses[235]. La Bible nétait plus un
texte impératif ; les Juifs de lécole de Tibériade, ceux dAlexandrie
surtout, pratiquaient la maxime de saint Paul : La
lettre tue, lesprit vivifie, et Philon nous a montré combien ces
libres interprétations faisaient apparaître de nouveautés. Mais létude des
origines chrétiennes et lexégèse du Nouveau Testament ne sont pas du ressort
de lhistoire politique. Celle-ci na le droit de soccuper du christianisme
quaprès quil est devenu un fait social, cest-à-dire lorsquil intéresse
une partie du peuple et quil attire lattention des pouvoirs publics. Cétait
au contraire un devoir pour elle détudier lévolution produite par
linfluence de la philosophie grecque dans le sein de la société romaine. Il
importait de montrer combien de choses concouraient alors à créer lesprit
nouveau qui, sous la direction de lÉglise, allait conduire le monde
gréco-latin en des voies où il navait pas encore marché.
Au cours du précédent volume, on a vu lapparition confuse
du christianisme dans la capitale de lempire dès le temps de Néron et de
Domitien ; la preuve, à lépoque de Trajan, des progrès quil accomplissait
sourdement ; enfin, sous Hadrien et Antonin, le courage de ses apologistes ;
sous Marc-Aurèle, celui de ses martyrs.
A la mort de ce prince, le christianisme comptait un
siècle et demi dexistence, quil avait employé à préciser la doctrine du
Dieu personnel et multiple, du Verbe incarné révélateur de la parole divine
et rédempteur de lhumanité déchue, de lEsprit qui éclaire les âmes par la
grâce, de la foi qui les sauve, de la résurrection de la chair pour la récompense
des bons et le châtiment des méchants. Il avait rédigé ses écrits canoniques,
réglé son culte et la discipline de sa première phase dexistence. Par le
dogme de la communication de lEsprit-Saint à lÉglise, il avait préparé ses
développements ultérieurs et constitué le pouvoir doctrinal des évêques, qui
se trouvaient revêtus de la double autorité donnée par lélection populaire
et par la consécration religieuse. Le nombre des ouvrages que lÉglise
déclarait apocryphes, celui des hérésies quelle avait déjà combattues[236], prouvent sa
vitalité. Longtemps la foi ne sétait propagée que dans les couches
inférieures de la population[237], où elle
portait des consolations pour toutes les misères et cette vertu, la charité,
quavaient enseignée, dès lorigine, le Christ et saint Paul[238]. Elle
condamnait la richesse qui lui semblait « un fruit diniquité ou un
héritage dinjustices[239] ; et elle
aimait la pauvreté, la souffrance comme la condition du rachat de la vie
terrestre. Les philosophes, qui ouvraient leur ciel aux seules âmes délite,
lui reprochaient cette sollicitude pour les humbles. Tandis, disait lun deux, que les autres cultes appellent à leurs cérémonies ceux
dont la conscience est pure, les chrétiens promettent le royaume de Dieu aux
pécheurs et aux insensés, cest-à-dire à ceux qui sont les maudits des dieux[240]. Celse, en
parlant ainsi, marquait bien le point essentiel : la rédemption dans lÉglise
et non pas hors de lÉglise, par la foi commune et non plus seulement par
leffort individuel[241].
Combien, au contraire, étaient douces aux oreilles des
déshérités ces paroles dégalité devant Dieu, du rachat des âmes par le Fils
de lÉternel insulté, bafoué, battu de verges et mort sur la croix des
esclaves ! La passion du Christ était leur propre histoire et la Bonne Nouvelle
paraissait apportée surtout aux petits. Le héros des anciens jours avait été
le fort et le vaillant, Hercule ou Thésée, puis le sage ; le héros des temps
nouveaux allait être le saint, et chacun pourra le devenir, car cétait par
le sentiment, non par la science, que le christianisme entendait conquérir le
monde.
Pour lenseignement ordinaire, point, à cette époque ;
dambitieux systèmes ni de discussions subtiles sur lessence des choses ;
point de minutieux préceptes ni de loi difficile à comprendre. Le salut,
cest la foi en celui qui sest rendu
visible afin damener les hommes à lamour des choses invisibles[242], et lEsprit
qui souffle où il lui plaît la donne par la grâce. La loi,
cest le Sermon sur la montagne, avec les adorables paraboles dont il a été
dit : le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point. Pour obtenir le ciel, il ne faut que
croire et aimer. Platon était arrivé au même point que le christianisme,
lorsquil avait mis la règle de la morale dans limitation de Dieu, Όμοίωσις
τώ Θεώ. Mais son Dieu nest pas un homme,
et lidéal quil propose est inaccessible. Tertullien, au contraire, put dire :
Après Jésus, nous navons rien à apprendre ;
après lÉvangile, nous navons rien à chercher[243]. Voilà le modèle
et la règle.
La théologie chrétienne, malgré les obscurités où saint
Paul lavait engagée, était pleine de vie et de lumière. Elle se
personnifiait en un Dieu séparé absolument de la nature, où Marc-Aurèle
lenveloppait encore ; et en lHomme-Dieu, vainqueur du mal et de la mort,
montré aux hommes comme type de perfection ; plus tard sera proposée aux
femmes limitation de la Vierge Mère et de son amour infini. Métaphysique
sans ombre, où pourtant de puissants esprits trouvaient matière aux plus
hautes spéculations ; ciel sans nuage, où il semblait que tout pût se voir,
se toucher et se comprendre. Or, dans la lutte entre des croyances, la
victoire est toujours à celle qui a les formules les plus précises et les
symboles les mieux arrêtés. Le dieu suprême de la race aryane, Jupiter, avait
été le Ciel Père[244], le christianisme
le remplaçait par Notre Père qui est au ciel,
et ce changement était toute une révolution.
Le culte était pur ; point de sacrifice sanglant et rien
qui ne tendit à éveiller les meilleurs sentiments de notre nature : des
chants, des prières, la lecture de lÉvangile et le grand acte de la
communion directe avec Dieu. Si quelques-uns, qui faisaient déjà du
christianisme la religion du Dieu des vengeances divines, voulaient lui
donner des dehors tristes et lugubres, pour le plus grand nombre il était la
religion du Bon Pasteur qui veille sur son troupeau, qui le défend contre les
loups ravisseurs et qui rapporte sur ses épaules la brebis égarée. Cette
image de grâce, de bonté et damour, fréquentent répétée dans les plus anciennes
catacombes de Rome[245], était alors le
symbole préféré de la foi chrétienne. Comme en celle-ci, tout était
espérance, tout, même dans la mort respirait le calme et la sérénité. Une
colombe représentait lâme sélevant vers les cieux ; un agneau, la troupe
des fidèles ; une seule vigne couvrant les murs de la chambre sépulcrale de
ses rameaux nombreux et de ses grappes vermeilles montrait, par un symbole
gracieux encore, lunité de lÉglise, ses progrès et les fruits abondants et
doux de la foi. La croix, le signe du Seigneur[246], que le moyen
âge mettra partout, avec les plaies saignantes et la tragique figure du
crucifié, est rare dans les catacombes, mais tout y faisait songer : le
fidèle qui les mains étendues élève à Dieu sa
pensée pure[247] ; le navire
glissant sur londe avec ses voiles gonflées que portent le mit et les
vergues ; loiseau qui monte dans les airs sur la
croix de ses ailes et qui semble porter à Dieu une prière[248]. La symbolique
chrétienne est née des pastorales évangéliques et du besoin de cacher sur les
tombeaux, aux yeux des païens, la foi qui restait visible pour les croyants.
Ainsi, simple et profonde dans son dogme, pure dans sa
morale, miraculeuse dans ses traditions et apparaissant aux hommes sous la divine
figure du doux Maître de Galilée, cette doctrine avait tout à la fois le
merveilleux nécessaire aux esprits amoureux de surnaturel et lélévation
réclamée par ceux qui entendaient raisonner leur foi tout en y cédant. Aux
âmes inquiètes ou malheureuses, elle apportait ce que celles-ci ne trouvaient
pas ou ne trouvaient quimparfaitement dans les cultes orientaux et dans les
philosophies : une promesse de salut, par conséquent, une espérance. Lesprit
du temps voulait des prophéties, des exorcismes, des miracles ; lÉglise en
faisait, car le ciel en fait toujours quand la conscience des multitudes le
demande. Les disciples de Jésus, dit
saint Irénée, ont reçu de leur maître le don des
miracles ; ils exorcisent les démons, prédisent lavenir, guérissent les malades
et ressuscitent les morts[249].
Quel était leur nombre vers la fin de la période antonine
? Tertullien, avec son imagination ardente, voyait les chrétiens remplissant
les cités et les bourgs, les camps et les tribus, le forum et le sénat[250]. Mais le païen
de lOctavius les appelle encore le peuple
des ténèbres[251]. En réalité,
ils étaient une très faible minorité comparés à la masse des habitants de
lempire. Le premier devoir des chrétiens était le soin des pauvres. Or une
lettre du pape Corneille en lannée 251, où il est dit que lÉglise de Rome
avait à secourir quinze cents indigents, veuves et malades, ne permet pas de
supposer que cette communauté fût bien considérable[252]. Soixante ans
plus tard, la grande cité, gardienne de ses vieilles divinités, était pleine
encore de païens ; Constantin ne trouvera pas un chrétien dans le sénat, et,
à la fin du quatrième siècle, Symmaque en comptera bien peu dans les grandes
familles romaines ; mais à quoi bon des calculs et des hypothèses sur le
nombre des chrétiens ? Ce sont les minorités ardentes qui font les
révolutions, et lardeur ne manquait pas aux chrétiens qui, après lédit de
tolérance de Gallien, en 260, se multiplièrent rapidement.
 Les lettrés et la haute société romaine ne connaissaient
pas, au deuxième siècle, le christianisme, ou le connaissaient fort mal :
témoin Tacite, Suétone, Juvénal, Pline le Jeune, Plutarque, Lucien, Hadrien
et Marc-Aurèle lui-même. Dans les uvres dApulée, un contemporain, un
compatriote de Tertullien et un homme curieux des
choses divines, il ne se trouve pas un mot doù lon puisse
conclure quil en ait soupçonné lexistence[253]. Quelques-uns
le prenaient pour une des innombrables sectes philosophiques. Quand Novatius
sortit de lÉglise : Je passe, dit-il,
à une autre philosophie[254]. Mais chaque
jour sa force augmentait, parce que, seul, il guérissait de cette maladie
inconnue des générations sceptiques et joyeuses, que lauteur des
Pseudo-Clémentines exprimait dun mot : Jai mal
à lâme[255] ; et comme il
donnait confiance dans lavenir doutre-tombe, il animait dun ardent esprit
de prosélytisme tous ceux qui venaient à lui. Dès quune communauté de
fidèles sétait formée, elle ne tardait pas à saccroître comme la grange semplit de bon grain au temps de la
moisson[256], et il sy
trouvait bien vite quelquun qui acceptait comme un ordre donné à tous cette
parole du maître : Ite et docete gentes.
Il prenait le bâton de voyage, partageait son bien entre les pauvres, sûr
dêtre assisté partout on il rencontrerait des frères, et sen allait fonder
une chrétienté nouvelle. Rien narrêtait les missionnaires de la foi, ni la
longueur du chemin ni la colère des populations blessées par ces contempteurs des dieux dans les habitudes
et les affections de leur vie publique et privée. Si jamais hommes ont paru à
leurs contemporains dirréconciliables ennemis de lordre établi, ce furent
assurément ces chrétiens qui, à chacun de leurs pas au milieu de cette
société, se heurtaient contre une idole quils voulaient briser ou contre une
coutume quils appelaient sacrilège. Quelques-uns périssaient dans les
tumultes populaires ou, depuis Trajan, étaient, comme rebelles, envoyés par
le magistrat aux carrières et aux mines ; un petit nombre, judiciairement
condamné, avait péri dans les amphithéâtres ou sous la hache du bourreau. Les lettrés et la haute société romaine ne connaissaient
pas, au deuxième siècle, le christianisme, ou le connaissaient fort mal :
témoin Tacite, Suétone, Juvénal, Pline le Jeune, Plutarque, Lucien, Hadrien
et Marc-Aurèle lui-même. Dans les uvres dApulée, un contemporain, un
compatriote de Tertullien et un homme curieux des
choses divines, il ne se trouve pas un mot doù lon puisse
conclure quil en ait soupçonné lexistence[253]. Quelques-uns
le prenaient pour une des innombrables sectes philosophiques. Quand Novatius
sortit de lÉglise : Je passe, dit-il,
à une autre philosophie[254]. Mais chaque
jour sa force augmentait, parce que, seul, il guérissait de cette maladie
inconnue des générations sceptiques et joyeuses, que lauteur des
Pseudo-Clémentines exprimait dun mot : Jai mal
à lâme[255] ; et comme il
donnait confiance dans lavenir doutre-tombe, il animait dun ardent esprit
de prosélytisme tous ceux qui venaient à lui. Dès quune communauté de
fidèles sétait formée, elle ne tardait pas à saccroître comme la grange semplit de bon grain au temps de la
moisson[256], et il sy
trouvait bien vite quelquun qui acceptait comme un ordre donné à tous cette
parole du maître : Ite et docete gentes.
Il prenait le bâton de voyage, partageait son bien entre les pauvres, sûr
dêtre assisté partout on il rencontrerait des frères, et sen allait fonder
une chrétienté nouvelle. Rien narrêtait les missionnaires de la foi, ni la
longueur du chemin ni la colère des populations blessées par ces contempteurs des dieux dans les habitudes
et les affections de leur vie publique et privée. Si jamais hommes ont paru à
leurs contemporains dirréconciliables ennemis de lordre établi, ce furent
assurément ces chrétiens qui, à chacun de leurs pas au milieu de cette
société, se heurtaient contre une idole quils voulaient briser ou contre une
coutume quils appelaient sacrilège. Quelques-uns périssaient dans les
tumultes populaires ou, depuis Trajan, étaient, comme rebelles, envoyés par
le magistrat aux carrières et aux mines ; un petit nombre, judiciairement
condamné, avait péri dans les amphithéâtres ou sous la hache du bourreau.
Cependant lÉglise commençait à sortir de lombre qui
avait protégé ses débuts ; déjà quelques docteurs païens étaient passés dans
ses rangs, et Justin venait de la produire audacieusement au grand jour. Elle
allait grandir rapidement et, à partir du règne de Commode, pénétrer
réellement dans la haute société romaine. La puissante et simple originalité
de son dogme lui donnait une grande force dattraction, et cette organisation
épiscopale que le sacerdoce païen navait pas connue, lui permettait de
mettre lunité dans son action et dans ses conseils, comme de soutenir la
propagande de chacun par les efforts de tous.
Pour les esprits cultivés, le vieux naturalisme était
mort, et les philosophes arrivaient à une nouvelle conception du divin, qui,
par son principe et ses applications, était un grand progrès dans la genèse
religieuse de lhumanité. Cette conception se rapprochait singulièrement de
celle des chrétiens. En outre, le Nouveau Testament nest, en son entier,
quune prédication morale qui laisse fort peu de place à la prédication
dogmatique ; la philosophie, de son côté, renonçait aux ambitions
métaphysiques des anciennes écoles. Le christianisme trouvait donc, dans la
société païenne, une foule déléments quil pouvait revendiquer comme
conformes à sa nature, et qui lui servaient à entrer au cur des populations
pour lincliner doucement vers lui :
La pure morale de Sénèque, dÉpictète et de Marc-Aurèle,
avec tous leurs préceptes dexamen de conscience, de direction et de
prédication ;
Lidée de la commune origine des hommes et du sentiment
nécessaire de la fraternité ;
La charité, comme vertu essentielle ;
Le dédain des choses de la terre et des plaisirs du corps,
comme principal moyen de perfectionnement moral ;
Lamour dé la pauvreté, même celui de la mort, qui
poussait tant de stoïciens au suicide et tant de martyrs au sacrifice
volontaire ;
La théodicée de Philon, de Plutarque, des platoniciens et
de Maxime de Tyr, avec leurs esprits intermédiaires entre lhomme et Dieu ;
Lidée de lunité divine avec la croyance aux peines et
aux récompenses ;
La régénération enfin par linitiation aux mystères, par
le baptême sanglant du taurobole ou le baptême de leau, par loblation du
pain et du vin, par lonction sainte au front des mystes[257]. Votre religion, disait saint Justin aux
adorateurs des dieux, nest quun christianisme
incomplet ; et Clément : Comme les
Bacchantes ont dispersé les membres de Penthée, les sectes philosophiques ont
divisé à linfini lindivisible lumière du Verbe[258] ; et il
présentait la nouvelle doctrine comme lachèvement de luvre commencée par
la raison humaine. Tertullien, qui rompt si fièrement avec la philosophie, a
écrit la phrase célèbre : Testimonium animæ
naturaliter christianæ ; quantité de pères et de docteurs ont
partagé ce sentiment, dont saint Augustin a donné la formule la plus complète
: Si les platoniciens changeaient un petit nombre
de mots et de pensées, on les prendrait pour des chrétiens[259].
Ce christianisme philosophique semble même, par un signe
extérieur, se rapprocher des anciennes philosophies et vouloir, aux yeux de
la foule, se confondre avec elles. Des chrétiens prenaient le manteau des
philosophes ; comme eux, ils venaient sur la place publique gourmander le
peuple, lui reprocher ses vices, annoncer le Dieu unique et subsistant par
lui-même, Celui qui dans la
Bible se définit : Ego sum qui
sum, et quà Delphes on honorait dun seul mot : εϊ, tu es. Si lon sétonnait de trouver
quelques nouveautés dans leurs discours, ils répondaient : Nous nenseignons rien de nouveau ni dextraordinaire,
rien que ne recommandent les livres des écoles et la commune sagesse[260].
Lart chrétien naissant se greffait aussi sur lart antique,
qui allait mourir. Mais il faut bien le reconnaître au risque de contredire des
enthousiasmes faciles à sexalter, les peintures des catacombes ne sont que
des essais informes. Ces débuts de lart chrétien sont à lart véritable ce
que les vagissements dun nouveau-né sont à la voix virile qui remplit le
sanctuaire. On voit bien que ces fresques furent luvre de pauvres artistes
travaillant pour de très pauvres clients. Deux choses sy marquent qui
dureront : le symbolisme et le mépris de la forme.
Dans les plus anciennes catacombes, nombre de décorations
sont empruntées à des sources païennes, mais détournées de leur sens antique
pour répondre à des sentiments nouveaux. On y voit Orphée jouant de la harpe
devant les bêtes sauvages ; cest le Christ qui apaise les instincts
farouches ; Bacchus est le dieu de la vendange céleste ; Psyché, lamour
divin ; le Jourdain, le dieu des fleuves. Le Bon Pasteur qui porte sur ses
épaules lagneau fatigué, figurant lhumanité souffrante, pourrait être pris
pour lHermès Kriophoros ou pour le Pan rustique. Ulysse attaché au mât de
son navire, afin de navoir rien à craindre des dangereuses chansons des
sirènes, cétait lÉglise traversant, sans y succomber, les tentations du
monde[261].
Le grain de blé qui renaît à la vie après avoir pourri dans la terre, le
raisin foulé au pressoir doù le vin sécoule, avaient été, dans les mystères
dEleusis, des symboles de résurrection ; ils le furent encore pour le
chrétien. Le poisson, si souvent représenté, nappartient pas à la mythologie
gréco-latine[262]
; mais, autour des représentations symboliques de la foi nouvelle, les
guirlandes de feuillage, les vases de fleurs et de fruits, les oiseaux, etc.,
rappelaient lart décoratif des païens[263]. Rien, en
effet, dans léternelle transformation des choses, ne simprovise. Pour exprimer
des croyances nouvelles, les premiers artistes chrétiens prenaient des formes
anciennes, comme les premiers Pères de lÉglise ont si souvent pris le
langage de Sénèque et de Platon. Niais ce double hommage au passé sera vite
oublié. Les théologiens combattront les philosophes, et lart nouveau
achèvera de tuer lart ancien. Celui-ci avait réalisé la plus parfaite
harmonie entre le corps et lâme. A Jupiter, Phidias donnait la majesté, avec
une forme puissante et fière qui est restée le type de la beauté virile. Le christianisme,
ennemi de la chair, la réduira à nêtre quune enveloppe transparente et
fragile, et sur ces corps émaciés on ne retrouvera plus la beauté idéale en
laquelle le Créateur doit se complaire, puisquelle est luvre de ses mains.
Lart chrétien ne sera un art véritable que le jour où, avec Raphaël, il
redeviendra païen, en joignant au culte de lexpression celui de la forme.

VII. RÉSUMÉ GÉNÉRAL.
La conquête du monde par les Romains a eu pour
conséquences nécessaires quatre révolutions.
Une révolution politique : la cité, devenant un
univers, a dû remplacer le gouvernement de plusieurs par celui dun seul.
Une révolution sociale : les vaincus ont pris la
place des vainqueurs par la puissance du nombre, du travail, de
lintelligence, et les lois étroites et dures de la république sont devenues
les lois générales et humaines de lempire.
Une révolution philosophique : les diverses écoles
se sont mêlées, comme se mêlaient tous les peuples, et leurs systèmes ont
abouti à une grande synthèse. Au lieu de la métaphysique qui divise, parce
quelle provient de vues particulières de lesprit, elles nont plus étudié
que la morale qui réunit, parce quelle sort de la nature humaine, laquelle
est la même partout.
Une révolution religieuse : dabord, aux cultes locaux
Rome impose celui de Rome et des Augustes ; il nest pas une ville où ne
sélève leur autel : cest la religion nationale. Mais voici venir la
religion universelle. Pour la première fois, le monde verra un culte qui ne
tient ni à une cité, ni à un peuple, ni à un empire : une religion sans
patrie, qui, du moins, nen voudra dautre que celle du genre humain[264].
De ces quatre révolutions, la première a été lobjet de
nôtre récit depuis les Gracques jusquà Tibère ; la dernière, commencée en
même temps que les trois autres, ne saccomplira que longtemps après les
Antonins ; la seconde et la troisième sont exposées dans le tableau qui vient
dêtre tracé de la société romaine aux deux premiers siècles de notre ère.
Si ce tableau est vrai, on sera forcément amené à croire
que cette société avait, dans ses institutions civiles et dans ses murs, des
forces de conservation ; dans ses idées, des forces de renouvellement. Quon
réfléchisse à lhabileté de son gouvernement où sétaient succédé plus de
princes sachant accomplir les devoirs de leur charge que les monarchies
absolues nen présentent pour un même espace de temps[265], à la
discipline de ses légions, à la vie active et large de ses populations, à la
forte constitution de la famille et de la cité, à la sagesse de ses grandes
écoles de législation et de philosophie dont le dernier mot était lunité de
la raison, du droit, de lhumanité et du principe immatériel de lunivers :
alors on reconnaîtra que lempire des Antonins était un corps robuste dont la
vie intellectuelle avait de la grandeur.
Il est vrai que les Romains conservaient trois iniquités :
lesclavage, labominable dureté des lois pénales et loutrageante
distinction qui séparait lhumilior de
lhonestior. En outre, le désaccord
entre les doctrines des sages et la vie de la foule était grand dans cette
société avide de plaisirs, qui tenait, comme tant dautres, bien plus à ses
vices quà ses croyances. Mais lesclavage, avec sa conséquence naturelle,
latrocité des peines, était une institution du droit des gens que le christianisme
na pas supprimée, parce que le temps seul et les progrès de la pensée
humaine pouvaient en avoir raison ; la contradiction entre les murs et
lidéal enseigné est dailleurs de toutes les époques. Si lempire navait
pas renfermé dautres causes de ruine, il naurait pas succombé à ces maux.
Malheureusement, dans cette société aristocratique, il ne se trouvait pas
daristocratie capable de défendre et de contenir son chef tout-puissant, et
ce chef ne comprenait pas quau lieu de considérer lempire comme un domaine
héréditaire, il devait, à lexemple de Nerva, de Trajan, dHadrien et
dAntonin, le léguer au plus digne. Les droits du sang lemportaient sur ceux
de lÉtat. Marc-Aurèle sest choisi un successeur impropre, par son âge et
par ses vices, à lexercice du pouvoir absolu ; et ce pouvoir sans limites,
Septime Sévère le donnera au fils qui aura voulu lassassiner, de sorte que
les orgies du despotisme recommenceront. Sous la pression administrative, la
vie cessera de circuler librement dans le corps social qui saffaissera,
tandis que larmée, de jour en jour plus étrangère à la population civile,
troublera lÉtat par de continuelles révolutions et ruinera ses finances,
tout en perdant elle-même, dans luniversel désordre, sa discipline et sa
force. Enfin la crise religieuse approche.
Il semble que chrétiens et païens auraient pu sentendre,
puisque, par certains côtés, le christianisme était la formule religieuse des
philosophies païennes. Mais dune extrémité du
monde social à lautre, les vérités se rencontraient sans se reconnaître[266], et la passion
populaire rendit inutile la bonne volonté des évêques et des princes. Si la
tourbe des grandes villes criait : Les chrétiens
aux lions !..., si les beaux esprits les poursuivaient de
sarcasmes insultants et de caricatures qui devaient leur paraître une
abomination[267],
dans les rangs du nouveau peuple se trouvaient aussi des violents qui, au
lieu de chercher, comme Justin et Clément dAlexandrie, à réunir les fidèles
de Platon aux disciples du Christ, creusaient entre eux un abîme. Hermias
essayait de prendre la verve de Lucien pour livrer, dans un pamphlet pieux,
les philosophes à la dérision, en faisant ressortir les contradictions de
lancienne métaphysique[268]. Tout en vous, leur dit-il, nest que ténèbres, nuit trompeuse, perpétuelle illusion,
abîme dignorance. Philosophes, voyez comme lobjet de votre poursuite
ardente fuit devant vous dune fuite éternelle ; combien la fin que vous vous
proposez est inexplicable et vaine. Ce ne sont pas les croyances seules,
cest lesprit même de la société païenne que lÉglise se propose de changer.
La liberté philosophique de la Grèce, avait créé la science ; lidéalisme
mystique, qui va, pour des siècles, prendre possession des intelligences
supérieures, naimera que les spéculations théologiques. En tête de son
livre, Hermias avait mis le mot de saint Paul[269] : La sagesse de ce monde est folie devant Dieu,
et Tertullien le répète avec colère. Cette civilisation que les sages
auraient voulu sauver en la pénétrant doucement de lesprit nouveau, il la
maudit ; les compromis, il les repousse avec horreur ; il ne veut même pas
que le chrétien accepte dêtre magistrat ou soldat, quil célèbre la victoire
ou la fête de lempereur. Lui, du moins, se contente de cette désertion des
devoirs civiques, mais il en est qui crient : Malheur aux riches ! et
qui appellent de leurs vux la destruction de lempire. Vers lan 250, un
autre Africain, Commodianus, laisse éclater sa joie à lannonce dun
formidable assaut que les Goths et les Perses vont donner aux provinces
romaines. Quenfin, sécrie-t-il, disparaisse cet empire de liniquité ! Il croit
Rome déjà tombée et la voit pleurant dans
léternité, elle qui se vantait dêtre éternelle ![270]
Rome nest pas seule condamnée ; le monde même va périr.
Dans le peuple circulaient les oracles irrités de la Sibylle. a Malheur aux
femmes qui verront ce jour ! Une nuée sombre entourera le monde immense. Les
flambeaux célestes se heurteront les uns contre les autres, et les étoiles
tomberont dans la mer. Un fleuve de feu coulera du ciel, il consumera la terre,
et les hommes grinceront des dents, lorsquils sentiront le sol senflammer
sous leurs pieds.... Tous, pères, mères, enfants, viendront brûler dans la
fournaise divine, et lon entendra mugir le vaste Tartare. Au milieu de leurs
tortures, ils appelleront la mort, mais la mort ne viendra pas[271]. n Tertullien,
qui était né dans les derniers jours dAntonin, répète ces paroles funestes :
Ah ! que je rirai ! Quel bonheur, quel transport
pour moi de voir ces puissants dont on a fait des dieux, et leurs courtisans,
et leurs magistrats persécuteurs, et ces sages philosophes brûlant pêle-mêle
avec leur Jupiter dans un feu vengeur ! Alors lacteur tragique poussera de
vrais cris dans sa propre détresse, le comédien amolli fondra dans les
flammes, et le cocher du cirque paraîtra sur un char de feu, tout rouge
lui-même des flammes éternelles[272]. Sombres
images, cris désespérés et menaçants qui devaient jeter la terreur et la
haine dans le cur des païens.
Dautre part, le polythéisme, religion officielle de
lÉtat, ne voulait pas abdiquer aux mains de ces mendiants
du Christ ; et, comme lHercule revêtu de la tunique fatale, Rome
ne pourra larracher de son flanc quen déchirant sa chair. Aussi la défiance
et la haine diviseront les citoyens ; à une persécution cruelle succédera une
demi tolérance ; le sang va couler à flots, et le glorieux esprit qui avait
fait les civilisations grecque et latine se voilera pour des siècles. Alors
cet empire qui avait été pour tant dhommes une bénédiction, affaibli par la
guerre religieuse, au moment où tout le monde barbare sagite pour de
formidables invasions, sera ensanglanté jusquau fond de ses provinces par la
guerre étrangère, et les peuples, qui avaient si longtemps vécu tranquilles à
lombre de leur vigne et de leur figuier, verront les feux ennemis sallumer
au milieu de leurs campagnes.
Cen est fait pour toujours de la paix romaine et, pour bien des siècles, de
la science et de lart ; mais il allait être donné au monde une grande
espérance.
|