|
I. RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
PRODUITE PAR LA
CONQUÊTE DE LUNIVERS ; ÉPOQUE DU PLUS GRAND LUXE ROMAIN.
On vient de voir que, considéré dans son ensemble, cet
immense empire de Rome avait bien des causes de prospérité : le respect dans
la famille, la discipline dans la cité, le travail et une richesse relative
dans les princes ; enfin, au deuxième siècle, dans le gouvernement, des
princes sages et une administration habile qui neutralisaient momentanément
les désastreux effets du pouvoir absolu.
Mais ces belles apparences ne cachaient-elles pas un mal
funeste ou hideux ? Cette grandeur nétait-elle point minée par un luxe
insensé qui détruisait les fortunes privées et par une dépravation des murs
qui avait usé le ressort des âmes ?
Rome exerce sur les esprits une sorte de fascination qui
change les proportions des hommes et des choses. Tite-Live et Corneille ont
fait trop grands les héros des anciens temps ; nous agissons comme eux, mais
en sens inverse, nous mettons trop bas les Romains de lempire. La faute en
est à cette rhétorique des écoles qui avait pris pour texte habituel de ses
déclamations les mérites de la pauvreté[1] et les dangers de
la richesse, les vertus que lune assure et les vices que lautre donne :
lieux communs que, pour notre malheur, Rousseau a repris et que la foule
répète.
Dabord il ny a ni vice ni vertu nécessairement attachés
à la pauvreté ou à la richesse, car, si la misère et la fortune sont parfois
mauvaises conseillères, il est des hommes qui possèdent la richesse et ne
sont point possédés par elle, comme il en est dautres dont lindigente demeure
na jamais abrité une pensée mauvaise. Ensuite, les murs de lancienne Rome
étaient forcément celles de la pauvreté, et, par une transformation
inévitable, les murs nouvelles de lempire furent celles de la richesse ou
de laisance. Enfin, si lon met à part quelques exceptions tapageuses,
telles quil sen produit toujours, ce luxe nétait pas plus extravagant que
le nôtre, ni ces fortunes plus grandes que celles qui, chez nous, valurent à
leurs heureux propriétaires titres et cordons. Il sagit, dans la présente
étude, non pas dune thèse de philosophie, mais dune question déconomie
sociale. On cherche la vérité et les conséquences politiques des faits
ramenés de leurs proportions légendaires à leur réelle importance. Quand 1on
aura constaté que ce luxe des Romains était confiné dans quelques villes, ces
richesses dans quelques familles, même dans une certaine époque, on sera
conduit à penser que ce ne furent pas des folies, auxquelles cent millions dhommes
restaient étrangers qui ruinèrent lempire.
Quand les compagnons de Romulus rapportaient en triomphe
dans lenceinte du Palatin les gerbes fauchées sur le sol ennemi, ils navaient
ni colonnes de porphyre pour soutenir leurs demeures, ni brillantes étoffes
pour embellir leurs rudes épouses, ni aliments variés pour apaiser leur faim.
Ils habitaient des huttes de branchages ou de boue, vivaient de leur champ et
de leur troupeau, achetaient des outils avec quelques as tirés des produits
de la vigne ou du pré, et la femme tissait la tunique et la toge.
Valaient-ils mieux que leurs descendants ? Pour les vertus civiques et
militaires, assurément, car ils étaient soldats et citoyens, et les Romains
de lEmpire nétaient plus ni lun ni lautre ; mais, pour les vertus
privées, qui peut affirmer que, dans les conditions modestes, la moralité nétait
pas la même ?
Les censeurs crurent les anciennes murs nécessaires à la République,
et elles lauraient été si Rome fût restée une ville de laboureurs, au lieu
de devenir la capitale du monde. Ils proscrivirent le luxe naissant des
habits et de la table, les parures des femmes, les ornements dor, certains
mets, jusquà lengraissement poulets et des oiseaux comestibles, qui leur
parut un danger public[2]. Sous Tibère
encore, les édiles voulurent faire revivre les édits fixant le prix quil
était permis de mettre à chaque mets et le nombre des mets pour chaque repas.
A cette nouvelle, grand émoi dans la ville. On craignait, dit Tacite, que le prince ne
fût tenté, par son austère économie, de ramener durement à lantique
frugalité[3]. Avec sa sagesse
habituelle, Tibère se moqua gravement du zèle spartiate des édiles ; il leur
montra que Rome avait besoin des provinces pour vivre ; que détruire les
relations établies serait bouleverser lÉtat ; quenfin il était dangereux de
faire des lois que, si vite, on oublie ou méprise.
Le commerce des Romains sétait étendu, en effet, avec
leurs conquêtes. Ils avaient su bientôt où se trouvaient les marbres les plus
précieux, les bois les plus beaux, les tissus les plus souples, les aliments
les plus délicats ; et, la victoire leur ayant livré les trésors accumulés
durant des siècles par les rois et les peuples, ils sétaient trouvés tout à
coup riches, comme le furent les Espagnols après la conquête du Pérou. Alors
il arriva ce quon a vu dans les circonstances analogues, quon voulut être
mieux logé, mieux vêtu, mieux nourri. Lhéritier de Cincinnatus remplaça lépaisse
tunique en laine grossière par une fine étoffe de Milet teinte dans la
pourpre de Tyr, et la fille des robustes ménagères qui pilaient le blé et
pétrissaient le pain de la famille couvrit sa tête, son cou et ses bras de
perles précieuses[4].
On changea les petites maisons bâties de pisé ou de travertin en monuments de
marbre où brilla tout le luxe dÉphèse et dAntioche. On fit servir, sur des
tables en cèdre de Maurétanie, le turbot de Ravenne et les huîtres de
Tarente, les escargots dIllyrie ou dAfrique et la murène de Sicile, le vin des
Cyclades et les chevreaux dAmbracie, les faisans de la Colchide et le paon de la Perse, le flamant dÉgypte
et la pintade de Numidie, mille autres choses enfin payées très cher et cherchées
bien loin, pas aussi loin, cependant, que nous allons pour nous donner le thé
de la Chine
et le café de lArabie, le sucre de lAmérique et livoire de lAfrique
centrale, la soie du Japon et les diamants du Brésil. Pline se fâche de ce quon
voulait boire frais, en achetant aux paysans des Abruzzes la neige de leurs
montagnes pour en mettre dans son vin[5]. Nous navons pas
le droit de partager cette trop vertueuse indignation, nous qui, sans nous
croire bien coupables, tirons notre glace de la Norvège ou du
Canada, et qui en portons jusque dans lInde.
Nous avons montré, dans un précédent chapitre, avec quelle
rapidité les côtes de la
Méditerranée sétaient couvertes de cités florissantes,
parce que les peuples assis au bord du grand lac romain échangeaient, dune
rive à lautre, leurs produits et trouvaient partout des marchés avantageux.
Tandis que les vaisseaux sillonnaient sans inquiétude une mer pacifiée, les
denrées arrivaient des contrées les plus lointaines aux lieux de consommation
par des routes tracées à travers les continents ; et de ces relations faciles
résultait une aisance générale. Que des écrivains, tout en jouissant
largement du présent, aient paru regretter la simplicité antique, il ne faut
point sen étonner. La thèse de laustérité était belle à soutenir, surtout lorsquelle
nobligeait personne et quelle permettait aux philosophes décrire, sur des
tables dor, léloge de la pauvreté. Pour se convaincre que ces belles
sentences étaient bien un canevas à broder de la prose ou des vers, il suffit
de voir Apulée morigéner son siècle avec la grosse voix de Caton, et Martial,
lui-même, soublier jusquà célébrer les plaisirs et les vertus champêtres du
bon vieux temps[6].
Laissons donc, sans les en blâmer, lépicurien Salluste,
et Varron, et Sénèque, et Pline lAncien, se scandaliser que lon courût la
terre et les mers pour donner à quelques voluptueux des plaisirs dun moment[7]. Avec la sécurité
qui régnait partout, lindustrie et le commerce mettaient nécessairement en
circulation une foule de produits dont on pouvait jouir sans se déshonorer.
Beaucoup en usaient bien ; quelques-uns en usaient mal, cest-à-dire avec
excès, et gaspillaient lor à de vaines somptuosités, comme ce fou qui, sous
Néron, dépensa, dit-on, pour les roses dun festin, 4 millions de sesterces,
qui allèrent naturellement aux paysans de Campanie dont lindustrie avait su
faire pousser ces roses[8]. Est-ce que lAngleterre
ne serait plus lAngleterre, parce que le descendant de ceux dont lexistence
était si parcimonieuse et si dure, au temps de la reine Élisabeth, traverse lOcéan
sur un navire de plaisance plus commode et plus beau que nen eut jamais
Cléopâtre, enlève à prix dor nos statues, nos tableaux, et, sans sémouvoir,
perd en un jour, au Derby, 4 ou 500.000 francs à parier pour ou contre un
cheval[9] ? Ce pari
est un mauvais emploi dune fortune qui passe dune main dans une autre sans
rendre, durant le trajet, aucun service à la communauté ; mais cet homme, qui
a probablement autant de vices et de vertus que son aïeul, na pas les mêmes
habitudes, parce quil vit dans un autre milieu. La richesse, remplaçant pour
lui la pauvreté, a changé les conditions de son existence ; elle na pas
nécessairement dégradé sa nature, et, comme son pays a gagné en libertés
politiques ce quil a perdu en rudesse de murs, lAngleterre a grandi au
lieu de diminuer. Lempire romain aurait eu la même fortune sil avait eu des
compensations analogues.
Lantiquité a vu deux fois le phénomène économique qui sest
produit deux fois aussi en Europe, au seizième et au dix-neuvième siècle,
lorsque des masses énormes de métaux précieux furent subitement jetées dans
la circulation. Alexandre mobilisa les trésors accumulés en lingots par les
monarques de la Chaldée,
de lAssyrie et de la Perse
: plus de 2 milliards de numéraire. LAsie occidentale en fut inondée, et son
commerce, son industrie, en reçurent une puissante impulsion. Une bonne
partie de ces richesses revint aux Romains par la conquête de la Macédoine, de
Pergame, de la Syrie
et de lÉgypte. Il sy ajouta tout ce que les proconsuls trouvèrent à prendre
en Sicile, à Carthage, en Espagne, en Gaule[10], et ce que César
jeta à ses légionnaires, quand il eut forcé les portes du sanctius ærarium. Cétait le produit dû travail
de dix siècles que le pillage du monde civilisé et barbare accumulait dans la
capitale de lunivers, aux mains des familles qui se partageaient les
commandements.
Le temps du plus grand luxe à Rome va de Lucullus à Néron,
ou depuis la conquête de lAsie occidentale jusquà la guerre civile qui
suivit lextinction de la maison des Césars. Alors se montrent toutes les
extravagances de cette noblesse qui, dans livresse de sa fortune, ne sut
gouverner ni les provinces, ni sa richesse, ni elle-même. Lucullus et César,
sous la république, Caligula et Néron, sous lempire, représentent cette
situation nouvelle du patriciat, les premiers avec les goûts relevés de
grands seigneurs artistes et lettrés, les deux autres avec la fougue insensée
de tyrans qui voulaient que rien ne partît au-dessus de leurs caprices[11].
Les plus grosses fortunes que nous connaissions pour ce
temps et pour toute lépoque romaine appartenaient à laugure Lentulus, sous
Tibère, et à laffranchi Pallas, sous Claude, 300 millions de sesterces ;
celle de Narcisse, sous Néron, allait à 400 millions. Cétait pour les deux
premiers un peu moins de 80 et pour le troisième environ 104 millions de
francs. Le bien du fameux Apicius arrivait seulement au quart de ce que
possédait Narcisse, celui de Crassus à la moitié[12]. Combien lAngleterre,
lUnion américaine, même la
Russie, nont-elles point de particuliers plus riches ? Un
de nos banquiers létait dix fois davantage[13]. Mais le pouvoir
de largent étant alors plus grand quaujourdhui, tandis que la masse de la
population se trouvait plus pauvre, lécart entre la condition de tous et
celle de quelques-uns semblait bien plus considérable. De là, létonnement et
le scandale. Du reste lécart diminua rapidement. Née du pillage, cette
fortune de hasard ne pouvait se renouveler aux dépens des sujets, sous un
gouvernement qui faisait respecter leurs biens, ni aux dépens des étrangers,
parce que Rome ayant soumis, durant la république, toutes les nations riches,
neut plus à combattre sous lempire que des nations pauvres. Au lieu de
prendre à ceux-ci leur or, ce fut Rome qui leur donna le sien par le commerce[14] et par les
pensions faites à leurs chefs.
Les sources où se puisait lor étant fermées et celles par
où il sécoulait souvrant largement, la richesse séchappa peu à peu des
mains dans lesquelles la victoire lavait mise. Les uns furent ruinés par le
luxe et la débauche, les autres par les confiscations. Une partie du sénat
avait déjà été pensionnée par Auguste, et on a vu Tibère obligé, malgré sa
parcimonie, de venir au secours de plusieurs nobles personnages. Le
petit-fils dHortensius, qui avait obtenu 1 million de sesterces du premier
empereur, mendiait encore sous le second, qui en donna 200.000 à chacun de
ses quatre enfants. On tendait la main sans pudeur. Verrucosus supplie le
prince de payer ses dettes ; dautres livrent au sénat la liste de leurs
créanciers pour intéresser lassemblée à leur misère. Ceux-ci refusent des
magistratures parce quils ne peuvent faire face aux dépenses quelles
exigent ; ceux-là se réjouissent que Claude les chasse du sénat à cause de
leur pauvreté. Auguste et Tibère avaient déjà fait de pareilles exécutions.
Il est à peine un empereur qui nait eu à reconstituer à plusieurs sénateurs
les 1.200.000 sesterces nécessaires pour siéger à la curie. Quand Vespasien
arriva au pouvoir, les deux premiers ordres étaient comme anéantis ; il fut
contraint de reformer une nouvelle noblesse avec des familles provinciales.
Encore toutes ces familles ne trouvèrent-elles pas le moyen de faire grande
figure à Rome, sil en faut croire Juvénal nous montrant des préteurs, des
tribuns, des descendants dillustres maisons qui mendient la sportule à la
porte de quelque riche affranchi, et qui supputent, au bout de lannée, de
combien leur maigre revenu sest augmenté par ce salaire quotidien[15].
Les empereurs eux-mêmes, et je parle des meilleurs, ne
furent pas toujours à labri de la gêne. Ils étaient riches, quand le trésor
était administré avec une sévère économie ou quand les confiscations le
remplissaient. Mais ceux qui confisquaient étaient aussi ceux qui
gaspillaient. On a vu Caligula et Néron aux abois : ils le méritaient. Mais
Galba fut économe par nécessité autant que par caractère ; à lavènement de
Vespasien, le gouvernement ne pouvait plus marcher. Nerva traversa une crise
pareille, et Marc-Aurèle fut obligé de vendre les joyaux, le mobilier du
palais et jusquà la garde-robe des impératrices.
Il se passa donc un phénomène qui na pas été assez
remarqué : de Lucullus à Néron, lor de la conquête reste dans un petit
nombre de mains, ce qui permet alors toutes les folies ; puis il se divise,
se disperse, et, comme par une pente naturelle, va, suivant les besoins du
luxe, à ceux qui produisent ou transportent ce que le luxe exige.
Quand la cuisine est grasse,
dit Franklin, le testament est maigre.
Où allèrent les millions dApicius et les fortunes consulaires de la première
époque ? A ceux qui avaient aidé à les manger en fournissant les objets de la
dépense. Octavius achète un surmulet 5000 sesterces : il fait une sottise
dont Tibère se moque, tuais le pêcheur fait une excellente affaire qui met
pour une année laisance dans sa cabane. Que le pauvre diable bénéficie dun
certain nombre de pareilles folies, et il finira par trouver la fortune dans
ses filets, celle du moins qui constituait alors, comme à présent, laisance
du petit bourgeois, 20.000 sesterces de revenu, ou 4 à 5000 livres de rente[16].
Non seulement la richesse se déplace en se répartissant
dans la masse de la population, proportionnellement au travail ou à ladresse
de chacun, mais elle diminue de quantité. La conversion de beaucoup dor et dargent
en objets dart, de parure et dornement, restreignit dautant le chiffre du
numéraire circulant. Pour la seule dorure du Capitole, Domitien dépensa 12.000
talents. Le commerce avec lOrient en faisait disparaître une autre partie ;
chaque année, 50 millions de sesterces prenaient la route de lInde et
probablement autant celle de lArabie, doù ils ne revenaient pas[17] ; enfin lOcéan
gardait ce que les naufrages lui avaient donné, et les Barbares ne rendaient
rien des pensions ou des présents faits à leurs chefs[18].
Les mines pouvaient-elles réparer toutes ces pertes ?
Celles dEspagne, qui étaient les plus riches[19], livraient
annuellement 20.000
livres pesant dor, soit 2.256.0000 francs. Celles dargent,
plus nombreuses, mais bien autrement difficiles à exploiter, ne devaient pas
donner beaucoup plus, puisque tout le minerai dargent produit actuellement
par lEurope entière, à laide des procédés les plus perfectionnés, ne va pas
à 14 taillions de francs. On allait cesser de travailler aux mines de
Laurion, et lon commençait seulement à tirer quelque chose de celles de la Transylvanie. LEspagne
restait donc le grand atelier de production pour largent[20]. Mais les
Carthaginois et la république romaine avaient dû épuiser bien des veines,
car, du temps de Polybe, quarante mille hommes travaillaient aux seules mines
de Carthagène, qui ne donnaient cependant que 25 000 deniers par jour, ou 2
sesterces ½ par ouvrier. Les exploitations métalliques ne rendaient donc pas
aux Romains beaucoup plus que léquivalent de ce quils perdaient chaque
année. Aussi le numéraire nétait pas abondant, comme le prouvent les
chiffres de lintérêt ordinaire, 6 pour 100 en Italie, qui avait plus de
capitaux, 12 pour 100 et davantage dans les provinces. Dès le règne du second
empereur, une crise monétaire éclata. Il nen conjura les désastreux effets
quen constituant de ses deniers un fonds de 100 millions de sesterces qui
servit à prêter, pour trois ans, sans intérêt, à la condition quon donnât
une hypothèque du double sur des terres. Cette clause prouve que la crise
atteignait surtout la classe riche ; elle avait, en effet, été déterminée par
la remise en vigueur dune loi de César, qui défendait davoir en espèces
plus de 60.000 sesterces. Une pareille loi, qui ne fut jamais abolie,
puisque, un siècle plus tard, Trajan et Marc Aurèle lappliquèrent aux
sénateurs, obligeait ceux qui ne voulaient pas rester à la discrétion dun
délateur à immobiliser, en maisons et en terres, la, meilleure partie de leur
fortune. Il en résulta que le capital foncier prit de jour en jour plus dimportance,
à la différence de ce qui se passe dans nos sociétés modernes, où la richesse
mobilière et industrielle tend à primer la richesse territoriale. Or celle-ci
ne tarde pas, dans les sociétés où elle domine, à faire des propriétaires du
sol un corps aristocratique, et cest à quoi lempire aboutira.
En somme, avec son capital restreint, son outillage
industriel insuffisant[21] et des procédés
de travail qui entraînaient une énorme dépense de temps, dhommes et dargent,
le monde romain était pauvre, comparé à nos sociétés modernes, et cette
pauvreté relative donnait des proportions effrayantes à des excès isolés. En
outre, comme il était entouré dune barbarie qui ne lui fournissait à peu
prés rien, il était obligé de vivre sur lui-même. La richesse, incessamment
détruite par lusage, ny était pas incessamment renouvelée et accrue par la
production. Pour les grandes familles romaines, la paix établie par Auguste
avait été moins profitable que la guerre. En deux ou trois générations, elles
perdirent sous lempire ce quelles avaient gagné sous la république, et,
comme deux forces qui sétaient usées lune contre lautre, lancien
patriciat disparut en même temps que la famille des Césars.
Sans apercevoir que lor triomphal était retourné aux
vaincus, dont il vivifiait le commerce et lagriculture, Tacite a, du moins, très
bien vu le rapide appauvrissement de la noblesse romaine et le changement
dans les habitudes qui en résulta. Il en donne même la date : celle de lavènement
de Vespasien, cest-à-dire du prince qui était né dans une condition modeste.
La noblesse, dit-il, épuisée de sang et de richesse, revint à des goûts plus
modérés. Dailleurs tous ces hommes nouveaux, qui arrivèrent des villes
municipales et des colonies, pour remplir le sénat, y apportèrent léconomie
de leur vie privée, et, quoique la plupart dentre eux, par bonheur ou
adresse, aient trouvé dans leur vieillesse lopulence, ils conservèrent leurs
premières habitudes. Mais le principal auteur de la révolution fut Vespasien,
qui, à sa table et dans ses vêtements, rappela la simplicité antique. Tout le
monde limita, et le désir de plaire en ressemblant au prince fit plus que
les lois, la crainte et les châtiments[22].
Les successeurs de Vespasien suivirent son exemple :
Nerva, Trajan même, malgré certains goûts de soldat quil garda sous la
pourpre, Hadrien, les deux Antonins, gérèrent avec sévérité les finances de lÉtat
et neurent que le luxe des constructions monumentales, qui sont la gloire dun
règne quand cest lart qui les élève ou lutilité publique qui les réclame.
Tous les provinciaux établis dans les charges et qui formaient maintenant la
haute société romaine réglèrent sans peine leurs murs sur celles de la
nouvelle cour.
Il faut donc distinguer, avec Tacite, deux époques,
lorsque lon parle des murs de lempire dans les premiers siècles : celle
qui sarrête à la mort de Vitellius et celle qui va de Vespasien à Commode.
La première est le temps des grandes folies. Alors on voit
des gens désireux, comme il sen trouve toujours, détonner le monde par un
luxe éclatant et de se faire un nom[23], à défaut de talent
ou de courage, par une maîtresse à la mode, des chevaux de sang, une table
digne de la salle dApollon, où Lucullus dépensait 200.000 sesterces à chacun
des dîners quil donnait. Sous les bons princes le désuvrement, sous les
mauvais la crainte, précipitaient dans ces excès les fils des grandes races.
On échappait à lennui ou à la peur par les vains bruits dune existence qui
semblait remplie parce quelle était agitée. Le règne de Néron marque le
point le plus bas où soit descendue la moralité païenne et le point le plus
élevé quait atteint le luxe des grands.
Mais, de même que pour la politique, les historiens ont
mis tout lempire dans Rome, en ne montrant jamais que ce qui se passait au
palais ou à la curie ; ils ont mis, pour les murs, Rome par tout lempire,
et pas même Rome entière, mais les habitudes de ses débauchés et de ses fous.
On voyait certainement, ailleurs que le long de la voie Sacrée ou sous le
portique de Quirinus, des gens qui tourmentaient leur fortune, des hommes
chaque jour en quête de plaisirs nouveaux, des femmes aussi préoccupées que
nos élégantes des minutieux détails dune toilette coûteuse ; mais cétait le
petit nombre, puisquils faisaient scandale, et ils vivaient dans les
capitales, dans les villes deaux et autour de ce golfe de Naples qui a vu
autant de folies que certains points de notre côte normande.
Pour la masse de la population, elle avait recueilli les
miettes tombées de ces tables trop bien servies, et elle avait gagné, à
satisfaire ce luxe, un peu daisance, pas assez cependant pour ne pas garder
des goûts modestes, à la mesure de sa fortune.
Un petit nombre de faits et de chiffres concernant la
table, le vêtement et lhabitation[24] serviront de
preuves à ces observations générales.

II. LA TABLE, LE VÊTEMENT, LHABITATION.
Le luxe de la table,
dit Tacite, se soutint avec fureur pendant cent
ans, depuis la bataille dActium jusquà la guerre qui mit Galba en
possession de lempire. Il avait commencé plus tôt, car les
célébrités en ce genre, Lucullus, Hortensius, Philippus, et les singularités
culinaires sont de beaucoup antérieures à Auguste. Dans la loi somptuaire de
Sylla, Macrobe trouvait mille mets énumérés comme étant alors fort
ordinaires, et que de son temps on ne connaissait plus. Quelle liste, bons dieux ! En voyant tant despèces de
poissons et de ragoûts aujourdhui inconnus, je ne puis mempêcher de croire
que le débordement des murs était extrême en ce siècle-là. La
gourmandise romaine avait diminué comme le luxe. Varron, avant Actium, Pline,
au temps de Néron, montrent que les derniers républicains et les premiers
sénateurs de lempire pouvaient rivaliser entre eux de sensualité
gastronomique. Alors on trouve des aliments nouveaux ou de nouvelles manières
de préparer les anciens. On pratique ce que nous croyons avoir inventé : la
pisciculture[25],
lacclimatation, la transplantation de vieux arbres, même de vieilles vignes[26]. On a des serres
pour les fleurs, les fruits, le raisin, et le
stérile hiver est forcé de donner les produits de lautomne[27]. On naturalise,
sur le littoral du Latium et de la Campanie, des poissons de la côte dAsie et une
foule de coquillages comestibles. On creuse des viviers pour conserver les
meilleures espèces et ne pas sexposer au risque de manquer de poisson un
jour de grosse mer. Ces constructions prennent de telles dimensions, que les
héritiers de Lucullus tirent 40 millions de sesterces de ce quils trouvent
dans ses viviers, chiffre qui semblerait impossible si un contemporain, Varron,
ne disait quHirrius, avec les siens, se faisait un revenu annuel de 12
millions de sesterces, et quil donna en une seule fois à César six mille
murènes.
La gourmandise romaine, savante et délicate, repousse les
aliments vulgaires, le mouton, le buf[28] ; elle veut des
mets plus légers, et, malgré les édits des censeurs, lindustrie des volières
et des parcs devient aussi lucrative que celle des viviers : on y élève toute
sorte doiseaux, danimaux et de mollusques, que nous ne mangeons plus, tels
que le loir, le paon, la grue, le flamant. Une matrone dune famille
consulaire vendait annuellement cinq mille grives engraissées à 3 deniers la
pièce, et, avant même le premier triumvirat, lélevage des paons rapportait à
Aufidius Lurco 60.000 sesterces par an[29]. On savait
engraisser les oies de manière à leur donner un foie énorme ; un consul et un
chevalier se disputaient lhonneur de cette invention[30].
Le patriciat trouvait à faire ces choses un plaisir et un
profit. Comme notre noblesse, après avoir perdu le pouvoir, se donna aux
améliorations agricoles, beaucoup de gouverneurs rapportaient des plantes et
des fruits de leurs provinces asiatiques ou africaines, et ils les faisaient
cultiver sur leurs domaines par des esclaves ou des affranchis amenés de ces
régions. Depuis Lucullus qui, quarante ans avant Actium, avait mis dans sa
part de butin sur Mithridate le cerisier du Pont, jusquau voyageur inconnu
qui, du temps de Pline, introduisit près de Naples le melon, originaire des
bords de lOxus, on ne cesse pas dimporter en Italie des plantes nouvelles,
que lon cherchait ensuite à améliorer. Le père de lempereur Vitellius, par
exemple, qui gouverna la Syrie
sous Tibère, essaya de naturaliser dans sa villa d Albe la plupart des
fruits de cette province. LItalie devint donc le jardin dacclimatation de lancien
monde[31]. De là, les
fleurs les plus belles, les fruits les plus savoureux, se propagèrent dans lOccident,
et ceux qui maudissent le plus éloquemment le luxe de Rome jouissent aujourdhui
sans remords du résultat de ses méfaits.
Lorsquon parle du luxe de la table à Rome, il nest pas
permis doublier deux hommes qui en marquent le point culminant : Apicius,
avec un certain art ; Vitellius, avec brutalité. Il y eut plusieurs Apicius ;
le plus célèbre vivait sous Auguste et Tibère. Il inventa des mets, rédigea
peut-être un traité de la cuisine, et fut réputé le plus grand gourmand de la
terre. Aussi eut-il pour gloire dernière dêtre pris comme modèle, par ce fou
dÉlagabal[32].
Il possédait 100 millions de sesterces et se tua quand il ne lui en resta
plus que 10 millions, pensant, comme notre cardinal de Rohan, quun galant
homme ne pouvait pas vivre à moins de 500.000 livres de
rentes. Bien des modernes ont eu des fantaisies aussi capricieuses sans
atteindre à sa renommée cest quaujourdhui quantité de gens donnent des
festins aussi somptueux, qui nétonnent personne, tandis que ceux dApicius
émerveillaient les uns et scandalisaient les autres.
Quant à Vitellius, il avait été le digne empereur de ceux
des Romains qui faisaient un dieu de leur ventre et qui trouvaient le moyen
de manger toujours, en pratiquant un usage immonde pour recommencer à dîner[33]. Toutefois il
semble avoir eu moins de frais dimagination à faire quon ne le suppose,
lorsquil inventa son fameux bouclier de Minerve, qui portait toutes les
raretés comestibles, si lon en juge daprès la table de Trimalcion, ou par
le festin quun siècle et demi plus tût sétaient donné les pontifes et les
vestales de la république. Le menu de ce dîner avait été religieusement
conservé par le grand pontife Metellus[34], car les festins
sacerdotaux étaient célèbres à Rome, comme ils lont été partout, pour la
chère exquise quon y faisait[35].
Voici, dit Macrobe,
en quoi consista le festin le jour où Lentulus
fut inauguré flamine de Mars :
Premier service : Hérissons de
mer, huîtres crues, pelourdes et spondyles (coquillages), grives, asperges, poule grasse sur un pâté dhuîtres et
de pelourdes, glands de mer noirs et blancs (coquillages), spondyles, glycomarides (coquillages), orties de mer, becfigues, rognons de chevreuil et de
sanglier, volailles grasses enfarinées, becfigues, murex et pourpres (coquillages).
Second service : Tétines de
truie, hures de sanglier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de truie,
canards, sarcelles bouillies, lièvres, volailles rôties, farines (sans doute des bouillies
ou des crèmes), pains du Picenum[36].
La liste est longue, et le Vatel de Lentulus faisait bien
les choses ; mais, en vérité, Carême, à qui le czar Alexandre donnait un
traitement de maréchal de France, 30.000 francs par an, pour diriger sa
cuisine, et Chevet, lordonnateur de tant de festins officiels, étaient de
plus grands artistes. Nous nen mettons pas moins la gourmandise romaine bien
au-dessus de la nôtre, en quoi nous faisons certainement tort à celle-ci.
On ne peut parler de la table à Rome sans montrer un
personnage qui est resté tout romain, car on ne le trouve dans aucune autre
société jouant un rôle si bien rempli : le parasite.
Dans les pays qui bordent, sous le plus heureux climat,
les rives de la
Méditerranée, le travail est une fatigue et un ennui :
aussi on travaille le moins possible, et cependant on jouit le plus quon
peut. Le plaisir coûte cher : comment gagner de quoi lacheter ? Par lindustrie
et le négoce ? Sans doute ; mais cela est bon pour le commun des hommes ; aux
habiles, il parait bien plus agréable de chercher la fortune avec son, esprit
quavec ses bras, sui : tout si lon ne répugne point à saventurer dans les
voies mauvaises où la délation, la servilité, lusure, la captation des testaments,
promettent de bonnes récoltes. Lunique industrie dun certain nombre est de
vivre aux dépens des autres. On exploite la vanité, les ridicules, et, quand
on ne peut pas, comme le délateur ou lusurier, prendre la fortune, on aide,
comme le parasite, à la manger.
Le parasite est dabord client : cest le stage nécessaire
pour monter plus haut. Allons, Chérestrate, voilà
le jour, lève-toi bien vite. Avant laurore il est sur pied. Il
sort précipitamment, avec une toge usée sur les épaules, et achève de shabiller
en courant. Où va-t-il ainsi ? Au travail ? Oh ! Que non ! Un vrai citoyen na
pas doccupations serviles. Il court au lever de Trimalcion. Cest un client
assidu. Il veut que son zèle soit remarqué, car il na que cela pour vivre.
Du matin jusquau soir, il est à la suite de son patron. Quoi ! Chérestrate
escorte un affranchi ! Ne vous indignez pas ; près de lui et au même titre
sont des fils de patriciens. A midi,
sa journée lui est payée. Il remporte son panier dosier plein des restes de
la table du maître. Ennius la dit, Juvénal le répète : Oportet habere, il faut avoir. Par quels moyens
? peu importe. Largent est toujours bon, don quil vienne. Le mot est dun
empereur.
Si Chérestrate a lhumeur bouffonne ou la tête dure, il
sortira de la foule. Au lieu de rester à la porte, réduit à humer lodeur des
mets, comme Jupiter vit de la fumée des sacrifices, il entrera au festin, il
deviendra le convive inséparable du martre : le voilà parasite. Cest un bon
métier, quoiquil ait ses ennuis ; mais lequel nen a pas ? Certains riches
veulent avoir sous la main un souffre-douleur. Leurs esclaves sont bien là ;
mais le beau plaisir de jeter un plat à la tête dun esclave ! Cela se fait
tous les jours : on nen rit plus. Un homme libre, un citoyen de vieille
souche quun affranchi dhier bafoue et soufflette, à la bonne heure ! Dans
les diverses catégories de parasites, celui-là sappelle le plagipatide ou le
duricapiton[37].
Être battu est sa spécialité : aussi, comme il tonnait les devoirs de sa profession,
il supporte tout sans se plaindre. Ses épaules ou sa tête payent pour son
estomac, et pourtant a-t-il bien souvent maigre pitance. Quelle chère faites-vous ? dit Juvénal aux
parasites. Un esclave insolent vous jette un
morceau de pain moisi et vous donne du vin qui ne serait pas bon à dégraisser
la laine. On apporte à lamphitryon un poisson qui remplit à lui seul un
bassin immense ; à vous, on glisse sur une assiette cassée un coquillage
farci avec la moitié dun uf, offrande usitée pour les morts. En échange,
les injures vous arrivent drues et serrées ; bientôt les coupes volent et les
serviettes se rougissent de sang ; ou bien cest un vase plein de cendres quon
casse sur votre front, à la grande hilarité des convives[38].
Ainsi traitée, fort battue et peu nourrie, la race des
duricapitons alla séteignant. Les adulateurs la remplacèrent : Moi, dit lun deux, je mattache à ces gens qui, en dépit dune triste nature, veulent être
les premiers en tout. Je souris quand ils plaisantent. Ils disent oui, je dis
oui ; ils disent non, je dis non. Il faut que je joue de malheur pour que
quelquun ne me dise pas : Allons, viens souper[39].
Lespèce la plus relevée était celle des diseurs de bons
mots. Mais le rude métier que damuser un homme ennuyé et davoir toujours de
lesprit ! Le derisor, cest son nom,
se tient à laffût de toutes les nouvelles. Il sait de quoi lon délibère
dans le conseil du roi Pacorus, le nombre de vaisseaux qui ont quitté lAfrique,
ce qui est arrivé, ce qui narrivera jamais, même ce que Junon a dit à loreille
de Jupiter.
Il y a par malheur une morte saison pour les parasites, lété,
quand les riches fuient à la campagne. Comme les
limaçons, dit lun deux, rentrent
pendant la sécheresse dans leurs coquilles et y vivent de leur propre suc,
ainsi les parasites vivaient de leur propre substance, lorsque ceux quils mangent
sont aux champs[40]. Heureux le parasite
qui aura pu amasser quelque chose pour ce temps néfaste ! mais il sera
méprisé de ses collègues : Cest un parasite de
rien, celui qui a de largent dans sa demeure[41]. Le point dhonneur
de leur profession est quil faut tout manger. Ainsi les vices font deux
victimes : celui qui les a et celui qui en vit. Le premier y perd la santé ou
sa bourse ; le second, son honneur. Par la débauche prospèrent mille
industries repoussantes ; au milieu de lorgie se forme une classe dégradée,
rampante et vile, qui sattache aux prodigues et les met sur la paille en
buvant tout, même la honte, jusquà la lie.
Cependant il ny avait pas dans lempire que des Apicius
ou des Trimalcions, et pour deux raisons : la première, cest que la
médiocrité générale des fortunes ne permettait les excès quà un petit nombre
; la seconde, cest que les gourmands avaient contre eux une grande force, le
climat. Il nétait pas nécessaire que dans les écoles les disciples dÉpicure
et de Zénon recommandassent à lenvi la sobriété : un maître plus impérieux,
la nature, en faisait une loi. Labus des boissons alcoolisées, déjà
dangereux au mord, devient, au Midi,
un vice qui tue. Là, une alimentation trop forte produit rapidement des maladies
mortelles : une erreur de régime a fait plus de victimes dans notre armée dAlgérie
que les balles des Kabyles. Un Arabe de Syrie ou dAfrique vit de quelques
dattes et fait de longues traites avec un peu de farine délayée, au creux de
sa main, dans leau dun ruisseau. Les Grecs ne connaissent pas plus livresse
aujourdhui quautrefois, et linterdiction du vin pour les croyants de lislam
est une mesure dhygiène que Galien conseillait déjà aux Romains. Ceux qui veulent se bien porter, disait-il, doivent mouiller leur vin[42]. En Italie, zone
intermédiaire entre les régions humides et les pays chauds, on faisait du vin
et on en buvait. Aux Saturnales, qui étaient la fête de la canaille, on
comptait bon nombre divrognes ; quelques personnages avaient même ambitionné
la réputation de grands buveurs : ainsi Marc Antoine, le triumvir, le fils de
Cicéron et Novellius Torquatus, qui avait gagné le surnom de Triconge en
vidant dix litres dun trait[43].
En général, la sobriété dominait. Pline lAncien mangeait très
peu[44]. Sénèque passa
une année entière sans une bouchée de viande ; il
finit par renoncer au vin, aux parfums, et nusa du reste quavec une
modération qui ressemblait beaucoup à de labstinence[45].
Il aimait à répéter après Épicure : Avec du pain et de leau, personne nest pauvre et tout le
monde peut prétendre au souverain bonheur dont jouit Jupiter[46]. On a vu le menu
de Lentulus, en voici un de Pline le Jeune. Un ami quil avait prié à dîner nétant
pas venu, il lui énuméra, pour lui donner des regrets, toutes les friandises
quil avait préparées : A chacun sa laitue, trois
escargots, deux ufs, un gâteau, du vin miellé et de la neige, des olives dAndalousie,
des courges, des échalotes et mille autres choses aussi délicates[47]. Cétait un dîner
de nonnes. Martial lui-même demandait beaucoup moins pour être heureux, et le
dîner quil offre à Turanius est encore plus modeste, bien que la carte soit
rédigée avec la complaisance dun poète qui a voulu tout à la fois écrire de
jolis vers et donner un modèle de bon goût gastronomique. Le démagogue
Ganymède, qui aurait bien voulu faire une émeute à Crotone, ne réclamait
point 35 as et du vin à discrétion : lappétit populaire nallait pas alors
au delà dun pain de 2 sous par jour ; encore consentait-on à le gagner[48] : cest la
ration dun lazzarone. Mais, si ces hommes du Midi se contentaient de peu, ils aimaient les jeux, les
spectacles, la faconde, et sentendaient a merveille à exploiter les prodigues
ou les chercheurs de popularité municipale. De là, tant de fêtes, de repas
publics, dassemblées, de confréries où, grâce à la verve méridionale, on
oubliait la pauvreté de la mise en scène[49] et la maigre
chère quon faisait aux dépens dun donateur à la fois vaniteux et avare.
Après quoi, on allait, las ou repus, sétendre au soleil. Que veux-tu donc ? demande-t-on à un coureur de
sportules fatigué de ses courbettes. Que veux-tu
? Dormir[50].
Dormir ou rêver, cest toujours le désir de ces Méridionaux,
quand la passion ne les jette pas dans laction violente.
Le vêtement.
Prise dans son ensemble, la société romaine dépensait moins encore pour ses
vêtements que pour sa nourriture. Elle avait, comme nous, son demi-monde qui
menait grand train, ruinait des jeunes gens de famille[51], quelquefois de
vieux sénateurs, et étalait le luxe insolent qui est particulier à ces sortes
de femmes. Malheureusement de respectables matrones, ou celles qui savaient
discrètement se créer des ressources, voulaient paraître aussi belles que les
courtisanes et dépensaient plus encore pour leur toilette. Aussi le mundus muliebris était-il déjà un arsenal muni
de tous les moyens dattaque et de conservation. Jy trouve les onguents qui
servaient à se peindre le visage, les fausses dents, les faux sourcils et
jusquaux faux cheveux, quon faisait acheter au fond de la Germanie et de lInde[52]. La courtisane
impériale, Messaline, qui était brune, se couvrait la tête dune chevelure
blonde pour aller là où Juvénal la conduit[53]. On frise tes cheveux, Galla, chez un coiffeur de la rue
Suburrane, qui chaque matin tapporte tes sourcils. Chaque soir tu ôtes tes
dents, comme ta robe. Tes attraits sont renfermés dans cent pots divers, et
ton visage ne couche pas avec toi[54].
Anciennement, les vêtements étaient faits avec la laine
fournie par le troupeau de la ferme ; on introduisit peu à peu lusage du lin
dÉgypte, des cotonnades de lInde, de la soie de Chine, des mousselines si
transparentes, quon les appelait de lair tissé, des tuniques brochées dor
ou brodées de perles, des pierres précieuses et des parfums de toute sorte. A
un simple festin de fiançailles, Pline vit Lollia Paulina couverte de perles
et démeraudes de la tête aux pieds, et toute prête à lui prouver, quittances
en mains, quelle en avait sur elle pour 40 millions de sesterces. A une fête
donnée par Claude sur le lac Fucin, Agrippine parut avec une chlamyde tissée
de fils dor, et Néroli brilla aux funérailles de Poppée plus dencens que lArabie
Heureuse nen fournissait en une année. Le luxe
des femmes, disait Pline avec amertume, nous coûte par an 100 millions de sesterces, que lArabie, lInde et la Sérique nous prennent[55]. LInde seule
entrait pour moitié dans cette somme. Que dirait-il aujourdhui que ce même
pays enlève à lEurope, année moyenne, en numéraire ou en lingots, quarante
ou cinquante fois plus que de son temps ? Les produits asiatiques étaient
alors beaucoup plus chers quà présent. César donna à Servilie une bague qui
lui avait coûté 6 millions de sesterces ; Pline évalue à 1500 deniers une
livre de cinnamome, et sous Aurélien on échangeait la soie contre son pesant
dor[56]. Nous ne
connaissons plus de pareils prix. Mais si le commerce de lOrient, qui
dépasse aujourdhui 7 milliards[57], nétait
représenté que par 100 millions de sesterces, si les denrées quil apportait
avaient une telle valeur, on est forcé dadmettre quil en entrait bien peu
dans lempire et quun très petit nombre de personnes pouvaient en jouir. On
est donc toujours conduit à la même conclusion, et nous lexprimons en
empruntant à Galien ses propres paroles : Dans
les grandes villes, les femmes riches ont de la soie, et cest pour elles quon
prépare, à Rome, les essences parfumées.
Malgré quelques extravagances du luxe féminin[58], la comparaison,
si on la faisait, ne donnerait pas aux modernes lavantage de la simplicité.
Nous ne sommes plus au temps où les gentilshommes de François Ier portaient leurs moulins et leurs prés sur leurs épaules,
où le costume des hommes, fait dor, dargent, de soie et de dentelle,
coûtait, comme celui de Bassompierre, plus de 40.000 livres ;
mais notre société est encore soumise à la plus capricieuse des souveraines,
la mode, qui chaque année change la coupe et la couleur des étoffes. Les
anciens ne connaissaient pas cette servitude, et, comme pour les hommes le
vêtement couvrait le corps sans sy appliquer, un ou deux morceaux détoffe
jetés autour des reins et sur les épaules suffisaient à les vêtir. Le premier
venu savait tailler une toge, et, les jours de fête, tout le monde, depuis lempereur
jusquau dernier des citoyens, la portait. Entre celle du riche et celle du
pauvre, la différence nétait que dans la blancheur et dans la finesse du
tissu ; lélégant y ajoutait lart de se bien draper et de faire tomber les
plis harmonieusement. Il aimait de plus à avoir une garde-robe bien montée,
parce que le climat obligeait à changer souvent dhabit, et son grand luxe
était de posséder des manteaux teints dans les différentes couleurs de la
pourpre. César les avait interdits, excepté pour certaines personnes et
certains jours ; Auguste, Tibère, Néron même, renouvelèrent ces défenses sans
plus de succès, car, sous Domitien, Martial parle de robes de pourpre
publiquement achetées 10.000 sesterces[59].
Les habitations.
Le vrai luxe des Romains de lempire était dans les constructions ; ils en
couvrirent lunivers. On a vu, dans lhistoire de chaque règne, les
innombrables travaux entrepris par les empereurs, à commencer par le premier.
Auguste avait bâti pour les dieux et pour le peuple ; Caligula et Néron
bâtirent pour eux-mêmes dimmenses palais qui disparurent avec eux. De la Maison dOr de Néron, il
ne reste que les descriptions de Suétone et de Pline, et la très modeste demeure
de Livie subsiste encore. Les particuliers rivalisèrent avec les princes.
Déjà, sous la république, la noblesse, chassée de la ville par la malaria,
avait pris lhabitude de passer lété sur les collines qui dominent la
campagne de Rome[60], ou sur les
rives du golfe de Naples. Quand un décret impérial obligea les sénateurs à
mettre un tiers de leur fortune en biens-fonds italiens, la péninsule entière
se couvrit dhabitations de plaisance, et dautant plus vite que nul pays au
monde nest mieux disposé par ses sites et son climat pour les divers genres
de villégiature, soit au bord de ses deux mers ou de ses lacs nombreux, soit
au penchant de ses montagnes, qui gardaient, sous un soleil ardent, leurs forêts
et leurs sources alimentées par les neiges de lhiver[61]. A ces beautés
de la nature, les arts de la Grèce
ajoutaient leurs charmes. Les marbres les plus variés, le stuc, le verre, le
bronze, des feuilles dargent et dor, délégantes peintures, de fines arabesques
que Raphaël ne dédaigna pas dimiter, décoraient les murailles, les plafonds[62], et, pour que
les yeux fussent partout agréablement occupés, les planchers portaient des
mosaïques dont quelques-unes étaient de magnifiques compositions ; témoin la
bataille de Darius et dAlexandre, trouvée à Pompéi dans la maison du Faune
et dont les figures sont presque aussi grandes que nature. A lintérieur, des
colonnes en marbre de Numidie et dEubée, que remplacera au siècle suivant le
porphyre dÉgypte, soutenaient des portiques où lair circulait librement, et
qui, lété, défendaient du soleil, lhiver, concentraient ses rayons et sa
chaleur. A chaque pas, une statue, un vase précieux, un objet dart, de
riches tentures. Plusieurs pièces étaient décorées avec un soin
particulier : latrium, où lon
plaçait les dieux lares, les images des aïeux et des plantes aromatiques qui
purifiaient latmosphère ; près de là, le tablinum
et lexedra pour les visiteurs ; plus
loin, le triclinium pour les convives[63] ; dans un
endroit écarté, lappartement des femmes ; dans un autre, le logis des
esclaves. Les cours étaient rafraîchies par a des eaux jaillissantes reçues
en des bassins de marbre que bordaient des fleurs : la rose, le lis, la
violette, lanémone, le myrte artistement taillé[64], et, lorsque la
place le permettait, quelque beau platane à lécorce lisse, au port élégant
et vigoureux, y donnait son ombrage[65]. Le patio
des Espagnols rappelle ce goût charmant. Deux corps de bâtiments ne
manquaient jamais à une habitation complète : la bibliothèque, qui était
petite, quoique tout ce monde fût lettré ou voulût le paraître[66] ; les thermes,
construction compliquée et dispendieuse[67], où lon passait
par toutes les températures, au milieu de vapeurs parfumées, et qui se
terminait par une palestre, afin que des exercices rendissent aux membres la
souplesse et la force. Dans lhygiène des Romains, le bain avec tous ses
accessoires jouait le principal rôle, et pas un jour ne sécoulait sans quon
en prit.
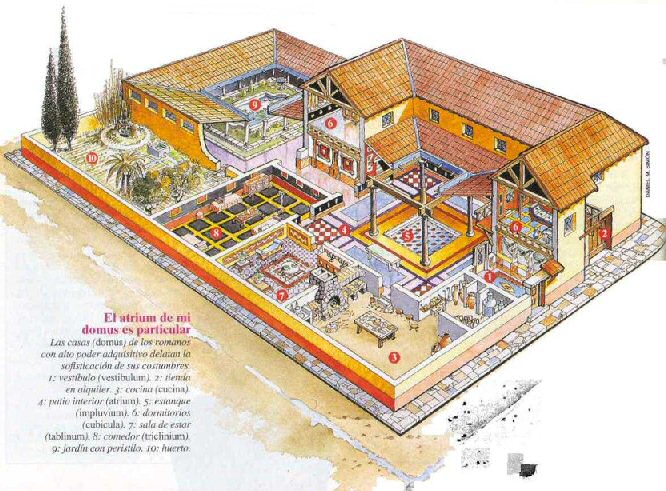
Plan dune
maison bourgeoise romaine
Cependant, malgré leur grandeur et leur luxe, ces
habitations étaient presque toujours disposées moins en vue de la commodité et
de la vie intérieure que pour lostentation. On mettait dans sa fortune lorgueil
quon plaçait autrefois dans ses consulats, et lon voulait être vanté pour
ses constructions, ne pouvant plus lêtre pour ses triomphes. Laristocratie
dargent avait succédé à laristocratie de race.
Les cités provinciales imitèrent Rome, en se donnant,
chacune selon ses ressources, des temples et des arènes, des thermes et des
théâtres, des basiliques et des curies. On prenait jusquaux notas de ses
rues : Antioche de Pisidie avait un Vélabre et un quartier Toscan ; Lyon et
la cité des Mattiaques, un Vatican ; Toulouse et Cirta, un Capitole[68], nom que porte
encore lhôtel de ville fort peu romain de la reine du Languedoc. Maintes
villes avaient, comme la capitale, des lactions du cirque et des
distributions de blé. Leurs riches citoyens eurent aussi, comme les
sénateurs, maison de ville et maison des champs, même plusieurs, afin de
pouvoir changer de climat, en se trouvant toujours chez soi[69]. Alors il ny
eut point de lac et de source thermale, point de coteau bien orienté pour la
vue ou le soleil, qui neût sa villa ; au besoin, on forçait la nature à se
plier au goût du propriétaire. Un ruisseau passait où sétait élevée une
colline ; des rocs jadis décharnés portaient des vignobles et des bois ; on bâtissait
dans la mer pour avoir des viviers et des bains que la tempête ne pût
troubler[70],
et le flot azuré reculait devant les môles
puissants[71]. On voit encore,
à Antium, des restes de ces constructions sous-marines. Sans les marées de la Manche, quon navait pas
sur les côtes dAntium ou de Pouzzoles, notre mer normande serait bientôt
contrainte de reculer aussi devant des constructions de plaisance, et les
rhéteurs modernes ny trouveraient pas un thème à déclamations philosophiques.
Quelques-unes de ces demeures étaient considérables : Sénèque
les compare à des villes[72]. Cependant tout
ce que nous connaissons de lantiquité romaine nous fait penser que les
habitations du plus grand nombre étaient petites et sans valeur. A Sora, à Fabrateria, à Frosinone, dit Juvénal[73], tu auras une jolie maison pour le prix du loyer dun bouge
à Rome.
A Pompéi, qui avait de riches citoyens, on trouve à peine
deux ou trois habitations considérables ; les maisons sont petites, les
pièces basses, sans lumière ; nos ménages douvriers refuseraient dy loger,
et, dans ses rues étroites, à chaque instant barrées par des pierres de
trottoir, il ne pouvait circuler que des litières ou des voitures à bras. A
Athènes, les fondations des maisons antiques sont encore plus petites, et lhabitation
de Livie, sur le Palatin, ne ressemble guère à une demeure dimpératrice.
Pline était riche, il possédait des villas aux portes de Rome, en Toscane[74] dans le
Bénéventin[75],
et, près de Côme, une seule de ses terres était louée plus de 400.000
sesterces (Lettres, X, 24). Il avait, en
outre, disait-il, quelque argent dans le commerce (Ibid., III, 29). Aussi, malgré de grandes
libéralités à sa ville natale et à ses amis, il était encore en état dacquérir
un bien de 3 millions de sesterces dans le Latium. Enfin, il avait une jeune
femme quil aimait ; il était le commensal du prince ; il appartenait par son
rang, ses relations, sa fortune, à la plus haute société romaine ; il devait
donc mener chez lui la grande existence dun des principaux personnages de lempire.
Or il nous a laissé une description minutieuse de ses deux villas du
Laurentinum, au bord de la mer, et de Tifernum, dans la haute vallée du
Tibre. Tout sy trouve pour la commodité, rien pour le luxe, si ce nest
celui dune belle nature. Il nénumère pas ses bronzes corinthiens, ses
tableaux, ses statues imitées des chefs-duvre de la Grèce ; il ne parle
ni des riches tissus ni des parures de Calpurnia ; mais de lhabile
disposition des pièces qui donnent la vue de la mer et des montagnes, où lon
trouve le soleil en automne, la fraîcheur en été et, dans tous les temps, le
calme et le silence[76]. On dira : cétait
un sage. Oui, mais aussi un homme semblable à beaucoup dautres ; qui
jouissait honnêtement de sa fortune, savait en faire un bon usage et
dédaignait les vulgaires plaisirs des prodigues dont le règne, dailleurs,
était, pour le moment, passé. On verra que beaucoup de gens alors pensaient
et vivaient comme lui.
Si on comparait ces demeures aux châteaux de nos
industriels enrichis, on trouverait dans ceux-ci moins de goût probablement[77], mais plus de
luxe ; et il est telle maison seigneuriale dAngleterre dont jamais la plus
magnifique des villas romaines na égalé létendue ni la richesse en trésors
dart, dameublement, dargenterie, de plantes rares, et où de bien autres
efforts ont été faits pour tirer parti du sol et braver le climat. Dans ce
qui touche aux agréments de la vie, nous avons reçu les leçons de Rome ; mais
combien les élèves ont dépassé les maîtres[78] !
 Il en faut dire autant de la manie des chevaux ;
quelques-uns furent aussi célèbres à Rome que nos vainqueurs de Longchamp, et
ils sy vendaient aussi cher. Caligula voulait décorer son cheval Incitatus
des ornements consulaires, et la popularité de Martial, en ses plus beaux
jours de faveur publique, était éclipsée par celle du coursier Andremon. Les
folies du cirque valent celles de nos courses : celles-ci lemportent même
sur celles-là, car les paris sont plus nombreux et plus forts à Longchamp et
à Epsom quils ne le furent jamais à Rome ou à Antioche. Dans la Pouille, la Calabre, la Sicile, la Cappadoce, de vastes
pâtures servaient à lélève du cheval, produit qui se plaçait toujours bien,
parce que voyageurs et marchands, gens riches et gens qui voulaient le
devenir, en avaient besoin pour leurs plaisirs ou leurs affaires. Les chevaux
croisés dEspagne et dAfrique passaient pour les meilleurs ; Antioche en
achetait, à grands frais, sur les bords du Tage et du Guadalquivir. Nous en
faisons venir du Nedjed : cest encore plus loin et plus difficile. On
dressait la généalogie des héros du cirque ; nous avons le Stud-book,
tenu sous la surveillance du gouvernement. Sauf les parieurs et les
élégantes, pour qui le champ de course est un champ de manuvres, nous
trouvons que nos cent Vingt hippodromes sont une fort utile institution.
Pourquoi blâmer si virement chez les anciens ce que nous approuvons chez nous
? Condamnons des deux côtés les excès, les scandales, largent inutilement
dépensé, mais acceptons le reste. Il en faut dire autant de la manie des chevaux ;
quelques-uns furent aussi célèbres à Rome que nos vainqueurs de Longchamp, et
ils sy vendaient aussi cher. Caligula voulait décorer son cheval Incitatus
des ornements consulaires, et la popularité de Martial, en ses plus beaux
jours de faveur publique, était éclipsée par celle du coursier Andremon. Les
folies du cirque valent celles de nos courses : celles-ci lemportent même
sur celles-là, car les paris sont plus nombreux et plus forts à Longchamp et
à Epsom quils ne le furent jamais à Rome ou à Antioche. Dans la Pouille, la Calabre, la Sicile, la Cappadoce, de vastes
pâtures servaient à lélève du cheval, produit qui se plaçait toujours bien,
parce que voyageurs et marchands, gens riches et gens qui voulaient le
devenir, en avaient besoin pour leurs plaisirs ou leurs affaires. Les chevaux
croisés dEspagne et dAfrique passaient pour les meilleurs ; Antioche en
achetait, à grands frais, sur les bords du Tage et du Guadalquivir. Nous en
faisons venir du Nedjed : cest encore plus loin et plus difficile. On
dressait la généalogie des héros du cirque ; nous avons le Stud-book,
tenu sous la surveillance du gouvernement. Sauf les parieurs et les
élégantes, pour qui le champ de course est un champ de manuvres, nous
trouvons que nos cent Vingt hippodromes sont une fort utile institution.
Pourquoi blâmer si virement chez les anciens ce que nous approuvons chez nous
? Condamnons des deux côtés les excès, les scandales, largent inutilement
dépensé, mais acceptons le reste.

III. LES PETITES INDUSTRIES ET
LES PETITES FORTUNES.
Sur un point nous sommes heureusement inférieurs aux
anciens : nous avons peu de domestiques, et ils en avaient beaucoup. Ainsi la
femme dApulée, dont la fortune nétait pas extraordinaire, 4 millions de
sesterces, en possédait assez pour quelle pût faire à ses fils du premier
lit un cadeau de noces de quatre cents esclaves[79].
Les divers services de la maison et souvent ceux de la
ferme étaient exécutés par eux. Mais lindustrie avant agrandi le champ du
travail, et les moyens dacquérir sétant multipliés en raison des besoins
qui sétaient produits, les propriétaires desclaves avaient trouvé
avantageux dintéresser ceux-ci à accroître le rendement de la terre et à
faire concurrence aux ouvriers libres. De là, ces colons qui avaient droit à
une part des récoltes et ces esclaves engagés dans les affaires dindustrie
et de commerce en compte à demi avec leurs maîtres. Les pécules amassés dans
ces travaux procuraient de nombreux affranchissements, et, comme les
affranchis étaient les plus intelligents des esclaves, beaucoup arrivaient de
la liberté à laisance, quelques-uns de laisance à la fortune. Sans doute
ils nallaient pas tous aussi loin que Narcisse ; mais beaucoup gagnaient assez
de bien pour former dans chaque cité une classe dont le fisc constata limportance
en mettant sur elle un impôt particulier, le vectigal
artium[80].
Aux grandes fortunes correspondaient les grandes terres,
autre sujet favori des déclamations philosophiques. Les anciens vantaient
toujours les sept arpents de Curius et de Fabricius, et ils avaient raison :
pour le temps où, du haut du Capitole, on voyait la frontière ennemie, la
médiocrité des fortunes était la garantie de la liberté et un moyen de salut.
Mais, quand Rome fut devenue un univers ; lorsque la classe des petits
cultivateurs du Latium eut été usée par la guerre ; que, grâce aux profits de
la victoire et du pillage, les chefs purent se former de vastes domaines ;
que le commerce et lindustrie, développés par la paix, au sein de cet empire
immense, ouvrirent à la fortune des sources nouvelles, la révolution
économique accomplie dans un court espace de temps produisit des
perturbations politiques et sociales qui firent condamner par les patriotes et
les philosophes la richesse sous toutes ses formes. Alors Pline lAncien sécria
: Les latifundia ont perdu lItalie, et
ils auront bientôt perdu les provinces. Mais lagriculture
italienne, qui connaissait déjà lirrigation[81], cherchait, en
ce temps-là, à sapproprier les conquêtes agricoles faites en dautres
climats. Les riches seuls avaient les avances indispensables pour courir les
risques et supporter les frais de ces expériences, de sorte que la grande
propriété, mauvaise à lépoque des murs simples et, plus tard, conséquence
forcée de la conquête du monde, avait fini par devenir, dans les nouvelles
conditions sociales, une nécessité. Lagriculture française serait en péril
si les profits de lindustrie ne reconstituaient chez nous la grande
propriété, à mesure que le code civil la détruit. En outre, on trouve en
cette question lexagération habituelle. Sénèque, qui dune pièce deau fait
une mer, nhésite pas à faire dune métairie un royaume[82]. Or les grandes
terres nétaient pas plus nombreuses que les grandes fortunes. Les plus
vastes parcs, fermés de mur, que connut Varron, avaient de 10 à 15 hectares de
superficie ; il sen trouve, même en France, quantité de plus considérables.
Dans lÉcosse, qui, depuis un siècle, a décuplé sa richesse, vingt-six
propriétaires possèdent 2.222.255 hectares, dun revenu annuel denviron
33 millions de francs[83]. Aux portes
mêmes de Rome, les petites propriétés étaient moins rares quelles ne le sont
peut-être aujourdhui[84]. Dans le
territoire de Cære, un homme possédait 14 jugera
(3 hectares 54 ares)
; Martial lappelle le plus riche cultivateur de la contrée[85], et il devait
paraître tel au poète qui, comme bien dautres, avait un si petit domaine, quil
disait : Ma terre ne porte que moi[86]. A Velleia,
quarante-six propriétaires, probablement les plus riches du pays, avaient des
biens valant en moyenne de 70 à 80.000 francs ; ces chiffres nannoncent pas
une grande concentration des propriétés. Enfin les latifundia nétaient pas toujours cultivés par des mains
serviles. Pline le Jeune louait ses terres à des fermiers[87] et Columelle
conseillait lemploi de métayers libres (coloni).
On raisonne au sujet de lempire en partant de lhypothèse
que le travail servile y faisait tout. Il en avait été à peu près ainsi à lépoque
où la guerre encombrait de captifs Rome et lItalie, où Crassus avait vingt
mille esclaves, quil louait à des entrepreneurs pour tous les métiers. Mais
la guerre nalimentait plus ce commerce depuis que les légions bornaient leur
rôle à garder la frontière, et les vides que faisaient dans la population
esclave la mortalité et les affranchissements étaient difficilement comblés
par les naissances serviles, la traite, lexposition, le vol ou la vente des
enfants. Il restait donc aux artisans libres une large place clans le champ
du travail, et cette place sagrandissait tous les jours, à mesure que se
développaient les industries du vêtement, des denrées alimentaires, de la
construction, des objets dart et limmense commerce qui avait à transporter
et à vendre les denrées de lunivers. Saint Paul voulait que lévêque et les
prêtres exerçassent un métier honnête ; et quand Dion Chrysostome senfuit de
Rome, nayant pour tout bien que le Phédon de Platon et une harangue
de Démosthène, il put atteindre lextrême frontière de lempire en vivant le
long du chemin du travail de ses mains, dans les fermes de la campagne ou les
jardins des villes[88]. Ainsi les
folles dépenses qui ruinaient les fortunes patriciennes retombaient en pluie
dor sur louvrier et remplissaient le coffre-fort du négociant.
Déjà avant lempire, Varron indiquait aux petits
propriétaires les avantages quils trouveraient à établir des jardins au voisinage des villes où les fleurs et les
fruits se vendent au poids de lor[89]. En preuve de ce
que lon pouvait faire avec de faibles moyens et de ladresse, il montre deux
de ses anciens soldats, deux frères, possesseurs dune maisonnette au milieu
dun petit champ quils avaient couvert de plantes aimées des abeilles, et
qui, du miel de leurs ruches, tiraient, année moyenne, 10.000 sesterces[90]. Dans les
villes, mille industries nécessaires aux riches et exigeant des ouvriers
spéciaux, quils ne trouvaient point parmi leurs esclaves, donnaient aux
pauvres du travail et du pain. Le barbier de Juvénal gagne des champs et des
maisons[91]
; Martial voit un cordonnier arriver à la fortune où lui-même ne parvint pas[92]. Or, de ces
petites gens qui, à force déconomie, dadresse et dheureuses rencontres,
pouvaient sélever au-dessus de leur condition, il se trouvait, alors comme
aujourdhui, un très grand nombre[93]. Quand Domitien
eut fait débarrasser les rues des échoppes qui les encombraient, Martial sécria
: Rome est enfin Rome ; naguère ce nétait quune
immense boutique[94]. Et lexemple de
Pompéi prouve quil en était de même dans les petites villes[95].
Avec ses quinze ou dix-huit cent mille habitants, Rome
présentait les mêmes phénomènes sociaux que nos villes modernes : au-dessus
des
petits industriels, les grands ; non loin des bouges où se
tenaient les uns, les magasins splendides où trafiquaient les autres ; notre
marché du Temple, dans toutes les ruelles ; le boulevard des Italiens, le
long de la voie Sacrée, aux Septa du Champ de Mars et dans le quartier Toscan
; ici des palais, là nos anciennes cours des miracles ; enfin la lutte pour
la vie, ardemment engagée de bas en haut, et, alors comme aujourdhui, les
petits finissant quelquefois par manger les gros, le pauvre dévorant le
riche, léconome laborieux et habile ayant raison de la richesse oisive et
prodigue.
La littérature officielle, je veux dire celle du grand
monde, la seule qui nous soit parvenue, vivant sur les lieux communs du
passé, ne voyait rien de ce grand labeur et continuait à mépriser les travailleurs,
sauf Dion Chrysostome qui mettait un ouvrier utile au-dessus dun rhéteur à
la parole dorée et vaine[96]. Mais des
inscriptions, des enseignes de magasin, des débris parfois informes et
cependant significatifs, toutes choses autrefois négligées de lhistoire,
attestent cette transformation : la société agricole de Caton lAncien
devenant la société industrielle de lempire. Ce nétait pas moins quune
révolution économique, par conséquent sociale, qui, nous lavons montré[97], modifia
profondément la loi civile. La même révolution sopérait dans toutes les
provinces. Voyez au musée de Saint-Germain les nombreux monuments funéraires
dhommes de métiers que les seules fouilles de la Gaule ont déjà mis au
jour. Ces monuments attestent deux faits : laisance de ces industriels,
assez riches pour se construire de coûteux tombeaux, et la fierté de ces
représentants du travail libre qui, loin de cacher leur condition, veulent
être vus, après leur mort, avec loutil quils tenaient de leur vivant. Ces
hommes ont évidemment lorgueil de leur profession, et sils lavaient, cest
que leurs concitoyens trouvaient cette fierté légitime.
Le luxe nest pas en soi chose blâmable ; quand il est
contenu et de bon goût, il révèle chez ceux qui le montrent une élégance desprit
qui annonce dautres qualités. Quelques-unes des charmantes peintures de Pompéi
ne donnent pas mauvaise opinion de ceux qui les ont commandées, et il ne
déplaît pas de trouver dans la maison de Livie ces décorations élégantes et
discrètes qui font penser à une vie bien ordonnée. Platon lai dit : Le beau a une vertu bienfaisante. Cest le luxe
dordre inférieur, celui qui entraîne aux dépenses folles et stériles, ou qui
sadresse aux bas côtés de notre nature, aux appétits sensuels et vulgaires,
quil faut proscrire. Il occupait une grande place dans la Rome des premiers Césars,
et nous nentendons pas le réhabiliter. Il exaltait les passions quil
convient de contenir, et, si lon ne pouvait avoir que celui-là, mieux
vaudrait se passer même de lautre. Malheureusement, ils vont de compagnie ;
cest pourquoi la philosophie les condamne tous les deux. Lhistoire, qui
tonnait mieux les conditions véritables des sociétés, se contente de flétrir
labus et de montrer que, par une juste loi dexpiation, les richesses mal
acquises sont promptement dissipées parles fils des spoliateurs. La misère dHortalus,
le désespoir dApicius, la mort de tant de personnages qui allèrent, comme
Vitellius, achever aux gémonies lorgie commencée dans les palais, lui
inspirent peu de pitié. Ces malheurs individuels lui semblent même compensés
par la vie rendue moins dure à tant de millions dhommes, par lavènement, en
place dun patriciat épuisé, dune noblesse nouvelle dont Tacite et Pline
sont les orateurs, Virginius Rufus et Agricola les généraux, Trajan et
Hadrien les empereurs.

IV. LUXE DES TRAVAUX PUBLICS ;
THÉÂTRES ET AMPHITHÉÂTRES.
Il est une autre réserve à faire, quand on parle des
folles dépenses des Romains, cest quune partie des richesses de lÉtat et
des particuliers fut employée à des constructions qui servaient non point,
comme Versailles, lorgueil du prince, ou, comme les châteaux de nos anciens
seigneurs, la vanité dune caste, mais les intérêts généraux de lempire,
tels que les routes, les ponts, les arsenaux et les ports ; ou les croyances,
les plaisirs et le bien-être de la foule, comme les temples, et les basiliques,
les thermes et les portiques, les cirques et les théâtres. Les vieux noms,
toujours subsistant à Rome et dans les cités provinciales, de république et
de peuple souverain, obligeaient le prince au bord du Tibre, les riches dans
leur municipe, à payer aux pauvres, en libéralités de toute sorte, la rançon
de leur pouvoir ou de leurs dignités. Auguste en donna lexemple. On se
souvient quil se vantait davoir fait de Rome une ville de marbre, et le
plus économe des empereurs, Vespasien, ne recula pas devant dénormes
dépenses pour construire lédifice gigantesque appelé par les Romains le
Colosse. Même parmi les mauvais princes, il y en eut pets qui ne laissèrent
pas quelque construction entreprise en vue de lutilité publique. Quelle
capitale moderne a mis au service gratuit de la foule des monuments
comparables au théâtre de Marcellus, aux thermes de Caracalla, au Colisée de
Vespasien, à ces portiques où lon se promenait à lair libre, et pourtant à
labri du soleil et de la pluie, durant plusieurs kilomètres, en ayant sous
les yeux les chefs-duvre de la Grèce ? Si lon excepte ce qui, dans ces
dernières années, a été fait à Londres et à Paris, que sont nos travaux
hydrauliques à côté de ceux des Romains pour approvisionner deau les
populations urbaines ? Dans les pays méridionaux, leau est un objet de
première nécessité puisque le bain y est une hygiène indispensable. La donner
pour rien, cétait, comme nous dirions, très démocratique ; et on savait la
faire arriver partout. Rome est encore, malgré la chute de tant daqueducs
antiques, la ville du monde la mieux pourvue de fontaines publiques[98]. Dans les cités
provinciales, la recherche des eaux quon pouvait y conduire était la
première préoccupation de la curie. On a vu, dans la correspondance de Pline,
comme gouverneur de Bithynie, les sommes considérables employées à ces
travaux. Naguère, Lyon, entre ses deux fleuves, manquait deau, et, chaque
été, Nîmes était exposée à périr de soif. Les Romains avaient su dans lune
faire monter leau jusquau sommet de Fourvières, et amener dans lautre, par
le pont du Gard, les sources fraîches et pures des Cévennes[99].
 Théâtres et amphithéâtres.
Si les théâtres étaient plus dangereux quutiles, ce nétait pas la faute
de ceux qui les construisaient, mais des poètes qui faisaient de mauvaises
pièces et des spectateurs qui en voulaient de licencieuses. Quand les fêtes
du peuple gardaient encore quelque chose de leur caractère primitif, celui de
mystères religieux, on aimait déjà à rire du gros sel et des obscénités qui déridaient
aux jeux Floraux les plus sévères républicains. Que devinrent ces coutumes au
milieu dune populace recrutée danciens esclaves ? Il faudrait aller jusquau
fond de lOrient pour voir, dans les danses lascives des almées de lInde ou
de lÉgypte, quelque chose qui rappelât les attitudes des mimes de Borne, des
danseuses de Gadès ou dAntioche et de celle qui fut limpératrice Théodora.
Même sans aller si loin, on trouverait, clans les fêtes royales ou princières
du quinzième et du seizième siècle, en pleine société chrétienne, des
exhibitions de femmes entièrement nues, choisies quelquefois parmi les plus
nobles de la cité, comme celles qui représentèrent à Lille, devant Charles le
Téméraire, le jugement de Pâris[100]. De nos jours,
les tableaux vivants et les ballets dopéra rie sont pas imaginés pour former
une jeunesse austère. Mais, Dieu merci ! nulle part on ne verrait de ces
pièces où le réalisme allait jusquà montrer, aux spectateurs dun drame
dEuripide, une femme outragée sur la scène, et, à ceux dHercule mourant,
un vrai bûcher, de vraies flammes, et, au milieu, un homme vivant quelles
consument[101]. Théâtres et amphithéâtres.
Si les théâtres étaient plus dangereux quutiles, ce nétait pas la faute
de ceux qui les construisaient, mais des poètes qui faisaient de mauvaises
pièces et des spectateurs qui en voulaient de licencieuses. Quand les fêtes
du peuple gardaient encore quelque chose de leur caractère primitif, celui de
mystères religieux, on aimait déjà à rire du gros sel et des obscénités qui déridaient
aux jeux Floraux les plus sévères républicains. Que devinrent ces coutumes au
milieu dune populace recrutée danciens esclaves ? Il faudrait aller jusquau
fond de lOrient pour voir, dans les danses lascives des almées de lInde ou
de lÉgypte, quelque chose qui rappelât les attitudes des mimes de Borne, des
danseuses de Gadès ou dAntioche et de celle qui fut limpératrice Théodora.
Même sans aller si loin, on trouverait, clans les fêtes royales ou princières
du quinzième et du seizième siècle, en pleine société chrétienne, des
exhibitions de femmes entièrement nues, choisies quelquefois parmi les plus
nobles de la cité, comme celles qui représentèrent à Lille, devant Charles le
Téméraire, le jugement de Pâris[100]. De nos jours,
les tableaux vivants et les ballets dopéra rie sont pas imaginés pour former
une jeunesse austère. Mais, Dieu merci ! nulle part on ne verrait de ces
pièces où le réalisme allait jusquà montrer, aux spectateurs dun drame
dEuripide, une femme outragée sur la scène, et, à ceux dHercule mourant,
un vrai bûcher, de vraies flammes, et, au milieu, un homme vivant quelles
consument[101].

Quant aux cirques, les Romains nen comprirent pas lusage
comme les Grecs. A Olympie, cétaient les plus nobles et les plus vaillants
qui descendaient dans larène, et les exercices du stade durent à cette
coutume une dignité que ne connurent point les jeux romains. En cela, nous
sommes encore bien plus les héritiers de Rome que ceux de la Grèce. Jamais non plus les Grecs naimèrent ces
spectacles sanglants où toute une ville était conviée à voir des bêtes fauves
déchirer des hommes ; et des prisonniers, des combattants volontaires, des
hommes libres, des sénateurs, ségorger pour de largent, pour les
applaudissements de la foule, pour un sourire du prince[102]. Le meilleur
des empereurs, Trajan, fit combattre dix mille captifs en des jeux qui
durèrent cent vingt-trois jours ; on a vu Claude en réunir deux fois autant
pour sa bataille navale sur le lac Fucin ; et comme ces malheureux nétaient
pas tous résolus à bien mourir, on lit avancer, pour les y contraindre, les
légions, les machines, les catapultes.
Dautres, au contraire, saisissaient avec joie lépée qui
allait les laire sortir de la vie ou de la servitude. Quelques-uns, acteurs
consommés dans ces jeux sanglants, mettaient de lart dans leurs gestes, de lélégance
dans leur maintien, pour donner ou recevoir le coup mortel. En tombant, ils
étudiaient encore leur pose et mouraient avec grâce. Mais, parfois aussi, un
noble captif refusait cette lutte dégradante et, le front haut, les bras
croisés, attendait le lion ou la panthère.
Les jeux finis, des esclaves armés de crocs tiraient les
corps de larène et les jetaient pêle-mêle dans le spoliarium, espèce de caverne établie sous les gradins de lamphithéâtre.
Là, deux hommes, Mercure et Charon, survenaient. Mercure touchait les corps
avec un fer rouge pour voir sils gardaient un reste de vie, et livrait, au
médecin les blessés qui navaient pas été frappés à mort. Charon achevait à coups
de maillet ceux qui ne valaient pas la peine quon tentât de les guérir. Deux
portes servaient dissue au spoliarium
; par lune sortait la chair vivante, par lautre la chair morte, porta sanavivaria, porta
mortualis.
On a trouvé des ruines damphithéâtre dans soixante-dix
villes dItalie[103]. Quelle
boucherie dhommes se faisait pour les amusements populaires !
Moins pourtant quon ne limagine. Chaque année, quelques
centaines dhommes, quelques milliers peut-être, périssaient dans les cirques[104] ; mais les uns
étaient des prisonniers de guerre ou des repris de justice à qui lon avait
laissé une chance déchapper à la mort ; les autres, des industriels dune
espèce particulière qui, comme le toréador espagnol, jouaient leur vie contre
la fortune, mortesque et vulnera vendita pastu[105]. Nous qui
supprimons la torture, qui cherchons même à cacher lexpiation suprême, nous
avons horreur de ces exécutions qui démoralisaient le supplice, et nous ne
voyous plus la justice frappant des coupables, mais la joie féroce dun
peuple qui samuse.
Ce dégoût est légitime. Il faut dire pourtant que la
croyance religieuse qui avait fait installer des jeux sanglants autour des
tombeaux nétait pas encore éteinte au temps de Commode, où lon trouve un
combat de gladiateurs donné pour le salut du
prince[106]. En outre, les
lois pénales des Romains étaient atroces : elles multipliaient à linfini les
cas de condamnation à mort, et le droit des gens mettait le vaincu à la merci
du vainqueur. Le gladiateur coûtait cher ; un coupable exposé aux bêtes était
donc une économie pour le trésor. Lassassin, lincendiaire, le brigand, le sacrilège,
le soldat qui sétait mutiné, etc., obligés de sentre-tuer ou de combattre
les fauves, diminuaient dautant la dépense des jeux. Quant aux prisonniers
de guerre trop barbares pour quon les attachât au service domestique, ils
étaient enfermés dans les écoles de gladiateurs, bien nourris, repus,
exercés, puis envoyés à larène, où ladresse et le courage en sauvaient
quelques-uns. Les grands égorgements avaient lieu après les expéditions
heureuses : sous Vespasien, quand Jérusalem tomba ; sous Trajan, au retour de
la dernière campagne dacique ; au temps dAurélien et de Probus, après leurs
triomphes[107]
; mais les petits combats qui se livraient continuellement le long des
frontières fournissaient des captifs dont la dureté romaine nétait pas
embarrassée. On enrôlait ou lon vendait ceux qui semblaient dociles ; les
autres recrutaient les bandes de gladiateurs. Même à une époque déjà
chrétienne, les panégyristes de Constantin disaient : La perfidie des Bructères na pas permis de les employer
comme soldats, ni leur caractère sauvage de les vendre comme esclaves ; en
les jetant aux bêtes, vous avez fait servir cette extermination des ennemis
de lempire aux plaisirs du peuple. Cétait le plus beau triomphe quon pût
imaginer[108].
 Tous les gladiateurs ne périssaient pas dans lamphithéâtre.
A chaque fête, bon nombre se sauvaient par leur adresse ou guérissaient de
leurs blessures, surtout quand cétait Galien qui les soignait, et
quelques-uns arrivaient à la célébrité. Les héros de larène étaient aussi
populaires à Rome que les héros du cirque. Les poètes les chantaient, les
peintres, les sculpteurs, retraçaient leurs exploits dans les palais, sur les
tombeaux et jusque dans les temples. Aussi, lattrait du péril, la pompe
enivrante dû spectacle, les applaudissements de la foule, le désir de se signaler,
an milieu de cette magnificence, par quelque coup fameux, dont ils trouveraient
ailleurs la récompense[109], entraînaient
de jeunes nobles dordre équestre, même sénatorial, à descendre dans larène.
La loi le défendait et notait le gladiateur dinfamie ; mais les murs
étaient plus fortes que la loi : lempereur Macrin avait été gladiateur[110]. Le besoin démotions
violentes, qui est dans la nature humaine, trouve satisfaction suivant le
caractère des peuples et des individus en des spectacles différents. Il avait
fait courir la foule intelligente dAthènes aux tragédies de Sophocle et dEschyle,
si pleines de terreur religieuse, il poussait, aux jeux de larène les fils
de ces rudes soldats dont la guerre avait fait la fortune, et qui semblaient
avoir transmis à leur postérité le goût du sang. Quelques-uns des acteurs de
ces jeux sanglants y trouvaient la richesse : le parcimonieux Tibère offrit
jusquà 100.000 sesterces à des gladiateurs émérites pour les décider à
paraître dans ses jeux, et Néron donna à des mirmillons de vastes domaines. Tous les gladiateurs ne périssaient pas dans lamphithéâtre.
A chaque fête, bon nombre se sauvaient par leur adresse ou guérissaient de
leurs blessures, surtout quand cétait Galien qui les soignait, et
quelques-uns arrivaient à la célébrité. Les héros de larène étaient aussi
populaires à Rome que les héros du cirque. Les poètes les chantaient, les
peintres, les sculpteurs, retraçaient leurs exploits dans les palais, sur les
tombeaux et jusque dans les temples. Aussi, lattrait du péril, la pompe
enivrante dû spectacle, les applaudissements de la foule, le désir de se signaler,
an milieu de cette magnificence, par quelque coup fameux, dont ils trouveraient
ailleurs la récompense[109], entraînaient
de jeunes nobles dordre équestre, même sénatorial, à descendre dans larène.
La loi le défendait et notait le gladiateur dinfamie ; mais les murs
étaient plus fortes que la loi : lempereur Macrin avait été gladiateur[110]. Le besoin démotions
violentes, qui est dans la nature humaine, trouve satisfaction suivant le
caractère des peuples et des individus en des spectacles différents. Il avait
fait courir la foule intelligente dAthènes aux tragédies de Sophocle et dEschyle,
si pleines de terreur religieuse, il poussait, aux jeux de larène les fils
de ces rudes soldats dont la guerre avait fait la fortune, et qui semblaient
avoir transmis à leur postérité le goût du sang. Quelques-uns des acteurs de
ces jeux sanglants y trouvaient la richesse : le parcimonieux Tibère offrit
jusquà 100.000 sesterces à des gladiateurs émérites pour les décider à
paraître dans ses jeux, et Néron donna à des mirmillons de vastes domaines.
On serait même tenté de dire quà voir ces hommes donnant
ou recevant, bravement la mort, les
populations de lOccident gardèrent un reste de virilité que neurent pas
celles de lOrient, où ces plaisirs ne furent jamais populaires[111]. Le restaurateur
de la discipline militaire, Hadrien, croyait ces exercices utiles et sy
livra : gladiatoria quoque arma tractavit[112] ; Titus, Verus,
frisaient de même, et, si nos lois ne sy opposaient, nous verrions encore
des gladiateurs volontaires. Un écrivain dé lépoque constantinienne
expliquait cette coutume par une idée à la fois religieuse et guerrière. A louverture
dune campagne, on faisait combattre des gladiateurs pour habituer le soldat
aux blessures et rassasier Némésis de sang[113]. Dans toute la
littérature latine, Sénèque est peut-être le seul qui, à légard de ces jeux
sanglants, ait pensé comme un moderne[114] : Ce brigand a tué, dit-il à un habitué de lamphithéâtre,
il est juste quil souffre ce quil a fait
souffrir. Mais toi, malheureux, quas-tu fait pour être condamné à un pareil
spectacle ? On ne comprendrait point de la part dhommes honnêtes
et bons, tels que Cicéron et Pline le Jeune, cette perversion du sens moral,
si lon navait vu les âmes les plus douces justifier linquisition et
applaudir la
Saint-Barthélemy. La morale, elle aussi, est une uvre du
temps, qui, par une lente élaboration, dégage, au sein de lhumanité, les
sentiments vrais des passions mauvaises, et lon na pas toujours plus de
mérite à valoir mieux, quand ce mérite tient seulement à ce que lon est venu
plus tard[115].

V. EXAGÉRATIONS DES MORALISTES
ET DES POÈTES DANS LA PEINTURE DE
LA
SOCIÉTÉ ROMAINE.
Les murs privées valaient-elles mieux que cette partie
des murs publiques ? Oui et non, suivant ce que lon regarde et qui lon
écoute. Ne regardez que Rome, Antioche, Alexandrie, foyers purulents dune
immense agglomération dhommes où se développent plus encore de maladies
morales que de maux physiques, et vous trouverez toutes les accusations
légitimes. Il en sera de même, si vous croyez sur parole les moralistes, qui
voient tout en noir, et les poètes de comédie et de satire, qui voient tout
en laid, parce que la règle du genre est, pour les uns, de condamner toujours
le présent au profit du passé, pour les autres détudier des cas
exceptionnels, de prendre des monstruosités sociales comme de fidèles
représentations de la société tout entière. Là où il faudrait une nuance, ils
mettent un ton cru qui accuse le relief ; et, comme eux, on naperçoit que ce
qui fait saillie. La vie calme, honnête, sans beaucoup de vertus ni beaucoup
de vices, cette vie de tous les jours, qui est aussi à peu près celle de tout
le monde, ne les attire pas plus que la plaine ne charme le voyageur en quête
de précipices et de belles horreurs. Ils font de lart et de léloquence sans
sinquiéter de la vérité, et ils ont raison den faire, attendu que léloquence
et lart, deux belles choses, sont encore des choses utiles par lesquelles
tous sont avertis et quelques-uns corrigés. Riais ils ne montrent quun coin
du tableau, au liai du tableau en son entier, et, si lon appliquait leur
procédé à toutes les époques, il nest pas une société qui ne parût
abominable. Sénèque se moquait déjà de ces gens qui font toujours le procès
de leurs contemporains[116]. Les murs sont perdues ! La méchanceté triomphe ! Toute
vertu, toute justice disparaît ! Le monde dégénère ! Voilà ce que lon criait
du temps de nos pères ; ce que lon répète aujourdhui, et ce qui sera encore
le cri de nos enfants.
  Prenons par exemple une épopée de truands, le Satiricon
de Pétrone. Ce livre singulier rappelle la bouffonnerie graveleuse de
Rabelais. La perle y est auprès du fumier, le sentiment auprès de lordure. Cest,
dit-on, la comédie humaine au temps de Néron. Je le veux bien, à condition
que ce soit celle des bouges où lauteur mène ses héros, gens de sac et de
corde, pourris par limmoralité sous toutes les formes, et pourris au point
de navoir pas même conscience de leur dégradation. Tacite, même Suétone,
laissent les infamies dans une ombre qui nest quà demi transparente.
Pétrone et Juvénal mettent tout à nu. Il faudrait descendre un moment au
milieu de ces immondices où toute grande société laisse traîner un pan de son
manteau. Mais le latin a des allures qui nappartiennent quà lui, et quand cest
le latin de Pétrone ou dApulée, il est absolument impossible de prendre,
dans notre langue, les libertés quil se donne. Que le lecteur désireux de
voir de près les bas côtés de la civilisation latine lise ces livres en leur
entier, ou quil aille revoir le chef-duvre dun artiste qui a voulu
peindre la décadence romaine. Dans une de ces villas magnifiques que les
riches de Rome se bâtissaient avec les dépouilles du monde, les fils des
Fabricius et des Gracques font débauche aux pieds des statues de leurs pères
et sous les regards indignés de deux stoïciens qui ont échappé à livresse
des fleurs, des femmes et du falerne. Cette orgie patricienne, ce délire des
sens, Rome les a vus, et les capitales modernes, celles mêmes qui se disent
les plus vertueuses, les voient encore. Ce tableau est une page dhistoire,
mais dune histoire qui se retrouve partout où se rencontrent la jeunesse, lor
et les loisirs dune vie inutile. Prenons par exemple une épopée de truands, le Satiricon
de Pétrone. Ce livre singulier rappelle la bouffonnerie graveleuse de
Rabelais. La perle y est auprès du fumier, le sentiment auprès de lordure. Cest,
dit-on, la comédie humaine au temps de Néron. Je le veux bien, à condition
que ce soit celle des bouges où lauteur mène ses héros, gens de sac et de
corde, pourris par limmoralité sous toutes les formes, et pourris au point
de navoir pas même conscience de leur dégradation. Tacite, même Suétone,
laissent les infamies dans une ombre qui nest quà demi transparente.
Pétrone et Juvénal mettent tout à nu. Il faudrait descendre un moment au
milieu de ces immondices où toute grande société laisse traîner un pan de son
manteau. Mais le latin a des allures qui nappartiennent quà lui, et quand cest
le latin de Pétrone ou dApulée, il est absolument impossible de prendre,
dans notre langue, les libertés quil se donne. Que le lecteur désireux de
voir de près les bas côtés de la civilisation latine lise ces livres en leur
entier, ou quil aille revoir le chef-duvre dun artiste qui a voulu
peindre la décadence romaine. Dans une de ces villas magnifiques que les
riches de Rome se bâtissaient avec les dépouilles du monde, les fils des
Fabricius et des Gracques font débauche aux pieds des statues de leurs pères
et sous les regards indignés de deux stoïciens qui ont échappé à livresse
des fleurs, des femmes et du falerne. Cette orgie patricienne, ce délire des
sens, Rome les a vus, et les capitales modernes, celles mêmes qui se disent
les plus vertueuses, les voient encore. Ce tableau est une page dhistoire,
mais dune histoire qui se retrouve partout où se rencontrent la jeunesse, lor
et les loisirs dune vie inutile.
Pétrone, complété par Martial, Apulée et Juvénal, a valu
bien mauvais renom à la société romaine. Mais ces écrivains quon a pris au
mot voulaient avant tout samuser et rire, et avec eux ont ri et se sont
amusés des gens très honnêtes que neffrayait aucune témérité de langage,
pourvu quil sy trouvât de lesprit et de lart. Dans le siècle des
Précieuses, le granit Condé aimait à se faire lire le Satiricon, et
Molière nous semble aujourdhui bien osé. Un peu plus tard, Mme de Sévigné
envoyait à sa fille les Contes de la Fontaine, quelle
admirait[117]
et que nous ne lisons plus ; et un ministre, le comte de Pontchartrain[118], se faisait
adresser pour sa bibliothèque particulière, comme curiosités aimables, les
livres que le parlement brûlait.
Comme toute grande ville a ses égouts, toute brande
société a ses immondices. Nous sommes justement fiers rte lélégante et noble
société qui entourait Louis XIV : cest notre grand siècle. On y trouve dhéroïques
soldats et des magistrats intègres, des saints et des martyrs, des lettrés et
des savants qui sont lhonneur de la France, mais aussi des hypocrites de religion
et de vertu qui ont passé par les verges de Molière et de la Bruyère, de
grands seigneurs qui trichaient au jeu et auraient volontiers jeté leurs
serfs aux murènes, de grandes dames qui volaient leurs fournisseurs ou qui
portaient dans le pays de Braquerie[119] leurs galanteries
effrontées et vénales, des magistrats prévaricateurs, des ministres
concussionnaires, enfin toutes les misères morales que nous ont révélées les
archives de la Bastille[120]. Sous Néron,
Locuste tenait école dempoisonnement. Mais, au plus beau siècle de la Renaissance, lItalie
sappelait a la
Vénéneuse n, et chez nous, au temps des Valois et de la Brinvilliers, lart
rie laire disparaître une créature humaine ratait porté à la perfection.
Dans le procès de la Voisin,
de labbé Guibourg et du chanoine Dulong, on dut arrêter les recherches pour
tic pas trouver des coupables jusque dans le palais du roi. Est-ce à dire quil
laille, pour cette glorieuse époque, aller prendre les représentants de la France à la Bastille et dans les
tripots ? Assurément non. Ce que nous faisons pour notre histoire, raisons-le
donc pour celle de lempire.
Pétrone et le Satiricon.
Les Romains avaient quelque chose de particulièrement odieux, le vice grec,
qui était passé de lOrient, où il règne encore, citez la forte race du Latium
et de la Sabine,
quil énerva. La réclusion des femmes orientales, la condition inférieure où
elles étaient tenues, labsence pour elles dune éducation qui les associât à
la vie intellectuelle de leur époux, expliquent, sans nous la faire
comprendre, cette abominable dépravation. Mais tout autre était le sort des
femmes en Italie. Cependant on est obligé de reconnaître que cette honteuse
aberration des sens existait en ce pays et quelle semble navoir offensé
personne. Au temps de la république, on trouve Cicéron, Brutus et César
suspects davoir connu ce vice[121] dont Horace se
vante et que Virgile chanta. Il faut dire que, layant mis au ciel et donné
au maître de lOlympe, à Apollon, même à Hercule, on le portait sans honte à
la ville et à la cour. Vespasien consacre la statue de Ganymède dans un
temple. Trajan rappelle les mimes, parce que Pylade lui plait, et Hadrien
fait un dieu dAntinoüs, dont toutes les villes dressent dans leurs murs la
statue, comme pour propager le culte de la divinité honteuse et homicide.
Nous avons eu sous notre vieille monarchie le règne des
maîtresses, qui, tout en étant moins repoussant, ne valait pas mieux pour la
bonne administration des affaires publiques. Lempire romain na pas connu la
maîtresse du roi, et les mignons y étaient sans influence.
En voyant les vieilles familles disparaître si rapidement
et tant dunions demeurer stériles[122], à ce point
que, de César à Antonin, en deux siècles, pas un empereur ne laissa de fils,
excepté le petit bourgeois de Reate[123], on serait
tenté de croire que le sang italien sétait appauvri, comme la terre
italienne sétait épuisée. Il est vrai que les générations susent vite dans
la fortune, la luxure et les curiosités malsaines dune existence inoccupée ;
mais la noblesse romaine avait deux ennemis particuliers : sous les mauvais
princes, le licteur ; en tout temps, le vice grec, qui, malgré les lois
caducaires, poussait à vivre dans le célibat et qui, sil ne tuait pas, du
moins empêchait de naître[124]. Il faut
ajouter cette cause à celles qui ont amené si rapidement la destruction de lancienne
noblesse[125].
 Le Satiricon donne une large place à ces peintures
hideuses, mais je ny prendrai que des portraits présentables et quelques
traits de cette vie de province que les historiens, tout occupés de Rome,
laissent absolument dans lombre. Voici dabord Trimalcion, ce Lucullus de
contrebande, type des enrichis du jour, qui pratique lusure, quoiquil ait
des millions, bat sa femme, malgré les services quelle lui rend, et commet
des barbarismes, bien quil ait toujours des rhéteurs affamés à sa table.
Avec la gravité sentencieuse dun homme qui tient à faire du beau style après
avoir fait une belle fortune, Trimalcion raconte comment il est devenu desclave,
affranchi ; de serviteur, maître. Le Satiricon donne une large place à ces peintures
hideuses, mais je ny prendrai que des portraits présentables et quelques
traits de cette vie de province que les historiens, tout occupés de Rome,
laissent absolument dans lombre. Voici dabord Trimalcion, ce Lucullus de
contrebande, type des enrichis du jour, qui pratique lusure, quoiquil ait
des millions, bat sa femme, malgré les services quelle lui rend, et commet
des barbarismes, bien quil ait toujours des rhéteurs affamés à sa table.
Avec la gravité sentencieuse dun homme qui tient à faire du beau style après
avoir fait une belle fortune, Trimalcion raconte comment il est devenu desclave,
affranchi ; de serviteur, maître.
Quand jarrivai dAsie, je nétais
pas plus haut que ce chandelier, et, pour faire pousser nia barbe, je me
frottais lèvres et menton avec lhuile dune lampe. Mais javais pour mon
maître et ma maîtresse toutes les complaisances ; aussi le patron me fit-il
son héritier, conjointement avec César ; il me légua un vrai domaine
sénatorial. Lhomme na jamais assez ! Je voulus faire du commerce ; je
chargeai de vin cinq vaisseaux, cétait de lor, à ce moment. Ils firent tous
naufrage. Vous croyez que jen fus découragé ? Non, ma foi ! Jéquipai dautres
navires plus grands, meilleurs et plus heureux. Il ne fallait pas quon me
crût un homme pusillanime. Ma femme se montra, dans cette circonstance, toute
dévouée : elle vendit ses bijoux, ses robes, et me mit dans la main cent
pièces dor. Ma nouvelle fortune est sortie de là. On va vite quand les dieux
vous poussent ; dune course, je gagnai 10 millions de sesterces. Tout ce que
jai entrepris ma réussi à souhait. Quand je me vis plus riche que le pays
tout ensemble, je jetai là les registres et mon commerce : je me bâtis un
palais. Maintenant, je fais travailler mon argent[126].
Il a raison davoir cette sereine tranquillité, car, une
fois arrivé au faite et installé dans la richesse, personne ne lui demandera
comment il y est parvenu. Lor ennoblit tout ; cest le dieu suprême. Comment
ne pas tenir en haute considération ses pontifes ? Trimalcion a des terres à lasser le vol dun milan[127] ; son argent fait des petits ; et ses esclaves, grands
dieux ! il ny en a pas un sur dix qui connaisse son maître. Il nachète
rien, tout naît dans sa demeure : la laine, la cire, le poivre. Vous
demanderiez du lait de coq quon vous en trouverait. Heureux homme que ce Trimalcion ! Il dort sur un lit divoire
sa grasse matinée, tandis que la foule empressée de ses clients se morfond à
la porte. Enfin il daigne se montrer ; il adresse quelques mots de côté et dautre,
favorise les privilégiés dun signe de tête. La litière ! les esclaves !
Trimalcion veut aller au Forum. Si le temps est beau, il sy rendra monté sur
une mule de prix. Chemin faisant, il sarpète pour une visite ; le cortége
des clients sarrête et lattend dans la bouc ou sous le soleil ; il se remet
en marche, on court. Et pourtant ce Trimalcion nest quun affranchi. Naguère
il portait du bois sur ses épaules. Doù vient ce respect dont il est entouré
? Il possède 18 millions de sesterces. Comment les a-t-il acquis ? On lignore
; mais il les a, cest limportant. Rangez-vous clone, quand il passe, et
gagnez ses bonnes grâces, si vous pouvez. Trimalcion sait ce quil vaut :
aussi voyez comme il sadmire, drapé dans sa toge flottante. Les larges
manches sont soigneusement ramenées sur ses mains durcies par les travaux
serviles. Métamorphose soudaine ! Hier les coups pleuvaient sur ses épaules ;
aujourdhui, il est honoré, considéré. Il parle haut et on lécoute ; il dira
mille sottises, quimporte ! sa fortune a de lesprit pour lui.
Digne précurseur de tous ceux qui ont élevé leur fortune
plus vite que leur esprit., Trimalcion dépense vaniteusement son argent à de
somptueux festins où il cherche à étonner ses convives par un luxe de mauvais
goût et une littérature apprise de la veille. Il cite Homère et Virgile ; il
fait des vers et de la philosophie. Au milieu de lorgie, il commande quon
apporte un squelette dargent, qui lui inspire cette belle sentence : Tels nous serons bientôt ; donc, vivons tant que nous
pourrons bien vivre[128]. Mais il est
plus ridicule que méchant ; même, à certains égards, il vaut mieux que les
hommes de lâge précédent, et je lui pardonne des travers, quand jentends
retentir, au fond de son âme épaisse, un écho des sentiments qui commençaient
à se répandre et qui allaient faire bien du chemin, puisquils parvenaient à
percer au travers de ce sac décus : Messieurs !
les esclaves sont des hommes aussi ; ils ont sucé le même lait ; cest la Fortune qui les a
traités en marâtre. Avant de mourir, je veux, et cela sera bientôt, quils
boivent de leau libre.
Chrysanthe nest pas monté si haut, mais il a bien vécu
selon le monde. Voyons ce que cétait que bien vivre selon Pétrone et bon
nombre de ses contemporains.
Chrysanthe a eu le sort quil
méritait : il a vécu honorablement, on la traité honorablement après sa
mort. De quoi se plaindrait-il ? Il navait pas un sou à son début ; il eût
ramassé avec ses dents une obole dans un tas de fumier. Mais il sest arrondi
peu à peu, et je crois, sur ma foi, quil laisse 100.000 écus de bien : A
quel âge croyez-vous quil soit mort ? À soixante-dix ans et plus. Il avait
une santé de fer et portait son âge à merveille. Il avait le poil noir comme
un corbeau. Je lavais connu autrefois fort débauché, et, vieux, cétait
encore un rude compère : il ne respectait ni lâge ni le sexe, tout lui était
bon. Qui pourrait len blâmer ? Le plaisir davoir joui, cest tout ce quil
emporta dans la tombe[129].
Jouir ! Pétrone dit là le mot de bien des gens de ce
temps-là et même du nôtre[130]. Mais ne
trouve-t-on pas, dans ces passages, des traits et un entrain de style qui
font songer à la
Bruyère ?
Écoutez, maintenant, ce politique de carrefour qui ne voit
que son ventre, rte trouve bien que ce qui assure sa pitance, et, si elle lui
manque, sert prend au ciel et à la terre : De
toute la journée, sécrie-t-il, je nai
pu me procurer une bouchée de pain ; il me semble que je jeûne depuis un an.
Malheur aux édiles qui sentendent avec les boulangers ! Aide-moi, je taiderai
! Et le menu peuple souffre pendant que ces sangsues vivent dans de
continuelles saturnales. Oh ! si nous avions encore ces lions que je trouvai
ici à mon retour dAsie ! Cétait alors quil faisait bon vivre. La disette
désolait la Sicile
; la sécheresse brûlait les campagnes ; mais Safinius était un tonnerre
plutôt quun homme ; en quelque lieu quil fût, il mettait tout en feu. A la
curie, comme il vous les pelotait ! Ah ! il ny allait pas, lui, par quatre
chemins, mais tout droit. Au Forum, quand il plaidait, on eût dit le son du
clairon. Et cependant, quil était affable ! Il rendait chaque salut ; il
appelait chacun par son nom ; on eût dit un des nôtres. Pendant son édilité,
le pain ne coûtait guère pour un as, vous en aviez de quoi manger à deux sans
en venir à bout ; aujourdhui, les pains dun as ne sont pas gros comme lil
dun buf. Hélas ! hélas ! tout va mal. La colonie pousse à rebours, comme la
queue dun veau. Et comment cela ne serait-il pas ? Nous avons pour édile un
homme de rien, qui aime mieux un as que la vie dun citoyen. Il se gaudit
chez lui ; il reçoit plus dargent en un jour quun autre nen aurait en
vendant tout son patrimoine. Je sais une affaire qui lui a valu 1000 pièces dor.
Oh ! que, si nous avions un peu de nerf, il naurait pas si bon marché de
nous ! Mais tel est le peuple aujourdhui : lions à la maison, renards au
dehors[131].
Vous avez entendu ce démagogue quelque part, car on en
trouve de pareils dans tous les temps ; mais, alors, il en restait aux cris
et narrivait pas jusquà lémeute. Celui-là, cependant, a un caractère que
les nôtres nont plus : il est religieux, ou paraît lêtre, et voudrait bien
ameuter les dévots en même temps que les paresseux et les mendiants.
Que devenir, si les dieux
refusent de prendre la colonie en pitié ? Maide le ciel ! je crois que tout
cela arrive par la volonté des immortels ! Car, maintenant, personne ne croit
plus que le ciel soit le ciel ; personne ne jeûne, personne ne fait cas de
Jupiter. La grande affaire est de compter son or. Autrefois, les femmes,
pieds nus, les cheveux flottants, le front voilé, lâme pure, allaient sur le
coteau supplier Jupiter denvoyer la pluie, et leau tombait par torrents, et
tous se réjouissaient. Autre temps, autre chose : pour prix de notre impiété,
nos champs sont stériles[132].
Mais ne prenez pas Pétrone au mot : il sait aussi bien que
Lucrèce ce que valent ses divinités : Maintenant,
ceux qui sont liés par des vux, ceux mêmes qui vendraient lunivers, se
forgent à lenvi des dieux propices à leurs désirs. Ils en avaient
imaginé un qui avait alors, comme à présent, beaucoup dadorateurs : le GAIN. Une inscription
de Pompéi, mise en mosaïque au seuil dune maison, obligeait le visiteur à
honorer en passant le dieu protecteur des industries fructueuses : Salve Lucru[133].

VI. SÉVÉRITÉ DES MURS DANS LES
PROVINCES ET DANS LA HAUTE SOCIÉTÉ.
Jai montré le débordement des mauvaises murs au dernier
siècle de la république ; à lépoque des Antonins, cette société que tant de
richesses soudainement et mal acquises avaient ébranlée se rassoit. Les fortunes
monstrueuses sétant dissipées et le moyen de les refaire nexistant plus,
les murs changent. Les Romains cessent dêtre des parvenus jetant à pleines
mains lor et lhonneur, comme des enrichis dhier, et la vie sociale reprend
son cours régulier. Puis, tout lempire ne tenait pas dans Rome. En suivant
les satiriques et les poètes, nous avons paru oublier comme eux les braves
gens qui vivaient honnêtement et sans bruit, loin des grandes cités, et qui
composaient la masse des populations de lempire : fond solide, mais terne,
quon voit mal et sur lequel se détachent en vives couleurs les vices, les
passions et les ambitions malsaines, parce que les mauvaises murs saffichent,
tandis que les bonnes se cachent.
Sans doute avec une religion qui ne défendait rien et lesclavage
qui facilitait tout, avec des spectacles obscènes où la jeune femme se
perdait : Chaste elle y était allée,
impudique elle en est revenue[134] ; la règle des
murs, incertaine et flottante, avait peu de force pour retenir les âmes
vulgaires. Aussi a-t-on pu supposer que tout lempire sétait mêlé aux fêtes
de Néron et assis aux festins de Vitellius, ainsi quon a cru que la France entière, il y a un
siècle et demi, avait les murs de la Régence et soupait chaque soir comme le duc dOrléans[135]. La raison
seule réclamerait, même sans preuves contraires ; parce que si la nature
humaine a ses faiblesses pour la passion, elle a aussi ses révoltes contre le
vice, et lon verra bientôt que la société romaine était alors traversée par
un courant didées morales, on les âmes délicates se fortifiaient dans lhorreur
des saturnales de la chair ; les gens de cur, dans le sentiment énergique de
la dignité humaine.
Mais les témoignages ne manquent pas pour donner à croire
que, si lon pouvait pénétrer au milieu des populations provinciales, même au
sein de quelques grandes familles romaines, on y trouverait les murs qui
toujours accompagnent la modération de la fortune et des désirs ou lélévation
des sentiments et du caractère. Dans les cités
éloignées, dit Tacite, on retrouve lancienne
Italie avec la sévérité de ses premières murs[136]. Et il montre
les provinciaux de passage à Rome, notables envoyés en députation vers le
sénat ou simples particuliers venus pour leurs affaires, rougissant dune
dissolution quils ne connaissaient pas, laseiviæ
inexperti. Les hommes nouveaux,
dit-il encore[137], qui furent appelés du fond des provinces au sénat de Rome
y apportèrent léconomie et lordre de leur vie privée. Marseille lui semble unir, par un heureux accord, la politesse de la Grèce à la simplicité des provinces[138], et, avant de
célébrer les exploits du provincial Agricola, son beau-père, il peint dun
mot ses vertus privées : Il épousa Domitia
Decidiana. Les deux époux vécurent en parfaite intelligence et dans une
tendresse mutuelle, chacun deux aimant lautre plus que lui-même[139]. Aussi ne
faut-il point sétonner de voir Tacite attribuer un changement dans les murs
de la noblesse romaine à lavènement des provinciaux aux grandes fonctions
publiques.
Pline pense comme Tacite, à ce sujet ; sa mère était de lEspagne
citérieure : Vous savez, dit-il, quelle est la réputation de cette province, quelle
sévérité de murs y règne. Et ailleurs : A Brescia on garde avec soin la modestie, la frugalité, la
franchise de nos pères. Vous connaissez
aussi le naturel austère des Padouans[140]. Écoutez même Martial,
le poète espagnol à qui Rome avait paru le seul lieu où lon pût vivre, parce
que des vers faciles y ouvraient la porte des grands. Sentant la vieillesse
arriver et sa veine peu fécondé se tarir, cet habitué du Palatin et des
Esquilies devient rural. Le voilà qui célèbre la vie simple, économe,
de la province. Ici, il faut nourrir ma terre ; cest
elle, là-bas, qui me nourrira. Et il veut quitter les bords du
Tibre où la faim même coûte cher ; où lon use
quatre toges en un été, lorsque, ailleurs, aux champs, une seule fait quatre
automnes[141]. Il regrette la
maison natale dont la table se couvre de lopulente
dépouille des champs paternels qui le feraient si riche avec si peu
; et il finira par y retourner.
Malheureusement, Tacite na pas songé à peindre cette vie
provinciale, parce que le bonheur ne fournit pas les sombres ou éclatantes
couleurs que préférait le grand artiste. Pourtant, à travers ses récits et
ceux de ses contemporains, on voit passer dans lombre des figures aimables
ou graves, et la correspondance de Pline nous fait entrer dans la meilleure
compagnie. Les idées, comme celles de lhomme qui nous y introduit, ny sont
pas très élevées ; mais il y règne les sentiments les plus honnêtes, et lon
ny rencontre que des gens avec qui lon vivrait volontiers. Dabord Pline
lui-même : on peut se montrer sévère pour le gouverneur de Bithynie, pour lécrivain
qui se croit lémule de Cicéron et de Démosthène en cadençant harmonieusement
des périodes vides, pour lorateur qui, mesurant léloquence à la clepsydre,
est tout fier davoir parlé sept heures de suite ; mais si Pline nest pas un
grand esprit, cest à coup sûr un très galant homme, toujours prêt à donner
sa bourse ou ses conseils, aimant le bien, les murs décentes et préoccupé de
ne rien faire, de ne rien dire, qui ne soit digne de lui et de sa toge
consulaire.
Quels sont ses amis ? Tacite, très grave personnage, qui
doit avoir eu les murs quil exigeait des autres ; Quintilien, quil aida à
doter sa fille et dont le grand ouvrage est autant un livre déducation que
de rhétorique ; Suétone, que Pline hébergea souvent[142] et dont les
goûts, comme la fortune, étaient très modestes, si lon en juge daprès la
propriété quil voulait acquérir. Ce domaine
tente mon cher Suétone par plus dun endroit : le voisinage de Rome, la
commodité des chemins, la petite étendue des bâtiments et de la terre, qui
suffisent à distraire, non à occuper. Aux savants comme lui, il faut une
allée pour se promener, une vigne dont ils puissent connaître tous les ceps,
et quelques arbustes dont le compte ne sera ni difficile ni long. Voilà
des gens de lettres qui ne couraient point après largent, saimaient entre
eux et ont vécu de telle sorte, que lhistoire ne relève à leur charge rien
qui puisse diminuer lestime quils saccordaient.
Veut-on un philosophe ? Euphratès nous est inconnu, et je
ne sais si nous devons regretter la perte de ses livres ; gardons du moins le
portrait que Pline trace de ce moraliste aimable, sérieux et non chagrin,
sage sans orgueil, qui, bien différent de ces philosophes chevelus et
braillards dont Lucien va bientôt se moquer, fait la guerre aux vices, non
aux hommes, et ramène à la vertu par la douceur, au lieu de repousser par linsulte.
Mais pour le moment, cest la vie domestique qui nous occupe. Euphratès est dune extrême politesse, qui égale la pureté
de ses murs. Trois enfants composent sa famille et il noublie rien pour
leur éducation. Son beau-père, qui tient le premier rang dans sa province,
est recommandable à mille titres, surtout par la préférence que, dans le
choix dun gendre, il a donné à la seule vertu sur la naissance et la fortune[143].
Des lettrés passons aux gens du monde, nous trouverons des
caractères. Corellius Rufus[144] avait tout ce
qui fait aimer la vie : une bonne conscience, la meilleure réputation, une
femme, une fille, quil chérissait, et des amis véritables. Il prolongea son
existence jusquà soixante-sept ans par la pureté de ses murs, et, quand une
maladie incurable le rendit à charge aux autres et à lui-même, il résolut de mettre
un terme à ses souffrances. En vain on le supplia de renoncer au fatal
dessein. Jai prononcé larrêt, dit-il
; et il se laissa mourir de faim. Titius Ariston fit comme Rufus. Vous savez, écrit Pline, mon admiration et ma tendresse pour lui. Rien ne surpasse
sa sagesse, son intégrité, son savoir.... Sa table, ses habits, sont dune simplicité antique, et en
entrant chez lui je crois revoir les murs de nos pères.... Pris dune maladie cruelle, il nous fit appeler, quelques
amis et moi, et nous pria de consulter sérieusement ses médecins, parce quil
voulait prendre un parti : attendre patiemment la guérison, si le temps
pouvait lamener, ou quitter une vie douloureuse, si le mal était incurable[145]. Ces hommes qui
pèsent tranquillement la vie et la mort, se font juges deux-mêmes et
prononcent larrêt, ne ressemblent guère aux efféminés de Martial ou aux
malandrins de Pétrone, et nont pas dû vivre comme eux. Ajoutez Thrasea, Helvidius,
Pline lAncien, Agricola, Verginius Rufus qui refusa lempire, Cornutus
Tertullus qui leût mérité, Pegasus, le très saint
interprète des lois, Trebonius Rufinus, duumvir à Vienne, qui
supprima les jeux dans cette ville, Junius Mauricus, qui demandait quon les supprimât
à Rome, et quantité de personnages dont les vertus sont restées dans lombre,
comme le dévouement des soldats qui vivaient et mouraient obscurément., sur
les frontières, dans laccomplissement du devoir.
Pline connaît les captateurs de testaments et nous raconte
les mésaventures de lun deux, Aquilius Regulus, le plus célèbre des
industriels de cette sorte, qui, arrivé à 60 millions de sesterces, comptait
bien doubler la somme[146]. Mais ses
lettres montrent quil y avait aussi des gens capables de refuser une
succession avantageuse, daccepter des legs onéreux, dexécuter des
codicilles qui nétaient pas obligatoires[147]. Hadrien,
Antonin, Marc-Aurèle, avaient donné lexemple de la plus grande simplicité de
vie : cétait une tradition dans cette ramille de parvenus. Le biographe dAntonin
dit du père de ce prince quil était intègre et de murs pures, integer et castus, de son aïeul maternel quil
avait été irréprochable, homo sanctus.
Où Juvénal a-t-il pris les femmes qui posent dans sa
galerie impudique ? Là où elles sont encore, auprès des théâtres et des bouges,
dans le quartier toscan où se trouvent, disait
déjà Plaute, des gens qui se vendent eux-mêmes[148] ; où se presse la foule impie, ajoute Horace, qui
pourtant nétait pas bien sévère[149]. Cependant Rome
a vu dautres murs, même dans ce palais impérial tant souillé aux temps de
Caligula et de Claude, de Néron et de Domitien. Sous Auguste : Livie,
indulgente pour son époux, mais sévère pour elle-même, et Octavie, dont
jamais un soupçon neffleura la chaste renommée ; sous Tibère : Antonia et
Agrippine, dignes objets du respect public ; sous Trajan : Plotine, dont la
vertu fut une force pour son époux ; et, si je ne place pas sur cette liste dhonneur
les deux Faustine, cest par une condescendance que lhistoire ne devrait pas
avoir à légard daccusations probablement calomnieuses. Quand Sénèque, qui
était né à Cordoue, nous montre sa mère élevée
dans une sévère maison, et sa tante durant les seize années que
son mari gouverna lÉgypte, comme inconnue dans
la province, on peut croire que sa piété filiale na cherché quun
trait de ressemblance entre les femmes de sa famille et celles des anciens
jours[150].
Mais il en connaît dautres qui rappellent les murs antiques, Marcia, par
exemple[151]
; et combien nen trouvons-nous pas dans Pline et Tacite qui, après avoir
été, comme dit Hérode Atticus de sa femme, la
lumière de la maison[152], resteront à
jamais lhonneur de leur sexe : ainsi Antistia et Servilia, qui, ne pouvant
sauver leur père, meurent avec lui, et cette Pomponia Græcina, femme de
naissance illustre, dont la vie est restée un mystère triste et touchant.
Liée dune étroite amitié avec Julie, fille de Drusus, que Messaline força de
se tuer, elle porta quarante ans son deuil, et jamais on ne la vit sourire.
Ce dégoût de la vie romaine et de ses dangereuses grandeurs avait-il
prédisposé son âme à recevoir la foi nouvelle ? Elle fut du moins
accusée de se livrer à des superstitions étrangères. Pour la sauver, saris
doute, son mari Plautius, conquérant de la Bretagne, réclama le
droit de la juger lui-même en présence ale ses proches, selon les formes
anciennes de la juridiction domestique. Ce tribunal la déclara innocente, et,
comme on était encore dans les bonnes années de Néron[153], la sentence
fut acceptée. Mais Græcina garda sa tristesse et probablement la secrète
espérance dune vie où pourraient sépanouir tous les nobles sentiments des
curs délicats et purs.
Le mari dArria, Cæcina Pætus, et son fils étaient
atteints dune grave maladie ; le fils mourut. Sa mère prit de tels soins des
obsèques, que le père nen sut rien. Chaque fois quelle entrait dans sa
chambre, elle lui donnait des nouvelles du pauvre mort : il navait pas mal
dormi, ou bien il commençait à manger, et, lorsquelle ne pouvait plus
retenir. ses larmes, elle sortait un moment, puis revenait les yeux secs, le
visage serein, ayant laissé son deuil à la porte. Plus tard, le mari, engagé
dans la conspiration de Scribonianus, est pris et mené à Rome. On lembarque.
Arria conjure les soldats de la recevoir à bord : Vous
ne pouvez, leur dit-elle, refuser à un
consulaire quelques esclaves qui le servent, lhabillent, le chaussent ;
seule je lui rendrai tous ces services. Comme ils restent
inexorables, elle loue une barque de pêcheur et suit, à travers lAdriatique,
le navire qui porte son époux. A Rome, elle rencontre la femme de
Scribonianus, qui veut lui parler : Que je técoute,
lui dit-elle, toi qui as vu tuer ton mari entre
tes bras et qui vis encore ! Prévoyant la condamnation de Pætus,
elle arrêta de ne pas lui survivre. Thrasea, son gendre, la conjurait de
renoncer à cette résolution : Voulez-vous donc,
lui disait-il, si je viens à périr, que votre
fille meure avec moi ? Oui, je le
veux, quand elle aura vécu avec vous aussi longtemps et dans une aussi
parfaite union que jai vécu avec Pætus. Sa famille surveillait
ses mouvements, ses gestes, pour déjouer son fatal projet. Vous perdez votre temps, dit-elle ; vous pourrez bien faire que je meure dune mort plus
douloureuse, mais il nest pas en votre pouvoir de mempêcher de mourir.
Et en même temps elle se leva et courut se heurter la tête avec tant de
violence contre le mur quelle tomba comme morte. Quand elle eut repris ses
sens, elle leur dit : Je vous avais prévenus que
je saurais mouvrir les passages les plus difficiles vers la mort, si vous me
fermez ceux qui sont aisés. On ne sétonne plus que, pour décider
son mari hésitant, elle se soit frappée dun poignard et lui ait donné le fer
en disant : Tiens, Pætus, cela ne fait point de
mal[154]. Voilà de
vaillantes femmes.
Préfère-t-on une affection plus simple, un dévouement
moins théâtral ? Écoutez Pline : Je me promenais
dernièrement sur le lac de Côme avec un vieillard de mes amis. Il me montra
une maison dont une chambre savance au-dessus des flots. De là, me dit-il,
une femme, notre concitoyenne, se précipita avec son mari. Celui-ci souffrait
beaucoup dun ulcère. Quand elle fut convaincue quil lui était impossible de
guérir, elle lexhorta à se donner la mort et promit de ne pas lui survivre.
Ils vinrent sur cette plate-forme, se lièrent ensemble avec des cordes et se
jetèrent tous deux dans labîme[155]. On ne sait
même pas son nom. Une autre montre cette dignité fière qui ne permet pas dhésiter
sur le devoir. Elle avait résolu denvoyer une somme considérable à une de
ses amies exilée par Domitien. On lui représente quinfailliblement cet argent
tombera aux mains du tyran. Il mimporte peu,
dit-elle, que Domitien le vole ; mais il mimporte
beaucoup de lavoir envoyé.
Que nous voilà loin des héroïnes impures de Martial et dEppia
la consulaire, fuyant avec un histrion jusquaux bords du Nil !
Le paganisme avait même de grands honneurs pour une vertu
qui nous semble bien peu païenne, la chasteté. Cérès, Vesta, dont la légende
était si, pure et si belle ; voulaient des prêtresses à leur ressemblance ;
et les personnes les plus respectées des Romains étaient les femmes
consacrées aux deux chastes déesses. Apollon même avait, à Argos, une
prêtresse qui devait navoir jamais connu que lamour divin[156]. Dans les
fêtes, les vestales venaient sasseoir au premier rang, et limpératrice
régnante prenait place au milieu delles[157].
Cette société connaissait aussi des femmes dont le mundus muliebris noccupait pas tous les
moments. Dans certaines maisons, on tenait des cercles littéraires, où de grandes
dames discutaient sur Homère et Virgile, comme on le faisait à lhôtel de
Rambouillet sur le Cid ou sur un madrigal. Rome avait ses Précieuses, même
ses Femmes Savantes, et Juvénal, Martial, ont ri de ce travers avant notre
grand comique[158] ; mais elle
avait aussi ces femmes charmantes dont le commerce délicat aiguise et relève
lesprit de ceux qui les écoutent. Pompeius
Saturninus ma montré des lettres quil dit être de sa femme. Je crus lire
Plaute ou Térence en prose. En est-il lauteur ? Je len félicite. Sa femme
les a-t-elle composées ? Je len félicite encore pour avoir si bien appris à
écrire à celle qui nétait quune enfant lorsquil lépousa[159]. Sulpicia, une
patricienne qui sétait mariée à un sage, et qui shonora par la pureté de sa
vie, fut un poète renommé. Il nous reste quelques-uns de ses vers, une satire
énergique contre lédit de Domitien qui exilait les philosophes ; mais nous
avons perdu le poème quelle avait composé sur lamour conjugal[160]. Rien quà
prononcer le nom de Sulpicia, Martial devient grave ; lui-même parle dune
jeune fille, fiancée à son ami Cassius, qui avait léloquence de Platon, laustérité
du Portique, et faisait des vers dignes dune Sapho chaste (VII, 69).
On pourrait continuer longtemps cette énumération et citer
encore Polla, la veuve de Lucain, dont Stace a peint linconsolable douleur[161] : Fannia, dont
Pline admire les vertus ; la femme de Minicius Macrinus passant trente-neuf
années avec lui, sans quun nuage sélevât entre eux, ou montrer Spurinna,
consulaire chargé dans et dhonneurs, qui vit aux champs avec sa vieille
épouse, sappuyant chacun au cur de lautre, pour achever ensemble le soir dun beau jour[162]. Dans la maison
dAgricola, nous avons vu même spectacle[163]. On na pu quentrouvrir
la porte de la maison où Perse shonorait par sa mâle poésie. Que de vertus,
que de tendresses délicates, ne trouve-t-on pas en lui et autour de lui[164] ?
Terminons par le portrait que fait Pline de Calpurnia, sa
jeune femme. Pour mieux lui plaire, elle étudiait les belles-lettres,
apprenait ses livres par cur, mettait ses vers en musique et les chantait
sur sa lyre : Vous ne pouvez vous imaginer ni son
inquiétude avant que je plaide ni sa joie après que jai plaidé. Il y a
toujours au tribunal quelquun chargé par elle de lui rapporter en toute hâte
les applaudissements et la victoire. Sil marrive de lire une pièce en
public, elle sait se ménager une place où, derrière le rideau, elle écoute et
savoure les éloges que lon donne à son époux. Quon lise encore
la lettre si tendre quil lui adresse[165] et celle où il
parle de mariages qui ne ressemblent guère aux unions que montrent les poètes
comiques, puisque les familles ny ont, de part et dautre, que la
préoccupation de lhonneur et de la vertu[166]. Enfin, daprès
ce quon peut voir par lui de la société romaine, ou ne trouve pas que les
femmes aient eu dans leurs familles une autre situation que dans les nôtres.
Elles y paraissent entourées daffection et de respect : Rien ne vous manque plus, écrit-il à un ami, puisque vous avez maintenant votre femme et votre fils[167].
Nous possédons une autre correspondance, celle de Fronton.
Grâce au mauvais goût de ce Numide, devenu consulaire, et à ses
préoccupations de petite littérature, ses lettres ne fournissent rien à lhistoire.
Cependant, avec lui, on se trouve encore en bonne compagnie. Cest un pauvre
esprit que la rhétorique tient à la lisière, niais un cur honnête qui aime
tendrement tous les siens, sa vieille femme, ses petits-enfants, son frère et
son gendre. Ne lui en demandons pas davantage et mettons-le dans notre
galerie dhonnêtes gens, avec ces nobles amis dHadrien, dont il a été parlé
plus haut, avec ce Cavius Maximus, homme de murs
graves et austères[168], Romain des anciens jours, qui, sous Antonin,
exerça durant vingt années, sans rien perdre de son honneur, la charge
redoutable de préfet du prétoire.
On dira : Ces hommes étaient
en bien petit nombre. Cest possible ; Rome alors ressemblerait à
tous les pays. Cependant ; de Caton à Marc Aurèle, en passant par Thrasea, on
trouve une suite de beaux caractères qui ne sinterrompt pas. La valeur
morale dune société se marque par le degré délévation quatteignent ses
hommes supérieurs et par le niveau où la foule arrive. Les premiers nous
donnent la mesure de la capacité morale du peuple et nous montrent lidéal
qui lui est proposé. Par les seconds, nous connaissons les facilités ou les
empêchements que les influences sociales et léducation, en prenant ce
dernier mot dans son acception la plus large, ont placés sur la route qui
conduisait à cet idéal. Or le stoïcisme romain est une des plus belles
créations de lesprit humain, et les faits exposés dans ce livre prouvent que
la société romaine, certains côtés mis à part, valait autant que beaucoup dautres
qui se croient bien plus haut placées sur léchelle morale.
Ces faits, ces personnages, appartiennent encore aux
grandes familles du temps. Mais regardons au-dessous delles, comme nous
avons regardé hors de Rome. Descendons dans ces humbles demeures où lon naime ni les dés et les danses impudiques, ni ladultère
et les passe-temps infâmes qui sont, chez les nobles, le masque du
savoir-vivre. Entrons dans ces pauvres maisons doù sortent les hommes habiles qui conduisent les procès du patricien
ignorant et la brave jeunesse qui court défendre lempire sur lEuphrate ou
le Rhin[169]. Là vivait une
classe moyenne qui, alors comme aujourdhui : était sollicitée au travail, à
léconomie, par la médiocrité de sa fortune, mais qui malheureusement na pas
dhistoire. On voit bien que cest elle qui laboure la terre et la mer, qui
produit et qui trafique, qui fait par son industrie la richesse de lempire,
et par son esprit dordre la tranquillité des provinces. Mais, pour savoir
quelque chose de ses sentiments, on est réduit à lire les inscriptions de ses
tombeaux.
.Aucun peuple nen a laissé daussi nombreuses : on
pourrait dire que cest un genre de littérature particulier aux Romains.
Elles sont souvent en vers et prennent tous les tons, toutes les formes. On y
trouve de la philosophie et de la religion, de la foi et du scepticisme, de
la raillerie, des regrets amers et bien peu despérance. Chacun y raconte sa
vie et y exprime ses sentiments. Tantôt le mort parle aux passants, les
avertit quils ne sont, comme lui, que cendre et poussière, ou leur
recommande sa tombe en les menaçant dune amende sils ne la respectent pas[170]. On y rencontre
jusquà des dialogues. En voici un entre les parents et les Mânes : Soyez-nous favorables, disent les parents ; et
les Mânes répondent : Et vous, donnez à ceux
qui sont ici ce qui leur est dû ; donnez à la mort. Sur quoi le
mort intervient et dit : Si les morts ont quelque
chose, cela mappartient. Tout le reste, je lai perdu[171].
Mais nous ne voulons chercher dans ces inscriptions que
certains détails de murs. Si beaucoup dentre elles mentent comme une
oraison funèbre, comme les pleurs dun héritier ou les éloges dun
successeur, quelques-unes montrent une vraie douleur ; on y entend retentir
un cri déchirant ; surtout on voit, par ce quelles louent, les qualités dont
cette société faisait lidéal de la femme : Amymone,
femme de Marcus, était bonne et belle, fileuse infatigable, pieuse, réservée,
chaste et bonne ménagère[172]. Elle a filé la laine et gardé la maison[173]. La morte,
peut-être, navait pas eu ces vertus ; mais, en lisant les inscriptions
funéraires, chaque fois quelles passaient à lentrée de la ville, sur la
voie des tombeaux, les vivantes savaient ce quon espérait delles, et plus dune
y conformait sa conduite. A celle-ci on fait honneur de navoir été mariée quune
fois, univira[174] ; à celle-là de
sêtre toujours montrée secourable[175]. Primus dit de
sa femme : Elle métait plus chère que la
vie[176] ; un autre : Elle
ne ma jamais causé de chagrin, si ce nest par sa mort ; un autre
encore : Cest en lettres dor quil faudrait
écrire ses vertus[177]. Ici je
commence à me défier de lemphase. Une veuve regrette de navoir pas précédé
son époux au tombeau[178] ; un mari jure
quaprès avoir vécu dix-huit ans avec sa femme, sans le moindre nuage, il nappellera
jamais une autre à la remplacer au foyer domestique[179].... Il nest
pas sûr quil ait tenu son serment, mais il est bien quil lait fait. A
Beyrouth, Rufus Antonianus élève, à la plus
pieuse et à la plus chaste des femmes, une statue de marbre, afin quelle serve dexemple[180]. Jaime mieux
ces simples mots gravés sur le tombeau dune affranchie, par lépoux
survivant, au nom de la pauvre morte : Jattends
mon mari, Virum expecta meum ; et il me plait de trouver cette
inscription en Gaule[181] ! En voici une
autre qui très certainement était sincère : Ô Mânes
très saints, je vous recommande mon mari. Soyez-lui très indulgents pour que
je puisse le voir aux heures de la nuit[182]. Servilius
Portunatus aimait tout autant sa femme, lui qui rapporta ses restes du fond de la Dacie, à travers les terres et les mers,
jusquau pied de lAurès[183]. Je sais bien
ce que Pline lAncien, Ovide, Sénèque et tant dautres, sans parler de
Juvénal, disent du mariage. Toutes ces méchancetés plus ou moins
philosophiques nempêchèrent pas Cicéron de prendre une seconde femme, Pline
le Jeune et Ovide de se marier trois fois.
A Rome, on a lu sur une tombe : Le jour de la mort de ma très chère épouse, jai rendu grâce aux hommes
et aux dieux. Il sagit bien cette fois dune mauvaise femme ou dun
mauvais mari, peut-être de deux méchantes gens ; mais, si vous acceptez cette
épitaphe pour véridique, pourquoi croiriez-vous que dautres ne le sont pas[184] ?
On faisait alors, comme de nos jours, des voyages de
plaisance avec tous les siens, et lon se rendait de fort loin à des lieux de
pèlerinage ou de curiosité. La statue parlante de Memnon, au fond de lÉgypte,
attirait beaucoup de gens qui venaient écouter le fils de lAurore et qui lui
apportaient le salut (proskynème) de leurs amis ou de leurs
proches. Dans les vers que Gemellus grave sur le colosse, il tient à dire quil
est là avec sa chère épouse Rufilla et ses
enfants. Un autre sy rend avec sa sur ; Trebulla regrette labsence
de sa mère ; Aponius, celle de sa femme ; N., celle de ses frères. Sur les
pyramides, une Romaine écrit : Je les ai vues
sans toi, ô le plus chéri des frères ! A ton souvenir, jai versé des larmes
et jai voulu écrire ici ma plainte[185].
Tout un petit poème trouvé sur une tombe à Cagliari
rappelle le dévouement dune nouvelle Alceste, Atilia Pomptilla, qui soffrit
aux dieux pour racheter les jours de son époux en danger de mort. Nous ne
savons pas comment sopéra le sacrifice, mais lépoux, survivant à regret, atteste le miracle, en
demandant avec ardeur que son âme se réunisse bientôt à celle de la plus
tendre des épouses[186].
Il faudrait citer en entier léloge funèbre[187] dune noble
femme dont le mari a longuement raconté les vertus, la douceur, la religion
éclairée et linfatigable dévouement qui ne se démentit pas un instant durant
quarante et une années. A force de prudence et de courage, elle sauva son
époux proscrit par les triumvirs et poursuivi par la haine implacable de
Lépide. Puis, voyant leur union demeurer stérile, elle parla de divorce : Tu moffris de céder cette maison vide à une épouse féconde,
de me préparer toi-même une compagne dont les enfants seraient devenus les
tiens. Tu voulais laisser tes biens à ma disposition, prête à me rendre, si jacceptais,
les soins dune sur ou dune belle-mère affectueuse. Voilà une
forme nouvelle du divorce que Martial ne nous montre pas. On a dit que les
anciens navaient connu que lamour brutal ; cest encore une opinion à
changer. La mère de Pertinax ne voulant pas quitter son fils, alors simple
préfet de la flotte, le suivit jusque sur les côtes brumeuses et froides de
la mer du Nord, où elle mourut victime de son amour maternel[188] ; une autre
quitta sa chaude province dAfrique pour accompagner son fils, soldat ou
officier de marine, jusquau fond de lArmorique[189]. Mais ce serait
faire injure à la nature humaine, de chercher des preuves de laffection
filiale ou paternelle ; elle est de tous les temps. Jaime mieux faire
remarquer que les tables alimentaires de Velleia fournissent peut-être une
confirmation des paroles de Tacite touchant la sévérité des murs
provinciales. Sur trois cents enfants secourus, on ny compte que deux spurii. Ces enfants naturels
participaient-ils au secours alimentaire par leffet dune faveur spéciale ?
Rien noblige à le croire. Mais sil ne sen trouvait pas davantage parmi les
pauvres de trois cantons, ne faudrait-il pas admettre que, au moins dans les
campagnes, les murs des contemporains de Trajan valaient les nôtres[190] ?
Ces sentiments, ces faits, sont dailleurs en complet
accord avec les prescriptions de la loi et avec les conseils des philosophes
qui font de lépouse légale du mari. Musonius, Plutarque, entre autres,
glorifient le mariage ; ils veulent des familles
nombreuses qui donnent à lÉtat des citoyens utiles, au monde des créatures
capables de comprendre lharmonieuse sagesse de ses lois, à Dieu de fidèles
serviteurs de ses temples, et la conscience publique avait accepté
ces doctrines.

VII. ADOUCISSEMENT DES MURS.
Les chapitres de la famille et de la cité ont déjà montré
combien les murs sétaient adoucies au sein de cette grande communauté de lempire.
Bien dautres faits fortifieraient cette démonstration. En voici
quelques-uns. A Fidènes, le cirque sécroule, et cinquante mille personnes,
dit-on, sont tuées ou blessées. En faisant ce triste récit, Tacite saisit loccasion
dopposer le spectacle de Rome républicaine soignant les blessés de ses
grandes batailles, à celui de la
Rome impériale relevant les blessés du cirque[191]. Cependant il
est forcé de nous laisser voir aussi la foule accourant de Rome pour relever
les victimes, les maisons des grands qui souvrent pour les recevoir, les
médecins quon appelle, les secours quon organise, en un mot, un généreux
mouvement de compassion publique pour adoucir les souffrances des pauvres
gens. Nous sommes justement très fiers de nos souscriptions nationales qui
réparent les suites de quelque fléau. Cette coutume était habituelle dans lempire.
Aristide raconte que le désastre de Smyrne, renversée par un tremblement de
terre, parut dans toute la province dAsie un malheur public. Les villes se
cotisèrent pour envoyer, par terre et par nier, aux habitants restés sur les
ruines de leur patrie, ce qui leur manquait. Les autres furent reçus dans les
cités ; on allait au-devant deux avec des vivres, des chariots, et lon fit
partout des quêtes pour les aider[192]. La Campanie agit
certainement de même après léruption du Vésuve en 79, et Lyon ne fut pas la
seule ville provinciale qui, au temps de Néron, aida Rome à se rebâtir[193]. Les historiens
ne recueillaient point alors les faits de ce genre. Cependant nous en
connaissons assez pour comprendre que les recommandations faites aux
gouverneurs de province en faveur des pauvres nétaient pas, dans cette
société, une anomalie discordante.
On a trouvé fort touchant que certaines lois barbares ne
fissent pas un crime à la femme grosse de prendre le long de son chemin des
fruits dans un verger. Les jurisconsultes romains, quon se représente
volontiers avec le dur visage de la Justice implacable, nont pas de ces délicatesses.
Cependant, pour constituer un vol, ils veulent quil y ait eu intention de
voler[194].
De sorte que des canonistes ont pu, au moyen âge, se croire autorisés par
certains textes juridiques à dire quune chose prise par nécessité nétait
point une chose volée ; et cette doctrine devint celle de lÉglise.
Le fou furieux nest pas encore à leurs yeux un malade quon
essayera de guérir ; mais il nest pas non plus ce quil resta chez nous
jusquen 1739, un condamné du ciel. Ils ne veulent pas que lenfant et le
fou, qui ont accompli un meurtre, tombent sous le coup de la loi. Lun, disent-ils, est
protégé par son innocence, lautre par le malheur de sa destinée[195]. Dans un accès
de fureur, un Mius Priscus avait tué sa mère. Marc-Aurèle écrivit au juge : Il est assez puni par sa démence[196].
Daprès la discipline catholique, lexcommunié ne peut
entrer dans léglise, ni son corps être reçu au cimetière béni. Lempereur,
qui était en même temps le souverain pontife, permettait aux proscrits de
quitter le lieu de leur exil, dans les Cyclades, pour aller prendre part aux
fêtes religieuses des grandes villes de la côte asiatique[197], et il laissait
les chrétiens ensevelir leurs morts où bon leur semblait[198].
Enfin, la philosophie avait ruiné le principe de lesclavage,
en développant cette vérité, devenue banale dans le monde romain, que la
nature a fait les hommes égaux et que la servitude légale nest quun malheur[199]. Tous les
arguments employés de nos jours contre lesclavage sont dans les livres de
Sénèque, dÉpictète et de Dion Chrysostome. Au quatorzième siècle, les
insurgés dAngleterre demandaient aux pauvres gens : Quand Adam bêchait, quand Ève filait, où donc était le
gentilhomme ? Bien longtemps avant eux, Sénèque le père avait dit
: Cherchez les aïeux dun noble, vous trouverez
un homme de rien[200]. On saperçoit
des progrès faits par la nouvelle doctrine en voyant ce quétait devenu linstrumentum vocale de Caton. Sauf son vice
originel, lesclavage se rapprochait beaucoup de notre domesticité, et, bien
souvent, entre le maître et le serviteur, il se trouvait plus de confiance et
daffection quil nen existe aujourdhui. Quelle amitié tendre Cicéron navait-il
pas pour son esclave Tiron, Pline pour sa nourrice ! Ceux des esclaves que
leur service plaçait habituellement auprès du maître faisaient comme partie
de la famille. a Je vous avouerai, dit Pline, ma douceur pour mes gens, dautant
plus franchement que je sais avec quelle bonté vous traitez les vôtres. Jai
toujours dans lesprit ces mots dHomère : Il
était pour eux le meilleur des pères, et le nom que le maître a
porté chez nous : pater familias. Et
il raconte que son affranchi Zosime, ayant craché le sang pour avoir forcé sa
voix en déclamant, il lavait envoyé une première fois se rétablir en Égypte.
Mais cette toux est revenue, et je vous ai
souvent entendu dire que, à votre terre du Frioul, lair est très sain et le
lait excellent pour ces sortes de maladies. Je vous supplie décrire à vos
gens de recevoir mon affranchi dans votre maison, en lui donnant tout ce qui
lui sera nécessaire. Je ferai les frais du voyage[201]. Et un autre
jour : La maladie de mes esclaves et la mort
de quelques-uns mont accablé de tristesse[202]. Il leur
permettait de faire un testament, bien quun esclave neût pas le droit de
tester, et il exécutait religieusement leurs dernières volontés : Mes gens laissent ce quils ont à qui ils veulent, pourvu
que ce soit à quelquun de la maison, car la maison est la patrie, la cité de
lesclave. Un proconsul entre, en passant, chez Fabatus, qui
profite de la présence du magistrat pour affranchir plusieurs esclaves. Pline
len félicite et sen réjouit : Unice lætor, car je désire que notre ville saccroisse de tous les
biens, et le plus grand est le nombre des citoyens. Pour parler
ainsi, il fallait que lui, Fabatus, et tout le monde alors regardât lesclavage
comme la source où le peuple pouvait se recruter sans péril, parce que les maîtres
avaient le devoir de préparer, par la discipline et léducation, les citoyens
nouveaux qui augmenteraient la beauté et la force
de la cité[203].
Bien des gens pensaient comme Pline : il ny avait point
de testament qui ne donnât la liberté à quelques esclaves, à ce point que la
loi dut, restreindre le nombre des affranchis testamentaires. On a vu lacte
de dernière volonté du consulaire Dasumius et comme il sétait occupé dassurer
lavenir de ses affranchis. Les paroles ne valent pas celles de Pline, mais
les sentiments sont les mêmes, et on en retrouve danalogues dan, dautres testaments
récemment découverts[204]. Songez aussi
au rôle habituel de laffranchi : lhomme de confiance de son patron, le
dépositaire de ses secrets, lexécuteur de ses desseins, lagent fidèle et
résolu, pour le bien ou pour le mal, de toutes ses volontés.
Un dernier mot : les témoignages publics de laffection des
esclaves envers leurs maîtres, des affranchis envers leurs patrons, et
réciproquement, sont si nombreux dans les inscriptions, quon en a formé des
recueils considérables[205], où la vérité nest
pas altérée par le faste dune douleur de commande. Pourrions-nous en faire
autant ?
Quelle sera la conclusion de ce chapitre ? Que Juvénal a
tort et que Pline a raison ? Non. Lun était un honnête homme, ne connaissant
que dhonnêtes gens ; lautre un poste qui, pour attirer lattention dun
public lassé de fades poésies, forçait la voix de sa muse et lui donnait un
visage farouche. Où est la vérité ? Des deux côtés. La société romaine
ressemblait à toutes celles qui atteignent à titi haut degré de culture desprit
et de richesse. Elle avait des vices honteux et de grandes vertus ; des
hommes de débauche et des hommes de continence ; des Messalines et des femmes
unies pour la vie et la mort à leur époux ; des bourreaux dargent et des
familles rangées qui administraient sagement leur fortune ; des maîtres
débonnaires et dautres qui, sans les lois nouvelles, auraient volontiers
traité leurs esclaves à la mode ancienne.
Beaucoup décrivains ont passé, sans les voir, à côté de
ces vertus domestiques : ceux-ci, parce quil leur a semblé plus agréable de
suivre les romanciers et les postes partout où ils nous conduisent, fût-ce en
de mauvais lieux ; ceux-là, parce que, de parti pris, ils entendent que cette
grande société romaine soit considérée comme légout de lunivers.
Il est tout naturel quayant eu ses mortels ennemis pour
héritiers, cette société ait été, depuis quinze siècles, représentée sous de
sombres couleurs, dautant plus quavec les facilités que donnaient ait
prince le despotisme, à tous lesclavage et la religion, les anciens avaient
pour le désordre une indulgence que, fort heureusement, nous ne connaissons
pas. Ce que nous cachons, ils le laissaient voir. Or cest déjà une demi
vertu de cacher ses vices, puisque cest la honte en plus et lexemple en
moins. Les apparences sont pour nous ; notre fond même est certainement
meilleur. Mais devons-nous en concevoir un orgueil tel, que nous nayons que
du mépris pour ceux qui nous ont précédés de si loin dans la vie ? On vient
de voir que la dépravation morale était le fait du petit nombre, il ne faut
donc pas laccuser de la chute de lempire. Dailleurs, quelque pénible quen
soit laveu, ce ne sont pas les murs privées, si lon prend ce mot au sens
restreint, qui sauvent ou qui perdent les États. Lorsque le désordre ne va
pas jusquà hébéter lesprit, il na point sur la vie extérieure linfluence
quon lui prête. Même dans lâme des débauchés, il reste des ressorts qui
peuvent les relever de leur dégradation. Combien nen a-t-on pas vu se
conduire eu héros, que defféminés ont su bravement mourir ! Cardons notre
respect et nos hommages pour ceux dont lexistence est irréprochable ; mais,
quand nous cherchons les causes de la décadence ou de la grandeur dun
peuple, étudions surtout ses moins publiques et ses institutions.
Tout peuple a sa part de vices[206], parce que le
vice est une déviation mauvaise dune chose excellente, la passion contenue,
qui est le principe actif de la vie, et partout lon trouve des monstruosités
morales, des hommes nés pour les sales débauches ou pour le crime, qui,
véritablement, ne sont que bêtes à deux pieds. De tout cela lempire eut sa
large part. Ce qui lui manqua, ce ne fut pas la justice dans la loi, lintelligence
dans les hommes, la discipline dans les familles, lordre dans les cités, ce
fut le caractère, et il lui manqua parce que, dans cette société, il ny eut
pas ce qui fait la dignité de lhomme, la liberté. Mais la nature humaine y
conservait ses droits ; elle sy montrait par les sentiments, même jusquà un
certain point par les murs, et nulle part dans lunivers alors connu on ne
travaillait, on ne pensait davantage. Quand seront apaisées les haines
religieuses, qui de nos jours se sont doublées des haines politiques, on
conviendra que nous devons quelque reconnaissance à cette Rome impériale qui,
après la Grèce, a été pour le monde la mère de toute vie
policée.
|