|
I. — NERVA (19 SEPTEMBRE 96-28 JANVIER 98)[2].
Dix empereurs se sont partagés les quatre-vingt-deux
années écoulées entre l’avènement de Tibère et celui de Nerva. Cinq
provenaient de l’hérédité, cinq de l’élection des soldats : l’une donnait,
par exemple, Caligula et Néron ; l’autre, Claude et Vitellius. D’après leurs
résultats, les deux systèmes se valaient.
C’est qu’ils différaient seulement par les apparences. Qu’Othon
achetât l’empire aux prétoriens ou que Domitien héritât de son frère, il
importait peu. Le prince, de quelque façon qu’il le fut devenu, était maître
sans partage, dans un pays qui n’avait cependant pas supprimé toute trace de
ses institutions libres, et dans un temps où l’on se souvenait encore du
peuple, du sénat, des comices avec leurs magistrats annuels et responsables.
Ainsi la forme du pouvoir était en contradiction avec les mœurs et les
traditions, deux grandes forces qui veulent être ménagées ; mais elle
paraissait d’accord avec une autre puissance dont il faut tenir compte : les
intérêts, car partout régnait un immense besoin de paix et d’ordre publie.
Il y avait donc, pour cette société, deux questions très différentes
l’une, politique, qui se débattait à Rome et malheureusement aussi dans les
camps, le plus souvent au milieu de péripéties sanglantes : celle de l’avènement,
du maintien ou de la chute du maître ; l’autre, économique, qui était le seul
souci des provinciaux : la paix sans concussions ni violences, la sûreté des
routes et l’activité du commerce, sans impôts trop lourds.
Auguste et Vespasien avaient satisfait à ce double besoin
; sous eux Rome avait été tranquille, la loi de majesté oubliée, le licteur
sans emploi, et il y avait eu : à l’armée, de la discipline ; dans les
provinces, du bien-être ; dans l’État, les formes extérieures de la liberté ;
mais ces biens provenaient de la sagesse de deux hommes, non des
institutions, et ils passèrent comme eux.
 Nerva commence une période toute différente. Cinq princes
régneront avec honneur durant quatre-vingt-cinq années, et aucun ne tombera
sous le poignard. Est-ce donc que vont s’établir enfin ces institutions que
nous montrions au chapitre LXXI de cet ouvrage, comme le moyen de concilier l’unité
de commandement, indispensable à l’empire, avec la participation régulière
des provinces au gouvernement de l’État, pour prévenir les soubresauts
violents des révolutions ? Ou va-t-il seulement se produire, par la vertu d’un
premier choix heureux, une succession inattendue d’hommes supérieurs ?
Commode et Caracalla recommenceront Néron et Domitien, comme si les Antonins
n’avaient pas tenu, durant près d’un siècle, le monde dans leurs mains. Et pourtant
ces princes étaient les derniers qui auraient pu sauver l’empire, en faisant
concorder harmonieusement ses mœurs et ses souvenirs, ses besoins et ses
institutions. Mais s’ils eurent une volonté honnête et le sentiment de leurs
devoirs en tant que chefs d’État, on ne leur trouve pas plus qu’à leurs
prédécesseurs le véritable esprit politique, car ils accélérèrent le
mouvement de concentration qui finira par détruire toutes les libertés
municipales, et, avec des formes meilleures, ils continuèrent ce pouvoir,
sans limites comme sans contrôle, qui devait perdre l’empire en ensevelissant
sous ses ruines la civilisation du monde. Nerva commence une période toute différente. Cinq princes
régneront avec honneur durant quatre-vingt-cinq années, et aucun ne tombera
sous le poignard. Est-ce donc que vont s’établir enfin ces institutions que
nous montrions au chapitre LXXI de cet ouvrage, comme le moyen de concilier l’unité
de commandement, indispensable à l’empire, avec la participation régulière
des provinces au gouvernement de l’État, pour prévenir les soubresauts
violents des révolutions ? Ou va-t-il seulement se produire, par la vertu d’un
premier choix heureux, une succession inattendue d’hommes supérieurs ?
Commode et Caracalla recommenceront Néron et Domitien, comme si les Antonins
n’avaient pas tenu, durant près d’un siècle, le monde dans leurs mains. Et pourtant
ces princes étaient les derniers qui auraient pu sauver l’empire, en faisant
concorder harmonieusement ses mœurs et ses souvenirs, ses besoins et ses
institutions. Mais s’ils eurent une volonté honnête et le sentiment de leurs
devoirs en tant que chefs d’État, on ne leur trouve pas plus qu’à leurs
prédécesseurs le véritable esprit politique, car ils accélérèrent le
mouvement de concentration qui finira par détruire toutes les libertés
municipales, et, avec des formes meilleures, ils continuèrent ce pouvoir,
sans limites comme sans contrôle, qui devait perdre l’empire en ensevelissant
sous ses ruines la civilisation du monde.
Cependant il faut reconnaître aux Antonins un plan général
de conduite dont Trajan sera l’expression la plus complète. Éclairés par tant
de catastrophes, ils vont entourer d’égards la nouvelle aristocratie que
Vespasien a formée et dont les membres remplissent, à ce moment, toutes les
hautes charges de l’État. Sans rendre aux grands le pouvoir, ils paraîtront
gouverner avec eux et pour eux[3]. Ils feront des
patriciens afin de tenir cette noblesse au complet, et, pour en finir avec le
Brutus républicain, Marc-Aurèle, au lieu de proscrire sa mémoire, vantera le
neveu de Caton comme le plus parfait modèle de la vertu romaine. Cela suffira
pour des ambitions devenues modestes ; l’aristocratie, qui était, contre les
Césars, même encore contre les Flaviens, en conspiration permanente, ne
formera plus que de rares complots dont pas un ne réussira ; et le sénat, qui
croit avoir recouvré à jamais le droit de nommer le magistrat suprême de la
république, fera frapper des médailles avec cette légende : Libertas restituta
; tandis que Pline célébrera la
Liberté rendue[4].
Le complot dont Domitien venait d’être la victime avait de
nombreuses ramifications. Il y parut bien aussitôt le coup fait ; cette fois,
tout était préparé : les Pères proclamèrent un vieillard d’une famille trois
ou quatre fois consulaire, Marcus Cocceius Nerva, qui lui-même avait reçu les
honneurs du triomphe[5].
Le choix était singulier. Homme de bien, lettré, de mœurs
douces, même faciles, Nerva, malgré ses deus consulats, ne s’était signalé ni
par de grands talents ni par d’éminents services, et rien n’avait pu appeler
sur lui cette préférence, à moins que ce ne fussent ses soixante-cinq ans[6], son mauvais
estomac et sa santé chancelante, qui donnaient aux ambitieux le temps de se
préparer, sans leur faire craindre une trop longue attente.
Les prétoriens murmuraient, ne sachant trop comment allait
tourner une révolution qu’ils n’avaient point faite et qui renversait le prince
auquel ils devaient une grande augmentation de solde. Nerva se rendit dans
leur camp, et la promesse d’un donativum
parut les apaiser. Quant aux légions des frontières, indifférentes au choix
du maître, mais très sensibles à la libéralité du prince, elles ne paraissent
pas avoir chancelé dans une fidélité que rien ni personne ne tentait[7].
Au sénat, on demanda le rappel des bannis avec restitution
des biens dont le fisc n’avait pas encore disposé, ce qui ne fit point
difficulté ; on voulait aussi le châtiment des délateurs, et une réaction
violente les menaça[8]. Plusieurs furent
exécutés, entre autres le philosophe Sevas
: ceux-là étaient de petites gens ; mais de plus redoutables siégeaient au
sénat. Nous avons une lettre où Pline raconte comment il attaqua un consul
désigné, celui qui avait mis la main sur Helvidius pour l’arracher de la
curie et le jeter aux licteurs. Nerva, timide et doux, modéra cette réaction
; il se contenta d’ôter le consulat au coupable, et jura que tant qu’il vivrait
aucun sénateur ne serait puni de mort : serment que tous les Antonins
répéteront. Il interdit les procès de majesté, l’accusation de judaïsme[9], et menaça de
peines sévères les délateurs dont l’accusation ne serait pas prouvée[10]. Le despotisme
relâche les liens sociaux en violant dans son intérêt la discipline des
ordres et des familles ; Nerva, pour la raffermir, punit de mort les esclaves
qui sous Domitien avaient trahi leur maître, les affranchis qui avaient trahi
leur patron ; et il renouvela la défense de recevoir leurs témoignages contre
ceux envers qui la loi leur imposait une respectueuse fidélité ou l’obéissance.
Ces édits ne rassurèrent pourtant pas le père d’Hérode
Atticus : il trouve dans une vieille maison d’Athènes un riche trésor, s’en effraye,
et, pour prévenir les délateurs qu’il continue à craindre, se hâte de révéler
au prince sa découverte, en lui demandant ce qu’il doit faire de cet or : Uses-en, répond Nerva. Atticus, peu rassuré par
des paroles si contraires à l’usage impérial, écrit de nouveau : Mais il y en a trop pour moi. — Eh bien, abuses-en. Le débonnaire empereur qui,
dans son élévation, ne voyait tin coup
de la Fortune,
respectait, pour les autres, les arrêts de la déesse qui lui avait été
favorable[11].
Domitien avait si bien épuisé le trésor, que Nerva
suspendit d’abord les jeux et les distributions, mesure dont il s’effraya
bientôt : l’année n’était pas révolue qu’il rétablissait les frumentationes[12]. Il laissa aussi
revenir les mimes, toutefois en diminuant la dépense des jeux, et il essaya
de rendre les combats de l’amphithéâtre moins meurtriers[13]. La fondation de
trois colonies en faveur de citoyens pauvres fut un soulagement pour quelques
misères[14],
et une pensée à la fois politique et charitable se trahit dans une institution
de l’année fil, que Trajan et ses successeurs développèrent : l’assistance de
l’État accordée aux enfants des familles indigentes[15]. Une de ses
médailles le montre assis sur la chaise curule et tendant la main, comme pour
les secourir, à un jeune garçon et à une jeune fille près desquels se tient
leur mère avec cette légende Tutela Italiæ[16]. Une autre
rappelle qu’il supprima pour l’Italie l’obligation imposée aux villes de subvenir
aux frais de la poste impériale.
Dion (LXVIII,
2) a bien vu cette
politique, et ses paroles sont à noter : Nerva,
dit-il, ne fit rien sans la participation des
grands. Sera-ce, comme on l’a cru, une forme nouvelle de
gouvernement ? C’est la tradition d’Auguste que ces princes vont reprendre,
et la condition générale de l’empire n’en sera pas modifiée.
Un Crassus, se disant de la famille du triumvir, conspira
cependant contre ce prince qui ne voulait être que le premier des sénateurs
et le père bien plus que le maître de l’empire ; Nerva se contenta de l’exiler
à Tarente. Un préfet du prétoire poussa les gardes à exiger la mort des
meurtriers de Domitien. Nerva, fort effrayé, trembla au lieu d’agir ; il
implora la grâce de ceux que les prétoriens condamnaient, s’offrit à leur
place en victime, sans pouvoir les sauver, et, le meurtre accompli, justifia
la soldatesque en imputant cette violence à un excès de respect pour le
serment militaire prêté au fils de Vespasien. Il s’humilia jusqu’à la
remercier devant le peuple d’avoir puni les plus méchants des hommes.
Cette mutinerie était de mauvais augure : Nerva n’avait
évidemment pas la main assez forte pour gouverner. L’histoire est trop
disposée à demander à un prince et à glorifier en lui cette bonté banale qui
cède à toutes les supplications. Ne se pourrait-il pas qu’il en ait été du gouvernement
de Titus et de Nerva, comme il en fut chez nous de la régence d’Anne d’Autriche
? Alors chacun tirait à soi et agissait à sa guise ; le pouvoir et le trésor
étaient au pillage ; mais il n’y avait qu’un mot dans toutes les
bouches : La reine est si bonne !
Prenons garde aussi que quelques-uns des bons empereurs n’aient été ceux qui
se montraient faciles à tous et sur tout ; quelques-uns des mauvais, ceux
qui, comme le damné cardinal,
voulaient de l’ordre et de l’obéissance sans intrigues ni complots. Un soir
que Mauricus, un banni de Domitien, soupait avec Nerva, la conversation tomba
sur un des plus odieux délateurs du dernier règne. S’il vivait encore, demanda le prince, que ferait-il à présent ? — Il souperait avec nous, répondit Mauricus[17]. Le consul Fronto
disait aussi en présence même de Nerva : C’est un
grand malheur de vivre sous un régime où tout est défendu ; mais c’en est un
non moins grand de vivre sous un prince avec qui tout est permis[18] ; et Pline
ajoutait : L’empire s’écroule sur l’empereur[19]. Ils avaient
raison : l’autorité qui vacille et hésite à user de ses droits légitimes
laisse tout se relâcher et tombe. Le gouvernement, quels qu’en soient le nom
et la forme, doit avoir pour devise : Sub lege imperium. La
loi commande, imperat, et le pouvoir
chargé de la faire exécuter doit commander comme elle, sans défaillance ;
sinon le respect même de la loi se perd, et alors tout est perdu.
A vrai dire, Nerva ne fit qu’une chose, mais elle suffit à
sa renommée : il adopta Trajan. La violence des prétoriens, quelques troubles
sur le Danube et sur le Rhin, le décidèrent, en octobre 97, à prendre un
collègue, et, sur les indications de Licinius Sura[20], il choisit le
plus habile de ses généraux, afin de rétablir la
discipline ébranlée et de donner à la république un prince qu’aucune
contrainte ne ferait céder[21]. Des lauriers
arrivaient de la Pannonie[22]. Nerva vint les
déposer au Capitole, sur les genoux de Jupiter ; et prenant à témoin les
dieux et les hommes, il déclara qu’il adoptait
Trajan pour fils[23].

II. — TRAJAN (98-117) ; GUERRE
DACIQUE.
 L’Espagne avait déjà envoyé à Rome toute une colonie de
lettrés, de savants, de poètes et de philosophes[24] ; elle allait
lui donner encore son premier empereur provincial[25]. Trajan (M. Ulpius Trajanus) était né, le 48
septembre 52, à Italica, sur le Bætis, un des plus anciens établissements d’outre-mer,
puisque Scipion l’Africain l’avait fondé durant la seconde guerre Punique. Il
avait fait ses premières armes sous son père, officier de mérite, chai avait
obtenu tous les honneurs militaires et civils : le consulta, le gouvernement
de Syrie, les ornements du triomphe, enfin, en 79, le proconsulat de la
province d’Asie. Il servit dix ans comme tribun militaire en Syrie et sur le
Rhin, fut préteur vers 85, commandant d’une légion en Espagne, consul en 91,
puis gouverneur de la haute Germanie[26] ; il était
brave, habile, populaire dans l’armée, malgré sa fermeté, parce que, s’il
maintenait une discipline sévère, elle était toujours juste. Au camp, il
vivait sans luxe ni mollesse, au besoin de privations, et se mêlait à tous
les exercices ; en campagne, il laissait ses chevaux aux bagages pour marcher
en tête des troupes, partageant leurs fatigues et rentrant le dernier sous la
tente. Enfin, il avait cette faculté des grands généraux, pleine de séduction
pour le soldat, de pouvoir appeler par leur nom jusqu’au dernier de ses
officiers et de ceux qui avaient reçu une blessure ou des récompenses. Aussi,
à la nouvelle de son élévation, toutes les armées lui envoyèrent des félicitations,
dont on ne peut cette fois suspecter la sincérité, parce que ce choix
inattendu était pour elles un honneur et pour les chefs militaires une
espérance. L’Espagne avait déjà envoyé à Rome toute une colonie de
lettrés, de savants, de poètes et de philosophes[24] ; elle allait
lui donner encore son premier empereur provincial[25]. Trajan (M. Ulpius Trajanus) était né, le 48
septembre 52, à Italica, sur le Bætis, un des plus anciens établissements d’outre-mer,
puisque Scipion l’Africain l’avait fondé durant la seconde guerre Punique. Il
avait fait ses premières armes sous son père, officier de mérite, chai avait
obtenu tous les honneurs militaires et civils : le consulta, le gouvernement
de Syrie, les ornements du triomphe, enfin, en 79, le proconsulat de la
province d’Asie. Il servit dix ans comme tribun militaire en Syrie et sur le
Rhin, fut préteur vers 85, commandant d’une légion en Espagne, consul en 91,
puis gouverneur de la haute Germanie[26] ; il était
brave, habile, populaire dans l’armée, malgré sa fermeté, parce que, s’il
maintenait une discipline sévère, elle était toujours juste. Au camp, il
vivait sans luxe ni mollesse, au besoin de privations, et se mêlait à tous
les exercices ; en campagne, il laissait ses chevaux aux bagages pour marcher
en tête des troupes, partageant leurs fatigues et rentrant le dernier sous la
tente. Enfin, il avait cette faculté des grands généraux, pleine de séduction
pour le soldat, de pouvoir appeler par leur nom jusqu’au dernier de ses
officiers et de ceux qui avaient reçu une blessure ou des récompenses. Aussi,
à la nouvelle de son élévation, toutes les armées lui envoyèrent des félicitations,
dont on ne peut cette fois suspecter la sincérité, parce que ce choix
inattendu était pour elles un honneur et pour les chefs militaires une
espérance.
Trois mois après, Trajan reçut à Cologne les envoyés du
sénat qui lui apportèrent la nouvelle de la mort de l’empereur ; il répondit
par une lettre à la fois modeste et digne, où il renouvelait l’engagement
pris par son père adoptif de ne frapper jamais un sénateur de la peine
capitale[27]
: promesse étrange que les règnes précédents expliquent, et qui d’ailleurs
annonçait que le nouveau prince, comme Nerva, porterait le gouvernement du
palais à la curie. Il était alors dans sa quarante-sixième année.
En preuve de sa confiance dans le sénat, il laissa même
cette assemblée et les consuls gouverner Rome et l’empire, tandis qu’il
demeurait sur le Rhin pour y achever les grands travaux ordonnés par
Domitien. Il semble que, pris déjà du désir de rendre leur éclat aux armes
romaines, et ne voyant rien d’important à faire sur cette frontière, il ait
voulu y constituer une défensive inexpugnable, pour n’avoir pas à craindre
une diversion de ce côté, lorsqu’il serait occupé ailleurs[28]. Les détails
nous manquent sur ces travaux, mais nous sommes assurés qu’il avait bien
employé les trois années de son commandement comme gouverneur ; qu’il employa
mieux encore la quatrième, celle de son adoption, et que ses successeurs
eurent sans doute plutôt à entretenir qu’à continuer l’immense retranchement
des terres Décumates. En arrière de cette ligne de défense, il avait établi
de nombreux postes militaires qui devaient en augmenter la force[29] ; au nord, pour
remplacer, sur la rive gauche du fleuve, le camp ruiné de Vetera Castra, il avait bâti Colonia Trajana (Kelln ou Clèves), dont la garnison commandait
le cours inférieur du Rhin ; au sud, il fonda Aquæ
(Baden-Baden),
à portée des défilés du Schwarzwald ; au centre, à Mayence, en face de la
grande entrée de Gaule en Germanie, il jeta sur le Rhin un pont permanent, qu’une
bonne route de 10.000 pas reliait à une forteresse construite vers Hochst, à
l’embouchure de la Nidda
dans le Mein, et que trois siècles plus tard Julien fut heureux de retrouver
pour s’y retrancher contre les Alamans[30]. Peut-être
faut-il aussi placer à ce moment l’expédition de Vestricius Spurinna, légat
de la basse Germanie, qui, sans combat, alla rétablir un roi des Bructères
dans ses États[31].
Tacite, avec l’exagération qui lui est habituelle, nous avait montré ce
peuple comme anéanti[32]. Après sa
défaite, des Chamaves, des Angrivariens s’étant établis en grand nombre sur
sols territoire, les Romains trouvèrent ce voisinage dangereux et aidèrent
les restes des Bructères à se reconstituer sous un roi national que sa
faiblesse maintiendrait dans leur dépendance. Ainsi, sur le Rhin inférieur,
la sécurité était assurée et l’influence de Rome rayonnait jusqu’au Weser[33].
Des bords du Rhin, Trajan avait annoncé à tout l’empire,
par un acte de fermeté, le commencement d’une administration virile. Nerva
lui avait envoyé son anneau et ce vers d’Homère :
Τίσειαν
Δαναοί έμά δάxρυα
σοϊσι
Βέλεσσιν[34].
Que tes flèches, ô Apollon ! Fassent
expier mes larmes aux fils de Danaos. Ces fils de Danaos étaient,
pour le faible vieillard, les auteurs de la dernière sédition. Trajan les
manda près de lui, et les uns furent dégradés, les autres bannis ou punis de
mort. Tout le monde comprit qu’il faudrait désormais obéir ; mais on sut
bientôt que ce serait l’obéissance à la loi, et non pas à un maître
capricieux ou cruel.
Ce long séjour sur la frontière marquait bien peu d’empressement
à courir aux pompes de Rome. Mais dans une monarchie militaire cette conduite
était très politique, et elle acheva certainement de gagner à Trajan la cour
des soldats de toutes les légions. Lorsqu’il partit enfin pour sa capitale,
dans la seconde moitié de l’année 99, les légionnaires de son escorte ne
donnèrent lieu, le long du chemin, à aucune plainte : on eût dit la suite
modeste d’un général. Cette modération était de bon goût et de bon augure ;
mais lorsqu’il fait afficher, en regard l’un de l’autre, le compte de ses
dépenses durant cette route, et celui d’un voyage de Domitien, je le trouve peu
généreux envers un mort qui avait préparé sa fortune par les honneurs et les
commandements dont il l’avait revêtu[35]. A Rome, pour
son arrivée, point de pompe ni d’appareil, seulement l’immense concours du
peuple, contemplant avec un étonnement joyeux cet empereur qui faisait à pied
sa première entrée dans sa capitale, ce soldat vieilli dans les camps et affable
envers les citoyens, ce vaillant capitaine, à la taille haute, à l’air
martial, qui témoignait de son respect pour le mérite civil et pour l’âge. L’impératrice
plaine, femme de mœurs sévères[36], dont les Grecs
firent, bien à tort, une nouvelle Vénus, Άφροδίτη
θεά νεωτέρα[37], ne voulait pas
plus de cérémonial autour d’elle ; en montant les marches du palais, elle se
retourna sers la foule pour dire : Telle j’entre
ici, telle j’en veux sortir ; et elle tint parole. Nerva avait
écrit sur la demeure impériale : Palais public, et comme
au temps d’Auguste, tous les citoyens y étaient admis. Trajan fit de même une
vieille coutume voulait d’ailleurs que la porte du souverain pontife ne fût
jamais fermée. Il ordonna de porter dans les temples, qui servaient alors de
musées, les joyaux et les raretés qui décoraient le palais. Ce qui brillait dans la demeure du prince, dit
Martial[38],
est donné aux dieux, tout le monde le verra.
On lui reprochait de diminuer le respect dû aux princes, en permettant trop
de familiarité ; il répondit : Je serai avec les
autres comme j’aurais voulu, quand j’étais simple particulier, que les
empereurs fussent avec moi. Dans la prière adressée annuellement
aux dieux pour la prolongation de son règne, il fit ajouter la clause : Tant qu’il le méritera ; et dans les actes
publics, il se nomma après le sénat et le peuple[39]. A l’exemple d’Auguste,
il visitait familièrement ses anciens amis, assistait à leurs fêtes de
famille et prenait sa part de leurs plaisirs, soupant, se promenant ou
chassant avec eux. Un jour, on voulut lui inspirer des soupçons contre un
sénateur ; il alla, sans gardes, dîner chez lui, et le lendemain dit aux
accusateurs : S’il eût voulu me tuer, il l’eût
fait hier.
Les Césars et les Flaviens, à l’exception du chef de la
seconde race, étaient tous lettrés, orateurs ou poètes, avec plus ou moins de
succès ; tous du moins avaient essayé d’écrire. Trajan, qui fit sa première
campagne à quatorze ans, put échapper à la funeste éducation de l’époque, à
ces rhéteurs qui corrompaient le goût de leurs élèves et parfois leur bon
seras. Il eut l’expérience des affaires et de la vie si nécessaire pour
former des hommes de commandement ; et, comme il avait l’esprit droit, le cœur
honnête, il ne montra pas de basse jalousie contre ceux qui possédaient les
dons que la nature ou les circonstances lui avaient refusés[40]. Dans la
déférence de ce vaillant homme de guerre pour le sénat se trouvait certainement
une pensée politique[41] ; il me semble y
voir aussi le respect involontaire du rude soldat tombé sous le charme des
élégances patriciennes.
Cette conduite d’un prince qui semblait concilier deux choses jusqu’alors contraires : le pouvoir
et la liberté[42], lui gagnait les
Pères, tout autant que soir serment, renouvelé à Rome, de n’en point mettre
un seul à mort. En garantie de cette promesse, il fit saisir ce qui vivait
encore de délateurs tarés, les livra, dans l’amphithéâtre, aux moqueries et
aux insultes, puis les relégua dans les îles. Plusieurs mesures utiles dont
il sera question plus loin, un zèle ardent pour le bien public et des égards
envers les vieilles familles[43], des faveurs qu’il
accorda à la jeune noblesse[44], surtout l’habitude
qu’il prit et qu’il garda de laisser le sénat beaucoup parler[45] et quelque peu
agir, lui assurèrent l’affection de la haute assemblée, qui, vers la fin du règne,
témoigna sa gratitude en lui décernant le titre d’Optimus,
qu’on ne donnait qu’à Jupiter.
Quant au peuple, qui, dans la monarchie impériale, n’a
joué, quoi qu’on en ait dit, qu’un rôle de comparse, sans intervenir jamais
dans la politique, content du congiaire obtenu, de l’air martial de son
nouveau maître, il était séduit par cette nouveauté d’un prince citoyen, qui
allait à pied dans les rues au milieu de la foule, quelquefois eu litière
avec ses amis, et pas toujours à la première place. D’ailleurs il voyait
derrière Trajan des légions dévouées ; celles-ci, en effet, à qui il ne
déplait pas de sentir qu’une main ferme les conduit, avaient, sans un murmure,
accepte : du nouvel empereur la moitié du donativum
ordinaire, et de ce général dans la force de l’âge elles attendaient des
campagnes, des victoires, du butin.
Enfin, s’écrie
Pline, au lieu d’être éclipsée par le prince, la noblesse
reçoit de lui un nouvel éclat ; César ne redoute ni n’épouvante les descendants
des héros, les derniers fils de la liberté ! S’il eût quelque part un reste d’une
ancienne lignée, un débris d’une vieille illustration, il le recueille, il le
ranime ; c’est une force de plus qu’il donne à la république. Les grands noms
sont en honneur[46]. Voilà donc cet
accord du prince et de la noblesse établi par Auguste, perdu sous ses
successeurs, retrouvé par Vespasien, que les Antonins, pour le bonheur de l’empire,
allaient réaliser pendant prés d’un siècle.
Trajan ne fit qu’un séjour de moins de deux années à Rome,
d’où il partit pour la guerre Dacique. Sans avoir été aussi honteuses que
Dion le prétend, les expéditions de Domitien étaient restées sans gloire ni
profit. Des généraux avaient été vaincus et tués, une aigle prise. Les Daces
avaient, il est vrai, perdu la dernière bataille, rendu leurs prisonniers et
envoyé à Rome une ambassade pour conclure la pair. L’empire aurait donc pu,
sur le Danube, comme maintes fois sur le Rhin, profiter d’un succès filial
pour renoncer à une guerre embarrassante qui menait aux aventures et non pas
à la sécurité ; mais Trajan n’était pas homme à se contenter de cette
attitude réservée. Nourri dans les camps, il en avait les mœurs ; il aimait
les exercices militaires, la chasse, le vin, les bons compagnons[47], surtout il
aimait la guerre, même avec ses plus rudes labeurs, la faisait bien, et par
conséquent se plaisait à la faire. Il n’examina point si la politique d’Auguste
pour les frontières était la meilleure ; si une forte défensive, derrière
deux grands fleuves, appuyée sur des camps, une nombreuse armée, des cités
populeuses, avec des intrigues et de l’argent jetés sur la rive opposée, au
milieu des peuplades ennemies, ne valait pas mieux que le plan gigantesque de
pénétrer aux Indes et de rentrer en Italie à travers les Barbares domptés. Ce
soldat s’ennuyait à Rome[48]. Pendant que le
sénat le fatiguait de ses adulations, Pline de sa verbeuse élégance[49], il rêvait d’Alexandre
et de César, cherchait un prétexte de guerre ; et, comme c’était chose facile
à trouver, il se faisait dire par ses orateurs que la honte infligée à l’empire
sous Domitien, sur les bords du Danube, devait être effacée[50].
On peut conclure de quelques mots de Pline que, durant l’hiver
de la première année de son principat, qu’il passa loin de Rome[51], Trajan avait
visité les légions de Pannonie et de Mœsie, pour répondre à leurs
félicitations, inspecter cette frontière, les camps riverains du Danube, se
rendre compte de la force des peuples qui en bordaient l’autre rive, et
commencer peut-être les grands travaux qui furent exécutés de ce côté-là sous
son règne. Sous Domitien, sous Nerva, il s’y était produit beaucoup d’agitation.
On y avait vu des combats malheureux et de douteuses victoires. Puisque le
Rhin et le haut Danube étaient pacifiés, Trajan se dit qu’il fallait aussi
pacifier le Danube inférieur. Il avait raison de tourner de ce côté ses
armes, car c’est là que seront les plus grands dangers de l’avenir et, par
là, que les invasions commenceront.
La vallée basse du Danube est enfermée entre deux chaînes
de montagnes, parallèles l’une à l’autre : les Balkans et les Carpates. Mais
tandis que les premières vont mourir à la mer Noire, les secondes se replient
brusquement entre Cronstadt et Fokchany, dans la direction de l’ouest, en
formant le grand coude où la
Transylvanie est aujourd’hui comprise, puis redescendent au
sud jusqu’au Danube, qu’elles dominent de leurs masses abruptes sur une
étendue de plus de 30 lieues. En face de ces massifs séparant la plaine du
Banat (vallée du
Témès) de l’immense plaine valaque, les Balkans envoient sur la rive
droite de puissantes ondulations de terrains qui se relèvent au bord du
fleuve jusqu’à 2 et 3.000
pieds de hauteur, et, par leurs assises inférieures,
traversent le lit du Danube, qu’elles sèment de récifs dangereux. C’est la
passe célèbre appelée les Portes de Fer, qui commence à Drenkova et se
termine près d’Orsova. Le fleuve majestueux, pressé dans cette gorge étroite
où l’on ne mesure pas, à Cazan, 200 mètres de large, s’y précipite avec
colère et y passe en écumant ; un vent violent y soulève des vagues telles
que les fleuves n’en connaissent pas, et, dans les basses eaux, il faut le
pilote le plus habile, au gouvernail la main la plus ferme, pour ne pas
sortir des canaux formés par les roches du fond[52]. La nature est, là,
magnifique, imposante et fière. L’homme aussi y fut grand, car ce fleuve,
Trajan l’enchaîna par un pont que les modernes n’ont point encore osé
reconstruire[53],
et cette montagne qui, sur la rive gauche, descend à pic dans les flots irrités,
il la tailla pour lui creuser au flanc un chemin que ses soldats pouvaient
suivre en tout temps. On lit encore gravés sur le roc ces mots d’une
inscription : Il ouvrit une route à travers le fleuve et la montagne domptés[54].
L’inscription est de l’an 100. On doit donc en conclure qu’une
partie des travaux était commencée avant la première guerre Dacique. Aurelius
Victor attribue même à Trajan l’ouverture d’une voie militaire allant du
Pont-Euxin à la Gaule.
Les Romains, ces grands constructeurs, n’avaient
certainement pas attendu plus d’un siècle avant de reconnaître la nécessité
de border d’une route sûre le grand fleuve qui couvrait leur empire sur une
étendue de 600 lieues, et, comme il est arrivé si souvent, l’œuvre de
plusieurs générations a été mise au compte du prince qui avait laissé sur
cette frontière les plus glorieux souvenirs[55].
L’importance des préparatifs militaires répondit à la
grandeur des travaux entrepris pour donner à l’armée une base solide d’opérations.
De Vienne, au pied du Kahlenberg, jusqu’à Troësmis, dans la Dobroutcha, huit
légions gardaient le pays des Pannoniens et la Mœsie. Cinq
quittèrent leurs cantonnements et furent réunies, en l’année 101, sur les
bords de la Save,
qui porta le gros bagage jusqu’au Danube, prés des lieux que nous venons de
décrire, vers Viminacium (Costolatz). Trajan
vint les rejoindre avec les dix cohortes prétoriennes et la cavalerie batave
et maure. Ce n’était pas trop pour combattre un peuple brave et un chef
habile dont l’histoire aurait fait un héros, si elle le connaissait mieux.
Les Daces occupaient les deux côtés de l’énorme
promontoire que les Carpates projettent sur le Danube : à l’ouest, la vallée
du Témés ou le Banat ; à l’est, la plaine valaque ; mais le centre de leur
puissance, leur capitale et leurs forteresses étaient plus au nord, dans la
haute vallée du Marosch (Transylvanie)[56]. C’est là qu’il fallait
aller frapper les coups décisifs. On pouvait y arriver par trois routes : l’une
à l’ouest, à travers le Banat, en franchissant, au col appelé aussi la Porte de Fer, la chaîne
secondaire qui sépare les bassins du Témès et du Marosch ; les autres, à l’est,
par la Petite
Valachie, en remontant deux vallées qui conduisent à cieux
gorges ouvertes clans la chaîne principale, celle du Jiul (Schyl) aboutissant
à la passe de Volcan, et celle de l’Alouta qui, née dans la Transylvanie,
traverse la grande chaîne au défilé fameux de la Tour Rouge (Rothe Trurmpass), dans le sud d’Hermanstadt. Ces
passages menaient tous deux aux environs de Sarmizegethusa
(Varhély).
Pour la première guerre, Trajan suivit, du moins avec sa
principale armée, la route du Banat qui l’éloignait le moins de la Pannonie où étaient ses
réserves ; pour la seconde, il parait avoir préféré les autres ; dans les
deux cas, il marchait avec un de ses flancs couvert par les montagnes, et par
conséquent toujours dans le voisinage de fortes positions à prendre contre
une attaque soudaine.
Un pont de bateaux, jeté près du bourg actuel de
Grodichte, lui permit de déboucher dans les plaines du Témès. L’armée s’avança
droit devant elle par la route qui se trouve encore tracée sur la carte de
Peutinger, franchit l’Eiserne Thor (porte de Fer), et, tournant à l’est, arriva devant la
principale forteresse des Daces, Sarmizegethusa
(Varhély).
Cette place fut enlevée avec les dépouilles que plusieurs générations y
avaient entassées.
Un peuple établi dans la vallée supérieure de la Theiss, les Burres,
essaya de s’interposer en faveur des Daces ; leur message était écrit en
caractères latins sur un énorme champignon ou plutôt sur un bouclier. Trajan
ne tint pas compte d’une menace qui venait de peuplades si pauvres ; il
poussa l’ennemi avec ardeur jusqu’au delà du Marosch, et l’écrasa dans une
grande bataille. Les Daces s’avouèrent vaincus ; ils livrèrent leurs armes,
les transfuges, l’aigle prise à Fuscus, rasèrent leurs forteresses et s’engagèrent
à tenir pour alliés les amis du peuple romain et ses ennemis pour
adversaires. Le Décébale vint lui-même accepter ces dures conditions. Sa
capitale reçut une garnison romaine, qui se relia par une série de postes
fortifiés aux camps du Danube. L’expédition avait exigé deux campagnes (101-102) et trois
combats sérieux, car Trajan fut trois fois salué imperator
par les soldats.
Il rentra dans Rome en triomphe, avec le surnom de
Dacique, et paya sa bienvenue par deux faveurs presque également agréables au
peuple : un congiaire et le rappel des mimes, contre lesquels il avait d’abord
fait revivre la loi de Domitien. Mais les fêtes qui suivirent la solennité
étaient à peine finies[57] que de mauvaises
nouvelles arrivèrent du Danube. Les Daces reprenaient courage ; ils rebâtissaient
leurs forts, ils amassaient des armes, nouaient des relations avec tous les
ennemis de Rome et attaquaient, au delà du Témès, les Iazyges ses alliés.
Trajan revint au milieu de ses soldats (105)[58], résolu à en
finir avec ce peuple.
L’attaque principale eut lieu à l’est, par les vallées du
Jiul et de l’Alouta. Pour déboucher Le
pont du Danube aisément de ce côté, il fit achever par son architecte Apollodore,
prés de Turn-Severin, un pont commencé dès la première guerre[59] et dont les
restes existent encore au fond du fleuve, où l’on a vit dans les basses eaux
seize des vingt piles de pierre qui avaient soutenu les travées de bois[60]. L’œuvre serait
encore aujourd’hui très difficile ; elle l’était bien davantage au temps de
Trajan ; aussi ne saurait-on trop admirer les ressources de l’empire qui l’entreprit
et le génie de l’architecte qui l’exécuta. En cet endroit, les rives sont
éloignées l’une de l’autre de 1.100 mètres[61] ; à l’étiage, on
trouve encore 6 mètres
d’eau dans le thalweg, le double au moment des crues, et le débit moyen
dépasse 9.000
mètres par seconde. Bâtir les Pyramides ou lé Colisée
avait été une entreprise moins difficile.
Avant que l’armée romaine franchit le pont, le Décébale
inquiet essaya de conjurer la tempête qui se dirigeait sur lui, en faisant
assassiner l’empereur. Ce coup manqué, il demanda la paix et le remboursement
de ses frais de guerre, promettant en échange de rendre un des meilleurs
généraux de Trajan, Cassius, qui, attiré à une conférence, avait été pris par
trahison. Pour laisser toute liberté à son prince, Cassius s’empoisonna. La
nouvelle de ce noble dévouement accrut l’ardeur des Romains ; les plus
difficiles obstacles furent surmontés, et l’ennemi, vaincu dans toutes les
rencontrer fut forcé dans toutes ses retraites. Le Décébale finit bravement :
à la prise de son dernier château, il se jeta sur son épée et ses chefs se
tuèrent après lui. Il avait enterré ses trésors dans le lit d’une rivière
dont on avait détourné le cours, et mis à mort les captifs qui avaient
travaillé à cet ouvrage[62] ; un de ses
familiers révéla le secret (fin de l’année 106). Encore un brave peuple qui, après une
résistance désespérée, disparaissait de l’histoire ; mais il n’est pas mort
tout entier il reste du sang dacique dans la population roumaine.
La conquête était achevée. Pour la rendre durable, Trajan
appela dans la région comprise entre le Témès et l’Alouta (Banat, Transylvanie et
Petite Valachie) des habitants tirés de toutes les provinces de l’empire[63] et des vétérans
de toutes les légions ; il y organisa deux puissantes colonies : Ulpia Trajana à Sarmizegetusa,
au centre du pays, pour le mieux contenir, et Tsierna,
au voisinage du grand pont, afin que ses légions eussent toujours libre
entrée dans la province. Il en fonda deux autres sur la rive droite du Danube
: Œscus (Gicen) et Ratiaria, près de Brsa-Palanca ; enfin il battit en face de l’embouchure
de l’Alouta la ville de la Victoire,
Nicopolis, qui s’appelle encore ainsi[64]. A ces noms on
pourrait joindre, si les ruines nous les avaient livrés, ceux des municipes,
des forteresses et des camps retranchés[65] qui furent
établis pour mettre en culture cette terre féconde, exploiter les mines des Carpates
et assurer tout à la fois l’obéissance des sujets et leur sécurité. Dans la
riante vallée de la Czerna,
où Trajan s’est à coup sûr arrêté quand il vint surveiller les travaux du
pont, coulaient deux sources, l’une sulfureuse, l’autre ferrugineuse ; les
Romains se hâtèrent d’y construire les bains de Mehadia, qui furent bien vite
fameux et qui le sont encore. Ils les consacrèrent à Hercule, parce que ces
eaux rendaient la force, et l’on y a trouvé une inscription Higiæ et Veneri,
les deux déesses à qui, dans tous les temps, on a demandé, aux stations
thermales, la santé et le plaisir.
Entre ces villes, les deux légions laissées par Trajan
dans la Dacie[66]
ouvrirent des routes mesurées au cordeau comme celles du reste de l’empire,
et dans l’intérieur des cités s’élevèrent des autels, des temples, des
amphithéâtres, dont quelques-uns datèrent des premiers jours de la conquête,
puisque, au bout d’un demi-siècle à peine, Antonin était obligé d’en
reconstruire un qui tombait de vétusté[67]. Dans les
montagnes de la
Transylvanie se trouvaient des mines d’or. Trajan en
organisa l’exploitation par d’habiles mineurs appelés de la Dalmatie[68], où l’on avait l’habitude
de ces travaux[69],
et qui nous ont laissé de nombreuses inscriptions mentionnant quelques-uns de
leurs usages ou de leurs contrats[70]. Un commerce
actif relia bien vite aux anciennes provinces cette terre barbare où l’on
voit, comme dans les plus vieilles cités de l’empire, des collèges formes par
des gens de métier, des sociétés de négociants étrangers établis dans les
villes daciques, et jusqu’à des tombeaux d’hommes de Palmyre[71] ou de l’Iturée
qui, entraînés par le service militaire ou le trafic, étaient venus
tristement mourir si loin de leur soleil. Aucune des inscriptions daciques
qui fournissent ces détails ne mentionne d’anciennes divinités du pays ; mais
il y est beaucoup question de dieux orientaux, de Mithra, d’Isis, de Sérapis,
du Jupiter de Tavium (Galatie),
de celui d’Héliopolis (Syrie),
du Bonus Puer (Posphorus ou l’Horus égyptien), de la Nehaletinia
gauloise, de la Vierge
de Carthage, etc.[72] Le courant de
colonisation déterminé par Trajan et ses successeurs avait été si puissant,
que la population indigène, submergée, n’eut point la force de percer ait
travers de la société nouvelle qui l’enveloppait, et de lui faire accepter
quelques-uns de ses dieux, comme il était arrivé en Gaule après la conquête
de César.
II faut donc reconnaître que les Romains, si l’on oublie
la plèbe de Ronce, écume de l’univers, avaient gardé dans leur décadence
quelques-unes de leurs anciennes qualités. Au second siècle de notre ère, on
aurait pu croire que ce peuple de laboureurs et de soldats qui, partout où il
s’était établi, avait si fortement saisi la terre, que sa trace y est encore,
s’était épuisé à coloniser l’Italie, la Gaule, l’Espagne, l’Afrique. Et voilà que le
vieux sang montre encore sa vertu et sa fécondité : les colons de Trajan se
sont assimilé l’ancienne population qu’on retrouve dans toits les villages
valaques, où elle se reconnaît à la haute stature, au teint clair, à la
chevelure blonde, aux mouvements calmes et lents des hommes du Nord, tandis
que les descendants des colons ont conservé la taille courte, l’œil ardent,
les cheveux noirs et la vivacité des hommes du Midi. Sous l’influence latine,
ces éléments si contraires se sont combinés en un tout homogène. La Dacie devint une Italie
nouvelle, Tzarea Roumanesca ; malgré
les invasions qu’elle a subies, elle s’appelle encore la Roumanie ; son peuple
est le peuple roumain, et, des rives du Marosch à celles du Pruth, du Danube
au sommet des Carpates, on parle une langue latine[73]. En songeant au
peu de temps qu’il fallut pour opérer cette transformation, on est conduit à
considérer cette latinisation de la
Dacie comme la plus grande œuvre de colonisation que l’histoire
connaisse. Quelle puissante vitalité dans cette race et que de grandes choses
on aurait pu faire avec des peuples si malléables, en les unissant par des
institutions générales qui leur auraient donné une vie commune ! Nous avons
dit à peu près tout ce que les écrivains anciens rapportent de cette guerre.
On en peut apprendre bien davantage de la colonne Trajane, qui est pour la
vie militaire des Romains ce que Pompéi est pour leur vie civile : la
représentation fidèle de choses disparues depuis dix-huit cents ans. Les
bas-reliefs qui se déroulent en spirales gracieuses autour de son fût de
marbre blanc nous montrent les armes et les costumes des légionnaires et des
Barbares, les engins de guerre, les camps, les attaques de forteresses, les
passages de fleuve ; Trajan lui-même haranguant ses troupes ou pansant les
blessés, et le roi des Daces se jetant sur son épée pour ne pas survivre à
son peuple[74].
Ce monument de la gloire militaire de Rome, plus durable
que son empire, s’élève encore au milieu des débris du forum que Trajan créa
en faisant disparaître une colline qui descendait du Quirinal vers le
Capitole. D’après l’inscription gravée au piédestal, il fallut enlever une
masse de terres dont la hauteur était égale à celle de la colonne, 43 mètres[75]. Nous ne pouvons
donner la description complète de ce monument, mais la nature de ce livre
exige que nous en reproduisions au moins les scènes principales.
Le premier combat est un engagement d’infanterie au
passage d’une rivière que les Daces défendent ; ils cèdent, effrayés par un
orage qu’indique la représentation de Jupiter lançant la foudre.
Les bas-reliefs suivants montrent l’empereur qui s’embarque
pour secourir ses troupes assiégées dans leur camp et qui les délivre : cette
fois la cavalerie a l’honneur de la victoire, malgré l’assistance prêtée aux
Daces par les Sarmates que l’on reconnaît à l’absence de boucliers dans leurs
armes.
Mais le succès est chèrement acheté, csar beaucoup de
soldats sont rapportés à l’ambulance, où les médecins pansent leurs blessures.
Trajan avance arec prudence, marquant sa route par des
camps que ses légionnaires construisent et qui sont de véritables
forteresses.
Par ses paroles et ses largesses il soutient le courage de
ses soldats.
Un chef maure, Lusius Quietus, à la tête de ses rapides
cavaliers, dont les petits chevaux à crinière épaisse rappellent les chevaux
numides, pousse des reconnaissances dans les forêts qui entourent la capitale
des Daces, Sarmizegetusa.
Il en ouvre la route à l’empereur, qui l’assiége et réussit
à la prendre. Le Décébale vaincu vient faire soumission aux pieds de l’empereur.
Trajan en quittant la Dacie avait laissé des garnisons dans ses camps
fortifiés ; quand la seconde guerre commença, ces camps furent assiégés : il
accourut polir les délivrer.
Il rencontra une résistance énergique. Une bataille
acharnée sous les murs de la nouvelle capitale des Daces lui livra cette
ville.
Mais le Décébale y mit le feu avant de l’abandonner ; ses
principaux chefs réunis dans un banquet se passèrent à la ronde une coupe
empoisonnée, pour se soustraire à la honte de la captivité.
D’autres, moins fiers, vinrent faire leur soumission aux
Romains.
Le Décébale, cependant ne désespérait pas ; il tenta
encore le sort des armes ; une dernière défaite le décida à se frapper
lui-même, pour ne pas tomber vivant aux mains de ses ennemis. Sa tête apportée
à Trajan et envoyée à Rome y annonça la fin de la guerre.
Il laissait derrière lui quelques braves, ses derniers
compagnons, qui aimèrent mieux vendre chèrement leur vie plutôt que rendre
leurs armes.
On n’eut raison d’eux qu’en brûlant le village où ils
résistaient encore, au milieu des murs écroulés.
La guerre avait été faite des deux côtés sans merci. Dans
les légions, on avait répandu le bruit que les Daces livraient les captifs
romains à leurs femmes, pour qu’elles les fissent périr dans les supplices ;
et l’architecte de Trajan les avait montrées, sur la colonne, égorgeant les
prisonniers. En élevant ce monument, qui a servi de modèle à toutes les
colonnes triomphales, le Grec Apollodore a renoncé au génie de sa race, qui
eût voulu de l’art idéalisé ; mais il a obéi à ce génie de Rome qui se plaît à
la réalité et à l’utile. Il a reproduit tous les incidents de ces deux
campagnes ; les travaux des soldats, leur armement, leur costume et ceux de
leurs adversaires ; on y voit en action jusqu’au service médical des légions.
Mais ne nous en plaignons pas : dans cette sévère épopée de marbre on eut
tire, non seulement la guerre Dacique, mais toutes celles que les Romains tirent
au delà du Danube et du Rhin.
Pendant ces conquêtes du prince au nord, un de ses lieutenants,
Cornelius Palma, sortait par la frontière orientale des anciennes limites de
l’empire. Le grand désert qui s’étend de l’Euphrate à la mer Rouge enveloppe
de ses vagues de sable et de ses nomades pillards la Syrie et la Palestine. Sur la
lisière des terres cultivées et presque sous le même méridien se trouvent la
grande cité de Damas, que les Romains tenaient depuis longtemps dans une demi
dépendance, et les quatre villes de Bostra, Gérasa, Rabbath Ammon (Philadelphie) et
Pétra ; celle-ci en plein désert, à distance égale de la mer Rouge et du lac
Asphaltite, et sur la route des caravanes qui se rendaient de la vallée de l’Euphrate
dans celle du Nil. C’était la résidence du roi des Nabatéens, Zabel, qui
commandait jusqu’à Damas, mais aussi le repaire des bandits qui désolaient
les riches pays du Jourdain et inquiétaient les caravanes. Cornelius Palma s’empara
de ces places (105[76]), réduisit le pays
en province (Arabia) et fit de Bostra une colonie qui
servit de quartier à la légion IIIa Cyrenaïca. Aussitôt des
routes furent tracées, des conduites d’eau établies pour utiliser les
torrents des montagnes et vivifier la plaine aride. Une inscription récemment
trouvée est un hommage des habitants de Kanata au légat impérial qui, le
lendemain de la conquête, avait amené une source dans leurs murs[77]. Avec des maîtres
si prévoyants, les villes gagnèrent de la vie, de la richesse et une
nombreuse population ; Pétra devint le centre d’un commerce considérable, et
l’on vit les nomades, pris du goût des arts, décorer leurs cités de monuments
dont les ruines, au milieu de ces solitudes, étonnent et charment le voyageur
; tandis que d’autres, gagnés par l’appât de la solde militaire, entraient au
service de l’empire ; les anciens coupeurs de routes se chargeaient de les
garder[78].
Ces conquêtes, surtout la première, produisirent à Rome un
grand effet[79].
Depuis Auguste, l’empire ne s’était augmenté que de la Bretagne, sous Claude,
et le triste prince n’avait gagné, au succès de ses lieutenants, ni gloire ni
popularité. Mais la double expédition conduite par Trajan lui-même dans un
pays sauvage, la soumission d’un peuple redouté, les multitudes de coloris qu’on
voyait s’acheminer du fond des provinces vers ces terres fécondes et Ies
aigles romaines planant au-dessus des Carpates, en plein monde barbare, tout
cela faisait ce qu’on appelle de la gloire, et ébranlait les imaginations
déshabituées des spectacles virils. Le sénat décrétait, pour les généraux,
des statues triomphales, pour le prince sa colonne, et les poètes rêvaient de
chants épiques en l’honneur de la
Rome nouvelle. Comment trouver,
écrivait Pline à son ami Caninius, un sujet aussi
riche, oui la vérité ait plus l’air de la fable ? Vous nous montrerez les
eaux rejetées dans les plaines arides[80] ; des ponts bâtis sur des fleuves qui n’en avaient jamais
porté ; des armées qui établissent leurs camps sur d’inaccessibles montagnes,
et un roi plein de résolution contraint de quitter sa capitale et la vie[81]. Mais, comme déjà
l’esprit latin fléchissait, au moins dans les lettres, c’est avec la métrique
et l’idiome d’Homère que Caninius se proposait d’écrire son poème national ;
et Pline, pris de la même inquiétude que Boileau, ne trouvait à cela qu’une
difficulté, celle de faire entrer dans des vers grecs des noms barbares.
Cependant, lorsque le conquérant de la Dacie fut de retour clans
la ville, on aurait pu croire, à regarder les choses du dehors, qu’il n’y
avait à Rome qu’un sénateur de plus. C’est le mot de Martial. Le poète impur
qui appelait Domitien un dieu ne donne même pas à Trajan le noie de seigneur.
Nous ne voyons plus un maître ici, s’écrie-t-il,
mais le plus juste des sénateurs[82]. Il discutait,
en effet, avec ses collègues, légiférait ou jugeait avec eux[83] ; il les
laissait remplir, en toute liberté, leurs innocentes fonctions, même
disposer, comme ils l’entendaient, de ces magistratures, idoles dorées
toujours tenues en grande vénération, mais d’où la vie politique s’était
retirée[84].
Pour faire arriver un plus grand nombre de sénateurs au consulat, Trajan
nomma douze consuls chaque année, et lui-même, durant son règne, ne prit que
cinq fois les faisceaux, en se soumettant à toutes les formalités
habituelles, même au serment prêté debout devant le consul en charge, qui
demeurait assis et dictait les paroles.
Pour les élections, il avait établi le scrutin secret, qui
sauvegardait la dignité des sénateurs, puisque l’œil du prince ne pouvait
plus marquer les opposants. Pline applaudit à cette réforme et en même temps
la redoute[85].
Il a raison. Ce scrutin, bon pour les petits, dont il faut protéger la
liberté, est mauvais pour les grands, qui, par lui, échappent à la
responsabilité de leur vote. Il est vrai que les grands d’alors étaient bien
petits. La première fois que les sénateurs firent usage du mode nouveau de
votation, on trouva sur plusieurs bulletins des plaisanteries, même des
impertinences : un d’eux portait le nom des protecteurs à la place du nom des
candidats[86].
A ces révélations inattendues de l’urne au scrutin, le sénat retentit de
clameurs indignées, et l’on appela toute la colère de l’empereur sur les
coupables. Ils restèrent inconnus ; ces mauvais plaisants étaient sans doute
des gents d’esprit qui, en public, jouaient très gravement leur rôle, mais
riaient, sous le masque, de la comédie qu’ils venaient représenter. Pline n’est
pas de ceux-là : un homme aussi préoccupé de l’opinion gardait l’étiquette et
le cérémonial jusque dans sa chambre à coucher, où, le soir même, il racontait
la scène à un ami, en se demandant si de pareilles gens n’étaient pas
capables de tout. Aussi pourquoi trouble-t-on sa sérénité par de discordantes
paroles ? Il admire consciencieusement son prince ; et avec raison ; peu s’en
faut même qu’il ne se croie revenu aux temps républicains. Vous nous avez commandé d’être libres, s’écrie-t-il,
nous le serons[87]. On se laissait
prendre à ces paroles, et quelques-uns se croyaient déjà revenus à I’ancienne
république. Un secrétaire de l’empereur, Titinius Capito, mettait dans sa
maison, à la place d’honneur, les images de Brutus, de Cassius et de Caton
qui avaient cessé d’être séditieuses ; il écrivait l’histoire des grands citoyens
immolés par la tyrannie, et il en faisait des lectures publiques, où
accourait toute la haute société de Rome[88]. Mais des gens à
qui il faut commander d’être libres ne le seront jamais. La liberté se prend,
ou, ce qui vaut mieux, l’opinion l’impose : le peuple qui la recevrait par
ordre ne serait ni digne ni capable de la garder. En réalité, l’autorité de
Trajan était aussi absolue que celle d’aucun de ses prédécesseurs. Pline,
dans ses Lettres, où il n’est plus gêné par l’éloquence officielle, montre
bien que Rome ne cessait pas d’avoir un maître. Il
est vrai, dit-il, que tout se fait à
la volonté d’un homme qui, dans l’intérêt commun, prend pour lui seul tous
les soucis, tous les travaux[89]. Il s’oublie,
même, dans le Panégyrique, jusqu’à faire du prince le propriétaire
universel qui peut disposer à son gré de tout ce
que les autres possèdent (27).
Mais ce pouvoir, Trajan, sans hypocrisie ni feinte, et
ceci le distingue d’Auguste, l’enveloppait des formes de la liberté, parce
que la courtoisie était dans sa nature ; parce qu’une seule chose le
préoccupait, l’intérêt de l’État ; parce qu’enfin, témoin de la lutte
homicide de Domitien et de l’aristocratie, il se rappelait ce que cette
guerre avait jeté d’odieux sur le prince, et ôté de force au gouvernement, en
l’obligeant à dépenser, pour déjouer des complots véritables ou imaginaires,
le temps, l’attention et les ressources que réclamait le service public.
Laissons donc ces sénateurs inutiles sur leurs chaises curules, et voyons
agir le prince.
Trajan est une des figures les plus sympathiques de l’histoire
; s’il manque de la haute intelligence et de l’audace politique du
réformateur qui reconstruit, il a la sagesse et la force qui consolident et
conservent. Avec le miracle impossible d’une succession d’empereurs tels que
lui, Rome était sauvée, parce que, dans les pays de pouvoir absolu, la puissance
du prince pour le bien est égale à celle qu’il possède pour le mal. Dans ses
jugements, on voit toujours l’esprit de justice ; dans sa correspondance
administrative, un parfait bon sens ; dans sa vie privée, la modération et la
retenue, sauf pour certains vices du temps[90] ; au palais, l’économie
; dans les travaux publics, la magnificence ; en tout, pour tous, la
discipline, l’ordre et le respect absolu de la loi.
Ainsi, il s’opposait à ce que l’on prononçât une
condamnation contre un absent involontaire ou sur une dénonciation anonyme : Mieux vaut, écrivait-il à Severus, laisser échapper un coupable que punir un innocent[91]. C’était de la
plus simple équité, et il n’y aurait pas à l’en louer si d’autres n’avaient
souvent tenu une conduite contraire. Pour les procès avec le fisc, il
constitua un tribunal dont le juge était désigné par le sort, et où les
parties avaient droit de récusation. Le pouvoir
et la liberté, dit Pline, plaident au
même forum, et, le plus souvent, ce n’est pas le fisc qui l’emporte, le fisc
dont la cause n’est jamais mauvaise que sous un bon prince[92].
Souvent il venait siéger au milieu des juges, entendre les
témoins et décider, fallût-il, comme dans le procès de Marius Priscus, rester
trois jours entiers au sénat, qu’il présidait en qualité de consul. Il recevait
les appels de tous les tribunaux de l’empire et retenait les causes pour
lesquelles on sollicitait son examen personnel. Pline nous a laissé le
tableau d’une de ces assises impériales, dans une lettre charmante qui fait
aimer celui qui l’écrivit, mais bien plus encore le prince au sujet duquel
elle fut écrite. J’ai été, dit-il, appelé par l’empereur au conseil tenu en sa maison de Centum
Cellæ. On a jugé différents procès. Claudius Ariston, le premier des
Éphésiens, avait été accusé par des envieux ; il a été absous et vengé[93]. Le jour suivant, on a jugé la femme d’un tribun des
soldats, Gallita, coupable d’adultère avec un centurion. Le mari en avait
écrit au légat consulaire, qui renvoya l’affaire au prince. Les preuves ne
laissant pas de doute, César cassa le centurion et le condamna à la
relégation. Restait sa complice. L’amour retenait le mari, qui, content d’avoir
éloigné un rival, gardait sa femme chez lui. On l’avertit qu’il devait
poursuivre le procès ; il le lit à contrecœur ; et, malgré lui encore, elle
fuit condamnée aux peines portées par la loi Julia. L’empereur voulut
que, dans le jugement, on rappelât le nom du centurion et la discipline
militaire, de peur qu’il ne parut évoquer à lui toutes les affaires de ce
genre[94].
Le troisième jour, on examina
les codicilles de Julius Tiron, qu’on disait faux pour une partie, et
authentiques pour le reste. Sempronius Senecio, chevalier romain, Eurythmus,
affranchi et procurateur du prince, étaient accusés de la falsification. Les
héritiers, par une lettre commune, avaient demandé à l’empereur, durant son
expédition dacique, de connaître lui-même de l’affaire. De retour à Rome, il
leur donna jour pour les entendre. Quelques-uns, par respect pour un
affranchi du palais, voulaient renoncer à l’accusation contre Eurythmus. Je
ne suis pas Néron, leur dit-il, ni lui Polyclète. Deux héritiers
seulement parurent et demandèrent que tous ceux qui avaient intenté l’accusation
fussent obligés de la soutenir ou qu’il leur fût permis à eux aussi de l’abandonner.
L’empereur parla avec beaucoup de douceur et de majesté, et l’avocat des
accusés ayant dit que, s’ils n’étaient point entendus, ils seraient livrés à
tous les soupçons. Ce dont j’ai souci, répondit Trajan, ce n’est point
que ces gens-là restent sous le coup des soupçons ou y échappent, c’est que
moi je n’y tombe pas. Alors se tournant vers nous : Vous voyez ce dont
il s’agit ; que devons-nous faire ? Le conseil en ayant délibéré, le
prince décida que tous les héritiers poursuivraient l’accusation ou
donneraient les motifs de leur désistement ; sinon qu’il les condamnerait
comme calomniateurs. Vous voyez combien ces jours ont été honnêtement et
utilement employés[95].
Il n’aimait pas les délateurs, quoique cette race fût à
Rome une nécessité et que la loi les encourageât, en leur accordant, même
dans les causes civiles, un quart de la fortune des condamnés (quadruplatores). Avec les mauvais princes, ils
gagnaient bien davantage. Trajan, qui avait déjà chassé de Rome ceux qui s’étaient
le plus compromis dans les accusations politiques, diminua beaucoup, pour les
autres, les bénéfices de leur industrie en décidant que les citoyens en
possession de biens caducaires, qui, de leur propre mouvement, le
déclareraient au fisc avant l’introduction de toute instance, partageraient l’héritage
avec lui. Il semble même avoir établi pour les délateurs une sorte de peine
du talion[96].
Pline vient de montrer Trajan condamnant comme calomniateurs ceux qui
accusaient sans prouver l’accusation ; et la peine était grave :
habituellement celle que l’accusé eût subie. Qu’ils
souffrent, dit Pline, ce qu’ils ont
fait souffrir ; qu’ils craignent autant qu’ils étaient craints[97].
La loi de majesté avait reçu une extension déplorable par
l’autorisation accordée aux esclaves d’accuser leur maître : Trajan leur
retira ce droit ; du même coup il brisait une des armes de la tyrannie et
ramenait la sécurité au sein des familles, car les riches n’allaient plus
être entourés d’espions haineux, au fond de leurs demeures, jusque dans l’intimité
et le secret de la vie privée. Il raffermit encore la discipline de l’esclavage
et de la clientèle, en décidant, par un édit, que l’affranchi ou l’esclave
qui aurait acheté ou obtenu d’un empereur, à l’insu du patron ou du maître,
le droit complet de cité, par conséquent la libre disposition de ses biens,
conserverait ce droit sa vie durant, mais, à sa mort, redeviendrait affranchi
latin, de sorte que sa fortune fit retour à son ancien patron[98]. La législation
ancienne condamnait à mort tous les esclaves du maître assassiné ; elle fut
aggravée par une constitution de Trajan, qui, dans ce cas, soumit à la
torture non seulement les affranchis testamentaires, mais ceux qui, ayant
reçu, du vivant du maître, la liberté, possédaient en totalité ou en partie
la cité romaine[99].
Ce prince ne ressentait donc pas le contrecoup des doctrines qui ébranlaient
alors l’esclavage : il conservait l’ancienne institution, et cependant il n’entendait
pas qu’on l’altérât frauduleusement. Quantité d’enfants nés libres étaient
exposés ou volés et servaient comme esclaves ; il leur reconnut le droit
perpétuel de revendiquer leur liberté, sans avoir à la racheter par le
remboursement des aliments qu’ils avaient reçus[100].
Avec ce même esprit de justice, il porta une atteinte
légitime à l’autorité paternelle, en forçant le père qui avait maltraité son fils
à l’émanciper et à renoncer à son héritage[101]. Il semble qu’on
doive aussi faire remonter à lui la création du curator
rei publicæ, fonction excellente dans les limites qu’il lui donna,
mauvaise pour l’indépendance municipale, quand on en eut fait la première
charge dans les cités. Du moins, c’est dans trois inscriptions du règne de
Trajan qu’on trouve la plus ancienne mention de ces magistrats
extraordinaires nommés par l’empereur pour surveiller l’administration
financière des municipes[102]. Bergame, qui
en eut un, se trouva, à partir de ce jour, en tutelle, puisqu’elle ne put,
sans l’autorisation de son curateur, aliéner une partie de son domaine, ou
même entreprendre une construction de quelque importance. Æcæ, en Apulie, et
l’antique Cœre en obtinrent. Ces villes avaient sans doute sollicité cette
intervention du prince, comme on verra plus loin Apamée demander à Pline de
vérifier ses comptes. Il était bon de leur envoyer un commissaire temporaire,
avec une mission spéciale pour réparer des désordres et remettre les choses
en état ; il sera mauvais de créer une fonction permanente qui finira par
supprimer l’autonomie administrative des cités.
Il envoya aussi un légat dans la Transpadane ; la
présence d’un magistrat supérieur, investi de l’imperium
militaire, y avait sans doute été rendue nécessaire par quelque tumulte ;
mais l’Italie perdait un de ses privilèges, et toute la région au delà du Pô
était ramenée à la condition d’un territoire provincial.
Durant son règne de dix-neuf ans, Trajan n’augmenta aucun
tribut, en diminua plusieurs[103], ne confisqua
aucune fortune et n’exigea aucun legs. Les
citoyens eurent enfin la sécurité pour leurs testaments, et le prince ne fut
plus, à cause de son nom inscrit ou oublié sur l’acte testamentaire, l’héritier
unique de tout le monde[104]. Il refusa les
présents autrefois volontaires, mais devenus obligatoires, qu’on était censé
offrir au prince comme don de joyeux avènement,
et il remit les impôts arriérés[105]. Cela avait été
fait par plusieurs de ses prédécesseurs ; mais il abolit la distinction qu’Auguste
avait mise par la loi du vingtième, entre les anciens et les nouveaux
citoyens. Ceux qui étaient arrivés au droit de cité par les privilèges du
Latium ou qui l’avaient obtenu des princes sans recevoir en même temps le jus cognationis étaient considérés comme
des étrangers au sein de leur famille et soumis, lorsqu’ils recueillaient une
succession, au payement des droits, fussent-ils père, fils ou frère du mort.
Beaucoup de petits héritages furent, en conséquence, exemptés des droits de
transmission[106],
comme nous dispensons dans les grandes villes les petits loyers de l’impôt. C’était
une diminution de recette, mais en même temps l’empereur chargeait une commission
sénatoriale de rechercher les moyens de restreindre les dépenses publiques[107], et nous sommes
assurés qu’avec une ferme volonté, comme était celle de Trajan, la commission
a rempli son office.
Il est curieux, en effet, de voir avec quelle facilité se
relevaient les finances de l’empire, dès qu’un prince intelligent arrêtait
les folles prodigalités. On sait les embarras financiers de Domitien et de
Néron ; voici que, grâce à l’ordre mis en tout, à l’économie dans les
dépenses de luxe et d’apparat, leur successeur est en état de faire d’immenses
travaux, une grande guerre, de magnifiques constructions, tout en diminuant
les impôts, et qu’il lui reste encore des ressources pour créer la plus belle
institution de l’empire.
Nerva, quelques mois avant sa mort, avait résolu d’aider
les parents pauvres de condition libre à élever leurs enfants, pour assurer, comme le dit une inscription, l’éternité de l’Italie[108]. Trajan reprit
ce dessein et lui donna de brandes proportions. Dès l’année 100, cinq mille
enfants reçurent à Rome l’assistance de l’État[109]. L’inscription
de Velleia, une des plus longues qui
nous restent, et la Table alimentaire des Bæbiani permettent de retrouver
le mécanisme ingénieux qu’il imagina[110]. Le moyen employé
consistait en une double opération habilement combinée pour assurer l’avenir de
l’institution contre les
caprices précipités d’un gouvernement moins généreux. Le fisc prêtait sur
hypothèque, par l’intermédiaire du corps municipal, de l’argent à certains
propriétaires pour l’amélioration de leurs fonds, et les intérêts, payés par
ceux-ci au taux modique de 5 p. 100, quelquefois même de 2 ½[111], fournissaient
les ressources à l’aide desquelles on constituait une sorte de caisse de
bienfaisance. Ainsi, d’après la
Table de Velleia, 51 propriétaires avaient reçu, pour des
biens ayant dix à douze fois la valeur du prêt hypothécaire[112], une somme de 1.116.000
sesterces (278.000
francs), dont l’intérêt annuel, 55.800 sesterces (13.950 francs),
servait à l’entretien de 300 enfants : 264 garçons et 36 filles. Les garçons
recevaient par an 192 sesterces (48 francs), les filles, 14 (36 francs)[113]. Les enfants
naturels avaient moins : les garçons, 141 sesterces, les filles, 120 ; mais,
sur les 300 assistés de Velleia on ne comptait que deux enfants naturels, un
garçon et une fille. La fondation était faite pour un nombre déterminé d’enfants,
nombre qui ne changeait pas tant que la fondation n’était pas accrue, mais l’assistance
variait, sans doute comme le prix des vivres dans les localités : ainsi, à
Velleia, 16 sesterces par mois ; à Terracine, 20.
À première vue on serait tenté de croire que cette
institution est née du sentiment de charité que la philosophie infiltrait au
cœur de la société païenne. Mais, en considérant que parmi les enfants
secourus se trouvait seulement un dixième de filles, il faut reconnaître que
la loi alimentaire de Trajan avait le même but que les lois d’Auguste de prole augenda[114] ; elle était un
encouragement donné à la population libre, et on se rappelle que déjà le
premier empereur avait admis, à Rome, les enfants à ses distributions. Pline
montre clairement le caractère de la nouvelle institution : Ces enfants sont élevés aux frais de l’État pour en être l’appui
dans la guerre, l’ornement dans la paix. Un jour ils rempliront nos camps,
nos tribus, et d’eux naîtront des fils qui n’auront plus besoin de cette
assistance[115]. Mais ailleurs
il ajoute : L’homme vraiment libéral donne à sa patrie, à ses proches, à ses
amis pauvres.... Il recherche ceux qui sont dans
le besoin, les secourt, les soutient et se fait d’eux une sorte de famille[116]. Trajan
lui-même réprimandait les villes qui dépensaient follement leurs revenus au
lieu de secourir leurs pauvres[117] ; et l’extension
donnée à l’institution alimentaire par ses successeurs, les fondations que
firent les particuliers, avaient certainement aussi pour motif une idée de
bienfaisance, qu’on pourrait retrouver encore dans le très ancien usage des
sportules accordées aux clients et des distributions de terres ou de blé
faites aux pauvres de Rome, dès l’époque républicaine[118].
Il est à noter que si, par la combinaison que Trajan avait
imaginée, l’État perdait l’intérêt de son argent, qu’il n’est pas tenu de
faire valoir comme un usurier, il conservait le capital, qui, passant d’un
propriétaire à l’autre, portait la fécondité dans les campagnes. L’agriculture
défaillante de l’Italie était secourue[119] en même temps
que les familles pauvres, et le gouvernement espérait que celles-ci,
soutenues à propos, s’élèveraient dans leur condition, de sorte que beaucoup
d’entre elles, à la seconde génération, n’auraient plus besoin d’assistance.
Nos sociétés modernes, travaillées du même mal que l’empire
romain, le prolétariat, n’ont encore rien imaginé d’aussi large et ajoutons d’aussi
habilement conçu que la loi alimentaire de Trajan ; car elles n’ont pour les
enfants pauvres qu’un petit nombre de salles d’asile et la gratuité de l’école.
On ne peut affirmer que l’institution ait été établie par
mesure générale dans l’Italie entière ; mais des monnaies, des inscriptions,
même des sculptures, permettent de la retrouver en beaucoup de lieux. Ainsi,
les bas-reliefs de l’arc de Bénévent représentent des hommes portant de
jeunes garçons sur leurs épaules, et quatre femmes, la tète ornée de
couronnes murales, qui conduisent vers Trajan des jeunes filles. Ces femmes
sont-elles l’image de quatre villes du voisinage ou le symbole de toutes les
cités d’Italie qui avaient profité du même bienfait ? La seconde hypothèse
est la plus vraisemblable, et Ilion la confirme[120].
Des cités provinciales, de riches particuliers, suivirent
l’exemple donné par les empereurs[121] : cette société
païenne, qui adoucissait le sort de l’esclave, se préoccupait de la misère de
ses pauvres et enseignait, avec Épictète et Marc-Aurèle, les plus beaux
préceptes de morale, montrait donc avant de périr qu’elle avait en elle des
forces de renouvellement capables de la sauver, si ses mauvaises lois politiques
ne l’avaient perdue.
Au nombre des mesures de bienfaisance prises par Trajan,
il faut compter la colonisation de la Dacie, exécutée sur une si vaste échelle, que
la race latine garde encore l’immense contrée dont elle prit alors
possession. Pour qu’il en ait été ainsi, on est obligé d’admettre que le
nombre des colons fut, considérable, et on ne peut supposer qu’ils aient été
pris parmi les riches. Ce fut donc une très large distribution de terres
faite, à l’exemple de Rome républicaine, aux indigents de l’empire. En
donnant les terres, on dut donner aussi les outils, les semences, le bétail
et toutes les choses nécessaires à un premier établissement, sous un climat
rigoureux pour des Méridionaux. Les dépouilles des Daces servirent à ces
avances, et nombre de villes furent délivrées d’une partie de leurs pauvres[122].
On n’oserait dire que Trajan ait établi la liberté du commerce
des grains et, par conséquent, provoqué une baisse dans le prix du blé, ou
une plus égale répartition ; du moins les mesures indiquées par Pline
devaient tendre à ce résultat[123], et furent un
bienfait.
Trajan honora son règne par de grands travaux publics,
autre façon de donner du pain aux pauvres. Apollodore de Damas, l’audacieux constructeur
du pont sur le Danube, écrivit en marbre la grande page d’histoire qui se
déroule autour de la colonne sous laquelle le prince se fit préparer un
tombeau, et il bâtit un nouveau forum qui par sa splendeur éclipsa tous ceux
îles Césars. Deux siècles et demi plus tard, Constance le contemplait avec
admiration et Ammien Marcellin l’estimait le plus
magnifique ensemble de constructions qui fût sous le soleil[124]. Avec son arc
de triomphe, son temple alors consacré à la divinité de Trajan, ses deus
bibliothèques pour les liges grecs et pour les livres latins, sa basilique,
ses immenses portiques surmontés d’un peuple de grands hommes, en marbre et
en bronze, qui formaient au héros impérial comme une garde d’honneur rangée
autour de sa statue équestre et de sa colonne triomphale, Trajan avait vaincu
Auguste en magnificence.
Rome dut à ce grand bâtisseur[125] bien d’autres
embellissements ; notons seulement un dixième aqueduc qui conduisit sur le
Janicule l’eau du lac Sabatinus (lago di Bracciano)[126].
Les deux meilleurs ports de l’Italie que la nature n’ait
point faits toute seule sont l’œuvre de Trajan et subsistent encore : sur l’Adriatique,
celui d’Ancône, où un arc de triomphe en marbre blanc rappelle le bienfaiteur
de la ville et humilie de son élégance l’arc qu’on a eu l’imprudence de
dresser, dans le voisinage, au pape Clément XII ; sur la mer de Toscane, celui de
Civita-Vecchia (Centum Cællæ), cité qui lui dut tout.
Pour activer les travaux, il s’y était bâti une villa, où il venait
séjourner. Pline, qui y passa plusieurs jours, montre les navires allant
incessamment précipiter à la mer des rocs entiers pour former, en avant du
port et de ses deux miles, une digue contre laquelle la mer brisait avec
fureur. De grands travaux d’assainissement furent entrepris par toute l’Italie,
et le célèbre Galien, qui fut presque un contemporain, en vante les heureux
effets pour la santé publique. Beaucoup d’anciennes
routes étaient dégradées et envahies par les broussailles ; d’autres
difficiles à gravir, dangereuses à descendre ou coupées par des torrents. Par
les soins du prince les parties humides et basses furent pavées, les passages
difficiles aplanis, les eaux sauvages contenues par des digues et des ponts[127]. Sur l’une de
ces routes reconstruites aux frais du prince, le sénat fit ériger l’arc de
Bénévent pour conserver le souvenir de ces grands travaux. Trajan pensa,
comme César, à dessécher les marais Pontins, et Dion parle de chaussées empierrées
qu’il y construisit ; mais les niveaux furent mal pris, et le ponte Maggiore, par où les eaux devaient s’écouler,
ne leur offrit pas un débouché suffisant[128]. Il semble
avoir relevé, en y envoyant une colonie, l’antique cité de Lavinium, où les
consuls et les préteurs, a leur entrée en charge, allaient sacrifier à Vesta
et aux dieux Pénates[129].
Il agrandit le port de Claude à Ostie en y creusant le lago Trajano, qui fut mis en communication avec
le Tibre par un canal, le Fiumicino ;
les navires eurent alors pour leurs manœuvres une surface d’eau de 113 hectares[130].
Dans les provinces, il surveilla et contint les
gouverneurs : c’était de tradition impériale ; un proconsul d’Afrique fut
banni comme concussionnaire ; un gouverneur de la Bétique,
dépouillé de ses biens pour la même cause : tous sentirent que, sous un tel
prince, il fallait absolument s’occuper de l’intérêt public et point d’autre
chose. Aussi, partout s’exécutaient des travaux utiles. En Égypte, Trajan fit
des réparations si considérables au Plolemæus amnis,
entre le Nil et la mer Rouge, que ce canal porta désormais son nom, Τραϊανός
ποταμός. C’était donner de
nouvelles facilités au commerce et surtout à l’exploitation des belles
carrières de porphyre et de granit du Djebel-Dokhan et du Djebel-Fateereh, au
voisinage des ports de Myos-Hormos et de Philotera, de sorte que les colonnes
qu’on en tirait arrivaient facilement à Rome et dans toutes les cités
maritimes de l’empire[131].
On a vu qu’il jeta deux ponts permanents sur le Rhin et le
Danube ; ils ont disparu, comme ceux qu’il construisit pour tenir toujours ouverts
aux légions les pays situés au delà du Tigre et de l’Euphrate ; nous venons d’en
retrouver un, écroulé, dans la vallée de la Medjerda, en Tunisie,
mais celui d’Alcantara, sur le Tage, existe encore, haut de 60 mètres et
long de 188[132].
Pour le dernier, Trajan n’eut qu’à seconder le zèle des provinciaux, en
envoyant un de ses meilleurs architectes à plusieurs cités lusitaniennes, qui
s’étaient cotisées pour les frais de cette colossale construction : preuve
nouvelle de la prospérité des provinces à cette époque et de la facilité qu’on
aurait eue à mettre, en commun les intérêts de leurs habitants. De nombreuses
inscriptions montrent que les routes étaient également faites ou réparées aux
dépens des municipes dont elles traversaient le territoire, quelquefois avec
une subvention du fisc.
A l’imitation de la capitale, Ies cités provinciales
dépensaient des sommes énormes pour s’embellir. Où les trouvaient-elles ? Le
prince venait de leur ouvrir une source nouvelle et abondante de revenus. L’ancienne
jurisprudence, considérant les villes, ainsi que les collèges et les
associations, comme des personnes incertaines,
ne les croyait pas capables de recevoir un legs[133], à moins d’une
autorisation spéciale[134]. Nerva leur
reconnut cette capacité, mais en termes assez vagues, parait-il, pour que le
prudent Pline n’osât user de ce rescrit[135]. Le sénatus-consulte
Apronien, rendu sous Trajan[136], permit aux
cités de recueillir des successions par la voie des fidéicommis, dernière gêne
qui disparaîtra sous Hadrien[137]. Alors la cité
deviendra une personne civile, ainsi que l’est notre commune française ; mais
entre les deux époques existe une grande différence : le patriotisme
municipal était, en ce temps-1a, bien autrement énergique qu’aujourd’hui, et
il n’y avait point de congrégations religieuses qui attirassent à elles les
libéralités des mourants, de sorte que les donations, qui viennent d’être
autorisées, seront très abondantes et iront directement à la cité pour servir
à ses besoins, même à ses plaisirs[138]. Souvent, à la
veille d’une élection municipale, un candidat s’engageait d exécuter quelque
ouvrage pour la ville, et, le lendemain, oubliait sa promesse. Un rescrit fit
de cette promesse une obligation légale, qui lia même les héritiers[139]. Enfin, le vol
des fonds municipaux, considéré jusqu’alors comme un simple détournement, fut
assimilé au péculat, qui était puni de la confiscation des biens et de la
déportation[140].
Voilà comment tout l’empire, à l’époque des Antonins, put se couvrir d’aqueducs,
de thermes, de théâtres, de ponts et de routes où circulait la poste
impériale, qui venait d’être réorganisée[141]. On faisait
remonter justement au prince l’honneur de cette impulsion donnée aux travaux
publics, et tant de monuments, des bords du Tage à ceux de l’Euphrate,
portaient la date de son règne, que Constantin, importuné de retrouver
partout ce nom, comparait Trajan d la pariétaire qui s’attache à toutes les
murailles. Niais ces temples, ces basiliques, ces ponts, ces aqueducs, il les
avait bâtis[142],
où en avait provoqué la construction, et il ne les avait pas décorés de
dépouilles enlevées à d’autres, tandis que Constantin déroba les bas-reliefs
de l’arc de Trajan pour orner celui qu’il se fit élever à Rome.
Cependant il se trouva des gens pour conspirer contre lui,
tant l’aristocratie romaine avait de peine à se déshabituer des complots,
même sous le prince qui lui témoignait tant d’égards. Un Crassus, qui avait
été condamné sous Nerva pour une pareille tentative, essaya de l’assassiner.
Trajan refusa de s’occuper de cette affaire ; il laissa le sénat instruire,
juger et faire exécuter la sentence, qui n’emporta que le bannissement.
Crassus est le seul membre du sénat qui fut frappé sous ce règne pour
attentat contre l’empereur[143].
Le prince qui mieux que tout autre méritait un historien n’en
a pas[144],
et l’on ne sait plus rien, lorsqu’on a épuisé l’étude des monuments, des
inscriptions, des monnaies et de quelques rares fragments épars çà et là dans
les abréviateurs. Cependant il nous reste de ce temps un document précieux
pour connaître, par un exemple pris sur le vif, l’état des provinces, le rôle
du légat, la part du prince dans l’administration générale, et ce que Ies
villes avaient déjà perdu d’indépendance : c’est la correspondance de Pline
et de Trajan. Écoutons ce curieux dialogue qui s’établit à 500 lieues de
distance entre l’empereur dans sa capitale et le gouverneur d’une de ses plus
lointaines provinces, la
Bithynie. Ires questions sont simples, les réponses
précises et les conséquences sautent d’elles-mêmes aux yeux[145].
I. Autorisation impériale
pour les travaux publics.
Faut-il autoriser les Prusiens
à remplacer leurs bains qui sont vieux et laids par des thermes nouveaux ?
— Oui, s’ils n’établissent pour cela aucune imposition
nouvelle et si les services ordinaires n’en souffrent pas.
Sinope manque d’eau ; j’ai
trouvé une source à 16 milles ; mais l’aqueduc devrait, sur une longueur de
1000 pas, traverser un terrain mou et suspect. Je ramasserai aisément l’argent
nécessaire ; il nous reste à obtenir votre approbation[146]. — Faites cet aqueduc, mais après avoir bien examiné si le
lieu suspect peut le porter et si la dépense n’excède pas les forces de la
ville.
Nicomédie a dépensé 3 329 000 sesterces pour un aqueduc qui est
tombé, 2 millions pour un autre qu’on a abandonné. J’ai le moyen d’en faire un
troisième qui tiendra, si vous nous envoyez un fontainier ou un architecte.
— Conduisez de l’eau à Nicomédie, mais recherchez
par la faute de qui tant d’argent a été perdu.
Nicée a dépensé 10 millions de
sesterces pour un théâtre qui s’écroule, et de grosses sommes pour un gymnase
qui a brûlé et qu’on rebâtit. À Claudiopolis on creuse un bain avec l’argent
que les décurions offrent pour leur entrée dans la curie. Que dois-je faire à
l’égard de tous ces travaux ? Envoyez-nous un architecte. — Vous êtes sur les lieux, décidez. Quant aux architectes,
nous les faisons venir de Grèce : vous en trouverez donc autour de vous.
Il me semble que les
entrepreneurs des travaux de la ville de Pruse prennent plus qu’il ne leur
est dû. Envoyez-moi un vérificateur pour toiser l’ouvrage. — Il y en a partout ; cherchez bien et vous en trouverez.
Amastris est empestée par un
cloaque qu’il faudrait couvrir. Si vous permettez qu’on exécute cet ouvrage,
j’aurai l’argent nécessaire. — Couvrez
d’une voûte ce ruisseau infect.
Sur les confins du territoire
de Nicomédie est un grand lac ; il serait fort avantageux de le joindre à la
mer par un canal. — Prenez garde que
le lac en se réunissant à la mer ne s’y écoule tout entier. Je vous enverrai
d’ici des gens entendus en ces sortes d’ouvrages.
II. Surveillance des
finances municipales.
Les villes de la province ont
de l’argent et point d’emprunteurs à 12 pour 100. Faut-il baisser le taux de
l’intérêt et forcer ensuite les décurions à se charger de ces fonds ?
— Mettez l’intérêt assez bas pour trouver des
preneurs, mais ne forcez personne à emprunter malgré lui.
Dans la ville libre et alliée
d’Amisus, qui, grâce à vous[147], se gouverne par ses propres lois, on m’a remis une
requête touchant les sociétés de secours mutuels. Je la joins à cette lettre
pour que vous voyiez, seigneur, ce que l’on peut tolérer ou défendre.
— Laissez-leur les sociétés (eranos) que le traité d’alliance leur donne ; surtout si, au lieu
de dépenser le produit de leurs cotisations en cabales et en assemblées
illicites, ils s’en servent pour soulager leurs pauvres. Dans toutes les
autres villes de notre obéissance, il ne faut point le souffrir.
La plupart de mes
prédécesseurs ont accordé aux villes du Pont et de la Bithynie une créance
privilégiée sur les biens de leurs débiteurs. Il serait à propos que vous
voulussiez bien, seigneur, faire à ce sujet un règlement. — Qu’on décide d’après les lois propres à chaque ville. Si
elles n’ont pas un privilège sur les autres créanciers, je ne dois pas le
leur donner aux dépens des particuliers.
Les habitants d’Apamée me
prient d’examiner leurs comptes, malgré leur privilège de s’administrer
eux-mêmes. Dois-je le faire ? — Oui,
puisque eux-mêmes le demandent.
Julius Piso a reçu en don 40
000 deniers du sénat d’Amisus. L’ecdicus les réclame d’après vos édits
qui défendent ces libéralités. — Si le
don remonte à plus de vingt ans, qu’il subsiste ; car il faut avoir égard au
repos des citoyens, tout en ménageant les deniers publics.
Les Nicéens prétendent avoir
reçu d’Auguste le privilège de recueillir l’héritage de leurs concitoyens
morts intestats. — Examinez cette
affaire en présence des parties, avec Gemellinus et mon affranchi Epimachus,
tous deux procurateurs, et ordonnez ce qui vous paraîtra juste.
Les Byzantins dépensent chaque
année 12 00.0 sesterces pour vous faire porter leur hommage, et 3000 pour
envoyer un des leurs saluer le gouverneur de Mœsie. — C’est assez qu’ils me fassent parvenir par votre entremise
leur décret d’hommage. Quant au gouverneur de Mœsie, il leur pardonnera, s’ils
lui font leur cour à meilleur marché. Réponse qui plut
certainement à Byzance, car, malgré la police faite dans l’empire, aller à
Rome n’était pas seulement une dépense, mais un péril. Pétrone, Apulée,
montrent que les détrousseurs de grands chemins étaient nombreux, et nous
avons un marbre où de braves gens de Mehadia sur le Danube, envoyés par leurs
concitoyens, ont gravé leur reconnaissance envers les Divinités des
eaux pour les avoir ramenés sains et saufs dans leur cité[148].
III. Les décurions.
On vient de voir Pline proposer à Trajan de contraindre
les décurions à souscrire des emprunts dont ils n’avaient pas besoin. C’est l’idée
de mettre au compte des curiales les charges des villes qui commence à se
faire jour et qui rendra bientôt leur condition déplorable[149]. Déjà on
appelle à la curie plus de membres que le nombre réglementaire, et ces
membres doivent payer un honneur qu’ils n’ont pas toujours sollicité. Pline
voit dans cette exaction une source de revenu pour les cités, et voudrait en
faire une prescription légale. Dans certaines
villes de la province, dit-il, les
décurions sont obligés, en entrant au sénat, de donner les uns 1000, les
autres 2000 deniers. Il vous appartient, seigneur, de faire une loi générale.
— Non. Le plus sûr est de suivre la coutume de
chaque ville, surtout à l’égard de ceux qu’on fait décurions malgré eux.
La loi de Pompée, observée en
Bithynie, exige trente ans pour exercer une magistrature et entrer à la
curie. Mais un édit d’Auguste a permis de remplir à vingt-deux ans les
magistratures inférieures. J’en ai conclu que ceux qui arrivaient aux charges
à cet âge devaient siéger au sénat municipal. Hais que faire à l’égard des
autres qui, ayant l’âge prescrit pour les magistratures, ne les ont pas
obtenues ?[150] — Leur fermer la curie.
IV. Droit de cité.
Pour obtenir le droit de cité
dans une ville, il faut, d’après la loi de Pompée, être originaire, de la
province. Beaucoup de décurions appartiennent à d’autres pays. Faut-il les
exclure de la curie ? — Non, mais
veiller à ce que la loi soit, à l’avenir, mieux observée.
V. Le defensor civitatis.
Dans quelques villes on trouve déjà des charges mal définies
qui deviendront celle du defensor civitatis,
dont le rôle sera si considérable au quatrième et au cinquième siècle. Byzance a un centurion légionnaire pour veiller sur ses privilèges.
Juliopolis de Bithynie vous demande la même faveur. — Byzance est une grande ville où quantité d’étrangers
abordent. Un gardien de ses droits lui est nécessaire. Si j’en donne un à
Juliopolis, toutes les petites villes voudront en avoir. Il vous appartient
de veiller vous-même à ce qu’il ne soit fait aucun dommage aux cités de votre
gouvernement.
On a vu plus haut qu’Amisus avait un ecdicus, sorte d’avocat de la ville ou de
tribun chargé de défendre ses intérêts auprès du gouverneur[151].
VI. Questions religieuses.
Peut-on, à Nicomédie, déplacer
un temple de Cybèle ? — Oui. Le sol
provincial n’est pas capable de recevoir les consécrations romaines.
On me demande à transférer des
tombeaux. A Rome, il faut une décision des pontifes. Que dois-je faire ici ?
— Accorder ou refuser selon la justice. Il serait
par trop dur d’imposer aux provinciaux de venir consulter à ce sujet les
pontifes romains.
J’ai trouvé une maison en
ruine pour y mettre le bain des Prusiens. Le propriétaire avait voulu y bâtir
un temple à Claude. Mais il n’en reste rien. — Mettez le bain dans cette maison, à moins que le temple n’ait
été construit, car, lors même qu’il aurait disparu, la place demeure
consacrée.
On dit, seigneur, qu’une femme
et ses fils ont été ensevelis au même lieu où s’élève votre statue. La statue
est dans une bibliothèque, les sépultures dans une grande cour enfermée de
galeries. Je vous supplie de m’éclairer dans le jugement de cette affaire.
Elle eût été grave, en effet, sous un autre prince, car une accusation de
lèse-majesté en pouvait sortir. Trajan s’irrite qu’on le croie capable de l’autoriser
et répond : Vous ne deviez pas hésiter sur une
telle question, car vous savez fort bien que je ne me propose pas de faire
respecter mon nom par la terreur et par les jugements de majesté. Laissez là
cette accusation que je ne permettrais pas de recevoir.
VII. Discipline militaire.
Faut-il faire garder la prison
par des soldats, ou, selon la coutume, par des esclaves publics ? J’ai mis
des uns et des autres. — Cela ne vaut
rien. Il faut s’en tenir à l’usage et ne pas éloigner le soldat du drapeau.
Le préfet du littoral pontique
qui n’a que douze soldats, en demande davantage. — Non. Tous les chefs veulent étendre leur commandement, et
les petites garnisons détruisent l’esprit militaire.
Des esclaves ont été trouvés
parmi les recrues. Qu’en faut-il faire ? — S’ils ont été choisis, la faute est à l’officier recruteur
; s’ils ont été donnés comme remplaçants, on s’en prendra aux remplacés ; si,
connaissant leur condition, ils sont venus s’offrir d’eux-mêmes, punissez-les.
VIII. Discipline civile.
Dans beaucoup de villes, des
gens condamnés aux mines ou à combattre comme gladiateurs servent d’esclaves
publics, quelques-uns avec des gages. Que faire ? — Exécuter les sentences, excepté pour ceux dont la
condamnation remonte à plus de vingt ans.
Un homme, banni à perpétuité
par Bassus, est resté dans la province sans user du droit que lui donnait un
sénatus-consulte, après la cassation des actes de Bassus, de réclamer dans
les deux ans un nouveau jugement. — Il
a désobéi à la loi ; envoyez-le aux préfets du prétoire, pour un supplice
plus rigoureux.
Ceux qui prennent la robe
virile, se marient, font l’inauguration d’un ouvrage public, ou entrent en
exercice d’une magistrature, ont coutume d’inviter les décurions et beaucoup
de monde, quelquefois plus de mille personnes, et de donner à chacune un
denier ou deux. Je crains que ces réunions ne soient des assemblées défendues
par vos édits. — Vous avez raison.
Mais j’ai fait choix de votre prudence pour réformer tous les abus de cette
province.
Un grand incendie a désolé
Nicomédie. Ne serait-il pas bon d’établir un collège de cent cinquante
artisans chargés de veiller au feu ? — Non,
les corporations ne valent rien.
Cette correspondance nous gâte Pline : timoré, indécis,
hésitant sur tout, il fait, comme gouverneur d’une grande province, la plus
triste figure[152]. Trajan, au
contraire, est net, précis ; il répond en maître expérimenté et juste,
commande sans phrase, et, en tout, fait respecter la loi. Sous ses paroles
affectueuses pour son très cher Secundus[153], on sent l’impatience
de l’homme supérieur qu’un lieutenant incapable dérange chaque jour pour des
misères. Tuais ce qui résulte surtout de cette correspondance, c’est la
preuve de l’omnipotence impériale et des progrès effrayants que faisait le
gouvernement central. Il est vrai que, sans une forte administration générale,
les affaires de l’État ne se font pas et que les affaires locales courent le
risque de se faire mal ; mais tout envahir, le droit civil, comme le droit
pénal des cités, l’administration des finances, comme celle de la voirie et
des travaux publics : c’était trop. On pourrait déjà presque dire qu’il ne se
remuait pas un pavé dans les provinces sans une requête à Rome, qu’il fût
question de couvrir un ruisseau fangeux ou de déplacer un mort dont le
tombeau s’était écroulé ; et l’on envoyait un courrier au prince pour lui
demander quelle garde on mettrait à la porte d’une prison.
Ainsi l’empereur fait la loi et, par lui-même ou par ses lieutenants,
il décide les cas particuliers ; il gouverne l’empire, et l’on pourrait dire
qu’il administre les cités, car il n’hésite pas à regarder dans toutes leurs
affaires, que ces villes soient simples municipes tombés sous la puissance de
Rome par la conquête ou cités alliées et libres, rattachées à l’empire par un
traité. Trajan respecte, il est vrai, leurs lois, leurs privilèges, parce qu’il
est habile et sage ; mais son légat ne doute pas que le prince ne puisse tout
changer. Après la lecture de cette correspondance officielle, on se fait
aisément l’idée de ce que l’empire deviendra, quand l’empereur, au lieu d’être
Trajan, sera Commode ou Élagabal. Nous ne sommes encore qu’au second siècle,
et nous voyons poindre le mal qui va miner l’empire. Trajan parle de gens que
l’on fait entrer malgré eux dans la curie[154], et Pline
considère déjà les magistrats municipaux comme les serfs de la chose
publique.
On dira que Pline avait une mission spéciale[155], que, comme
Libon l’aura sous Marc-Aurèle[156], il avait
obtenu de l’empereur l’autorisation de prendre ses conseils dans les cas
douteux ; qu’enfin tous Ies légats n’accablaient pas le prince de lettres
aussi nombreuses : c’est possible, mais nous ne pouvons l’affirmer, puisque
ces correspondances officielles ont péri, une seule exceptée, celle du
gouverneur de Bithynie. Dans tous les cas, que l’empereur décidât de Rome ou
que le proconsul prononçât sur place, le résultat était le même : la
dépendance des provinciaux. Des empereurs comme Caligula et Néron, tout
occupés de leurs plaisirs, laissaient aller les choses à leur gré ; des
princes comme Tibère et Vespasien, qui trouvaient suffisamment lourde la
tâche de gouverner l’empire, ne songeaient pas aux menus détails de l’administration
des cités. Trajan, homme de commandement et de discipline, voulut mettre l’ordre
en tout, ce qui le conduisit à regarder partout. Il a déjà créé les curateurs
pour contrôler les finances de certaines villes ; il envoyait des
commissaires extraordinaires pour y supprimer les abus. C’était bien. Mais
ces mesures plaçaient le gouvernement sur une pente où il glissera
facilement, jusqu’à venir se mêler, selon son bon plaisir, des plus petites
affaires et en retarder la marche. Un affranchi de Vespasien offre aux
Cérites de construire à ses frais une salle de réunion pour leurs Augustaux,
à condition qu’on leur en donne la place. Le conseil municipal fait l’abandon
du terrain, mais il faut l’assentiment du curateur, et celui-ci met dix mois
à l’envoyer[157].
La plus importante des lettres de Pline est relative aux
chrétiens. Ceux-ci ne justifiaient pas les craintes inspirées d’abord par
leur adoration d’un crucifié, qui avait paru à quelques-uns une menace de
révolte. Saint Paul avait prêché la soumission aux puissances, au prince qui est le ministre de Dieu[158], et saint
Pierre écrivait : Rendez à chacun l’honneur qui
lui est dû[159]. L’Église ne
travaillait même pas directement à ruiner l’esclavage, cette base de la
société païenne. Les fidèles avaient des esclaves, et des esclaves chrétiens,
à qui Pierre disait : Serviteurs, soyez soumis et
respectueux envers vos maîtres, non seulement lorsqu’ils sont doux et bons,
mais encore lorsqu’ils sont rudes et fâcheux[160]. Ils vivaient
donc paisibles et dans l’ombre, multipliant au milieu des humbles par la
vertu de cette charité qui leur montrait des frères dans tous les misérables.
Mais la condition essentielle de leur culte était la prière en commun. Or
Trajan n’aimait point les associations[161] ; on vient de
voir qu’il n’en voulait même pas contre les incendies, et que les réunions
trop nombreuses, fût-ce pour une fête, lui étaient suspectes. Il sentait,
sans pouvoir s’en rendre compte, comme un travail souterrain qui minait la
société romaine, et ses lettres portent la trace de l’irritation qu’il
éprouvait contre tout ce qui voulait sortir de l’ordre établi. Aussi ne
faut-il pas s’étonner si les secrètes agapes des chrétiens lui parurent
dangereuses. D’ailleurs on est forcé de répéter que, suivant la légalité de
ce temps, une attaque contre les dieux de Rome était une insulte à l’empereur,
et que, par suite de l’union impie de la politique et de la religion, les
incrédules à l’apothéose du prince devenaient des rebelles à son autorité. Il
en va toujours ainsi. Le présent et l’avenir sont trop souvent deux mortels
ennemis qui, dans l’éternelle transformation des choses, se heurtent et se
combattent. Le vieux monde destiné à périr se défend avec colère contre ce
qui l’attaque et bientôt le tuera. La ciguë de Socrate, la croix de saint
Pierre, le bûcher de Jean Huss, le pilori des puritains, la pastille des
libéraux, ont fait des victimes, mais aussi des morts triomphants. Trajan,
esprit étroit et dur, comme toute cette race romaine, malgré sa véritable
grandeur, était ennemi des nouveautés, et incapable de comprendre celle qui
se produisait alors. Ce serait même un sujet d’étonnement profond de voir des
hommes tels que Tacite, Trajan, Pline, Suétone, Marc-Aurèle, ne pas s’apercevoir
de l’immense révolution qui se préparait, si l’histoire tout entière ne
déposait de l’ignorance où les puissants du jour s’obstinent à rester
touchant les puissances du lendemain.
Je me fais un devoir, seigneur,
écrit Pline à Trajan, de vous exposer tous mes
scrupules..., je n’ai jamais pris part au procès d’aucun chrétien et ne sais
sur quoi porte l’information qu’on fait contre eux ni de quelle peine ils
doivent être frappés. Faut-il distinguer entre les âges et pardonner à qui se
repent ? Est-ce le nom seul qu’on punit en eux ou les crimes qui s’attachent
à ce nom ? Voici la règle que j’ai suivie. Je leur demande s’ils sont
chrétiens. Ceux qui l’avouent, je les interroge une seconde et une troisième
fois, en les menaçant du supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai
envoyés ; car, de quelque nature que fût ce qu’ils confessaient, ils étaient
toujours coupables de désobéissance et d’une inflexible obstination. Parmi
ces fous j’ai réservé ceux qui sont citoyens romains pour les £aire conduire
à Rome[162].
J’ai reçu des dénonciations
anonymes contre de prétendus chrétiens ; mais ces gens ont, en ma présence,
invoqué les dieux dans les termes que je leur prescrivais, offert de l’encens
et du vin à votre image, et, chose à quoi l’on ne saurait, dit-on,
contraindre des chrétiens véritables, ils ont maudit leur Christ. Ceux-là, je
les ai absous. D’autres ont reconnu qu’ils avaient été chrétiens, en
déclarant qu’ils ne l’étaient plus depuis plusieurs années ; tous ont accompli
les rites devant votre image et les statues des dieux ; tous aussi ont maudit
le Christ.
Ils prétendaient que toute la
faute ou l’erreur consistait pour eux en ceci, qu’à un jour marqué ils s’assemblaient,
avant le lever du soleil, pour chanter tour à tour des vers à la louange de
Christ., comme s’il eût été dieu ; qu’ils s’engageaient par serment à ne
point manquer à leurs promesses, à ne commettre ni vol, ni violence, ni adultère,
à ne point nier un dépôt ; qu’enfin ils se réunissaient encore pour manger en
commun des mets innocents[163] ; mais qu’ils avaient cessé de le faire depuis l’édit par
lequel, selon vos ordres, j’avais interdit toute sorte d’assemblée. Pour m’assurer
de la vérité de ces paroles, j’ai mis à la torture deux filles esclaves qu’ils
disaient attachées au ministère de leur culte et n’ai trouvé qu’une mauvaise
superstition poussée à l’excès. Par cette raison, j’ai suspendu l’enquête
pour prendre vos ordres.
L’affaire mérite attention par
le nombre de ceux qui se trouvent en péril. Beaucoup de personnes, en effet,
de tout pige, de tout ordre, de tout sexe, sont déjà et devront être
impliquées dans l’accusation, car ce mal contagieux a envahi non seulement
les cités, mais les bourgs et les villages.
En bon courtisan, Pline ajoute que le mal peut être
arrêté, qu’il l’est déjà, puisque les temples désertés voient la foule
revenir, que les sacrifices recommencent, qu’on vend beaucoup de victimes
restées auparavant sans acheteurs ; et, en honnête homme qui ne voudrait pas
envoyer au supplice des gens inoffensifs, il demande au prince de faire grâce
au repentir.
Trajan ne parait pas s’être beaucoup ému du tableau
contradictoire que lui faisait son légat : cette contagion impie qui gagnait
les villes et les hameaux, cette vie nouvelle qui se montrait dans les
temples ; et il refusa de prendre une mesure générale. On ne saurait, dit-il, établir pour les procès des chrétiens une forme certaine
qui puisse être suivie partout. N’en faites pas recherche ; mais s’ils sont
accusés et convaincus, punissez-les. Ne recevez pas de dénonciations anonymes
et ne condamnez point sur des soupçons.
On a vu, par les mesures que prirent à l’égard des druides
Auguste, Tibère et Claude, quel arsenal de lois la république avait légué à l’empire,
pour frapper les cultes ennemis de celui de Rome. Les accusations de
lèse-majesté, de sacrilège, d’association illicite et de magie pouvaient être
tournées contre les chrétiens, et toutes entraînaient la mort. Trajan, qui n’aimait
pas les assemblées secrètes, n’autorisa pourtant pas les poursuites de ce
chef, à propos d’hommes de petite condition et qu’on lui représentait comme
inoffensifs, mais il ne permit pas les publiques offenses aux dieux de l’empire,
et, avec la constitution particulière à l’État romain, avec cette religion
officielle dont nous avons montré le caractère’, il ne pouvait pas les
permettre. Aussi sa réponse est-elle : Ne
cherchez pas des coupables, mais punissez ceux qui, par acte public,
outrageront les autels de la patrie. Ce sentiment était si
profondément romain, que deux consulaires d’humeur très pacifique s’expriment
à ce sujet de la même façon, à trois siècles de distance : Que nul, dit Cicéron, n’ait des dieux particuliers ; que personne n’introduise
des dieux nouveaux ou étrangers, s’ils n’ont pas été admis par l’autorité
publique[164] ; et sous
Alexandre Sévère, Dion Cassius (LII, 36) faisait
recommander par Mécène à Auguste de punir les adorateurs des faux dieux.
De pareils ordres provoqués par de semblables demandes
furent sans doute envoyés ailleurs, et ce qui avait lieu en Bithynie a dû se
passer en d’autres provinces, même avec plus de rigueur là où se trouvaient
des gouverneurs moins humains et des populations moins paisibles, qui
croyaient venger leurs dieux en criant dans l’amphithéâtre : Les chrétiens aux bêtes ! Ainsi la tradition de
l’Église place sous ce règne les martyres de saint Ignace, évêque d’Antioche,
et de saint Siméon, évêque de Jérusalem, martyres que nous ne racontons
point, parce que l’histoire intérieure de l’Église ne peut rentrer dans le
cadre de cette histoire générale de l’empire[165].
 Les deux lettres qui viennent d’être citées mettent
plusieurs points en lumière. Pline, né sous Néron avant l’incendie de Rome,
avocat, jurisconsulte, sénateur et consulaire, mêlé à toute la vie politique
de son temps, savait fort mal, lorsqu’il arriva en Bithynie, ce qu’était un
chrétien : preuve qu’il n’y avait pas encore eu contre eux d’information
juridique, de décision solennelle ni de persécution générale[166]. Il les frappe
parce qu’il les regarde comme s’étant mis en révolte contre la loi religieuse
de l’empire, en méprisant ses dieux ; contre la loi civile, en faisant des
assemblées illicites ; contre l’autorité proconsulaire, en lui refusant
obéissance. Et cependant il montre la simplicité de leur foi, la pureté de
leur vie, ces agapes fraternelles, ces chants pieux qui étaient alors tout
leur culte, et le caractère fondamental de cette religion des pauvres qui
mettait dans le sacerdoce, ou du moins dans les honneurs de la naissante
Église, deux filles esclaves. C’est qu’eux et lui habitaient en esprit dans
deux mondes différents et, tout en parlant la même langue, ne pouvaient se
comprendre. Aussi suis-je assuré que Trajan, le gardien rigoureux de la
discipline militaire et civile, envoyait un chrétien au supplice sans plus d’hésitation
ai de remords que s’il eût été question d’un soldat réfractaire ou d’un esclave
fugitif[167].
Ces cruautés nous révoltent et ces violations des droits de la conscience
nous indignent ; mais il faut reconnaître que les contemporains de Trajan
pensaient comme lui et ne pouvaient point penser autrement ; que, pour eux,
les chrétiens étaient des rebelles ; et qu’en effet, ces hommes qui allaient
briser l’ancienne société, étaient les plus grands révolutionnaires que le
monde eût encore vus. Nous sommes avec eux contre leurs persécuteurs,
toutefois avec la douloureuse obligation de dire qu’ils ont eu le sort de
tous les réformateurs, celui qu’eux-mêmes ont infligé plus tard à quiconque
essaya aussi de remplacer l’ancienne loi par une loi nouvelle[168]. Y a-t-il bien
longtemps qu’agir comme les chrétiens de Pline, avec d’autres idées, n’expose
plus au même péril ? Ah ! que la justice est lente à venir et que l’homme
marche péniblement à sa propre délivrance ! Les deux lettres qui viennent d’être citées mettent
plusieurs points en lumière. Pline, né sous Néron avant l’incendie de Rome,
avocat, jurisconsulte, sénateur et consulaire, mêlé à toute la vie politique
de son temps, savait fort mal, lorsqu’il arriva en Bithynie, ce qu’était un
chrétien : preuve qu’il n’y avait pas encore eu contre eux d’information
juridique, de décision solennelle ni de persécution générale[166]. Il les frappe
parce qu’il les regarde comme s’étant mis en révolte contre la loi religieuse
de l’empire, en méprisant ses dieux ; contre la loi civile, en faisant des
assemblées illicites ; contre l’autorité proconsulaire, en lui refusant
obéissance. Et cependant il montre la simplicité de leur foi, la pureté de
leur vie, ces agapes fraternelles, ces chants pieux qui étaient alors tout
leur culte, et le caractère fondamental de cette religion des pauvres qui
mettait dans le sacerdoce, ou du moins dans les honneurs de la naissante
Église, deux filles esclaves. C’est qu’eux et lui habitaient en esprit dans
deux mondes différents et, tout en parlant la même langue, ne pouvaient se
comprendre. Aussi suis-je assuré que Trajan, le gardien rigoureux de la
discipline militaire et civile, envoyait un chrétien au supplice sans plus d’hésitation
ai de remords que s’il eût été question d’un soldat réfractaire ou d’un esclave
fugitif[167].
Ces cruautés nous révoltent et ces violations des droits de la conscience
nous indignent ; mais il faut reconnaître que les contemporains de Trajan
pensaient comme lui et ne pouvaient point penser autrement ; que, pour eux,
les chrétiens étaient des rebelles ; et qu’en effet, ces hommes qui allaient
briser l’ancienne société, étaient les plus grands révolutionnaires que le
monde eût encore vus. Nous sommes avec eux contre leurs persécuteurs,
toutefois avec la douloureuse obligation de dire qu’ils ont eu le sort de
tous les réformateurs, celui qu’eux-mêmes ont infligé plus tard à quiconque
essaya aussi de remplacer l’ancienne loi par une loi nouvelle[168]. Y a-t-il bien
longtemps qu’agir comme les chrétiens de Pline, avec d’autres idées, n’expose
plus au même péril ? Ah ! que la justice est lente à venir et que l’homme
marche péniblement à sa propre délivrance !
Trajan, qui inscrit au code pénal de Rome un nouveau
crime, celui de christianiser, essaye en même temps de consolider les
maîtres de l’Olympe sur leurs autels croulants. Dans une longue inscription
récemment découverte, nous avons la preuve de sa sollicitude pour rendre aux
anciens dieux leurs honneurs et à une vieille institution religieuse son
autorité. Du temps de Strabon, Delphes était fort pauvre, quoique le domaine
du temple, fût très riche, puisqu’une, seule de ses forêts d’oliviers, sur un
des contreforts du Parnasse, donne aujourd’hui un revenu annuel de 70 000
drachmes. Mais ce domaine avait été envahi de tous côtés par les cités
voisines, malgré un jugement solennel des amphictyons qui, cent
quatre-vingt-dix ans avant notre ère, en avait fixé les limites. Trajan
chargea un des grands personnages de l’empire de faire respecter comme loi
souveraine la sentence amphictyonique, de rendre au dieu ses biens et de
remettre en place les vingt-six bornes sacrées[169]. Était-ce de sa
part zèle pieux ? Nullement. Apollon et ses confrères en divinité lui étaient
parfaitement indifférents. Mais, à l’exemple d’Auguste et de Vespasien, il considérait
la religion officielle comme une nécessité d’ordre public. C’était un
conservateur à outrance, et il faut bien reconnaître qu’il ne pouvait pas
être autre chose.

III. — GUERRE PARTHIQUE.
Si l’on excepte les mesures contre les chrétiens, Trajan
avait bien rempli son rôle de maître du monde romain. L’immense machine gouvernementale,
tant de fois dérangée par les intrigues, les complots, la guerre civile,
était remontée et marchait régulièrement avec trois forces, bonnes en tous
temps : l’ordre dans les cités, la justice dans l’administration, le respect
dans les sujets pour la loi et pour celui qui la représentait. Au bout de
quelques années, Trajan crut avoir gagné, par ses soins pacifiques, le droit
de revenir à ses goûts militaires et de rajeunir ces triomphes daciques par
de nouvelles victoires. La vieillesse arrivait : il avait cinquante-neuf ans,
peut-être soixante-deux ; s’il rie reprenait pas à ce moment les armes, il ne
les reprendrait jamais, et sa gloire se bornerait à avoir forcé des villes de
bois et battu des peuples que de simples légats avaient vus fuir devant eux. La Bretagne était un trop
petit théâtre, bon pour Claude ; les Germains ne donnaient prétexte à aucune
guerre ; la Dacie
se latinisait paisiblement, et des montagnes de la Calédonie au
bord de l’Euxin il lie s’offrait pas un champ de bataille où pût s’accomplir
quelque exploit retentissant. Sur la rive méridionale de la Méditerranée,
l’empire avait atteint, des cataractes de Syène au détroit d’Hercule, une
frontière infranchissable, le désert ; donc rien à faire ni en Afrique ni en
Europe ; du moins il le croyait. Restait l’Asie. De ce côté on pouvait
trouver à accomplir ce que l’histoire complaisante appelle de grandes choses
— par exemple, faire de l’Arménie un poste avancé contre la barbarie
asiatique, comme la Dacie
l’était contre la barbarie européenne ; dompter l’Euphrate et le Tigre, comme
l’avaient été le Rhin et le Danube ; en un mot, achever à l’orient l’œuvre de
consolidation des frontières de l’empire. C’était la logique du règne de
Trajan ; mais pour lui la guerre était surtout un ardent désir de gloire[170], et il avait eu
raison de se faire représenter, sur son arc de triomphe, sacrifiant à Mars : c’était
le dieu qu’il avait le mieux servi.

Le motif de l’expédition fut un effort des Arsacides pour
rétablir leur influence en Arménie. Khosroès avait fait arriver son neveu
Exédarès au trône de ce pays, que les Romains voulaient garder au moins sous
leur influence ; et Trajan n’avait pas oublié qu’à la cour de Ctésiphon on
avait sans doute prêté une oreille complaisante aux ouvertures du Décébale
pour former une vaste coalition qui eût menacé l’empire en Asie, tandis que
les Daces l’attaqueraient de front en Europe. L’empereur se rendit durant l’hiver
(113) à
Athènes, où Khosroès, inquiet de la grandeur des préparatifs qui le
menaçaient, lui envoya une humble ambassade, avec de riches présents, se
bornant à demander que le Romain donnât l’investiture dit royaume d’Arménie à
un aube de ses neveux, Parthamasiris. L’empereur renvoya l’ambassade, les
présents, et dit qu’il ferait connaître sa réponse lorsqu’il serait au bord
de l’Euphrate. Au commencement de l’an 114, il arrivait à Antioche, et, pour
que toutes ses capitales eussent des trophées de sa guerre dacique, il déposa
dans le temple de Jupiter Kasios des offrandes qu’Hadrien célébra en vers
grecs. À Jupiter Kasios, le maître des dieux,
Trajan, le fils d’Énée et le maître des hommes, fait cette offrande : deux
coupes richement ciselées et une corne d’urus garnie d’or. Il les a prises
aux Gètes superbes qu’il terrassa de sa lance. Toi dont la tête se cache
clans les nuages, ô dieu, accorde-lui la victoire dans la guerre Achéménide,
et tu te, réjouiras d’avoir de doubles dépouillés, celles des Arsicides à
côté de celles des Gètes[171].
Les événements militaires des années 114-117, nous sont
fort mal connus, et la chronologie des campagnes parthiques est incertaine.
Trajan eut d’abord à rétablir la discipline dans les légions amollies et
séditieuses des provinces orientales ; il y mit sa sévérité habituelle, et
tout plia sous cette main énergique. Il entra en campagne au cœur même de l’été
et remonta par la vallée de l’Euphrate jusqu’à la grande Arménie. Dans une
première lettre, Parthamasiris avait pris le titre de roi : elle lui lut
renvoyée sans réponse ; dans une seconde, il supprima le titre, mais demanda
qu’on lui expédiât, pour traiter, le gouverneur de la Cappadoce. L’empereur
le somma de venir lui-même. L’Arménien hésitait à se confier à la bonne foi
romaine ; cependant, les légions avançant toujours, il vint au camp, salua l’empereur
assis sur son tribunal, avec l’armée entière rangée derrière lui, déposa à
ses pieds la couronne qu’il avait sur la tète, et, debout, silencieux, avec
la dignité grave des Orientaux, il attendit que Trajan lui permît de
reprendre son diadème. A la vue de cet Arsacide, de ce roi découronné qui
leur semble un captif, les soldats poussent un cri immense, comme à la suite
d’une victoire, et proclament leur général imperator. Parthamasiris se croit
tombé dans un piège et cherche à fuir : entouré de toutes parts, il demande
que l’empereur lui épargne au moins la honte de parler au milieu de cette
foule. On le conduit au prétoire, mais le Romain veut savourer l’humiliation
d’un descendant de ceux qui portent le titre de roi des roi, et rien ne se
conclut au prétoire ; le prince, ramené au milieu du camp, est forcé d’exposer
ses demandes. Cependant je n’ai pas été vaincu !
s’écrie-t-il ; je n’ai pas été fait prisonnier !
C’est volontairement que je suis venu, dans la pensée que mon royaume me
serait rendu par vous, comme il l’a été à Tiridate par Néron. — L’Arménie, répond Trajan, appartient à Rome et elle aura un gouverneur romain.
Des Arméniens, des Parthes, avaient accompagné le prince au camp. Trajan retint
les premiers comme étant déjà ses sujets et laissa Parthamasiris emmener les
autres en leur donnant une escorte qui devait les empêcher de communiquer avec
personne. Nous ignorons le détail de ce qui se passa ensuite. Eutrope parle du
meurtre de Parthamasiris, et dans un fragment retrouvé sur un palimpseste, un
ami de Marc-Aurèle disait : Il est difficile
d’excuser Trajan au sujet de la mort de ce roi. Sans doute il périt justement
au milieu du tumulte qu’il avait excité ; mais, pour l’honneur de Rome-,
mieux eût valu que ce suppliant s’en retournât sans dommage que de souffrir
un supplice mérité[172]. Parthamasiris
fut-il tué en essayant d’échapper a son escorte, ou supposa-t-on une attaque
pour avoir une occasion de se défaire de lui ? On ne le sait ; mais il est
clair que, s’il ne tomba pas dans un guet-apens au départ, il y était tombé à
l’arrivée. Cette façon de renverser un roi n’avait rien d’héroïque, et elle a
laissé une tache de sang sur la main de Trajan. Ni lui ni personne alors ne
la vit. Cet étranger gênait : on l’avait supprimé ; la moralité politique des
anciens ne s’en effarouchait pas, et l’ami de Marc-Aurèle était seul
peut-être à s’en étonner. On osa même, à Rome, frapper une médaille où
Parthamasiris est représenté tête nue et pliant le genou, avec cette brève et
dédaigneuse légende : Rex Parthus, sans même le nom de son
royaume[173].
Trajan, par sa renommée, par la masse imposante de ses
forces, causait un tel effroi, que les peuples et les rois, de l’Euphrate au
Caucase et de l’Euxin à la
Caspienne, se soumirent sans combat. Depuis deux siècles,
Rome rêvait cette conquête, et avec raison, car elle lui aurait donné les
clefs d’une des portes de l’Asie, le Caucase, dont les étroits défilés[174] sont si faciles
à rendre impraticables, et elle lui aurait assuré en Arménie une position
excellente pour l’attaque comme pour la défense. Dans ses mains, les hautes
montagnes de ce pays seraient devenues une forteresse inexpugnable, qui
aurait couvert l’Asie Mineure, même la Syrie. Bien établis à la tête des vallées du
Tigre et de l’Euphrate, les Romains eussent rendu toute attaque contre leurs
riches provinces impossible ou du moins fort dangereuse pour l’assaillant.
Avant d’atteindre, en effet, les deux grands passages du fleuve à Thapsaque
et à Zeugma, où viennent mourir les dernières collines de l’Amanus[175], une armée
parthique aurait été contrainte de longer le pied des montagnes arméniennes,
avec le risque continuel d’être prise de flanc ou tournée. Plus au sud, c’est
le désert qui défend la Syrie,
et qui la défendit bien jusqu’au jour où le fanatisme religieux fit sortir de
ces solitudes un ennemi inattendu.
L’occupation de l’Arménie était donc commandée par de grands
intérêts, et Trajan avait bien fait, sauf le moyen employé, de trancher une
question que Pompée, César, Antoine, Auguste, n’avaient point résolue, les
uns faute de temps, les autres faute d’habileté ou de résolution. Nais plus
cette acquisition était importante, plus il fallait l’assurer à l’empire, en
donnant à la nouvelle province une organisation civile et militaire qui la
fit promptement romaine, et en employant à cette œuvre de patience les
forces, les ressources, le temps que Trajan allait gaspiller dans des
expéditions inutiles.
Il passa l’hiver de 114-115 à Antioche, qui, durant son
séjour, fut presque détruite par un tremblement de terre : quantité de gens
notables y trouvèrent la mort ; le consul, avec Vergilianus Pedo, y fut
grièvement blessé, et Trajan manqua périr. Les païens attribuèrent sans doute
ce désastre à la colère des dieux, irrités par l’impiété chrétienne, et saint
Ignace, évêque d’Antioche, souffrit, vers ce temps-là, le martyre. On a vu
que Trajan n’hésitait pas à considérer les chrétiens comme des rebelles et,
lorsqu’ils faisaient profession publique de leur foi, comme des rebelles, qu’il
fallait punir. Il n’aura donc éprouvé aucun scrupule, en face d’une foule
affolée de peur, à satisfaire du même coup ses dieux, la populace et les lois
détestables de l’empire[176].
Au printemps, il franchit l’Euphrate, sans doute a Zeugma,
et se rendit à Édesse, dont le prince fut sauvé par son fils[177]. De cette
ville, il poussa, au travers de la Mésopotamie, une colonne d’avant-garde conduite
par Lusius Quietus ; elle prit la forte place de Singara, qui commandait la
route du désert ; lui-même enleva Nisibe, et, comme tous les chefs de cette
région étaient en guerre entre eux ou en révolte contre Khosroés, il put
atteindre sans peine les bords du Tigre, en face de l’Adiabène. C’est là qu’Alexandre
avait vaincu Darius et conquis l’Asie ; Trajan aimait à suivre les traces du
héros macédonien dont il espérait la fortune. Le Tigre avait dans ces parages
un lit large et profond, il fallait une flotte pour le franchir et pour
assurer les communications. On employa l’arrière-saison à construire dans les
forêts de Nisibe des bateaux qui se démontaient et que des chariots portèrent
aux points choisis pour le passage. Étonnés de voir leur fleuve si facilement
vaincu et cette barrière tombée, les Barbares ne résistèrent pas à une vive
attaque, qui donna aux Romains la rive gauche. Quoique ce succès ne valet pas
la victoire d’Arbelles, il ouvrit, comme elle, la route de Babylone, que les
Parthes, affaiblis par leurs divisions, n’osèrent fermer. Trajan y entra avec
le surnom de Parthicus, que ses
soldats lui donnèrent, et sacrifia aux mânes d’Alexandre dans le palais où le
héros avait expiré (116).
L’opinion était éblouie par ces faciles triomphes. Chaque
jour le sénat apprenait que de nouveaux peuples s’étaient soumis à sa puissance
; que des rois consentaient à tenir de lui leur couronne ; que des pays
portant les grands noms d’Arménie, de Mésopotamie et d’Assyrie, qui
rappelaient : ceux de Ninus, de Sémiramis, de Xerxès et d’Alexandre, étaient
sujets de son empire. Avec le puéril empressement d’un jeune victorieux,
Trajan se hâtait de déclarer réunies pour jamais au domaine du peuple romain
les régions que traversait son armée. L’Arménie formait déjà une province ;
il en fit deux autres : celle de Mésopotamie, entre le Tigre et l’Euphrate,
au pied des montagnes arméniennes ; celle d’Assyrie, comprenant la vallée
orientale du Tigre jusqu’à la chaîne du Zagros, qui la sépare de la Médie. En même
temps, de grands préparatifs s’achevaient ; toute une flotte, amenée par l’Euphrate,
était traînée dans le Tigre, à travers l’isthme qui s’étend entre les deux
fleuves, pour attaquer Ctésiphon[178]. Les Parthes ne
défendirent pas mieux leur capitale que leurs provinces. Khosroès ou son
successeur s’enfuit au fond de la Médie ; la fille du grand roi, son trône d’or
massif, furent pris à Suses, et Séleucie, l’ancienne capitale grecque, ouvrit
ses portes. Maître des principales places de la Babylonie, Trajan
descendit le Tigre avec sa flotte, recevant sur son passage a soumission des
chefs riverains, et arriva jusqu’au golfe Persique, où, voyant nu navire qui
partait pour l’Inde, il s’écria : Que ne suis-je
plus jeune, je donnerais à Rome pour frontière les limites de l’empire d’Alexandre
! Et la ville éternelle, confiante comme son prince, frappait des
médailles montrant l’Arménie renversée que l’empereur foulait aux pieds, ou
deux Parthes, assis à terre, ayant devant eux un carquois vide et un arc
détendu[179].
Mais ces Parthes allaient se lever, le carquois allait se remplir, l’arc
résonner encore, et le victorieux empereur entendra jusque dans son camp le sifflement
aigu de ces flèches qu’il croyait avoir brisées.
Déjà, en effet, les défections éclataient partout derrière
lui, Séleucie s’était soulevée, et la révolte des villes du nord de la Mésopotamie, par où
l’armée romaine avait pénétré en Assyrie, menaçait d’enfermer les Romains
dans le désert. Il était à craindre que l’expédition ne finit comme celle de
Crassus. Les généraux de Trajan frappèrent quelques coups vigoureux. Nisibe
fut reprise ; Édesse et Séleucie, emportées d’assaut, furent livrées aux
flammes. Ces succès servirent au moins à cacher, sous des apparences de
victoires, une retraite nécessaire. Trajan se décida même, pour arrêter ces
dangereux mouvements, à restaurer la royauté parthique qu’il avait cru
détruire ; de retour à Ctésiphon, il mit, en présence du peuple et de l’armée,
la couronne du roi des rois sur la tète d’un Arsacide, Parthamasatès ;
puis, par le plus court chemin, il reprit la route de Syrie. Arrêté dans un
désert sans eau et sans fourrage, devant la petite place d’Atra, il voulut l’enlever
et fut repoussé. Un légat, beaucoup de légionnaires, y périrent ; des hommes
de son escorte furent tués auprès de lui. Le victorieux
empereur retournant à Rome pour triompher de tant de nations marquait sa
route par le sana et les cadavres de ses soldats[180].
Les fatigues, le chagrin, quelque maladie peut-être,
contractée, comme celle d’Alexandre, dans les plaines marécageuses de la Babylonie, minèrent sa
robuste constitution. Il atteignit Antioche, où il fit adieu à son armée,
mais ne put dépasser Sélinonte en Cilicie. Il y mourut le 10 août 117.
Il laissait l’Orient en feu. Dans l’île de Chypre, à
Cyrène en Égypte, avait éclaté une formidable insurrection des Juifs dont le
signal semble avoir été donné par leurs coreligionnaires de la Mésopotamie[181], et les
récentes conquêtes retournaient à leurs anciens maîtres. Une fois de plus l’empire
romain, comme au temps de Crassus et d’Antoine, était convaincu d’impuissance
à s’étendre au delà de l’Euphrate et de cette ligne de déserts qui sépare
deux mondes. L’Occident même était agité, du moins sur ses bords : les Maures
fatiguaient l’Urique de leurs incursions, les Bretons remuaient dans leur île,
et les Sarmates menaçaient les provinces du Danube[182]. Voilà en quel
état Trajan laissait l’empire, et l’histoire juge les règnes par leurs
résultats, comme l’arbre est jugé d’après les fruits qu’il porte.
Il avait voulu reprendre la politique conquérante de la République et de
César, qu’Auguste et ses successeurs avaient abandonnée. Rut-il raison ? Oui
et non. Oui pour l’expédition d’Arménie et la conquête du pays des Daces ;
non pour celles de Babylone et de Ctésiphon. Nous avons, plusieurs fois,
donné les raisons qui devaient arrêter au cours supérieur de l’Euphrate et du
Tigre la frontière de l’empire. Aller plus loin de ce côté, c’était aller
coutre la nature des choses, qui est la plus grande des forces. Il n’en était
pas de même sur le Danube. Trajan, qui tenait à réveiller l’esprit militaire
des Romains, fit bien de conquérir la Dacie. Mais il aurait dû achever cette œuvre,
en plantant ses aigles de l’autre côté de la Theiss et en Bohême.
Alors l’empire eût enfermé dans ses frontières toute la vallée du Danube et
tenu la chaîne de montagnes qui s’étend presque sans interruption des
environs de Mayence, jusqu’à la mer Noire, par le Taunus déjà fortifié, par
les monts de Franconie, de Bohême, de Moravie et les Carpates. Maître de
cette grande ligne de défense, ramassant ses forces dans les provinces
situées en arrière, y multipliant les postes militaires, les colonies de
vétérans, et, de l’autre côté des monts, développant au milieu des Germains
la vie romaine par les relations du commerce et la contagion de l’exemple, l’empire
aurait résisté plus longtemps aux assauts de la Barbarie.
Mais ces services eussent été sans éclat, et Trajan
voulait la gloire retentissante que donnaient la conquête, même éphémère, des
capitales parthiques et une expédition rivale de celle d’Alexandre. Terminons
cependant l’histoire de ce grand règne par le vœu qu’après Trajan le sénat
forma toujours à l’avènement d’un nouvel empereur : Puissiez-vous être plus heureux qu’Auguste, meilleur que
Trajan ! Le moyen ange a recueilli cette pensée, et Dante a mis
Trajan dans son Paradis.
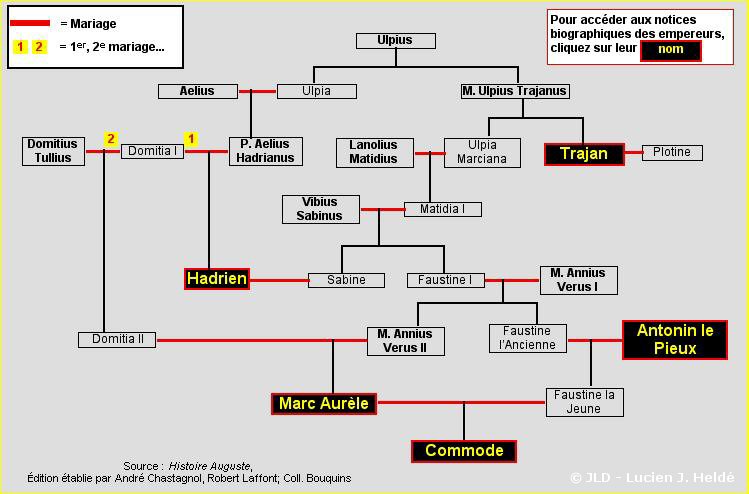
Généalogie
des Antonins
|