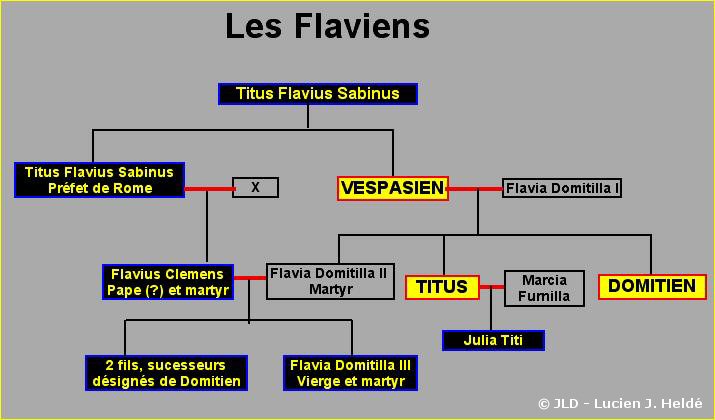HISTOIRE DES ROMAINS
NEUVIÈME PÉRIODE. — LES CÉSARS ET LES FLAVIENS (14-96), CONSPIRATIONS ET GUERRES CIVILES. DIX EMPEREURS, DONT SEPT SONT ASSASSINÉS
CHAPITRE LXXVII — VESPASIEN (69-79).
I. — GUERRE DES BATAVES (69-70).
L’auteur d’une de ces guerres, Civilis, était de race
royale parmi les siens : titre ambitieux qui s’appliquait, chez les
Germains, à de petits chefs que leur naissance dans une famille respectée
élevait au-dessus de la masse des hommes libres. Il avait contre l’empire de
légitimes ressentiments. Néron avait fait tuer son frère, lui-même faillit
périr. Galba l’ayant gracié, les soldats de l’armée du bas Rhin l’accusèrent
d’être complice du meurtre de Fonteius Capito et demandèrent sa mort.
Vitellius le sauva une seconde fois ; mais il jura de ne point couper sa
chevelure qu’il ne se fût vengé. Quand Antonins Primus eut proclamé Vespasien
en Pannonie, il écrivit à Civilis de susciter aux légions du Rhin quelques
embarras qui les empêchassent d’accourir au secours de Vitellius. Le Barbare
accepta avec ardeur ; il avait perdu un œil et se glorifiait de cette
blessure pour se comparer à Annibal et à Sertorius ; il rêvait, comme eux, d’accabler
Rome par les bras de ses sujets. À la réception des lettres d’Antonins, il
convoqua secrètement les principaux de son peuple[1], leur montra En peu de jours, les Romains furent chassés de tous les
postes qu’ils occupaient dans file que forment le Rhin, le Wahal et Les huit cohortes bataves revenues d’Italie étaient déjà
arrivées à Mayence, lorsque le messager de Civilis les atteignit, au moment
où, sur l’ordre de Vitellius, elles reprenaient le chemin des Alpes. Elles
répondirent sans balancer à l’appel de leurs compatriotes, et sur leur route
écrasèrent, près de Bonn, un troisième corps romain qui leur fermait le
passage. Civilis avait maintenant une armée aguerrie ; il la mena à l’attaque
des lignes de Pétera. L’armée du haut Rhin accourut pour les défendre, mais l’indiscipline
régnait dans ces légions, où les officiers tenaient pour Vespasien, les
soldats pour Vitellius. Ceux-ci, soupçonnant partout la trahison, et non sans
motif, venaient d’ôter le commandement à leur chef Hordeonius. Ils se
divisèrent : les uns campèrent à Gelduba
(Gelb), où ils
faillirent être enlevés ; les autres à Novesium
(Neuss) ; le
reste à Mayence. Cependant Vetera fut
débloqué. Les nouvelles apportées d’Italie augmentèrent l’irritation et l’indiscipline.
Dans une sédition, les soldats massacrèrent Hordeonius, et Dilius Vocula, qu’ils
avaient mis à sa place, fut réduit à s’échapper déguisé en esclave. Ils se
réunirent, puis se divisèrent encore. Ils avaient prêté serment à Vespasien ;
deux légions relevèrent. Ies images de Vitellius, bien qu’elles le sussent
déjà mort, et peu après les brisèrent de nouveau. Ces incertitudes et ces
troubles favorisaient les progrès des Bataves, qui prirent Gelduba. Civilis avait un jeune fils, il l’exerça
au tir de l’arc en lui donnant pour but des prisonniers romains attachés aux
arbres de la forêt. D’autres légionnaires furent envoyés en présent aux chefs
de Les Belges, dévoués à Vitellius et, par conséquent, ennemis du nouvel empereur, furent les premiers à éclater. Deux Trévires, Classicus et Tutor, un Lingon, Sabinus, qui prétendait descendre du premier César, s’entendirent pour la délivrance de leur pays. Ils débauchèrent d’abord les auxiliaires belges et germains, puis les soldats mêmes, en leur montrant les troupes de Vespasien qui accouraient à travers les Alpes pour les punir de leurs hésitations. Deux légions prêtèrent serment à l’empire des Gaules sur les étendards que Classicus leur donna : résolution inouïe et qu’on ne pourrait comprendre, si l’on ne savait qu’il n’y avait plus que des provinciaux dans les légions. Les cinq mille hommes enfermés dans Vetera, et, que Civilis tenait assiégés avec de l’infanterie germaine, acceptèrent les mêmes conditions. Mais les Barbares n’entendaient pas laisser échapper leur proie. Les Romains marchaient avec confiance sous la foi du serment lorsque, à cinq milles de leurs retranchements, les Germains se jetèrent sur eux. Tout ce qui ne fut pas massacré dans ce premier instant courut au camp pour s’y réfugier. Les Barbares l’avaient déjà pillé ; ils y mirent le feu, et les fugitifs périrent dans les flammes. Civilis était enfin vengé : il coupa sa chevelure. Son
ambition croissant avec sa fortune, il refusa de s’engager dans une cause
étrangère. Ni lui ni aucun de ses Barbares ne prêta serinent à l’empire
gaulois. Il rêvait autre chose : une vaste domination dont son pays serait le
centre, Dans l’intérieur du pays, Sabinus avait soulevé les Lingons et pris le titre de César. Mais beaucoup pensèrent que, pour faire un empereur, autant valait un Romain qu’un habitant de Langres. Ce fut l’avis des Séquanes (Franche-Comté), qui, attaqués par les Lingons leurs voisins, les battirent complètement. Sabinus, réfugié dans une de ses villas, y mit le feu. On crut que, comme Sacrovir, il y avait péri. Cette défaite ralentit le zèle des partisans de l’indépendance.
Dans une assemblée générale réunie à Reims, les Trévires et les Lingons
parlèrent énergiquement pour la guerre. On leur reprocha d’avoir trahi la
cause de Cet abandon ne fit point perdre courage aux cités
rebelles. Mais les chefs restèrent au-dessous de leur tâche. Civilis perdait
le temps à poursuivre un de ses parents que la jalousie avait jeté dans le
parti romain et qui l’attaquait avec des auxiliaires tongres et nerviens.
Classicus jouissait comme en pleine paix des douceurs du commandement, et
Tutor ne prenait aucune mesure pour occuper les passages des Alpes. Quatre
légions, à cette heure, les traversaient sous un général habile, Petilius
Cerialis ; Mucien lui-même allait suivre avec le plus jeune fils de
Vespasien, qu’il était opportun d’éloigner de Rome. Deux autres légions
arrivaient d’Espagne, et la quatorzième était rappelée de l’île des Bretons. Sept légions, s’écriaient les Rèmes avec
effroi, sont sur nos têtes. Tutor
marcha au-devant du corps qui débouchait par l’Helvétie. A la vue des aigles,
ses légionnaires passèrent aux Romains. Il recula, ruais se laissa surprendre
à Bingen. Cette défaite dégagea Mayence et toute la vallée du Rhin jusqu’à Vetera. Les légions cantonnées à Trèves, plutôt
captives que rebelles, rétablirent aussitôt sur leurs enseignes le nom de
Vespasien, et Cerialis, renvoyant dédaigneusement les auxiliaires gaulois,
parce que l’empire voulait lui-même et seul, disait-il, venger ses injures,
marcha sur la dernière armée, qui couvrait la cité des Trévires. Elle fut
dispersée, et ses chefs pris. Avec une modération habile, Cerialis ouvrit son
camp aux anciennes légions du Rhin et défendit qu’on rappelât le passé. Les
soldats voulaient saccager Trèves : il les retint. Nos pères, dit-il aux Trévires, ne
sont venus dans Civilis essaya d’ébranler la fidélité du Romain. Il lui écrivit que Vespasien était mort, Rome et l’Italie en proie à la guerre civile, Mucien et Domitien sans autorité et sans force ; que si Cerialis voulait l’empire des Gaules, lui et ses Bataves se contenteraient d’être libres sur leur territoire. Cerialis n’ayant point répondu à cette ouverture, les alliés vinrent l’attaquer. Ils mirent un instant l’armée en péril, mais essuyèrent une défaite sanglante qui détermina la défection de Cologne. Les habitants de cette ville égorgèrent tous les Germains entrés dans leurs murs, et après avoir enivré dans Tolbiac une cohorte de Chauques et de Frisons, la meilleure troupe de Civilis, ils mirent le feu aux maisons et la brûlèrent tout entière. En même temps arrivait la légion de Bretagne, qui soumettait les Nerviens et les Tongres. Civilis voyait s’évanouir ses grands desseins. L’ambitieux
était déçu, le patriote espéra encore. Pour couvrir son !le des Bataves, il
essaya, mais inutilement, de défendre Vetera.
Forcé dans cette place, il se retira derrière le Wahal, y ramena la masse des
eaux du Rhin en coupant la digue de Drusus qui les jetait dans le Lech et l’Yssel,
et, avec cent treize sénateurs ou décurions trévires, alla solliciter les
tribus germaines de faire un puissant effort. En son absence, Cerialis
franchit le Wahal, irais faillit être enlevé dans une surprise ; les Germains
amenèrent en triomphe à Velléda, par L’insurrection des deux provinces gauloises de Belgique et de Germanie avait échoué. Ses chefs étaient morts ou en fuite, et une recherche sévère, ordonnée par Vespasien dans toutes Ies cités, frappa ceux qui n’avaient point péri sur les champs de bataille. Les Trévires furent punis par la perte de leur liberté[5]. Un des chefs pourtant, et le plus compromis, Sabinus,
échappa. Après l’incendie de sa villa, il aurait pu fuir aisément jusqu’au
fond de Vespasien aurait pu, sans péril, se montrer clément. II. — GUERRE DE JUDÉE (66-70).Nous devons passer maintenant à l’autre extrémité de l’empire où s’achevait une guerre moins dangereuse, mais plus difficile et qui est restée un des grands faits de l’histoire, parce qu’un peuple entier parut y périr. Les derniers moments de ce peuple offrent d’ailleurs à la psychologie historique un curieux sujet d’étude, par l’étrange état moral où les Juifs se trouvaient alors, sorte d’ivresse ou de folie divine que produit l’exaltation religieuse et qui fait espérer contre toute espérance. C’est un phénomène qu’on voit reparaître aux époques de fermentation religieuse, avec le même mélange, dans tous les temps, d’abominable cruauté et de dévouements sublimes, de passion qui obscurcit la conscience ou voile la raison, et de foi ardente qui, du même homme, peut faire un bourreau ou un martyr. Et pourtant quelque terrible que soit souvent ce spectacle, l’âme y souffre moins qu’à se trouver en face des ignobles appétits qu’il nous a fallu montrer. Il a été plusieurs fois parlé des Juifs dans cette histoire, au temps de Pompée, de César et d’Auguste. On a vu comme ils avaient semé par tout l’orient et jusqu’en Italie leurs colonies, leurs synagogues et leur croyance à un Dieu unique, qui ébranlait l’autorité déjà si compromise des dieux païens et préparait les voies à la doctrine de Jésus. Auguste avait fait de leur roi Hérode son ami ou plutôt l’instrument
de ses desseins dans cette partie de l’Orient. Après la mort de ce prince,
les Juifs avaient demandé à l’empereur que
Aucune province n’avait alors besoin de la main ferme de l’empire comme ce malheureux pays, en proie, depuis plusieurs années, à cette incurable anarchie qui annonce les derniers jours d’un peuple. Il n’y avait plus de lien social, plus de force publique. Tous les jours on assassinait dans les rues de Jérusalem, jusque dans le temple, au milieu de la foule et durant Ies fêtes solennelles[6]. Les routes n’étaient pas même sûres pour les envoyés de l’empereur, et ceux que Josèphe, l’ami des Romains, traite de brigands, de magiciens, de trompeurs, mais que la foule appelait des prophètes, des Christs suscités par Jéhovah[7], formaient des bandes aussi nombreuses qu’une armée. Tout le mal ne venait pas de l’absence d’un gouvernement
énergique. L’esprit prophétique était l’âme de ce peuple. Très habiles à conduire
leurs intérêts privés, à pousser leur fortune dans le trafic, les Juifs
perdaient terre dès qu’il fallait s’élever aux idées générales. La science qui
exige une froide raison, l’art qui suppose l’étude de la nature, le sentiment
des rapports et l’harmonie des proportions, leur furent toujours étrangers.
Les Apocalypses, dont ils avaient pris le goût chez les mazdéens durant la
captivité, étaient devenues leur grande forme littéraire. Dans les moments de
crise, ils exprimaient ainsi tout ce qu’on sent, aime, ou espère. L’Apocalypse
de saint Jean est la plus haute expression et est restée le modèle de ces œuvres
symboliques, où le Voyant raconte les secrets de l’Abîme, révèle les arrêts
du Très-Haut et annonce aux puissants de la terre les châtiments qui les
attendent. Beaucoup l’avaient précédée, beaucoup la suivirent : c’était un
genre littéraire d’origine persique qui offrait de grandes ressources au
poète et au croyant. Dans la révélation envoyée aux Sept Églises d’Asie,
l’Apôtre continue contre les ennemis de Ils croyaient toujours à leur saint temple et ils accomplissaient les rites extérieurs de leur culte. Mais en voyant que leur doctrine si pure, que leur morale si belle ne les avaient pu sauver et qu’il leur fallait. obéir, eux le peuple de Jéhovah, eux la race élue, à ceux dont l’ironie sanglante d’Isaïe avait flagellé les idoles, ils se rattachaient avec la force du désespoir à la seule espérance qui leur restât, la venue d’un Messie[8]. Les chrétiens leur disaient bien que ce Messie était venu, que son royaume commençait et que sa loi avait été portée jusque dans la cour de Néron. Dans la sainte victime attachée à la croix du Golgotha, ils refusaient de voir le Sauveur qui devait les faire régner sur le monde ; et ils attendaient toujours, écoutant chaque voix qui s’élevait, suivant quiconque leur disait : Venez et voyez.
L’Écriture elle-même témoigne de cette sourde fermentation qui agitait les esprits ; les Actes des Apôtres parlent du magicien Simon, du faux prophète Élymas, et citent les remarquables paroles du pharisien Gamaliel sur les révolutions qui viennent de Dieu et qu’on ne peut arrêter, sur celles qui viennent des hommes, et qui se détruisent d’elles-mêmes. Il y a quelque temps, disait-il, s’éleva un certain Theadas qui prétendait être quelque chose de grand. Quatre cents hommes s’attachèrent à lui, mais il fut tué, et tous ceux qui avaient cru en lui furent réduits à rien. Judas de Galilée s’éleva après lui et gagna beaucoup de monde ; mais il périt aussi, et tous les siens furent dispersés[13]. La prédication du nouvel Évangile ne ramena pas le calme dans les âmes, car, à Jérusalem, les chrétiens étaient poursuivis, et plus ils parlaient du Messie méconnu, plus les Juifs espéraient en celui qu’ils attendaient encore, non pas humble et persécuté, mais glorieux et puissant. Pour arriver à cette domination promise, il fallait sauver d’abord l’indépendance nationale, et, à cette pensée, tous les cœurs s’armaient de courage. Ceux que Josèphe appelle des brigands furent les premiers à souffler partout la révolte, car, de même qu’au temps de Mathathias et de Judas Macchabée, ces brigands étaient de hardis patriotes qui refusaient de servir l’étranger. Soyons justes envers cette nation qui a donné au monde le plus grand exemple qu’il ait encore vu ; ce ne sont pas quelques hommes, ni une armée, c’est un peuple presque entier qui va mourir pour ses croyances et sa liberté. Que ce sacrifice n’ait pas été nécessaire ; qu’il soit resté inutile pour la race de ceux qui l’accomplissaient, comme pour l’humanité qui ce jour-là vit commencer une persécution dont elle a souffert durant dix-huit siècles ; que ce peuple enfin ait eu tort : en religion, quand il refusait la doctrine évangélique qui complétait sa loi ; en politique, quand il repoussait la domination de Rome qui lui eût au moins donné l’ordre matériel ; tout cela est vrai. Mais l’historien trouve tant de guerres entreprises pour de condamnables motifs, qu’il ne peut refuser sa sympathie à ceux qui ont combattu et sont tombés au nom de la patrie et de la religion. Longtemps la domination romaine avait été douce en Judée, comme ailleurs, plus qu’ailleurs même, parce que les Juifs de Palestine furent particulièrement protégés des premiers empereurs. Sous Tibère, ils n’avaient eu en vingt-deux ou vingt-trois ans que deux procurateurs, et le dernier, Ponce Pilate, avait été rappelé pour rendre compte de mouvements séditieux qu’il avait trop sévèrement réprimés[14]. Sous Claude, un soldat romain, qui dans un village avait déchiré un exemplaire du Pentateuque, fut décapité ; et un procurateur, qui s’était laissé corrompre, condamné à l’exil. Pour la même affaire, l’empereur renvoya à Jérusalem un tribun des soldats qui fut traîné sur la claie, par les rues de la ville, puis mis à mort[15]. A cette justice sévère se joignaient des égards pour leur culte. Aucun officier romain n’entrait dans la capitale sans monter au temple pour y adorer le Dieu national ; et chaque année des victimes y étaient offertes au nom du prince. Ces ménagements allèrent si loin, qu’on prit soin de donner aux Juifs des gouverneurs qui leur fussent agréables : c’est à la demande du grand sacrificateur Jonathan que Félix, le frère de l’affranchi Pallas, obtint la procurature de Judée (52-60)[16]. Niais, durant les dernières années de Claude et sous le
règne de Néron, les excès des proconsuls républicains furent renouvelés.
Vintidius Cumanus administrait alors Cette conduite était dangereuse ; car si le peuple, travaillé par les messies et fanatisé par les prêtres inférieurs que leurs chefs dépouillaient des dîmes[19], courait en foule se réunir aux bandits et donnait ainsi au brigandage la couleur d’un soulèvement patriotique contre l’étranger, les riches et les grands cherchaient dans l’appui des soldats romains la sécurité qui leur manquait pour leur vie et leur fortune. Les aliéner eût donc été une imprudence, s’ils n’avaient pas redouté plus encore les violences de leurs compatriotes que celles des procurateurs[20]. Au-dessous d’eux, en effet, ils voyaient fermenter dans la foule, non seulement les germes d’une lutte politique et religieuse, mais ceux dune révolution sociale : une insurrection des pauvres contre les riches. La nouvelle Loi, préoccupée du faible, de l’affligé, avait des paroles de menace contre les puissants. Beaucoup prenaient à la lettre, et dans le sens de leur application sociale, les préceptes de l’égalité évangélique. Quand une doctrine nouvelle apparaît, il est des hommes qui la suivent en son entier et dans son esprit ; mais il en est aussi qui la côtoient, s’arrêtent à la surface et en prennent ce qui convient à leurs passions. Ce partage se produisit certainement à l’époque de la prédication chrétienne. Tandis que les uns, avec Jésus, regardaient au ciel, d’autres, comme il arriva si souvent dans les émeutes de paysans au moyen fige, n’entendirent que les paroles qui s’appliquaient aux intérêts terrestres. Les premiers allaient au Christ lorsqu’il prêchait le mépris des richesses : Nul ne peut servir deux maîtres ; choisissez donc entre Dieu et l’or ; ou lorsqu’il enseignait de préférer la prière au travail : N’ayez point souci de votre nourriture ni de votre vêtement ; considérez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent et n’amassent rien dans les greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Or n’êtes-vous pas plus que les oiseaux du ciel ? — Pourquoi vous inquiéter de votre vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant je vous déclare que Salomon, dans toute sa gloire, n’a jamais été vêtu comme un seul d’entre eux. Si pieu prend soin de vêtir une plante des champs qui est aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, combien mieux saura-t-il vous vêtir, ô hommes de peu de foi ! Cette doctrine, si conforme aux habitudes de l’Orient ; où le travail est une souffrance et n’est jamais une impérieuse nécessité, avait pu produire l’abandon de quelques ateliers ou comptoirs, comme elle décida Pierre à laisser son filet de pêcheur et Matthieu ses tablettes de publicain. Mais d’autres paroles, celles-ci par exemple : Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, furent sans doute avidement recueillies par les hommes de violence qui poussaient à une révolution démagogique, contre le haut clergé que Jésus attaquait comme détenteur aveugle de la loi, et contre les riches à qui le doux maître des affligés fermait presque les avenues du ciel. Ses disciples précisèrent davantage ; à Jérusalem, ils exigèrent des fidèles la mise en commun de tous les biens ; et ce que saint Jacques écrivait aux tribus dispersées, il le disait certainement aux Juifs de la capitale dont il gouverna l’Église durant vingt-neuf années : Comme la fleur des champs qui est brûlée du soleil perd sa beauté, sèche et tombe, ainsi le riche se flétrira dans ses voies. N’est-ce pas lui qui vous déshonore et qui vous opprime ?... Ne sont-ce pas eux qui vous traînent aux tribunaux ? Et plus loin : Ô riches ! Pleurez, hurlez à la vue des misères qui vont fondre sur vous.... Le salaire que vous faites perdre aux ouvriers.... crie contre vous, et leurs cris sont montés jusqu’aux oreilles du Dieu des armées ; — vous avez vécu sur la terre dans les délices, et vous vous êtes engraissés comme des victimes préparées pour le jour du sacrifice[21]. Nous avons malheureusement une trop longue expérience des révolutions populaires pour ne point penser que ces paroles, tombant dans la fournaise où bouillonnaient les esprits, donnèrent au feu de nouveaux aliments. Ceux mêmes qui rejetaient la nouvelle doctrine, en retenaient cette réprobation des riches qui convenait si bien à leurs appétits. Quand la guerre éclata, les premiers actes des révoltés furent l’incendie du greffe public, ors ils brûlèrent les contrats et les obligations des débiteurs, le meurtre du grand prêtre et de quelques-uns des principaux citoyens, enfin la destruction du palais du roi Agrippa et de la reine Bérénice. A la tête de ce mouvement démagogique se plaça la secte des zélateurs ou zélotes, née cinquante ans plus tôt, et qui, ne reconnaissant que Dieu seul pour maître au ciel et sur la terre, avait essayé vingt fois déjà de briser du même coup le joug de Rome et celui de la caste sacerdotale. Longtemps les efforts des zélateurs s’étaient traduits en actes de violence. Réfugiés dans les montagnes, ils s’y étaient associés aux bandits ; mais, en couvrant le brigandage de l’excuse d’une doctrine pieuse, ils en avaient formé un parti à la fois politique et religieux, et l’association des sicaires, dont Josèphe parle avec tant d’effroi, de ces hommes qui venaient tuer au milieu de la foule une victime désignée, rappelle à certains égards la terrible secte des Ismaéliens qui, onze siècles plus tard et presque dans les mêmes lieux, épouvanta l’Asie de ses assassinats. Avec de tels chefs, imposteurs et magiciens, prêtres opprimés et brigands fanatiques, quel peuple fût resté paisible, surtout quand les modérés étaient eux-mêmes poussés à la révolte par tant de sentiments divers : l’amour du pays, de la religion des aïeux et de la liberté ; la haine implacable contre les amis de l’étranger, qui exploitaient ses misères ; par-dessus tout, la ferme croyance à une puissance sans bornes qui lui avait été promise et dont le jour était venu[22] ? Que de causes pour une explosion terrible ? Ce fut l’an 65 qu’elle éclata, et, cinq ans après, elle avait tout emporté, la ville, son temple et son peuple.
Gessius Florus s’était retiré à Césarée, les riches à peu près abandonnés à eux-mêmes[24] firent tête à l’insurrection ; pendant sept jours on se battit au milieu des rues. Mais les sicaires eurent le temps d’accourir de leurs montagnes. Dés qu’ils eurent pris part à la lutte, elle se décida promptement : les grands furent chassés de la ville haute, leurs palais incendiés, ceux d’entre eux qu’on put saisir égorgés. Des soldats romains avaient été laissés par Florus à Jérusalem ; ils se défendirent dans les tours d’Hippicus, de Phasaël et de Mariamne, jusqu’au moment où, à bout de ressources, ils ouvrirent leurs portes, en stipulant qu’ils auraient la vie sauve ; on les massacra le jour même glu sabbat. Dés que le bruit de ces événements se fut répandu, la
haine des Grecs, longtemps contenue, éclata contre ce peuple que la colère de
Rome allait nécessairement frapper. Dans la capitale de l’Égypte, cinquante
mille Juifs périrent à la suite d’une émeute ; à Césarée, vingt mille ; à
Scythopolis, treize mille ; à Damas, dix mille ; à Ascalon, deux mille cinq
cents. Toutes les villes de Syrie, Antioche, Apamée et Sidon exceptées,
eurent de semblables exécutions. Partout les populations se vengeaient de
cette égalité que le sénat leur avait imposée avec une nation odieuse et des privilèges
qu’il leur avait accordés[25]. Quand les Juifs
de Palestine virent arriver au milieu d’eux ceux qui avaient échappé à ces
massacres, ils crurent à un complot formé pour l’extermination de leur race,
et l’insurrection de Jérusalem gagna le pays tout entier. Aux égorgements de Juifs
en Syrie répondirent ceux de Grecs en Palestine. Dans Cependant le gouverneur de Syrie, Cestius Gallus, entra en Judée à la tête de ses troupes il arriva bien jusqu’à Jérusalem, occupa la ville neuve et le quartier de Bézétha, mais, assailli par un peuple immense, il fut contraint à une retraite précipitée, dans laquelle il perdit six mille hommes, ses machines de guerre et ses bagages (oct. 66). Ce succès décida les plus timides. D’ailleurs, depuis les massacres de Damas et d’Alexandrie, personne n’osait plus parler de poser les armes. Entraînés par l’exemple ou la crainte, tous, même les Esséniens[26], acceptèrent cette dernière lutte pour l’indépendance. Les chrétiens seuls n’avaient rien à faire dans ces querelles pour un temple et une patrie qu’ils ne reconnaissaient plus ; suivant le conseil du Maître[27], ils quittèrent Jérusalem avec leur évêque Siméon, et se retirèrent dans les solitudes, au delà du Jourdain[28]. Ce qu’ils font en ce moment pour Jérusalem, ils le feront plus tard pour Rome ; ces conquérants des âmes et du ciel ne voulaient point enfermer leur doctrine clans l’enceinte d’une ville ou d’un empire périssable. Une grande assemblée eut lieu dans le temple, après la retraite de Cestius, afin d’élire des chefs et d’organiser partout la résistance. Les principaux personnages adhérèrent cette fois au mouvement, et les modérés acceptèrent des charges. L’historien Josèphe, de l’illustre famille des Asmonéens, et qui comptait parmi les moins ardents, eut un des cinq gouvernements entre lesquels on partagea le pays, celui de Galilée, qui, par sa richesse et sa population, était comme le boulevard de Jérusalem. Josèphe prétend y avoir établi jusqu’à cent mille hommes, qu’il habitua par de fréquents exercices à la discipline romaine. Un synédrion ou conseil suprême, siégeant à Jérusalem, avait la direction générale des opérations. Malgré les dédains affectés de Néron pour cette levée de boucliers d’un des plus petits peuples de l’empire, la guerre allait être sérieuse, car, dans ce pays hérissé de montagnes, l’assaillant, malgré le nombre et l’habileté de ses troupes, ne pouvait brusquer l’attaque contre des rochers inexpugnables défendus par des hommes résolus aux derniers sacrifices. Le roi agrippa, créature de Rome, trahissait la cause de son peuple ; mais les Juifs, répandus en grand nombre dans tout l’Orient, pouvaient envoyer des secours à leurs frères et peut-être entraîner quelques-uns des peuples au milieu desquels ils habitaient. Parmi les défenseurs de Jérusalem, on voit des Babyloniens, des Adiabènes, des Arabes. Josèphe le dit expressément, il s’agissait moins de châtier les Juifs que de maintenir dans le devoir le reste de l’Orient, en arrêtant les dispositions de tous ces peuples à secouer le joug de Rome[29]. Au fond, Néron en jugea ainsi, et ce fut son meilleur général, Vespasien, qu’il chargea d’écraser ce peuple qui seul osait troubler le repos du monde[30]. Dans les derniers mois de l’année 67, Vespasien entra en
Galilée à la tête de plus de soixante mille hommes, en comptant les
auxiliaires, au reste peu nombreux, des rois voisins, Antiochus de De pareilles scènes et de plus terribles allaient se renouveler à Jérusalem, car les Juifs, dont la croyance à une autre vie avait été si lente à se former, pensaient à présent que ceux qui tombaient dans les batailles ou dans les supplices[32], les héros et les martyrs, jouissaient de l’immortalité. C’était déjà dire ce que Mahomet enseignera plus tarit : Le paradis est à l’ombre des épées. Les zélateurs s’étaient rendus maîtres du temple, et de ce point culminant ils dominaient la ville, qu’ils remplissaient de sang. Les membres de la famille d’Hérode, les citoyens les plus nobles et les plus riches, furent arrêtés comme suspects de vouloir traiter avec les Romains : c’étaient vies otages. Mais on craignit de ne pouvoir les garder ; un jour la population entoura la prison, où des brigands armés s’introduisirent et égorgèrent les captifs. Dans leur radicalisme religieux, les zélateurs ne voulurent plus de souverain pontife choisi dans les grandes familles sacerdotales ; ils tirèrent cette charge au sort, et un lévite ignorant et pauvre, qui jamais n’était sorti des champs, fut malgré lui revêtu de la robe du grand prêtre. Cependant le véritable grand prêtre, Ananus, essayait de relever le courage des citoyens paisibles. C’est vous, leur disait-il, qui, par votre silence et votre résignation, avez inspiré tant d’audace à nos tyrans. Quand vos concitoyens ont été traînés à travers la ville, qui d’entre vous leur est venu en aide ?... Vous avez abandonné des hommes qui n’avaient pas été frappés par un jugement public ; vous les avez vu égorger, et, tandis que les victimes tombaient comme le troupeau qu’on a conduit au sacrifice, non seulement vous n’avez pas levé le bras pour les défendre, mais vous n’avez pas jeté un cri pour protester contre cet attentat. Ces reproches réussirent un moment : on s’arma ; on suivit le chef qui s’offrait et l’on refoula les zélateurs derrière la seconde enceinte du temple. Il y eut alors trois guerres en Judée : celle des démagogues religieux armés contre Rome et contre la société juive ; les défenseurs de celle-ci ; les Romains ennemis des uns et des autres. Selon l’usage dans les temps de crise, ce fut le parti modéré qui d’abord succomba. Avec de la décision, les politiques auraient pu forcer l’asile des démagogues : Ananus, qui craignait d’ensanglanter les lieux saints, se contenta d’un blocus qu’on tint avec négligence. Beaucoup se faisaient remplacer à prix d’argent dans leur service par des hommes du peuple, qui étaient de connivence avec les ennemis des riches. Avertis par leurs nombreux espions de la facilité qu’il y aurait à franchir les lignes, les zélateurs firent partir des émissaires qui gagnèrent les districts du Sud, où ils appelèrent les paysans (les Iduméens) à la défense de la maison de Dieu que des traîtres voulaient livrer aux Romains. Un grand nombre accoururent et enveloppèrent Jérusalem. Ils étaient incapables d’y pénétrer de vive force ; mais une nuit, durant un orage qui avait fait rentrer les sentinelles sous les abris, les zélateurs descendirent du temple dans la ville et en ouvrirent les portes aux Iduméens. Ananus, accouru au premier bruit, fut tué ; beaucoup d’autres périrent ; parmi eux tout le haut clergé et ceux des riches qui ne surent pas s’échapper à temps. C’était, disaient les assassins, la colère de Dieu et du peuple qui s’appesantissait sur eux. Le jour, on remplissait les prisons ; la nuit, on les vidait, en égorgeant les captifs, dont les corps étaient jetés aux chiens. Personne n’osait laisser voir sa douleur et ses larmes. Seuls les pauvres et les gens de rien n’avaient pas à craindre[33]. Il y eut cependant un mémorable exemple de courage civil. Les zélateurs, pour se couvrir des apparences de la justice, formèrent un tribunal de soixante-dix juges, devant lesquels on traîna d’abord nu ami d’Ananus, Zacharias, fils de Baruch, sous l’inculpation d’avoir entretenu des intelligences avec Vespasien. Il se disculpa aisément et reprocha au parti victorieux son usurpation et ses crimes. L’assistance jetait des cris de fureur et voulait l’égorger avant le jugement. Les soixante-dix, à l’unanimité, le renvoyèrent absous. A deux pas du tribunal il fut assassiné. Les juges, impassibles sur leurs sièges, attendaient le même sort ; on les chassa de l’enceinte du temple, et ils se retirèrent sous les huées, les insultes et les coups. Vespasien connaissait cette situation de Jérusalem, et,
laissant les Juifs s’y égorger, il achevait la conquête du pays avec une
lenteur calculée pour rester, dans les difficiles conjonctures où se trouvait
l’empire, à la tête de forces considérables. Il employa l’année 64 à
soumettre, sur la rive gauche du Jourdain, Le répit que l’élévation de Vespasien avait valu aux Juifs n’avait fait qu’accroître leurs discordes. Trois partis, trois armées, se livraient, à Jérusalem, de fréquents combats. Jean de Giscala, avec les zélateurs modérés, tenait l’enceinte extérieure du temple et les abords du mont 1loria ; Éléazar, le chef des assassins du grand prêtre, s’était enfermé dans le temple même ; Simon ben Giora, avec ses bandes d’Iduméens, occupait la haute ville ou la montagne de Sion. Chacun de ces trois chefs aurait voulu être seul maître de Jérusalem, la sauver des Romains et se faire reconnaître ensuite comme le Messie auquel tant de gloire était promise. Éléazar, fortement établi dans une position inexpugnable, faisait des sorties que Jean ne pouvait prévenir, mais dont il se vengeait sur Simon auquel il disputait Acra ou la ville. basse. A la fête de Pâques, Éléazar ouvrit aux fidèles l’entrée du temple. Jean cacha dans la foule des hommes armés, et à la suite d’un sanglant combat il força son adversaire à se rendre. C’était une faction de moins ; il en restait deux, qui, en face de l’ennemi commun, cessèrent enfin de se battre entre elles. Au printemps de 70, Titus partit de Césarée à la tête de soixante mille hommes et arriva dans les premiers jours de mars[34] sous les murs de Jérusalem. Le siège, qui dura cinq mois, est un des plus mémorables de l’antiquité et celui qui nous est le mieux connu, Josèphe, qui y prit part, en ayant longuement raconté l’histoire. Nous ne pouvons même résumer son récit ; pour le faire comprendre, il faudrait entrer dans des détails de topographie et de machines qui nous prendraient une place dont nous ne disposons pas[35]. Disons, d’un mot, que les travaux des Romains furent immenses, et la résistance des Juifs égale ou supérieure à tout ce que l’héroïsme a jamais accompli ailleurs. Bien que Vespasien eût réuni ce que nous appellerions une artillerie formidable, il fallut à Titus six semaines pour pratiquer une brèche dans la première enceinte et enlever le faubourg Bézétha. La ville basse semblait prise, mais chaque maison devint une forteresse ; et une seconde muraille la défendait ; les Romains ne s’en rendirent maîtres qu’au bout de neuf jours. Aux maux de la guerre se joignirent ceux de la famine. Le siége ayant commencé durant les fêtes du temps pascal, une foule immense s’était trouvée enfermée dans la place. Les vivres avaient été bientôt épuisés par les besoins de cette multitude et par l’ordre de remettre aux soldats ce que chacun avait en réserve. La misère devint telle, qu’une mère mangea son enfant. Aussi beaucoup essayaient de fuir ; mais ceux qui échappaient aux gardes des murs étaient saisis par les Romains et mis en croix ; à un certain moment, il en périt, de cette manière, jusqu’à cinq cents par jour. Titus offrait de traiter. La maison de Dieu ne saurait périr, répondait Jean avec un farouche enthousiasme, et la lutte continua longtemps encore sur les ruines des murs, au milieu des débris fumants des portiques du temple. Le général romain aurait voulu épargner ce sanctuaire célèbre ; mais un soldat, poussé, dit Josèphe, comme par une inspiration divine, jeta une pièce de bois enflammé dans une des salles qui entouraient le temple ; le feu gagna aussitôt de tous côtés, et les Juifs, avides d’aine mort qui leur ouvrait le ciel[36], se précipitèrent à travers les flammes et les épées des Romains. Ainsi fut bradé le second temple de Jérusalem, le 8 juillet de l’an 70 de Jésus-Christ. La ville haute tenait encore ; le 1er août, les Romains la prirent et l’incendièrent. Trois forteresses, que les zélateurs occupaient aux environs, furent successivement enlevées. Dans la dernière, Masada, les Juifs, près d’être forcés, égorgèrent leurs femmes et leurs enfants, puis chacun, tenant embrassés les corps de ces chères victimes, tendit la gorge à ceux d’entre eux que le sort avait désignés pour rendre à leurs compagnons ce dernier service. Ceux-ci s’entretinrent à leur tour ; et quand les Romains entrèrent dans la place, ils n’y trouvèrent qu’un silence de mort, troublé seulement par le bruit de l’incendie qu’avant de mourir les zélateurs avaient encore allumé[37]. Ce fut le dernier acte de cet épouvantable drame. Au
compte de Josèphe, qui, il est vrai, exagère tous les chiffres, onze cent
mille Juifs auraient péri, dont la moitié dans Jérusalem.
Quatre-vingt-dix-sept mille étaient prisonniers ; les uns furent vendus, d’autres
envoyés aux carrières d’Égypte, le reste réservé pour les combats du cirque.
Il fallait récompenser les villes syriennes de leur fidélité : Titus leur
donna des jeux et des fêtes, où il leur montra ces Juifs odieux déchirés dans
l’amphithéâtre par des bêtes fauves ou s’égorgeant entre eux comme
gladiateurs. A Panéas, pour célébrer la fête de son frère, il en fit périr
deux mille cinq cents dans les flammes ou au cirque ; autant à Beyrouth, au
jour anniversaire de la naissance de Vespasien. Il n’en garda que sept cents
pour suivre, à Rome, le char sur lequel Vespasien et lui firent leur entrée
triomphale. Devant eux, les captifs voyaient porter les dépouilles du temple,
la table d’or, le chandelier à sept branches, les voiles du sanctuaire, le
livre de la loi[38].
À leur tête marchaient les deux chefs Jean et Simon. Le dernier, conduit,
après la fête, au Forum, y fut longtemps battu de verges, puis décapité ; l’autre
mourut en prison. Des médailles frappées en souvenir de cette guerre
représentaient une femme en pleurs assise au pied d’un palmier, avec cette
inscription : Elle l’était, et pour toujours ! Du temple, il ne restait
qu’un amas de décombres ; de la ville sainte, çà et là, des pans de murailles
noircies par le feu[40], et du peuple
juif des débris épars dans les provinces, où la haine va s’attacher à eux.
Déjà Vespasien a réuni La guerre venait de détruire presque en mène temps les deux sanctuaires des croyances religieuses qui se partageaient le monde. Mais tandis que l’un se relèvera bientôt étincelant d’or, l’autre restera éternellement abattu. C’est qu’à présent le dernier n’est plus nécessaire. L’idée qu’il tenait enfermée dans le Saint des Saints en est sortie pour se répandre sur le monde, et, par elle, les vaincus d’aujourd’hui seront les vainqueurs de demain[42] ; les fugitifs deviendront des conquérants ; ceux qu’on a cru écraser par la force domineront par l’esprit, et le Dieu juif, chassé par Titus du temple de Jérusalem, entrera en maître dans le Capitole de Rome, d’on Jupiter et tous les grands Dieux seront précipités. Tacite raconte qu’avant le dernier assaut les portes du temple s’ouvrirent d’elles-mêmes ; qu’on entendit une voix surnaturelle qui criait : Les dieux s’en vont, et en même temps tout le bruit d’un départ[43]. C’était le Jéhovah mosaïque, transfiguré par Jésus, qui abandonnait son roc solitaire de Sion pour devenir le Dieu de l’univers, et y faire régner, durant des siècles, avec la seconde loi révélée, une nouvelle théocratie pleine de mansuétude envers les siens, implacable, comme la juive, a l’égard de ses adversaires. Mais un jour, au sein du monde renaissant, la lutte recommencera ; car les deux peuples qui viennent de nous donner ce terrible spectacle représentaient deux tendances contraires de notre nature, dont l’opposition n’est pas près de finir : la foi contre la raison, l’enthousiasme contre la science, la religion contre la politique, le droit divin contre le droit naturel. III. — VESPASIEN (69-79).Les deux guerres que nous venons de raconter nous ont
retenu aux extrémités do, l’empire ; retournons à Rome, que nous avons
laissée, au lendemain (le la mort de Vitellius, avec son Capitole en cendres
et ses rues jonchées de morts. Les combats qui l’avaient ensanglantée étaient
les dernières convulsions d’une anarchie de deux ans. Commencé dans Son séjour en Égypte ne fut pas tout entier perdu pour les
choses sérieuses. Il fit d’utiles réformes dans l’administration de ce pays,
qui depuis Auguste n’avait pas vu d’empereur, et il augmenta, malgré les
railleries des Alexandrins, les impôts dus par cette riche cité[48]. De là aussi il
veillait sur Il aurait voulu attendre la fin de la guerre de Judée pour
retourner à Rome avec Titus. Mais, le siège de Jérusalem se prolongeant, il
était parti, visitant sur sa route Rhodes et diverses cités de l’Asie-Mineure.
Il prit terre en Italie à l’extrémité de
Domitien lui donna plus de soucis. Ce jeune prince, âgé de dix-neuf ans, s’était trouvé avec Sabinus au Capitole et n’en était sorti qu’à la faveur d’un déguisement. Pour le danger qu’il avait couru, il se croyait un des vainqueurs et tranchait du souverain. Eu un jour il distribua vingt places. Vespasien lui écrivit. Je dois m’estimer heureux que tu n’aies pas songé à nommer aussi un empereur. Quand on apprit la révolte des Gaules, Domitien, jaloux de son frère, voulut commander l’armée et partit de Fume Mucien, qui n’osait le quitter, le suivit ; mais ils apprirent au pied des Alpes la défaite des Trévires ; sur quoi, Mucien représenta au jeune César qu’il y aurait peu de gloire a aller achever une guerre qui finissait d’elle-même, et il le décida à s’arrêter à Lyon. On croit que de cette ville Domitien fit sonder secrètement Cerialis pour savoir si le commandement lui serait remis au cas où il se rendrait à l’armée. Cerialis éluda la réponse, et Domitien, s’apercevant avec dépit que ces vieux politiques se jouaient de lui, se retira de toutes les affaires ; il ne parut occupé désormais que de vers et de littérature[55]. Son habile tuteur le ramena à Rome, d’où tous deux allèrent au-devant de l’empereur. Malheureusement Tacite nous manque encore en cet endroit, et cette fois pour toujours. Rien n’a été sauvé de ses Histoires depuis le milieu de l’année 70, et nous voilà réduits aux sèches biographies de Suétone, aux fragments de Dion, aux abrégés d’Aurelius Victor et d’Eutrope. Le fleuve majestueux où nous puisions et qui coulait à pleins bords n’est plus qu’un maigre filet d’eau. De tous les empereurs, Vespasien est celui qui y perd le plus, car il fut, dit saint Augustin, un prince très bon et très digne d’être aimé[56]. Il arrivait au pouvoir à un âge où l’on ne change plus, à soixante ans. Il n’avait jamais aimé ni le jeu ni la débauche, et il entretenait sa santé par un régime frugal, passant même tous les mois un jour sans manger. Sa vie était simple et laborieuse ; empereur, il employa toujours une partie de la nuit aux affaires ; Pline l’Ancien et bien d’autres venaient avant le jour travailler avec lui ; enfin Thrasea et Soranus, les plus vertueux du sénat, avaient été ses amis[57]. Ce soldat habitué à la discipline, ce parvenu ayant connu la misère, était bien l’homme qu’il fallait à l’empire. Dans le palais impérial, il ne changea rien à ses habitudes, vécut comme auparavant, en simple particulier, sa porte ouverte à tous, sans souvenir des injures[58] et sans fierté ; raillant ceux qui voulaient lui faire une généalogie, et répondant aux sarcasmes par des plaisanteries à gros sel, qui valaient toujours mieux qu’un ordre d’exil ou une sentence de mort ; capable de reconnaissance, chose rare dans un prince, souffrant la vérité et les conseils[59]. Il dota magnifiquement la fille de Vitellius, n’ôta rien des biens de leurs pères aux enfants de ceux qui avaient combattu contre lui[60], et laissa Mucien, qu’il décora deux fois de la pourpre consulaire, prendre le ton et les manières d’un collègue plutôt que d’un ministre ; sans faiblesse cependant, même pour son fils Domitien, qu’il tint dans une étroite dépendance. Selon les traditions de la première cour impériale, il recevait familièrement les grands et les visitait chez eux sans appareil. On voulut un jour l’inquiéter sur un personnage à qui les astres promettaient l’empire ; il lui donna le consulat. S’il devient empereur, dit-il, il se souviendra que je lui ai fait du bien. Vespasien n’a pas une renommée retentissante ; on le connaît surtout par les anecdotes de Suétone et de Dion. Nous-même qui avons soigneusement recherché ses actes, lorsque nous aurons dit qu’il prit Auguste pour modèle, nous lui aurons donné tout l’éloge que mérite son esprit politique. Il ne visait pas plus haut qu’à mettre l’ordre dans l’état et dans les finances ; mais il le mit ; et si son principat, comme tous les autres, ne prépara rien pour l’avenir, il fit beaucoup pour le présent. Ce fut un règne réparateur dont on sentit les effets durant plusieurs générations : ce service vaut bien des gloires plus brillantes. A l’exemple du second des Jules, le premier des Flaviens
se résolut à prendre dans le sénat le point d’appui de son gouvernement.
Cette assemblée, avilie par tant d’années de tyrannie, avait besoin, autant
qu’un siècle plus tôt, d’être soumise à une révision sévère. En outre, les
guerres civiles, les complots, la débauche, avaient s : bien décimé la
noblesse que, a en croire un vieil historien, on n’aurait pas alors compté
dans Rome deux cents gentes. Cet épuisement du sang aristocratique semblait
un péril à l’égard des dieux dont certains autels allaient rester déserts ;
et, aux veux du peuple, il en résultait une diminution d’éclat pour la cité
qui, comme l’Angleterre de nos jours, honorait les grandes familles et aimait
leur large existence. Vespasien agit résolument : investi, en 73[61], du titre de
censeur, avec son fils Titus pour collègue, il raya de la liste des deux
ordres Ies membres indignes, les remplaça par les personnages les plus
distingués de l’empire, et, en vertu de ses pouvoirs comme souverain pontife,
il en éleva plusieurs au patricial. Mille familles italiennes ou provinciales
vinrent s’ajouter aux deux cents familles aristocratiques qui avaient
survécu, et constituèrent avec elles la haute société romaine, celle où l’on
prenait les candidats à toutes les fonctions civiles, militaires et
religieuses[62].
Une preuve du soin extrême que Vespasien mit et choisir vraiment., comme
disent Suétone et Aurelius Victor, les meilleurs,
c’est qu’au nombre de ceux qu’il nomma patriciens, se trouvèrent Agricola,
beau-père de Tacite, qui était de Il est fâcheux que nous n’ayons pas de renseignements sur cette rénovation de la noblesse romaine : événement considérable dont l’écho se retrouve sous Domitien dans les vers de Stace[66], et qui a eu pour conséquence l’heureuse époque des Antonins. Cette aristocratie, empruntée par Vespasien aux cités provinciales où elle s’était formée aux affaires publiques, où elle avait pris le goût de l’économie, de la simplicité et de l’ordre[67], apporta dans Rome des mœurs honnêtes que ne connaissaient plus les descendants des proconsuls républicains, cette jeunesse dorée dont on a vu sous Néron les abominables licences. Elle fournira les grands empereurs du second siècle, les habiles lieutenants qui les seconderont et des sénateurs qui ne conspireront plus qu’à de longs intervalles, parce que, oublieux enfin de Brutus et de Caton, dont les images ne se dressent plus dans l’atrium de ces maisons nouvelles, ils céderont rarement aux tentations mauvaises que donnaient à leurs prédécesseurs l’illustration du nom, l’influence de la richesse et la fatalité des souvenirs. Le sénat ainsi renouvelé et pour un moment devenu la représentation sincère de l’empire, Vespasien lui soumit toutes les affaires importantes. Il assistait régulièrement aux discussions, et, lorsqu’il adressait un message aux Pères, c’étaient ses fils, et non pas son questeur, qui allaient en donner lecture. Par ses libéralités, il combla le cens de quelques sénateurs et forma, pour secourir les consulaires pauvres, un fonds annuel de 500.000 sesterces[68]. Suétone lui rend ce témoignage qu’il serait difficile de citer un seul individu puni injustement sous son règne, à moins que ce ne fût en son absence ou à son insu[69]. Il aimait à rendre lui-même la justice au Forum ; et, afin de liquider l’arriéré de la guerre civile en terminant vite les innombrables procès qui surchargeaient les rôles des centumvirs, il institua une commission de juges tirés au sort qui fit restituer ce qui avait été usurpé à la faveur des troubles. Dans le même esprit, il déchira toutes les créances du fisc pour n’hériter point de ces temps malheureux. Les légions, qui avaient fait et défait cinq empereurs en deux ans, ne connaissaient plus l’ancienne discipline ; il les y ramena, et, mettant en pratique le mot de Galba, il choisit ses soldats et ne les acheta point. Les mutins furent cassés, les vainqueurs mêmes attendirent, longtemps les dons promis[70]. Les mœurs valaient moins encore ; il fit mieux que des lois pour les réformer : il donna de bons exemples. Un jeune homme étant venu tout parfumé le remercier du don d’une préfecture, il se détourna d’un air de dégoût en lui disant d’une voix sévère : J’aimerais mieux que tu sentisses l’ail, et il révoqua la nomination. Caton n’eût pas mieux fait. Aussi Tacite date de ce règne un changement salutaire. Vespasien, dit-il, rappelait, à sa table et dans ses vêtements, la simplicité antique. Le désir de plaire et de ressembler au prince fit plus que les lois, les châtiments et la crainte. Dans son couvre de restauration, il comprit, à l’exemple d’Auguste, le culte officiel, et il essaya, lui aussi, de ranimer des ardeurs qui s’éteignaient. Nous ne pouvons qu’entrevoir cette réforme dans l’ombre qui enveloppe toute l’histoire de ce prince ; mais il y travailla, car des inscriptions que nous lisons encore le célèbrent comme le restaurateur des rites anciens, des pompes religieuses et des édifices sacrés[71]. Un des temples qu’il bâtit était dédié à une divinité étrange, à Claude ; mais Claude était l’auteur de sa fortune ; d’ailleurs, ayant été fait dîmes, il devait avoir ses prêtres et ses autels : c’était légal. Vespasien n’aimait pas les spectacles, surtout ceux de gladiateurs, et dans tout l’empire il ne permit qu’aux seuls Éphésiens d’instituer de nouveaux jeux. Mais il multiplia les constructions, car il voulait, comme Auguste encore, que le peuple pût gagner sa vie en travaillant. Un mécanicien promettait de transporter à peu de frais dans le Capitole des colonnes immenses ; il lui fit compter une grosse somme, mais rejeta ses propositions en disant : Permettez que je nourrisse les pauvres gens[72]. A peine de retour dans sa capitale, il se mit à l’œuvre avec une telle ardeur, qu’au bout de peu de mois les rues de Rome, rendues impraticables par le malheur des temps, se retrouvèrent en bon état de viabilité[73]. La même sollicitude s’étendit aux provinces[74]. Il répara les aqueducs, augmenta les sources qui alimentaient les fontaines de Rome[75], et pour faire disparaître les ruines qui l’encombraient, depuis le grand incendie de Néron, il permit à qui le voudrait d’occuper les terrains vacants et d’y bâtir, si les propriétaires négligeaient de le faire. On avait commencé par ses ordres la reconstruction du Capitole, mais l’ouvrage allait lentement ; quand il fut de retour, il mit lui-même la main à l’œuvre pour déblayer les décombres et porta des pierres sur ses épaules. Personne, après cela, ne pouvait se refuser au travail. Trois mille tables d’airain, sur lesquelles étaient gravés les sénatus-consultes et les plébiscites relatifs aux alliances, aux traités et aux privilèges accordés à différents peuples, avaient été détruites dans l’embrasement du temps ; il fit rechercher partout des copies de ces actes et reconstitua les archives de l’histoire nationale. Auguste avait élevé deux autels à la faix, Vespasien lui bâtit un temple où il déposa les plus précieuses dépouilles de Jérusalem[76] ; et afin de montrer mieux encore à l’univers ses intentions pacifiques, le vieux général ferma pour la sixième fois les portes du temple de Janus. Il ajouta un forum entouré de colonnades à ceux qui existaient déjà, et commença, au milieu de la ville, l’immense amphithéâtre, montagne de pierres aux trois quarts debout encore aujourd’hui, qui frappe le voyageur d’étonnement et d’admiration. Quatre vingt sept mille spectateurs tenaient à l’aise sur ses gigantesques gradins. Une statue colossale élevée près de là pour Néron, mais que Vespasien consacra au Soleil, lui donna son nom, le Colisée. Il recula le pomœrium : c’était un droit que lui donnaient ses victoires[77]. En Italie, il fit creuser un tunnel sous une montagne pour
donner une pente plus douce à la voie Flaminienne, et il releva, à
Herculanum, le temple de Aussi ne comprend-on pas qu’après l’énumération de ces dépenses, dont les unes étaient des nécessités, les autres des bienfaits, Suétone lui ait adressé un reproche qui est resté sur sa mémoire, celui d’une avarice sordide et coupable. Suivant cet écrivain, qui écoute à toutes les portes et qui prend de toutes les mains, anecdotes suspectes et renseignements authentiques, paroles officielles et bons mots fabriqués dans les salons de Rome, sans s’inquiéter si telle portion de son récit ne détruit pas l’autre, Vespasien aurait vendu les magistratures aux candidats et l’absolution aux accusés ; accaparé certaines denrées polar les revendre en détail ; enfin permis aux gouverneurs de piller, sauf à leur faire rendre gorge, comme des éponges qu’il laissait s’emplir dans les provinces, mais qu’il pressait à Rome. De telles habitudes eussent constitué un gouvernement détestable, organisant lui-même le gaspillage de ses propres ressources ; Vespasien, soldat rompu à la discipline et à l’ordre, ne les eut certainement pas, et nous n’en trouvons aucune trace dans les faits arrivés jusqu’à nous. Les choix que nous connaissons de lui sont excellents : en Bretagne, Cerialis, Frontinus et Agricola, que Tacite traite de grands hommes ; en Asie, Silius Italicus, qui, au témoignage de Pline, s’y acquit beaucoup de gloire[82] ; on a vu qu’il prépara la fortune de Trajan, celle des Antonins, et il honora le consulat en y appelant le célèbre jurisconsulte Pegasus. Suétone nous montre encore Vespasien partageant avec ses affranchis les profits que ceux-ci retiraient de certaines complaisances. Un jour, le serviteur qui conduisait sa litière s’arrêta sous prétexte qu’une des mules était déferrée, et un plaideur se trouva juste à point pour présenter une requête. Combien as-tu gagné à ferrer ta mule ? demanda-t-il au valet ; et il exigea la moitié de la bonne main. Un de ses affranchis sollicitait une intendance pour. un prétendu frère ; l’empereur manda le candidat, se fit compter la somme promise, et donna la place. Les députés d’une ville venaient lui annoncer qu’une somme d’argent avait été votée par leurs concitoyens pour lui ériger une statue. Mettez-la ici, dit Vespasien en tendant la main, la base est toute prête. Qu’on ajoute encore, si l’on veut, le surnom de Six-Oboles, que lui donnaient les Alexandrins, et la parodie du bouffon à ses funérailles : Combien mon convoi ? — 10 millions de sesterces ? — Donnez-m’en 100.000, et jetez-moi au Tibre ; et l’argent de certain impôt dont Vespasien disait à son fils qui s’y était opposé : Trouves-tu que cet argent sente mauvais ?[83] — Tout cela manque de dignité assurément ; mais ne seraient-ce pas de bons tours joués par un vieillard qui aimait à rire, ou plutôt des médisances mises en circulation par le beau monde de Rome, par ces élégants débauchés de la cour de Néron, qui ne se consolaient pas de voir le plébéien parvenu compter l’argent de l’État, que l’héritier des Jules leur jetait en fêtes et en orgies : pour eux, être prodigue c’était faire le César[84]. Laissons ces misères et venons à l’histoire sérieuse. Oit sait qu’il est impossible de dresser le budget de l’empire
et que, d’après toutes Ies probabilités, ses ressources n’étaient point
considérables : sous Domitien, une augmentation d’un tiers pour la solde
ruina l’ærarium militare, quoiqu’il
fût alimenté par les plus gros revenus de l’État[85]. Les mauvais
princes paraient à cette insuffisance financière avec la loi de majesté, mais
Vespasien n’entendait pas «apurer ses comptes nit la façon de Caligula et de
Néron[86]. Cependant,
depuis bientôt dix années, le gouvernement ne faisait rien pour l’empire, et
aux ruines causées par l’incurie du pouvoir s’étaient ajoutées celles qui
provenaient des discordes intestines ; tous les services publics étaient en
souffrance. Quantité de créanciers adressaient des réclamations au trésor ;
bien des villes demandaient qu’on les aidât à rebâtir leurs temples, leurs
murailles, et la seule reconstruction du Capitole, c’est-à-dire du sanctuaire
national, devait coûter des sommes énormes ; mais il fallait encore réparer
les ponts, les chaussées ; relever les castra
stativa renversés sur certains points par les Barbares ; établir
de nombreuses colonies de vétérans, pour rendre les légions plus dociles et diminuer
les dépenses de la solde ; remplir les arsenaux vidés par la guerre civile ;
pourvoir enfin aux dépenses que nécessitait la réorganisation militaire des
frontières. Nous ne connaissons pas les guerres de Vespasien, bien que trois
fois en 71 il ait pris le titre d’imperator
et trois fois encore l’année suivante. Mais en le voyant faire de Voilà le secret de cette sévère économie qui parut aux prodigues et aux esprits légers une ladrerie honteuse : Vespasien déclara un jour aux pères conscrits que 4 milliards de sesterces ou, suivant une autre version, 40 milliards lui étaient nécessaires pour tout remettre en état[88]. Il mena hardiment cette œuvre de réparation, rétablissant les impôts abolis sous Galba, en créant de nouveaux et augmentant ceux des provinces. Ce fut autant pour cette réorganisation financière de l’empire qu’il se fit nommer censeur, que pour sa réorganisation politique et morale. Le cadastre qu’il fit dresser aida à découvrir nombre de terres et de personnes qui s’étaient affranchies de l’impôt ou n’avalent point été portées sur les rôles. Il les y fit comprendre, et le tribut de plusieurs provinces se trouva doublé[89]. Néron avait follement prodigué les immunités, Vespasien les retira et créa encore au profit du trésor, en formant de nouvelles provinces, une nouvelle matière imposable. C’est ce qu’il voulait lorsqu’il ôta leurs franchises à huit Mats restés libres, et qui pour la plupart usaient fort mal de cette liberté. On comprend toutes ces mesures, elles sont d’un homme d’État qui sait trouver des ressources pour faire face à des dépenses nécessaires. Il ouvrit même une source nouvelle de dépenses
permanentes. Tout rude qu’il était dans ses manières et dans son langage, le
fils du publicain de Reate comprenait l’influence des lettres et des arts, et
il les protégea en accordant de riches gratifications,
de magnifiques présents aux poètes célèbres[90], aux artistes fameux, à celui, par exemple, qui fit D’ailleurs tout ce qui était autrefois activité libre, industrie privée, se réglait et prenait sa place dans la grande machine construite par les empereurs. Déjà sous Néron on avait fait entrer les médecins dans les cadres de l’organisation officielle et municipale, en donnant un traitement, des immunités et un titre aux médecins de ville et de quartier, archiatri populares, et aux médecins du palais, archiatri palatini, qui tous finiront par prendre une sorte d’autorité sur le reste de leurs confrères. Vespasien faisait de même pour les lettres. en leur donnant une place à la cour et dans l’État, il obéissait à cet esprit de classement qui avait été inoculé par Auguste au gouvernement impérial. Ainsi l’administration, comme le poisson aux mille bras, qui dans le libre Océan arrête et dévore tout ce qui passe à sa portée, allait saisir peu à peu et envelopper ce qui auparavant avait librement vécu. Quand elle aura réussi dans cette œuvre d’absorption, elle aura supprimé tout mouvement, toute vie ; la perfection du système sera, pour l’empire, l’immobilité et bientôt après la mort. Il est vrai de dire cependant qu’une partie des lettrés se proposa désormais de puiser à cette source qu’on leur ouvrait et calma son éloquence. D’autres continuèrent leurs déclamations contre les tyrans. En supprimant la guerre civile et la vie politique, l’empire
avait fait beaucoup de désœuvrés qui, après les proscriptions triumvirales,
comme chez nous après Deus
nabis hœc otia fecit. Le règne paisible et admiré d’Auguste est dû à cette universelle lassitude tout autant qu’à la sagesse du prince ; mais, à la longue, le repos fatigue, l’admiration lasse, et l’ennui dégoûte même du bonheur. A partir de Tibère, il se forma dans Rome une opposition très pauvre d’idées et de sens politique, très riche de cet esprit piquant qui se plaît aux médisances, aux paroles creuses et sonores, la joie des oisifs dans les salons ou sous les portiques. Ce n’était point un parti ayant des plans arrêtés et prêt à devenir un gouvernement, mais des mécontents isolés, incapables ; d’agir, et pourtant très capables, comme dit Sénèque le père, de risquer leur tête pour un bon mot. À côté d’eux se trouvaient des philosophes cyniques et stoïciens, deux sectes très indifférentes à la politique, mais qui fournissaient aux têtes malsaines de beaux thèmes de déclamation contre la société et l’État. Ces gens, disait Mucien, sont remplis d’un fol orgueil. Laisser pousser sa barbe, relever les sourcils, s’envelopper d’un manteau troué et marcher sans chaussure, voilà ce qui fait l’homme sage, courageux et juste. Le reste n’est digne que de mépris. Les nobles sont des sots, et les petites gens de petits esprits ; l’homme beau est un impudique, le riche un voleur, le pauvre un valet[93]. Juvénal, écho de l’antipathie populaire contre ces fougueux moralistes qui prétendaient dire son fait à la foule comme au prince, est plus dur encore pour ces hypocrites[94]. Vespasien, par sa censure, leur avait donné des recrues, en chassant du sénat et de l’ordre équestre des gens tarés qui cachaient ensuite leurs rancunes sous le manteau du philosophe. Tel fut ce Palfurius Sura qui, pour plaire à Néron, avait combattu dans l’arène contre une jeune fille de Lacédémone et à qui Vespasien avait ôté sa toge consulaire déshonorée. Cette disgrâce fit de lui un stoïcien et nu austère personnage[95] qui réclama la liberté et le gouvernement populaire jusqu’au moment où, rentré dans la faveur de Domitien, il devint le plus avide des délateurs, puis travailla, comme jurisconsulte, à fonder la théorie des droits absolus de l’empereur. Au temps des princes qui prononçaient facilement une sentence de mort, ces hommes s’étaient tus, drapés dans leur silence ; une attitude résignée et triste alors avait suffi à leur dignité ; sous le débonnaire Vespasien, ils parlaient, ils accusaient, ils invectivaient.. L’empereur ne fit point d’abord attention à ces clameurs ; leur vertu s’indigna de cette indifférence, et, comme ils couraient le risque d’être oubliés s’ils n’eussent forcé le ton, ils appelèrent la persécution, estimant qu’elle leur donnerait la gloire, sans le martyre. Quelques-uns même, rendus ivres d’orgueil et d’insolence par l’impassible sang-froid du prince, en vinrent à braver tout péril, pour avoir raison de cette injurieuse tranquillité. On finit par reprendre contre eux une vieille loi républicaine qui chassait les étrangers de la Ville[96]. Un d’eux, condamné au bannissement parce qu’il avait publiquement enseigné que le gouvernement d’un seul était le pire des gouvernements, apprit la sentence au milieu d’une déclamation qu’il prononçait encore contre la monarchie ; il continua. Un autre, également puni de l’exil, voit l’empereur venir de son côté. Au lieu de se lever, ou de saluer au moins le chef du monde romain, il l’insulte. Tu fais ton possible, se contenta de dire Vespasien, pour que je t’ôte la vie, mais je ne tue pas un chien qui aboie. Un troisième, Diogène, se faisant censeur public des mœurs du palais, invectiva Titus, en plein théâtre, sur sa liaison avec la reine Bérénice ; on le condamna aux verges. Héras, son compagnon recommença aussitôt, en ajoutant force insolences pour le peuple ; on lui trancha la tête[97]. Ces réformateurs qui vont au théâtre gourmander le prince et le peuple semblent ridicules, et, par l’exagération de leurs sentiments et de leur langage, ils l’étaient. C’est pourtant un symptôme grave que ces publiques attaques contre les mœurs et les idées du temps. A la même époque, d’autres hommes rompaient aussi avec la société romaine et ses croyances. La réaction philosophique et religieuse contre le sensualisme païen suscitait donc des apôtres, même des martyrs, et le monde s’engageait dans une route toute nouvelle qui sera pleine de dramatiques incidents, de généreux sacrifices, mais aussi où les liens sociaux se relâcheront, et où s’affaiblira, jusqu’à se perdre, l’amour pour la patrie terrestre. Vespasien mit un terme à ces agitations en renouvelant contre les stoïciens et les cyniques les sénatus-consultes républicains qui avaient interdit le séjour de Rome aux philosophes. Il excepta Musonius, ce chevalier romain déjà proscrit par Néron et qui semble n’avoir suivi la secte que par ses bons côtés. Il eût bien voulu épargner aussi Helvidius, gendre de Thrasea et aussi honnête homme que son beau-père, mais républicain à contretemps qui mettait la liberté dans les insultes au pouvoir. Ce que Démétrius et Diogène faisaient dans la rue, Helvidius le faisait à la curie, au tribunal : il conspirait tout haut et au cœur du gouvernement. Durant sa préture, il ne parla jamais de Vespasien dans ses édits, et quand le prince était revenu à Rome, il l’avait salué sous son nom de famille, comme si l’empereur n’était à ses yeux qu’un simple particulier. Au sénat, il discutait contre lui avec emportement ; au Forum, dans les groupes qui se formaient, sitôt qu’il avait été reconnu, ses paroles étaient toujours l’éloge du gouvernement populaire, et jamais il ne manqua de célébrer par une fête le jour de naissance de Brutus et de Cassius[98]. Il serait difficile de ne pas trouver cette conduite séditieuse[99] ; et comme Helvidius était sénateur, l’impunité eût été une de ces preuves de faiblesse que donnent les gouvernements qui veulent mourir. Vespasien, entraîné par Mucien, le laissa condamner à la déportation, et, quelque temps après, sur de nouveaux sujets de plainte, il envoya l’ordre de le tuer. Cet ordre, il voulut aussitôt le retirer, mais on le trompa en lui disant qu’il était trop tard. Helvidius avait-il pris part à une de ces nombreuses conspirations dont parle Suétone[100] ? Nous l’ignorons ; car nous n’en connaissons qu’une seule, celle de Marcellus, personnage consulaire, et de Cæcina, l’ancien général vitellien. Celui-ci avait déjà gagné nombre de soldats, quand, la veille de l’exécution, Titus, qui venait de saisir une proclamation aux prétoriens écrite de la main même de Cæcina, invita le général à un festin où il le fit poignarder : exécution juste sans doute, mais bien expéditive et, par sa forme, digne des plus mauvais jours. Marcellus, condamné par le sénat, se coupa la gorge[101]. Depuis Tibère, nul empereur ne donna autant que Vespasien d’attention aux affaires des peuples alliés ou sujets ; il reprit et pratiqua en Brand le système des colonies pour multiplier dans les provinces l’élément romain. On peut reconnaître dans le surnom de flavienne porté par beaucoup de cités, les villes où lui et ses fils, mais lui surtout, envoyèrent des vétérans, et on ne les connaît certainement pas toutes[102]. On l’a vu entreprendre partout d’utiles travaux et inscrire dans le sénat, dans l’ordre équestre, les notables des provinces. Durant soli séjour en Égypte, il avait fait dans ce pays de sévères reformes qui lui avaient attiré les railleries des turbulents Alexandrins. En Judée, il crut avoir étouffé un volcan qui, avant de s’éteindre, ébranlera encore tout l’Orient. Les Juifs échappés au carnage avaient fui de deux côtés : sur les bords du Tigre, où ils portèrent leur haine impuissante, et en Afrique, où un million de leurs coreligionnaires les avaient depuis longtemps précédés. En se retrouvant là si nombreux, ils voulurent renouveler la guerre qui venait de finir par la ruine de Jérusalem ; un instant ils réussirent à troubler Alexandrie, où ils abattirent les statues de l’empereur ; mais, trahis par leurs frères à Cyrène, à Thèbes, dans toute l’Égypte, ils périrent au milieu des supplices, et Vespasien fit fermer le temple que le grand prêtre Onias avait bâti dans le voisinage d’Héliopolis[103]. Quelques Grecs, entraînés dans ces agitations, furent épargnés ; une sédition qui éclata plus tard à Antioche ne fut pas plus sévèrement punie : Vespasien s’inquiétait peu de ces accès de turbulence municipale dans la populace des grandes cités grecques, pourvu que l’ordre général ne frît pas compromis. Il fut plus sévère à l’égard d’un prince du voisinage.
Antiochus, roi de Partout Vespasien resserrait les liens de l’empire, que
Néron avait tant relâchés ; il retira aux Lyciens la liberté que le
successeur de Claude leur avait sans doute rendue, et les réunit à Ce remaniement des provinces attesterait mie autre
préoccupation, celle de diviser les gouvernements trop considérables que
depuis Auguste on formait volontiers en Orient pour concentrer les forces et
mieux assurer la résistance contre les Parthes. Vespasien, qui avait éprouvé
par lui-même combien ces grands commandements favorisaient les projets des
ambitieux, fit de Nous ne savons rien des bords du Rhin et du Danube ; il
faut en conclure que la ferme discipline rétablie par Vespasien y maintint la
paix. On voit seulement que En Gaule, des recherches sévères avaient été faites contre les fauteurs de la dernière insurrection ; on a vu qu’un des principaux chefs, Sabinus, découvert au bout de neuf ans, fut conduit à Rome et exécuté : cruauté qui fait tache dans la vie de Vespasien, s’il n’a pas eu quelque raison impérieuse de manquer cette fois à sa clémence habituelle. Galba avait donné le jus
Latii à la plus grande partie de Les affaires de Bretagne nous sont mieux connues, grâce à
Tacite, que nous retrouvons ici avec Vespasien touchait au terme de sa laborieuse carrière. Il
avait soixante-neuf ans et se trouvait dans sa petite maison du territoire de
Reate, quand il reconnut les approches de la mort. Je sens que je deviens dieu, dit-il à ceux qui l’entouraient,
se riant d’avance de son apothéose. Il n’avait pas plus de respect, à ce
moment du moins, pour les présages. On lui parlait de l’apparition d’une
comète comme d’un augure infaillible : Cela
regarde, dit-il, le roi des Parthes
qui est chevelu, et non pas moi qui suis chauve[111] ; paroles d’un
superstitieux qui finit en incrédule. Jusqu’au dernier moment, des pensées
viriles l’occupèrent ; il reçut les députations, donna les ordres, pourvut à
toutes les affaires, et, une défaillance survenant : Un empereur, dit-il, doit mourir debout. Il voulut se lever et expira dans ce
suprême effort ( Le premier empereur plébéien n’a pas eu d’historien, mais deux mots de son biographe suffisent pour sa renommée : rem publicam stabilivit et ornavit : par lui l’État fut affermi et glorifié. Pline dit aussi : La grandeur et la majesté ne produisirent en lui d’autre effet que de rendre la puissance de faire le bien égale au désir qu’il en avait. Ajoutons que ce soldat fait empereur par les légions fut plus sage que Trajan, qu’on vantera davantage : il demanda tout à la paix, rien à la guerre[112]. |
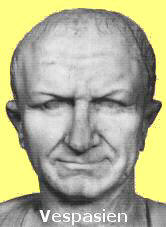 Vespasien vit la fin de deux guerres commencées, l’une
sous Néron, l’autre sous Vitellius, et qui ne tiennent à l’histoire de son
principat que parce que ses généraux en frappèrent les derniers coups.
Vespasien vit la fin de deux guerres commencées, l’une
sous Néron, l’autre sous Vitellius, et qui ne tiennent à l’histoire de son
principat que parce que ses généraux en frappèrent les derniers coups. Un caprice de Caligula releva ce royaume. Un
petit-fils d’Hérode,
Agrippa, avait osé, du vivant de Tibère, faire sa cour au jeune Caïus.
Un caprice de Caligula releva ce royaume. Un
petit-fils d’Hérode,
Agrippa, avait osé, du vivant de Tibère, faire sa cour au jeune Caïus. 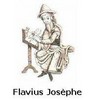 Nulle part
Nulle part L’étincelle qui alluma l’incendie partit de la ville où
les deux religions, les deux civilisations, mises par Hérode en présence, s’irritaient
chaque jour au contact l’une de l’autre. Pendant que les Juifs de Césarée
étaient réunis dans leur synagogue, un Grec, pour insulter à leurs rites,
vint à la porte de cette maison immoler des oiseaux. De là émeute, combat,
puis plaintes au procurateur Gessius Florus, lequel donna tort aux Juifs,
bien qu’ils lui eussent donné S talents pour acheter son appui. A cette
nouvelle, le peuple de Jérusalem insulta le gouverneur ; il répondit comme
répondent habituellement ceux qui ont des épées à leur commandement : ses
cavaliers chargèrent la foule ; beaucoup furent tués, d’autres pris, et
quelques-uns, malgré leur qualité de chevaliers romains, déchirés à coups de
fouet, puis crucifiés. Vainement le roi Agrippa
L’étincelle qui alluma l’incendie partit de la ville où
les deux religions, les deux civilisations, mises par Hérode en présence, s’irritaient
chaque jour au contact l’une de l’autre. Pendant que les Juifs de Césarée
étaient réunis dans leur synagogue, un Grec, pour insulter à leurs rites,
vint à la porte de cette maison immoler des oiseaux. De là émeute, combat,
puis plaintes au procurateur Gessius Florus, lequel donna tort aux Juifs,
bien qu’ils lui eussent donné S talents pour acheter son appui. A cette
nouvelle, le peuple de Jérusalem insulta le gouverneur ; il répondit comme
répondent habituellement ceux qui ont des épées à leur commandement : ses
cavaliers chargèrent la foule ; beaucoup furent tués, d’autres pris, et
quelques-uns, malgré leur qualité de chevaliers romains, déchirés à coups de
fouet, puis crucifiés. Vainement le roi Agrippa