|
I. — L’ITALIE.
Le voyage que nous venons d’accomplir à travers les
provinces romaines et les pays qui leur sont limitrophes nous ramène en face
de l’Espagne, d’où nous étions partis pour faire le tour de la Méditerranée. Mais,
au milieu de cette mer, unique au monde pour la beauté de ses rives, au
centre de ce bassin vers lequel convergeaient les regards de vingt peuples,
nous avons oublié la péninsule qui s’élevait comme une haute citadelle, d’où
Rome surveillait et contenait son empire. Position inexpugnable si elle reste
bien approvisionnée de force et de courage[1] !
Par malheur, l’Italie avait cruellement expié ses
victoires, et ce n’était qu’aux temps antiques que pouvait se rapporter le
magnifique salut du poète :
Salve,
magna plarens frugum, Saturnia tellus,
Magna
virunz l
Maintenant, en effet, que restait-il de la vieille race
italienne ? et l’Italie même était-elle encore ce sol fécond où l’on croyait
que les dieux étaient venus donner les premières leçons de la sagesse
agricole ? Il y avait bien çà et là des traces de l’ancienne fertilité ; sur
quelques points on montrait des merveilles : un cep qui portait deux mille
grappes, un autre à Rome même qui donnait douze amphores de vin. Varron
vantait aussi le blé de Campanie et d’Apulie, le vin de Falerne, l’huile de
Vénafre et cette
multitude d’arbres qui fait, disait-il, de notre pays un immense verger. Mais généralement la richesse
du sol s’était perdue avec les vieilles traditions de culture[2], et le blé ne
rendait plus eu moyenne que 4 pour 1[3]. Nous avons abandonné le soin de nos terres aux derniers de
nos esclaves, dit Columelle : aussi les traitent-ils en vrais bourreaux. Nous
avons des écoles de rhéteurs, de géomètres, de musiciens. J’en ai vu même où
l’on enseigne les professions les plus viles, comme l’art d’apprêter les mets
ou de parer la tête ; mais, pour l’agriculture, nulle part je n’ai trouvé ni
professeur ni élève. Et cependant, dans le Latium même, il nous faut, pour
éviter la famine, tirer le blé de pays situés au delà des mers, et le vin des
Cyclades, de la Bétique
et de la Gaule.
Ces moissons de la Sicile, de l’Afrique et de l’Égypte, données ou
vendues à vil prix dans les cités maritimes, c’est-à-dire sur tous les points
de grande consommation, firent aux maigres récoltes de l’Italie une
concurrence redoutable : le blé étranger acheva de tuer le blé indigène[4]. Alors ou fit de
la viande, qui se vendait mieux, en substituant les prairies aux terres à
labour, les cultures dont Jupiter fait tous les
frais à celles qui demandent beaucoup de bras ; et, sur ces latifundia, il n’y eut pas plus de travail
pour l’ouvrier agricole que de place pour le petit propriétaire[5].
Ainsi la terre manquait aux hommes, et les hommes à la
terre ; le sol italien s’était appauvri, et l’Italie s’était dépeuplée.
Aux causes économiques de cette dépopulation il faut
joindre les causes politiques et militaires : tout le sang répandu depuis les
Gracques, la guerre des Marses et la colère plus terrible de Sylla ; puis
tant de légions italiennes décimées par les fatigues et la guerre, tant de
colons envoyés hors de la péninsule, et ces continuelles migrations d’aventuriers
qui allaient chercher fortune au loin. Ils étaient Romains, le monde leur
appartenait, et, à présent que la misère était une honte, ils seraient
modestement restés à labourer leurs champs, comme au temps de l’antique
pauvreté ! Mieux valait exploiter dans les provinces leur titre de
citoyen, la faveur d’un patron, magistrat ou publicain ; et gagner quelque
emploi lucratif dans ces sociétés de commerce si nombreuses dans l’empire que
toute ville importante avait une colonie de négociants romains[6]. Si nous avons
trouvé tant d’Italiens en Asie au temps de Mithridate, combien y en a-t-il à
présent ? Combien encore en Égypte, en Syrie, à Carthage, qu’à cette heure
même ils relèvent ; en Espagne, où la moitié du pays parle déjà latin ; en
Gaule, où ils ont achevé l’invasion de la Narbonnaise, et où ils
commencent celle de la
Celtique et de l’Aquitaine ? Bientôt nous en verrons au
fond de la Germanie
chez les Marcomans et les Chérusques, et jusque dans les solitudes, où l’Arabe,
qui les rencontre, s’arrête étonné devant ces hommes d’un monde qu’il ne
connaît pas.
Ainsi le peuple romain, dispersé dans les plus lointaines
régions, laissait désertes ces campagnes d’où les vigoureuses races de l’ancienne
Italie avaient disparu ; et Rome s’encombrait d’une foule famélique, misera ac jejuna plebecula, qu’il ne fallait
pas regarder de trop prés de peur de voir, sous les toges déchirées, la trace
du fouet et des fers[7]. Dans cette
multitude qui se recrutait si bas Tite-Live ne voyait plus de soldats[8]. Columelle[9] montre les jeunes
Romains de bonne maison si ruinés avant l’âge par la débauche, que la mort n’avait
presque plus rien à faire quand elle venait les prendre.
Toute exagération mise a part, l’Italie, au milieu de sa
surprenante grandeur, déclinait ; il lui arrivait ce qui sera le sort de l’Espagne
sous Philippe II,
de s’épuiser à élever une domination colossale et de payer sa gloire par d’incurables
misères. Le soleil ne se couchait pas sur l’empire du fils de Charles-Quint :
le Pérou lui envoyait ses trésors ; ses frottes couvraient la mer ; ses
armées menaçaient l’Europe entière ; et avec tant de richesses et de
puissance, l’Espagne se ruinait, ses campagnes se changeaient en déserts, ses
villes en bourgades, ses châteaux en masures, et leurs maîtres, les fiers
hidalgos, couvraient le pays d’un peuple de mendiants. La base qui portait l’édifice
fléchissant, bientôt tout croula. Heureusement pour l’Italie, elle avait
lentement monté, lentement aussi elle descendit.
Cet état frappait les yeux clairvoyants. César s’était
inquiété de voir le mal qui avait tué la Grèce s’étendre sur l’Italie[10]. Afin d’arrêter
ces migrations qui dépeuplaient la péninsule, et de combattre l’absentéisme
qui l’appauvrissait, il avait ordonné qu’an citoyen ne pût rester plus de
trois années de suite dans les provinces, à moins d’empêchement légal ; et il
forçait ses vétérans colonisés à rester vingt années sur leurs champs avant d’avoir
le droit de les vendre. Mais les troubles du second triumvirat remirent tout
en question. Les proscriptions, la guerre de Pérouse, surtout les nouvelles
colonies triumvirales, accumulèrent sur l’Italie de nouvelles et plus grandes
misères. On a compté que, de la dictature de César aux premières années du
principat d’Auguste, soixante-trois villes avaient été livrées à des vétérans
sortis de toutes Ies provinces et recrutés dans toutes les races[11] ! Après ces
exécutions, les chemins de l’Italie se couvraient d’émigrants que la failli
chassait vers Rome. Et, tandis qu’ils remplissaient de leurs lamentations le
Forum et les temples[12], ceux qu’ils laissaient
derrière eux sur leurs terres gaspillaient, en quelques mois d’orgies, le
bien qui avait nourri dis générations de laboureurs. L’usure défaisait ce qu’avait
fait la violence. Combien de ces soldats paresseux et grossiers s’attachaient
au sol, élevaient une famille, fondaient une maison ? Bien peu. La plupart,
continuant la guerre en pleine paix[13], pillaient leurs
voisins, et, quand ils ne trouvaient plus rien à prendre, ils vendaient leur
terre à quelque riche accapareur, pour accourir à Rome faire le peuple
souverain, vivre à la porte d’un patron, s’asseoir au cirque, ou tendre la
main sur le pont Sublicius, et manger en un coin du Forum la sportule qu’ils avaient mendiée.
Aussi comme Rome grossit, comme elle déborde par-dessus
ses murailles et par toutes ses portes ! Autour de la grande ville, il y
en a une autre, suburbana, qui descend
vers Ostie ou court le long des voies Appienne et Latine, qui gagne vers
Tusculum ou Tibur, et passe le fleuve pour monter au Janicule et au Vatican. La Grande-Grèce est
désolée, deleta, sauf cieux ou trois
villes que leur position protège, et le pays des Samnites est désert :
Bénévent, le grand passage entre les deus versants de l’Apennin méridional, y
garde seul un peu de vie[14] ; la Sabine, l’Étrurie,
achèvent de mourir. Au moyeu âge, après le désastre de la Melloria, qui voulait
voir Pise allait à Gènes ; qui cherche l’Italie n’a maintenant qu’à demeurer
à Rome. Combien y étaient-ils ? Les uns disent quatre, six, même huit
millions, d’autres seulement cinq cent soixante-deux mille. Il faut probablement
tripler ce chiffre. La divine Nature,
dit tristement Varron, avait fait la campagne,
les hommes ont fait les villes.
Cependant les riches fuyaient de temps à autre loin de
cette foule, sur les collines du Latium et de l’Étrurie méridionale. Là où nos pères gagnaient des triomphes, dit
Florus, leurs descendants bâtissent des villas.
On les voit surtout vers les beaux rivages du golfe de Naples, qu’ils
couvrent de somptueuses constructions. La sombre forêt qui entourait l’Averse
était tombée sous la hache des légionnaires d’Agrippa, et de nombreux
édifices, couronnant ces collines redoutées, se miraient dans le lac limpide
qu’on avait appelé la bouche des enfers. Sur ce coin de l’Italie se
concentrait une activité qu’on ne retrouvait plus qu’à Rome. Agrippa y
complétait ses grands travaux en faisant construire par Cœccius Nerva une
route souterraine de l’Averse à Cumes, et il allait creuser ou agrandir la
fameuse grotte du Pausilippe qui devra son nom au Sans-Souci de Vedius
Pollion[15].
A Pouzzoles, des cris en vingt langues, et l’infinie
variété des costumes et des denrées, annonçaient un des grands marchés de l’empire.
Près de là s’étendaient les rives enchantées de Baïa, qu’Horace appelle le
plus beau lieu du monde : des îles et des promontoires découpant la mer en un
lac immense et tranquille, dont les brises calmaient les ardeurs d’un soleil
radieux ; toutes les beautés du ciel et de la terre, toutes les poétiques
terreurs de la légende et de la nature : l’antre ténébreux de la Sibylle aux oracles
redoutables, le voisinage du royaume des ombres que Virgile allait ouvrir
avec son rameau d’or et les champs Phlégréens laissant échapper leurs vapeurs
infernales au milieu de bruits sinistres ; mais aussi de verdoyantes collines
couvertes de constructions gracieuses qui descendaient jusque dans Ies flots,
des sources thermales qui promettaient la santé, et une tiède atmosphère qui
invitait au plaisir. Aussi que de matrones y laissaient leur vertu : La chaste et sévère Lævina y vint... ; Pénélope elle
arriva, Hélène elle repartit[16].
Naples la voluptueuse, l’oisive Parthénope, offrait un
asile moins fastueux aux rhéteurs émérites qui venaient y chercher les
souvenirs toujours vivants de la
Grèce, les gymnases, les phratries avec leurs joyeux
festins des concours de musique et tous les jeux du stade. Non loin de là,
Pœstum se laissait gagner par la malaria sortie des eaux marécageuses (lue
ses habitants ne savaient plus contenir. Cicéron en parlait encore, comme d’un
lieu où l’on abordait en revenant d’Afrique[17], mais Strabon la
trouvait insalubre, et ses temples n’allaient bientôt s’élever au milieu d’un
désert[18]. Brindes, où l’on
s’embarquait pour la Grèce,
grandissait chaque jour ; Rhegium, colonisé par Octave après la défaite de
Sextus Pompée, relevait plus lentement sa fortune ; mais Tarente, assise sur
un sol fertile, devant le meilleur port de l’Italie du sud, retrouvait une
partie de ses richesses d’autrefois, si elle ne retrouvait pas sa puissance ;
cependant elle n’occupait encore que la moitié de son ancienne enceinte.
Ainsi, sauf la
Campanie et un point ou deux de la Grande-Grèce, l’Italie
se dépeuplait au profit de Rome, où se promenait une royauté en haillons,
mendiante et fière, qui voulait s’asseoir chaque jour au festin de l’empire,
servi par le maître qu’elle s’était donné.

II. — LE PEUPLE ROMAIN ET LES
CAUSES DE LA
RÉVOLUTION IMPÉRIALE.
Nous voici enfin à Route. Nous connaissons les hommes qui
s’y trouvent et les idées qui y règnent, car le second et le troisième volume
de cette histoire ont servi à montrer la lente décomposition de la société
romaine, de ses mœurs, de ses institutions et les tentatives faites, cri sens
contraire, durant un siècle, pour sauver la république ou pour la précipiter.
Il ne faut rien oublier de ce tableau, si l’on veut se rendre un juste compte
d’un des plus grands événements de l’histoire, la fondation de l’empire.
Les écrivains, comme les peuples, sont naturellement
enclins à faire trop large la part des personnages historiques. Un savant
peut changer la face d’une science ; un général, celle d’une guerre : un
homme d’État ne changera jamais la face d’une société, parce que la politique
est une résultante et que la loi constitutionnelle, expression d’un rapport
entre les idées, les mœurs et les institutions, n’a qu’une valeur de
relation, à la différence de la loi morale qui a une valeur absolue. Les plus
grands en politique sont ceux qui répondent le mieux à la pensée inconsciente
ou réfléchie de leurs concitoyens. li reçoivent plus qu’ils ne donnent, et
leur force est e moins dans le génie qu’ils ont que dans l’enchaînement
logique des idées et des faits dont ils savent se rendre les serviteurs
nécessaires : d’où il résulte que l’usurpation ou le salut, l’honneur ou la
honte, leur viennent autant de la foule qui les soutient que de l’ambition
qui les pousse.
Quand les peuples seront pénétrés de cette vérité virile,
quand ils sauront que ce sont eux surtout qui, en politique, font les héros
où les coupables, ils donneront moins à l’adulation ou à la haine et
davantage à la prévoyance. On a prononce un mot dur, mais juste : les nations
ont les gouvernements qu’elles méritent, comme l’homme a la condition qu’il
se là.
Cette doctrine ne détruit la responsabilité de personne,
mais elle l’étend à ceux qui trouvent commode de s’en affranchir, et si elle
a des paroles sévères pour l’usurpateur qui entreprend sur les anciennes
lois, elle en a aussi pour les multitudes qui ont applaudi à l’usurpation.
Seulement, en jugeant les uns et les autres, elle tient compte des événements
qui ont rendu les transformations nécessaires où inutiles, durables ou
transitoires. Elle absout ceux qui ont marché dans la direction du grand
courant de la vie nationale, et elle condamne les faiseurs de révolution par
en haut ou par en bas qui ont voulu remonter le courant ou en changer
violemment la route.
Appliquons ces principes aux Romains. Ils s’étaient tout
asservi, de l’Euphrate à la
Manche et des Alpes à l’Atlas ; mais ceux qui commandaient
à toits s’étaient eux-mêmes soumis, d’abord au sénat, ensuite a un parti,
plus tard à un homme.
Faut-il parler, après Actium, de démocratie triomphante ?
Antoine et Octave n’étaient point des chefs de parti. Ils avaient combattu,
pillé et tué, non pour les grands ou pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Les
tyrannicides vaincus, le premier fit du pouvoir une orgie, taudis que le
second confondit son ambition satisfaite avec l’intérêt, public. On voit bien
l’oligarchie qui s’en va, on ne voit pas la démocratie qui arrive. Auguste
passera son règne à mettre des distinctions dans la société romaine, à
parquer chacun dans une classe, à imposer à chaque classe un costume. Le
droit romain, sous l’empire, ira se rapprochant chaque jour davantage de la
loi naturelle ; mais il gardera des peines différentes pour les riches et
pour les pauvres. Les empereurs s’appelleront les tribuns du peuple, et ils
pousseront les municipalités à une organisation aristocratique ; de sorte que
cet empire, qui semblait avoir mission d’établir l’égalité, préparera l’immense
inégalité sociale du moyen âge.
Cependant il est encore question de comices : les
triumvirs ont fait confirmer par eux leur pouvoir ; mais cette intervention
de l’assemblée populaire n’était qu’une formalité. Le peuple paraissait
donner la légalité aux volontés des puissants, comme certaines machines
donnent l’empreinte aux monnaies, sans faire le métal dont celles-ci sont
formées.
Nous savons ce qu’étaient devenues les vieilles légions
républicaines. Les soldats, recrutés au hasard, appartenaient à qui les
payait le mieux. Sella, qui leur avait livré l’Asie, César, qui avait gagné
avec eux tant de lucratives victoires, avaient pu compter sur leur
dévouement. Lucullus maintient une discipline sévère, ils l’abandonnent ;
Antoine leur refuse les legs de César, ils le quittent ; Octave met ses biens
en vente ; afin de remplir les promesses de son père, ils vont à lui. Ils ne combattaient pas, dit Montesquieu, pour une certaine chose, mais pour une certaine personne[19]. La postérité,
qui se trompe rarement, a laissé à cette révolution son caractère véritable,
en ne donnant aux Césars que leur titre militaire, imperator.
Quant aux provinciaux, ils suivaient le cours des
événements sans essayer de le changer. Lorsque les armées romaines
partagèrent leur obéissance entre César et Pompée, entre Octave et Antoine,
pas un cri d’indépendance ne sortit du sein des nations vaincues. Elles se
mêlèrent à la lutte par contrainte ; comme les soldats, elles se décidèrent
non pour une cause, mais pour un homme, pour celui qui était présent avec de
grandes forces, ou dont le patronage utile avait lié les intérêts de la
province à ceux de sa maison.
Du temps de Tacite, la révolution qui conduisit la
république à l’empire apparaissait d’une manière très simple. La passion du pouvoir, dit-il, grandit avec notre empire et, comme nos armes, renversa
tout. Tant que l’État fut petit, l’égalité se maintint. Lorsque nous eûmes
conquis le monde, tous se disputèrent le pouvoir et les richesses qu’il
donnait : d’abord le peuple et le sénat, les tribuns et les consuls ; plus
tard, Marius et Sylla, qui détruisirent la liberté et sur ses ruines
fondèrent leur domination. Pompée, après eux, marcha par des voies plus
détournées, non meilleures ; depuis, on ne combattit plus que pour l’empire[20].
Ces mots de Tacite expliquent-ils bien toute la révolution
? Le grand historien, ou mieux le grand artiste dont l’âme tragique se trouve
à l’aise au milieu des plus sombres récits, aime, comme la foule, à s’en
prendre aux hommes plutôt qu’aux choses, parce que celles-ci veulent être
analysées froidement, tandis que ceux-là, composant la partie vivante et
passionnée du drame de l’histoire, frappent les yeux du poète et des
multitudes. Cependant l’homme, en tant qu’individu, n’a d’action que sur un très
court espace de la durée ; et cet ensemble de volontés, d’intérêts et de
passions qui forment une société, exercent une influence bien autrement
persistante et forte. Qu’est-ce que tous les ambitieux qui se succèdent à
Rome, à côté de Rome elle-même incessamment transformée par ses vices et par
ses victoires ?
En devenant, au lieu d’une ville, un monde, Rome ne
pouvait conserver des institutions établies pour une seule cité et pour un
petit territoire. Avec les droits souverains personnellement exercés par
chaque citoyen ait forum ou à la curie, avec les élections annuelles faites
ail Champ de Mars, avec les lois discutées au Comice, la justice rendue au
prétoire, les augures pris au Capitole, comment faire entrer soixante
millions de provinciaux dans le cercle étroit et rigide de ces institutions
municipales ? En Italie même, est-ce que les citoyens des colonies et des
municipes pouvaient être désireux d’assister à ces comices qui n’avaient d’intérêt
que pour l’habitant de Rome ? Une révolution était donc inévitable ; mais les
Romains n’ayant pas changé à temps leur constitution de cité contre une
constitution d’empire, ils perdirent l’une avant de s’être donné l’autre, et,
sans lois, sans mœurs, se trouvèrent, tels qu’un vaisseau qui n’a plus ni
ancres ni boussole, abandonnés à toutes les aventures[21].
Or deux choses les poussaient fatalement aux aventures
menaçantes. Comme ils avaient détruit toutes les armées des peuples établis
autour de la
Méditerranée, ils s’étaient imposés l’obligation d’avoir
une puissante organisation militaire qui devait nécessairement amener l’unité
et la permanence du commandement. Et puisqu’au peuple énergique des anciens
jours s’étaient substitués un sénat de parvenus sans honneur et l’immense
prolétariat des affranchis, ce chef inévitable des légions pouvait aisément
trouver dans Rome même l’ombre de légalité dont il avait besoin pour
consacrer l’usurpation.
Supprimez de l’histoire romaine Sella et Pompée, même
César et Auguste, et la république n’en sera pas moins précipitée. Le
césarisme est né parce que la liberté ne pouvait plus vivre ; et la liberté
se mourait parce qu’il fallait alors au monde autre chose.
Jamais les peuples ne veulent fortement deus choses à la
fois. A ce moment, si l’on excepte quelques hommes plus grands par le cœur que
par l’intelligence, le monde ne demandait pas la liberté ; il aspirait à la
paix, à l’ordre, à la sécurité, comme, trois siècles plus tard, il courra,
fût-ce au travers des supplices, vers cet avenir inconnu que la grande âme de
Virgile avait entrevu, lorsqu’il annonçait une renaissance du monde.
Tacite dit très bien, cette fois, en commençant ses Annales
: La terre, fatiguée de discordes civiles,
accepta Auguste pour maître, et les provinces saluèrent de leurs acclamations
la chute d’un gouvernement débile qui ne savait réprimer ni les magistrats
avides ni les nobles insolents. Les jurisconsultes parlent de
même, plus froidement, mais avec leur habituelle rigueur : De même que les circonstances, ipsis rebus dictantibus,
avaient donné le pouvoir à un petit nombre, il arriva, grâce aux factions, qu’il
devint nécessaire de confier à un seul le gouvernement de la république, car
le sénat n’était plus capable d’administrer honnêtement tant de provinces[22].

III. — OCTAVE.
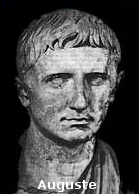 Ces désordres, Auguste allait les arrêter ; ces vœux des
provinces, les remplir ; cette paix désirée, la donner à tous ; et il n’est
resté grand dans la mémoire des hommes, malgré son médiocre génie, que parce
qu’il a répondu à l’attente universelle. Porté par le flot, il a suivi le
courant, mais en dirigeant avec adresse, au milieu des écueils, ce navire
tant battu des orages, aux voiles déchirées, aux flancs entr’ouverts, qu’Horace
voyait avec effroi retourner, avant Actium, au milieu des tempêtes ! Pilote
prudent et timide, il craint la haute mer et les rivages inconnus : fortiter occupa portum ! Il s’arrête au
port où la vague berce doucement et endort l’équipage aux chants mélodieux de
ses poètes. Lui cependant il veille, et ce repos que le monde lui devra, il
ne le connaîtra pas. L’Espagne, la
Gaule, l’Asie, toutes les provinces, le verront tour à tour
tracer des divisions nouvelles, ouvrir des routes, fonder des villes,
organiser l’armée, les finances, l’administration, attaquer enfin et
combattre, mais pour se défendre., et négocier, plutôt, de crainte que les
esprits ne se réveillent au bruit des armes. Ces désordres, Auguste allait les arrêter ; ces vœux des
provinces, les remplir ; cette paix désirée, la donner à tous ; et il n’est
resté grand dans la mémoire des hommes, malgré son médiocre génie, que parce
qu’il a répondu à l’attente universelle. Porté par le flot, il a suivi le
courant, mais en dirigeant avec adresse, au milieu des écueils, ce navire
tant battu des orages, aux voiles déchirées, aux flancs entr’ouverts, qu’Horace
voyait avec effroi retourner, avant Actium, au milieu des tempêtes ! Pilote
prudent et timide, il craint la haute mer et les rivages inconnus : fortiter occupa portum ! Il s’arrête au
port où la vague berce doucement et endort l’équipage aux chants mélodieux de
ses poètes. Lui cependant il veille, et ce repos que le monde lui devra, il
ne le connaîtra pas. L’Espagne, la
Gaule, l’Asie, toutes les provinces, le verront tour à tour
tracer des divisions nouvelles, ouvrir des routes, fonder des villes,
organiser l’armée, les finances, l’administration, attaquer enfin et
combattre, mais pour se défendre., et négocier, plutôt, de crainte que les
esprits ne se réveillent au bruit des armes.
Tant de prudence n’était cependant pas nécessaire, car,
dans cette ruine du gouvernement républicain, il n’était resté debout du
vieil édifice rien d’assez grand ni d’assez fort qui pût être, sur la route
nouvelle, un embarras sérieux. Ceux qu’on appelait les républicains étaient
tombés sur les champs de bataille de Pharsale, de Thapsus, de Munda et de
Philippes, ou avaient péri avec, Sextus. Le peu qui avaient survécu s’étaient,
de désespoir, ralliés à Antoine ; et ceux-là encore avaient partagé son sort,
ou, renonçant à des espérances quatre fois détruites en vingt ans, avaient
abaissé leur orgueil devant la clémence du vainqueur.
Mais les révolutions provoquent presque toujours des
complots. L’épée qu’on brise devient facilement un poignard, et quelques-uns
de ceux que la victoire jette aux genoux du maître n’y restent que pour mieux
marquer la place où ils devront frapper. L’expédition d’Égypte n’était pas
encore achevée, quand Marcus Lepidus, fils du triumvir et neveu de Brutus par
Junie sa mère, complota d’assassiner Octave à son retour et de rétablir la
république. Mécène, qui commandait aux gardes de la ville, démêla aisément
les projets mal combinés du jeune imprudent ; il épia ses menées avec une
dissimulation profonde ; il l’enlaça de liens inaperçus, puis tout à coup,
sans bruit ni tumulte, il le saisit et étouffa ce germe de nouveaux troubles[23]. L’épouse du
coupable, Servilie, se donna la mort en avalant des charbons ardents. Sa
mère, accusée d’avoir encouragé ses desseins, fut traînée au tribunal du
consul, et on vit le vieux Lépide, pour sauver sa femme, se jeter aux pieds
du juge. Ce juge était un sénateur que le frère de Junie avait autrefois
proscrit ; il pouvait s’en souvenir ; il eut le cœur assez haut pour être
touché de si grandes vicissitudes. Maintenant d’ailleurs on pardonnait.
Cet attentat fut, sous Auguste la seule et véritablement
la dernière protestation contre l’empire. Il y aura bien encore des complots
: Cépion et Murena[24] en l’an 22 av.
J. C. ; Egnatius Rufus, Plautius Rufus et L. Paulus, un peu plus tard ;
enfin, en l’an 4 de notre ère, le trop célèbre Cinna, et à diverses époques d’obscures
tentatives d’assassinat ; mais il est difficile de dire ce qu’il y avait,
dans l’âme de ces hommes, d’ambition trompée ou de noble et farouche
inspiration. A en juger par les anciens récits, ce n’était pas la part des
généreux instincts qui était la plus forte.
Décimé par vingt années de guerres et de déceptions, le
parti républicain, pour le moment, n’existait plus, et du patriciat romain il
ne restait que des gens qui tous pensaient ce qu’Asinius Pollion disait à
Octave avant Actium : Je serai le butin du
vainqueur. La république !
s’écrie Tacite, mais qui donc l’a vue ?
Pour en retrouver une faible et dernière image, il fallait remonter à travers
les deux triumvirats et les fureurs de Clodius jusqu’aux premiers beaux jours
de Cicéron, c’est-à-dire plus loin que l’espace d’une vie d’homme. La
génération actuelle, née dans la guerre civile et les troubles, préférait un
présent tranquille à ce passé dont elle ne connaissait que les douleurs[25].
Quand une société se transforme, ce sont en effet les
partis extrêmes et violents qui occupent la scène ; les modérés s’éloignent
et se taisent. Mais les premiers s’usent dans la lutte, en raison même de
leur énergie et au profit des seconds, qui, l’œuvre de la force achevée,
ressaisissent l’influence. Ces modérés remplissaient maintenant le sénat et
les charges. Ils avaient la fortune, et ne demandaient pas le pouvoir,
heureux qu’un autre en prit les ennuis et les dangers. Hommes nouveaux,
créatures de tous les régimes, jetés dans le sénat par tous les ambitieux qui
avaient eu l’autorité, ils étaient sans crédit sur le peuple qui ne les
connaissait pas. Des anciens pères conscrits ils avaient bien le costume :
ils n’en avaient ni la grande existence ni l’influence respectée[26]. pour beaucoup d’entre
eux, le laticlave cachait mal la braie gauloise ou la saie ibérienne. Si
encore on ne les avait recrutés que de braves soldats ! Mais qui ne
trouvait-on pas sur ces sièges où Cinéas avait vu des rois ! Naguère
afin de sauver la dignité du corps, trop souvent compromise, il avait fallu
défendre qu’on appelât des sénateurs en justice pour cause de vol et de brigandage,
et on avait arrêté les poursuites contre ceux qui étaient alors accusés[27]. Quant à les
voir rivaliser avec les gladiateurs, ce n’était plus une nouveauté ; un d’eux
combattra tout à l’heure dans l’arène pour la dédicace de la curie Julienne[28].
Les chevaliers, occupés de la banque, du commerce, des
impôts, ruinés par la guerre, enrichis par la paix et vieux alliés de César,
étaient les soutiens naturels de l’ordre nouveau. Au-dessous d’eux, trois
peuples romains : l’un qui courait la fortune sur la mer et dans les régions
lointaines, l’autre qui la mendiait à Rome, le troisième qui s’élevait
lentement dans les provinces, mais ne comptait pas encore. Le premier ne
demandait que paix et sécurité ; le second que des jeux et des congiaires.
Ceux-là, vieillis dans les comptoirs ou sur les navires, occupés de chiffres,
de denrées et de ruses pour tromper la douane et l’acheteur, rendus humbles
et serviles par le commerce, que les vieilles lois n’honoraient pas, vivaient
loin de Rome et s’accommodaient de tout ce qui les laissait à leur trafic et
à leurs gains. Les autres formaient une masse nombreuse qui eût été à
craindre, si l’on n’avait bien su que sa politique se bornait à être amusée
et nourrie. Pendant les guerres civiles, on l’avait oubliée pour les soldats,
qu’elle n’aime pas ; aussi bénit-elle le retour de la paix, qui, rendant les
légions inutiles, la délivre de rivaux aussi habiles qu’elle-même à exploiter
la faveur du prince.
Comme on dit que nos pères, après la Ligue, étaient affamés de
voir un roi, les Romains appelaient un maître, car, depuis longtemps, un des
principes qui font vivre les sociétés humaines, la sécurité, avait disparu. À
Rome même, on volait, on tuait en plein jour[29], et toutes les
routes étaient, comme aux plus tristes temps des bandits italiens, infestées
de brigands. Les bravi modernes ne
prennent aux voyageurs que leur bourse, quand ceux-ci la donnent de bonne
grâce ; leurs prédécesseurs prenaient le voyageur lui-même lorsqu’il était
assez jeune pour faire un bon esclave ; et, comme on ne connaissait pas alors
cette aristocratie de la peau qui
protégea les blancs au nouveau monde, tous étaient exposés à de terribles
vicissitudes. Un des premiers soins d’Octave sera de faire une guerre en
règle à ces bandits et de minutieuses visites dans les ateliers d’esclaves
pour délivrer les hommes libres qui y étaient retenus[30].
On voulait un maître qui donnât de l’ordre, on voulait
surtout un maître qui dispensât à tous la fortune publique. Depuis cinquante
ans, la propriété, en Italie, avait tant de fois changé de mains, enlevée aux
uns, donnée aux autres, reprise encore, qu’elle avait, dans ces perturbations
répétées, presque disparu. Car la guerre civile ruine deux fois le pays, en
consommant la richesse déjà produite et en empêchant la production qui l’eût
renouvelée. Sauf quelques hommes comme le Gaditain Balbus, assez riche pour
léguer au peuple romain 25 deniers par tête ; comme le prudent Atticus, qui
avait placé en domaines épirotes la plus grande partie de ses 10 millions de
sesterces, sauf encore quelques héritiers des anciennes fortunes
aristocratiques, oubliés par les proscriptions, ou quelques parvenus des
guerres civiles, tous ces gens-là étaient pauvres, ruinés, mendiants. Il
faudra qu’Auguste prête ou donne à tous[31]. Il perdra exprès
au jeu pour faire à ceux qui ne savent pas encore tendre la main une
gratification nécessaire. En une seule fois, il complétera le cens sénatorial
à quatre-vingts sénateurs qui n’ont pas les 800.000 sesterces voulus par la
loi[32]. Aujourd’hui c’est
un édile qui abdique parce qu’il est trop pauvre[33] ; demain ce
seront des chevaliers que l’empereur verra se cacher dans la foule et n’oser
prendre aux jeux leur place réservée, de peur que des créanciers impatients
ne viennent les y saisir. Singulier spectacle que cet homme qui paye pour qu’on
accepte les honneurs qu’il donne ! qui paye pour avoir un sénat, un ordre
équestre, des, magistrats ! C’est une universelle misère : lui seul est riche[34].
On refusera les honneurs, parce que les magistratures
restent onéreuses, comme sous la république, et n’offriront plus en
compensation les profits que Verrès y trouvait. On les refusera encore parce
que le maître lui-même donnera le ton de la modération et du
désintéressement. Comme lui, on affectera de vouloir se soustraire au fardeau
des affaires publiques. Personne,
écrit Dion Cassius (LIV,
26), ne veut entrer au sénat ; et les fils de
sénateurs refusant les places de vigintivirs, qu’on leur réservait, il faudra
ouvrir ces dignités aux membres de l’ordre équestre. Mécène, L. Proculeius, son
beau-frère, Salluste, autre ami d’Auguste et petit-neveu de l’historien,
resteront simples chevaliers[35] ; Horace, tribun
légionnaire à vingt ans, ne sera jamais que scribe du trésor et écrira sa
dernière épître pour se vanter de n’avoir pas eu d’ambition.
Le repos et le plaisir, cette vie molle, élégante,
doucement occupée de petites choses, que chantait si bien le poète de Tibur :
plus de tribune, plus de luttes ardentes, plus de ces paroles qui étaient des
poignards ; la paix, le silence ; qu’un seul veille, agisse pour tous, à l’unique
condition que les provinces, jadis le patrimoine de quelques familles,
redeviendront par lui le patrimoine véritable du peuple romain, tel est
maintenant le vœu général. Depuis quelques années, Octave l’entendait, et,
aux signes de lassitude universelle, il avait compris que la violence avait
fait son temps, que l’heure de la modération était venue. Cette intelligence
fit sa force, car les hommes, même les plus grands, ne le deviennent qu’à la
condition d’arriver à propos et de faire servir les circonstances à leur
fortune. Après avoir été le chef des plus violents, Octave s’était fait peu à
peu celui des modérés. On voit dans le triumvir et l’empereur deux hommes
différents : c’est le même. Octave n’était pas cruel par nature, mais par
position. Jeté avant vingt ans au milieu des plus difficiles affaires, sans
que personne voulût le prendre au sérieux, il appela la sévérité sur son
jeune visage, et sa main, à peine assez forte pour tenir une épée, signa fermement
la liste des proscriptions. Alors il fallut bien croire à son énergie, à sa
puissance et cesser de le traiter en enfant. Dans cette voie de sang, on ne s’arrête
guère ; il s’arrêta cependant au moment où il eût peut-être tout perdu, s’il
eût continué ; de sorte qu’il eut le rare bonheur de suffire à deux époques
différentes d’une révolution. C’est qu’il eut toujours devant les yeux l’image
de César étendu sanglant aux pieds de la statue de Pompée, pour avoir affiché
trop haut son mépris des hommes et refusé de compter avec, leurs faiblesses.
Ce souvenir avait appris au fils de la grande victime qu’on peut bien prendre
impunément la liberté publique, qui est le bien de tous, parce qu’il y a des
temps où les passions des uns, l’indifférence des autres, la peur du plus
grand nombre, font bon marché du précieux héritage, mais qu’il est prudent de
respecter ce qui est plus cher à chacun, la vanité et cette secrète fierté
qui fait survivre l’homme au citoyen.
César avait violemment saisi le pouvoir ; Octave, à qui
ces allures héroïques ne vont point le déposera après l’avoir conquis, pour
le recevoir modeste ment des mains débiles auxquelles il feindra de le
remettre. Il jouera jusqu’au bout ce rôle de désintéressement, en se cachant
derrière d’anciens titres et de vieilles institutions, d’où toute force est
sortie, mais dont la forme subsiste, innovant le moins possible, garantissant
le présent, mais ne préparant rien pour l’avenir ; de sorte que l’empire, à l’exemple
de son fondateur, vivra au jour le jour, sans souci du lendemain, au milieu
de convulsions perpétuelles, qui ne troubleront pas nécessairement les
provinces, mais qui feront du palais une arène sanglante.
Octave s’était aidé et s’aidera encore de deux hommes dont
le nom, par sine justice peu ordinaire, est resté uni au sien, de Mécène et d’Agrippa.
C’était durant son séjour à Apollonie qu’il s’était lié avec eux ; et, quoi
qu’on ait dit de son esprit soupçonneux et cruel, il conserva toujours, dans
ses diverses fortunes, les deux amis de sa jeunesse. Le premier, Mécène, plus
âgé que lui de quelques années, descendait d’une illustre famille d’Étrurie[36]. Mais, ministre
d’un gouvernement qui n’allait tenir aucun compte de la naissance, il se
moquait lui-même de sa noblesse, tout en laissant Horace chanter son origine
royale. Sa fortune le mettait dans l’ordre équestre ; il n’en voulut pas
sortir. H. Vipsanius Agrippa, au contraire, était né d’une obscure maison, la
même année qu’Octave, en 65, quand Cicéron gouvernait Rome avec des discours.
Il se trouvait près du jeune César au moirent où arriva en Épire la nouvelle
des ides de mars, et il fut de ceux qui le décidèrent à réclamer son
dangereux héritage. On dirait que les dieux, pour terminer la lente agonie de
la république, avaient réuni toutes les bonnes qualités de la vieille race
latine dans ce fondateur de la monarchie : esprit net, mais sans éclat,
travailleur infatigable, rude en ses manières[37], parlant peu,
agissant beaucoup, propre à la guerre comme aux affaires civiles, et
réussissant dans toutes ses entreprises, parce qu’il y mettait l’intelligence
qui prépare le succès et l’énergie qui l’assure. Si le dévouement de tels
hommes est, honorable pour celui qui sut l’inspirer, jamais amitié ne fut
plus utile. Pour conduire une négociation difficile, pour jeter la discorde
parmi des adversaires, ou rallier des mécontents, pour endormir la haine ou
raffermir les amitiés chancelantes, enfin pour connaître les hommes et savoir
les conduire, nul n’égalait Mécène ; pour commander et combattre, nul ne valait
Agrippa. Les traités de Brindes et de Tarente, les mariages politiques d’Octave
avec Scribonia, d’Antoine avec Octavie et l’avortement du complot de Lépide,
voilà les titres de Mécène ; la soumission des Gaules, la défaite de Sextus
et la victoire d’Actium sont ceux d’Agrippa. Ces deux hommes ont fait la
moitié de la fortune d’Auguste.
Leurs services seront grands encore, mais différents.
Mécène, qui a tarit aidé son maître par sa dextérité à tourner les écueils
durant la tourmente, arrivé au port, s’assoit et se repose. Il s’efface et se
tient loin des honneurs ; il laisse Agrippa gérer avec Auguste le consulat et
la censure, administrer, bâtir des temples et des aqueducs, fonder des villes
et des chemins militaires, parcourir sans cesse l’empire, et porter partout,
en tout, son activité et sa lucide intelligence. Pour lui, il reste à Rome :
il fait de petits vers ; il écoute Horace et Varius ; il donne de fins
soupers où les parfums ruissellent ; et Auguste, qui volontiers plaisante, l’appelle
l’homme au style et aux cheveux trempés d’huile. Cependant son rôle n’est pas
moins sérieux : à sa table, les conversions s’opèrent, les courages farouches
s’adoucissent, les vertus austères fondent au souffle du plaisir ; là on
apprend toutes les joies de la paix, l’indolence, la volupté ; là surtout on
oublie, et on appelle insensés ceux qui n’oublient pas. Mécène tient maison
ouverte d’esprit et de mollesse, et c’est chez lui, au terme d’un joyeux
festin, entre une ode épicurienne d’Horace et une élégie de Properce, que la
liberté abdique en se consolant avec quelque épigramme de Domitius Marsus,
que l’amphitryon lui-même applaudit.
Après les deux grands ministres, on voit autour d’Octave
la froide et sévère figure d’Antistius Labéon, républicain inflexible, et pourtant,
dans la science du droit, novateur ; Ateius Capiton, moins fier, et, comme
lui, chef d’école ; Valerius Messala Corvinus, qu’Octave venait de prendre
pour collègue dans le consulat ; Statilius Taurus, homme nouveau comme
Agrippa, mais aussi homme de mérite, qui allait doter la ville de son premier
amphithéâtre en pierre, comme pour dire aux Romains que leur nouveau maître
ne voulait pas qu’il y eût de relâche à leurs plaisirs ; Salluste, le fils
adoptif de l’historien, et Cocceius, et Dellius, et les autres amis des premières entrées : tous
recrutés dans le camp ennemi, conquis par la clémence[38].
Messala Corvinus, proscrit par les triumvirs comme
complice du meurtre de César, avait, à la première journée de Philippes, pris
le camp d’Octave et infligé au jeune triumvir cette défaite qui lui valut
tant de sarcasmes. Octave n’oublia jamais celai qui l’avait si bien battu.
Quand Messala, sauvé après Philippes par Antoine, quitta ce chef insensé,
Octave le combla d’honneurs, lui confia les plus importantes affaires et lui
laissa vanter en toute liberté, même devant lui, les vertus de son cher Brutus. C’était un de ces hommes
complets que produisent les époques agitées : grand orateur, au jugement de
Quintilien, vanté par Sénèque comme un des écrivains les plus purs ;
excellent général, bon administrateur et meilleur citoyen, car il défendit la
république sans violence et le pouvoir sans servilité. Un autre sénateur, L.
Sestius, conservait pieusement l’image et le souvenir du tyrannicide, ce qui
ne l’empêchera pas d’arriver au consulat. Octave, qui voulait paraître
continuer la république et honorer toutes ses gloires, se gardait bien d’interdire
ce respect inoffensif pour le dernier républicain. Tite-Live, l’éloquent
historien des hauts faits de l’aristocratie romaine et des beaux jours de la
liberté, en sera quitte pour un surnom. blême un fils d’affranchi pouvait
rappeler impunément à l’ancien triumvir qu’il avait combattu contre lui ; le poète
se hâtait, il est vrai, d’ajouter qu’il avait été aussi un des premiers à
fuir :
....
Relicta non bene parmula.
Mais Octave n’avait pas imposé à Horace cet aveu sans
honneur. A Milan, il respecta une statue de Brutus ; il appela Cicéron, qu’il
avait tué, un bon citoyen, et il chercha à effacer ses remords en nommant consul
et augure le fils de la victime, bien que celui-ci eût pour principal mérite
de disputer à Torquatus Triconge la
réputation du plus grand buveur de Rome.
La poésie, naguère hostile avec Catulle, désarmait, comme
la politique. Si Tibulle, que la guerre avait vite effrayé, boudait encore
Octave, il ne chantait plus que l’amour, à l’exemple de Properce, et Tite-Live,
Virgile, Horace, glorieux représentants de l’histoire, de l’épopée et de la
poésie lyrique, servaient les desseins du fondateur de l’empire en célébrant
la grandeur de Rome ou les destinées promises aux descendants d’Iuile.
Auprès du vainqueur d’Actium, je trouve encore un ancien
ami et serviteur habile de César, Asinius Pollion, le protecteur de Virgile
et, malgré les éloquents conseils d’Horace, l’historien des guerres civiles.
Il avait autrefois juré à Cicéron de combattre jusqu’à la mort pour la
liberté[39].
Convaincu que cette liberté n’était plus possible, il avait accepté un
maître, mais sans empressement ni bassesse, et, contre le despotisme, il s’était
réfugié dans le culte des lettres et l’indépendance de l’esprit. Octave
estimait plus qu’il n’aimait ce grave personnage.
Munatius Plancus avait moins honorablement traversé ces
temps difficiles. Lieutenant de César, puis ami de ses assassins, il était
passé aux triumvirs, auxquels il abandonna son frère. A Alexandrie, bouffon d’Antoine,
qu’à Lyon il avait appelé un infâme brigand, il était encore venu le dénoncer
à Rome. En lui se résumaient toutes les trahisons ; mais un homme si consciencieusement
dévoué au plus fort, et qui tenait école ouverte d’adulation[40], était trop
utile pour n’être pas employé. Octave, qui négligeait Pollion, comblera
Plancus d’honneurs, afin de bien montrer à tous quelle est maintenant la
route de la fortune. Le chantre de Tibur l’appelle un sage, mais cette
sagesse d’Horace est celle qu’épouvantait le nom seul de l’indomptable Caton,
atrocem animum Catonis.
J’insiste sur ces deux personnages, parce qu’ils sont les
représentants des deux fractions du sénat et de la noblesse : la première,
résignée, cependant fière encore, mais peu nombreuse ; la seconde, qui s’accroîtra
chaque jour, allant à Octave pour arriver par lui aux dignités, aux richesses
et aux honneurs promis à la servilité[41].
A côté de ces hommes, il faut une place pour une femme, la
première qui, dans le monde romain, ait fait sentir son influence dans les affaires
politiques. Je veux parler de Livie. L’empire qu’elle avait pris sur son mari
était discret et légitime. Auguste éprouvera plus d’une fois la sûreté de son
jugement et l’excellence de ses conseils. Impérieuse avec ses fils, avec ses
brus, elle sera pour son époux douce, complaisante, et l’empereur pourra
donner en exemple, aux matrones qu’il voudra ramener aux mœurs antiques, la
tenue toujours très digne et la chasteté sévère de celle qui, dans son
palais, continuait la tradition de Tanaquil la fileuse[42]. Elle était fort
belle : C’est Vénus pour les traits,
dit Ovide, et Junon pour les mœurs ;
ses bustes ne démentent pas les éloges du poète que Tacite répète. Elle avait
eu de Claudius Néron, son premier mari, deux fils, Tibère et Drusus, mais elle
n’en donna point à l’empereur. Si Julie, fille d’Auguste et de Seribonia, devait
scandaliser Rome et la cour par ses désordres, la charmante Antonia, la femme
aimante et toujours aimée de Drusus, sa mère Octavie, dont jamais un soupçon
n’effleura la chaste réputation, et la petite-fille d’Auguste, cette noble
Agrippine, que l’empire tout entier honora pour ses vertus, feront revivre
dans la maison impériale les vieilles mœurs sabines.
Nous venons d’examiner attentivement chacun des rouages
dont se composait l’immense machine, comme Montaigne appelait la Rome impériale. Résumons
cette longue étude en quelques propositions générales dont nous ferons autant
de questions auxquelles l’empire devra répondre, autant de problèmes qu’il
sera tenu de résoudre, puisque la république les lui aura légués.
De l’Euphrate à la Manche et des Alpes à l’Atlas, nous avons
trouvé une autorité souveraine, celle du peuple romain, et, sous cette unité
extérieure, une infinie variété de lois de mœurs, de religions et de
franchises locales. L’empire romain est fait ; mais il n’y a pas encore de
nation romaine. Les empereurs sauront-ils en faire une ? En tous ces pays, la
république a renversé, sauf en quelques points, les gouvernements indigènes.
L’empire sera donc obligé d’administrer à leur place. Fera-t-il bonne police,
et la Paix Romaine, que les
peuples appellent de leurs vœux, sera-t-elle garantie par de prévoyantes
institutions ?
Autour de cette immense domination, nous avons vu des
peuples barbares, quelques-uns braves et turbulents, mal divisés, d’autres
corrompus, tous faibles ; nul indice par conséquent, à cette heure, d’un
danger sérieux. Cependant, puisque les Romains ont détruit les forces
militaires de leurs sujets, ils sont tenus de défendre ceux qu’ils ont
désarmés et qui les payent ; pour cette protection nécessaire, il leur faudra
recourir à une nouveauté redoutable, l’établissement d’une armée permanente.
Cette armée aura-t-elle l’esprit de discipline et celui de sacrifice, l’amour
du pays et le respect de la loi civile ?
Le droit de commander implique encore d’autres devoirs.
Rome occupe toute la partie civilisée de l’ancien monde et
elle dispose des forces que donnent l’intelligence, l’organisation sociale et
la richesse. La Rome
nouvelle usera-t-elle de ces forces pour augmenter l’activité du foyer où s’est
allumé le flambeau qui éclaire le monde, pour en rendre la chaleur plus
douce, la lumière plus éclatante, en un mot pour conserver, accroître et
purifier la civilisation ancienne dont le dépôt se trouve remis en ses mains
?
Enfin l’histoire du dernier siècle de la république a
prouvé la nécessité de l’empire, voilà l’excuse d’Octave. Sera-t-il capable
de l’organiser ? C’est lit que nous attendons Auguste peur dire s’il a mérité
sa fortune.
|
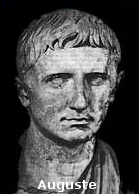 Ces désordres, Auguste allait les arrêter ; ces vœux des
provinces, les remplir ; cette paix désirée, la donner à tous ; et il n’est
resté grand dans la mémoire des hommes, malgré son médiocre génie, que parce
qu’il a répondu à l’attente universelle. Porté par le flot, il a suivi le
courant, mais en dirigeant avec adresse, au milieu des écueils, ce navire
tant battu des orages, aux voiles déchirées, aux flancs entr’ouverts, qu’Horace
voyait avec effroi retourner, avant Actium, au milieu des tempêtes ! Pilote
prudent et timide, il craint la haute mer et les rivages inconnus :
Ces désordres, Auguste allait les arrêter ; ces vœux des
provinces, les remplir ; cette paix désirée, la donner à tous ; et il n’est
resté grand dans la mémoire des hommes, malgré son médiocre génie, que parce
qu’il a répondu à l’attente universelle. Porté par le flot, il a suivi le
courant, mais en dirigeant avec adresse, au milieu des écueils, ce navire
tant battu des orages, aux voiles déchirées, aux flancs entr’ouverts, qu’Horace
voyait avec effroi retourner, avant Actium, au milieu des tempêtes ! Pilote
prudent et timide, il craint la haute mer et les rivages inconnus : 