|
I. — GUERRE D’ALEXANDRIE (OCT. 48 A JUIN 47), EXPÉDITION CONTRE
PHARNACE.
César savait achever ses victoires. Laissant Cornificius
en Illyrie pour veiller sur Caton et la flotte pompéienne, Calenus en Grèce
pour en réduire les peuples, il partit avec deux légions qui formaient à peine
une troupe de trois mille deux cents piétons et de huit cents cavaliers, et
il suivit Pompée à la piste, afin de ne pas lui donner le temps de refaire
une armée. D’après un récit peu vraisemblable, comme il traversait l’Hellespont
sur une barque, il aurait rencontré Cassius à la tête de dix galères
pompéiennes et lui aurait commandé de se rendre. Cassius, troublé, se serait
soumis sans penser qu’il pouvait d’un coup finir la guerre[1]. Une chose plus
certaine, c’est que l’Asie, horriblement foulée par Scipion, apprit avec joie
quel maître lui donnait le sort des armes. Le vainqueur déchargea la province
du tiers des impôts, lui permit de lever elle-même le tribut[2] et en changea le
système : au régime désastreux des dîmes il substitua une redevance fixe[3] ; de sorte qu’il
aie resta aux publicains que la levée de quelques impôts indirects de peu d’importance
; il comptait bien trouver et prendre en Égypte l’argent qu’il ne voulait pas
demander à l’Asie épuisée.
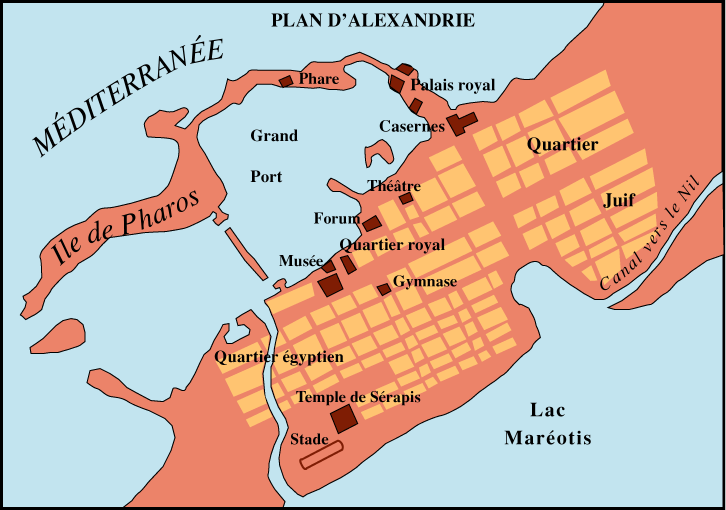
Peu de jours après la mort de Pompée, il arriva devant
Alexandrie, avec trente-cinq vaisseaux et quatre mille hommes. Quand Théodote
lui présenta la tête de son rival, il détourna les yeux avec horreur, et
ordonna qu’on ensevelit pieusement ces tristes restes dans une chapelle de
Némésis qu’il fit bâtir aux portes de la ville. Les ministres du roi se
sentirent blessés de ces honneurs rendus à leur victime, et voyant César si
mal accompagné, ils oublièrent qu’ils avaient devant eux le maître du monde.
Les soldats égyptiens, excités sous main, s’écriaient, quand passaient les
licteurs, que leur présence était un attentat à la majesté royale. Chaque
jour il y avait des émeutes où l’on tuait quelques légionnaires. Lorsque,
pour payer ses troupes, le consul réclama une vieille dette de Ptolémée Aulète,
montant à dix millions de sesterces, Pothin répondit dédaigneusement que
César avait encore sur les bras de bien grandes affaires ; qu’il lui serait
utile de partir au plus vite pour les terminer, et qu’à son retour il
recevrait certainement, avec les bonnes grâces du roi, tout l’argent qui lui était
dû. Ce langage était trop clair ; mais César ne pouvait ni ne voulait partir.
Les anciens disaient que de novembre en mars la mer était fermée[4]. Les vents
étésiens, ou vents du nord, qui soufflent avec violence dans l’Archipel,
interrompaient la navigation d’Égypte en Grèce, et condamnaient le vainqueur de
Pompée à rester dans Alexandrie[5]. Or il avait trop
à cœur les intérêts de Rome pour ne pas utiliser son séjour forcé au bord du
Nil en réglant les affaires égyptiennes selon les convenances de la république
; et l’intérêt de la république était que les assassins de Pompée, qui le
prenaient de si haut avec César, cessassent d’être les maîtres de ce riche
royaume, placé depuis longtemps dans la clientèle de Rome. Il manda
secrètement à Cléopâtre de revenir. Elle partit avec le seul Apollodore, son confident, et
arriva de nuit devant le palais. Comme elle ne pouvait en passer le seuil
sans être reconnue, elle s’enveloppa dans un paquet de hardes qu’Apollodore
lia avec une courroie, et qu’il porta chez César. Cette jeune femme, qui
venait de lever une armée pour se faire elle-même justice et qui répondait si
hardiment à son appel, lui parut être l’alliée dont il avait besoin. Au nom
de Rome, qui avait revu la tutelle de cette race royale divisée, il força Dionysos
à se réconcilier avec sa sœur[6]. Plutarque ne
voit dans cette aventure qu’une affaire d’amour ; j’y vois aussi et surtout
une affaire de politique. Les ministres comprirent bien vite que leur ruine
était le gage de cette réconciliation. Pour la rompre, ils persuadèrent au
jeune Ptolémée de s’échapper du palais et d’appeler le peuple à son secours.
Les Romains ressaisirent le prince fugitif ; mais cette tentative d’évasion
excita dans la ville un soulèvement que César essaya d’apaiser en lisant au
peuple le testament du dernier roi, Aulète, et en déclarant qu’à titre de
tuteur il ordonnait, conformément à cet acte, que Ptolémée et Cléopâtre
régnassent ensemble[7]. L’insurrection n’eut
pas de suite ; Pothin parut même se résigner, mais en secret il rappela
Achillas, qui commandait à Péluse vingt mille hommes d’assez bonnes troupes,
grâce aux cadres romains que Gabinus avait laissés en Égypte. César leur fit
défendre par Ptolémée de commettre aucune violence, pour réponse, ils mirent
à mort les envoyés ; quatre mille Romains eurent alors à tenir tête à vingt
mille soldats exercés et à un peuple irrité de trois cent mille âmes. Ils
occupèrent, au nord de la rue Canopique, une partie des quartiers du Bruchium, où se trouvaient le palais des rois et le théâtre ; puis ils
fermèrent toutes les avenues, de manière à faire de cet ensemble de
constructions solides une vaste forteresse où Achillas perdit bientôt l’espoir
de les forcer. Pour couper leurs communications avec la mer, il attaqua, dans
le port, la flotte royale dont César s’était emparé ; les Romains ne pouvant
la sauver y mirent le feu, qui gagna l’arsenal et détruisit la fameuse
bibliothèque des Ptolémées ; elle renfermait, disait-on, quatre cent mille
volumes.
De l’intérieur du palais, Pothin entretenait d’actives
communications avec les assiégeants ; César le fit tuer, et resserra plus
étroitement Ptolémée. L’eunuque Ganymède, confident de Pothin, parvint
cependant à s’échapper avec la plus jeune sœur du roi, Arsinoé ; il la
conduisit au camp, où elle fat saluée du nom de reine. Ganymède, homme actif
et intelligent, profita pour lui-même de la faveur des soldats ; il leur fit
tuer Achillas, prit sa place, et crut avoir trouvé un infaillible moyen de
détruire l’armée romaine en coupant les aqueducs qui fournissaient de l’eau à
leur quartier et en faisant arriver, à l’aide de machines, l’eau de la mer
dans leurs citernes. Mais ils creusèrent des puits[8], et attendirent
patiemment les secours demandés par César au gouverneur de l’Asie, Domitius
Calvinus.
C’était un habile homme, ferme et juste, qui, nommé à ce
poste après Pharsale, avait déjà tout réorganisé. Il put envoyer au dictateur
une légion par terre et une autre par mer, qui fut jetée par les vents à l’ouest
d’Alexandrie. César, avec quelques vaisseaux, alla chercher la seconde, et au
retour battit Ganymède qui lui barrait le passage. L’eunuque répara ses
galères, en construisit d’autres, et s’obstina à vouloir fermer la nier pour
affamer les Romains. En face de la ville s’étendait l’île de Pharos, qu’un
môle joignait au rivage ; César l’attaqua et réussit à s’en emparer. Hais les
Alexandrins continuèrent bravement leurs efforts pour détruire sa hotte, et
il se trouva un jour si pressé qu’il n’échappa qu’en se jetant à la mer, où l’on
veut qu’il ait tenu d’une main, au-dessus de l’eau, ses Commentaires, en nageant de l’autre. Encore une légende à
supprimer César n’avait certainement pas emporté ses manuscrits pour un
combat dans le port d’Alexandrie[9].
A la fin, cependant, il s’alarma de cette lutte qui lui
faisait perdre un temps précieux et courir des dangers inutiles. Il rendit
aux Alexandrins leur roi, dans l’espérance d’arriver à un accommodement ou de
jeter la division parmi ses ennemis. Cette concession, prise comme un signe
de faiblesse, ne fit que les animer davantage, et ils arrêtèrent encore un
convoi qui arrivait de Cilicie. Heureusement Mithridate le Pergaméen, que l’on
croyait fils du grand Mithridate et que César avait chargé de lever des
troupes en Syrie, réunit dans cette province une armée qui se grossit en
route de beaucoup de Juifs ; car ce peuple voyait dans le vainqueur de Pompée
l’exécuteur des arrêts de Jéhovah contre celui qui avait violé le Saint des
Saints. Le Pergaméen atteignit Péluse à la fin de janvier 47 ; la ville,
quoique forte et bien gardée, fut enlevée par une vive attaque.
Il y a deux clefs de l’Égypte, dit l’auteur de la Guerre d’Alexandrie : l’une est au Phare, la
porte de mer ; l’autre à Péluse, la porte de terre. César tenait l’une ; Mithridate
venait de prendre l’autre, qui assurait ses communications ; il pouvait donc
s’enfoncer sans crainte dans le pays. Il remonta la rive orientale de la
branche pélusiaque, et dans une assez chaude affaire, dont le principal
honneur resta au père d’Hérode, il jeta au fleuve une armée égyptienne qui
voulait l’arrêter. Ce succès facilita le passage du Nil, qu’il opéra entre le
sommet du Delta et Memphis. Beaucoup de Juifs habitaient cette ville. Des
lettres du grand prêtre Hyrcan les avaient ralliés au parti de César ; ils
fournirent à Mithridate des auxiliaires, des vivres et des renseignements.
Tel était le nombre des circoncis dans cette armée que le lieu où se livra la
bataille décisive en garda le nom de camp des Juifs[10].
En apprenant l’approche de l’armée de secours, César était
sorti de sa forteresse alexandrine, et prenant à l’ouest, tandis que Ptolémée
remontait avec sa flotte la branche canopique, il avait, bien que sa route
fût plus longue, prévenu les Égyptiens, et fait sa jonction avec Mithridate.
Le roi plaça son camp sur une colline de la chaîne Libyque qui vient mourir
au Nil, vers Chom-Cherik, au lieu où Amasis, cinq siècles auparavant, avait
conquis l’Égypte sur Apriès et où, sept siècles plus tard, Amrou la conquit
sur les Alexandrins. Sa flotte, à l’ancre dans le fleuve et remplie d’archers
et de frondeurs, pouvait couvrir de flèches et de balles de plomb l’étroit
espace qui restait libre entre le Nil et le camp. Néanmoins les légionnaires,
après avoir franchi de vive force un canal d’irrigation, se ruèrent sur le
camp royal ; mais, pris entre les traits qui en partaient et ceux qui
venaient de la flotte, ils se trouvèrent dans une situation dangereuse. Un
mouvement tournant les dégagea ; des cohortes cheminèrent inaperçues sur les
derrières du camp et l’assaillirent par les hauteurs. Il était mal gardé de
ce côté, où les Égyptiens croyaient n’avoir rien à craindre, et fut pris. A
la vue des enseignes romaines dans ses lignes, l’armée royale se précipita en
désordre vers la flotte. Dans la bagarre, le roi se noya, et un riche butin
récompensa les légionnaires de leur longue patience. L’Égypte accepta pour
reine Cléopâtre, qui épousa le dernier de ses fières, Ptolémée Néotéros,
tandis que sa sœur, Arsinoé, était envoyée captive à Rome[11].
Sorti glorieusement de cette rude épreuve, César demeura
encore deux ou trois mois en Égypte. On lui reproche ce séjour : Cléopâtre,
dit-on, l’enivrait de toutes les séductions de l’esprit et de la beauté ;
molle et fastueuse comme une fille de l’Orient, vive et passionnée comme une
enfant de l’Ionie, la voluptueuse sirène retenait le héros. — Si César aimait
le plaisir, il aimait davantage sa gloire et sa fortune, qu’une passion
sénile eût compromises[12]. Après onze ans
passés sous latente,il avait droit, sans doute, à quelques jours de repos, mais
le moment de se reposer n’était pas venu, alors que ses adversaires
reconstituaient en Afrique une puissante armée et battaient les césariens en
Illyrie, quand un nouveau Mithridate se montrait en Asie, des troubles en
Espagne, des passions révolutionnaires à Rome et en Italie. Avec un tel
homme, il faut voir les choses par leur côté sérieux : s’il n’a point quitté
plus tôt l’Égypte, c’est d’abord qu’il lui avait été difficile d’en sortir,
ensuite qu’il y était retenu par un intérêt romain, bien plus que par l’amour
d’une femme. Amené dans ce pays par le désir de terminer la guerre en s’emparant
de Pompée, il était tombé au milieu d’un peuple en révolte contre la tutelle
de Rome. Chaque jour qu’il avait passé sur ce rivage avait été pour lui un
jour de combat, et, comme l’opinion, même en ce temps-là, était une grande
force, il n’avait pas voulu sortir d’Égypte en fugitif. Après la victoire, il
fallut rester encore pour faire accepter à la turbulente Alexandrie la
condition de cité vassale, garantir la sécurité des deux légions qu’il y
laissa, affermir l’autorité des rois qu’il venait de lui donner, et apaiser
les ressentiments populaires par des hommages aux dieux indigènes. Ce n’était
point par simple complaisance pour Cléopâtre qu’il s’était arrêté à cette
solution de la question égyptienne[13]. Faire de ce
riche pays une province eût été exposer à de dangereuses tentations le
proconsul qu’on y enverrait : Auguste et les empereurs, durant deux siècles,
ont pensé à ce sujet comme César[14]. Mieux valaient
des chefs indigènes, qui seraient utiles sans être jamais dangereux. Mais ces
rois imposés par l’étranger, il fallait habituer le peuple à les craindre, et
ce protectorat nécessaire exigeait que la main virile du dictateur prit et retint
quelque temps les rênes. La tranquillité rétablie et ce qui avait paru d’abord
une aventure terminée par un triomphe, il put partir comme il était venu en
dominateur, avec une auréole de plus au front.
De pressantes dépêches l’appelaient à Rome, mais l’Asie
Mineure était menacée par le roi du Bosphore. Entre un intérêt personnel et l’intérêt
de la république, il n’hésita pas ; au lieu de faire voile pour l’Italie, il
se résolut à arrêter les progrès de Pharnace, dût-il l’aller chercher jusqu’au
fond de son royaume.
Ce fils de Mithridate, fait par Pompée roi du Bosphore,
avait profité de la guerre civile pour reprendre le Pont, chasser Dejotarus
et Ariobarzane de la petite Arménie et de la Cappadoce. Le
gouverneur de la province d’Asie avait été battu en essayant de défendre ces
deux princes, et Pharnace, maître de la plus grande partie de l’ancien
royaume de son père, y exerçait d’affreuses cruautés, emmenant captifs les
publicains et tuant ou émasculant les Romains qui trafiquaient dans ces
régions. César traversa rapidement la Palestine et la Syrie. Dans la Judée, régnait de nom le
faible Hyrcan II, le dernier des Maccabées ; en fait, le pouvoir appartenait
à son ministre, l’Iduméen Antipater. César reconnut le premier comme chef
politique et religieux de sa nation, mais il laissa le pouvoir réel au
second, qu’il fit citoyen romain et procurateur de la Judée. Des deux fils
d’Antipater, l’aîné, Phasaël, eut le gouvernement de Jérusalem ; le second,
Hérode, celui de la
Galilée. Ces Arabes judaïsants, sortis de l’Idumée,
fondaient leur fortune sur les ruines de celle des Maccabées et la
cimentaient avec l’amitié de César, que les premiers empereurs leur
continuèrent.
Antioche avait été bien traitée par Pompée ; quand il
avait fait de la Syrie
une province romaine, il avait donné à cette ville l’autonomie. Mais les
habitants de la voluptueuse cité portaient légèrement la reconnaissance : à la
nouvelle du désastre de Pharsale, ils étaient passés du côté du plus fort.
César leur en tint compte et renouvela en leur faveur le décret qui garantissait
leur indépendance, puis il gagna rapidement Tarse, où il avait convoqué d’avance
les députés de la Cilicie
et des pays voisins. Il prit connaissance de toutes les contestations,
récompensa et punit, donnant beaucoup en fait de privilèges, demandant peu,
si ce n’est de l’argent que ces riches provinces étaient en état de fournir.
Nous avons encore un décret qui rappelle ses faveurs à Aphrodisias de Carie,
qu’il déclara libre et exempte d’impôt. Beaucoup de cités participèrent à ces
largesses qui grevaient l’avenir, mais servaient le présent, parce qu’elles étaient
achetées argent comptant[15]. L’ordre
promptement remis en ces pays troublés il traversa à grandes journées la Cappadoce, s’arrêta
deux jours à Mazaca, sa capitale, rétablit Ariobarzane, et donna à un
descendant de la famille royale la grande prêtrise du temple de Bellone, à
Comana. Dejotarus, qui possédait, avec le titre de tétrarque, presque toute la Galatie et, avec celui
de roi, la petite Arménie, vint au-devant de César sans insignes et en
suppliant. Il avait combattu à Pharsale pour Pompée et s’attendait à expier
douloureusement la faute de n’avoir pas su deviner le vainqueur. Selon les
usages anciens, cette imprudence devait lui coûter ses États, peut-être la
vie ; il en fut quitte pour des reproches, une amende et la perte de quelques
districts ; César lui rendit les ornements royaux[16].
Dans le Pont, Pharnace essaya de négocier pour traîner les
choses en longueur. César n’était pas homme à se laisser tromper par cette
duplicité de barbare : il marcha en avant, quoiqu’il eût bien peu de monde
sous la main : une seule légion de vétérans réduite à mille hommes par les
fatigues et les combats, les deux légions de la province d’Asie que Pharnace
avait battues et quelques troupes de Dejotarus. Mais, avec lui, les recrues
devenaient vite de vaillants soldats, et l’ennemi se sentait d’avance vaincu
par ce capitaine que nul encore n’avait pu vaincre. Cette fois cependant,
Pharnace, qui se vantait d’avoir gagné vingt-deux batailles, osa attendre l’armée
romaine et l’attaqua le premier. César sourit à cette audace[17]. Une seule
action réduisit le fils de Mithridate à fuir avec quelques cavaliers jusque
dans le Bosphore ; il y fut tué par Asander, qui avait épousé sa sœur Dynamis
et qui prit sa place. En cinq jours cette guerre était terminée[18]. Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu, écrivait
César à un de ses amis de Rome. Il donna le royaume de Pharnace à Mithridate
le Pergaméen, qui avait si bien conduit l’expédition d’Égypte ; et, comme il
ne pouvait lui en assurer la possession immédiate, il ajouta à ce don
éventuel les tétrarchies galates de Dejotarus[19]. Heureux Pompée, s’écriait César en comparant
ces guerres d’Asie avec sa lutte des Gaules, heureux
Pompée d’avoir acquis à si peu de frais le surnom de grand !
Après avoir renversé la fortune de son rival, il ruinait sa gloire.

II. — RETOUR DE CÉSAR À ROME (47).
Les affaires de l’Asie réglées, César partit enfin pour l’Italie,
où son absence prolongée avait causé de graves désordres, et il y arriva
avant qu’on sût qu’il était parti.
Ces troubles étaient causés par un personnage que nous
avons déjà rencontré, Cœlius, cet amide Cicéron, qui le déclare un grand
politique et dont l’histoire n’a fait qu’un brouillon. C’était un homme d’esprit,
amuseur de salon et fort méchante langue, qui s’était fourvoyé dans la
politique lorsqu’en lui le goût du pouvoir s’était joint à celui des
plaisirs. Préteur en 48, il se crut mal récompensé de services qu’il n’avait
point rendus, et, sans autres titres que de jolies lettres et de scandaleuses
amours, il prétendit aux premiers rôles, qui tous étaient pris. Au moment où,
de chef populaire et de chef d’armée, César, avec un grand sens politique, se
faisait chef d’État, Cælius se fit démagogue et rêva de chercher la fortune à
la tête des pauvres. Il promit son appui aux débiteurs qui ne voudraient pas
se soumettre à la décision des arbitres si judicieusement établis l’année
précédente par César ; et personne ne se présentant, il recourut aux grands
moyens révolutionnaires : la suspension du payement des loyers et l’abolition
des dettes. Le sénat de César et son collègue dans le consulat, Servilius,
montrèrent heureusement beaucoup de décision. Le consul défendit à Cælius d’exercer
les fonctions de sa charge, et, le préteur s’y obstinant, il fit briser sa
chaise curule et le chassa de la tribune, sans qu’une voix s’élevât dans le
peuple en faveur de ce représentant arriéré des violences tribunitiennes.
Après ce déshonneur public et cet abandon de la part du peuple, le nouveau
Catilina sortit de honte, et finit comme lui, mais avec moins de grandeur
sauvage. Cælius avait rappelé de Marseille Milon, qui avait encore quelques-uns
de ses gladiateurs ; tous deux cherchèrent à exciter un soulèvement dans la Campanie et la Grande-Grèce. C’était
assez des deux grandes ambitions qui se disputaient l’empire ; on ne fit
aucune attention é ces aventuriers obscurs, qui périrent salas bruit, l’un
devant Cosa, l’autre à Thurium.
Pendant les huit mois que dura la lutte en Grèce, la ville
resta dans une cruelle anxiété, que la nouvelle de la bataille de Pharsale ne
dissipa point, parce que tout ce qui restait de forces aux pompéiens se tenait
dans le voisinage de l’Italie. Quand arriva le récit de la mort de Pompée et
qu’on vit son anneau apporté par Antoine, l’enthousiasme, jusqu’alors
incertain et tenu en réserve au service de celui des deux rivaux que la
victoire désignerait, éclata autour du nom de César. Antoine eut soin de le
diriger d’une manière utile aux intérêts de son général, qui fut élu une
seconde fois dictateur pour une année entière (oct. 48) ; on lui donna le consulat pour cinq
années, la puissance tribunitienne pour sa vie durant, le droit lie décider
de la paix et de la guerre, avec la présidence des comices d’élection aux
brandes magistratures. Aussi, comme il était absent, n’élut-on, pour l’année
47, que des tribuns du peuple. César prit possession de la dictature à
Alexandrie, et, puisqu’il n’y avait pas de consuls, il chargea Antoine, son maître
de la cavalerie, du gouvernement de la ville. Brave, mais violent et
débauché, Antoine n’avait ni l’énergie persévérante ni la prudence déliée que
les circonstances réclamaient. Les bruits sinistres qui circulèrent bientôt
sur la triste situation de son chef en Égypte rendirent sa conduite indécise
; il n’osa tenir tête aux brouillons à qui la mort de César ferait peut-être
passer la puissance. Le gendre de Cicéron, Corn. Dolabella, ruiné par ses
débauches, s’était, comme Clodius, fait adopter par un plébéien, afin d’arriver
au tribunat. Une fois nommé, il avait repris la proposition d’abolir les
dettes. Antoine résista d’abord mollement ; mais, quand il crut avoir à
venger sur Dolabella une offense personnelle, il passa à l’excès contraire,
et des scènes de violence et de pillage recommencèrent dans la ville[20], comme pour
prouver, même aux plus incrédules, l’indispensable besoin que Rome avait d’un
maître. Heureusement ce maître arrivait ; César avait enfin débarqué à
Tarente en septembre 47.
Contre l’attente de beaucoup, son retour ne fut marqué par
aucune proscription. Seulement il confisqua les biens de ceux qui portaient
encore les armes contre lui, et fit vendre à l’encan ceux de Pompée.
Dolabella et Antoine s’en rendirent adjudicataires ; mais le dernier refusa d’en
payer le prix, et répondit fièrement aux réclamations de César, que c’était
sa part dans le butin. Le dictateur se contenta de lui imposer une légère
restitution d’argent : il n’estimait pas assez les hommes de son temps
pour employer contre eux la sévérité, ce qui eût été les supposer capables de
changement, et il répugnait par nature aux mesures de rigueur.
Il multiplia les charges : les unes, comme la préture,
dans l’intérêt du service ; les autres, telles que les collèges sacerdotaux,
pour satisfaire de vaniteuses et puériles ambitions[21]. Il doubla le
sénat en y appelant de braves officiers, comme Junius Pera avait fait après
Cannes et en donnant le laticlave aux plus considérés des provinciaux[22]. La noblesse
romaine, naturellement, s’en indigna ; elle appela ces nouveaux venus des
barbares et les poursuivit de ses sarcasmes ; mais ces prétendus barbares
représentaient, dans la curie, une grande et nouvelle idée, l’unité du monde
romain.
Quoiqu’on fût au neuvième mois de l’année, il tint les comices
consulaires, et proclama Fufius Calenus et Vatinius. Quelques jours après, il
se fit désigner lui-même consul, pour l’année suivante, avec Lépide, et il
prit en même temps la dictature. Ses partisans dotés de places, de dignités
et de gouvernements, il para aux pauvres leur lofer d’une année, et accorda
aux débiteurs la suppression des intérêts des trois derniers termes. Les
soldats réclamaient aussi l’accomplissement des promesses tant de fois
renouvelées ; ceux de la dixième légion allèrent jusqu’à une révolte ouverte.
César l’apprend et les convoque au Champ de Mars ; il s’y rend seul, monte
sur son tribunal et leur commande de parler. A sa vue, les murmures se
taisent : incertains, honteux, ils demandent à voix sourde leur congé. Je vous licencie, répond aussitôt le général ; allez, Quirites. César a trouvé pour eux la
plus vive offense : il les appelle citoyens, eux, ses compagnons d’armes,
eux, des soldats ! Les rendre citoyens, c’est les dégrader : ils aiment
mieux qu’il les châtie, qu’il les décime ; et ils le pressent de retirer la
flétrissante parole. On a vanté ce trait d’éloquence ; il jette un triste
jour sur cette époque ; tout ce que nous avons dit de la transformation des mœurs
politiques est expliqué par le sens attaché maintenant à ces deux mots,
citoyens et soldats, Quirites
et commilitones ; l’homme civil
n’est plus rien, l’homme de guerre est tout ; le règne des adnées approche :
déjà leur chef ne veut plus quitter, même dans l’intérieur de la cité, son
titre militaire d’imperator.

III. — GUERRE D’AFRIQUE (46).
THAPSUS, MORT DE CATON.
Cette sédition apaisée, César partit pour accabler en
Afrique les débris de Pharsale. Après la perte de cette bataille, Octavius,
un chef pompéien, avait réuni quelques troupes en Macédoine ; de là il était passé
en Illyrie, avait été contraint par Cornificius et Vatinius de fuir en Afrique,
où Juba et Atius Varus commandaient la seule armée pompéienne qui prit se
vanter d’une victoire. Les chefs réunis à Corcyre, Labienus, Scipion,
Afranius, Petreius, Faustus Sylla, fils du dictateur, résolurent de gagner
cette province. Caton était à Dyrrachium avec une flotte et des soldats. Il
en offrit le commandement à Cicéron, qui était consulaire, tandis que
lui-même n’avait été que prêteur. Mais, depuis Pharsale, Cicéron était dans
les plus vives angoisses, craignant de rester avec
ces forcenés, honteux de partir, et ne sachant comment excuser
auprès de César sa fuite d’Italie. La proposition de Caton le décida. Lui commander, lui combattre, quand il ne fallait pas
poser les armes, mais les jeter : c’était une dérision. Le fils
aîné de Pompée, Cneus, irrité de ces paroles, courut sur lui l’épée à la main
et l’aurait tué, sans Caton qui protégea son départ. Il revint à Brindes
toujours accompagné de ses licteurs avec leurs faisceaux couronnés du laurier
triomphal ; et pendant une année il y maudit la guerre d’Alexandrie, celle de
Pharnace et les lenteurs de César, coupable cette fois d’éterniser ses
anxiétés, en laissant aux pompéiens le temps de se relever, et peut-être d’amener
une nouvelle péripétie[23].
Tandis que ses amis faisaient route vers Utique, Caton,
soupçonnant que Pompée s’était dirigé sur l’Égypte, se résolut à lui conduire
ses trois cents vaisseaux et les troupes qui les montaient. Sans la trahison
des Égyptiens, ces dix mille hommes, trouvant dans Alexandrie Pompée vivant,
auraient pu changer la face des choses. Prudemment, il les mena sur les côtes
de la Cyrénaïque
pour y recueillir de plus sûres nouvelles. Ce fut le fils même de Pompée qui
lui apprit la catastrophe. Il ne lui restait donc qu’à gagner à son tour la
province romaine d’Afrique. Les mêmes vents qui empêchaient César de quitter
Alexandrie, forcèrent Caton à laisser sa flotte tout l’hiver dans les ports
de la Cyrénaïque.
Mais, vu l’urgence de rejoindre l’armée qui se reformait
autour d’Utique, il s’approvisionna d’eau et de vivres à Cyrène et s’engagea
au travers du désert de Barca. Lorsqu’au bout de trente jours il atteignit Leptis Magna, ses troupes se trouvèrent si
fatiguées, qu’il dut se résigner il y attendre la fin de l’Hiver. Du reste,
il était là à portée de Scipion et assuré de pouvoir faire sa jonction avec lui.
On avait reconnu pour chef ce consulaire qui portait un
nom de bon augure dans mue guerre d’Afrique, mais Scipion était un fort
mauvais général[24].
Il prit pour second un ancien lieutenant de César, Labienus, dont l’habileté
ne pouvait balancer les inconvénients du choix malheureux qu’on avait fait.
Si, à Dyrrachium, à Pharsale, les pompéiens étaient déjà divisés, qu’était-ce
maintenant que le seul homme qui pouvait les contenir n’était plus ? Quelqu’un
cependant prenait les façons d’un chef suprême : c’était le roi barbare. Sans
Caton, tous ces Romains si fiers lui eussent cédé, même Scipion, à qui Juba
interdit de porter le manteau écarlate des commandants en chef, parce que la
pourpre, disait-il, n’appartenait qu’aux rois[25]. Il voulait
qu'on saccageât Utique, l’accusant d’être dévouée à César, en réalité pour
détruire la capitale romaine de l’Afrique ; Caton encore l’en empêcha. Mais
Scipion ne voyait pas si loin ; il s’engagea à payer la solde de la cavalerie
numide, et, entrant à son insu dans les vues du roi, il dévasta la province,
sous prétexte de ruiner d’avance l’ennemi.
Dès que César avait quelques troupes sous la main, il
allait en avant. Cette fois encore il parut jouer sa fortune sur un coup de
dé. Renouvelant la témérité qui lui avait fait franchir le canal d’Otrante
sans tenir compte de la flotte pompéienne qui eût pu le couler, il s’embarqua,
malgré la saison contraire, franchit le canal de Malte et, après quatre jours
de navigation, arriva au voisinage d’Hadrumète (Souza). En débarquant, il tomba : c’était
un mauvais augure ; il le changea en heureux présage : Terre d’Afrique, s’écria-t-il, je te tiens, et ses soldats ne doutèrent pas qu’ils
n’allassent en prendre possession. Il n’avait pourtant que cinq mille
fantassins et cent cinquante cavaliers gaulois (1er janv. 46)[26]. C’était à peine
une escorte, et il s’exposait a rencontrer un adversaire qui avait soixante
mille hommes sous les armes, cent vingt éléphants et une nombreuse cavalerie.
Mais il pensa que la flotte ennemie, prudemment retirée dans ses ports, lui livrerait
encore libre passage, et ses légions, lasses de guerre, avaient besoin d’être
entraînées par le sentiment du péril où leur chef se jetait. Il avait d’autres
motifs de confiance : le bruit s’était répandu que, pour payer les secours de
Juba, Scipion lui avait promis l’abandon de la province romaine, et les
nombreux citoyens qui s’y étaient établis s’indignaient d’un marché qui les
faisait passer sous la domination du roi barbare. Parmi eux se trouvaient des
descendants de vétérans marianistes qui, avec la tenace fidélité des Romains
aux traditions de famille, voyaient un patron dans le neveu du général de
leurs pères[27].
Les pompéiens punissaient ce sentiment comme une félonie et dévastaient les
districts où ils avaient cru le trouver. Tout césarien tombé en leurs mains
était mis à mort. Cicéron même s’indigna de ces cruautés[28]. Malgré leurs
défaites répétées, ces héritiers de Sylla étaient animés de son esprit, et
tout démontre que, s’ils avaient triomphé, une violente réaction eût fait
couler des flots de sang à Rome, en Italie et dans les provinces.
Ce régime de terreur n’assurait pas la fidélité de leurs
soldats. Leur armée, en grande partie formée d’affranchis[29], d’esclaves, de
paysans dont on avait brûlé la ferme, et de provinciaux enrôlés de force, n’avait
point de consistance. Le nom de leur adversaire effrayait ces troupes novices
qui ne partageaient point les passions de leurs chefs, et les déserteurs
arrivaient au camp de César en si grand nombre, qu’il put former d’eux toute
une division[30].
Il lui vint un autre secours sur lequel il ne comptait
pas. Le désordre était tel et depuis si longtemps dans cette république en
décomposition, qu’un italien, Sittius, ancien complice de Catilina, s’était
fait en Afrique une sorte de royauté nomade. Il avait autour de lui des
aventuriers de tout pays, en avait formé une petite armée, qui avait une escadre
de guerre, et il errait le long des côtes ou dans les terres, vivant tantôt
de pillage et tantôt de la solde que lui payaient les chefs auxquels il vendait
son assistance. Sittius était fort indifférent à la grande querelle qui
ébranlait le monde romain ; mais la fortune des pompéiens lui inspirait peu
de confiance, taudis qu’il en avait une grande dans celle de César ; et puis,
il ne se peut pas que, dans sa vie vagabonde, quelques démêlés avec Juba ne
lui aient point attiré l’inimitié de ce roi. Sittius avait une grande
connaissance des lieux, et des intelligences dans les deux royaumes numide et
maure : César lui donna la mission de décider Bocchus à envahir les États de
Juba, quand ce prince les quitterait pour rejoindre ses alliés.
Le dictateur comptait enlever sans peine Hadrumète.
Considius l’occupait avec des forces supérieures ; il vint même menacer les
césariens, qui reculèrent jusqu’à Ruspina, harcelés dans leur marche par deux
mille Numides. Mais chaque fois que les cent cinquante Gaulois de César,
pesamment armés, chargeaient cette cavalerie, qui menait ses chevaux sans
bride et n’avait qu’un javelot à lancer, elle tournait le dos et fuyait. Les
villes marchandes de la côte étaient pour celui qui finirait au plus tôt ces interminables
guerres, c’est-à-dire pour César. Une d’elles, Ruspina, lui envoya des
députés ; il se hâta d’occuper cette place qui avait un port où il pouvait
attendre les six légions restées en Sicile. De meilleures nouvelles lui
arrivèrent encore. Leptis la
Petite, qui malgré son nom était une riche et importante
cité, lui offrit son port, un des meilleurs de cette côte ; il était assez
vaste pour que César pût y mettre ses vaisseaux à couvert. Bientôt un convoi
arriva[31] ; d’autres
étaient en route ; César allait partir à leur rencontre pour les empêcher de
tomber aux mains de l’ennemi, quand ils parurent en vue du camp. Aussitôt il reprend
l’offensive, et, à trois milles de Ruspina, il vient heurter avec trente
cohortes l’innombrable cavalerie de Labienus. Celui-ci laissa ses Numides
combattre à leur manière ; ils arrivaient à quelque distance du front de
bataille, lançaient leurs traits, puis fuyaient, entraînant après eut les
légionnaires en désordre, qui prêtaient le flanc alors et tombaient sous les
coups des fantassins ennemis. César fit publier par tous les rangs qu’on ne s’éloignât
pas des enseignes de plus de quatre pieds. Cette immobilité encouragea l’ennemi,
et Labienus, s’approchant des césariens, leur cria : Eh ! Mais, conscrit, tu fais bien le brave ! Il vous a
donc tourné la tête, à vous aussi, avec ses belles paroles ? Par
Hercule ! il vous a mis dans un mauvais pas, et je vous plains.
— Tu te trompes, répondit un soldat, je ne suis pas
un conscrit, mais un vétéran de la dixième, et, ôtant son casque :
reconnais-moi, ou mieux à ceci, et il lui lança son javelot, que
Labienus n’évita qu’en faisant cabrer son cheval, qui le reçut au milieu du
poitrail. Cependant l’armée, formée en cercle, était enveloppée ; la position
ne paraissait plus tenable. Mais c’était un piège pour attirer l’ennemi à
portée du javelot et de l’épée. A un signal, le cercle s’ouvrit et s’allongea
rapidement en deux lignes qui refoulèrent tout ce qui se trouvait devant
elles, puis vinrent, par la droite et la gauche, se joindre au front de
bataille que César porta, par une vive attaque, sur les rangs dégarnis et
troublés des pompéiens. Ceux-ci ne purent résister et se débandèrent. Un
secours amené par Petreius engagea Labienus à recommencer l’action, quand
César la croyait finie. Depuis leur victoire du matin, ceux de ses soldats
que la veille, on pouvait encore appeler des conscrits étaient des vétérans ;
une charge à fond balaya la plaine.
César venait de courir un grand péril ; il s’en était tiré
par son sang-froid, en improvisant une manœuvre audacieuse que l’admirable
discipline de ses légionnaires lui permit d’exécuter. Mais Scipion se
trouvait à trois marches en arrière, à la tête de huit légions et de trois
mille cavaliers ; une autre armée et cent vingt éléphants[32] arrivaient avec
Juba. Pour ne pas rencontrer en plaine de telles forces, César s’établit
entre Ruspina et la mer, dans un camp qu’il rendit inexpugnable able et d’où
il pressa l’arrivée de ses convois. Il commençait à souffrir de la disette,
lorsque Salluste, alors préteur, surprit l’île de Cercina où étaient les
magasins de l’ennemi et en emporta les provisions. Dans le mène temps,
Sittius avait pris Cirta, capitale de la Numidie, soulevé les Gétules, qui lie
pardonnaient pas à Pompée de les avoir soumis aux rois numides, et par cette
heureuse diversion il avait rappelé Juba à la défense de son royaume ; enfin
deux légions débarquèrent de Sicile.
La situation de César n’en restait pas moins des plus
étranges ; l’histoire militaire n’en connaît point de pareille. De l’Afrique,
il ne tenait que le terrain renfermé dans ses lignes. Tout lui manquait, et
il lui fallait tout créer : des ateliers pour forger des arises, des
chantiers pour construire des machines ; il désarma plusieurs galères, afin d’avoir
du bois à faire des palissades ; et comme il n’avait pas de fourrage à donner
aux chevaux, il imagina de les nourrir avec des algues marines, bien lavées
dans l’eau douce. A son départ de Sicile, comme la flotte était insuffisante,
il n’avait voulu à bord ni bagages ni esclaves, et les soldats n’avaient
emporté que leurs armes. Un tribun légionnaire ayant contrevenu à cet ordre,
il l’appela, aussitôt débarqué, en présence des tribuns et des centurions de
toute l’armée, et lui dit : C. Avienus, parce que
tu as été inutile à la république et à moi, en remplissant mes vaisseaux de
tes gens et de tes chevaux au lieu d’y mettre mes soldats, je te chasse de
mon armée, avec la note d’ignominie[33], et je t’ordonne de quitter l’Afrique aujourd’hui même.
Jamais homme de guerre n’a mieux compris la nécessité de réduire le plus
possible les impedimenta qui rendent
les armées paresseuses et lourdes.
Ses soldats réparaient tout à force d’industrie et d’activité.
La guerre des Gaules où il avait fallu improviser à chaque instant des camps,
des forteresses, des flottes, des ponts sur de grands fleuves, des routes à travers
les marais, leur avait appris à être ingénieurs, pontonniers, Mécaniciens.
Aussi faisaient-ils sans murmurer tous les métiers, et ils ne se plaignaient
pas de manquer du nécessaire, parce que leur général vivait comme eus. Le
légionnaire romain était habitué à loger au camp sous une tente de peau ; eux
couchaient à la belle étoile ou se faisaient des huttes de roseaux et de
branchages ; et quand survenait un de ces violents orages d’Afrique, ils s’abritaient
en riant sous leur bouclier[34]. Mais nul retard
dans les manœuvres ; le camp était levé ou dressé avec une extrême rapidité,
et César pouvait lancer en plaine, à portée de l’ennemi, ces hommes toujours
alertes. Un jour, en moins d’une demi-heure,ils se couvrirent d’un fossé et d’un
retranchement contre la cavalerie de Scipion[35].

Ce général méthodique n’avait pas su profiter des avantages
que lui donnaient la témérité de César, la supériorité de sa flotte et sa
nombreuse armée[36]
; il voulait affamer son terrible adversaire, et, pour donner à Juba le temps
de le rejoindre avec trois légions, son unique souci fut d’éviter la bataille
que César cherchait. Deux mois se passèrent en marches et en campements, sans
résultats, dans l’étroit espace compris entre les villes de Leptis, Ruspina,
Achilla et Agar, que tenait César, Hadrumète, Thapsus, Uzita et Thysdrus que
Scipion occupait[37]. Il n’était pas
dans les habitudes de César de rester si longtemps près de l’ennemi sans trouver
le moyen de l’amener à une bataille, comme à Pharsale, ou de le cerner, comme
à Lérida. Mais il n’avait que quelques centaines de chevaux, quand il s’en
trouvait des milliers dans l’armée pompéienne, et il était attaché au rivage
par la nécessité d’attendre ses convois de Sicile, car les provisions des
villes qui avaient reçu ses garnisons et les silos des indigènes avaient été
vite épuisés. Pour l’eau, il était obligé de creuser des puits dans la plaine
qui s’étendait des collines à la mer et, par conséquent, de laisser les
hauteurs à ses adversaires ; enfin ses troupes peu nombreuses comptaient
beaucoup de recrues dont il ne faisait des vétérans que par des escarmouches
de tous les jours.
Un dernier convoi lui ayant amené des vivres en abondance
et les dépôts de ses légions, il se décida à frapper enfin des coups
décisifs. Une tentative sur Thysdrus échoua, mais, par d’habiles manœuvres,
il réussit à investir Thapsus, place importante dont le port, ajouté à ceux de
Ruspina et de Leptis, devait lui donner une grande étendue de coites et par
conséquent faciliter ses approvisionnements. Située entre la mer et un lac d’eau
salée, Thapsus communiquait par une seule route avec le continent. En quelques
heures César coupa cet isthme, et les anciens étaient si incapables de battre
des retranchements de manière à y faire brèche, qu’il suffisait d’un fossé et
d’une levée de terre exécutés dans une nuit pour arrêter une armée. Scipion
ne pouvait sans honte ni péril abandonner Thapsus ; il accourut dès qu’il fut
informé de la marche de l’ennemi, mais s’arrêta devant ses lignes et se
décida à accepter une bataille. César donna pour mot d’ordre à ses troupes Félicitas. La journée, en effet, fut
heureuse. Les éléphants causaient de l’effroi, la cinquième légion demanda à
les combattre et en eut facilement raison, en les forçant à coups de pierres
et de javelots à se rejeter sur les lignes pompéiennes. Depuis ce jour, dit
un écrivain du second siècle de notre ère, cette légion a toujours eu sur ses
enseignes l’éléphant qu’on y voit encore[38]. Malgré leur
nombre, les pompéiens furent battus, leurs trois camps enlevés, et ils
laissèrent trente mille hommes sur le terrain [6 avril (6 février)]. Tout ce qui restait
de l’armée républicaine se débanda ; Thapsus, Hadrumète et Thysdrus ouvrirent
leurs portes ; Zama, capitale du roi numide, lui ferma les siennes ; Bulla
Regia, une autre de ses résidences, doit avoir fait de même. Dans ce
sauve-qui-peut général, la clémence de César parut. aux soldats le refuge le
plus sûr ; les officiers secondaires, presque toute la cavalerie de Juba, se
rendirent à lui.
Les chefs ne pouvaient agir ainsi. Après Pharsale, nul
parmi eux n’avait songé à prendre contre lui-même une résolution extrême. C’était
une guerre loyale qui finissait, et les cruautés de Bibulus et de Labienus n’étant
tombées que sur des matelots et des soldats, on les avait oubliées, de sorte
que personne n’avait craint des représailles. Le lendemain de la bataille,
Brutus était passé dans le camp de César, et quelques jours après Cassius lui
avait livré sa flotte. La guerre d’Afrique eut un tout autre caractère, celui
d’une lutte sans merci, et que les pompéiens firent atroce. D’aucun côté les
chefs ne pouvaient espérer que le vainqueur pardonnât ; il ne restait donc
aux généraux vaincus qu’à chercher, s’ils pouvaient en trouver, d’autres
champs de bataille, ou à mourir. Labienus, Varus et Sextus Pompée gagnèrent l’Espagne,
où s’était déjà rendu l’aîné des fils de Pompée, après une vaine tentative sur
les côtes de la
Maurétanie. Scipion s’embarqua aussi pour cette province,
mais le navire qui le portait fut poussé par la tempête dans le port de Bône,
au milieu de l’escadre de Sittius, qui l’enveloppa. Où est le général ? criaient les assaillants. Le général est en sûreté, répondit Scipion[39], et il se jeta
sur son épée. Presque tous les autres périrent ; Considius fut tué dans sa
fuite par son escorte de cavaliers gétules ; Afranius et Faustus Sylla
tombèrent aux mains de Sittius, et furent égorgés dans une émeute de soldats[40]. Juba et
Petreius, repoussés de toutes les villes, se résolurent à en finir avec ces
misères. Après un somptueux festin, ils prirent chacun une épée et engagèrent
un combat singulier. Juba tua sans peine Petreius, qui était déjà un
vieillard, et se fit achever par un esclave ses cendres allèrent rejoindre au
Madras’en celles des rois numides. Le duel du jeune Marius et de Telesinus
dans les souterrains de Préneste avait mis ce genre de mort à la mode. Caton
en inaugura un autre, que de fameux ou illustres personnages imitèrent plus
tard et dont l’histoire parle avec respect.
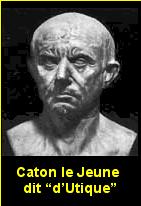 Caton commandait à Utique ; il y reçut, le 8 avril au
matin, la nouvelle de la défaite et assembla aussitôt les sénateurs restés
auprès de lui, ainsi que les trois cents citoyens romains établis dans cette
ville pour le commerce et l’exploitation de la riche vallée du Bagradas[41]. Il leur proposa
de défendre la place ; d’abord son énergie passa dans tous les cœurs ; mais
il fallait commencer par affranchir leurs esclaves pour les armer ; ce
premier sacrifice les arrêta, et ils finirent par rejeter l’idée de la
résistance. Des cavaliers de Scipion, réfugiés dans la place, voulaient qu’on
tint ces marchands, ou qu’au moins on les chassât de la ville avec les autres
habitants. Caton s’opposa à cette cruauté inutile, et les cavaliers s’éloignèrent
lorsqu’il leur eut donné à chacun 100 sesterces sur l’argent du trésor, et
Faustus Sylla autant sur son propre bien. Il s’occupa ensuite de sauver ceux
qui n’osaient attendre leur grâce de César. Lorsqu’il apprit que le dictateur
marchait sur Utique : Eh quoi !
dit-il, César nous traite donc en hommes !
Et, se tournant vers les sénateurs, il leur conseilla de ne plus différer,
lit fermer toutes les portes, excepté celle du port, donna des vaisseaux à
ceux qui en manquaient et veilla à ce que tout se fit avec ordre. L. César,
un parent du vainqueur, que les trois cents avaient chargé d’implorer pour
eux sa clémence, le pria de lui composer un discours, ajoutant que, quand il
faudrait intercéder pour lui, ce ne serait pas avec des paroles, mais en se
jetant aux pieds de César. Caton le lui défendit : Si je voulais lui devoir la vie, j’irais
moi-même le trouver seul ; mais je ne tiendrai rien d’un tyran. Après
le bain, il soupa en compagnie nombreuse, et l’on discuta longtemps sur ce
texte que l’homme de bien est seul libre et que tous les méchants sont
esclaves. Quand il eut congédié ses convives, il se retira et lut dans son
lit le dialogue de Platon sur l’immortalité de l’âme. Il s’interrompit après
quelques pages, pour chercher son épée, et, ne la trouvant pas, s’enquit où
elle était, puis continua sa lecture, afin de ne pis montrer d’impatience ;
lorsqu’il l’eut achevée, il fit venir tous ses esclaves, leur demanda d’une
voix haute son épée et frappa un d’eux si violemment que sa main en fut
ensanglantée. Son fils entra fondant en larmes, avec ses amis. Caton se
levant alors sur son séant : Quand m’a-t-on vu,
lui dit-il d’un ton sévère, donner des preuves de
folie ? Tu m’enlèves mes armes pour me livrer sans défense ; que ne me
fais-tu lier aussi les mains derrière le dos ? Ai-je besoin d’un morceau de
fer pour m’ôter la vie ? On lui envoya son épée par un enfant ; il
la prit, en examina la pointe. Maintenant, je
suis mon maître, dit-il. Alors il reprit le Phédon, le
relut deux fois en entier, puis s’endormit d’un si profond sommeil que le
bruit de sa respiration s’entendait au dehors. Caton commandait à Utique ; il y reçut, le 8 avril au
matin, la nouvelle de la défaite et assembla aussitôt les sénateurs restés
auprès de lui, ainsi que les trois cents citoyens romains établis dans cette
ville pour le commerce et l’exploitation de la riche vallée du Bagradas[41]. Il leur proposa
de défendre la place ; d’abord son énergie passa dans tous les cœurs ; mais
il fallait commencer par affranchir leurs esclaves pour les armer ; ce
premier sacrifice les arrêta, et ils finirent par rejeter l’idée de la
résistance. Des cavaliers de Scipion, réfugiés dans la place, voulaient qu’on
tint ces marchands, ou qu’au moins on les chassât de la ville avec les autres
habitants. Caton s’opposa à cette cruauté inutile, et les cavaliers s’éloignèrent
lorsqu’il leur eut donné à chacun 100 sesterces sur l’argent du trésor, et
Faustus Sylla autant sur son propre bien. Il s’occupa ensuite de sauver ceux
qui n’osaient attendre leur grâce de César. Lorsqu’il apprit que le dictateur
marchait sur Utique : Eh quoi !
dit-il, César nous traite donc en hommes !
Et, se tournant vers les sénateurs, il leur conseilla de ne plus différer,
lit fermer toutes les portes, excepté celle du port, donna des vaisseaux à
ceux qui en manquaient et veilla à ce que tout se fit avec ordre. L. César,
un parent du vainqueur, que les trois cents avaient chargé d’implorer pour
eux sa clémence, le pria de lui composer un discours, ajoutant que, quand il
faudrait intercéder pour lui, ce ne serait pas avec des paroles, mais en se
jetant aux pieds de César. Caton le lui défendit : Si je voulais lui devoir la vie, j’irais
moi-même le trouver seul ; mais je ne tiendrai rien d’un tyran. Après
le bain, il soupa en compagnie nombreuse, et l’on discuta longtemps sur ce
texte que l’homme de bien est seul libre et que tous les méchants sont
esclaves. Quand il eut congédié ses convives, il se retira et lut dans son
lit le dialogue de Platon sur l’immortalité de l’âme. Il s’interrompit après
quelques pages, pour chercher son épée, et, ne la trouvant pas, s’enquit où
elle était, puis continua sa lecture, afin de ne pis montrer d’impatience ;
lorsqu’il l’eut achevée, il fit venir tous ses esclaves, leur demanda d’une
voix haute son épée et frappa un d’eux si violemment que sa main en fut
ensanglantée. Son fils entra fondant en larmes, avec ses amis. Caton se
levant alors sur son séant : Quand m’a-t-on vu,
lui dit-il d’un ton sévère, donner des preuves de
folie ? Tu m’enlèves mes armes pour me livrer sans défense ; que ne me
fais-tu lier aussi les mains derrière le dos ? Ai-je besoin d’un morceau de
fer pour m’ôter la vie ? On lui envoya son épée par un enfant ; il
la prit, en examina la pointe. Maintenant, je
suis mon maître, dit-il. Alors il reprit le Phédon, le
relut deux fois en entier, puis s’endormit d’un si profond sommeil que le
bruit de sa respiration s’entendait au dehors.
Vers minuit,
il envoya au port un de ses affranchis pour s’assurer que tout le monde était
embarqué, et se fit bander la plaie qu’il s’était faite à la main. Comme les
oiseaux commençaient à chanter, il se rendormit pour quelques instants, puis,
tirant son épée, il se l’enfonça au-dessous de la poitrine. Sa main blessée l’empêcha
de frapper un coup assuré, et, en luttant contre la douleur, il tomba de son
lit. Au bruit, on accourut ; les entrailles lui sortaient du corps, et il
regardait fixement. La blessure n’était pas mortelle ; le médecin la banda ;
mais dès qu’il eut repris les sens, il arracha l’appareil, rouvrit la plaie
et expira.
Stoïcien, Caton mettait sa conduite d’accord avec sa
doctrine, en pratiquant, selon les préceptes de l’école, la sortie raisonnable, εΰλογος
έξαγωγή. Il le fit simplement,
quoique l’effet en ait été théâtral, et il priva le vainqueur de sa plus
noble conquête. Ô Caton, s’écria César
en apprenant cette fin, tu m’as envié la gloire
de te sauver la vie ! Cependant, quand Cicéron, admirateur d’un
courage qu’il n’avait pas, composa un éloge de l’illustre mort, le dictateur,
qui maniait la plume comme l’épée, y répondit par l’Anti-Caton, satire
railleuse et spirituelle où le rigide préteur était représenté passant au
tamis les cendres de son frère, pour retirer l’or fondu sur le bûcher, ou
cédant sa femme jeune et belle à Hortensius, et la reprenant vieille, mais
riche, après la mort de l’opulent orateur. Chose singulière, Caton a contre
lui les deus Césars, celui des temps anciens et celui des temps modernes. L’un
livre à la risée de ses courtisans la vertu trop rigide du dernier
républicain ; l’autre, dont tant de fois la mort n’a pas voulu, l’accuse d’avoir
lâchement déserté son poste[42]. Tous deux ont
eu à peu près raison, mais nous aimons les dévouements qui accompagnent toute
grande chose qui périt. Caton et la république s’en vont ensemble ; la mort
de l’un achève dignement les funérailles de l’autre.
La grande et vraie république des anciens jours, qui avait
suscité tant de dévouements obscurs et silencieux, était depuis longtemps
disparue, et la fausse liberté pour laquelle Caton mourait ne méritait pas ce
sacrifice. Mais il croyait donner sa vie pour le droit, et il faut honorer,
alors même qu’il s’égare, le sentiment du devoir qui fait aller jusqu’à la
mort. De ce jour, le parti républicain eut son martyr ; le sang de Caton lui
donna une vertu qui le fit survivre longtemps à sa défaite et qui fut cause
des terribles tragédies qu’on verra sous l’empire. Caton ne s’est pas tué
seul ; par son exemple et par la légende qui se forma autour de son nom, il a
entraîné, à sa suite, dans le tombeau bien des hommes qui eurent, avec son
esprit étroit, sa farouche vertu. N’importe, il reste le premier de ces héros
de la vie civile qui ont protesté par de belles fins stoïques contre les
inclémences du sort ou la dégradation des âmes.
|
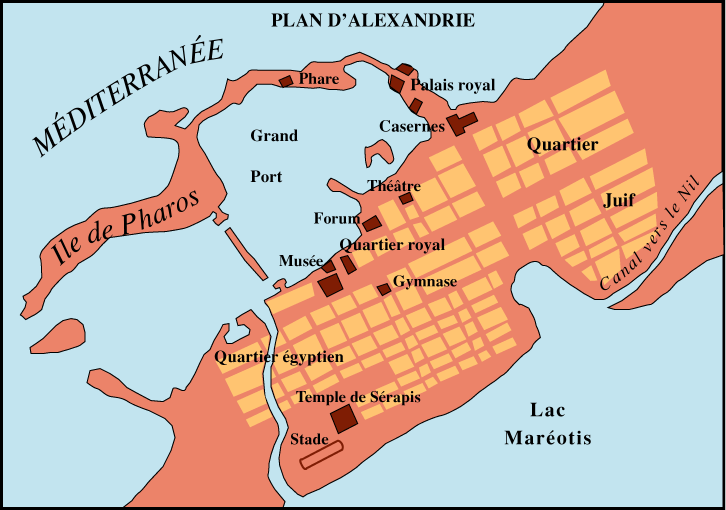

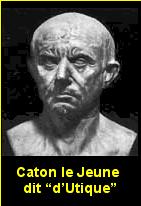 Caton commandait à Utique ; il y reçut, le 8 avril au
matin, la nouvelle de la défaite et assembla aussitôt les sénateurs restés
auprès de lui, ainsi que les trois cents citoyens romains établis dans cette
ville pour le commerce et l’exploitation de la riche vallée du Bagradas
Caton commandait à Utique ; il y reçut, le 8 avril au
matin, la nouvelle de la défaite et assembla aussitôt les sénateurs restés
auprès de lui, ainsi que les trois cents citoyens romains établis dans cette
ville pour le commerce et l’exploitation de la riche vallée du Bagradas