|
I. — PROGRÈS DE L’IDÉE MONARCHIQUE.
Déjà César, dans sa course
rapide, avait franchi les Alpes glacées, méditant en sa pensée les commotions
violentes et la guerre prochaine. Il touchait aux rives du Rubicon[1], barrière étroite et dernière, quand la grande ombre de
la patrie en deuil se dressa devant lui. Ses traits brillent au milieu de la
nuit obscure, malgré la tristesse profonde qui les couvre. De son front
chargé de tours ses longs cheveux tombent en désordre ; les bras nus et
debout, elle dit ces mots, entrecoupés de gémissements : Où courez-vous ? Où
portez-vous mes enseignes ? Si le droit est pour vous, si vous êtes citoyens,
arrêtez ! De ce côté commence le crime[2]. Le crime ! Non,
mais une révolution nécessaire, que cachaient aux yeux de Lucain les
illusions épiques dont il se consolait à la cour de Néron. Ce ne fut pas, en
effet, la faveur du peuple qui fit de César le maître de Rome, ni son armée,
ni son génie. La cause première, irrésistible, fut le besoin que l’empire
avait d’un gouvernement ferme et régulier.
Tout tendait à une monarchie que la perte de l’égalité, la
désorganisation de l’empire et les vœux des classes tranquilles rendaient
inévitable. Qu’avaient été le tribunat de Caïus, les consulats de Marius et
de Cinna, la dictature de Sylla, les commandements de Pompée, si ce n’est
autant de royautés temporaires[3] ? Depuis un siècle,
cette idée avait fait bien du chemin et rallié, à leur insu, bien des
esprits, même parmi les plus élevés. Cette paix que Lucrèce demande[4] ; cette sagesse
nouvelle qui conseille de fuir la vie publique et ses dangereuses séductions,
autant que les temples et leurs vaines terreurs ; ce repos que cherche
Atticus dans l’éloignement des affaires et l’amitié de tous les rivaux[5] ; les
incertitudes mêmes de Cicéron, ne sont-ce pas les indices du dégoût inspiré
par la désolante anarchie qu’on appelait la république romaine ? La république, disait Curion, mais abandonnez donc cette vaine chimère[6]. Ralliez-vous à nous, écrivait à Cicéron
Dolabella, son gendre ; ralliez-vous à César,
sous peine, en poursuivant je ne sais quelle république surannée, de ne
courir qu’après une ombre[7]. C’était le mot
de César, vain nom, ombre sans corps[8]. Si les aruspices
consultés, en 56, sur des prodiges dont le peuple s’effrayait, avaient
répondu que la république était menacée de tomber au pouvoir d’un seul, cet
avis leur avait été révélé non par les entrailles des victimes ou le vol des
oiseaux, mais par l’opinion publique dont ils avaient été l’écho inconscient[9]. Cicéron
n’écrivait-il pas lui-même : Qu’entendez-vous par
les hommes du bon parti ? Je n’en connais pas. Est-ce le sénat, qui laisse
les provinces sans administration et qui n’a point osé tenir tête à Curion ?
Sont-ce les chevaliers, dont le patriotisme a toujours été chancelant, et qui
sont maintenant les meilleurs amis de César ? Sont-ce les commerçants et les
gens de la campagne, qui ne demandent qu’à vivre en repos, n’importe sous
quel régime, fût-ce même sous un roi ?... César est maintenant à la tête de
onze légions et d’autant de cavalerie qu’il en voudra. Il a pour lui la Transpadane, le
peuple de Rome, la majorité des tribuns, toute la jeunesse débauchée,
l’ascendant de son nom, et son incroyable audace[10].
Plutarque, qui avait sous les yeux des documents que nous
avons perdus, écrit de son côté : On voyait des
candidats dresser des tables au Champ de Mars et acheter sans pudeur les
suffrages, tandis que d’autres y amenaient des troupes armées qui, à coups de
flèches, de frondes ou d’épées, chassaient leurs adversaires. Plus d’une
fois, la tribune fut souillée de sang ; la ville était emportée dans
l’anarchie comme l’est dans la tempête un vaisseau sans gouvernail. Aussi les
sages souhaitaient-ils que cette démence n’enfantât rien de pire que la monarchie,
et ils s’y résignaient[11]. — La république est incurable, disaient-ils
encore ; il n’y a d’autre remède que la monarchie, et ce remède il faut le demander
au médecin le plus doux[12].
Ceux qui cherchaient pour la grande malade le médecin le
plus accommodant, celui qu’on aurait à payer le moins cher, voulaient
désigner Pompée[13],
de sorte que ce personnage arrivait doucement à son but : les consuls
abdiquaient en ses mains ; qu’il abatte César, c’est le dernier obstacle ; et
il compte y réussir sans peine. Il ne croit pas même qu’il soit besoin de
longs préparatifs : à Ravenne[14], César n’a
qu’une légion, et ses négociations persévérantes ne prouvent-elles pas sa
faiblesse et ses craintes ?

II. — PASSAGE DU RUBICON ; CÉSAR
PREND POSSESSION DE ROME ET DE L’ITALIE (49).
 Mais tout à coup la nouvelle arrive qu’il a franchi le
Rubicon, limite de sa province, et pris Ariminum, où il a montré à ses
soldats les tribuns fugitifs sous leurs habits d’esclave ; que toutes ses
forces sont en mouvement, entraînant avec elles la Gaule qui lui promet dix
mille fantassins et six mille chevaux ; que ses légionnaires, loin d’hésiter,
sont pleins d’ardeur et lui font crédit de leur solde, tandis que chaque
centurion lui donne un cavalier ; qu’enfin toutes les villes lui ouvrent
leurs portes, et que de sa personne il avance rapidement par la voie
Flaminienne, accueilli avec enthousiasme par les populations. Où est ton armée ? demande Volcatius à Pompée. Frappe donc du pied la terre, lui dit
ironiquement Favonius, il est temps. Et
le faux grand homme, coupé de ses légions d’Espagne, était réduit à avouer
qu’il ne pouvait défendre Rome. Il essaya d’échapper à la première
impétuosité de César, en l’arrêtant par une feinte négociation dont il
chargea un des parents du proconsul et le préteur Roscius. César maintint les
conditions contenues dans sa lettre au sénat et exprima le désir d’avoir une
entrevue avec Pompée. Au retour les députés firent de sa modération le plus
grand éloge. Sa demande d’un désarmement simultané paraissait juste à tout le
monde[15] ; elle l’était
et il la faisait en toute sincérité, car il savait que si les deux généraux
désarmaient en même temps, les élections devenant libres, il serait sûrement
nommé consul. Pompée le savait comme lui, et c’est pour cela qu’il voulait la
guerre. Il empêcha qu’il fût répondu à l’ultimatum de César et avertit les
sénateurs et les magistrats qu’ils devaient se retirer sur Capoue[16]. Ce n’était pas
un simple avis qu’il donnait ; il déclara que quiconque resterait clans la
ville serait traité en ennemi public. Ainsi, dès le début de la campagne, il
laissait son adversaire en possession de la capitale, avantage immense dans
un État où la capitale était encore tout. Mais tout à coup la nouvelle arrive qu’il a franchi le
Rubicon, limite de sa province, et pris Ariminum, où il a montré à ses
soldats les tribuns fugitifs sous leurs habits d’esclave ; que toutes ses
forces sont en mouvement, entraînant avec elles la Gaule qui lui promet dix
mille fantassins et six mille chevaux ; que ses légionnaires, loin d’hésiter,
sont pleins d’ardeur et lui font crédit de leur solde, tandis que chaque
centurion lui donne un cavalier ; qu’enfin toutes les villes lui ouvrent
leurs portes, et que de sa personne il avance rapidement par la voie
Flaminienne, accueilli avec enthousiasme par les populations. Où est ton armée ? demande Volcatius à Pompée. Frappe donc du pied la terre, lui dit
ironiquement Favonius, il est temps. Et
le faux grand homme, coupé de ses légions d’Espagne, était réduit à avouer
qu’il ne pouvait défendre Rome. Il essaya d’échapper à la première
impétuosité de César, en l’arrêtant par une feinte négociation dont il
chargea un des parents du proconsul et le préteur Roscius. César maintint les
conditions contenues dans sa lettre au sénat et exprima le désir d’avoir une
entrevue avec Pompée. Au retour les députés firent de sa modération le plus
grand éloge. Sa demande d’un désarmement simultané paraissait juste à tout le
monde[15] ; elle l’était
et il la faisait en toute sincérité, car il savait que si les deux généraux
désarmaient en même temps, les élections devenant libres, il serait sûrement
nommé consul. Pompée le savait comme lui, et c’est pour cela qu’il voulait la
guerre. Il empêcha qu’il fût répondu à l’ultimatum de César et avertit les
sénateurs et les magistrats qu’ils devaient se retirer sur Capoue[16]. Ce n’était pas
un simple avis qu’il donnait ; il déclara que quiconque resterait clans la
ville serait traité en ennemi public. Ainsi, dès le début de la campagne, il
laissait son adversaire en possession de la capitale, avantage immense dans
un État où la capitale était encore tout.
L’ordre fut exécuté, et l’on vit ces sénateurs, hier
menaçants, s’enfuir à la hâte devant une légion. En peu d’instants, la voie
Appienne se couvrit d’une foule en désordre, moins irritée peut-être contre l’homme
qui semblait la chasser que contre celui dont l’orgueilleuse incurie n’avait
rien préparé pour la défendre. A Capoue, la confusion fut au comble. On
manquait d’argent, quoiqu’on en eût exigé de toutes les villes et pris dans
tous les temples[17] ; on manquait
même d’hommes, car la crainte était partout ; à Rome, on avait pris les vêtements
de deuil et ordonné des prières publiques, comme dans les grandes calamités. En Italie, les levées étaient difficiles : les uns se
refusaient au service ; les autres se présentaient mollement ; la plupart
criaient qu’on s’accommodât[18], et Cicéron
trouvait que son ancien héros était un bien mauvais général[19]. Dans la
précipitation de leur fuite, les consuls avaient laissé à Rome le trésor.
Pompée voulait qu’ils retournassent le prendre ; mais il fallait une armée
pour escorte, et c’est à peine si les deux légions de Capoue suffisaient à
contenir les gladiateurs que César entretenait dans cette ville. D’ailleurs
celui-ci approchait à grands pas, précédé de cette déclaration : Je viens délivrer le peuple romain d’une faction qui
l’opprime et rétablir ses tribuns dans leur dignité. Pisaurum,
Ancône, Iguvium, Asculum, furent pris ou plutôt ouvrirent leurs portes en
chassant les garnisons pompéiennes.
Pour produire en temps opportun des défections dans son
armée, on avait offert des congés aux soldats et, fait de grandes, promesses
aux chefs. Un d’eux s’était laissé séduire, Labienus, le plus renommé de ses
lieutenants. César avait mis en lui toute sa confiance. Durant l’année 50, il
l’avait chargé du commandement de la Cisalpine, son poste avancé et sa forteresse. Mais
Labienus, fier de sa gloire militaire et des richesses qu’il avait acquises[20], croyait avoir
bien plus que son chef conquis la
Gaule. A l’approche de la guerre civile, il supputa les
chances des deux partis, s’imagina que Pompée serait le plus fort, et, dés le
début des hostilités, passa de son côté : grande joie pour les pompéiens qui
prirent cette fuite pour le signal des défections annoncées. Cicéron voyait
déjà le nouvel Annibal abattu ; mais
pas un soldat ne suivit Labienus ; César ne daigna même pas garder les
bagages du traître[21]. Cette
générosité politique, sa douceur envers les prisonniers, qu’il laissait
libres d’entrer dans ses troupes ou de retourner à leur parti, la discipline
observée par ses soldats, ébranlèrent le zèle de plusieurs. Dés le début, il
avait dit ce mot très politique : Qui n’est pas
contre moi est pour moi, à la différence de Pompée qui déclarait
ennemis tous ceux qui ne se prononceraient pas pour lui. César ralliait ainsi
à sa cause les indifférents et les timides, qui sont toujours les plus
nombreux ; il s’attachait même les esprits droits en adressant à toutes les
cités d’Italie des messages dans lesquels il conjurait Pompée de soumettre
leur différend à un arbitrage[22]. On citait ses
lettres à Oppius et Balbus : Oui, j’userai de
douceur, et je ferai tout pour ramener Pompée. Tentons ce moyen de gagner les
cœurs et de consolider la victoire : la terreur n’a réussi qu’à faire
détester mes devanciers et n’a soutenu personne. Sylla fait exception, mais
je ne le prendrai jamais pour modèle. Cherchons le succès par d’autres voies,
et recommandons notre cause par les bienfaits et la clémence[23]. Il faut
pardonner beaucoup à l’homme qui a écrit cette noble lettre, et renoncé aux
mœurs politiques de son temps, en face d’un parti dont les chefs auraient
autrement usé de la victoire.
Pompée, au contraire, prenait des airs de roi ; ils
n’avaient, lui et ceux qui l’entouraient, que la menace à la bouche[24]. On eût dit autant de Sylla. Cette royauté était
depuis deux ans sa secrète pensée : S’il a
déserté Rome, écrit Cicéron, ce n’est
pas qu’il n’eut pu la défendre ; s’il abandonne l’Italie, ce n’est pas la
nécessité qui l’y force ; son seul dessein dès le commencement a été de
bouleverser la terre et les mers, de soulever les rois barbares, de jeter sur
l’Italie des flots armés de peuples sauvages, de réunir sous lui
d’innombrables soldats. Un pouvoir à la Sylla, voilà ce qu’il envie, et tout ce que
veulent ceux qui l’accompagnent. Aussi beaucoup s’échappaient à
petit bruit et regagnaient la ville[25].
Deux grandes routes conduisaient de Rome vers la Cisalpine, en
traversant, l’une le pays des Étrusques, l’autre celui des Ombriens ; César
les ferma rapidement en s’emparant des fortes places d’Arretium sur la via Cassia, d’Iguvium, de Pisaurum et d’Ancône
sur la voie Flaminienne. La désaffection contre le sénat et son général était
si grande, que le Picenum, où Pompée avait ses domaines héréditaires et d’innombrables
clients, ne fit aucune résistance. Les villes chassaient les garnisons
sénatoriales et ouvraient leurs portes à César. Asculum le rendit maître de
la via Salaria, le débouché de la Sabine sur Rome ; Cingulum,
qui se donna à lui, malgré les bienfaits dont Labienus l’avait comblé, le mit
en possession de la vallée du Velinus par
où l’on descendait dans celles de l’Anio et du Tibre. Toutes les avenues de
la capitale étaient donc dans ses mains, l’Apennin le couvrait contre les
troupes qui sortiraient de la ville, et, sur le versant occidental de la chaîne
il occupait deux points par où il pouvait prendre l’offensive, soit dans l’Étrurie,
soit dans le Latium.
Mais Pompée n’avait point d’armée à Rome ; réfugié dans la Campanie, il ne s’y
trouva bientôt plus en sûreté et recula jusqu’à Lucérie. Cette marche
révélait le dessein de passer la mer et de porter la guerre dans les
provinces orientales où les sénateurs verraient Pompée entouré d’un cortége
de rois. Là, en effet, se trouvaient pour lui de grandes ressources. Il
croyait pouvoir compter sur le dévouement des cités et des princes, depuis
l’Adriatique jusqu’à l’Euphrate, et du Danube aux cataractes de Syène, de la Cyrénaïque au fond de
l’Espagne, que gouvernaient ses lieutenants. Enfin l’immense flotte qu’il
avait préparée durant son intendance des vivres reliait toutes ces provinces
et lui donnait l’empire incontesté de la mer. Cicéron le blâme d’avoir
abandonné l’Italie, et la postérité a fait comme Cicéron, qui n’était pas un
grand général[26].
Mais, ayant commis la faute de mépriser son adversaire, ce qui l’empêcha de
former en Italie, avant l’ouverture des hostilités, une armée sérieuse, puis
celle de croire à des défections dont une seule eut lieu, il ne pouvait, avec
ses recrues, disputer Rome à de vieilles légions qui s’étaient habituées à
vaincre durant neuf campagnes de la plus terrible guerre. La retraite au delà
de l’Adriatique était une nécessité militaire et, peut-être, depuis longtemps
prévue[27].
César comprit ce plan dès que Pompée s’éloigna de Capoue.
Rejoint par deux légions, vingt-deux cohortes de Gaulois auxiliaires et trois
cents cavaliers du Noricum[28], il s’avança à
marches forcées sur le Midi,
pour couper aux fugitifs la route de Brindes. La résistance de Domitius à
Corfinium l’arrêta sept jours. Il y avait dans la place et aux environs
trente et une cohortes, des sénateurs et des chevaliers ; mais en ce pays,
ancien foyer de la guerre Sociale, les peuples avaient peu d’empressement à
combattre pour les héritiers de Sella contre le neveu de Marius. Les troupes
de Domitius se mutinèrent, et la ville fut livrée avec les immenses magasins
qu’elle contenait. On s’attendait aux cruautés habituelles ; pour les
prévenir, Domitius voulut s’empoisonner. Le médecin ne lui donna qu’un
narcotique, et il put, comme les autres, implorer le pardon de l’homme à qui
lui et les siens n’auraient certainement point pardonné. Ils lui demandaient
la vie. Mais, leur dit-il, j’ai quitté ma province pour me défendre, non pour me
venger ; et il les garantit contre toute insulte de ses soldats ;
il les laissa même emporter leurs richesses, sans exiger l’engagement de ne
plus servir contre lui. Noble imprudence qui lui coûta beaucoup d’hommes, de
temps et d’argent : quelques semaines plus tard, Domitius essayait de
soulever contre lui la Narbonnaise
et compromettait l’expédition de César au delà des Pyrénées, en retenant
trois de ses légions sous les murs de Marseille révoltée.
Cette clémence inusitée produisit une sensation profonde. Souvent, écrit Cicéron, je cause avec les habitants des municipes et des villages.
Leur champ, leur toit, leur petit pécule, voilà leur unique souci. Ils
redoutent celui en qui naguère ils se confiaient, ils aiment celui qui leur
faisait peur[29], et ajoutons :
qui à présent les rassure. Ces paysans de Cicéron s’inquiétant fort peu de la
politique, mais beaucoup de eues intérêts, sont de tous les temps. Ils
tremblaient, eu entendant gronder au-dessus de leurs têtes l’orage déchaîné
par des passions qu’ils ne comprenaient lias, et ils faisaient des vœux pour
celui qui semblait devoir ramener la sérénité. Le vieux consulaire finit par
penser comme eux ; il en vint à souhaiter que César arrivât assez tôt à
Brindes pour qu’il pût y prévenir Pompée et lui imposer la paix[30].
Cette paix était le veau ardent et sincère de César : à
chaque occasion il en répétait la demande, et nul doute que, sans l’immense
orgueil de Pompée qui ne souffrait pas d’égal, sans la haine violente de
l’oligarchie contre le proconsul populaire, la paix se serait aisément
conclue. D’Ariminum, César avait envoyé à Pompée un message où, en rappelant
ses justes griefs, il renouvelait les très acceptables propositions qu’il
avait déjà faites et qu’il faut répéter comme lui. On avait voulu abréger la
durée légale de son imperium et on lui avait refusé le bénéfice de la
loi votée en sa faveur. A l’offre de licencier son armée si Pompée renvoyait
la sienne, on avait répondu par l’ordre d’en lever une troisième en Italie,
et on avait retenu à Capoue les deux légions qu’on lui avait prises sous prétexte
de les expédier en Asie. Toutes ces mesures avaient été dirigées contre lui.
Eh bien, que Pompée parte pour l’Espagne, et lui, César, congédiera ses
troupes. Alors les élections consulaires se feront en toute liberté, et le
sénat, le peuple, auront recouvré leurs droits. Si quelque malentendu empêche
d’accepter sur l’heure ces ouvertures, que les deux généraux se rencontrent
en conférence, et toutes les difficultés s’aplaniront[31]. En apprenant
ces conditions la joie avait été grande parmi ceux que la guerre civile
effrayait, mais elles avaient rempli Pompée de
crainte, parce qu’il savait bien que si le peuple était pris pour juge, son
rival l’emporterait[32]. Aussi avait-il
fait une réponse évasive où les paroles les plus claires étaient que le
proconsul des Gaules devait retourner dans sa province et que, jusqu’à ce
qu’il dit licencié ses troupes, les levées continueraient en Italie. César ne
pouvait se fier à ces obscurités menaçantes[33] ; il n’arrêta
pas sa marche. Cependant, sur la route de Brindes, devant Brindes même, il
demanda encore à deux reprises une entrevue. Les
consuls sont loin, répondit Pompée, on
ne peut traiter sans eux. Ces aveugles, à qui la perte de l’Italie
aurait dû ouvrir les yeux, ne voulaient ni voir ni entendre ; même en fuyant,
ils rêvaient de victoires, de meurtres et de proscriptions. Le plus pacifique,
Cicéron, ne dit-il pas : L’assassinat de César
serait une solution heureuse[34] ; et Pompée ne
doutait pas qu’il ne dût revenir de l’Orient, comme Sylla, maître du monde.
La résistance de Corfinium avait dérangé les calculs de
César ; quand il parut sous les murs de Brindes, les consuls et leurs cinq
légions étaient déjà de l’autre côté de l’Adriatique, à Dyrrachium. Pompée
les avait fait partir, de peur qu’ils ne
tentassent quelque chose en faveur de la paix[35]. Lui-même, resté
dans la ville avec vingt-deux cohortes, n’attendait que le retour de ses
navires pour s’embarquer. César essaya, par de grands travaux, de
l’envelopper dans la place, en fermant l’entrée du port. Avant qu’ils fussent
achevés, la flotte consulaire revint et Pompée partit (17 mars-25 janvier).
Durant ces opérations en Italie, trois légions gauloises
commandées par Fabius Maximus étaient allées prendre position à Narbonne pour
empêcher les pompéiens de sortir d’Espagne ; les trois autres, lentement
rapprochées des Alpes, pouvaient se porter, suivant les circonstances, contre
les Gaulois qui auraient remué, ou au secours soit de César en Italie, soit
de Fabius dans la Narbonnaise.
La ligne d’opération s’étendait donc de Brindes au pied des
Pyrénées, et César n’avait plus à craindre d’être pris à revers. En même
temps, Valerius s’était emparé sans coup férir de la Sardaigne, Curion de
la Sicile[36],
et les deux greniers de Rome étaient dans ses mains. Soixante jours avaient suffi
pour chasser les sénatoriaux de l’Italie, soumettre la péninsule avec ses
îles et garantir la sécurité des cieux Gaules.
Cette activité prodigieuse arrache, malgré lui, à Cicéron
un cri d’admiration et d’effroi : Ah ! L’horrible
célérité ! Cet homme est une merveille de vigilance ; et son ami
Cœlius, resté parmi les césariens, lui écrivait : Que
pensez-vous de nos soldats ? Au plus fort de l’hiver, ils ont fini la guerre
en se promenant[37]. Elle allait au
contraire se prolonger et s’étendre.
Faute de vaisseaux, César n’avait pu poursuivre son rival.
Pour arrêter un retour offensif de Pompée, il fit occuper par des troupes
Brindes, Sipontum et Tarente, puis il revint à Rome, qu’il n’avait point vue
depuis dix ans et où tout avait repris son cours habituel : les préteurs donnant audience, les édiles préparant leurs
jeux, et les gens du bon parti exploitant la circonstance pour placer leurs
fonds à gros intérêts[38]. Quand le
vainqueur y rentra le 1er avril (7 février), il y trouva assez de sénateurs
pour reconstituer un sénat qu’il opposa à celui que Pompée faisait siéger
dans son camp. Deux tribuns, Marc Antoine et Cassius, le convoquèrent au
Champ de Mars, où César se rendit. Il rappela qu’il avait, suivant la loi,
attendu dix années pour solliciter un second consulat, et qu’il avait été
légalement autorisé à briguer, quoique absent, cette magistrature ; puis il
exposa ses efforts pour éviter la guerre, ses offres réitérées de licencier
ses troupes, si Pompée renvoyait les siennes. Il pria les sénateurs de l’aider
dans le gouvernement de la république, à moins qu’ils n’aimassent mieux lui
laisser ce fardeau ; enfin il demanda qu’une ambassade fût désignée pour
aller traiter de la paix avec les pompéiens[39].
Cette dernière proposition était sérieuse, puisque César
ne perdait pas une occasion de la renouveler ; mais personne ne voulut s’en
charger, tant on redoutait les menaces faites par Pompée contre ceux qui
étaient restés à Rome. César n’insista pas : tout en poussant vivement la
guerre, il voulait se donner l’avantage de la modération ; c’est pourquoi il
parlait toujours de réconciliation et de concorde, sans persuader personne,
car l’instinct populaire ne s’y trompait pas ; on sentait que la révolution
était inévitable, et l’on se disait que César allait devenir le maître. Pour
montrer que cette royauté n’oubliait pas son origine, il réunit le peuple et
lui promit une gratification en blé et en argent. Mais déjà l’argent lui
manquait ; il se fit autoriser par son sénat à prendre le trésor déposé dans
le temple de Saturne. C’était l’or réservé pour les nécessités extrêmes, et
une loi défendait d’y toucher, si ce n’est en cas d’invasion gauloise. Un tribun,
L. Metellus, s’y opposa. J’ai vaincu la Gaule, dit
César ; cette raison n’existe plus ; d’ailleurs
le temps des armes n’est pas celui des lois ; et le tribun se
plaçant devant la porte pour empêcher qu’on la forçât, César menaça de le
faire tuer : Sache, jeune homme, qu’il m’est
moins aisé de le dire que de le faire. César avait pris les armes
pour défendre, disait-il, l’inviolabilité tribunitienne, et, à son tour, il
la violait. Metellus, cédant à la violence, se retira. Nous ne savons rien de
sa vie, si ce n’est cet acte de courage ; il lui a mérité que l’histoire
conservât son nom.

III. — CÉSAR EN ESPAGNE ; SIÈGE DE MARSEILLE (49).
Pompée chassé d’Italie, le plus grand péril qui menaçât en
ce moment César était un soulèvement en Gaule. Il y courut après avoir confié
le gouvernement de la ville à Lépide, fils du consul révolté en 78 contre le
sénat syllanien, le commandement de toutes les troupes laissées en Italie à
Marc Antoine et celui de l’Illyrie à son frère Caïus Antonius. Celui-ci
devait inquiéter les pompéiens sur la rive orientale de l’Adriatique ou leur
fermer la route, s’ils essayaient de pénétrer par là en Italie, comme le
bruit en courait[40]. Je vais, disait César, combattre une armée sans général ; ensuite, j’attaquerai
un général sans armée. Ce mot explique toute la guerre. Marseille,
pompéienne de cœur, l’arrêta au passage ; elle prétendait rester neutre mais elle
venait de recevoir dans ses murs Domitius, que César, sans pouvoir le gagner,
avait si généreusement traité à Corfinium. Avant le commencement des
hostilités, Domitius avait été investi par le sénat du commandement de la Gaule-transalpine,
et de Marseille il pouvait remuer toute la province où son aïeul, par ses
victoires et ses travaux, avait établi l’influence de sa maison. César se
hâta de l’enfermer dans la place, qu’il fit attaquer par trois légions, sous
la conduite de Trebonius et par une flotte que Decimus Brutus construisit en
trente jours dans le Rhône, au port d’Arles. Durant ces opérations, les trois
légions de Fabius filaient de Narbonne vers l’Espagne pour se saisir des
passages des Pyrénées ; trois autres et six mille cavaliers gaulois ou
germains s’apprêtaient à les soutenir. Les centurions, les tribuns et les
amis de César lui avaient prêté l’argent nécessaire, qu’il ne voulait pas
demander aux confiscations.
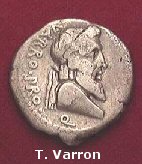 Terentius Varron, le polygraphe, commandait dans
l’Ultérieure ; Pétreius, un vieux soldat, dans la Lusitanie ; Afranius
dans la Citérieure
; les deux derniers se réunirent, et, avec cinq légions cantonnées au nord de
l’Èbre, près d’Ilerda[41] (Lérida), ils firent
face à Fabius, lorsque celui-ci eut franchi les montagnes sans qu’une seule
troupe lui en disputât le passage. À son arrivée, César trouva les deux
armées en présence ; les siens, établis dans une position difficile entre la Sègre et la Cinca, ne pouvaient
s’approvisionner qu’en tirant leurs convois des pays situés à droite et à
gauche de ces deux fleuves. César y jeta des ponts ; les eaux gonflées par
une fonte subite des neiges les emportèrent, et il se vit lui-même comme
cerné et affamé : le boisseau de blé (modius)
se vendait, dans le camp, 50 deniers, et le soldat mal nourri perdait ses
forces. La situation devenait grave, car pendant ces longs retards, Pompée,
s’il eût été le grand général qu’on le croyait, aurait pu avec sa puissante
flotte repasser l’Adriatique, recouvrer l’Italie et Rome, où il n’était resté
que des forces insuffisantes, délivrer Marseille et écraser César entre les
légions de Pétreius et celles qu’il aurait amenées. Mais, pour cela, il lui aurait
fallu cette vue nette des choses qu’avait son adversaire, sa résolution et
son activité, toutes qualités qui lui manquaient. Terentius Varron, le polygraphe, commandait dans
l’Ultérieure ; Pétreius, un vieux soldat, dans la Lusitanie ; Afranius
dans la Citérieure
; les deux derniers se réunirent, et, avec cinq légions cantonnées au nord de
l’Èbre, près d’Ilerda[41] (Lérida), ils firent
face à Fabius, lorsque celui-ci eut franchi les montagnes sans qu’une seule
troupe lui en disputât le passage. À son arrivée, César trouva les deux
armées en présence ; les siens, établis dans une position difficile entre la Sègre et la Cinca, ne pouvaient
s’approvisionner qu’en tirant leurs convois des pays situés à droite et à
gauche de ces deux fleuves. César y jeta des ponts ; les eaux gonflées par
une fonte subite des neiges les emportèrent, et il se vit lui-même comme
cerné et affamé : le boisseau de blé (modius)
se vendait, dans le camp, 50 deniers, et le soldat mal nourri perdait ses
forces. La situation devenait grave, car pendant ces longs retards, Pompée,
s’il eût été le grand général qu’on le croyait, aurait pu avec sa puissante
flotte repasser l’Adriatique, recouvrer l’Italie et Rome, où il n’était resté
que des forces insuffisantes, délivrer Marseille et écraser César entre les
légions de Pétreius et celles qu’il aurait amenées. Mais, pour cela, il lui aurait
fallu cette vue nette des choses qu’avait son adversaire, sa résolution et
son activité, toutes qualités qui lui manquaient.
Dans le même temps, Curion avec deux légions était passé
de Sicile cri Antique, où Varus commandait pour Pompée. Durant son tribunat,
voulant se donner l’honneur et, sans doute, le profit de confisquer un
royaume, il avait proposé de dépouiller Juba, roi des Numides[42]. Le prince en
avait naturellement gardé un ressentiment qui le fit pompéien dévoué. Il mit
en mouvement toutes ses forces, les réunit à celles de Varus, et Curion,
défait sur les bords du Bagradas, se tua. Les vainqueurs égorgèrent les légionnaires
faits prisonniers. Dolabella, que César avait chargé de lui construire une
flotte sur l’Adriatique, était aussi battu par Octavius et Scribonius Libo ;
enfin C. Antonins, dans l’Illyrie, tombait aux mains des pompéiens.
Quand à Rome on apprit ces malheurs des lieutenants et la
triste situation du chef, dont les lettres d’Afranius exagéraient encore les
dangers, on crut sa cause perdue. Plusieurs sénateurs, jusqu’alors demeurés
neutres, se hâtèrent de gagner Dyrrachium. Il est triste de compter parmi eux
Cicéron, qui jusqu’à ce moment était resté en Italie. Quelques mois plus tôt,
cette décision eût paru du dévouement à la cause républicaine ; maintenant ou
pouvait l’appeler d’un nom sévère. Il faut dire pour sa défense qu’il s’était
bercé de l’idée de jouer le rôle de médiateur entre les deux rivaux. Mais,
après la visite que César lui avait faite en revenant de Brindes, il avait
compris qu’on ne voulait de lui que son nom ait bas des décrets qui allaient
être rendus, et il avait été blessé au vif par cette découverte du peu
d’importance politique qu’on lui accordait. Dès lors il avait pensé, malgré
les lettres de César et les avis d’Atticus, resté à Rome, à rejoindre
furtivement Pompée, tout en disant : Ah ! Je
vois bien quel serait le meilleur parti. Il voulait parler d’une
neutralité qui aurait sauvé sa tète et sa fortune. N’accusons pas sa
faiblesse, mais sa trop clairvoyante intelligence ; car, s’il aimait d’un
sincère amour cette république où l’éloquence l’avait mené aux honneurs, il
savait aussi que, quel que fût le vainqueur, elle resterait sur le champ de
bataille[43].
De là ces découragements, ces incertitudes et cette apparente versatilité,
qu’il faut condamner cependant, parce que cet exemple d’un grand homme a
peut-être en d’autres temps légitimé l’indifférence et la lâcheté, ou prêté
êtes sophismes à la trahison. À la fin, il oublia sa prudence et les
moqueries qu’il avait faites de la loi de Solon contre les citoyens restés
neutres entre les factions ; malheureusement il les oublia à un moment où, en
passant à Pompée, il allait à lui, non parce que le parti sénatorial était le
plus juste, mais parce qu’il semblait devenir le plus fort. C’était du reste
la règle de conduite que Cælius avait depuis longtemps conseillée. Tant qu’on en restera aux paroles, lui avait-il
écrit, je serai avec les honnêtes gens ; si l’on
en vient aux coups, je nie rangerai du côté de ceux qui donneront les
meilleurs[44] ; et Cicéron
suivait le conseil de Cælius. Mais celui-ci était allé à César, et l’autre venait, comme Amphiaraüs, se jeter vivant dans le gouffre[45].
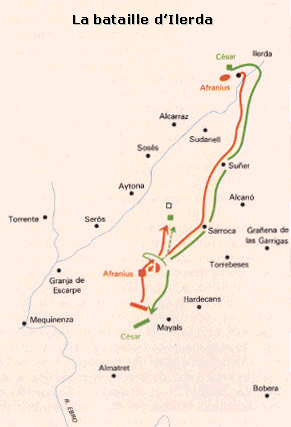 Cependant, en Espagne, les événements avaient pris une
tournure inattendue. César avait fait construire, avec du bois léger, de
l’osier et du cuir, des bateaux qu’on pouvait porter partout. Il les
conduisit an bord de la Sègre,
loin des éclaireurs ennemis, se fortifia rapidement sur l’autre rive, et put
alors construire tranquillement un pont par où lui arrivèrent ses convois ;
puis, imposant à ses soldats des travaux gigantesques, il saigna le fleuve
par de nombreux canaux pour en diminuer la profondeur, et y créer des gués
qui lui rendirent la liberté de ses mouvements. Des escarmouches heureuses
décidèrent la défection de plusieurs peuplades, et les généraux pompéiens
furent réduits à quitter leur position d’Ilerda, où César, avec sa nombreuse
cavalerie gauloise, aurait fini par les affamer. Mais battre en retraite
devant un général si actif était une entreprise difficile. Ils l’essayèrent
cependant. Pas un de leurs mouvements, de nuit ou de jour, n’échappa à sa
vigilance ; il devina tous leurs plans, les prévint dans toutes les positions
qu’ils voulurent occuper, les cerna, et vit enfin les soldats des deux
généraux élever leurs boucliers au-dessus de leur
tête[46]
: signe équivalent du nôtre, mettre bas les armes (9 juin 49). Il leur accorda la vie, et
les licencia est leur disant : Si vous allez
rejoindre les pompéiens, dites-leur comment je vous ai traités.
Cette campagne, où par l’ascendant de ses
manœuvres César réduisit sans combat une armée égale en force à la
sienne, a fait l’admiration du grand Condé et de Napoléon. Soit lenteur
imprudente, soit retard calculé, Varron n’avait pas rejoint à temps ses deux
collègues. Toute résistance lui était maintenant impossible ; il parut à
Cordoue devant le vainqueur, qui lui enleva sa caisse militaire, grossie par
de nombreuses exactions[47]. Cependant, en Espagne, les événements avaient pris une
tournure inattendue. César avait fait construire, avec du bois léger, de
l’osier et du cuir, des bateaux qu’on pouvait porter partout. Il les
conduisit an bord de la Sègre,
loin des éclaireurs ennemis, se fortifia rapidement sur l’autre rive, et put
alors construire tranquillement un pont par où lui arrivèrent ses convois ;
puis, imposant à ses soldats des travaux gigantesques, il saigna le fleuve
par de nombreux canaux pour en diminuer la profondeur, et y créer des gués
qui lui rendirent la liberté de ses mouvements. Des escarmouches heureuses
décidèrent la défection de plusieurs peuplades, et les généraux pompéiens
furent réduits à quitter leur position d’Ilerda, où César, avec sa nombreuse
cavalerie gauloise, aurait fini par les affamer. Mais battre en retraite
devant un général si actif était une entreprise difficile. Ils l’essayèrent
cependant. Pas un de leurs mouvements, de nuit ou de jour, n’échappa à sa
vigilance ; il devina tous leurs plans, les prévint dans toutes les positions
qu’ils voulurent occuper, les cerna, et vit enfin les soldats des deux
généraux élever leurs boucliers au-dessus de leur
tête[46]
: signe équivalent du nôtre, mettre bas les armes (9 juin 49). Il leur accorda la vie, et
les licencia est leur disant : Si vous allez
rejoindre les pompéiens, dites-leur comment je vous ai traités.
Cette campagne, où par l’ascendant de ses
manœuvres César réduisit sans combat une armée égale en force à la
sienne, a fait l’admiration du grand Condé et de Napoléon. Soit lenteur
imprudente, soit retard calculé, Varron n’avait pas rejoint à temps ses deux
collègues. Toute résistance lui était maintenant impossible ; il parut à
Cordoue devant le vainqueur, qui lui enleva sa caisse militaire, grossie par
de nombreuses exactions[47].
Cette province toute pompéienne conquise et pacifiée en
quarante jours[48],
César partit pour Marseille, où son adversaire, qui disposait d’une flotte
immense, n’avait su faire parvenir qu’un secours insignifiant de seize galères
conduites par Nasidius. Enfermés dans leurs murs par deux défaites sur mer
que Decimus Brutus, l’habile chef qui avait si bien mené la guerre contre les
Vénètes, leur avait infligées, les habitants étaient réduits aux dernières
extrémités. A l’arrivée du proconsul, ils se décidèrent à traiter, livrèrent
leurs armes, leurs navires et tout l’argent du trésor public. Là encore César
s’honora par sa clémence ; il n’eut cependant point à l’exercer envers
Domitius, qui s’était enfui avant que la ville ouvrit ses portes.
Comme Alexandre, il s’inquiétait de ce qu’on pensait de
lui. Pour des villes barbares, il n’avait guère de scrupules. Qui parlait de
leur ruine ? Marseille était célèbre : c’était l’Athènes des Gaules, il
l’épargna. Il lui laissa sa liberté, ses lois, ses murailles. Mais il lui
prit ses armes, ses vaisseaux, son trésor ; il lui ôta plusieurs des villes
qui lui étaient sujettes, entre autres Agde et Antibes, dont il fit deux
colonies romaines, et il fonda, à l’embouchure de l’Argens[49], Fréjus,
destinée dans sa pensée à faire aux Massaliotes, sur la côte de l’est, la
même concurrence que leur faisait Narbonne sur celle de l’ouest. Quelques
années plus tard, sous Auguste, Fréjus sera un des arsenaux de l’empire, et
Strabon appellera Narbonne le port de toute la Gaule. Mans cette
dernière ville, à Béziers et Arles, il établit ceux de ses soldats qui
avaient achevé leur temps de service militaire.
Les dernières opérations garantissaient la soumission de
toutes les provinces occidentales de l’empire, de celles qui fournissaient
les plus braves soldats[50]. César, sûr
maintenant de n’être plus inquiété sur ses derrières, pouvait aller chercher
le général dont il venait de détruire la meilleure armée.
Il était encore sous les murs de Marseille, quand il
apprit que, sur la proposition de Lépide, le peuple l’avait proclamé
dictateur. Bien des formalités prescrites avaient été omises ; c’étaient un
préteur et le peuple, au lieu d’un consul et du sénat, qui lui avaient donné
cette charge. Mais, au milieu du bruit des armes, les seules apparences de la
légalité paraissaient suffire. Comme il allait prendre possession, à Rome, de
sa nouvelle magistrature, il rencontra à Plaisance sa neuvième légion en pleine
révolte, parce qu’elle n’avait pas encore reçu les dons promis à Brindes.
L’exemple était dangereux, César les punit sévèrement : douze des plus
coupables furent condamnés à périr sous la hache. Un des douze ayant prouvé
qu’il était hors du camp pendant l’émeute, le centurion qui l’avait dénoncé
fut exécuté à sa place.
Il ne garda la dictature que onze jours, juste le temps
d’accomplir quelques mesures nécessaires pour la tranquillité de Rome et de
l’Italie. Depuis le commencement de la guerre, la gêne était générale, le
crédit nul ; tout le numéraire semblait retiré de la circulation, et l’on
craignait une abolition générale des dettes, ce qui aurait amené une affreuse
perturbation[51].
César recourut à un heureux expédient, anciennement employé. Il nomma des arbitres
pour faire l’estimation des meubles et des immeubles d’après le prix où ils
étaient avant la guerre, et ordonna que les créanciers reçussent tout ou
partie de ces biens en payement, après qu’on aurait déduit des créances les
intérêts déjà payés[52]. Pour activer la
circulation du numéraire, il défendit qu’on gardât chez soi plus de 60.000
sesterces en argent monnayé, mesure difficile à appliquer, surtout lorsqu’il
ajouta, par respect pour l’ancien droit, que l’esclave ne serait pas autorisé
à déposer contre son maître[53]. Pourtant il y
eut quelque argent placé en biens-fonds ; le prix des terres se releva et le
commerce trouva des capitaux. Le peuple avait espéré mieux, il l’apaisa par
une large distribution de blé. Tous ceux qui, à tort ou à raison, avaient eu
à souffrir de l’ancien gouvernement, obtenaient naturellement sa protection.
Dès l’ouverture des hostilités, plusieurs bannis que Pompée avait fait
condamner durant son troisième consulat étaient venus lui offrir leurs
services : il fit présenter au peuple par les préteurs et les tribuns une loi
qui les rappela. Milon, le meurtrier d’un tribun, et Antonius, le vainqueur
involontaire de Catilina, furent cependant exceptés de l’amnistie. La loi de
Sylla qui frappait les enfants des proscrits d’incapacité politique était
encore en vigueur, elle fut rapportée ; enfin il récompensa les Cisalpins de
leur longue fidélité par la concession du droit de cité[54]. Avant d’abdiquer,
il présida les comices consulaires qui le nommèrent consul avec Servilius
Isauricus ; les autres charges furent données à ses partisans dans toutes les
formes légales. Lui-même n’avait pris les faisceaux qu’à l’époque fixée par
la loi qui les lui avait promis, après la dixième année de son commandement[55].
Ainsi la république durait au profit de César : rien ne
lai manquait d’un gouvernement régulier : décrets du sénat, élections du
peuple, sanction des curies et des auspices. Proconsul, César devenait un
rebelle dès qu’il sortait de sa province ; consul légalement institué,
c’était, aux yeux de ce peuple formaliste, de son côté qu’était le droit, du
côté de ses adversaires qu’était la révolte. Ceux-ci reconnaissaient
eux-mêmes qu’en perdant Rome ils avaient perdu la légalité, ou du moins le
pouvoir de la faire ; car, bien qu’il y eût deux cents sénateurs dans le camp
de Pompée et qu’on appelât ses soldats le vrai peuple romain, on n’osait y
rendre des décrets ni procéder aux élections ; l’année révolue, les consuls
Lentulus et Marcellus abdiquèrent leur titre et prirent, suivant l’usage, celui
de proconsuls.

IV. — LA GUERRE EN ÉPIRE ET EN
THESSALIE, PHARSALE (49-48).
A la fin d’octobre 49, César arriva à Brindes, rendez-vous
de ses troupes, afin de passer de là en Épire. Pompée
avait eu une année entière pour faire ses préparatifs. Aussi avait-il
rassemblé une flotte considérable fournie par l’Asie, les Cyclades, Corcyre,
Athènes, le Pont, la
Bithynie, la
Syrie, la
Cilicie, la
Phénicie, l’Égypte. Partout on avait construit des navires
et levé de grosses sommes sur les princes, les tétrarques, les peuples
libres, et les compagnies fermières des impôts dans les provinces dont il
était le maître.
Il avait neuf légions de
citoyens romains, dont cinq venues avec lui d’Italie, une de vétérans de
Sicile, qu’il appelait Gemella, parce qu’elle était formée de deux
autres ; une de Crète et de Macédoine, composée de vétérans qui, licenciés
par les généraux précédents, s’étaient établis dans ces provinces, et deux
que Lentulus avait levées en Asie. De nombreuses recrues lui étaient venues
de la Thessalie,
de la Béotie,
de l’Achaïe, de l’Épire, et il avait joint à ces troupes les soldats qui
restaient de l’armée de C. Antonius[56]. Il attendait deux autres légions que Scipion lui amenait
de Syrie ; il avait trois mille archers de Crète, de Sparte, du Pont, de la Syrie ; deux cohortes de
frondeurs de six cents hommes chacune ; sept mille chevaux, dont six cents de
la Galatie
avec Dejotarus, cinq cents de la
Cappadoce arec Ariobarzane, autant de la Thrace, ceux-ci commandés
par le fils de Cotys ; deux cents lui étaient venus des bords de la Propontide sous les
ordres de Rascipolis, homme d’un rare courage. Pompée le fils avait amené sur
la flotte cinq cents cavaliers gaulois et germains que Gabinius avait laissés
à Alexandrie pour la garde de Ptolémée, et huit cents levés parmi ses
esclaves et ses pâtres ; les tétrarques de Galatie en avaient fourni trois
cents, le Syrien Antiochus de Commagène deux cents ; la plupart étaient des
archers à cheval. Il avait encore des Phrygiens, des Besses, en partie
soudoyés, en partie volontaires ; des Macédoniens, des Thessaliens et des
gens d’autres pays.
Il avait tiré une grande
quantité de vivres de la
Thessalie, de l’Asie, de l’Égypte, de Crète, du pays de
Cyrène et d’autres contrées. Son dessein était de passer l’hiver à Dyrrachium,
à Apollonie et dans les autres villes maritimes, afin d’interdire l’entrée de
la Grèce ; et
dans ce même but il avait disposé sa flotte, qui ne comptait pas moins de six
cents navires, tout le long de la côte[57]. L’immensité de
ces ressources explique pourquoi Pompée avait si facilement abandonné
l’Italie à son rival.
César n’avait à citer parmi ses auxiliaires ni tant de
peuples ni tant de rois. Cependant, sans parler de la légion de l’Alouette ni
des secours fournis par les cités gauloises et espagnoles, par les Cisalpins
et les peuples d’Italie, il avait enrôlé des cavaliers germains, dont il avait
maintes fois éprouvé le courage ; et sans doute que l’exemple de ce roi du
Noricum, qui lui avait envoyé des troupes dés le début de la guerre, avait
été suivi par d’autres chefs des bords du Rhin et du Danube. C’était donc
l’Orient et l’Occident qui allaient se trouver aux prises et combattre, non
pour un sénat et une liberté qu’on ne connaissait plus, mais pour César ou
Pompée, que chacune des deux grandes portions de l’empire voulait avoir pour maître,
après les avoir eus tour à tour pour conquérants et pour bienfaiteurs.
Toutefois les forces ne semblaient pas égales. César n’avait ni flotte, ni
argent, ni magasins, et ses troupes étaient moins nombreuses ; mais depuis
dix ans elles vivaient sous la tente ; leur dévouement à sa personne était
sans bornes, comme leur confiance en sa fortune. Nuls travaux, nulles
fatigues, ne pouvaient les effrayer, et elles avaient ce qui double le
nombre, l’habitude de vaincre. Si l’armée de Pompée était plus forte, il y
avait moins de discipline dans les soldats, point d’obéissance dans les
chefs. A voir dans le camp ces costumes étranges, à écouter ces commandements
donnés en vingt langues, on eût pris les légions pompéiennes pour une de ces
armées asiatiques auxquelles le sol de l’Europe fut toujours fatal. Au
prétoire, autre spectacle : tant de magistrats et de sénateurs gênaient le
chef, quoiqu’on lui eût donné pouvoir de décider souverainement de toutes
choses[58]. Puisque l’on
combattait, disait-on, pour la république, il fallait bien que le
généralissime montrât aux pères conscrits, constitués en conseil à
Thessalonique, une déférence qui serait de bon augure et de bon exemple ;
mais cette déférence s’accordait-elle avec les nécessités de la guerre ?
Les anciens n’aimaient pas à naviguer l’hiver. Aussi, bien
qu’entre Brindes et Dyrrachium la traversée fût seulement de vingt-quatre
heures, Pompée ne s’attendait à être attaqué qu’au printemps, et il avait mis
ses troupes en quartiers dans la
Thessalie et la Macédoine. Il pensait que son adversaire n’oserait s’embarquer dans la
saison rigoureuse. Ce fut cette rigueur même de la saison qui
décida César. Avec sa flotte de transport, il ne pouvait passer que par
surprise, e’ cette surprise n’était possible qu’en hiver, alors que les
escadres pompéiennes s’étaient mises à l’abri du gros temps dans les ports ;
au printemps, leurs nombreuses croisières auraient barré la route. Malgré son
infériorité numérique et une mer dangereuse, César prit donc encore
l’offensive. Le 4
janvier 48 (5 novembre 49),
il embarqua sur des navires de transport sept légions, qui ne formaient que
quinze mille fantassins et cinq cents cavaliers. S’il eût rencontré la flotte
pompéienne, c’en était fait de lui ; mais, comme il l’avait pensé, les
galères pompéiennes, vides de soldats et de matelots, se balançaient
tranquillement sur leurs ancres, dans les rades d’Oricum et de Corcyre :
son coup d’audace était encore un calcul. Les sept légions passèrent sans rencontrer
un vaisseau ennemi et débarquèrent au pied des monts Acrocérauniens dans la rade
de Paleassa (Paljassa). On sut qu’il était
arrivé avant d’apprendre qu’il était parti. L’amiral de Pompée
était le malheureux consulaire que la fortune opposait toujours à César, et dont
le sort fut d’être toujours aussi trompé par lui. Bibulus, accouru trop tard,
se vengea sur Ies navires que César renvoyait à vide, pour prendre à Brindes
Antoine et le reste de ses troupes ; il en enleva trente, qu’il brûla avec
les pilotes et les matelots. Puis, pour expier sa négligence, il ne voulut
plus descendre de son vaisseau et se donna de telles fatigues à surveiller la
côte et la mer, qu’il fut saisi d’un mal qui l’emporta.
La première ville que César rencontra fut Oricum
(Eriko).
L’officier pompéien qui y commandait voulait la défendre, mais les habitants
déclarèrent qu’ils ne pouvaient combattre un consul du peuple romain, et ils
ouvrirent leurs portes ; à Apollonie, à l’embouchure de l’Aoüs (Voiussa), même résolution. Il attachait plus d’importance à
la possession de Dyrrachium (Durazzo)[59], à cause de son
port, le meilleur de cette côte, et de sa forte position ; apprenant que
Pompée l’avait prévenu en y établissant ses magasins, il s’arrêta sur les
bords de l’Apsos (Beratino), pour
couvrir les places qui s’étaient données à lui, et les cantons de l’Épire,
d’oie il tirait ses approvisionnements.
Cette fois encore il proposa la paix, moins dans l’espoir
qu’elle se ferait que pour se concilier l’opinion publique. Il écrivit à Pompée
: Tu as perdu l’Italie, la Sicile, les deux Espagnes
et cent trente cohortes de citoyens romains ; moi, j’ai à regretter Curion et
mole armée d’Afrique. Nous savons donc tous deux que la fortune de la guerre
a des chances diverses, et puisque nous sommes encore égaux en forces,
soumettons notre différend au sénat et au peuple, et, en attendant,
licencions nos armées.
César ne risquait
rien à faire ces propositions. Comme dictateur, il avait complété le sénat de
manière à n’avoir rien à craindre des sénateurs pompéiens ; et consul en charge,
il restait, pour toute l’année 48, maître de la situation. Du reste Pompée ne
mit pas son désintéressement à l’épreuve : il refusa, et César rapporte des
paroles de lui qui ne peuvent avoir été sa réponse officielle, mais qui expriment
certainement sa pensée secrète : Que dira-t-on de moi lorsqu’on me verra rentrer sans un
soldat dans cette Italie que j’ai quittée à la tête d’une puissante armée ?
Et qu’ai-je à faire d’une patrie, de la vie même que je devrais à César ?[60]
Un jour, Vatinius, pour César, Labienus, pour Pompée,
discutaient à haute voix, entre les deux armées, les conditions d’un
accommodement. Les soldats écoutaient ; ils pouvaient prendre au sérieux ces
grands mots de guerre impie, de patrie en larmes, et forcer leurs chefs à
traiter ; tout à coup une grêle de traits, au dire de César, partit des rangs
pompéiens, et Labienus rompit la conférence en s’écriant : La paix ! Vous ne l’aurez que quand vous nous
apporterez la tête de César. Il est certain que les pompéiens, si
César ne les a pas calomniés, ne rêvaient que massacres : un navire parti de
Brindes ayant été pris en mer, tous ceux qui le montaient furent égorgés ; le
mot de Cicéron rapporté plus haut donne créance à ces récits[61].
Cependant de pressants messages ordonnaient à Antoine de
passer le détroit au premier vent favorable ; mais les jours s’écoulaient, et
Antoine n’arrivait pas. On raconte que César, peu accoutumé à ces lenteurs,
voulut aller lui-même chercher ses légions, et qu’un soir il sortit seul de
son camp, monta sur une barque du fleuve, et ordonna au pilote de cingler
vers la haute mer. Un vent contraire, qui souffla presque aussitôt, refoulait
les vagues, et le pilote, effrayé par la tempête, refusait d’avancer : Que crains-tu ? lui aurait dit son passager
inconnu, tu portes César et sa fortune !
Tous ces fondateurs d’empire croient ou feignent de croire à une fatalité qui
les protège jusqu’à ce qu’ils aient accompli l’œuvre pour laquelle ils se
prétendent appelés. Il fallut pourtant, si l’anecdote est vraie, malgré le
silence des Commentaires, regagner le bord ; mais la tempête, une
autre fois, le servit. Depuis la mort de Bibulus la flotte pompéienne était
sans chef ; par une malheureuse faiblesse, ou pour ne pas confier à un autre
consulaire, peut-être moins docile et moins sûr, un commandement si
important, Pompée laissa les huit lieutenants de Bibulus conduire à leur gré
les escadres. Ils ne s’accordèrent pas ; la surveillance fut moins active, et
un jour que soufflait avec force le vent du midi, Antoine arriva en quelques heures en vue
d’Apollonie avec quatre légions et huit cents cavaliers. Poussé par la
tempête, il dépassa Dyrrachium et ne put aborder qu’au port de Nymphée, à
cent milles au moins du camp de César. Deux de ses navires avaient été coupés
par l’ennemi ; l’un portait deux cent vingt recrues qui, malades de la mer,
se rendirent, et, malgré la promesse qu’ils auraient la vie sauve, furent
égorgés ; l’autre portait deux cents vétérans : ils forcèrent le pilote à
jeter le navire à la côte et furent sauvés[62]. Pompée se
trouvait entre les deux armées césariennes ; il lui eût été facile d’accabler
Antoine. Il l’essaya, mais avec les lenteurs qui permirent aux deux chefs
d’opérer leur jonction (avril
48).
Le mouvement des pompéiens les avait éloignés de
Dyrrachium. César leur déroba une marche et vint se poster entre eux et cette
ville qui était leur place d’armes. Ils le suivirent et campèrent sur le mont
Petra, d’où ils conservaient leurs communications avec la mer. Alors commença
une lutte de quatre mois. César, ne pouvant amener son rival à une action
décisive, conçut l’audacieuse pensée d’enfermer, dans une ligne de postes
retranchés, une armée qui lui était supérieure en nombre. A Alésia et en
Espagne, cette manœuvre lui avait réussi, parce qu’il avait pu affamer ses
adversaires. Ici ce résultat était impossible, puisque l’armée pompéienne
était maîtresse de la mer. Ses vétérans, toujours admirables, commencèrent de
gigantesques travaux avec leur activité ordinaire. Chacune des collines qui
entouraient le camp pompéien fut couverte d’un fort, et des lignes de
communication les relièrent entre elles. Deux motifs l’avaient décidé à
suivre ce plan : comme la nombreuse cavalerie de ses adversaires rendait,
dans un pays ruiné, les approvisionnements difficiles, il voulait les
enfermer, afin d’avoir lui-même ses mouvements libres pour aller au fourrage
; et puis il tenait à montrer au monde le grand Pompée emprisonné dans son
camp et n’osant combattre.
Napoléon a jugé sévèrement ces manœuvres : Elles étaient extrêmement téméraires, dit-il ; aussi César en fut il puni. Comment pouvait-il espérer
de se maintenir avec avantage le long d’une ligne de contrevallation de six
lieues, entourant une armée qui avait l’avantage d’être maîtresse de la mer
et d’occuper une position centrale ? Après des travaux immenses il échoua,
fut battu, perdit l’élite de ses troupes, et fut contraint de quitter ce
champ de bataille. Pompée lui avait opposé une ligne de
circonvallation protégée par vingt-quatre forts, et qu’il agrandissait sans
cesse pour forcer son adversaire à s’affaiblir en s’étendant. Tous les jours
des escarmouches avaient lieu entre les travailleurs des deux armées. Une
fois la neuvième légion fut tout entière engagée, et Pompée crut u a instant
saisir la victoire. Mais les vétérans soutinrent leur réputation et
repoussèrent l’ennemi. Dans une de ces attaques journalières dont chaque
colline était le théâtre, un fort fut cerné ; l’ennemi y lança tant de
projectiles qu’il ne s’y trouva pas un soldat saris blessure. Ils montrèrent
avec orgueil à César trente mille flèches qu’ils avaient ramassées et le
bouclier d’un de leurs centurions percé de cent vingt coups.
On a remarqué que nos soldats manquaient de vivres quand
ils gagnèrent leurs plus belles victoires[63]. Ceux de César
aussi étaient habitués à la disette, qu’amenaient la rapidité et l’audace de
ses manœuvres. Nulle part ils n’en souffrirent comme à Dyrrachium. César
avait bien envoyé des détachements dans l’Épire, l’Étolie, la Thessalie et jusqu’en
Macédoine ; maïs on ne pouvait tirer que de rares et maigres convois de ces
pays, épuisés par la présence de tant d’armées, et où l’on se battait déjà,
car Metellus Scipion y était arrivé avec ses deux légions. Les soldats en
vinrent à broyer des racines pour en faire une sorte de pâte, et quand les
pompéiens les raillaient sur leur disette, ils leur jetaient de ces pains, en
leur criant qu’ils mangeraient l’écorce des arbres plutôt que de laisser
échapper Pompée. Celui-ci avait du blé en abondance, mais il manquait d’eau
et de fourrages ; César avait détourné les ruisseaux qui descendaient des
montagnes, et les pompéiens étaient réduits à l’eau saumâtre du rivage. Aussi
les bêtes de somme, les chevaux, périssaient en foule, et les exhalaisons qui
sortaient de tant de cadavres infectaient l’air et causaient des maladies qui
tuaient beaucoup de monde. Un jour enfin que Pompée crut avoir trouvé une
occasion favorable, il prépara, conduit par des transfuges, une attaque de
nuit et faillit enlever toute une légion campée au bord de la mer. Antoine ne
parvint à la sauver qu’après qu’elle eut subi de grandes pertes. Pour réparer
cet échec sur l’heure même, César, à la tête de trente-trois cohortes,
pénétra dans le camp ennemi. Mais son aile droite s’étant trompée de route
laissa entre elle et l’aile gauche un vide dans lequel Pompée se jeta ; les
césariens rompus s’enfuirent en désordre ; en vain César allait au-devant des
fuyards : une terreur panique avait saisi ses troupes, il fut entraîné
lui-même, et laissa aux mains de l’ennemi trente-deux enseignes.
Ce jour-là Pompée aurait pu finir la guerre. La facilité
du succès lui fit redouter une embuscade, et il n’osa poursuivre sa victoire.
On la vanta cependant comme une affaire décisive, et, en l’annonçant à toutes
les provinces, il reprit le titre d’imperator.
Décidément, disait-on dans son camp, César a gagné à peu de frais sa renommée
; il a pu vaincre des Barbares, mais il a fui devant des légions romaines ;
c’est à la trahison qu’il a dû en Espagne tous ses succès. On avait fait
quelques prisonniers : Labienus, qui tenait à prouver son zèle à ses nouveaux
amis, les réclama, et, après les avoir promenés par dérision autour de son
camp, il les fit égorger en leur disant : Eh quoi
! Mes compagnons, les vétérans ont-ils donc appris à fuir ! Caton
avait fait décréter par le sénat pompéien qu’aucune ville ne serait pillée,
aucun citoyen mis à mort hors du champ de bataille : il se voila la tête
pour ne pas voir comment les chefs militaires, quand l’épée est tirée,
obéissent aux décrets du pouvoir civil (mai et juin 48).
Tandis que les pompéiens déclaraient la guerre terminée,
les légions césariennes, bientôt revenues de leur effroi, demandaient
elles-mêmes qu’on punît les coupables, et voulaient retourner au combat. Mais
César avait d’autres desseins. Sa position n’était plus tenable : les vivres
allaient lui manquer, et Scipion approchait ; en allant au-devant de ce chef,
il entraînerait certainement à sa suite l’ennemi devenu confiant, et
peut-être trouverait-il une occasion de livrer bataille. Dans tous les cas,
il gagnerait de l’espace, il ramasserait des vivres, et éloignerait les
pompéiens de leur flotte. Enfin la guerre de siège ayant échoué, il fallait
tenter celle de campagne, qui présentait mille incidents dont le plus habile
saurait profiter. Laissant donc à Apollonie ses blessés et ses malades, il
traversa l’Épire, et par Gomphi, qu’il saccagea, parce qu’elle lui avait
fermé ses portes, il entra dans la Thessalie. Toutes
les villes de la vallée du Pénée, excepté Larisse, se donnèrent à lui, et ses
soldats se trouvèrent, en ce fertile pays, dans une abondance qu’ils
n’avaient pas connue depuis leur départ de Brindes.
Comme il l’avait prévu, Pompée le suivit, malgré les
conseils d’Afranius, qui voulait qu’on regagnât l’Italie. Caton et Cicéron
avaient été laissés à Dyrrachium avec les bagages ; la surveillance et les
regrets républicains dut premier, l’humeur chagrine du second, gênaient l’imperator. Mécontent de lui-même et des autres,
Cicéron n’avait apporté dans le camp que son esprit railleur, son
découragement et ses craintes trop légitimes des proscriptions qui suivraient
la victoire ; il regrettait les laborieux loisirs de ses villas, Tusculanenses dies, et il avait volontiers
laissé partir cette armée où on le traitait de prophète de malheur[64].
Scipion, envoyé par Pompée en Asie pour y recevoir des
soldats et de l’argent, avait perdu beaucoup de temps en Syrie et dans l’Asie
Mineure, vivant grassement dans
ces riches provinces, qui, s’il en faut croire César[65], eurent alors à
souffrir des maux presque aussi grands que du temps de Sylla. Un ordre formel
de Pompée l’obligea enfin à quitter son quartier général de Pergame, mais il
marcha encore avec lenteur. Son entrée en ligne pendant les combats devant
Dyrrachium aurait pu changer en désastre l’échec de l’armée consulaire. César
eut le loisir d’envoyer Cassius Longinus avec une légion en Thessalie pour en
fermer la porte, la vallée de Tempé, et Domitius Calvinus, avec deux autres
légions, en Macédoine, oïl il occupa fortement la vallée de l’Haliacmon. De
là il tint sous sa surveillance la grande voie militaire, via Egnatia, que Scipion suivait et qui
l’aurait conduit de Thessalonique à Dyrrachium. Le général pompéien alla
droit à Calvinus ; mais, arrivé clans son voisinage, il lui déroba une
marche, en laissant devant les césariens ses bagages, dans un camp fortifié
que gardèrent huit cohortes, et il marcha sur Cassius. Celui-ci, effrayé à
l’apparition sur ses derrières des cavaliers thraces du roi Cotys qui semblent
avoir franchi l’Olympe par des sentiers, se replia de Temps ; sur les
hauteurs du Pinde. Scipion était donc libre d’entrer en Thessalie quand il
lui conviendrait d’y passer. Mais il risquait, en s’y engageant, de livrer sa
ligne d’approvisionnement et de retraite aux césariens de Macédoine ; il
resta dans cette province et dans la vallée de Tempé, jusqu’à ce que Calvinus
eût levé son camp pour rejoindre César, vers les sources du Pénée.
Pompée avait de son côté rallié, vers Larisse, les légions
de son beau-père. Il voulait encore traîner la guerre en longueur pour
épuiser son ennemi, mais les jeunes nobles qui l’entouraient trouvaient cette
campagne bien longue, et tant de circonspection leur était suspect. S’il ne se décide pas à combattre, disait-on, c’est pour garder son commandement, tout fier qu’il est de
traîner à sa suite des consulaires et des prétoriens. On
l’appelait Agamemnon, le roi des rois ; et Favonius s’écriait qu’on ne
mangerait pas cette année de figues de Tusculum, parce que Pompée ne voulait pas
si vite abdiquer. L’impatience s’accroissait encore de la certitude qu’on
avait de triompher sans peine. Déjà l’on se disputait les dignités, comme si
l’on eût été à Rome, à la veille des comices, et quelques-uns envoyaient
retenir les maisons le plus en vue autour du Forum, celles d’où l’on pourrait
le mieux briguer ; on désignait les consuls pour les années suivantes, et
l’on se partageait les dépouilles des césariens. On commencerait par une
proscription générale qui serait accomplie judiciairement, comme il convenait
à des hommes qui se battaient pour la défense des lois ; même ils avaient
arrêté la forme du jugement. On était moins d’accord sur le partage du butin.
Fannius voulait les biens d’Atticus, Lentulus ceux d’Hortensius et les jardins
de César. Les plus sages devenaient aveugles : Domitius, Scipion, Lentulus
Spinther, se disputaient chaque jour avec aigreur le grand pontificat de
César. Les chances se balançaient entre ces trois candidats, car, si Lentulus
avait pour lui son âge et ses services, Domitius jouissait d’un grand crédit,
et Scipion était beau-père de Pompée ! Ainsi,
dit celui qui fit évanouir ces folles espérances, au
lieu de s’occuper des moyens de vaincre, ils ne pensaient tous qu’à la
manière dont ils exploiteraient la victoire.

Pressé par les clameurs de ces nobles qu’il ne savait pas
plier à l’obéissance, Pompée se décida à livrer bataille près de Pharsale,
aux mêmes lieux où, cent cinquante ans auparavant, Rome avait conquis la Grèce et tout l’Orient
hellénique (Cynocéphales).
À la vue de ses cohortes se déployant dans la plaine, César s’écria joyeux : Enfin donc le voilà venu ce jour où nous aurons à
combattre, non plus la faim, mais des hommes ! Et aussitôt il
s’avança pour reconnaître la ligne ennemie, formée de quarante-sept mille
fantassins et de sept mille cavaliers, sans parler des auxiliaires que l’on
ne comptait pas. La droite s’appuyait à un ruisseau dont les bords escarpés
rendaient une attaque difficile ; aussi Pompée avait-il jugé cette position
avez forte pour porter toute sa cavalerie à la gauche. Massée sur ce point,
elle déborderait facilement l’ennemi, le prendrait en flanc, le tournerait,
et assurerait le succès de la journée. César comprit le dessein de son
adversaire, et ce fut sur cette attaque prévue qu’il compta pour vaincre. Il
n’avait que vingt-deux mille légionnaires et seulement mille cavaliers.
Contre l’habitude, il forma de son armée quatre ligues d’inégale étendue :
les deux premières devaient aborder l’ennemi, la troisième servir de réserve,
et la quatrième faire face en arrière contre la cavalerie qui allait
assaillir sa droite. Il avertit les vétérans des six cohortes qu’il plaça
obliquement de ce côté que de leur courage et de leur sang-froid dépendrait
la victoire : Soldat, leur cria-t-il, frappe au visage ! Il savait, a-t-on dit, que
les jeunes nobles qui allaient mener la charge craindraient plus la
difformité d’une blessure que le déshonneur de la fuite. En réalité, l’ordre
de garder leur pilum, afin d’en frapper de près l’ennemi au visage,
était un avis bien conçu pour combattre des cavaliers couverts d’armes
défensives que n’avaient pas eues les cavaliers gaulois, contre lesquels ses
légionnaires s’étaient jusqu’à présent battus.
Antoine commandait l’aile droite, Sylla la gauche, Calvinus
le centre de sa personne il se plaça au milieu de sa dixième légion, célèbre
par le dévouement qu’elle lui avait toujours montré, et que les cavaliers de
Pompée lui avaient promis d’écraser sous les pieds de leurs chevaux. Le mot
d’ordre de son armée était Vénus victorieuse, la déesse à qui nul ne
résiste ; celui de l’armée pompéienne, Hercule invincible, que deux
fois pourtant, par Omphale et Déjanire, Vénus avait vaincu, et qu’elle allait
vaincre encore par César.
Pompée avait ordonné aux siens d’attendre le choc sans
s’ébranler, espérant que par la course les césariens arriveraient épuisés et
en désordre. Mais quand ils virent leurs adversaires rester immobiles,
d’eux-mêmes les vétérans s’arrêtèrent, reprirent haleine, puis s’avancèrent
encore au pas de course et en ligne, lancèrent leurs javelots et attaquèrent
à l’épée. Pendant que l’action s’engageait sur le front de bataille, la
cavalerie pompéienne rompait celle de l’ennemi et tournait son aile droite.
César donne alors le signal à la quatrième ligne, qui charge avec tant de
vigueur, que les cavaliers, surpris de cette attaque imprévue, tournent bride
et s’enfuient. Du même pas les cohortes se portent sur la gauche ennemie
qu’ils enveloppent ; César saisit cet instant pour lancer sa réserve toute
fraîche, et les pompéiens, brisés par le choc, se débandent. Pompée avait
quitté le champ de bataille, lorsqu’il avait vu sa cavalerie repoussée, et il
s’était retiré dans sa tente désespéré. Tout à coup il entend des clameurs
qui s’approchent : c’est César qui mène ses soldats victorieux à l’attaque
des retranchements. Quoi, s’écrie le
malheureux général, jusque dans mon camp !
Il jette les insignes du commandement, saute sur un cheval, et se sauve par
la porte Décumane. On trouva dans le camp, sous des tentes ornées de lierre
et couvertes de frais gazon, des tables toutes dressées, des buffets chargés
de vaisselle d’argent, des amphores pleines de vin : tous les apprêts d’un
festin joyeux. Et ceux qui se permettaient ce
luxe frivole, dit le vainqueur, osaient
accuser de mollesse cette armée de César, si pauvre et si forte, à qui même
le nécessaire avait toujours manqué. (9 août-6 juin 48.)
Malgré les efforts de César pour arrêter le massacre,
quinze mille six cents hommes étaient tués, mais pas un chef : Domitius seul
périt en fuyant[66].
Ils l’ont voulu, disait-il, en
traversant ce champ de carnage ! Après tout ce
que j’ai fait pour la république, j’eusse été condamné comme criminel si je
n’en avais pas appelé à mon armée[67]. Sa clémence ne
se démentit pas. Dès que le succès fut décidé, il défendit qu’on tuât un seul
citoyen et reçut en grâce tous les captifs qui implorèrent sa pitié. Ceux
mêmes qui l’avaient éprouvée déjà n’avaient besoin que d’un intercesseur pour
être encore pardonnés. Dans la tente de Pompée, il trouva sa correspondance ;
elle pouvait lui livrer de très utiles révélations : il la brûla sans la
lire. L’histoire serait plus curieuse. Les peuples et les princes qui avaient
pris parti pour son rival tremblaient : il les rassura. Les Athéniens, peu
faits pour ces combats de géants, étaient venus prêter à Pompée leur débile
assistance, au lieu d’accepter la neutralité que les deux partis leur
offraient. César tenait à gagner la ville qui
savait parler ; quand ses députés parurent en suppliants devant
lui, il se contenta de leur dire : Que de fois
déjà la gloire de vos pères vous a sauvés !
Sans donner à ses troupes le temps de piller les richesses
éparses dans le camp pompéien, César les entraîna à la poursuite de l’ennemi
dont il cerna les derniers débris sur une montagne : vingt-quatre mille
hommes furent pris. Le lendemain l’armée entière décerna le prix de la valeur
à César, à la dixième légion et à un centurion. Au moment de donner le signal
du combat, César avait reconnu ce vétéran et, l’appelant par son nom, lui
avait dit : Eh bien, Crastinus, avons-nous bon
courage ? les battrons-nous ? — Nous
vaincrons avec gloire, César, avait-il répondu, d’une voix forte, et
aujourd’hui vous me louerez vivant ou mort. A ces mots, il avait
marché en avant, et cent vingt hommes de la cohorte s’étaient élancés avec
lui pour porter les premiers coups. Après de brillants exploits, il était
tombé. César fit chercher son cadavre, le couvrit des récompenses militaires
qu’il avait si bien gagnées, et lui dressa un tombeau particulier à côté de
la fosse où les autres morts furent couchés.

V. — MORT DE POMPÉE.
Pompée avait commis une grande faute en s’éloignant de sa
flotte et en acceptant le combat au milieu du continent grec ; c’en était une
autre de ne s’être pas assuré une place de refuge en cas de défaite. Mais
telle était sa confiance qu’il n’avait pas même désigné un lieu de ralliement
; aussi tous s’étaient dispersés à l’aventure, et de cette puissante armée il
ne restait que des morts et des suppliants. Le chef lui-même, uniquement
occupé de sauver sa vie, fuyait vers la vallée de Tempé, et les deux Lentulus
qui l’accompagnaient virent le vainqueur de Mithridate, des pirates et de
Sertorius, pressé par la soif, boire au fleuve dans sa main, comme les pâtres
de la montagne. Arrivé au bord de la mer, il passa la nuit dans une cabane de
pécheur, et, au matin, fut recueilli par un navire de charge qui avait jeté
l’ancre à l’embouchure du Pénée. Peu d’instants après parut au rivage le roi
Dejotarus, faisant des gestes désespérés. Le patron le reçut encore à son
bord et se hâta de larguer les voilés. Pompée fit mettre le cap sur Mitylène,
où il prit sa femme Cornélie ; puis il tira au sud par la mer des Sporades, qu’il traversait jadis avec cinq cents galères[68]. Le bruit de sa
défaite l’avait précédé, et, dans ces îles, dans cette province d’Asie, qu’il
croyait si dévouées à sa cause, nul ne montrait d’empressement à l’assister,
à Rhodes même, il ne put s’arrêter qu’un instant. Sur les côtes de la Carie et de la Lycie, théâtre de ses
anciens exploits, étaient de riches cités, Aphrodisias, Telmissus, Patara,
qui lui donnèrent un peu d’argent ; la Cilicie lui fournit des navires et quelques
soldats. Mais où aller ? On dit qu’il songea à fuir chez Ies Parthes, et
qu’Antioche, qui s’était déclarée pour César, lui ayant fermé la route du
désert, il s’était décidé à chercher un asile en Égypte. Il n’avait pas
d’autre parti à prendre[69]. Le roi régnant,
dont il avait obligé le père, Ptolémée Aulète, était son allié : soixante
navires égyptiens avaient rallié dans l’Adriatique la flotte sénatoriale, et,
à la suite de l’expédition de Gabinius, il était resté en Égypte quelques
milliers de soldats pompéiens qui n’avaient pas encore oublié leur ancien
général ; enfin le pays était facile à défendre, et de là on pourrait
communiquer avec les Parthes, s’il était nécessaire, plus certainement avec
Varus et Juba, maîtres de la
Numidie et de l’Afrique romaine.
Pompée arriva en vue de Péluse, suivi d’environ deux mille
hommes. D’après le, testament du dernier roi, Cléopâtre devait épouser son
frère Ptolémée Dionysios, plus jeune qu’elle de deux ans[70], et régner
conjointement avec lui, sous la tutelle du sénat. Mais, au bout de trois
années, la jeune reine avait été chassée par le général Achillas et le
gouverneur du roi Théodote ; elle s’était retirée en Syrie, et Ptolémée avait
réuni aile armée à Péluse pour arrêter l’expédition que sa sœur préparait
contre lui. Quand Pompée vaincu se présenta, Pothin et Achillas furent d’avis
de le recevoir avec honneur. Théodote rejeta la pensée d’unir les destinées
du roi et du pays au sort d’un fugitif, et une barque fut envoyée au vaisseau
sous prétexte de conduire le général auprès du roi.
Quand la barque s’approcha,
Septimius se leva le premier en pieds qui salua Pompeius, en langage romain,
du nom d’imperator, qui est à dire, souverain capitaine, et Achillas le salua
aussi en langage grec, et luy dist qu’il passast en sa barque, pource que le
long du rivage il y avoir force vase et des bans de sable, tellement qu’il
n’y avoit pas assez eau pour sa galere ; mais en mesure temps on voyoit de
Loing plusieurs galeres de celles du roy, que lon armoit en diligence, et
toute la conte couverte de gens de guerre, tellement que quand Pompeius et
ceulx de sa compagnie eussent voulu changer d’advis, : ilz n’eussent plus
sceu se sauver, et si y avoit d’avantage qu’en monstrant de se deffier, ilz
donnoient au meurtrier quelque couleur d’executer sa meschanceté. Parquoy
prenant congé de sa femme Cornelia, laquelle desja avant le coup faisoit les
lamentations de sa fin, il commanda à deux centeniers qu’ilz entrassent en la
barque de l’Ægyptien devant luy, et a un de ses serfs affranchiz qui
s’appeloit Philippus, avec un autre esclave qui se nommoit Seynes. Et comme
ja Achillas luy tendoit la main de dedans sa barque, il se retourna devers sa
femme et son filz, et leur dist ces vers de Sophocles :
Qui
en maison de prince entre, devient
Serf,
quoy qu’il soit libre quand il y vient.
Ce furent les dernieres
paroles qu’il dist aux siens, quand il passa de sa galere en la barque : et
pource qu’il y avoit loin, de sa galere jusques à la terre ferme, voyant que
par le chemin personne ne luy entamoit propos d’amiable entretien, il regarda
Sept.imius au visage, et luy dist : Il me semble que je te recognois,
compagnon, pour avoir autrefois esté à la guerre avec moy. L’autre luy
feit signe de la teste seulement qu’il estoit vray, sans luy faire autre
reponse ne caresse quel conque : parquoy n’y ayant plus personne qui dist
mot, il prit en sa main un petit livret, dedans lequel il avoir escript une
harengue en langage grec, qu’il vouloit faire à Ptolemmus, et se meit à la
lire. Quand ilz vindrent à approcher de la terre, Cornelia, avec ses
domestiques et familiers amis, se leva sur ses pieds, regardant en grande
detresse quelle seroit l’issue. Si luy sembla qu’elle devoit bien esperer
quand elle apperceut plusieurs des gens du roy, qui se presenterent il la descente
comme pour le recueillir et l’honorer : mais, sur ce poinct, ainsi comme
il prenoit la main de son affranehy Philippus pour se lever plus à son aise,
Septimius vint le premier par derriere qui luy passa son espée à travers le
corps, après lequel Salvius et Achillas desguainnerent aussi leurs espées, et
adonc Pompeius tira sa robbe à deux mains au devant de sa face, sans dire ne
faire aucune chose indigne de luy, et endura vertueusement les coups qu’ilz luy
donnerent, en souspirant un peu seulement ; estant aagé de cinquante-neuf
ans, et ayant achevé sa vie le jour ensuivant celuy de sa nativité. Ceulx
rade, quand qui estoient dedans les vaisseaux à la rade quand ilz
apperceurent ce meurtre jetterent une si grande clameur, que lon l’entendoit
jusques à la coste, et levans en diligence les ancres, se meirent à la voile
pour s’enfouir, à quoy leur servit le vent qui se leva incontinent frais
aussi tort qu’ilz eurent gaigné la haulte mer, de maniere que les Ægyptiens
qui s’appareilloient pour voguer après eulx, quand ilz veirent cela, s’en
deporterent, et ayant couppé la teste en jetterent le tronc du corps hors de
la barque, exposé à qui eut envie de veoir un si misérable spectacle.
Philippus, son afrranchy,
demoura tousjours auprès, jusques à ce que les Égyptiens furent assouvit de
le regarder, et puis l’ayant lavé de Peau de la nier, et enveloppé d’une
siene pauvre chemise, pource qu’il n’avoit autre chose, il chercha au long de
la greve, où il trouva quelque demourant d’un vieil bateau de pescheur, dont
les pieces estoient bien vieilles, mais suffisantes pour brusler un pauvre
corps nud, et encore non tout entier. Ainsi comme il les amassoit et assembloit,
il survint un Romain, homme d’aage, qui, en ses jeunes ans, avoit esté à la
guerre soubs Pompeius : si luy demanda : Qui es-tu, mon amy, qui fais
cest apprest pour les funerailles du grand Pompeius ? Philippus luy
respondit qu’il estoit un sien affranchy. Ha, dit le Romain, tu
n’auras pas tout seul test honneur, et te prie, vueille moy recevoir pour
compagnon en une si saincte et si devote rencontre, à fin que je n’aye point
occasion de me plaindre en tout et par tout de m’estre habitué en païs
estranger, ayant, en recompense de plusieurs maulx que j’y ay endurez,
rencontré au moins ceste bonne adventure de pouvoir toucher avec nies mains
et eider à ensepvelir le plus grand capitaine des Romains. Voilà comment
Pompeius fut ensepulturé. (29
sept.-24 juillet 48.)
Le lendemain, Lucius Lentulus
ne sachant rien de ce qui estoit passé, ains venant de Cypre, alloit cinglant
au long du rivage, et apperceut un feu de funerailles, et Philippus auprès,
lequel il ne recogneut pas du premier, coup : si luy demanda : Qui est
celuy qui, ayant ici achevé le cours de sa destinée, repose en ce lieu ? Mais
soudain, jettant un grand souspir, il adjouxta : Hélas ! à l’adventure
est-ce toy, grand Pompeius ? Puis descendit en terre, là où tantost après
il fut pris et tué[71].
L’histoire fait comme César, qui pleura sur cette fin de
son rival. Mais, si l’on accorde que les services de Pompée, que l’éclat de
sa vie militaire, la dignité de sa vie privée, méritent des éloges, il faut
cependant condamner l’ambition stérile et les perpétuelles indécisions de
celui qui ne voulait le pouvoir que pour étaler sa robe triomphale. Des
talents après tout ordinaires ne suffisent point à mériter le titre d’homme
d’État. On n’y a droit qu’a la condition d’avoir bien compris les besoins de
son temps, par conséquent, l’avenir qui s’approche, puis, ce but reconnu, d’y
avoir marché résolument. Pompée, qui tant de fois passa du sénat au peuple et
du peuple au sénat, n’eut jamais d’autre mobile que l’intérêt de sa grandeur.
De son histoire il ressort une moralité politique : le fugitif de Pharsale
était le transfuge de tous les partis.
|
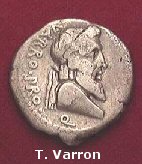 Terentius Varron, le polygraphe, commandait dans
l’Ultérieure ; Pétreius, un vieux soldat, dans
Terentius Varron, le polygraphe, commandait dans
l’Ultérieure ; Pétreius, un vieux soldat, dans 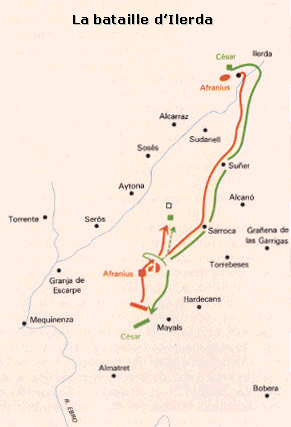 Cependant, en Espagne, les événements avaient pris une
tournure inattendue. César avait fait construire, avec du bois léger, de
l’osier et du cuir, des bateaux qu’on pouvait porter partout. Il les
conduisit an bord de
Cependant, en Espagne, les événements avaient pris une
tournure inattendue. César avait fait construire, avec du bois léger, de
l’osier et du cuir, des bateaux qu’on pouvait porter partout. Il les
conduisit an bord de 
