|
I. — LA GAULE AU TEMPS DE CÉSAR.
Au milieu du siècle qui précède l’ère chrétienne, beaucoup
des vieilles choses que nous avons montrées dans l’ancienne Gaule avaient
changé. Les chefs des tribus et les nobles avaient brisé le joug de la classe
sacerdotale. L’institut druidique, en décadence, ne prendra point, dans la
guerre de la liberté, le rôle d’un clergé national : un druide, Divitiac, sera
même le guide et l’ami de César. L’aristocratie, à son tour, avait trouvé
deux ennemis puissants. Quelques-uns des siens, les plus habiles ou les plus
braves, avaient réuni plusieurs tribus et s’étaient fait proclamer rois. Sur
d’autres points, les habitants des villes s’étaient soulevés, et les druides,
unis aux révoltés contre les nobles qui les avaient dépossédés, avaient
essayé d’abolir le gouvernement aristocratique ou royal, et de le remplacer
par un gouvernement démocratique plus ou moins mêlé d’éléments anciens. Dans
un canton, c’étaient les notables, principes,
et les prêtres qui, constitués en sénat, nommaient le vergobret, juge annuel, prononçant sur la vie
ou la mort[1],
au besoin chef de guerre ; dans un autre, le peuple avait institué un sénat
ou des magistrats, quelquefois un roi, qui restait dans la dépendance de l’assemblée
publique[2]. César raconte qu’après
sa victoire sur les Helvètes, les chefs de presque toutes les cités, principes civitatum, vinrent lui demander de
les autoriser à réunir le conseil de la Gaule[3]. Nous avons dit
ce qu’il convient de penser de ces assemblées générales.

Ainsi, pendant que Rome accablait les colonies gauloises d’Italie
et d’Asie Mineure, la grande Gaule se déchirait de ses mains, au lieu de s’organiser
et de s’unir. Aucun principe de gouvernement n’avait prévalu, ni la royauté,
ni l’aristocratie, ni le clergé. Voilà pourquoi la Gaule était restée ouverte
aux envahisseurs : par le nord aux Belges et aux Germains, par le sud aux
légions romaines. Cependant au milieu de ce chaos s’étaient formés quelques
États puissants. C’étaient des peuplades qui, plus nombreuses que leurs
voisines, avaient placé celles-ci dans leur dépendance. Comme les hommes
libres se mettaient dans la clientèle des grands, les petites tribus s’étaient
faites, de gré ou de force, les clientes de tribus plus puissantes, sans
aliéner leur liberté intérieure ; et il en était résulté de grandes
confédérations qui dominaient sur de vastes portions du territoire gaulois. A
en croire Strabon, les Arvernes auraient étendu leur suzeraineté sur la Gaule entière (V, 2, 3) : domination qu’il faut réduire à des proportions plus
modestes.
Ces peuples connaissaient mal le régime municipal qui fit
la grandeur des Gréco-Italiens et la civilisation du monde ; la forme sociale
qui dominait chez eux était celle du clan et de la tribu. Cependant les
confédérations dont il vient d’être parlé étaient un premier essai d’organisation
générale. En s’étendant, en se reliant les unes aux autres, elles auraient pu
donner la paix au pays et assurer son indépendance. Malheureusement le
sentiment du péril commun se révéla trop tard, et la Gaule entière ne s’unit,
une fois, que pour tomber, tout entière aussi, sous les coups de César.
Sans pouvoir être regardé comme une terre civilisée, ce
pays était sorti de la barbarie. Ses peuples n’étaient plus des hordes de
chasseurs errant à l’aventure, mais des sociétés assises sur le sol, où déjà
les bras et les intelligences travaillaient. Ils avaient des finances
organisées, des douanes, des impôts de diverses sortes[4]. César oppose la richesse
de la Gaule à
la pauvreté de la Bretagne
et de la Germanie,
et il en tira assez de richesses pour acheter le peuple romain.
De son temps, les Gaulois connaissaient l’art d’exploiter
les mines, et le pratiquaient très activement. Les Édues avaient des
fabriques pour l’or et l’argent, les Aquitains pour le cuivre, les Bituriges
pour le fer. Ce dernier peuple avait même trouvé l’art, resté traditionnel
chez lui et chez ses voisins les Arvernes, de l’étamage par l’étain ou le
plomb blanc. Les Édues avaient inventé le placage et l’argenture ; ils
ornaient ainsi les mors et les harnais des chevaux. Le char du roi Bituit
était argenté ou même plaqué d’argent. Les chefs portaient des cottes de
mailles en fer, récente invention gauloise, parfois même une cuirasse dorée,
et nos collections contiennent quantité d’armes, d’outils, de colliers (torques), de
bijoux, de vases en bronze, d’objets en émail, travaillés par les Gaulois.
Ils savaient tisser et brocher les étoffes, et leurs teintures n’étaient pas
sans réputation. On leur attribue l’invention de la charrue à roues, de la
herse, du crible de crin, et l’emploi de la marne et des cendres comme
amendement. Ils composaient diverses sortes de boissons fermentées, telles
que la bière et l’hydromel. De l’écume de la bière ils avaient fait la levure
ou ferment pour le pain. Bien qu’ils eussent peu de vin, on disait qu’ils
avaient été les premiers à fabriquer les tonneaux propres à le conserver,
tandis que les Romains en étaient encore à garder le vin dans des outres ou
des jarres de terre. L’élève des animaux domestiques était en honneur.
On recherchait en Italie leurs chevaux hongres, leurs bœufs,
et les esclaves celtes étaient renommés pour le service de l’écurie et de l’étable.
Les Massaliotes, qui cultivaient fort bien la vigne et l’olivier, avaient
appris à quelques-uns de leurs voisins et jusqu’aux Helvètes l’usage des
lettres grecques ; les Arvernes limitrophes de la Narbonnaise se
servaient de l’alphabet latin. Nous avons de très nombreuses médailles
gauloises ; sur beaucoup l’on voit un cheval sans bride, ou un sanglier,
double symbole de liberté et de guerre.
Leur système monétaire était celui des Gaulois du Danube,
qui, après le pillage de la
Grèce, avaient copié les magnifiques statères de Philippe II, de Thasos, etc.
; entre leurs mains inhabiles, le type avait perdu sa beauté. Cependant il
était venu un assez grand nombre de ces pièces macédoniennes dans la grande
Gaule pour qu’il s’y établît de nombreux ateliers monétaires qui ont fourni
des types curieux, où la vanité des chefs a fait reproduire leur image[5].
Le commerce avait une activité qui explique la richesse de
la Gaule et
que facilitaient les ponts jetés sur les fleuves, les routes solidement
établies, même au travers des marais[6], une navigation
fluviale très active et de nombreuses monnaies qui facilitaient les échanges.
Le grenat fin qu’ils trouvaient au pied de plusieurs de leurs montagnes était
fort recherché des Grecs dès le temps d’Alexandre. Les Séquanes envoyaient
par la Saône
et le Rhône leurs salaisons à Marseille, qui les répandait dans l’Italie et la Grèce, où ses marins
portaient encore les fromages des Cévennes et des Alpes, Ies vins de Béziers
et des côtes de la Durance,
les esclaves, qu’on achetait parfois pour une anaphore de vin. En ce
temps-là, avec l’immense consommation d’esclaves que faisaient les sociétés
civilisées, l’homme était la denrée la plus recherchée, celle qu’on était sûr
de placer vite et bien, et la
Gaule fournissait beaucoup de cette marchandise. Elle
exportait aussi de gros draps, des poteries noires, et avait, avec l’île de
Bretagne, de nombreuses relations dont le centre était à Corbilo, à l’embouchure
de la Loire. Les
Vénètes, autour du Morbihan, avaient même une marine qui, à certains égards,
était supérieure à celle des Romains et des Grecs. A la rame, l’engin des
temps classiques pour la marine militaire, ils avaient substitué la voile,
qui a permis les lointains volages et que de nos jours seulement la vapeur tend
à remplacer. Leurs bâtiments, également propres à la grande navigation comme
au cabotage, tenaient la haute mer ou pénétraient, à travers les écueils et
les bancs de sable, dans l’intérieur des golfes et des rivières. César eut
fort à faire avec ces hardis marins qui allaient chercher l’étain et le
cuivre de la Bretagne,
les grands chiens et les pelleteries de I’Irlande et de l’Écosse. A bien des
pages de ses Commentaires, César parle de marchands parcourant la Gaule, et trafiquant en
Bretagne, même dans la
Germanie. Ce furent des marchands gaulois qui rassurèrent
les soldats de César au sujet des Suèves et qui donnèrent le premier éveil
aux Bretons sur la descente des Romains dans leur île.
Les villes se multipliaient et s’entouraient de remparts
formés de plusieurs lits d’arbres et de pierres qui alternaient, comme on a
pu le voir dans les restes de l’enceinte de Mursceints. Les arbres, dégrossis
en poutres longues chacune de 40 pieds, étaient tenus réunis par des
traverses intérieures. Le feu n’avait point de prise sur les pierres, et le
bélier ne pouvait rien contre les poutres dont il ne rencontrait que les
extrémités : Jules César admire cette ingénieuse combinaison.
A Péran, près de Saint-Brieuc, on a trouvé quelque chose
de plus singulier : une muraille cimentée avec du verre fondu, un château de verre, comme disent les Écossais,
qui ont chez eux sept ou huit de ces enceintes vitrifiées. Le miracle n’était
pas difficile à réaliser : des lits de sable et de fougère, et par-dessus un
grand feu entretenu durant plusieurs jours, pouvaient l’accomplir. Quelque
feu allumé sur leurs grèves ou dans leurs landes avait sans doute révélé aux
Gaulois la facile vitrification du sable. Les Phéniciens avaient ainsi trouvé
l’art de faire le verre.
La Gaule
marchait donc d’elle-même et seule. Elle était divisée, mais moins que ne l’avaient
été l’Italie et la Grèce,
et les éléments de force et de civilisation ne lui manquaient pas. On s’est
demandé ce qu’elle serait devenue sans la conquête romaine, si la perte de
son indépendance a été un bien, enfin s’il ne serait pas sorti des entrailles
de la société gauloise, sous l’influence pacifique des arts de la Grèce et de l’Italie, une
civilisation plus originale et peut-être meilleure que celle qui lui fut
inoculée par Rome.
Sans doute, il est fâcheux que la Gaule ne soit pas arrivée
au complet développement d’une vie nationale, mais il était impossible qu’elle
y parvint. Placée entre les Romains qui, pour couvrir l’Italie, avaient
besoin d’en posséder les approches, et les Germains qui, durant plus de vingt
siècles, ont convoité la Gaule,
ce pays ne pouvait manquer d’être le champ de bataille des deux races
ennemies. C’était en Gaule que Marius avait vaincu les Teutons ; c’est là que
César allait combattre Arioviste ; là encore que les empereurs, jusqu’à la
dernière heure de l’empire, arrêteront l’invasion. La guerre qui va commencer
était une de ces fatalités historiques qui rie permettent pas aux esprits
sérieux d’inutiles regrets. Depuis l’origine de
notre empire, dit Cicéron, il n’est
personne, ayant une vue nette des conditions d’existence de notre république,
qui n’ait pensé que les Gaulois étaient pour elle le plus grand danger[7], et par
conséquent leur soumission, une nécessité pour Rome.
Nous saurons que les Romains avaient commencé depuis
soixante ans la conquête du pays transalpin et que les peuples établis de
Genève à Toulouse et de Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges avaient
reconnu l’autorité du sénat. De leurs grands établissements de Narbonne et d’Aix,
les Romains surveillaient la
Gaule chevelue. Ils avaient humilié la nation puissante des
Arvernes par la défaite de Bituit, et accordé aux Édues leur protection
intéressée[8].
Aussi la crainte ou la confiance inspirée par Rome à ces deux peuples qui
entouraient la Province
avait permis aux gouverneurs de faire impunément peser sur elle toutes les
exactions. Quand les Allobroges, à bout de patience, se soulevèrent après la
conjuration de Catilina, ils furent écrasés (61), sans qu’un seul Gaulois tirât l’épée
pour eus. L’état de la Gaule
n’était point tel, d’ailleurs, que ses peuples pussent s’abandonner aux
pensées belliqueuses. Depuis la révolution qui avait renversé les
gouvernements aristocratiques, il s’était formé deux partis dans chaque cité,
dans chaque bourg, et presque dans chaque famille. Les nouvelles républiques,
trop jeunes pour que la liberté y fût paisible, étaient livrées à tous les
orages que soulevaient des ambitions rivales ou mécontentes. Vers le temps du
consulat de César, un chef arverne avait péri sur un bûcher pour avoir voulu
rétablir la royauté proscrite[9], et, à l’heure
même, trois nobles chez les Helvètes, les Séquanes et les Édues conspiraient
la chute du gouvernement démocratique. En outre, tous ces peuples étaient
rivaux ; chaque année la guerre éclatait sur mille points[10]. Fiers de l’abaissement
des Arvernes et du titre d’alliés de Rome, les Édues avaient abusé de leur
puissance et de la crainte qu’inspiraient les légions, pour opprimer leurs
voisins. Maîtres du cours moyen de la Loire parla forte place de Nevers et de celui
de la Saône
par Mâcon et Chalon, ils avaient interdit aux Arvernes la navigation du premier
de ces fleuves et mis de lourds péages sur les denrées que les Séquanes
envoyaient par l’autre à Marseille. Poussés à bout, ces deux peuples s’étaient
unis, et, pour être plus sûrs de vaincre, avaient pris à leur solde quinze
mille Suèves avec leur chef Arioviste. Les Édues avaient été battus et
contraints de livrer des otages, mais les Séquanes n’avaient pas eu à se
réjouir longtemps de leur victoire. Sorti des forêts humides et des terres
incultes de la Germanie,
Arioviste n’avait plus voulu quitter le beau pays qu’on lui avait
imprudemment ouvert. Sous divers prétextes, il fit venir huit fois autant de
guerriers qu’il en avait promis, et il exigea pour eus un tiers du territoire
séquanais. Les Édues et les Séquanes, réunis par une commune oppression, se
levèrent ensemble contre le roi germain. Il trompa leur colère en se
réfugiant derrière des marais, lassa leur patience, puis saisit une occasion
favorable de les accabler. Leur défaite, au confluent de la Saône et de l’Oignon, le
rendit plus avide. Maintenant, il voulait un autre tiers des terres
séquanaises pour vingt-quatre mille Harudes, ses alliés.
Contre ces dominateurs de l’Est, les Gaulois implorèrent
ceux du Midi. Un des
principaux Édues, Divitiac, vint à Rome réclamer la protection tant de fois
promise à ses frères. On tarda longtemps à lui répondre. Un événement
inattendu força le sénat de donner enfin plus d’attention à ces plaintes. On apprit
que les Helvètes, fatigués des continuelles incursions des Suèves, voulaient
aller chercher sur les bords du grand Océan un climat moins rude et une vie
plus tranquille. Mais, avec leurs alliés de la rive droite du Rhin qui s’étaient
engagés à les suivre, les Helvètes formaient une masse de près de quatre cent
mille âmes[11],
et ils comptaient prendre leur route par la Province. Il y
avait pour Rome dans ce projet un double danger ; l’Helvétie abandonnée
serait occupée par les Suèves, dont le voisinage était redouté ; et, en
traversant la Gaule,
ces quatre cent mille émigrants devaient y causer des désordres dont on ne
pouvait prévoir les suites. Un de leurs chefs d’ailleurs, Orgetorix, espérait
qu’à la faveur de ces mouvements il pourrait recouvrer l’autorité royale qu’avaient
exercée ses pères. Le Séquane Castic et l’Édue Dumnorix, initiés à ses
projets, devaient le seconder et recevoir de lui l’appui nécessaire pour
opérer dans leur pays la même révolution ; puis ce triumvirat barbare aurait
soumis la Gaule
entière[12].
Les menées d’Orgétorix furent découvertes, mais la mort de ce chef ne
détourna point le peuple du plan d’émigration qu’il avait conçu. A Rome, on s’alarma
justement, car on se souvenait de la part que les Helvètes avaient prise
quarante ans auparavant à l’invasion des Cimbres. Trois sénateurs, envoyés
dans la Gaule,
apportèrent un sénatus-consulte donnant au gouverneur de la Narbonnaise des
pouvoirs illimités pour faire tout ce qu’il jugerait utile à la république et
pour protéger les alliés du peuple romain. Les Édues, gagnés par ce décret, s’engagèrent
à fermer, avec l’aide des Séquanes, les passages du mont Jura.
Les Helvètes et leurs alliés s’étaient donné trois ans
pour achever leurs préparatifs[13] ; la troisième
année tombait sous le proconsulat de César. C’était donc à lui qu’allait
revenir cette guerre, en exécution du décret sénatorial de 61. Dans cette
prévision, et pour diviser à l’avance ses ennemis, il chercha dés l’année 59
à s’attacher Arioviste, en lui faisant donner le titre d’ami du peuple
romain. Le roi barbare promit, en effet, de n’apporter aucun obstacle à l’exécution
du plan arrêté contre les Helvètes. Dans le courant de mars 55, César partit
pour la Narbonnaise,
une de ses trois provinces, et en huit jours il atteignit Genève. Les
Helvètes, afin de s’ôter toute envie de retour, venaient de brûler leurs
douze villes et leurs quatre cents bourgades ; ils s’étaient donnés
rendez-vous au bord du Rhône pour le 28 mars.

II. — PREMIÈRE CAMPAGNE DE CÉSAR
(58). VICTOIRES SUR LES HELVÈTES ET SUR ARIOVISTE.
Le Rhône, en descendant du Saint-Gothard, coule entre deux
chaînes de hautes montagnes, jusqu’au lac Léman, qu’il forme, et d’où il sort
à Genève pour aller se heurter, à quelques lieues de cette ville, contre le
Jura et un dernier contrefort des Alpes, le mont Vuache. Après une lutte dans
laquelle le fleuve a fini par triompher, il a fait brèche dans la montagne,
et il quitte la Suisse
par une gorge affreuse qui sépare la Franche-Comté de la Savoie, le pals des
Séquanes de celui des Allobroges. Pour gagner l’intérieur de la Gaule, les Helvètes m’avaient
point d’autre route, à moins de se jeter dans les gorges du Jura méridional,
difficilement praticables à une émigration de cette espèce, ou de franchir le
Rhône sur quelque point entre le Léman et les montagnes des Allobroges. Nais
César était à Genève, et il avait déjà coupé le pont de cette ville. Les
Helvètes, hésitant à s’engager dans la gorge de l’Écluse où quelques hommes
résolus pouvaient arrêter une armée, demandèrent au proconsul le passage par
les terres des Allobroges. Comme il n’avait encore qu’une légion, il remit au
13 avril à leur rendre réponse : c’était un délai de quinze jours qu’il se
donnait et dont il profita bien. Quand les députés reparurent, ils trouvèrent
que ce peu de jours lui avait suffi pour fortifier tous les points facilement
abordables de la rive gauche du fleuve, depuis le Jura jusqu’à la pointe du
Léman, sur une longueur de 27 kilomètres[14]. Des troupes
accourues de la Province
couronnaient le rempart, toutes les tentatives des barbares pour passer le
Rhône de vive force échouèrent. Il fallut reprendre la route du Jura.
Dumnorix et Castie leur firent accorder le consentement des Séquanes ; sans s’inquiéter
du refus des Édues, la horde s’achemina vers la Saône, heureuse déjà de
laisser derrière elle ces dangereux défilés.
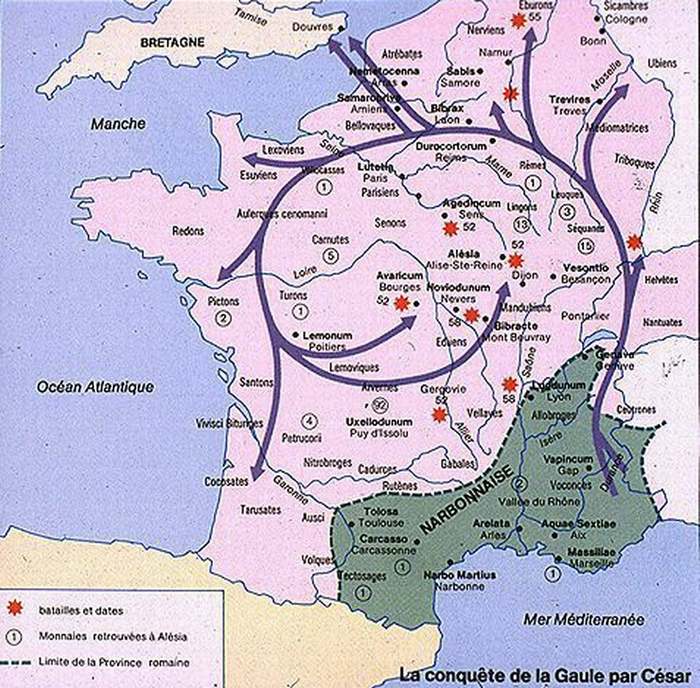
Par une habile opération qui ne lui avait pas coûté un
homme, César venait de préserver la Province d’une dangereuse invasion. Le péril était
rejeté sur les Édues ; mais César avait déjà résolu de s’autoriser du
sénatus-consulte de 61 pour sortir de sa province et secourir les alliés de
Rome[15].
La marche des Helvètes fut si lente, qu’il eut le temps d’aller
chercher en Italie cinq légions, et de retrouver les barbares encore occupés,
depuis vingt jours, à passer la
Saône que les troupes éduennes n’avaient point osé
défendre. Il s’établit probablement à Sathonay et y attendit que les trois
quarts de l’armée ennemie se trouvassent de l’autre côté du fleuve, pour
écraser l’arrière-garde, demeurée sur la rive orientale, à la hauteur de
Mâcon (juin) ;
mais, jetant en un jour toute son armée sur la rive opposée, il se trouva en
présence de la horde entière, qui remonta vers le nord. Pendant quinze jours,
il la suivit à très peu de distance sans trouver une occasion d’engager le
combat, jusqu’à ce que, les vivres lui manquant par la trahison de Dumnorix,
il résolut d’en aller prendre dans la capitale même des Édues, Bibracte (sur le mont Beuvray, à 15 kilomètres d’Autun).
Les Helvètes crurent qu’il fuyait, et se jetèrent sur son arrière-garde ;
mais ils trouvèrent toute l’armée rangée en bataille, sur les flancs dune
colline d’où partit une grêle de traits qui mit le désordre dans leurs rangs.
Les légions alors descendirent pour attaquer à l’épée, et il s’engagea un
violent combat qui dura jusqu’au milieu de la nuit avec un immense massacre
des Gaulois. Dès le commencement de l’action, César avait renvoyé son cheval,
en signe qu’il voulait partager tous les périls de ses soldats (fin de juin ou
commencement de juillet). Le reste de la horde précipita sa marche vers
le nord pour gagner le Rhin et la Germanie. Bientôt
atteints, ils livrèrent leurs armes, et, par l’ordre du proconsul, les
survivants de cette émigration désastreuse, cent dix mille hommes,
retournèrent vers leurs montagnes, que César ne voulait pas laisser occuper
par les Germains. Les Allobroges reçurent l’ordre de fournir du blé aux
débris de ce malheureux peuple, jusqu’à ce qu’il eût ensemencé ses terres.
Une peuplade alliée des Helvètes, les Boïes, resta, avec,
la permission de César, au milieu des Édues, qui l’établirent sur leur
frontière du sud-ouest (le
Beaujolais), pour la défendre contre les Arvernes. C’étaient les
descendants de ce brave peuple qui avait quitté l’Italie pour n’y pas vivre
sujet de Rome. Menacés sur les bords du Danube par les Gètes, ils s’étaient
associés à la fortune des Helvètes, et revenaient, après plus de cinq siècles,
dans leur première patrie. Ils allaient y retrouver la domination qu’ils
avaient fuie si longtemps.
La Gaule
était alors entre deux invasions : celle des Suèves, force désordonnée et
sauvage ; celle, des Romains, puissance admirablement organisée, toutes deux
redoutables pour un peuple qui ne savait pas mettre en commun ses intérêts et
son courage. Les Suèves effrayaient par leur barbarie. Chaque année, dit César, leurs guerriers vont chercher des combats et du butin. Ils
n’habitent jamais un même canton plus d’un an, vivent moins de blé que de
lait, de viande et de gibier. Leurs vêtements sont des peaux de bêtes qui
laissent à découvert la plus grande partie du corps. Ils ne veulent point qu’on
apporte chez eux du vin ou des denrées étrangères, et aiment à s’entourer de
vastes solitudes. Ces grandes terres dépeuplées leur semblent un titre de
gloire pour la nation qui a fait ces ravages : c’est une preuve que beaucoup
de peuples n’ont pu résister à leurs armes. On dit que derrière eux, à l’orient,
ils ont fait le désert sur un espace de six cent mille pas. Il n’y
a point à s’étonner que la
Gaule, n’ayant pu fermer ses portes à de tels hôtes, fût
pressée de s’en débarrasser par la main de Rome.
La guerre des Helvètes terminée, César se trouva en face d’Arioviste.
Il n’eut garde de rejeter les prières des Gaulois, quand les députés des
principales cités, réunis en assemblée générale, concilium
totius Galliæ, vinrent implorer son appui contre le roi germain ;
car ces barbares étaient bien plus inquiétants pour la province romaine que
les Helvètes ne l’avaient été. Annibal avait imposé à Rome l’obligation de
soumettre l’Espagne, d’où était parti le grand coup de la seconde guerre
Punique ; la conquête de ce pays avait contraint le sénat à s’assurer d’une
route entre les Alpes et les Pyrénées, et la sécurité de la province formée
le long de cette voie militaire exigeait que le statu quo territorial, créé en Gaule par les victoires de Fabius
et de Domitius, ne fût point changé. Tel est l’enchaînement des nécessites
historiques dont la guerre des Gaules fût la dernière et glorieuse
conséquence.
Le proconsul fit proposer une entrevue à Arioviste, qui
répondit fièrement : Si j’avais besoin de César,
je serais allé le trouver ; César a besoin de moi, qu’il vienne. Le
proconsul ayant répliqué par des menaces : Personne,
dit le barbare, ne s’est encore attaqué à moi,
qui ne s’en soit repenti. Quand César le voudra, nous mesurerons nos forces,
et il apprendra ce que sont les Germains, ces guerriers qui, depuis quatorze
ans, n’ont pas dormi sous un toit. En même temps, les Édues
annonçaient que les Harudes envahissaient leurs terres, et les Trévires, que
de nouvelles troupes, fournies par les cent cantons des Suèves, s’approchaient
du Rhin. La Germanie
tout entière s’ébranlait : il n’y avait pas un instant à perdre pour refouler
cette invasion, dont Arioviste n’était que l’avant-garde.
César se dirigea vers lui à marches forcées, dans la
direction de l’importante place de Vesontio (Besançon), dont Arioviste voulait se
saisir et où César le prévint. Il y arriva vers le commencement du mois d’août.
La description qu’il en fait prouve l’exactitude des renseignements qu’il
nous donne, car cette description peut servir encore aujourd’hui : La ville est si bien défendue par la nature, quille offre
tolite facilité pour la guerre. Le Doubs l’environne presque en entier, et l’espace
de 1600 pieds
(480 mètres) où la rivière ne passe point est occupé par une haute
montagne dard la base est baignée par les eaux. Un mur l’entoure et en fait
une citadelle qui est réunie à la ville. César s’y arrêta quelques
jours pour rassembler des vivres et prendre connaissance du pays. Ce délai
faillit lui être fatal. Ses soldats, effrayés des récits que faisaient les
habitants sur la haute taille et le courage des Germains, ne voulaient pas
avancer plus loin. Dans tout le camp, chacun faisait son testament. Les moins
effrayés montraient la difficulté des chemins, la profondeur des forêts, l’impossibilité
des transports et du ravitaillement ; on rapporta même à César que les
soldats étaient résolus à ne point obéir, quand il donnerait l’ordre de lever
les enseignes. Il convoqua un grand conseil de guerre auquel les centurions
assistèrent ; il y rappela tontes les victoires des légions sur les peuples
du Nord : celles de Marius sur les Cimbres et les Teutons, de Crassus sur les
gladiateurs, celles qu’ils venaient eux,-mêmes de gagner sur les Helvètes,
tant de fois vainqueurs des Suèves ; et il représenta Arioviste n’ayant eu l’avantage
sur les Gaulois que par des ruses impraticables avec des Romains. Quant à ceux, dit-il, qui, pour cacher leurs craintes, parlent de la difficulté
des chemins et de l’approvisionnement, ils sont bien téméraires de prétendre
prescrire au général ses devoirs ou de penser qu’il les oubliera Ce sain là
appartient et il y a pourvu. Le blé sera fourni par les Séquanes, les Lingons
(Langres) et les Leuces (Toul) ; déjà
il est mûr dans les campagnes. Quant aux chemins, ils en jugeront bientôt. On
prétend que les soldats refuseront d’obéir, il n’en croit rien, car une armée
ne devient rebelle qu’avec un chef incapable ou criminel. Pour lui, sa vie
entière atteste son intégrité, et la guerre des Helvètes, son heureuse
fortune. Aussi il avancera le départ ; dès la nuit suivante, à la quatrième
veille, le camp sera levé, car il est impatient de savoir si dans le cœur de
ses soldats la peur l’emporte sur le devoir et l’honneur. L’armée ne
devrait-elle pas le suivre, qu’il partirait avec la dixième légion seule ;
elle sera sa cohorte prétorienne. En général consommé, César n’abandonnait
aucun des droits du commandement ; tout en donnant les raisons d’agir et d’espérer,
il ne permettait pas qu’on les discutât. La dixième légion, flattée de la
confiance qu’il lui montrait, promit son absolu dévouement, et les autres,
par l’organe de leurs tribuns et centurions, protestèrent de leur soumission
aux ordres du chef qui seul avait la direction de
la guerre.
Deux routes pouvaient conduire de Besançon dans la vallée
du Rhin : l’une plus courte, mais montagneuse et boisée, par conséquent
difficile ; l’autre plus longue de 50 milles, parce qu’elle contournait ce massif
dans la direction de Besançon à Vesoul. César prit celle-ci, et, après sept
jours de marche, arriva clans la vallée du Rhin, dont jamais un Romain n’avait
touché les bords. Arioviste y campait : il demanda au proconsul une conférence
entre les deux camps. Chacun s’y rendit avec dix cavaliers, ceux de César
étaient des soldats de la dixième légion qu’il avait montés avec des chevaux
gaulois : Il dépasse ses promesses,
disaient-ils, il devait nous faire prétoriens, et
nous voilà chevaliers, equites. Arioviste reprocha au
proconsul d’être entré en ennemi sur ses terres. Cette partie de la Gaule, disait-il, était sa
province, comme le sénat avait la sienne, et il n’était pas si barbare qu’il
ne comprit que, sous le masque de l’amitié, César songeait à asservir les
Gaulois ; il ajoutait : Si tu ne t’éloignes avec
ton armée, je te traiterai en ennemi, et sache que de nombreux messagers sont
venus de la part des grands de Rome m’offrir leur amitié et leur
reconnaissance si je les débarrassais de toi[16]. Mais laisse-moi la libre possession de la Gaule, et, sans fatigue ni
danger de ta part, je me chargerai de toutes les guerres que tu voudras
entreprendre.
César n’était pas venu jusque-là pour reculer : mais
Arioviste refusa pendant plusieurs jours la bataille. C’est que les
devineresses des Suèves avaient consulté le sort en écoutant le murmure des
eaux et en étudiant les cercles qu’une pierre jetée dans le fleuve y traçait
; et le sort avait répondu : Il ne faut combattre
qu’après que la nouvelle lune aura montré son croissant d’argent. César,
à cette révélation faite par des prisonniers, n’en fut que pins pressé d’engager
l’action. Il réussit à forcer les Germains de recevoir le combat avant l’époque
heureuse fixée par leurs prophétesses. La bataille fut acharnée, mais
désastreuse pour les barbares (10 septembre). Un petit nombre seulement échappa, et parmi
eux Arioviste, qui, blessé, repassa le Rhin avec peine.
Quelques jours avant la bataille, Arioviste ayant demandé
une nouvelle conférence, César lui avait envoyé M. Mettius, un hôte du roi
barbare, et le Gaulois Valerius Procillus, dont le père avait obtenu d’un des
gouverneurs de la Narbonnaise
le titre de citoyen. Procillus parlait celte et pouvait s’entendre avec le
Germain qui comprenait cette langue. Mais, à leur entrée dans son camp, il
les traita d’espions et les fit mettre aux fers. Dans la déroute, leurs
gardiens les entraînaient, quand César, qui poursuivait l’ennemi à la tête de
sa cavalerie, les délivra. La fortune,
dit-il, n’avait pas voulu troubler, par la perte
de l’homme le plus considéré de la province, son hôte et son ami, la joie de
son triomphe. Procillus lui raconta qu’il avait vu trois fois
consulter le sort pour décider s’il serait brûlé sur l’heure ou plus tard.
Deux des femmes d’Arioviste et une de ses filles furent tuées, probablement
avec beaucoup de leurs compagnes, car elles s’étaient, comme à la bataille d’Aix,
placées sur les chariots dont les Suèves avaient couvert les deux flancs et
les derniers rangs de l’armée.
La nouvelle de cette défaite répandit la joie dans la Gaule et la douleur dans la Germanie : les Suèves s’éloignèrent
du Rhin et s’enfoncèrent dans leurs forêts. En une seule campagne César avait
terminé deux guerres formidables (58). Il alla passer l’hiver dans la Cisalpine pour y
recevoir les félicitations de ses amis de Rome et y remplir les devoirs
judiciaires de sa charge, en tenant ses assises, conventus,
dans les principales villes de la province. De là aussi, il veillait sur les
remuantes peuplades de la
Pannonie. C’étaient d’autres Celtes qui, au bruit des
combats gaulois et des victoires des Gètes leurs voisins sur les Grecs d’Olbia
et de la côte de Thrace[17], pouvaient être
tentés de reprendre la route de l’Adriatique où ils auraient trouvé les ossements
des légions exterminées par leurs pères. D’habiles négociations, dont il ne
reste qu’une trace à demi effacée, retinrent les Pannoniens dans l’alliance
de Rome, et César, n’ayant rien à craindre pour ses provinces orientales,
pourra les dégarnir et porter toutes ses forces en Gaule[18].

III. — SECONDE CAMPAGNE, OPÉRATIONS
CONTRE LES BELGES (57).
La défaite d’Arioviste axait délivré les Édues et les
Séquanes de la servitude ; mais une partie de leurs clients, au lieu de
rentrer sous leur protection, avaient réclamé celle des Rèmes, peuple
puissant de la Belgique,
et César n’avait pas empêché cette défection. Puis, au lieu de regagner l’Italie,
les légions avaient pris des quartiers d’hiver sur leur territoire, et il
semblait que la vallée de la
Saône fût déjà, comme celle du Rhône, une province romaine.
Le mécontentement succéda à l’enthousiasme : on craignit de n’avoir fait que
changer de maître ; le peuple s’indignait d’un mot de César, qui voulait,
assurait-on, rétablir la royauté, et les ambitieux se disaient qu’il faudrait
compter non plus avec leurs adversaires, mais avec Rome. Une guerre nouvelle
détourna pour quelque temps ces craintes.
Les Belges s’étaient réunis en assemblée générale, et
avaient voté une levée en masse : deux cent quatre-vingt-seize mille hommes
devaient être prêts au printemps sous les ordres de Galba, chef de guerre des
Suessions et des Bellovaques. Averti de ces mouvements par les lettres de son
lieutenant Labienus, César enrôla en Italie deux nouvelles légions, les
dirigea sur la Belgique,
et, dès que la campagne put s’ouvrir, arriva lui-même sur la frontière. Il
avait de longue main préparé les Rèmes à jouer dans le Nord le rôle de
Marseille dans le Midi,
et celui des Édues au Centre, c’est-à-dire à lui ouvrir le pays, à guider sa
marche, à préparer les défections. Ils s’en acquittèrent avec un honteux
dévouement. Iccius et Antebrogius, deux des principaux chefs, vinrent lui
dire que leur peuple se mettait sous la foi du peuple romain, qu’il ferait
tout ce qui lui serait ordonné ; qu’il livrerait des otages, ses places et
des vivres. César demanda que le sénat tout entier se rendit près de lui et
que les enfants des plus nobles familles lui fussent remis.
Ce fut sur le territoire des Rèmes, aux environs de Bibrax
(Vieux-Laon),
qu’il rencontra les Belges. Il hésita quelque temps à mettre ses huit
légions, soixante mille hommes, aux prises avec près de trois cent mille
barbares renommés comme les plus braves de la Gaule. Pour les
diviser, il fit partir secrètement Divitiac et l’armée éduenne avec mission
de dévaster sur les derrières des confédérés le pays des Bellovaques, tandis
que lui-même prenait les précautions nécessaires en si lointains pays. Il fit
à Berry-au-Bac une forte tête de pont, où il plaça, sous le commandement de Titurius
Sabinus, six cohortes qui devaient lui donner sécurité pour ses convois et
pour sa retraite ; puis il occupa avec ses légions, sur la rive droite de l’Aisne,
dans un camp fortement retranché, une colline dont les approches étaient
défendues par le ruisseau marécageux de la Miette. De là il
pouvait étudier sans péril leur manière de combattre et familiariser ses
troupes avec leur aspect.
Cette prudence augmenta la confiance des barbares. Ils
essayèrent d’enlever Bibrax que défendait le Rémois Iccius ; un renfort
envoyé à propos par César les obligea de se retirer après une attaque
furieuse. Les Romains se refusant à traverser le terrain marécageux, les
Belges se décidèrent à tourner la position en passant l’Aisne plus bas.
César, averti par ses éclaireurs, envoya contre eux sa cavalerie, qui les
chargea jusque dans le lit du fleuve, et en fit un grand carnage. Ce double
échec mit le désordre dans leur armée. La nouvelle de l’attaque de Divitiac
acheva de la dissoudre. Les Bellovaques, au nombre de soixante mille, ayant
couru à la défense de leurs foyers, les autres peuples suivirent ce fatal
exemple, et César n’eut qu’à lancer ses cavaliers pour changer cette retraite
en une fuite désordonnée. Pendant tout un jour les Romains tuèrent sans péril
pour eux-mêmes (57)[19].
La coalition dissoute, il en fallait dompter les peuples l’un
après l’autre ; c’était plus facile, mais plus long. César y mit toute son
activité. Dès le lendemain il marcha contre les Suessions, assiégea leur
capitale, Noviodunum (Soissons) ; et les
barbares, effrayés de l’approche rapide des vineæ,
ou galeries couvertes, et de l’aspect menaçant des machines, capitulèrent.
Leur roi Galba, sauvé par les prières des Dèmes, livra ses fils en otage. De
là le proconsul passa sur les terres des Bellovaques (Beauvais). La terreur le précédait ;
devant leur plus forte place, Bratuspantium
(Breteuil), il
ne trouva que des vieillards et des femmes ; les chefs s’étaient enfuis dans
l’île de Bretagne. Sa générosité politique accorda aux prières de l’Éduen
Divitiac le pardon des Bellovaques, comme il avait accordé celui des Suessions
aux sollicitations des Rèmes. Les Ambiens (Amiens) se hâtèrent de livrer des otages.
La moitié de la Belgique était soumise ; la Marne, l’Aisne, la Somme, traversées, et l’armée
romaine n’avait pas encore couru de dangers sérieux. Mais ils allaient
commencer. César voulait pénétrer dans le pays sauvage des Verves (Hainaut). D’immenses
marais, des forêts où l’on n’avançait qu’en s’ouvrant un chemin avec la
hache, des haies formées de jeunes arbres recourbés, dont les branches
dirigées horizontalement étaient entrelacées de ronces et d’épines,
couvraient le territoire de ce peuple qui reniait le nom de Gaulois pour se
vanter de son origine germanique. Ils n’avaient point de villes, chassaient
les marchands et s’interdisaient l’usage du vin et de tout ce qui leur
paraissait devoir énerver les âmes. Réunis aux Atrébates (Arras) et aux Viromandues
(habitants du
Vermandois, Saint-Quentin), ils attendirent les Romains derrière la Sambre (aux environs de Maubeuge[20]). Dans l’ordre de
marche, chaque légion était suivie de ses bagages, et toute l’armée formait
une longue colonne qu’au milieu de ces forêts il était aisé de couper.
Avertis par des déserteurs gaulois, les Nerves se disposèrent à surprendre
les légions l’une après l’autre, et ils attendirent, cachés dans un bois, que
la première se montrât. Mais, au voisinage de l’ennemi, César avait changé
ses dispositions. Six légions marchaient ensemble, et les deux dernières,
composées de nouvelles levées, gardaient les bagages réunis en un seul
convoi. Dés que l’armée parut sur la colline et eut commencé les premiers
travaux du camp, les Nerves s’élancèrent et franchirent la Sambre, qui en cet
endroit était partout guéable. Leur attaque fut si impétueuse, que les chefs n’eurent pas le temps de revêtir leurs insignes,
les soldats de mettre les casques et d’ôter l’enveloppe des boucliers. Chaque
légionnaire, en accourant des travaux, se plaça au hasard près du premier
drapeau qu’il aperçut, afin de ne pas perdre à chercher le sien le temps de
la bataille.
Malgré les haies qui coupaient le terrain et qui
empochaient les légions de se voir et de combiner leurs mouvements, les
Atrébates, à l’aile droite de l’armée nervienne, furent précipités dans la Sambre ; les Viromandues,
qui tenaient le centre, furent acculés au fleuve, mais, tandis qu’ils y
faisaient une résistance désespérée, les Nerves, à l’aile gauche,
gravissaient et tournaient la colline. De ce côté, le camp à peine ébauché
fut pris ; les légions étaient coupées, et tous les centurions de la douzième
légion tués ou mis hors de combat. Les troupes légères, les auxiliaires,
fuyaient, même les Trévires, les plus braves des cavaliers de la Gaule, qui prirent la
route de leur cité en répandant par tout le bruit que les Romains étaient vaincus
et leurs bagages enlevés. César lui-même croit la bataille perdue ;
saisissant un bouclier, il se jette en avant, reforme la ligne, et combat
comme un soldat. Les siens, entraînés par son exemple, font reculer de
quelques pas les troupes nerviennes. Il profite de l’espace que lui donne ce
vigoureux effort, pour étendre ses cohortes trop serrées et rapprocher peu à
peu les légions, qui s’appuient les unes aux autres. Le combat se rétablit
avec plus d’ordre ; la discipline, la tactique, reprennent leurs avantages ;
l’arrière-garde a le temps d’accourir, et Labienus, qui poursuivait les
Atrébates, envoie au secours du proconsul sa dixième légion. Une partie de l’armée
nervienne se fit tuer. De nos six cents sénateurs,
disaient les vieillards à César, il en reste
trois ; de soixante mille combattants, cinq cents ont échappé[21].
De si vaillants ennemis inspirèrent de l’estime à leur
vainqueur. On ne doit pas s’étonner,
dit-il, que des hommes si intrépides aient osé
franchir une large rivière, gravir ses bords escarpés et combattre dans le
lieu le plus défavorable. La grandeur de leur courage leur rendait facile la
plus difficile entreprise[22].
La bataille de la Sambre[23] fut une des
journées où César combattit pour la vie ; elle mit la Belgique à ses pieds.
Les Atuatiques seuls étaient encore en armes. Ils descendaient des Cimbres
qui, près d’un demi-siècle auparavant, avaient envahi la Gaule. Six mille de
ces barbares laissés sur le bord du Rhin à la garde des gros bagages de la
horde y avaient fait, souche de peuple et s’étaient fixés vers le confluent
de la Sambre
et de la Meuse,
où d’autres Germains étaient sans doute venus les rejoindre. Ils avaient
promis leur assistance aux Nerviens, la nouvelle du désastre leur fit rebrousser
chemin. Certains d’être attaqués bientôt, ils abandonnèrent leurs bourgades
et se réfugièrent, avec tout ce qu’ils possédaient, dans la plus forte de
leurs places. C’était un massif de roches escarpées que couronnait un plateau
auquel on arrivait par une rampe en pente douce, large de 200 pieds, mais coupé
par un fossé et par un double mur formé d’énormes pierres. S’il faut placer
cet oppidum au confluent de la Sambre et de la Meuse, sur la montagne qui
pose la citadelle de Namur, il se trouvait encore défendu de deux côtés par
ces rivières[24].
À l’approche des légions, les Atuatiques coururent
bravement au-devant d’elles et engagèrent de petits combats qui n’empêchèrent
pas les travaux de César. En peu de temps, une contrevallation, haute de 12 pieds, longue de 15
milles et garnie de forts, arrêta les sorties, puis les Romains formèrent une
terrasse, fabriquèrent des mantelets et construisirent, hors de la portée du
trait, une tour dont l’étage supérieur devait dominer le rempart. En la voyant, les assiégés riaient et se moquaient du haut
de leurs murailles, nous demandant ce que nous prétendions faire d’une si
lourde machine et comment des nains tels que nous pourraient la faire
mouvoir. Mais, quand ils la virent s’approcher de leurs murs, ils furent frappés
d’effroi et consentirent à livrer leurs armes. Ils en jetèrent dans les
fossés de la place une telle quantité, qu’il s’en amoncela aussi haut que les
murs. Mais ils en avaient encore gardé : la nuit suivante, croyant surprendre
le camp romain, ils l’attaquèrent. Des signaux de feu donnèrent l’éveil ; on
accourut de toutes parts vers le point attaqué[25] : quatre mille Atuatiques tombèrent au pied du
retranchement ; tout le reste, au nombre de cinquante-trois mille, fut, le
lendemain, vendu aux marchands d’esclaves qui suivaient l’armée. Ces
descendants des Cimbres avaient le sort de leurs pères[26].
Pendant les derniers combats, le jeune Crassus, qui s’était
distingué à la bataille contre Arioviste, avait été détaché avec une légion
pour parcourir le pays compris entre la Seine et la Loire. Il n’avait pas
rencontré de résistance : tous les peuples de cette région, sous l’impression
des retentissantes victoires de César, et sans préparatifs de guerre, s’étaient
résignés à reconnaître la souveraineté de Rome et à livrer des otages. Cette
expédition n’avait donc été qu’une promenade militaire.
Dès la seconde campagne (57), la Gaule semblait soumise, et plusieurs peuplades
germaniques de la rive droite du Rhin envoyaient au vainqueur d’humbles
députations. César laissa cependant sept légions en quartiers d’hiver au nord
de la Loire
chez les Carnutes, les Andes et les Turons, pour surveiller les peuples qui
venaient de voir les armes romaines, mais n’en avaient pas senti le poids ;
la huitième, sous le lieutenant Galba, revint avec une partie de la cavalerie
chez les Véragres, dans le Valais, et reçut l’ordre d’ouvrir à travers le
grand et le petit Saint-Bernard, par où déjà les marchands italiens
passaient, des routes faciles et courtes, entre la Celtique et l’Italie.
Pour César, il allait employer l’hiver à régler les affaires de la Cisalpine, de l’Illyrie
et de sa troisième province, la Narbonnaise, où les Pyrénées ont gardé de lui
un souvenir, la source de Vieux-César à Cauterets[27].

IV — TROISIÈME CAMPAGNE. GUERRE D’ARMORIQUE
ET D’AQUITAINE (56).
César était en Illyrie, quand il apprit que la légion de
Galba, attaquée par les montagnards, avait failli être détruite, et que toute
l’Armorique était soulevée. Crassus manquant de blé en avait demandé aux
peuples voisins de ses campements ; ceux-ci avaient mis aux fers ses envoyés,
des chevaliers romains, et avaient déclaré qu’ils ne les rendraient que si, à
son tour, il rendait les otages. C’était une violation du droit des gens que
ces barbares mêmes reconnaissaient, et elle explique, salis la justifier, la
cruauté que le Romain allait montrer. Ceux qui venaient de faire ce pas hardi
employèrent l’hiver à former une vaste confédération qui comprit presque tous
les peuples du littoral, de la
Loire à l’Escaut ; ils demandèrent des secours jusque dans
l’île des Bretons. César était prêt pour cette guerre, car il avait étudié d’avance
le pays et les hommes qu’il allait avoir à combattre. Aussitôt ses
instructions partirent. Il fallait saisir tous les navires gaulois qu’on pourrait
trouver, en construire d’autres, lever des rameurs dans la Narbonnaise, engager
des pilotes ; puis, tandis que Decimus Junius Brutus, fils adoptif de
Postumius Albinus, réunirait la flotte à l’embouchure de la Loire, sans doute à
Corbilo (Saint-Nazaire),
Crassus battrait le pays au sud de ce fleuve jusqu’à la Garonne. Labienus
avec toute la cavalerie légionnaire, inutile dans une guerre maritime,
parcourrait la Belgique
pour la contenir et arrêter les Germains, qu’on disait disposés à passer le
Rhin ; enfin Titurius Sabinus, à la tête de très légions, châtierait les
peuples établis entre les bouches de la Seine et celles de la Bancs Ses deux ailes
et ses derrières ainsi couverts, César attaquerait lui-même de front la plus
puissante nation de l’Armorique, les Vénètes.
Cette guerre devait être difficile par la nature du pays
coupé de baies profondes et de presqu’îles rocheuses, plus encore par le
courage des habitants, qui défendaient pied à pied un terrain hérissé de
forteresses que le flux rendait inabordables aux gens de pied, le reflux aux
vaisseaux[28].
On ne pouvait, dit César, les assiéger aisément. Si, après de pénibles travaux, on
parvenait à contenir la mer par des digues et à élever une terrasse jusqu’à
la hauteur des murs, les assiégés, lorsqu’ils désespéraient de leur fortune,
rassemblaient leurs nombreux navires, y transportaient tous leurs biens, et
se retiraient en d’autres villes où la nature leur offrait les mêmes moyens
de défense. Ils pratiquèrent cette manœuvre durant une grande partie de l’été,
d’autant plus aisément que notre flotte était retenue par les vents
contraires, et d’ailleurs naviguait avec difficulté sur une mer
perpétuellement agitée par de hautes marées.
Les vaisseaux des Vénètes
étaient construits et armés de manière à lutter contre tous les obstacles que
ces mers présentent. Ils ont la carène plus plate que les nôtres ; aussi
redoutent-ils moins les bas-fonds. Leurs proues sont très élevées, et le
corps du navire, tout de chêne, peut soutenir le choc, le plus rude des vagues.
On y voit des poutres d’un pied d’équarrissage, attachées par des clous de
fer de la grosseur d’un pouce. Les ancres sont retenues, non par des
cordages, mais par des chaînes de fer ; au lieu de toiles de lin, comme sur
nos bâtiments, ils ont pour voiles des peaux apprêtées, estimant qu’elles
résisteront mieux aux efforts des vents impétueux de l’Océan. Dans l’action,
notre seul avantage était de les surpasser en agilité. Nos éperons ne
pouvaient entamer ces masses solides, et la hauteur de leur muraille
au-dessus de l’eau les mettait à l’abri de nos traits. Le vent venait-il à s’élever,
ils s’abandonnaient à la tempête, et couraient sans péril sur les bas-fonds,
ou nos galères, tirant plus d’eau, se seraient brisées.
Quand la flotte romaine parut, les Vénètes allèrent à sa
rencontre avec deux cent vingt navires fournis par eux-mêmes ou par leurs
alliés. Les Romains furent quelque temps inquiets : les éperons étaient
inutiles, et les tours placées sur les galères n’atteignaient même pas la
poupe des vaisseaux ennemis, de sorte que les traits, lancés d’en bas,
restaient sans effet, tandis que les Gaulois ne perdaient pas un coup. L’instinct
militaire des Romains leur fit trouver contre les Vénètes, comme à Myles
contre les Carthaginois, un engin nouveau et une nouvelle tactique. On
imagina d’adapter à de longues perches des faux extrêmement tranchantes, avec
lesquelles on parvint à couper les cordages qui attachaient les vergues aux
mâts. Celles-ci tombant, le vaisseau restait immobile ; deux ou trois galères
l’entouraient alors, les légionnaires montaient à l’abordage, comme à un
assaut, avec une aide r extrême, car on combattait sous les yeux de César et
de l’armée rangée sur les collines du rivage. Les Gaulois perdirent ainsi une
partie de leurs navires, et, effrayés de cette manœuvre, ils allaient
chercher leur salut dans la fuite, lorsque soudainement le vent tomba. Ils n’avaient
point de rances, et ne pouvaient suppléer aux voiles. Leurs vaisseaux furent
pris l’un après l’autre ; un bien petit nombre regagna la terre à la faveur
de la nuit. Ce combat, qui avait duré depuis dix heures du matin jusqu’au
coucher du soleil, est le premier que l’histoire connaisse sur l’atlantique ;
il ouvre dignement la liste des tristes mais glorieuses rencontres qui devaient
tant de fois se renouveler en vue de ces rivages. Les Vénètes avaient perdu l’élite
de leur nation, ils demandèrent la paix : elle fut cruelle ; tout leur sénat
périt dans les supplices, le reste de la population ou du moins ce qu’on put
en prendre fut vendu. Ce vaillant peuple eût mérité que son nom restât au
pays qu’il avait si bien détendu.
César faisait la guerre suivant sa nature, qui était
borine, mais aussi selon les usages anciens, qui étaient cruels, de sorte qu’on
le voit clément avec les uns, inexorable avec les autres. Les Vénètes, comme
les Atuatiques, attaqués contre tout droit, s’étaient vengés par une perfidie
; leur châtiment fut pareil. Mais deux peuples braves périssaient pour avoir
défendu leur indépendance contre un empire qu’ils ne menaçaient pas et dont
le nom était à peine parvenu jusqu’à eux !
Durant ces opérations, le roi des Unelles (Cotentin), Viridovix,
soulevait les Aulerques éburovices (Évreux) et les Lexoves (pays d’Auge et Lieuvin), qui, en gage de
leur foi, massacrèrent leur sénat partisan de la paix ; en peu de temps, il
réunit une nombreuse armée contre Sabinus. Le légat avait choisi l’emplacement
de son camp avec l’habileté ordinaire aux Romains[29] ; il s’y tenait
enfermé et affectait la crainte pour inspirer une confiance, présomptueuse.
Un jour, un transfuge vint dire aux Gaulois que César, enveloppé par les
Vénètes, appelait Sabinus à son secours, et que, la nuit suivante, les
légions devaient se mettre en route. On craint qu’elles ne s’échappent ; on
force Viridovix à commander l’attaque, et toute l’armée court au camp,
chargée de sarments et de broussailles pour combler le fossé. Le transfuge était
un agent romain. En prévision de cette attaque, Sabinus tenait ses légions
derrière le rempart, armées et prêtes. Les Gaulois, qui pour atteindre à la hauteur
occupée par l’ennemi avaient à parcourir une pente douce, mais longue de 1000
pas, arrivaient en désordre et hors d’haleine, quand les portes du camp s’ouvrirent
devant une troupe aux rangs serrés qui se précipita sur les assaillants et,
du premier choc, les culbuta. Un grand nombre périrent ; la cavalerie acheva
les fuyards, et les Gaulois, aussi prompts à
laisser tomber leurs armes qu’à les prendre, faute de constance dans les
revers, se remirent à la discrétion du légat.
Au sud, Crassus avait reçu dans l’alliance romaine les
Pictons et les Santons, jaloux de la supériorité maritime des Vénètes, et il
avait pénétré sans obstacle jusqu’à la Garonne, franchi ce fleuve et pris la
principale ville des Sotiotes, Sos (au nord d’Eauze). Quand cette place capitula, Adietuanus, qui
y commandait, refusa pour lui-même le traité et se jeta sur le camp romain.
Pas un de ses dévoués, au nombre de six cents, n’hésita à le suivre
dans cette lutte désespérée, où pourtant il ne périt pas : Crassus consentit
à le comprendre au traité. En pénétrant plus avant dans le pays, Crassus
trouva des adversaires plus redoutables. Cinquante mille hommes que guidaient
des officiers espagnols formés à l’école de Sertorius lui opposèrent, au lieu
de la fougue inconsidérée des barbares, une tactique toute romaine : des
reconnaissances de cavalerie pour s’éclairer sur les mouvements de l’ennemi,
un camp fortement retranché, et, derrière ces retranchements, une grande
armée qui refusait d’en sortir, afin de s’y faire attaquer, mais qui envoyait
de nombreux partis inquiéter la marche des douze cohortes de Crassus et
enlever ses convois. Il aurait voulu les amener à combattre en rase campagne
; n’y ayant pas réussi, il dirigea contre le camp une attaque qui aurait
échoué, si quatre de ses cohortes, arrivant par un long circuit sur les
derrières mal fortifiés de la position, n’y étaient entrées à l’improviste. À
leurs cris, à leur vue, les combattants jettent leurs armes, l’autre face du
camp est emportée et les Romains font encore un affreux carnage.
Par l’ensemble de ces opérations si bien calculées, l’Armorique
avait été domptée, presque toute l’Aquitaine soumise, et dans la Belgique personne n’avait
bougé. Les Morins seuls et les Ménapes n’avaient point envoyé de députés au
proconsul pour lui promettre la paix : César alla les chercher au fond de
leurs forêts et de leurs marécages, mais sans pouvoir les atteindre. La Gaule, des Pyrénées à la
mer du Nord, avait été parcourue, cette année, par les légions victorieuses.
Durant ces trois campagnes, César avait fait une autre
conquête, celle de son armée, qui, le voyant payer de sa personne dans les
marches et dans les combats, s’était éprise d’un chef toujours heureux dont
le commandement était à la fois ferme et doux. Sévère sur la discipline, très
exigeant à l’égard des exercices et des travaux, il ne demandait rien d’inutile
et fermait les yeux sur les fautes légères. Mais pas un trait de bravoure ne
lui échappait : ils étaient aussitôt récompensés par de publics éloges, de
riches armures et de l’or. II aimait le luxe dans les armes de ses soldats,
dans leur costume, et il encourageait leurs plaisirs. Qu’importe qu’ils se parfument, disait-il, pourvu qu’ils se battent bien[30].
A leur tête, il plaçait, à côté de vétérans expérimentés,
de jeunes nobles, désireux de servir si près de l’Italie, sous un général
qui, à chaque courrier, envoyait à Rome l’annonce d’une victoire et dont la
tente, durant l’hivernage ou entre deux expéditions, ressemblait à quelque
somptueuse villa de la voie Latine par le luxe de l’ameublement[31] et des festins.
Ils y retrouvaient toute la vie romaine : l’élégance du maître, qui
commandait celle de ses hôtes, les causeries tour à tour spirituelles et
sérieuses, engagées au sujet d’une question littéraire[32] ou à propos des
lettres arrivées le matin de la
Ville, avec des vers de Catulle et le récit des trop
galants exploits de sa Lesbie, la fameuse Clodia quadrantaria
(?). Cette
brillante jeunesse, à qui César donnait tout ce que cherche la jeunesse, de
la gloire et du plaisir, racontait à son tour aux amis, restés sous les
ombrages de Tibur, ces marches prodigieuses, ces expéditions en des pays
inconnus, ces victoires sur terre et sur mer, qui mettaient fin à la plus
grande terreur de la république.
Cicéron était l’écho retentissant de ces merveilles
gauloises. Contre la haine de Clodius, la froideur de Pompée, l’indifférence
des nobles, il avait senti le besoin de s’appuyer sur César, et il était allé
à lui avec l’ardeur du voyageur qui s’étant levé
trop tard doit redoubler de vitesse pour arriver avant les autres[33]. — Quels prodigieux événements ! s’écriait-il.
C’était l’opinion des sages, depuis l’origine de
notre empire, que les Gaulois étaient nos plus terribles ennemis. Au lieu de
les provoquer, nos généraux ont cru faire assez pour notre gloire en
repoussant leurs attaques. Cette guerre redoutable, César l’a portée au cœur
de la Gaule ;
ces nations dont le nom n’était jamais venu jusqu’à nous, il les a réduites
en notre obéissance. Nous n’avions qu’un sentier en Gaule ; aujourd’hui les
limites de ces peuples sont les frontières de notre domination. Ce n’est pas
sans un bienfait des dieux que la nature avait donné à l’Italie les Alpes
pour rempart. Que ces montagnes s’abaissent maintenant : des Alpes à l’Océan,
il n’est plus rien à redouter pour l’Italie[34].

V. — QUATRIÈME CAMPAGNE.
EXPÉDITIONS DE GERMANIE ET DE BRETAGNE (55).
Tout n’était pas encore fini, comme le croyait Cicéron. a
Dans l’hiver qui suivit, les Usipètes et les Tenctères passèrent le Rhin non
loin de l’endroit où il se jette dans la mer. La cause de cette émigration
était que les Suèves, depuis plusieurs années, leur faisaient une guerre
acharnée, qui les empêchait de cultiver leurs champs. Les Suèves sont la plus
puissante et la plus belliqueuse nation de toute la Germanie. On dit qu’ils
forment cent cantons, de chacun desquels ils font sortir chaque année mille
hommes armés qui portent la guerre au dehors. Ceux qui restent dans le pays
le cultivent pour eux-mêmes et pour les absents, et, à leur tour, ils s’arment
l’année suivante, tandis que les premiers séjournent dans leurs demeures.
Ainsi ni l’agriculture ni l’habitude de la guerre ne sont interrompues. Mais
nul d’entre eux ne possède de terre en propre et ne peut demeurer plus d’un an
dans le même lieu. Ils consomment peu de blé, vivent en grande partie du
produit de leur chasse, du lait et de la chair de leurs troupeaux. Ce genre
de vie, leurs exercices journaliers et la liberté dont ils jouissent dès l’enfance,
en font des hommes robustes et d’une taille gigantesque. Malgré la rigueur de
leur climat, ils se baignent toute l’année dans leurs fleuves.
Aux marchands qui pénètrent en
leur pays ils vendent ce qu’ils ont pris à la guerre et ils ne leur achètent
rien, pas même ces chevaux que les Gaulois aiment tant et payent si cher.
Ceux des Germains sont mauvais et disgracieux, mais, en les exerçant tous les
jours, ils les rendent infatigables. Dans les engagements de cavalerie, ils
sautent souvent à terre pour combattre à pied ; et, comme Ies chevaux sont
dressés à rester à la même place, ils les rejoignent promptement si le cas le
requiert. Se servir de selle leur parait une mollesse honteuse, et, en
quelque nombre qu’ils soient, ils ne craignent pas d’attaquer de gros corps
de cavalerie.
A l’ouest, ils sont voisins
des Ubiens, peuple autrefois florissant, autant qu’on peut le dire des
Germains, et plus civilisé, parce que, touchant au Rhin, il a de nombreux
rapports avec les marchands et les Gaulois. Les Suèves l’ont souvent attaqué,
sans pouvoir lui enlever ses terres, mais ils l’ont rendu tributaire et
réduit à un grand état de faiblesse.
Les Usipètes et les Tenctères
frirent aussi exposés à l’attaque des Suèves. Après leur avoir résisté
longtemps, chassés à la fin de leur domaine, ils errèrent trois ans à travers
plusieurs cantons de la
Germanie et arrivèrent près du Rhin, en des pays habités
par les Ménapes, qui possédaient, des deux côtés du fleuve, des champs, des
maisons et des bourgs. Effrayés à l’approche d’une telle multitude, les
Ménapes abandonnèrent la rive droite et se fortifièrent sur la rive gauche,
pour s’opposer au passage des Germains. Ceux-ci essayèrent de franchir le
fleuve de vive force, puis à la dérobée ; n’y ayant pas réussi, ils
feignirent de rentrer dans leur pays, et, au bout de trois jours, revenus sur
leurs pas, ils attaquèrent à l’improviste les Ménapes, dont ils enlevèrent
les bateaux qui leur servirent à traverser le Rhin.
Au bruit de cette invasion qui rappelait celle des
Helvètes, César, malgré les neiges, repassa précipitamment les Alpes, et
convoqua près de lui les principaux personnages de la Gaule, dont plusieurs
étaient d’intelligence avec l’ennemi ; il les flatta et en obtint de la
cavalerie ; puis il marcha vers le Rhin avec toutes ses forces. Les Germains
lui envoyèrent des députés qui renouvelèrent les demandes des Teutons à
Marius : Donnez-nous des terres, et nous vous
donnerons notre amitié. César, qui dès le premier jour s’était présenté
comme le protecteur de la
Gaule contre les invasions germaniques, ne pouvait accepter
ces conditions. Il leur accorda une trêve de trois jours, mais, dès le
lendemain, ils la rompirent en surprenant les cavaliers gaulois, qui
perdirent soixante-quatorze hommes. Dans ce combat périt un Aquitain dont l’aïeul
avait été le chef de son peuple et à qui le sénat avait décerné le titre d’Ami
du peuple romain ; son frère, en voulant le sauver, tomba avec lui. César fit
aussitôt avancer ses troupes en ordre de bataille ; les barbares, intimidés,
lui envoyèrent leurs chefs et leurs vieillards pour se justifier de l’attaque
de la veille. Le proconsul, se croyant autorisé par cette trahison à ne pas
respecter en eux le caractère d’ambassadeurs, les fit arrêter, puis attaqua ;
la horde, acculée sur la langue de terre qu’enveloppent à leur confluent le
Rhin et la lieuse, périt presque entière. Au compte de César, qui, souvent
comme Sylla, exagère le chiffre de ses ennemis et diminue celui de ses
pertes, ils étaient, hommes, femmes et enfants, au nombre de quatre cent
trente mille. Caton voulait qu’on livrât aux Germains le général parjure ; le
sénat vota de nouvelles actions de grâces aux dieux.
Les chefs arrêtés avant la bataille furent relâchés. Mais
où aller ? Leur peuple n’existait plus, et les Gaulois n’auraient que du
mépris pour ces vaincus ; ils demandèrent à rester dans le camp romain. Que
de meurtres, que de misères pour faire un victorieux !
Cependant César s’effraya de ces secours imprévus qui
arrivaient aux Gaulois des pays voisins. L’année précédente, les Armoricains
avaient reçu de la Bretagne
des soldats et des navires ; cette fois, l’invasion des Usipètes avait
réveillé les espérances de tous les peuples récemment vaincus. Il comprit
que, pour n’être pas troublé dans sa conquête, il lui fallait isoler la Gaule de la Bretagne et de la Germanie, rompre les
relations de file avec le continent et porter sur la rive droite du Rhin la
terreur du nom de Rome. En dix jours, avec cette prodigieuse activité qu’un
autre général, Bonaparte, a seul égalée, il construisit un pont de pilotis
sur le Rhin (vers
Bonn ?)[35]
; puis franchit le fleuve et effraya les tribus voisines, sans toutefois
livrer de sérieux combats. Les Suèves, à la seule nouvelle de son entreprise,
s’étaient enfoncés dans leurs forêts. Après dix-huit jours passés en Germanie,
comme la saison s’avançait et qu’il voulait, cette année même, faire une
descente en Bretagne, il ramena ses légions derrière le Rhin, rompit le pont
et gagna le pays des Morins, sur le détroit (Boulonnais).
Cette expédition n’avait pas ajouté un police de terre au
domaine de la république, mais César l’avait faite moins pour Rome que pour la Gaule. Son but était
atteint, car il avait mené ses auxiliaires gaulois fourrager à leur tour au
pays des Suèves. Et puis, même au bord du Tibre, que d’acclamations à la
nouvelle que le fleuve mystérieux et redouté avait porté un pont romain et vu
passer les enseignes des légions !
César se proposait de donner aux Romains un autre sujet d’étonnement
et d’orgueil par une campagne faite aux derniers
confins du monde.
La
Bretagne, peuplée des mêmes nations que la Gaule, entretenait avec
elle de fréquentes relations. C’était 1à que se trouvait le sanctuaire des
druides, l’île de Mona, où de pieux pèlerinages amenaient du continent tous
ceux qui voulaient arriver aux derniers degrés du savoir et de l’initiation
religieuse.
De bonnes relations avec ces peuples eussent été un gage
de sécurité pour la domination romaine en Gaule. Aussi César avait-il, depuis
quelque temps, cherché à ouvrir des négociations avec les Bretons, qui
avaient paru s’y prêter et lui avaient fait porter en Gaule des propositions
de paix. Mais, comme le roi des Atrébates, chargé par lui d’aller dans l’île
en arrêter les conditions, avait été mis aux fers, il importait à César de
venger cette injure, qui aurait affaibli son autorité parmi les nations
gauloises si elle était restée impunie, et la nouvelle campagne avait été
résolue[36].
Il envola un de ses officiers, Volusenus, faire, sur une galère, le relevé de
la côte bretonne opposée au littoral de la Morinie. Cet
officier n’osa ou ne put descendre à terre et revint au bout de cinq jours.
Sur les renseignements qu’il donna, César partit dans la nuit du 24 au 25
août, avec deux légions embarquées sur quatre-vingts navires de transport et
quelques galères qu’il avait réunies à Wissant ou dans la Liane[37]. Elles n’avaient
que fort peu de bagages ; lui-même n’emmena que bois serviteurs Le lendemain
matin, il était en vue des falaises de Douvres, dont les Bretons, prévenus
par leurs amis gaulois, couronnaient la crête Le débarquement était
impossible en ce lieu dominé par les hauteurs que l’ennemi occupait ; il
attendit à l’ancre le retour de la marée et remonta avec elle vers le nord,
pour trouver, à l’extrémité des falaises, la plage unie de Deal. Les Bretons,
qui suivaient de la côte tous les mouvements de la flotte, y étaient déjà
accourus. Aussi, malgré la protection des machines qui du haut des navires
lançaient une grêle de traits, le débarquement fut difficile. Le
porte-enseigne de la dixième légion se jeta à la mer pour entraîner ses
camarades, et il y eut un combat au milieu des flots. Quand les légionnaires
eurent atteint la terre ferme, une charge furieuse dispersa les barbares.
César raconte qu’un de ses soldats, Cœsius Scæva, et
quatre autres légionnaires avaient gagné sur une barque un rocher à fleur d’eau,
que la mer entourait, et de là lançaient à l’ennemi des traits qui tous
portaient. Quand le reflux rendit guéable l’espace qui séparait ce roc de la
terre ferme, les quatre légionnaires reprirent leur barque où Scæva refusa de
descendre Aussitôt les Bretons accoururent ; il en tua plusieurs et arrêta
les autres, jusqu’à ce qu’il eut la cuisse percée d’une flèche, la figure
presque écrasée d’un coup de pierre, et soit bouclier brisé. En cet état, il
se jeta à la mer et regagna, son vaisseau à la nage. Comme on le félicitait
de son courage, il n’était préoccupé que de la pensée d’avoir perdu son
bouclier et s’en excusait auprès dit général. César le nomma sur l’heure
centurion.
L’audace des Bretons était tombée ; ils demandèrent à
traiter, livrèrent des otages, et accoururent en foule au camp, curieux de
voir de près ces machines de guerre et ces armes qui les avaient tant
effrayés.
On était alors à l’époque de la pleine lune et près de l’équinoxe,
c’est-à-dire, an temps des plus hautes marées de l’Océan. Une violente
tempête et la marée, favorisée par un vent violent, dispersèrent l’escadre
qui amenait à César sa cavalerie, et brisèrent sur les rochers du rivage ses
navires de charge Ce désastre rendit le courage aux insulaires ; ils
assaillirent une légion au fourrage et bientôt le camp lui-même. Mais ils
furent rudement reçus, et une sortie les disperse. César profita de leur
découragement pour parler en maître, exiger le double des otages qu’il avait
demandés et regagner en toute hâte le continent sur ses navires à demi
radoubés[38].
Ils disparurent, dit un ancien
chroniqueur, comme disparaît sur le rivage de la
mer la neige qu’a touchée le vent du midi.

VI. — CINQUIÈME ET SIXIÈME
CAMPAGNES (54-53). SECONDE DESCENTE EN BRETAGNE. SOULÈVEMENT DE LA GAULE DU
NORD.
Cette retraite ressemblait trop à une fuite, pour que
César, qui venait d’être prorogé dans son commandement pour cinq années, ne
fut pas pressé de recommencer cette expédition. Les préparatifs furent
poussés avec vigueur durant l’hiver. Il avait laissé des ordres précis pour
construire des navires d’un nouveau modèle : moins hauts de bordage, afin qu’an
pût y adapter des rames, tout en y laissant des voiles ; plus larges, à cause
des bagages et des chevaux qu’ils devaient transporter. Ce qui était
nécessaire à l’armement naval vint d’Espagne. Pendant que les soldats
exécutaient ces travaux, lui-même tenait ses assises dans la Cisalpine et
allait, au fond de l’Illyrie, apaiser des troubles qui pouvaient amener une
guerre de ce côté. Au printemps, il revint sur les côtes de la Manche passer
la revue de l’armée[39], inspecter les
magasins et la flotte ; celle-ci se composait de six cents vaisseaux et de
deux cents barques. Tout était prêt pour l’embarquement, mais des mouvements
inquiétants s’annonçaient chez les Trévires, qui n’avaient point envoyé leurs
députés à l’assemblée des Gaules. Un patriote, Indutiomare, qui disputait le
pouvoir à Cingétorix, le partisan des Romains, était l’âme de l’insurrection
projetée[40].
César se rendit chez ce peuple, à marches forcées, avec quatre légions sans
bagages, et Indutiomare, intimidé, sortit des retraites impénétrables de la forêt
d’Ardenne, où il s’était d’abord réfugié, pour amener au proconsul deux cents
otages, parmi lesquels son fils et ses plus proches parents.
Cette affaire terminée, César regagna Itius Portus,
où se trouvèrent réunisses huit légions et quatre mille cavaliers espagnols
ou gaulois ; il désigna cinq légions avec deux mille cavaliers pour le suivre
en Bretagne, et laissa le reste à Labienus, qui devait garder le port,
pourvoir aux vivres et veiller sur la Gaule. Parmi les Gaulois dont il
voulait se faire accompagner, était Dumnorix, personnage remuant qui avait
joué un rôle dans l’émigration des Helvètes et n’avait été épargné alors que
grâce aux prières de son frère Divitiac. Il refusait de partir, sous prétexte
qu’il ne pourrait supporter la traversée et que sa religion lui défendait de
passer la mer, mais, en de secrets conciliabules, il disait aux chefs qu’ils
étaient emmenés dans file pour y être égorgés. Au milieu du tumulte de l’embarquement,
il s’échappa du camp avec la cavalerie éduenne. César avait l’œil sur lui :
il suspend aussitôt l’opération commencée, dans la crainte que cette fuite ne
soit un signal de révolte générale, et il envoie toute sa cavalerie à la
poursuite du fugitif avec ordre de le ramener mort ou vif. Dumnorix voulut
résister ; il criait : Je suis libre et membre d’une
nation libre ! On l’entoura, et il fut sabré.
L’armée descendit en Bretagne aux lieux où elle avait pris
terre la première fois, et rencontra l’ennemi dans une position difficile,
derrière une petite rivière et à l’abri d’une forêt profonde dont les entrées
étaient défendues par de grands abatis d’arbres. Les soldats formèrent la
tortue et enlevèrent aisément ces grossiers remparts ; toutefois César ne
jugea point prudent de poursuivre les Bretons dans la profondeur des bois. Le
succès de cette première affaire promettait une prompte issue à l’expédition,
lorsque des cavaliers accourus à toute bride annoncèrent au proconsul qu’une
partie de sa flotte avait encore été détruite par une tempête. Il revint sur
ses pas, demanda à Labienus des ouvriers et de nouveaux navires ; puis, la
flotte réparée et mise à sec dans son camp, il retourna chercher les
barbares. Grâce à ce délai, leur nombre s’était singulièrement grossi ;
Cassivellaun, un de leurs puissants chefs, les commandait. Leur manière de
combattre par pelotons épars, sur des chars rapides, d’où ils s’élançaient
pour achever l’ennemi blessé, fatigua d’abord les légions. Elles se firent
bien vite à ce genre d’attaque, et cherchèrent une action générale, que les
Bretons refusaient. Dans l’espoir de les y amener, César marcha vers la
Tamise, où étaient les terres de Cassivellaun. Ce chef essaya de disputer le
passage du fleuve, et rangea ses troupes en bon ordre sur l’autre rive. Mais
l’infanterie romaine força le passage, probablement vers Windsor, où la
Tamise n’est plus qu’une petite rivière, et Cassivellaun recommença cette
guerre de surprises et d’incursions rapides, qui menaçait d’affamer ou de
ruiner peu à peu les légions.
Heureusement ces barbares, souvent en guerre les uns
contre les autres, ne s’étaient pas réunis en face de l’ennemi commun, et
dans le camp romain se trouvaient des traîtres à la cause nationale. Un jeune
chef de la peuplade des Trinobantes était venu en Gaule solliciter César de
le venger de Cassivellaun, qui avait tué son père. Il avait servi de guide à
l’armée, lui avait indiqué les gués du fleuve, le lieu où s’élevait, au fond
des marais et des bois (vers
Saint-Albans), l’oppidum qui
contenait les richesses de Cassivellaun ; César y conduisit ses légions, qui
s’en emparèrent. Ces échecs répétés, une vaine tentative des confédérés contre
le camp où se trouvait la flotte romaine, et la défection de plusieurs
peuples, décidèrent Cassivellaun à traiter. Les Bretons livrèrent des otages,
promirent un tribut annuel, et le proconsul, qui n’en demandait pas
davantage, repassa sur le continent.
Il ne doit avoir rapporté de file qu’un maigre butin.
Pline cite cependant une cuirasse ornée de perles qu’il consacra à Vénus ;
mais il avait montré la route que d’autres suivront. Son épée venait d’ouvrir
à l’action ou à l’influence de Rome trois grands pays, France, Angleterre ;
Allemagne, et c’est sa plume qui en donnait la première description (juillet et août 51).
Dans sa première campagne, César avait refoulé les
Helvètes sur le pays qu’ils voulaient quitter et rejeté les Suèves au delà du
Rhin, c’est-à-dire asservi l’est de la Gaule ; dans la seconde, le Nord avait
été conquis ; dans la troisième, l’Ouest ; dans la quatrième, il avait montré
aux Gaulois, par ses deux expéditions de Bretagne et de Germanie, qu’ils n’avaient
rien à attendre de leurs voisins ; et il venait, dans la cinquième, de
renouveler cette leçon, en portant de nouveau dans la Bretagne,ses aigles
victorieuses. On regardait donc la guerre des Gaules comme finie ; elle n’était
pas commencée.
Jusqu’alors quelques peuples avaient séparément combattu ;
mais tous savaient maintenant que les prétextes dont les Romains avaient usé
pour s’établir au cœur de leur pays cachaient le dessein de les asservir.
Portant au delà des Alpes la politique suivie par le sénat dans toutes ses conquêtes,
le chef du parti populaire à Rome avait, dans la Gaule, renversé, partout où
il l’avait pu, les gouvernements démocratiques. Menacée par les classes
populaires, l’aristocratie avait cherché appui contre elles auprès de César,
qui donnait au plus influent la cité romaine et son nom[41], des grades dans
ses troupes auxiliaires, des faveurs dans le partage du butin. Il avait pour
eux des égards et des séductions qui les charmaient ; il les invitait à sa
table, à ses fêtes[42] ; et il
favorisait l’élévation des plus ambitieux, qui lui livraient ensuite l’indépendance
de leurs cités : ainsi, Tasget chez les Carnutes, Comm chez les Atrébates,
Cavarin chez les Sénons, Cingétorix chez les Trévires. L’Éduen Dumnorix s’était
aussi vanté que César lui avait promis de le faire roi, et, durant six
années, l’aristocratie arverne empêcha son peuple de prendre part à la guerre
de l’indépendance. Là où le gouvernement populaire subsistait, César avait
formé un parti romain qui dominait l’assemblée et le sénat, gênait leur
action ou trahissait leurs conseils.
Un autre moyen d’influence dont il s’était habilement
saisi, était la tenue des états de la Gaule, réunion annuelle des députés de
tous les peuples[43]. C’était là que,
par la séduction de ses manières et l’ascendant de sa gloire, il gagnait ces
hommes qui semblaient délibérer librement avec lui sur les intérêts du pays,
et qui, en réalité, n’obéissaient qu’à ses injonctions et légitimaient ses
demandes de vivres, de subsides, d’auxiliaires.
Il n’en allait pas ainsi avec la multitude : chaque
défaite augmentait le nombre des patriotes, parce que chaque victoire de
César accroissait l’insolence et les exactions des agents romains. Pour
ceux-ci, la Gaule était une terre vierge sur laquelle ils s’abattaient comme
un vol d’oiseaux de proie, et le général donnait lui-même l’exemple[44]. Cependant César
reconnut de bonne heure la haine qui s’amassait lentement au fond des cœurs ;
on a vu qu’à sa dernière expédition de Bretagne il avait emmené tous ceux
dont il se défiait, et qu’un noble éduen, Dumnorix, refusant de le suivre,
avait été tué. C’était un des chefs du peuple qui avait ouvert la Gaule aux
légions et le frère de Divitiac, l’ami de César. Sa mort montrait à qui
pouvait encore en douter que le proconsul briserait quiconque ne servirait pas
ses desseins.
Comme César revenait de Bretagne victorieux, la Gaule
resta tranquille. Ce calme trompeur et l’apparente résignation des députés
gaulois, aux états qu’il tint à Samarobriva
(Amiens), chez
les Ambiens, lui firent croire que le danger était encore éloigné. Pour parer
à la disette des vivres rendus rares par une grande sécheresse, il dispersa
ses huit légions sur un espace de plus de 100 lieues : une chez les Essuviens
(Séez), entre
les Carnutes (Chartres)
et les Armoricains, quatre chez les Trévires (Trèves), les Éburons (Liège), les Nerves (Hainaut) et les
Morins (Boulonnais),
trois au centre, entre l’Oise et la Seine.
 Cependant un vaste complot préparait, entre le Rhin et la
Loire, le soulèvement de tous les peuples sur qui la présence continuelle des
légions, depuis quatre années, faisait peser de tout son poids la domination
étrangère. Un chef éburon, Ambiorix, et le Trévire Indutiomare en étaient
Dame. On devait prendre les armes dés que César serait en route pour l’Italie,
chasser ses partisans, car toute cité avait un parti romain, appeler les
Germains, assaillir les légions dans leurs quartiers, et couper
rigoureusement entre elles les communications. Le secret fut bien gardé, mais
l’insurrection des Carnutes éclata trop tôt. Ils renversèrent l’agent que le
Romain leur avait imposé pour roi, Tasget, et, après jugement public, le
mirent à mort. Ce fut pour César une révélation du péril : il resta en Gaule.
Ambiorix, qui le croyait déjà au delà des Alpes, porta tout son peuple à l’attaque
du camp de Sabinus et de Cotta à Aduatuca (Tongres) : il fut repoussé. Rusé comme un
chef indien, il fait cesser le combat, demande une conférence, et affecte les
meilleurs sentiments pour les Romains. Je dois de
la reconnaissance à César, dit-il : il
a délivré mon peuple du tribut que nous payions aux Aduatuques ; il m’a rendu
mon fils et le fils de mon frère qui étaient enchaînés comme otages à
Aduatuca. Aussi est-ce malgré moi que l’on combat. Riais aujourd’hui même
éclate un complot longtemps médité et général. Puis il montre à
Sabinus la Gaule entière en armes, les Germains occupés à franchir le Rhin,
et, comme unique moyen de salut, une prompte retraite sur le camp de Q.
Cicéron, dans le pays des Nerves. Cependant un vaste complot préparait, entre le Rhin et la
Loire, le soulèvement de tous les peuples sur qui la présence continuelle des
légions, depuis quatre années, faisait peser de tout son poids la domination
étrangère. Un chef éburon, Ambiorix, et le Trévire Indutiomare en étaient
Dame. On devait prendre les armes dés que César serait en route pour l’Italie,
chasser ses partisans, car toute cité avait un parti romain, appeler les
Germains, assaillir les légions dans leurs quartiers, et couper
rigoureusement entre elles les communications. Le secret fut bien gardé, mais
l’insurrection des Carnutes éclata trop tôt. Ils renversèrent l’agent que le
Romain leur avait imposé pour roi, Tasget, et, après jugement public, le
mirent à mort. Ce fut pour César une révélation du péril : il resta en Gaule.
Ambiorix, qui le croyait déjà au delà des Alpes, porta tout son peuple à l’attaque
du camp de Sabinus et de Cotta à Aduatuca (Tongres) : il fut repoussé. Rusé comme un
chef indien, il fait cesser le combat, demande une conférence, et affecte les
meilleurs sentiments pour les Romains. Je dois de
la reconnaissance à César, dit-il : il
a délivré mon peuple du tribut que nous payions aux Aduatuques ; il m’a rendu
mon fils et le fils de mon frère qui étaient enchaînés comme otages à
Aduatuca. Aussi est-ce malgré moi que l’on combat. Riais aujourd’hui même
éclate un complot longtemps médité et général. Puis il montre à
Sabinus la Gaule entière en armes, les Germains occupés à franchir le Rhin,
et, comme unique moyen de salut, une prompte retraite sur le camp de Q.
Cicéron, dans le pays des Nerves.
Sabinus avait une légion de nouvelles levées et sans doute
peu de confiance en elle ; il se laissa persuader, et, malgré Cotta, sortit
de ses retranchements. Comme ses troupes, embarrassées de bagages,
traversaient une étroite vallée dominée par une forêt profonde, les Éburons,
embusqués, l’attaquèrent de toutes parts et jetèrent la plus extrême
confusion dans la colonne ennemie. Tandis que Sabinus courait, troublé, au
milieu de ses cohortes rompues, Ambiorix retenait les siens dans les rangs,
empêchait le pillage, qui eût amené le désordre, et faisait attaquer de loin,
à coups de pierres et de traits, sans attendre les charges des Romains. Une
partie de la légion était déjà détruite, quand Sabinus fit demander une
nouvelle conférence au chef gaulois, qui l’accorda. Le lieutenant, les
tribuns et les centurions y viennent avec leurs armes : il leur commande de
les déposer, et ils obéissent. On discute les conditions du traité, mais
Ambiorix traîne l’entretien en longueur ; lorsqu’il voit que ses Gaulois ont
enveloppé la troupe de Sabinus, il donne le signal, et on les égorge. Le
reste de l’armée romaine périt du moins en combattant ; quelques soldats à
peine échappèrent.
César croyait avoir tout tué ou vendu chez les Aduatuques
et les Nerves. Il s’y trouva encore assez de guerriers pour que, réunis à
leurs anciens clients et aux Éburons, ils formassent une armée de cinquante
mille hommes. Ambiorix les mène au pied des retranchements de Quintus
Cicéron, le frère du grand orateur de Rome[45]. Ils veulent l’attirer,
comme Sabinus, hors de son camp ; ils lui disent que toute la Gaule est
soulevée, César et ses lieutenants assiégés, les Germains déjà sur la rive
gauche du Rhin et les troupes de Sabinus exterminées. Ce serait une
dangereuse illusion d’attendre le secours des autres légions qui,
elles-mêmes, sont dans une situation désespérée. D’ailleurs ils n’ont aucun
mauvais vouloir contre Cicéron ; ils ne lui demandent que de quitter ces
quartiers d’hiver dont l’armée a pris l’habitude, et il aura toute sécurité
pour se retirer par la route qu’il voudra choisir. Cicéron répondit : Le peuple romain n’est pas dans l’usage d’accepter des
conditions d’un ennemi. Qu’ils déposent leurs armes et envoient des députés à
César, il intercédera pour eux et obtiendra sans doute de sa justice ce qu’ils
demandent. La réponse était fière ; les actes répondirent aux
parles, et tandis que Sabinus s’était perdu avec tous les siens en s’abandonnant,
Q. Cicéron, par sa fermeté, sauva César, sa légion et lui-même.
Il fallait donc forcer le camp ; les Nerves l’entourèrent
d’un rempart haut de li pieds, d’un fossé profond de 15 et dont le circuit
était de 15.000 pas. Ils n’avaient pour le faire ni instruments ni outils ;
ils coupaient le gazon avec leurs épées, et portaient la terre dans leurs
saies. Et cependant César assure , s’il n’y a pas erreur dans son texte, que
cet immense ouvrage fut fait en trois heures. Ses leçons avaient bien profité
aux Gaulois.
Le septième jour, comme un vent violent s’était élevé, ils
lancèrent par-dessus le retranchement des boulets d’argile rougis au feu et des javelines
enflammées. Les huttes des soldats, couvertes de paille à la manière
gauloise, furent bientôt en flammes, et tout l’intérieur du camp brûla. En
même temps, les Nerves, avec de grands cris, roulaient des tours jusqu’au
pied du rempart et formaient la tortue, afin de tenter l’escalade. Mais pas
un soldat n’avait quitté le parapet pour arracher à l’incendie quelque partie
de son bagage ; l’ennemi fut contenu et repoussé. On vit même deux
centurions, qui depuis longtemps se disputaient le prix de la valeur, sortir
du camp, et n’y rentrer qu’après avoir tué les plus braves des assaillants.
Ces combats à l’arme blanche assuraient une grande supériorité à des hommes
soigneusement exercés, comme l’étaient les soldats de César.
Dans le même temps, Indutiomare, chez les Trévires,
renversait son rival Cingétorix, soulevait le peuple et menaçait le camp de
Labienus. La treizième légion, chez les Essuviens, voyait aussi s’agiter les cités
armoricaines, et Accon, chez les Sénons, chassait Cavarin, l’ami des Romains.
Au nord et à l’est de la Loire, le mouvement était général. Les Édues et les
Rèmes restaient seuls fidèles, ou, comme les Gaulois disaient, seuls traîtres
à la cause nationale.
Malgré sa vigilance, César ne savait rien. Depuis douze
jours une de ses légions était détruite ; depuis une semaine Q. Cicéron était
assiégé, et le concert avait été si bien arrêté, que la nouvelle du
désastre,. qui courait déjà parmi toutes les nations de la Gaule, ne lui
était point parvenue : pas un messager n’avait pu arriver jusqu’au quartier
général, à Samarobriva. Un esclave gaulois passa cependant et apprit au
proconsul ‘extrémité où son lieutenant était réduit. César n’avait sous la
main que deux légions incomplètes, à peine sept mille hommes, et les
assiégeants étaient au nombre de soixante mille ; néanmoins il précipita sa
marche. Il avait décidé un cavalier gaulois à se charger pour Cicéron d’une
dépêche écrite en grec, afin que les assiégeants ne pussent la comprendre, si
elle tombait entre leurs mains. Il lui avait recommandé, dans le cas on il ne
pourrait pénétrer jusqu’au lieutenant, d’attacher la lettre à son javelot et
de le lancer dams le camp. Le trait resta deux jours fiché dans une tour,
sans être remarqué ; quand on le porta enfin à Cicéron, il lut à ses troupes
les trois mots de César : Courage, le
secours arrive.
L’incendie des habitations annonça aux Nerves l’approche
du général ; ils allèrent à sa rencontre, et lui, affectant l’effroi, se
cacha clans un camp dont il diminua à dessein l’enceinte et dont il mura les
portes avec des mottes de gazon. Rendus confiants par ces signes de crainte,
les barbares se présentèrent sans ordre et sur un terrain désavantageux ; une
sortie vigoureuse les dispersa, et les vainqueurs gagnèrent facilement le
camp de Cicéron, où il n’y avait pas un soldat sur dix qui fût sans blessure[46].
César était arrivé, après trois heures de l’après-midi, au
camp de Cicéron ; le même jour avant minuit, à 60 milles de distance (90 kil.), les
acclamations des Rèmes annonçaient à Labienus sa victoire et la fin du péril.
Le bruit de ce double succès arrêta en effet tous les mouvements.
Indutiomare, qui marchait sur le camp de Labienus, et les Armoricains sur
celui de Roscius, chez les Carnutes, se replièrent en toute hâte. Mais la
Gaule entière était agitée ; les peuples échangeaient de secrètes ambassades
; les Carnutes avaient tué leur roi, ami des Romains, les Sénons condamné à
mort celui que César leur avait donné, Cavarin, et les trévires pressaient
les Germains d’accourir. Le proconsul jugea prudent de passer cet hiver dans la
Gaule ; il établit son quartier à Samarobriva, d portée de ces nations du
Belgium et de l’Armorique à qui la mort de Sabinus avait donné tant d’espérance.
Les Rèmes seuls et les Édues ne chancelaient pas dans une fidélité qu’ils
eussent payée bien cher si César avait été vaincu.
Avant même que le printemps fût venu, Indutiomare fit
reprendre les armes aux Trévires et attaqua le camp de Labienus ; celui-ci,
imitant la tactique de soli chef, se laissa insulter plusieurs jours par les
Gaulois, qui venaient le provoquer jusqu’au pied du rempart. Mais un soir qu’Indutiomare
se retirait avec quelques-uns des siens sans ordre, Labienus fit ouvrir les
portes et lança sa cavalerie à toute bride, promettant de grandes récompenses
à qui lui rapporterait la tête dut chef ennemi. Le Trévire tomba percé de
coups ; sa mort dispersa son armée et arrêta les Éburons, les Nerves, les
Aduatuques et les Ménapes déjà en marche pour le rejoindre.
À l’assemblée générale que le proconsul tint à Samarobriva,
les Sénons, les Carnutes et les Trévires refusèrent d’envoyer leurs députés :
c’était une déclaration de guerre. César l’accepta avec joie, car il avait
besoin de relever par d’éclatants succès la réputation de ses armes, et s’était
préparé durant l’hiver, en appelant d’Italie trois nouvelles légions[47], à tirer une
prompte vengeance de ces peuples qui remettaient en question l’œuvre de cinq
années, et compromettaient sa fortune en le retenant loin de Rome, où il
avait une autre guerre à suivre. Il prorogea les états, dont il fixa la
prochaine réunion à Lutèce chez les Parisii
: voilà notre grande ville qui entre dans l’histoire ; et c’est le fondateur
de l’empire romain qui prononce le premier son nom.
De Samarobriva, César gagna rapidement le pays des Sénons.
Ceux-ci n’avaient pas achevé leurs préparatifs ; ils demandèrent la paix ; le
proconsul était résolu à faire de ce peuple un exemple sévère ; l’intervention
des Édues, leurs anciens alliés, le sauva. Les Carnutes durent aussi leur
salut à la médiation des Rèmes. Mais les deux cités livrèrent toute leur
cavalerie et de nombreux otages. La colère du proconsul alla tomber sur
Ambiorix et sur les Éburons. Pour rendre sa vengeance complète, il les cerna.
Les Ménapes, leurs voisins au nord, et qui seuls de tous les Gaulois
n’avaient jamais envoyé de députés à César, furent assaillis par cinq
légions, qui avaient laissé derrière elles leurs bagages pour marcher plus
lestement. Surpris et forcés dans leurs bois, ils demandèrent la paix. Les
Trévires touchaient aux terres des Ménapes ; attirés par une ruse de Labienus
à livrer bataille dans un lieu défavorable, ils perdirent beaucoup de monde
et furent contraints d’accepter comme roi Cingétorix, qu’ils avaient chassé.
Alors tournant à l’est pour fermer la Germanie au peuple qu’il voulait
proscrire, César jeta un pont sur le Rhin, battit au loin l’autre rive,
défendit aux tribus qui l’habitaient toute relation avec la Gaule ; et
certain alors que les Éburons ne pouvaient lui échapper, il revint sur eux.
Sa cavalerie prit les devants et tomba comme la foudre au milieu de ce peuple
livré à l’extermination, tandis que dix légions entouraient le pays et, se
rapprochant peu à peu, brûlaient et tuaient tout ce qu’elles rencontraient.
César, qui appelait cette vaillante tribu une
race impie, invita les nations voisines à l’aider dans son œuvre
de destruction. On incendia les villages, on coupa les blés, et pendant
plusieurs mois on chassa à l’homme dans l’immense forêt Arduenna, où les
Éburons s’étaient jetés. Leur roi, le vieux Cativolk, incapable de combattre
ou de fuir, s’empoisonna, après avoir chargé d’imprécations Ambiorix, l’auteur
de cette guerre d’extermination. Ce vaillant chef poursuivi de retraite en
retraite, traqué comme une bête fauve, n’avait autour de lui que quatre
cavaliers, mais les captifs que les légionnaires forçaient à servir de guides
les trompaient par de faux rapports, et Ambiorix s’échappa au delà du Rhin,
où il alla attendre des jours meilleurs.
De retour sur le territoire rémois, César réunit l’assemblée
générale, et, par un vain simulacre de justice, lui fit juger le Sénonais
Accon. La sentence était dictée d’avance : Accon fut battu de verges et
décapité. L’excommunication civile et religieuse frappa ses complices et les
auteurs du soulèvement des Carnutes qu’on n’avait pu saisir.

VII. — SEPTIÈME CAMPAGNE.
SOULÈVEMENT GÉNÉRAL (52).
Ces exécutions alimentèrent la haine du nom romain ;
durant, l’hiver que César passa en Italie, un second soulèvement fut préparé
dans de nombreux conciliabules ; les Gaulois enfin s’unissaient. C’était bien
tard, et pourtant ils furent sur le point de réussir !
On savait qu’à Rome il y avait, entre César et Pompée, une
mésintelligence croissante, et que le proconsul des Gaules serait peut-être
retenu en Italie pour une guerre civile. Les légions n’étaient point
dispersées comme l’année précédente : deux campaient chez les Trévires, deux
chez les Lingons, les six autres sur les terres des Sénons ; et comme l’hiver
fermait les passages des Alpes et des Cévennes, on espérait que si le
mouvement était général, elles seraient surprises, écrasées, avant que César
pût les rejoindre. Pour que l’engagement fût irrévocable, on porta les
drapeaux militaires dans un lieu écarté, et, sur ces enseignes, les députés
de tous les peuples ligués jurèrent de prendre les amies dès que le signal
serait donné.
Il partit du centre druidique de la Gaule, du pays des
Carnutes, qui venaient d’être accablés de réquisitions. Au jour convenu, ce
peuple se jeta sur Cenabum (Orléans), ville de
commerce au bord de la Loire, et y égorgea les négociants italiens qui y étaient
accourus en grand nombre. Le même soir, la nouvelle portée de village en
village par des crieurs disposés sur les routes arriva à Gergovie, à 160
milles de distance (240
kil.).
 Là vivait un jeune et noble Arverne qui attirait déjà les
regards par toutes les qualités qu’estiment des nations belliqueuses : une
haute stature, l’air martial, l’adresse à manier un cheval de guerre ou à
lancer le javelot gaulois ; son nom même était de bon augure : il s’appelait
le grand chef des braves[48], Vercingétorix.
Son père, en voulant usurper la royauté, avait péri dans la tentative, et le
fils avait la même ambition. Lié d’amitié avec César, il avait sans doute
contribué à maintenir les Arvernes en paix durant les premières campagnes ;
mais, en voyant, par toute la Gaule, l’agitation du parti populaire et le
succès qu’Ambiorix avait été sur le point d’obtenir, il comprit qu’il y avait
un grand rôle à prendre. Dans les assemblées publiques ou les réunions
religieuses, il laissait deviner, plutôt qu’il ne montrait, sa pensée. Mais
elle se révélait dans les conciliabules secrets, où il faisait voir aux
siens, comme prix de leur courage, l’Arvernie relevée de son abaissement, et
placée à la tête des nations gauloises, qu’elle aurait tirées de la servitude
étrangère. Là vivait un jeune et noble Arverne qui attirait déjà les
regards par toutes les qualités qu’estiment des nations belliqueuses : une
haute stature, l’air martial, l’adresse à manier un cheval de guerre ou à
lancer le javelot gaulois ; son nom même était de bon augure : il s’appelait
le grand chef des braves[48], Vercingétorix.
Son père, en voulant usurper la royauté, avait péri dans la tentative, et le
fils avait la même ambition. Lié d’amitié avec César, il avait sans doute
contribué à maintenir les Arvernes en paix durant les premières campagnes ;
mais, en voyant, par toute la Gaule, l’agitation du parti populaire et le
succès qu’Ambiorix avait été sur le point d’obtenir, il comprit qu’il y avait
un grand rôle à prendre. Dans les assemblées publiques ou les réunions
religieuses, il laissait deviner, plutôt qu’il ne montrait, sa pensée. Mais
elle se révélait dans les conciliabules secrets, où il faisait voir aux
siens, comme prix de leur courage, l’Arvernie relevée de son abaissement, et
placée à la tête des nations gauloises, qu’elle aurait tirées de la servitude
étrangère.
Dès qu’il apprit le massacre de Cenabum, il arma ses
clients et proclama l’insurrection dans Gergovie. Les grands, son oncle même,
refusent de s’associer à ses desseins, et sont assez forts pour le chasser de
la ville. Il soulève le peuple des campagnes, et César, injuste cette fois
envers son plus grand adversaire, le montre se formant une armée avec le
rebut de la population et les gens perdus de dettes. C’était bien la foule
des pauvres, mais c’étaient ceux aussi qui ne se résignaient pas à la
domination de l’étranger ; et ils devaient être la grande majorité de la
nation, puisqu’ils vainquirent sans combat l’opposition des nobles.
Vercingétorix, rentré avec eux dans Gergovie, y est proclamé roi et se fait l’âme
de la guerre sainte. Il envoie de pressants messages à tous les peuples ; il
rappelle les serments prêtés, l’occasion favorable, la nécessité de briser ce
joug, qui longtemps s’est caché sous un désintéressement hypocrite et qui pèse
aujourd’hui si lourdement sur les têtes. De la Garonne à la Seine, toutes les
cités répondent à son appel, et on lui défère la conduite de la guerre.
Ainsi les Arvernes et le centre de la Gaule, restés jusqu’à
présent étrangers à la lutte, allaient y prendre le premier rôle. Ces
défections rendirent le courage aux Gaulois du Nord. Malgré la présence de
dix légions, les chefs bellovaques et trévires, entraînés par l’exemple du
roi atrébate, Comm, longtemps le fidèle allié de César, préparèrent l’insurrection
de leurs peuples. Labienus crut la prévenir en faisant assassiner Comm ; mais
l’Atrébate survécut à ses blessures, pour se venger.
César avait enfin trouvé un digne adversaire.
Vercingétorix imitait la prodigieuse activité du proconsul : il amassait
des vivres et des armes, il fixait les contingents, prenait des otages, s’attachait
à former une cavalerie formidable, et donnait à la ligue une organisation qui
avait jusqu’à présent manqué à toutes les tentatives des Gaulois. Mais n’accordant
à personne le droit de s’épargner plus que lui-même et de déserter la cause
de la patrie, il se montra sévère jusqu’à la cruauté. Les traîtres
périssaient dans le feu ou les tortures ; pour une faute légère, il faisait
couper les oreilles ou crever les yeux, puis renvoyait les coupables, afin
que la vue du supplice avertit et effrayât.
Vercingétorix n’avait si vite acquis une telle autorité,
que parce qu’il répondait au sentiment national qui faisait enfin explosion
sous les coups répétés de César. Prêtres et nobles avaient abandonné la Gaule
; le peuple se levait pour la sauver, en se serrant autour du jeune héros qui
révélait à la fois sa haine contre l’étranger et des talents supérieurs d’organisation.
Son plan d’attaque fut habile ; un de ses lieutenants, Luctère, descendit au
sud vers la Province, qu’il devait envahir, tandis que lui-même marchait au
nord contre les légions. Sur son chemin, il s’arrêta pour soulever les
Bituriges (Berry),
clients des Édues ; il y réussit, et la grande ville d’Avaricum lui ouvrit ses
portes. Mais ce délai permit a César d’arriver d’Italie. Le proconsul ne
craignait pas cette fois que ses légions, massées sur trois points peu
éloignés les uns des autres et tenues en éveil par la gravité des
circonstances, se laissassent surprendre ; il prit le temps d’organiser la
défense de la Narbonnaise. Au reste peu de jours lui suffirent pour tout voir
et tout faire, pour chasser l’ennemi, franchir les Cévennes, malgré 6 pieds
de neige, et porter la désolation sur le territoire arverne (hiver de 53-52).
Vercingétorix était encore chez les Bituriges, quand
arrivèrent ces nouvelles. Contraint par les murmures de ses soldats, il
courut défendre leurs foyers. César était parti ; il avait une seconde fois
passé les montagnes, pris à Vienne un corps de cavalerie, et, longeant le
Rhône et la Saône à marches forcées, il avait traversé sans se faire
connaître tout le pays des Édues, dont il commençait à suspecter les
intentions. Déjà il était au milieu de ses légions, et les Belges
suspendaient leurs armements.
L’audace et l’activité du proconsul avaient déjoué le
double projet du général gaulois. Celui-ci, moins pressé maintenant d’aller
au nord, vint assiéger la ville des Boïes, Gorgobina,
vers le confluent de la Loire et de l’Allier, pour décider la défection de ce
peuple, autre client des Édues, comme il avait obtenu celle des Bituriges.
Cet événement entraînerait peut-être les Édues eux-mêmes, qui, en présence de
la Gaule presque entière soulevée contre Rome, chancelaient dans leur
fidélité.
César avait concentré ses forces à Agedincum (Sens). Il avertit les Boïes de sa
prochaine arrivée et précipita sa marche avec huit légions. Sur sa route, il
enleva Vellaunodunum (Château-Landon ou
Triguères), une ville des Sénons, où il ramassa des vivres, et
atteignit la Loire à Genabum (Gien ??). Une
attaque impétueuse des légions, au milieu même de la nuit, réussit : tout fut
tué ou pris et plus tard vendu. Sur le pont de Cenabum César passa la Loire
et emporta encore la première ville des Bituriges qu’il rencontra, Noviodunum (Sancerre ?) ; Vercingétorix, accouru pour
la sauver, vit sa chute, et comprit qu’avec un tel adversaire il fallait une
autre guerre. En un seul jour vingt villes des Bituriges furent par eux-mêmes
livrées aux flammes, et l’on décida qu’à l’approche des Romains chaque peuple
imiterait ce dévouement héroïque. On voulait affamer l’ennemi et le
contraindre à faire, pour son approvisionnement, de lointains détachements,
ce qui permettrait de détruire son armée en détail. Mais on n’alla pas jusqu’au
bout de cette résolution, qui eût perdu César : la capitale du pays,
Avaricum, fut épargnée. Ne nous forcez pas à détruire
de nos mains la plus belle ville de la Gaule, disaient les
habitants au conseil de l’armée, nous vous jurons
de la défendre et de la sauver. On céda ; aussitôt César y courut.
Bien que située en plaine, cette ville (Bourges), couverte
par deux rivières et des étangs, était d’accès difficile : les meilleurs
guerriers des Bituriges s’y étaient enfermés, et la grande armée gauloise
campait à quelques lieues, derrière les légions, jetant sans cesse dans la
place des hommes et des vivres. Au bout de peu de jours, César se trouva dans
une position si critique, qu’il proposa à ses soldats de lever le siège ; ils
refusèrent tout d’une voix, comme s’il leur eût demandé une lâcheté. Content
de cette épreuve, le proconsul poussa avec ardeur les travaux gigantesques
que les soldats romains savaient accomplir. En vingt-cinq jours, on
construisit des tours d’attaque et une terrasse longue de 330 pieds sur 80 de
hauteur. Déjà elle touchait aux murailles, quand une nuit les assiégés, au
moyen d’une mine, y portèrent l’incendie. Mais les Romains étaient sur leurs
gardes, et, après un combat terrible, ils restèrent maîtres de leurs
ouvrages. César raconte qu’un Gaulois, placé en avant d’une porte, lançait
sur une tour embrasée des boules de suif et de poix pour activer L’incendie.
Frappé par un n’ait parti d’un scorpion, il tomba ; un autre prit aussitôt sa
place, un troisième succéda à celui-ci également blessé à mort, puis un
quatrième, et, tant que l’action dura, ce poste mortel ne resta pas vide un
seul instant.
César s’effrayait moins de leur courage que de leur
adresse à imiter tout l’art des Romains pour rendre le siége inutile. Ils détournaient nos béliers, dit-il, avec des lacets, et, lorsqu’ils les avaient accrochés, ils
les tiraient en dedans de leurs murs avec des machines. Ils arrivaient jusque
sous nos terrasses par des galeries souterraines : travail qui leur est
familier, à cause des mines de fer dont leur pays abonde. Ils avaient garni
leurs murailles de tours recouvertes de cuir. Nuit et jour, ils faisaient des
sorties, mettaient le feu à nos ouvrages, ou attaquaient nos travailleurs. A
mesure que nos tours s’élevaient sur la terrasse, ils établissaient sur leurs
murs des échafaudages faits de poutres qu’ils liaient avec art. Si nous
ouvrions une mine, ils l’éventaient, et remplissaient la route que suivaient
nos mineurs de pieux pointus et durcis au feu, de poix bouillante ou de
rochers qui arrêtaient notre travail et nous empêchaient d’avancer.
La garnison cependant se lassa la première ; elle fit savoir à Vercingétorix
qu’elle ne pouvait plus tenir, et reçut de lui l’ordre de quitter la ville.
Mais avant qu’elle pût obéir, César profita d’un jour froid et pluvieux pour
ordonner un assaut général. La place fut prise ; de quarante mille soldats ou
habitants qu’elle renfermait, huit cents à peine gagnèrent le camp gaulois.
Les provisions que César trouva dans Avaricum le
nourrirent le reste de l’hiver (premiers mois de 52). Le printemps venu, il allait reprendre
les opérations offensives, quand des troubles éclatèrent chez les Édues. Une
double élection à la magistrature suprême de cette cité menaçait d’amener une
guerre civile qui pouvait lui faire perdre l’appui des plus anciens alliés de
Rome dans la Gaule. Pris pour arbitre, il se rendit à Decetia (Decize) sur le territoire éduen, parce que
la loi interdisait au vergobret de passer la frontière, et, après s’être
minutieusement renseigné, il se prononça pour celui des deux candidats qui
lui parut devoir rallier le plus grand nombre d’adhérents : c’était
Convictolitan, que les magistrats et les prêtres avaient choisi. En retour,
il demanda aux Édues toute leur cavalerie et dix mille fantassins pour
escorter ses convois. De grandes faveurs,
leur disait-il, récompenseront, après la guerre,
vos services.
Ces services étaient grands, car, n’ayant pas, durant
toute la guerre, chancelé dans leur fidélité envers ceux qui les avaient
sauvés d’Arioviste, les Édues et les Séquanes avaient garanti à César la
liberté de ses communications avec la Province. Tant que la large route de la
vallée de la Saône lui restait ouverte, il pouvait sans crainte s’enfoncer
dans le Nord ou dans le centre du pays. Il se crut même, après la prise d’Avaricum,
assez fort pour diviser ses forces. Labienus, avec quatre légions, se dirigea
du pays des Sénons contre les Parisii,
que Vercingétorix avait soulevés, tandis que lui-même conduisait les six
autres contre les Arvernes par la vallée de l’Allier. Le généralissime
gaulois avait rompu tous les ponts et suivait, le long de la rive gauche, les
mouvements des légions sur le bord opposé. César lui déroba une marche et
passa le fleuve ; il ne put cependant l’obliger à recevoir bataille en plaine
; et lorsqu’il parut devant la capitale de la ‘ligue, Gergovie des Arvernes,
à une lieue et demie au sud de Clermont-Ferrand, l’armée gauloise la
couvrait.
Le plateau qui portait Gergovie avait 1500 mètres de long
sur environ 500 mètres de large. Il s’élevait de 380 mètres au-dessus de la
plaine et de 730 au-dessus de la mer, entre les villages actuels de Romagnat,
d’Orcet et de Chamonat, avec des pentes abruptes de deux côtés et d’accès
difficile sur les autres. Un mur de 6 pieds, fait en grosses pierres,
couvrait les approches de l’oppidum, sur le versant par où l’attaque
devait se prononcer. Une de ses extrémités se perdait dans des hauteurs
inabordables ; l’autre venait mourir à la montagne de Risolles, d’une
altitude égale à celle du plateau de Gergovie. Un col, large seulement de 120
mètres, faisait communiquer les deux plateaux. Vercingétorix campait sur
celui de Risolles, et un poste établi à la Roche-Blanche lui permettait de s’approvisionner
de fourrage et d’eau dans ta vallée de l’Auzon. Les Romains s’arrêtèrent en
face de lui, au voisinage aussi de l Auzon, sur des collines qui dominaient
une plaine favorable aux escarmouches de cavalerie. De leurs lignes, on
apercevait l’armée de Vercingétorix étagée sur les pentes, et chaque matin,
au lever du soleil, on pouvait reconnaître les officiers qui venaient à la
tente du général recevoir ses instructions[49]. César avait
appris aux Gaulois a se retrancher. A la vue de ces hauteurs portant chacune
le contingent d’une cité et entourées de solides défenses, il eut un moment d’inquiétude
: C’était, dit-il, un effrayant spectacle.
Son premier soin fut d’enlever, une nuit, le poste de la
Roche-Blanche, qu’il occupa fortement, et de creuser de cette colline à son
camp principal un double fossé, profond de 12 pieds, qui permit de se rendre
à couvert de l’une à l’autre position. De nombreuses machines disposées sûr
le rempart furent tenues prêtes à battre la plaine : elles allaient sauver l’armée.
Litavicus, chef des auxiliaires éduens envoyés au camp de
César, avait fomenté une insurrection parmi ses troupes et voulait les
conduire à Vercingétorix. Le proconsul, averti de ce dangereux complot,
courut avec quatre légions salas bagages à la rencontre des insurgés et les
ramena à lui. Mais, quelques précautions qui eussent été prises pour cacher
ce départ des principales forces romaines, il n’avait pu échapper à
Vercingétorix. Lui aussi voyait ce qui se passait dans les lignes de César,
et il avait profité de son absence pour les attaquer. Le lieutenant Fabius s’était
habilement servi des deux légions qui lui restaient ; il avait repoussé tous
les assauts, grâce aux machines, cette artillerie des Romains, mais il avait
été réduit à murer les portes, ce qui ne se faisait que dans les cas de grand
péril, et il rappelait César en toute hâte. Le lendemain, le proconsul
reparaissait : il avait fait, en vingt-quatre heures, 74 kilomètres, aller et
retour.
Il venait d’échapper à deux dangers ; la sédition éduenne
lui en faisait pressentir un aube plus grand : l’insurrection, cette fois
générale, de la Gaule. Il songeait donc à abandonner le siège pour attirer
son adversaire en plaine, lorsque, dans une visite des travaux au petit camp,
il reconnut qu’en se saisissant d’une colline (au-dessus de Merdogne ?), d’où les Gaulois
s’étaient retirés pour se concentrer sur le plateau de Risolles, on pouvait
arriver à l’avant-mur, facile à franchir, et se trouver en face d’une des
portes de l’oppidum. De bruyantes démonstrations, faites sur la droite et la
gauche par la cavalerie et par les valets de l’armée, cachés sous des casques
de soldats, détournèrent l’attention de Vercingétorix du véritable point d’attaque,
et les légions amenées au petit camp, par le double fossé dont l’épaulement
les dérobait à la vue, furent lancées sur Merdogne (?). Elles atteignirent si rapidement
la colline et le premier mur, que Teutomatus, roi des Nitiobriges, faillit
être enlevé dans sa tente. Un centurion parvint même unir la crête du rempart
de Gergovie, et les habitants croyaient la ville prise, quand les Gaulois
accourus en foule rétablirent le combat et précipitèrent les Romains des
hauteurs. Les vainqueurs n’osèrent toutefois descendre dans la plaine, et la
dixième légion arrêta aisément la poursuite des plus ardents. Cette journée
coûtait au proconsul sept cents hommes, dont quarante-six centurions.
C’était un échec ; il l’imputa à ses légionnaires, ce qui
était une injustice ; il leur reprocha de n’avoir pas cessé le combat
aussitôt qu’il avait fait sonner la retraite. Niais tous n’avaient pu entendre
le signal, et les dispositions qu’il avait prises révèlent l’intention d’enlever
la place par un coup de main rapide. Les vétérans avaient exécuté ce plan
avec leur bravoure habituelle, et les attaques de cette sorte étant très meurtrières,
lorsqu’elles ne réussissent pas, il avait fait des pertes sensibles. Pour
pallier cet échec, César mit la mort des légionnaires tombés au pied de l’oppidum
au compte de leur témérité et non pas de la sienne : blâme auquel se mêlait
un éloge, car des soldats ne se plaignent jamais d’être accusés de trop d’audace
; et leur confiance dans le général n’en diminua pas, puisqu’il paraissait
avoir voulu les tirer à temps du péril.
Deux jours de suite, César offrit en plaine la bataille à
Vercingétorix, qui se garda bien de l’accepter et se contenta d’escarmoucher
avec sa cavalerie. Jugeant après cela,
dit le proconsul, que la jactance des Gaulois
était abattue et le courage des siens raffermi, il se dirigea sur
le pays des Édues, afin de se rapprocher de Labienus qui était à 80 lieues de
là, et il se hâta de mettre l’Allier entre lui et la grande armée gauloise.
Cette marche en arrière ressemblait à une fuite ; ainsi le
proclamaient partout les émissaires de Vercingétorix. Les Édues crurent que
la fortune de César ne s’en relèverait pas, et, de crainte que la cause
gauloise ne triomphât sans eux, ils se décidèrent à passer au parti national,
lui portant, comme gage d’alliance, la nouvelle du massacre, dans toutes les
villes éduennes, des recrues de César, des marchands italiens et des otages
des Rèmes, restés fidèles à l’amitié romaine.
Cette défection mettait l’armée en un sérieux péril,
enfermée qu’elle était dans le delta que forment, par leur réunion, la Loire
et l’Altier, alors grossis par les pluies, et Ies Cévennes, d’où tous les
deux descendent. Derrière l’Allier, l’armée victorieuse de Vercingétorix ;
derrière la Loire, le pays soulevé des Édues ; point de provisions, nul passage,
car la ville de Noviodunum des Édues (Nevers), où se
trouvaient ses magasins, ses bagages, le trésor de l’armée et un pont sur
lequel il avait compté traverser le fleuve, venait d’être détruite. Aussi
plusieurs lui conseillaient de regagner la Province. Il pensa que, s’il
pouvait rallier l’armée de Labienus, il serait toujours en mesure, avec une
masse de dit légions, de se rouvrir le chemin de la Narbonnaise, et puis il
avait embarqué toute sa fortune politique dans cette guerre : s’il était
vaincu en Gaule, il était proscrit à Rome. Il rejeta donc tout projet de
retraite et s’enfonça hardiment au nord, laissant cent mille Gaulois entre
lui et la Province. A force de recherches, il trouva un gué dans la Loire ;
les soldats avaient de l’eau jusqu’aux aisselles, mais la cavalerie, placée
en amont, rompit le courant. Une fois sur l’autre rive, il gagna à marches
forcées le pays des Sénons, dont la capitale, Agedincum
(Sens),
renfermait les dépôts des légions de Labienus. Cet habile lieutenant y
rentrait, reculant, lui aussi, devant le soulèvement de tous les peuples du
Nord.
La ligue du Nord avait pour chef l’Aulerque Camulogène,
vieux guerrier habile et actif, qui avait porté son quartier général à
Lutèce. Cette ville était alors renfermée tout entière dans une île de la
Seine ; Labienus voulut d’abord l’atteindre en suivant la rive gauche du fleuve.
Arrêté par les Gaulois devant les marais de l’Essonne ou de l’Orge, il
rétrograda jusqu’à Melodunum (Melun), saisit
toutes les barques qu’il trouva sur le fleuve, enleva ce bourg, établi, comme
Lutèce, dans une île du fleuve, et passa sur l’autre rive pour attaquer la
ville des Parisii par le nord. La
place était d’accès facile de ce côté, et les bateaux qu’il amenait de Melun
lui servirent à franchir la Marne, le seul obstacle sur la rive droite de la
Seine qui pût l’arrêter. Camulogène craignit d’être forcé dans la place ; il
brûla la ville et ses deux ponts, puis se retira sur les hauteurs de rive
gauche, dont le Panthéon et l’Observatoire marquent aujourd’hui le point
culminant. Il savait que les Bellovaques s’armaient sur les derrières de
Labienus, et il voulait forcer ce général à recevoir bataille adossé à un
grand fleuve et enveloppé par deux armées.
Mais Labienus trompa sa vigilance. Tandis que cinq
cohortes, les bagages et une partie des bateaux remontaient la Seine à grand
bruit, d’autres, à la première heure, dix heures du soir, filèrent silencieusement
vers le Point-du-Jour. Des barques les transportèrent à travers le grand bras
du fleuve, dans les îles de Billancourt et Béguin qui servirent de rideau
pour cacher le passage. Trois légions massées en cet abri franchirent
rapidement le petit bras et descendirent à l’improviste sur la rive gauche.
Un violent orage avait encore épaissi les ténèbres et couvert le bruit. On ne
trouva sur le bord que des sentinelles, qui furent enlevées. Quand le soleil
parut, l’armée romaine était en bataille dans la plaine de Grenelle, d’où
elle put s’élever par une pente douce sur le plateau, en tournant par la
plaine de Montrouge la position de Camulogène.
Le vieux général, trompé par les mouvements faits en amont
de la Seine, avait dirigé de ce côté une partie de ses forces ; avec le
reste, il essaya de rejeter les Romains dans le fleuve. L’action fut
sanglante ; Camulogène et presque tous ses guerriers y périrent[50]. A ce succès,
Labienus ne gagnait que sa retraite ; il se hâta d’atteindre le territoire sénon,
où César était déjà arrivé[51].
Une nouvelle assemblée de tous les députés de la Gaule
confirma Vercingétorix dans le commandement suprême. Trois peuples évitèrent seuls
d’y paraître : les Lingons, les Rèmes et les Trévires. Par leur moyen, César,
qui manquait de cavalerie, soudoya plusieurs bandes de Germains qu’il monta
avec les chevaux de ses tribuns et des chevaliers. Cependant il songeait
maintenant à opérer sa retraite sur la Province, que Vercingétorix finit
attaquer par trois points à la fois. Le généralissime gaulois avait commandé
aux Édues et aux Ségusiaves, leurs clients, de soulever les Allobroges qui
restaient fidèles à Rome, aux Gabales (Gévaudan) et à des troupes arvernes de
ravager le territoire des Helves (Vivarais), aux Rutènes et aux Cadurques (Rouergue et Quercy)
d’envahir le pays des Volks arécomiques (bas Languedoc). Lui-même, avec quinze mâle
cavaliers et une infanterie nombreuse, se proposa de suivre César, en se
refusant à toute action, de lui couper les vivres, d’enlever ses fourrageurs,
d’incendier à son approche les villages et les moissons ; en un mot, de faire
le vide autour de lui et de le réduire par la famine. C’était le plan que
Vercingétorix avait proposé au début de la grande guerre. il était excellent,
à la condition qu’il fût exécuté mieux que la première fois, et qu’on sût
toujours éviter cette rencontre que César, au contraire, allait chercher avec
ardeur. Il avait fait route le long de la frontière des Lingons pour franchir
la Saône et gagner la Séquanie, en évitant le grand foyer de l’insurrection,
qui était maintenant au pays éduen. Cette marche aussi le conduisait à l’ennemi,
et peut-être lui fournirait-elle l’occasion d’une bataille. Il ne se trompait
pas.
Quand Vercingétorix vit les Romains approcher de la Saône,
il craignit que César, lui échappant, ne revint ensuite avec de plus grandes
forces, et il se décida à risquer au moins un combat de cavalerie[52]. Pour cette
arme, tout l’avantage paraissait de son côté : quinze mille cavaliers d’élite
dont chacun avait fait cette imprécation solennelle :
Que
je ne sois jamais reçu sous mon toit domestique,
Que
je ne revoie jamais ni mon vieux père, ni ma femme, ni mes enfants,
Si
je ne traverse deux fois à cheval cette armée de César.
Deux divisions de la cavalerie romaine furent en effet
sabrées ; mais César tenait ses légions derrière elles et si près, que les
escadrons gaulois ne purent éviter le choc. Il y courut les plus grands
dangers, faillit être pris, et laissa son épée aux mains de l’ennemi.
Heureusement, une charge des cavaliers germains rejeta une partie des Gaulois
en désordre sur leur infanterie. César voit le tumulte : aussitôt il entraîne
ses cohortes, menace le flanc de l’armée gauloise, et celle-ci, craignant d’être
tournée, s’enfuit vers son camp. La terreur l’y suit, ils forcent leurs chefs
à lever les enseignes, à fuir encore ; les cris des mourants, que l’avant-garde
de César égorge, précipitent leur marche, et ils ne s’arrêtent que sous les
murs d’Alésia[53].
Alésia, assise sur le plateau d’une colline escarpée, le
mont Auxois[54],
passait pour une des plus fortes places de la Gaule. Sur les flancs de la
colline, Vercingétorix traça un camp pour son armée encore nombreuse, usais
qui ne pouvait compter les quatre-vingt mille fantassins et les dix mille
cavaliers que César lui donne[55]. Il le couvrit d’un
fossé et d’un mur en pierre sèche haut de 6 pieds ; c’était la même position
qu’à Gergovie, il y comptait sur le même succès. Quand César eut examiné la
place et le camp gaulois, il conçut l’audacieuse pensée de terminer d’un coup
la guerre en assiégeant à la fois la ville et l’armée. Il établit son
infanterie sur les collines qui entourent à peu de distance le mont Auxois,
et il mit sa cavalerie dans les intervalles. Puis il commença ces prodigieux
travaux qui ont fait l’admiration du grand Condé. D’abord un fossé profond de
10 pieds, large d’autant, dont les côtés étaient à pic, et qui coupait la
plaine des Laumes, entre l’ose et l’Ozerain, le seul endroit par où
Vercingétorix aurait pu s’échapper. A 400 pieds en arrière commençait la
contrevallation véritable qui entourait le mont Auxois, sur un développement
de 11.000 pas (16
kilomètres). Elle était formée par deux fossés larges de 15 pieds et
profonds de 8 à 9 ; dans le premier, César avait détourné les eaux de l’Ozerain
et du Rabutin ; le second bordait une terrasse de 12 pieds de haut, surmontée
de créneaux, palissadée, sur tout son pourtour, de troncs d’arbres fourchus
et flanquée de tours à 80 pieds de distance les unes des autres. En avant des
fossés, il plaça cinq rangées de chevaux de frise (cippi),
huit lignes de pieux enfoncés en terre, et dont la pointe était cachée sous
des branchages (scrobes) ; plus près encore du camp
ennemi, il sema des chausse-trappes armées d’aiguillons acérés (stimuli). Comme il pouvait être assiégé en même temps
qu’assiégeant, il répéta ces ouvrages du côté de la campagne, où la
circonvallation eut un circuit de 14 milles (21 kilomètres). Cinq semaines et moins de
soixante mille hommes suffirent à cette tâche[56].
Les Rèmes persévéraient dans leur trahison. Les
Bellovaques, par un orgueil insensé, refusèrent d’aller se perdre dans la
grande armée. Nous combattrons quand il nous
plaira, dirent-ils, et pour notre
compte ; nous entendons n’obéir à personne. Cependant, à la prière
du roi des Atrébates, ils envoyèrent deux mille hommes. Nous les verrons
venir seuls provoquer César, quand tout sera perdu.
Vercingétorix n’était pas resté inactif. Il avait essayé
de gêner les travaux par des attaques, mais sans succès. Ne pouvant nourrir
sa cavalerie, il la renvoya avant que les lignes fussent achevées. Je puis, dit-il à ses cavaliers, tenir trente jours ; mais que toutes les cités se lèvent
en masse, que la Gance n’abandonne pas à l’ennemi celui qui s’est dévoué pour
elle et ses quatre-vingt mille frères. Ces paroles furent
entendues, et deus cent quarante-huit mille hommes se rassemblèrent de tous
les points de la Gaule[57]. Mais cette
levée en masse avait donné moins une armée qu’une immense cohue qui était
forcée de vaincre vite ou de se disperser, puisqu’elle ne pouvait vivre dans
un pays épuisé par les réquisitions de Vercingétorix et de César. Quand ils
parurent en vue d’Alésia, les trente jours étaient passés, et la disette se
faisait sentir dans la place. Un Arverne, Critognat, avait proposé qu’on se
nourrit de cadavres ; d’autres avaient fait chasser de la place toutes les
bouches inutiles ; on avait vu une multitude de femmes, de jeunes enfants et
de vieillards errer des murs aux retranchements, en implorant tour à tour la
pitié de l’ennemi et celle de leurs frères, puis, repoussés à coups de
traits, mourir de faim sous leurs yeux.
Dès le lendemain de son arrivée, la cavalerie gauloise se
répandit dans la plaine. César envoya contre elle ses cavaliers légionnaires,
qui furent d’abord maltraités ; déjà des cris de victoire s’élevaient de la
ville et du milieu de l’armée gauloise, lorsque les cavaliers germains,
chargeant en masse serrée, mirent encore une fois leurs adversaires en fuite.
Le jour suivant, l’armée entière attaqua les lignes extérieures, et les
assiégés firent une sortie ; niais les piéges dispersés dans la plaine
arrêtèrent l’élan des assaillants, tandis que les machines qui couvraient le
rempart faisaient pleuvoir sur leurs rangs épais une grêle de traits, de
pierres et de boulets de plomb qui y portaient la mort. Cette seconde attaque
échoua encore ; une troisième fut résolue.
Une colline que César n’avait pu comprendre dans la
contrevallation, le mont Réa, dominait une partie du rempart. L’Arverne Vergasivellaun,
parent de Vercingétorix, et Sedullis, chef des Lémovices, s’y portent en
secret avec soixante mille guerriers l’armée de secours. Dès que
Vergasivellaun voit la cavalerie se déployer dans la plaine, l’infanterie
marcher aux retranchements de la circonvallation et, du côté de la ville,
Vercingétorix sortir de la place avec des fascines pour combler le fossé
intérieur, il démasque sa troupe et attaque avec fureur. César, placé sur une
éminence d’où il embrasse son camp et tout le champ de bataille, reconnaît le
danger. Du côté de la plaine, les Gaulois, contenus par tous les obstacles qu’il
a si prudemment semés sur leur passage, attaquent mollement ; le fort de l’action
est vers la colline que Vergasivellaun a gravie. La, les légionnaires ont
déjà épuisé leurs traits. César commande à Labienus d’y conduire en toute
hâte six cohortes. Du côte de la ville, il suit les progrès de Vercingétorix
; il le voit franchir sur un point les fossés, atteindre le rempart et couper
avec des faux les mantelets qui mettent le légionnaire à l’abri des traits.
Encore quelques efforts, et l’ennemi va atteindre les créneaux. Il y envoie
Brutus avec six cohortes, puis Fabius avec sept autres, et, le danger
croissant, lui-même s’y porte ; enfin l’ennemi, accablé par les traits des
balistes, est repoussé. Rassuré sur ce point, César court à l’attaque de
Vergasivellaun, où Labienus est en péril ; ses soldats et l’ennemi le
reconnaissent au manteau de pourpre qu’il porte les jours de bataille, et
sous ses yeux redoublent d’efforts. Tout à coup sa cavalerie, qu’il a fait
sortir en secret, se lance à land de train, prend les barbares à dos, tandis
que les cohortes fraîches qu’il a amenées les précipitent du rempart. Les Gaulois
cèdent après un grand carnage, et fuient en abandonnant leurs camps ; mais
César sait achever la victoire : il les poursuit, taille en pièces leur
arrière-garde, et jette dans leurs rangs une terreur panique qui les disperse
au loin.
Cette fois, la Gaule était bien vaincue, et pour toujours.
Vercingétorix le comprit, et sa grande âme n’en fut pas ébranlée. Il rentra
dans Alésia, sans emportement ni douleur bruyante, pour y remplir un devoir suprême.
Il n’avait pu sauver la Gaule par son génie, il espéra pouvoir sauver au
moins ceux qui l’avaient suivi, eu s’offrant aux Romains comme victime expiatoire.
Il réunit l’assemblée. Je n’ai pas,
dit-il, entrepris cette guerre pour élever ma
fortune, mais pour sauver la commune liberté. Le sort des armes nous est
contraire. J’ai été votre chef, satisfaites aux Romains par ma mort, ou
livrez moi vivant, il ne m’importe. La foule était si abattue, que
ce sacrifice est accepté. On députe à César : il demande que les armes,
les chefs, Vercingétorix, lui soient
remis ; et il va s’asseoir sur son tribunal en avant de ses lignes. Les
portes de la ville s’ouvrent, un cavalier en sort seul : c’est
Vercingétorix. Monté sur son cheval de bataille et couvert de sa plus riche
armure, il arrive au galop jusqu’en face de César, tourne en cercle autour du
tribunal, puis saute à bas de son cheval, et, sans une prière, sans une
parole, avec un regard assuré et fier, il jette aux pieds du Romain
impassible et dur son casque et son épée. Les licteurs l’emmenèrent : César
lui fit attendre six années l’insultante solennité du triomphe et la mort[58].

Le sénat romain, à la nouvelle de ce grand succès, décréta
qu’on remercierait les dieux de Rome par vingt jours de fêtes solennelles.
Cependant César n’osa aller hiverner au delà des Alpes ; il prit ses
quartiers à Bibracte, au milieu de ses légions. Il avait abandonné à ses
soldats les captifs faits à Alésia, de sorte que chaque légionnaire eut un
esclave gaulois à vendre ou à garder[59]. Pour lui, il se
réserva vingt mille Édues et Arvernes qu’il mit en liberté afin de gagner
leurs deux peuples. Ceux-ci firent en effet soumission.

VIII. — HUITIÈME CAMPAGNE (51) ;
SOUMISSION DES BELLOVAQUES ET DES CADURQUES.
Cependant la guerre n’était point finie. Les Gaulois du
fiord et de l’Ouest, à l’exception des Nerves, des Vénètes et des Éburons, n’avaient
pas encore éprouvé de sanglantes défaites. Dans la campagne précédente leurs
contingents avaient été faibles, et les pertes étaient principalement tombées
sur les Arvernes et les Édues. Leurs forces étaient donc entières comme leur
courage, et l’expérience leur avait appris quelle guerre ils devaient faire
aux légions : des surprises, des attaques partielles, mais plus de ces
batailles ou la tactique romaine détruisait en un jour d’immenses armées. L’activité
de César déconcerta ce nouveau plan[60]. Au milieu de l’hiver,
il tomba sur les Bituriges avant qu’ils eussent achevé leurs préparatifs, et
portant dans tout le pays le fer et la flamme, il força cette population à
fuir chez les nations voisines, devant l’extermination et l’incendie. Après
cette leçon cruelle, il lui permit de revenir dans ses foyers dévastés, et,
pour récompenser les deux légions qui venaient de faire cette expédition par
un froid rigoureux, il donna à chaque soldat 200 sesterces, à chaque
centurion 2000.
Le centre de la Gaule semblait définitivement pacifié,
comme disaient les Romains. Mais à ce moment le Nord éclate, et d’abord les
Carnutes. Ce peuple, qui avait donné le signal de la grande insurrection,
devait à sou rang parmi les nations gauloises de combattre jusqu’au dernier jour.
César rentrait, à Bibracte, quand il apprit le mouvement des Carnutes ; il
repartit aussitôt, s’établit avec deux légions au milieu des ruines de
Cenabum, et de là fit battre le pays par sa cavalerie et ses auxiliaires. C’était
une guerre de dévastation et de pillage à laquelle les soldats se portaient
avec l’ardeur du gain et l’amour du meurtre ; une partie considérable de la
population carnute périt de froid et de misère au fond des bois.
Cette exécution n’était pas terminée, qu’un soulèvement général
des peuples du Nord-Est le força d’accourir avec quatre légions au secours
des Rèmes sérieusement menacés. Ambiorix, entendant un bruit de guerre
retentir enfin dans la Belgique, était sorti des forêts de la Germanie où il
se cachait, et cette fois les Bellovaques s’étaient levés en masse, soutenus
par les peuples des vallées de la Somme et de l’Escaut, Ambiens et Atrébates,
et par ceux de la basse Seine, Véliocasses, Calètes et Aulerques éburovices.
Le proconsul se dirigea vers leur pays : il le trouva désert ; et quand il
les rencontra sur le mont Saint-Marc (?) dans la forêt de Compiègne, leur position défendue par des
marais était si forte, qu’il n’osa les attaquer. Il lui fallut songer à se
prémunir lui-même contre toute surprise, en construisant pour ses quatre
légions, à proximité de l’ennemi, une véritable forteresse, un camp dont le
rempart, haut de 12 pieds, était surmonté de tours à trois étages que réunissaient
des ponts couverts où les soldats combattaient à l’abri, deux fossés, larges
chacun de 15 pieds, le précédaient. Plusieurs jours se passèrent en
escarmouches de fourrageurs. César n’osait tenter une attaque à fond qui l’obligerait
à traverser un terrain marécageux et à gravir ensuite des hauteurs hérissées
de défenses. Il se résolut à recourir à son grand moyen, l’investissement,
qui, avec des soldats aussi habiles à manier la pioche que l’épée, et contre
des adversaires imprévoyants, permettait d’affamer l’ennemi d’autant plus
vite qu’il était plus nombreux. Trois autres légions furent appelées, et les
travaux commencèrent. A la vue de ces cheminements si rapidement poussés par
de vigoureux travailleurs, les Bellovaques se souvinrent avec effroi d’Alexia,
et une nuit ils firent sortir du camp les femmes, les enfants, les vieillards
et les nombreux chariots qui portaient leurs bagages. Le jour les ayant
surpris dans cette opération, César profita du désordre pour se rapprocher d’eux,
afin de trouver l’occasion de frapper quelque coup décisif. Il Jeta des ponts
en clayonnage sur le marais et gagna une hauteur voisine de celle que les
Gaulois occupaient. Ceux-ci allumèrent de grands feux sur le front de leur
camp, et derrière ce rideau de flammes et de fumée, que les Romains n’osaient
franchir, de peur de tomber dans quelque embuscade, ils s’échappèrent.
Atteints au voisinage de l’Aisne, ils perdirent leur meilleure infanterie,
tous leurs cavaliers et leur chef Correus, qui refusa de se rendre[61]. Ce revers les
découragea : ils implorèrent la clémence du vainqueur ; toutes les cités du
nord-est livrèrent, comme eux, des otages. César parcourut la Belgique,
rejeta encore une fois au delà du Rhin, Ambiorix, qui était rentré sur les
terres de son peuple avec quelques centaines de fugitifs, puis il retourna
vers la Loire, car au sud de ce fleuve toutes les cités s’étaient aussi
soulevées.
Un ami des Romains, Durat, avait arrêté l’insurrection des
Pictons en s’emparant de leur capitale. La guerre dans l’Ouest se concentra autour
de cette place, que les Gaulois assiégèrent et que les Romains vinrent défendre.
Le lieutenant Caninius y était accouru des frontières de la Province avec
deux légions ; César lui envoya encore vingt-cinq cohortes sous les ordres de
Fabius. Les alliés, craignant de se trouver pris entre la place et deux
armées romaines, tachèrent de regagner la Loire. Au moment où ils la
passaient, la cavalerie de Fabius parut et les rejeta sur la rive gauche ;
les cohortes les y atteignirent, et cette armée fut encore détruite. Les
Andes, ce qui restait des Carnutes et les cités armoricaines donnèrent des
otages.
Des braves honorèrent ces derniers jours de la Gaule.
Relevons pieusement leurs noms, car l’histoire doit faire comme ce vieillard
des tombeaux, qui s’en allait par les bois et les monts cherchant les
lieux où les martyrs étaient tombés, débarrassait de la mousse et des ronces
la pierre des sépulcres, et faisait revivre les noms oubliés. Le chef des
Bellovaques, Corrée, tombé dans une embuscade, combattit longtemps. Le fleuve,
les forêts, étaient proches : il aurait pu fuir ; il ne le voulut pas,
abattit tous ceux des légionnaires qui osèrent l’approcher, et ne succomba
que quand l’ennemi l’eut accablé de loin sous une grêle de traits.
Guturvath était le chef des Carnutes et, comme Corrée,
comme Vercingétorix, l’instigateur de la guerre acharnée que son peuple
faisait aux Romains. César exigea qu’il lui fût livré, et ordonna à ses
licteurs de battre de verges et de décapiter cet homme qui avait défendu
contre lui son pays.
Un chef sénon, Drapeth, avait armé pour la guerre de la
liberté jusqu’aux esclaves ; même après les derniers désastres, il continua
de courir sus aux Romains ; pris par eux, il se laissa mourir de faim.
Dumnac, chef des Andes, se jeta dans les bois, quand il n’y
eut plus d’espérance, et y fît perdre sa trace ; comme Ambiorix, il mourut
ignoré, mais libre.
Comm, roi des Atrébates, avait expié par d’éclatants
services envers la cause gauloise l’erreur qui l’avait fait d’abord ami de
César. Labienus, redoutant son influence, l’avait attiré à une entrevue. On
arrêta qu’au moment où l’officier romain, Volusenus, prendrait la main du
Gaulois, les centurions dont il était accompagné se jetteraient sur Comm et
le perceraient de leurs épées. Mais ses amis détournèrent le coup, et Comm,
bien que grièvement blessé, échappa. Quand son peuple traita de la paix et
voulut, pour le sauver, le comprendre parmi les otages, il refusa : J’ai juré, dit-il, de
ne jamais me retrouver face à face avec un Romain ; et il disparut
au fond des bois. Des fugitifs vinrent le rejoindre. Il continua la guerre
avec eux, infestant le voisinage des camps, enlevant les convois destinés aux
quartiers des légions. Un jour il rencontra le préfet Volusenus à la tête d’un
parti de cavalerie. La vue de son ennemi irrite sa colère. Les Gaulois sont
moins nombreux, mais Comm les supplie de l’aider dans sa vengeance. Il
attire, par une fuite simulée, Volusenus loin des siens, puis tourne bride,
se jette sur lui avec fureur et le blesse d’un coup de javelot. Les Romains
accourent, il ne peut l’achever ; mais sa vengeance était satisfaite ; il
députe à Antoine et offre de poser les armes, à la condition qu’il pourra
vivre là où il sera sur de ne rencontrer jamais un Romain.
La dernière résistance fut faite par une ville obscure. L’invasion
de Caninius dans l’Ouest avait contraint Luctère, l’ancien lieutenant de
Vercingétorix, à renoncer à une nouvelle invasion de la Narbonnaise, et il
avait jeté quelques troupes dans la petite place d’Uxellodunum[62] (probablement le Puy d’Issolu),
chez les Cadurques (Quercy).
Caninius en forma aussitôt le siège. La place, bâtie au
milieu de rochers escarpés, était si folie, que César eut le temps d’arriver
de la Belgique, et ce ne fut qu’en coupant l’eau aux assiégés qu’on les força
de se rendre. Le proconsul, qu’une telle guerre à la longue aurait ruiné,
voulut faire un terrible exemple de ces derniers défenseurs de la liberté
gauloise. Tous ceux qu’il trouva dans Uxellodunum eurent les mains coupées ;
dispersés par toute la Gaule, ils allèrent annoncer le sort que les Romains
réservaient à ceux qu’ils ne voulaient plus regarder que comme des rebelles.
Un traître livra Luctère (51)[63].
Cette atrocité fut le dernier acte de la guerre des
Gaules. Aucune lutte n’a laissé dans le monde ancien de plus grands
souvenirs. Durant ces huit années, dit
Plutarque, César força plus de huit cents villes,
subjugua trois cents nations, vainquit trois millions d’hommes, dont un tiers
périt sur le champ de bataille, et un autre tiers fut vendu. Que
ces chiffres soient exagérés, peu importe ; ils montrent combien l’esprit des
anciens fut frappé par ces combats clé géants. La Gaule avait une fin digne
du renom que tant de victoires et de conquêtes lui avaient donné. A nous ses
fils, il sera permis de ne pas nous atteler au char du vainqueur et d’honorer
une résistance héroïque.
Mais, après cet hommage rendu au courage de nos pères,
reconnaissons qu’au point de vues des intérêts généraux du monde, César
venait de fermer d’une manière glorieuse la liste des conquêtes de la
république romaine. Une grande guerre était finie et une grande œuvre était
commencée. La frontière de Rome portée des Alpes au Rhin ; la barbarie
germanique refoulée et contenue ; la civilisation gréco-latine semée aux
bords de la Saône, de la Loire, de la Seine, et gagnant ainsi une assez large
base pour n’avoir pas à craindre d’être à jamais, aux jours de malheur,
étouffée sous les pas des envahisseurs : voilà le service rendu par César non
seulement à Rome, mais à l’humanité. A cette œuvre, il avait employé huit
années, onze logions, les inépuisables ressources de la discipline romaine,
son génie et son incomparable activité. La Gaule était naguère comme le
cheval indompté que nous voyons empreint sur les monnaies nerviennes, libre
et emporté dans ses allures ; il lui avait mis le frein. Mais dès qu’elle eut
accepté sa nouvelle condition, il s’appliqua à lui faire oublier sa défaite
et à fermer les plaies de cette terrible guerre. Durant une année entière, il
visita les principales cités, pour gagner les esprits et calmer les cœurs.
Point de confiscations qui livrassent des terres à ses soldats, car il ne les
avait pas achetés par dix ans de victoires et de butin pour en faire, à la
veille de Pharsale, de pacifiques laboureurs dans les plaines gauloises.
Point de lourd tribut, seulement celui que la nouvelle province avait
consenti à paver durant la guerre (40 millions de sesterces, 10 millions de francs). Encore les
exemptions étaient-elles nombreuses pour les alliés et les villes qui avaient
su mériter ce privilège, surtout pour les nobles Gaulois qui devaient former
dans chique cité une faction dévouée et rester les clients de César. A ces
faveurs il ajouta ce que les sujets de Rome connaissaient moins encore, le
respect pour les vaincus, pour leur gloire, pour les trophées, même élevés à
ses dépens. Il avait perdu son épée dans une bataille, ses soldats la
trouvèrent un jour suspendue dans un temple gaulois et voulurent l’arracher :
Qu’elle leur reste, dit-il, elle est sacrée. Il leur laissait bien autre
chose, leurs prêtres, leur religion, leurs lois, et il semblait, après la
victoire, ne demeurer au milieu d’eux que pour leur imposer la paix publique
et les associer à la grandeur romaine.
C’est qu’il avait intérêt à s’attacher maintenant cette
race vaillante. La conquête de la Gaule lui avait donné l’armée la plus
aguerrie, en même temps que la plus dévouée, de prodigieuses richesses et,
dans la république, une immense influence. Il ne pouvait plus rentrer simple
citoyen dans Rome, car il s’était élevé trop haut pour ne pas monter encore.
|