HISTOIRE DES ROMAINS
SEPTIÈME PÉRIODE — LES TRIUMVIRATS ET LA RÉVOLUTION
(79-30)
CHAPITRE LIII — LA
GAULE AVANT CÉSAR.
I. — LES POPULATIONS PRIMITIVES.L’homme de tous les temps se demande d’où il vient et où il
va. La philosophie et la religion se chargent de répondre à la seconde
question ; l’histoire essaye d’éclaircir la première, en dissipant la nuit
qui couvre les origines. Puisque la suite de nos récits nous amène dans la
vieille Gaule, arrêtons-nous un instant à étudier les peuples qui en ont commencé
la civilisation. Nous l’avons fait pour l’Italie ; on nous pardonnera de le
faire pour Dans les âges géologiques, Mais il y a cinq ou six mille ans, au temps où Babylone
bâtissait ses temples et l’Égypte ses pyramides, A l’ombre de ces grands bois erraient le bœuf sauvage[5], qui n’existe
plus que dans une forêt de C’est par les seuls écrivains de Rome et de Les modernes ont cité plus curieux, mais ont longtemps cherché en vain. L’étude comparée des langues a enfin résolu le problème. Les chefs de notre race ont d’abord habité les plaines de la haute Asie, mêlés aux aïeux des Hindous et des Perses, parlant aine langue que ceux-ci comprenaient, et peut-être ayant déjà en germe la corporation sacerdotale des druides, comble les deux autres peuples eurent celles des brahmanes et des mages. A une époque inconnue, les Celtes se séparèrent de leurs frères asiatiques ; ils prirent à l’ouest, et marchèrent dans cette direction tant qu’il y eut de la terre polar les porter[10]. L’Europe était alors, comme Avec leurs haches et leurs couteaux de pierre polie, affilés à la meule ou au polissoir, avec leurs flèches à pointe de silex et des harpons en bois de renne, ils vivaient de la chasse et de la pêche, comme les Peaux-Rouges d’Amérique ; mais ils ne revenaient pas toujours, comme eux, au wigwam accoutumé. Leur terrain de chasse s’étendait sans cesse plus loin. C’étaient bien les hommes des forêts, les Celtes[11], comme les Grecs les appelèrent. À force d’aller et de franchir fleuves et montagnes, ils
arrivèrent un jour au bord de la grande mer qui bornait l’Occident. D’un
point de ses côtes, ils virent de hautes falaises blanchir à l’horizon, et
voulurent encore les atteindre. La grande île qui flanque Ils n’en conservèrent nul souvenir, et se crurent
eux-mêmes nés dans Cette langue des Celtes n’est pas perdue. Elle a une littérature, des poèmes, des légendes, et elle est encore parlée au fond de notre Bretagne, dans quelques coins reculés du pays de Galles, dans le nord de l’Écosse, en Irlande et dans l’île de Man. Ceux qui s’en servent sont les derniers représentants de cet ancien peuple. Ainsi quelques débris restés debout attestent la grandeur des monuments écroulés : mais ces débris mêmes s’amoindrissent chaque jour. En France, il n’y a pas trois cent mille Bas-Bretons qui comprennent encore et parlent l’idiome des druides. Le celte recule devant te français : l’école primaire, celle du régiment et le commerce lui font une guerre mortelle. Les Celtes, dans les auteurs classiques, n’apparaissent que tiers la fin du sixième siècle avant notre ère ; mais ce n’est pas une preuve que ce peuple rte fut pas très ancien en Gaule, où il forma le second ban de la population et le second âge de l’histoire, celui de la pierre polie, des monuments mégalithiques et des palafittes ou stations lacustres. De cette époque datent les dolmens et les cillées couvertes, constructions funéraires, qu’on a trouvées dans onze cents communes de France, et qui ont permis de créer une science nouvelle, celle qui interroge les morts, ou du moins leurs cercueils, et que les Italiens ont si bien nommée la science des tombeaux. Après un long intervalle, arriva le gros des tribus
gauloises apparentées aux Celtes, mais parties beaucoup plus tard de l’Asie,
et eu apportant une culture plus avancée. Établis d’abord dans la vallée du
Danube, au voisinage de pays riches et civilisés, l’Asie Mineure, Poursuivant leur route vers l’ouest, ils franchirent le
Rhin et le Jura, refoulèrent les premiers Celtes devant eux et couvrirent d’innombrables
tumulus On a distingué les Celtes des Gaulois ou Galates[12]. Nous n’avons
pas à discuter des questions spéciales d’ethnologie dans ce rapide résumé qui
montrera seulement la physionomie générale des peuples dont Rome fit la
conquête. L’archéologie gauloise, science née d’hier, a fait rapidement de
grands progrès ; mais elle est encore en formation, et l’historien ne peut
utiliser que les sciences faites ou assez avancées pour avoir résolu les plus
importants problèmes, Du travail accompli, on peut conclure qu’il faut mettre
hors de doute la haute antiquité de l’homme en Gaule, celle aussi des
monuments mégalithiques, qu’on a appelés longtemps des monuments druidiques,
mais dont l’existence a été constatée sur mille points du globe ; l’origine
aryenne des Celtes ou Gaulois et de leur idiome ; la succession de
civilisations différentes sur notre sol ou plutôt le développement progressif
de l’industrie arrivant, des grossiers silex de Saint-Acheul, aux armes et
aux instruments de bronze, surtout de fer, des tumulus ; enfin la longue
occupation par les Gaulois de la vallée du Danube. Pour le reste, il convient
d’attendre la lumière qui sortira du musée de Saint-Germain, où s’accumulent
les objets trouvés dans les innombrables fouilles qu’une armée de savants
exécute. Provisoirement, nous nous en tiendrons à cette phrase de César sur
les habitants de En arrivant dans le pays qui allait garder leur nom, les
Gaulois trouvèrent des peuplades inconnues qu’ils exterminèrent ou
asservirent et des tribus ibériennes établies depuis Il y eut entre les deux races de longs combats. Les
Eskualdunac furent chassés des bords de Quand se produisit la réaction des tribus ibériennes, deux
peuplades gauloises, les Tectosages et les Arécomiques, tinrent bon dans les
bassins de Des Celtes mélangés de Germains étaient restés sur la rive
droite du Rhin : ils franchirent à leur tour le grand fleuve et s’avancèrent
le long de la mer brumeuse jusqu’aux bouches de Deux peuples, d’une origine et d’une civilisation très différentes,
vinrent mêler au sang gaulois quelques gouttes de sang étranger, les
Phéniciens et les Grecs. Les hardis navigateurs de Tyr et de Carthage, qui
parcoururent de si bonne heure tous les rivages de La légende relative à l’Hercule tyrien en dit trop lorsqu’elle
montre les Phéniciens fondateurs de villes dans l’intérieur de Les Phéniciens avaient précédé les Grecs dans la
domination de La nouvelle cité s’accrut rapidement sous la protection du
puissant chef des Ségobriges. Mais Coman, son successeur eut, pour elle des
sentiments contraires. Un jour qu’une grande fête était annoncée, Coman fait
dire aux Massaliotes qu’il voulait honorer leurs dieux, et il envola dans la
ville des chars couverts de feuillage sous lequel étaient des hommes armés.
Lui-même s’approcha des portes avec ses guerriers, et s’y mit en embuscade.
Une femme avait fondé la ville, une autre la sauva. Éprise d’un Phocéen, la
fille d’un Ségobrige dévoila le complot ; les barbares, surpris, furent tués
; Coman lui-même périt. Mais de là sortirent des guerres continuelles qui
auraient fini par épuiser les forces des Massaliotes sans un secours
inattendu. Une horde immense descendait du Mord pour passer les Alpes. Son
chef Bellovèse prit parti pour Marseille et frappa sur les Ligures de tels
coups, que de longtemps ils ne purent inquiéter la cité phocéenne. Elle
reçut, d’ailleurs, en 542, de nombreux renforts. Cyrus et ses Perses ayant
soumis les Grecs d’Asie Mineure, les habitants de Phocée, plutôt que de lui
obéir, abandonnèrent leur ville et jetèrent à la mer une masse de fer rougie
au feu, en jurant de ne rentrer dans Phocée que lorsque ce fer remonterait
brûlant à la surface des eaux ; ensuite ils firent voile pour leur riante
colonie des Gaules. Marseille prospéra par l’alliance des Romains, qui
abattirent tous les rivaux de son commerce ; en reconnaissance, elle leur
ouvrit Il nous reste de ces temps reculés un monument curieux et
étrange, qui n’annonce pas les chefs-d’œuvre que la statuaire grecque
enfantait déjà. C’est une pierre, qu’on eût prise pour un simple caillou,
sans l’inscription qu’elle porte et qui en fait la représentation du fils de Vénus[18]. La première
idole que II. — LES GAULOIS.On a souvent tracé des Gaulois, au moral, un portrait qui
fait d’eux une race supérieure. On leur a donné courage
et loyauté, foi religieuse et amour de la liberté, vivacité de l’intelligence,
aptitude aux lettres, élan vers les idées, vers les choses nouvelles et
promptitude morale à regretter le passé ou quelquefois d se décourager dans
une lutte malheureuse. C’est un charmant pastel, mais il est
douteux que nos guerriers aux moustaches fauves, aux passions violentes et
brutales s’y fussent reconnus. Il n’aurait pas fallu se fier plus que de
raison à leur loyauté. S’il est juste de les tenir pour braves et amoureux de
l’indépendance, on trouverait ces qualités partout. Les druides ont eu grand
crédit parmi eux : les prêtres n’ont-ils jamais régné ailleurs ? Leur élan
vers les idées et les choses nouvelles étonne, car ils ont vécu longtemps
près de la civilisation romaine et grecque, sans lui rien prendre, et les
Galates établis durant six siècles au milieu de l’Asie Mineure y restèrent de
vrais Gaulois. Leur aptitude aux lettres, à cause de quelques rhéteurs,
peut-être d’origine italienne, que
Laissons ces fantaisies et allons au vrai. Notre patriotisme n’est pas intéressé à cacher que nos pères étaient de vrais barbares, très braves, très batailleurs, grands détrancheurs d’hommes et faisant, quand ils le pouvaient, des festins homériques, au fond très semblables aux barbares de tous les temps, parce que la barbarie se ressemble à peu près partout, quand les conditions géographiques sont les mêmes[20]. Seulement les nôtres durent à leurs longs voyages, et plus encore à leur établissement en un pays placé à l’extrémité de la ligne des migrations asiatiques, un caractère particulier. Regardez la mer : au large, la vague est longue et mollement onduleuse ; au rivage, où elle finit, elle produit un ressac violent. Nos Gaulois, établis au bord extrême du continent et sans cesse remués par de nouveaux flots de peuples, luttèrent longtemps, ce qui les fit braves, et furent parfois contraints de céder leurs terres, ce qui les obligea d’en chercher d’autres et leur donna le goût des aventures. Diodore de Sicile, qui écrivait à Rome du temps d’Auguste, représente les Gaulois comme de grande taille, avec la peau blanche et les cheveux blonds. Ce portrait n’est plus le nôtre, parce que notre sang est très mêlé et que les conditions physiques de notre pays et de notre existence ne sont plus les mêmes ; il conviendrait aux Scandinaves et à une bonne partie des Allemands. Quelques-uns, dit le même écrivain, se rasent la barbe, d’autres la laissent croître : les nobles portent de longues moustaches. Ils prennent leurs repas, accroupis sur des peaux de loups et de chiens. A côté d’eux, devant de larges foyers flamboient des chaudières et des broches garnies d’énormes quartiers de viande. On honore les braves en leur offrant les meilleurs morceaux. Tout étranger qui survient est invité au festin : ce n’est qu’après le repas qu’on lui demande qui il est et ce qu’il veut. Alors il faut de longs récits, car les Gaulois sont curieux d’entendre comme de voir. Mais ces festins sont souvent ensanglantés : les paroles font naître des querelles, et, comme ils méprisent la vie, ils se provoquent à des combats singuliers. Leur aspect est effrayant ; ils ont la voix forte et rude, parlent peu et s’expriment par énigmes, en affectant, dans leur langage, de laisser deviner la plupart des choses. Nous n’avons pas gardé cette sobriété de paroles, mais on la retrouve chez les Indiens d’Amérique, qui croiraient se déshonorer s’ils parlaient autrement. Diodore ajoute : Ils emploient volontiers l’hyperbole pour se vanter eux-mêmes ou pour abaisser les autres. C’est encore un trait qui convient à bien des barbares et à beaucoup de civilisés. Les anciens avaient grande peur des Gaulois, qui, enveloppant, parle Nord et l’Ouest, Ies pays de civilisation gréco-latine, y avaient semé souvent l’épouvante et la mort. Ils leur prêtaient des colères puériles qui paraissaient dénoter un caractère indomptable : Race violente, disaient-ils, qui fait la guerre aux hommes, à la nature et aux dieux. Ils lancent des flèches contre le ciel quand il tonne ; ils prennent les armes contre la tempête ; ils marchent, l’épée à la main, au-devant des fleuves débordés, ou de l’Océan en courroux. Strabon les appellera un peuple franc et simple, où chacun ressent les injustices faites à son voisin, et si vivement, que tous se rassemblent promptement pour les venger. C’était une disposition heureuse, mais qu’ils ont partagée avec toutes les tribus guerrières qui ont établi la solidarité du sang et de l’outrage. Les Romains, gens du Leurs maisons furent d’abord les grottes naturelles ou le gourbis de nos populations algériennes, des huttes rondes de branchages recouvertes de terre pétrie ou gazonnée, avec un trou au sommet pour la fumée, et dont l’intérieur était souvent creusé en contrebas du sol. On voit encore en plusieurs lieux de ces excavations circulaires que le peuple appelle, sans se tromper beaucoup, des fosses à loups[22]. Ils plaçaient volontiers leurs demeures au confluent de deux rivières, dans les ales, les presqu’îles, prés d’une source, ou dans le voisinage des forêts ; et ils n’avaient pas pour cela besoin d’aller bien loin. Pour plus de sûreté, les premiers Celtes, quand ils se trouvaient au voisinage d’un lac, établissaient leurs cabanes sur pilotis au milieu des eaux (palafittes), et cet usage se conserva longtemps. Plus tard, quand ils surent creuser des puits, ils établirent, en des lieux élevés et forts, des postes de refuge, oppida. Chaque demeure était entourée de haies faites avec des arbres abattus ; plusieurs de ces enclos réunis par une pareille enceinte formaient un village ou une ville. Longtemps les premiers habitants de Les armes de bronze, alliage de cuivre et d’étain, celles
de fer, plus difficiles à fabriquer[24], sont d’un âge
postérieur et appartinrent d’abord aux tribus de Il faut toucher avec respect ces armes informes ; c’est la première victoire de l’esprit et une conquête bien autrement précieuse alors que toutes les merveilles de la science moderne. Nul ne saura dire combien de temps et d’intelligence ont été dépensés pour arriver à tailler le silex, puis à le polir sur la meule ou le polissoir, pour découvrir le cuivre, sa fusibilité, son alliage avec l’étain, pour faire les moules où le métal fut fondu et coula. De quelle puissance se trouva armé le premier qui tint dans ses mains une hache de métal ! De ce jour seulement l’homme ne fut plus l’être déshérité de la création. Il cessa d’envier la vitesse de l’oiseau ou la force de l’ours, car sa flèche alla plus vite que l’épervier et sa hache abattit la bête fauve. Il y a une ballade fameuse de Schiller, celle du hardi plongeur qui va chercher au fond du gouffre mugissant une coupe d’or que le roi y a jetée. Le cœur lui tremble, malgré son courage, quand il se voit seul, sous les vastes flots, parmi les monstres de l’abîme qui l’entourent et le menacent. Ainsi fut longtemps l’humanité, désarmée au milieu des bêtes dévorantes, jusqu’à ce qu’elle eût conquis la coupe d’or qui renfermait les premiers arts et que l’intelligence pût commencer son grand combat contre la force. Dans les régions scandinaves, les archéologues ont pu
diviser la civilisation préhistorique en trois périodes, celles de la pierre,
du bronze et du fer. La succession n’a pas été aussi régulière en Gaule, où
le bronze et le fer semblent être apparus presque dans le même temps, mais en
quantité différente, le premier de ces métaux fournissant plus d’objets que
le second. Leur présence ne marque pas une évolution spontanée de la
civilisation celtique, car ces métaux arrivèrent en Gaule par la voie des
échanges et donnèrent aux populations de l’Est, qui les reçurent les
premières, la force de refouler dans l’Ouest les représentants moins bien
armés de l’âge des dolmens et de la pierre polie. Au reste, cette vieille
histoire de Le conquérant romain, tout en combattant, regardait, et
ses Commentaires, écrits d’un style net et rapide, fournissent de précieux
détails sur les mœurs et les coutumes de Leurs boucliers étaient travaillés avec beaucoup d’art et parfois décorés de figures d’airain en bosse. Leurs casques d’airain portaient des figures en relief soit d’oiseaux, soit de quadrupèdes, ou des cornes qui semblent avoir eu une signification religieuse, de même que le collier, torques. Les bracelets étaient aussi des ornements indispensables : dans l’âge de pierre, on les faisait avec des coquilles ; plus tard, ils furent en métal, même en or[25]. Le guerrier des prairies d’Amérique et celui des îles Océaniennes surmontent leur tête de plumes brillantes ou d’ornements bizarres. Dans l’âge barbare l’homme a la vanité de la femme : il veut paraître beau autant que fort et brave. Dans les voyages et dans les batailles, les plus riches se servent de chars à deux chevaux, portant un conducteur et un guerrier[26]. Ils lancent d’abord la saunie, et descendent ensuite pour attaquer l’ennemi avec l’épée. Quelques-uns méprisent la mort au point de venir au combat sans autre arme défensive qu’une ceinture autour du corps. Ils amènent avec eux des serviteurs de condition libre, et les emploient comme conducteurs et comme gardes. Avant que la trompette ait donné le signal de l’action, ils ont coutume de sortir des rangs et de provoquer les plus braves des ennemis à un combat singulier, en brandissant leurs armes pour effrayer leurs adversaires. Si quelqu’un accepte le défi, ils chantent les prouesses de leurs ancêtres, vantent leurs propres vertus et insultent leurs adversaires. Ils coupent la tête de leurs ennemis tombés, l’attachent au cou de leurs chevaux et clouent ces trophées à leurs maisons. Si c’est un ennemi renommé, ils conservent sa tête dans de l’huile de cèdre, et on en a vu refuser de vendre cette tête contre son poids d’or. J’en ai vu beaucoup, dit le philosophe Posidonios[27], et j’ai été long à m’habituer à ce spectacle. D’autres enchâssaient dans l’or le crâne de leur ennemi, et s’en servaient en guise de coupe pour les libations religieuses. Ces provocations, ces longs discours, avant d’en venir aux mains, se retrouvent dans l’Iliade, et presque tous les barbares ont fait cet honneur à leurs ennemis, de conserver leur tête ou leur crâne comme un trophée. Avant le combat, ils vouaient souvent à Hésus les dépouilles de l’ennemi, et, après la victoire, ils lui sacrifiaient ce qu’il leur restait du bétail qu’ils avaient enlevé. Le surplus du butin est placé dans un dépôt public ; et on peut voir, dans beaucoup de villes, de ces monceaux de dépouilles entassées dans des lieux consacrés. Il n’arrive guère qu’au mépris de la religion un Gaulois ose s’approprier clandestinement ce qu’il a pris à la guerre, ou ravir quelque chose de ces dépôts. Le plus cruel supplice punit ceux qui commettent ce larcin. Chez les sauvages d’Afrique, d’Australie et du nouveau
monde, qui n’ont pas même dans leurs
langues le mot aimer, la femme est un instrument
de plaisir et de travail qu’on rejette ou que l’on brise, quand il a cessé de
plaire ou de servir. La condition des femmes, en Gaule, annonce un état de
civilisation déjà avancée. De choses, elles sont devenues des personnes.
Libres dans le choix de leur époux, elles apportaient une dot, le mari
prenait sur son bien une valeur égale ; on mettait le tout en commun, et
cette somme restait au survivant avec les fruits qu’elle avait produits[28]. Mais l’époux
avait sur sa femme comme sur ses enfants le droit de vie et de mort, et le
fils ne pouvait aborder son père en public avant d’être en âge de porter les
armes. Dans Lorsqu’un père de famille d’une haute naissance vient à mourir, ses proches s’assemblent, et, s’ils ont quelque soupçon sur sa mort, les femmes sont mises à la question[30] ; si le crime est prouvé, on les fait périr par le feu ou dans les plus horribles tourments. Les funérailles sont magnifiques. Tout ce qu’on croit avoir été cher au défunt pendant sa vie, on le jette dans le bûcher, même les animaux. Peu de temps encore avant l’expédition de César, on brûlait avec le mort les esclaves et les clients qu’il avait le plus aimés. Souvent les parents plaçaient sur le bûcher des lettres adressées a leurs proches, dans la pensée que les morts pourraient les lire, et l’on entassait des pierres sur leur tombeau[31]. Il semble qu’une portion du territoire de chaque peuplade, les pâturages, les eaux, les forêts, restait propriété collective : la tribu elle-même était comme une réunion de clans[32]. Deux classes s’y trouvaient : les nobles et les hommes libres. Les premiers ne composaient pas une caste fermée. Ils avaient de l’illustration, de la richesse, des terres, et autour de chacun d’eux se pressait une foule nombreuse de serviteurs et de clients qui vivaient héréditairement dans la maison ou sur le domaine du chef. César les appelle equites, les chevaliers, et cette cavalerie fut très estimée dans les légions de l’empire. Mais leurs rangs s’ouvraient devant le courage, et qui était digne de prendre place parmi les premiers de la cité, pouvait y prétendre. Quand il survient quelque guerre, ce qui arrive presque chaque année, tous les nobles prennent les armes, et proportionnent à l’éclat de leur naissance et à leurs richesses le nombre de serviteurs et de clients dont ils s’entourent. Quelques-uns de ces clients se vouaient à leur chef à la vie, à la mort. Chez les Aquitains, ces dévoués s’appelaient soldures. Les soldures jouissent de tous les biens de la vie avec ceux auxquels ils se sont consacrés par un pacte d’amitié ; si le chef périt, ils refusent de lui survivre et se tuent. Il n’est pas encore arrivé, de mémoire d’homme, qu’un de ceux qui s’étaient dévoués à un chef par un pacte semblable ait refusé de le suivre dans la mort. Mais cette coutume de la clientèle avait aussi ses
inconvénients : le chef devait défendre ses clients, venger le tort qui leur
était fait ; d’où il résultait que chacune de ces associations formait comme
un État dans l’État, et que la cité était bien souvent pleine de troubles.
Nous avons vu la clientèle à Rome, et elle a existé presque partout, parce qu’elle
est la première des formes sociales : le faible s’appuyant au fort. Mais la
discipline romaine mit la cité au-dessus du clan, le citoyen au-dessus de l’individu
; c’est pourquoi Rome devint forte, tandis que Les chevaliers et leurs clients ne laissaient qu’une place très humble aux hommes libres, plebs pene serco habetur. Cependant le nombre de ceux-ci était une force, et, utilisée par un ambitieux, elle changera plus d’une fois la constitution de l’État[33]. Les anciens formaient le conseil de la cité où certains
peuples ne laissaient pas siéger deux membres de la même famille ; au-dessus
d’eux était le roi ou un chef temporaire, même annuel. Quelques paroles des Commentaires
donneraient à penser que dans les grandes circonstances il se réunissait un
conseil général de Dans les assemblées, des précautions étaient prises contre les décisions précipitées auxquelles des rumeurs populaires auraient pu donner lieu. Dans les cantons, dit César, qui passent pour être le mieux administrés, c’est une loi sacrée que celui qui apprend quelque nouvelle intéressant la cité, doit en informer aussitôt le magistrat, sans la communiquer à nul autre, l’expérience ayant fait connaître que souvent les hommes imprudents et sans lumière s’effrayent de faux bruits, prennent des partis extrêmes, ou même se portent à des crimes. Les magistrats cachent ce qu’ils jugent convenable, et ne révèlent à la multitude que ce qu’ils estiment bon qu’elle sache. C’est dans l’assemblée seulement qu’on vient s’entretenir des affaires publiques. Pour y maintenir l’ordre, les Gaulois avaient établi un usage singulier. Si quelqu’un interrompait l’orateur ou voulait parler hors de son tour, on lui coupait un pan de son manteau. Aux assemblées de guerre, d’autres coutumes existaient : celui dont l’embonpoint ne pouvait être contenu dans une ceinture réservée à cet usage était puni d’une amende, et celui qui arrivait le dernier au rendez-vous d’armes était mis à mort ; celui-là sans doute, en se faisant longtemps attendre, finissait par être regardé comme un réfractaire. Les Romains avaient une coutume analogue . à la revue des chevaliers, celui qui avait une trop forte corpulence était privé de son cheval par le censeur et relégué dans une classe inférieure[34] ; le citoyen qui ne répondait pas à l’appel de son nom pour le service militaire était vendu[35]. III. — LES DRUIDES.Les Gaulois adorèrent d’abord le tonnerre, les astres, l’Océan, les fleuves, les lacs, le vent, les forêts, les montagnes et les grands chênes, c’est-à-dire les forces de la nature, croyances qui, en tous lieux, ont formé le fond du polythéisme primitif. Peu à peu les phénomènes se personnifièrent : Kirk représenta le terrible vent de la vallée du Rhône, le mistral, que les Provençaux nomment encore parfois de son nom gaulois, Cers ; Tarann fut l’esprit du tonnerre ; Bel, le dieu du soleil ; Pennin, le génie des Alpes ; Arduin, celui de l’immense forêt des Ardennes, etc. Plus tard encore, les Gaulois adorèrent les forces morales et des dieux supérieurs Hésus, la cause première qui repousse toujours ; Ceutatés, l’ordonnateur du monde, le père du peuple ; Mercure, l’inventeur des arts et le conducteur des âmes, dont le nom gaulois a disparu ; Camul, le génie farouche de la guerre, le maître des braves ; Borvo, le dieu qui guérit[36] ; Ogmius, le dieu de la poésie et de l’éloquence qui était représenté, avec des chaînes d’or et d’ambre sortant de sa bouche pour aller saisir et entraîner ceux qui l’écoutaient ; la déesse Épona, protectrice des chevaux et des cavaliers, nombreux en Gaule ; les déesses mères, aïeules des Bonnes Dames et des Fées du moyen âge, etc. Le druide, ministre de ces divinités, était à la fois l’interprète des volontés du ciel et des secrets de la terre. Il était prêtre et sorcier, s’abusait lui-même et abusait les autres. C’est l’état des religions et des sacerdoces à toutes les époques barbares. Comme il n’y a pas encore de science qui explique les phénomènes, tous ceux qui se produisent ont un caractère surnaturel dont le prêtre seul rend compte ou que seul il semble pouvoir conjurer. De la sa puissance, qu’il affermissait par un culte imposant et terrible, et par un enseignement qui tenait les fidèles sous son autorité morale[37].
Chaque année, durant la nuit du 1er mai, le
retour radieux du soleil, ou de Bel, était célébré par de grands feux allumés
sur les hauteurs. Nos feux de D’autres herbes saintes avaient vies vertus merveilleuses
; mais, après le gui de chère, rien m’était puissant comme l’œuf de serpent[38]. Durant l’été, dit Pline, on voit se rassembler dans certaines cavernes de Les druides n’ont rien écrit, et les chants des bardes des
anciens jours sont morts avec eus. Mais, dans un coin de l’Angleterre et de Il y avait une femme puissante, la fée blanche, Koridwen, l’épouse de Hu-Ar-Bras, le premier des druides. Koridwen voulait faire sortir la science de la nuit, mais pour elle seule. Dans une chaudière elle lait les sis plantes de grande vertu : l’herbe d’or (probablement une espèce de verveine), la jusquiame, le samolin (le vélar barbare), la verveine, la primevère et le trèfle. Tout autour étaient les perles de la mer. Le nain Korrig se tenait auprès, mêlant les herbes sacrées qui bouillonnaient dans le vase. L’aveugle Morda devait entretenir le feu pendant un an et un jour sans interruption. L’année expirait lorsque trois gouttes de la liqueur enflammée tombèrent sur la main de Korrig. Se sentant brûlé, il porta le doigt à sa bouche. Aussitôt la science se découvre à lui, il comprend et sait tout ; excepté ces trois gouttes, le reste du breuvage était un poison. Le vase se renverse et se brise. Tout est perdu. La fée voit que le secret du monde lui échappe. Elle se jette sur le nain pour le tuer ; lui, il fuit, changeant de forme pour dérouter la poursuite. Mais Koridwen le presse toujours et prend, elle aussi, chaque fois, une forme supérieure et plus forte. D’abord, c’est une levrette qui chasse un lièvre jusqu’au bord d’une rivière. Le nain s’y jette et devient poisson ; une loutre le poursuit et va le saisir, il se change en oiseau ; un épervier fond sur lui, il se laisse tomber sur un tas de froment comme un grain de blé ; la fée blanche devient aussitôt une poule noire qui le trouve et l’avale. Mais la science, la vérité, ne peut périr. Dans le sein de l’ennemie, elle croit, se développe, et neuf mois après, Koridwen met au monde un enfant. Hu-Ar-Bras veut qu’il périsse ; l’enfant est si beau, que Koridwen ne peut se résoudre à le tuer ; elle le met dans un berceau et l’abandonne à la mer. Le fils d’un chef rencontre le berceau arrêté au rivage, et, en voyant le nouveau-né, s’écrie : Taliessin ! (quel front radieux !) Le nom en resta à l’enfant. Taliessin eut la science profonde des druides et les chants harmonieux des bardes. Des sacrifices humains ensanglantaient les grossiers autels que les druides élevaient au milieu des landes sauvages ou au plus tapais des forêts séculaires. Les grands bois ont une majesté sombre et triste qui prédispose à la crainte. Qu’y a-t-il au fond de ces abîmes de verdure qui ont si longtemps recelé pour l’homme des dangers redoutables ? Les druides y montraient des dieux avides de sang. Les Gaulois, dit César, sont très superstitieux : ceux qui sont attaqués de maladies graves, comme ceux qui vivent au milieu de la guerre et des dangers, immolent des victimes humaines, ou font vœu d’en immoler, et ont recours, pour ces sacrifices, au ministère des druides, sans lesquels aucun sacrifice ne peut s’accomplir. Ils pensent que la vie d’un homme est nécessaire pour racheter celle d’un homme, et que les dieux immortels ne peuvent être apaisés qu’à ce prix ; ils ont même institué des sacrifices publics de ce genre. Ils ont quelquefois des mannequins d’une grandeur immense et tissus en osier, dont ils remplissent l’intérieur d’hommes vivants ; ils y mettent le feu et font expirer leurs victimes dans les flammes. Ils pensent que le supplice de ceux qui sont convaincus de vol, de brigandage ou de quelque autre délit, est plus agréable aux dieux immortels ; mais, quand ces hommes leur manquent, ils prennent des innocents. La manière dont tombait la victime, les convulsions de son agonie, la couleur de son sang, étaient autant de signes auxquels le sacrificateur reconnaissait la volonté des dieux[40]. Les Grecs avaient la même croyance quand ils voulaient tuer Iphigénie et qu’Achille égorgeait ses captifs sur la tombe de Patrocle ; les Romains lorsqu’ils enterraient vivants des Gaulois dans le Forum ou qu’ils faisaient combattre des gladiateurs autour d’un tombeau. D’après certains témoignages de l’antiquité grecque et latine, les druides auraient enseigné que des peines et des récompenses, dans une vie à venir, attendaient l’homme. Ils cherchent à persuader, écrit César, que les âmes ne périssent point et qu’après le trépas elles passent dans un autre corps : croyance qui est singulièrement propre à inspirer le courage en éloignant la crainte de la mort. La métempsycose est une idée pythagoricienne que les Grecs ont prêtée aux Gaulois et dont quelques druides hellénisants se seront vantés auprès de César. Rien, en effet, n’autorise à penser que ces prêtres aient eu, touchant le grand problème de la mort, un corps de doctrines mieux arrêté que ne l’était celui des Romains. Mais les cérémonies funèbres prouvent une foi en la vie d’outre-tombe, bien autrement vive que la croyance crépusculaire des Latins en la, triste existence des mânes. Horace, l’épicurien, qui sans cesse répète : Jouissez vite, ne perdez pas un moment, car la mort approche, trouve bien farouche cette Gaule qui ne s’effraye pas des funérailles : Non, parentis funera Galliæ. L’Occident n’a pas vu de peuple qui jouât plus facilement avec la vie et courut avec moins de crainte au-devant du fer, dans les combats, dans les duels, dans l’immolation volontaire des victimes pour les sacrifices, et jusque dans les festins. On en voyait, pour un peu de vin, tendre, après la coupe vidée, la gorge au couteau et mourir en riant. La mort n’était pour eux qu’un passage étroit et sombre au delà duquel ils voyaient briller la lumière. La poussière des anciens renaîtra, disait, au sixième siècle de notre ère, Merlin l’enchanteur[41]. En signe de cette renaissance, dans la nuit du 1er novembre, les druides éteignaient tous les feux. La terre, plongée dans les ténèbres et le silence, semblait morte tout à coup, sur la plus haute colline, un feu brillant resplendissait ; la flamme des foyers domestiques se rallumait, après le foyer national, et le peuple éclatait en chants d’allégresse ; la vie reprenait possession du monde. Dans cette même nuit, Samhan, le juge des morts, s’était assis sur son siège bien loin dans l’Occident, pour juger les âmes de ceux qui avaient succombé durant l’année. Elles arrivaient de tous les points de la grande Gaule, à l’extrémité de l’Armorique, au pied de ce promontoire de Plogoff, contre lequel la mer jette sa plainte éternelle. Les habitants de ce rivage, dit le poète Claudien, entendent les ombres qui arrivent et gémissent ; ils voient passer les pâles fantômes des morts. A l’heure solennelle de la nuit, où les légendes font ,s’ouvrir les cercueils et reparaître ceux qui ne sont plus, les pêcheurs de la côte entendaient frapper à leur porte et trouvaient leurs barques chargées de passagers invisibles. Dès qu’ils avaient orienté la voile et fixé le gouvernail, ils étaient emportés par une force inconnue qui, en quelques instants, amenait l’esquif aux rives de l’île de Prydain. La barque aussitôt s’allégeait, et le nautonier pouvait regagner sa demeure : les âmes étaient parties. Mais elles reviendront pour remplir une seconde existence plus complète et meilleure. La mort n’est que le milieu de la vie. Ne savez-vous pas, fait-on dire au vieux barde Gwenc’hlan[42], qu’il faut que chacun meure trois fois, avant de se reposer pour toujours ? Ainsi le druide recommencera sa vie de méditations et d’étude, afin de savoir davantage ; ainsi le héros renaîtra, pour venger son peuple. Les Gallois n’ont-ils pas durant cinq cents ans attendu le retour d’Arthur ? Les druides formaient non pas une caste héréditaire, niais
un dopé se recrutant parmi les plus capables, avec un pontife suprême, des
conciles et l’arme terrible de l’excommunication. Leur chef avait une
autorité sans bornes. A sa mort, le plus éminent en dignité lui succède ; ou, si
plusieurs ont des titres égaux, l’élection a lieu par le suffrage des
druides, et la place est quelquefois disputée par les armes. A une certaine
époque de l’année, bus les druides s’assemblent dans un lieu consacré, sur la
frontière du pays des Carnutes (Chartres), qui passe pour le point central de Les druides ne vont point à la guerre et ne payent pas d’impôts. Séduits par de si grands privilèges, beaucoup de Gaulois viennent auprès d’eux de leur propre mouvement, oui y sont envoyés par leurs proches. Là, dit-on, ils apprennent un grand nombre de vers ; il en est qui passent vingt années dans cet apprentissage. Il n’est pas permis de confier ces vers à l’écriture, et cependant, dans la plupart des affaires publiques et privées, ils se servent de lettres grecques. Il y a, ce me semble, deux raisons de cet usage : l’une est d’empêcher que leur science ne se répande dans le vulgaire ; l’autre que leurs disciples, se reposant sur l’écriture, ne négligent leur mémoire. Le mouvement des astres, l’immensité de l’univers, la grandeur de la terre, la nature des choses, la force et le pouvoir des dieux immortels, tels sont les sujets de leurs discussions ; ils les transmettent à la jeunesse. Ce profond savoir des druides, dont il ne reste aucune trace authentique, et ce grand pouvoir qu’on ne voit pas agir durant la guerre de l’indépendance, nous sont suspects. Ces prêtres ont évidemment étonné les Romains et leur ont fait penser aux castes sacerdotales de l’Orient dont il était de mode de vanter la sagesse. Les faits connus de l’histoire gauloise ne laissent même pas soupçonner le rôle politique que César leur donne. On est donc tenté de croire que les renseignements fournis par son principal agent en Gaule, le druide Divitiac, homme d’imagination et de peu de scrupule, se rapportaient, non pas au présent, mais à un passé lointain que sa vanité montrait tout plein de la puissance et de la majesté de son ordre. Cependant il faut retenir, des dernières paroles de César,
ce qui concerne la constitution singulière de ce grand corps sacerdotal. Elle
contraste avec toutes les institutions de l’antiquité gréco-latine. À Rome,
le prêtre et le magistrat ne faisaient qu’un : César avait le souverain
pontificat en même temps que l’autorité proconsulaire ; dans On trouve affiliés à l’ordre des druides des bardes, des
devins et des prophétesses. Celles-ci, magiciennes redoutées, aimaient à
vivre sur des écueils sauvages, battus par une mer orageuse. Les neuf
druidesses de l’île de Sein, à la pointe occidentale de Les ovates, où devins, étaient chargés de toute la partie matérielle du culte. C’étaient eux qui cherchaient la révélation de l’avenir dans les entrailles des victimes et le vol des oiseaux. Un Gaulois n’accomplissait aucun acte important sans recourir à la science divinatoire de l’ovate. Telle est l’éternelle curiosité des peuples enfants. Ils ne savent rien du passé, bien peu du présent ; ils n’ont de souci que pour percer les ténèbres de l’avenir. Tant que le pouvoir des druides fît incontesté, les bardes furent les poètes saufs appelés à toutes les cérémonies religieuses. Après que les chefs militaires se furent affranchis de la domination des prêtres, les bardes célébrèrent les puissants et les riches. De chantres des dieux et des héros, ils se firent les courtisans des hommes. On les voyait, à la table des grands, payer, par leurs vers, le droit de s’y asseoir. Un d’eux arrive trop tard, quand Luern, le roi des Arvernes, remontait déjà sur son char ; le barde suit le chef qui s’éloigne, eu déplorant sur une modulation grave et triste le sort du poète que l’heure a trompé. Luern, charmé, lui jette une poignée d’or. Aussitôt la ratte s’anime, ses cordes vibrent avec un son joyeux, et le barde chante : Ô roi, l’or germe sous les roues de ton char ; la fortune et le bonheur tombent de tes mains. Cette tradition nous est venue par les Grecs, et on y reconnaît l’élégance de leur pensée ; l’ancienne poésie des bardes était certainement empreinte du caractère sauvage que ces hommes de sang devaient aimer. IV. — MONUMENTS DITS DRUIDIQUES.On trouve dans un grand nombre de nos provinces de l’Ouest des monuments étranges : peulvens ou menhirs (men, pierre ; hir, longue), blocs énormes de pierres brutes, fichées en terre isolément, ou rangées en avenue ; kroumlech’ ou menhirs disposés soit en un cercle unique, soit en plusieurs cercles concentriques autour d’un menhir plus élevé. Dans ces enceintes religieuses, on déposait les trophées des victoires, les étendards nationaux, même les trésors enlevés à l’ennemi, dont plus tard on confia la garde à des étangs et à des bois consacrés[43]. Les dolmens formés d’une ou plusieurs grandes pierres plates posées horizontalement sur plusieurs pierres verticales, étaient des chambres sépulcrales parfois recouvertes d’un terrassement, et qui renfermaient les restes de quelque chef fameux. Au pied d’un des dolmens des environs de Saumur, on a découvert un squelette avec un couteau de pierre au flanc. Était-ce le guerrier tombé dans la bataille, ou bien la victime immolée dans le sacrifice funéraire ? On connaît les dolmens, dans un grand nombre de
départements, sous les noms de pierre couverte,
pierre levade, table du diable, tuile
des fées, allée couverte.
Il y a de ces monuments qui ont jusqu’à Dans les dolmens on trouve des instruments de pierre, quelquefois du bronze ou de l’or, très rarement du fer. Les palafittes ou cabanes sur pilotis sont du même âge : elles renferment des objets d’os et de pierre, identiques à ceux des dolmens, mais, de plus, des étoffes et, dans les vases tombés de ces cabanes au fond des eaux, des grains de froment, d’orge, d’avoine, de pois et de lentilles : preuve que ces chasseurs savaient aussi cultiver la terre. Ils ne connaissaient pas ou connaissaient fort peu les
métaux, qui abondent, au contraire, dans les tumulus. Ces tombeaux, qui
contiennent beaucoup d’objets en bronze et en fer, n’en ont qu’un petit
nombre eu silex ; et les poteries, moins grossières que celles des dolmens,
sont décorées de losanges, de dents de loup, qui rappellent l’ornementation
des plus anciens vases de
L’allée couverte ou dolmen de Bagneux près de Saumur,
connue sous le nom de Roche aux Fées, a Dans la lande du haut Brambien on compte encore près de
deux mille menhirs debout ou renversés. Celui du Champ-Dolent, près de Dol, a
A Lock-Maria-Ker se trouvent le Roi des menhirs, Ailleurs, ce sont des tombelles comme celle de la presqu’île
de Dhuys, dans le Morbihan, qui a Ces singuliers monuments portent parfois de grossières ciselures et des signes divers : on y voit des croissants, des excavations rondes disposées en cercles, des spirales, des figures qui représentent peut-être des haches de pierre, des serpents ou des arbres entrelacés. On dirait le tatouage bizarre des sauvages appliqué au granit. Les monuments appelés druidiques furent élevés avant l’arrivée
des druides en Gaule ou avant l’époque de leur puissance ; ils appartiennent
aux premières populations celtiques, qui continuèrent longtemps à en
construire. Ces pierres colossales, dressées pour une limite de territoire,
un souvenir aux hommes ou un hommage aux dieux, sont la plus antique
manifestation monumentale de la force humaine, non pas seulement chez les
Gaulois, mais partout. L’Iliade et Beaucoup d’anciens peuples ont, en effet, formé leurs premiers autels et les plus anciens monuments de leur piété envers les dieux où de leur reconnaissance envers les hommes, avec de grands amoncellements de terre ou de pierres non taillées, telles que la nature les leur fournissait. Plus grand était l’effort, plus pesante était la pierre, plus il leur semblait que la divinité devait être satisfaite. Des alignements monstrueux de Karnak aux magnificences du Parthénon la distance est grande, mais la pensée est la même : seulement les Gaulois n’enfermaient pas la divinité en d’étroites murailles, ils lui donnaient des temples dont le ciel était la voûte. Si l’on en croyait les traditions des bardes gallois, les pierres de l’équilibre, comme ils appelaient les rochers que nous avons nommés les pierres branlantes, auraient été l’image de la divinité même, qui, libre dans sa volonté, ne penche, au gré d’aucune passion, plutôt d’un côté que de l’autre. L’idée est trop philosophique pour avoir appartenu à un temps où les dieux, au contraire, étaient conçus comme des êtres passionnés et violents. Le respect pour les pierres druidiques résista aux
interdictions réitérées des conciles de prier ou
d’allumer des flambeaux devant les pierres ; et il n’est pas
effacé partout. Des Bas-Bretons leur attribuent encore des vertus
surnaturelles. En Normandie, on parle, à quelques veillées d’hiver, ou l’on y
parlait naguère, des pierres tourneresses
qui, dans la nuit de Noël, à |
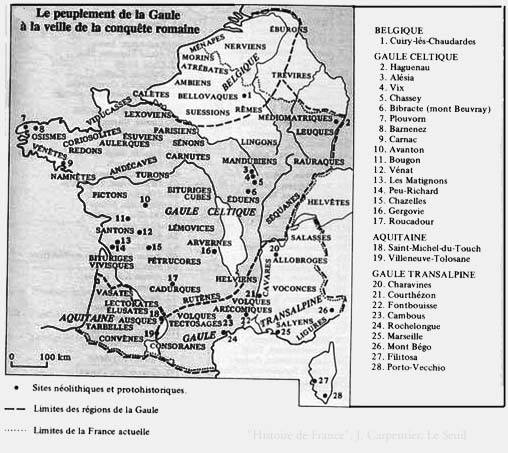
 Les plus célèbres monuments mégalithiques sont dans
Les plus célèbres monuments mégalithiques sont dans 