|
I. — RÉSUMÉ DE LA PÉRIODE
PRÉCÉDENTE.
La vie des peuples se partage en périodes qu’on peut
appeler organiques ou de vie pleine et tranquille, et en périodes
inorganiques ou de transformation violente. Les nations sont dans la première
époque quand elles ont trouvé la forme de gouvernement qui convient le mieux
à leurs intérêts présents, et elles sont dans la seconde lorsque les forces
sociales entrent en lutte les unes contre les autres. Le temps des rois avait
été, à Rome, autant que nous le connaissons, celui de la formation
harmonieuse de la société et de la grandeur de l’État. Il fut suivi d’un
siècle et demi de rivalités intestines et de faiblesse extérieure. Après
Licinius Stolon, au contraire, la paix se rétablit entre les deux ordres par
l’égalité, et la fortune de Rome reprend son cours. Mais aux guerres
héroïques d’Italie et d’Afrique, dont on a vu l’enchaînement inévitable, à
celles de Grèce et d’Orient, plus politiques que nécessaires, succéda, par
l’effet des causes que nous avons longuement étudiées[1], une nouvelle
période de déchirements intérieurs.
Ou premier des Gracques à Sella, durant cinquante années,
ces hommes, naguère si grands en face de Pyrrhus, d’Annibal et des
Macédoniens, redevinrent les fils de la louve ; ils s’égorgèrent entre eux
pour savoir à qui resterait le monde. Afin de suivre, au milieu de tant de
massacres et de ruines, le double mouvement de destruction et de
renouvellement qui s’opère, à cette époque, au sein de la société romaine et
qui, sous des formes et des noms différents, se continuera pendant une autre
moitié de siècle récapitulons les tragédies que nous avons vues, afin de mieux
comprendre celles que nous allons voir.
Deux siècles de guerres, de conquêtes et de pillage
avaient eu pour conséquence de concentrer tous les pouvoirs aux mains d’une
étroite oligarchie et d’user cette portion moyenne du peuple romain qui jadis
remplissait les légions et les tribus rustiques. Deux classes ennemies, les
pauvres et les riches, se trouvèrent en présence. Pour les empêcher de se
jeter l’une sur l’autre, les Gracques essayèrent de reformer par la loi
agraire une population virile de petits propriétaires ruraux, et de
constituer dans l’État, par l’attribution du pouvoir judiciaire aux
chevaliers, un troisième ordre qui tînt la balance entre les deux autres.
Les Gracques tombent sous les coups des grands, et, avec
eux, la cause populaire, qui était celle de la république et de la liberté,
semble perdue. Mais, comme elle offre aux ambitieux un moyen de produire au
Forum des agitations favorables aux menées ténébreuses, des patriciens, des
consulaires, passent au peuple sous prétexte de défendre ses intérêts, et
l’État se partage entre deux factions, les conservateurs obstinés et les
révolutionnaires à outrance. Au fond, les uns et les autres n’ont plus souci
que de pouvoir et d’or ; les idées généreuses qui avaient animé les Gracques
sont mortes avec eux.
Marius, qui reconstitue le parti populaire, ne sait pas le
conduire, et son associé, Saturninus, le compromet par ses violences. Ce
tribun est tué, Marius s’exile, et l’oligarchie triomphe encore.
Scipion Émilien et le second Drusus cherchent une autre
solution au problème de la constitution romaine : ils voudraient faire
place aux Italiens dans la cité, afin de donner à l’empire une large base qui
pût le porter longtemps. L’un est assassiné par les chefs du petit peuple de
Rome, qu’il méprise ; l’autre par les chevaliers, qu’il voulait dépouiller de
la judicature ; et les Italiens, perdant l’espoir qu’une loi leur fasse
justice, recourent aux armes. Une guerre terrible éclate ; le nom seul en dit
l’horreur : la guerre Sociale, ou des alliés.
Les Italiens, vaincus, semblent sortir victorieux de cette
lutte fratricide : ils obtiennent le droit de cité, mais la noblesse, pour
rendre ce droit illusoire, enferme les nouveaux citoyens dans des tribus qui
ne voteront jamais, et en même temps elle s’aliène les chevaliers par le
retrait des jugements.
Marius, revenu d’exil, et Sulpicius profitent de cette
double faute pour associer à leur cause les nouveaux citoyens et l’ordre
équestre. L’un est égorgé ; l’autre, qui, dans sa fuite, manque dix fois de
l’être, revient avec une armée d’esclaves et d’Italiens, se baigne dans le
sang de la noblesse et meurt au moment où le vengeur des grands arrive.
Ainsi chaque parti a du sang sur les mains, mais c’est la
noblesse qui en a le plus répandu. Dans ces cinquante années, l’oligarchie
compte cinq victoires marquées par le meurtre des principaux adversaires du
sénat et couronnées par une dictature inexorable[2].
Sylla croit en finir avec la faction populaire, les
Italiens et les chevaliers, par un immense égorgement, et avec toutes les
nouveautés par une législation qui ramène la république de trois siècles dans
le passé, au temps où les patriciens étaient tout et le peuple rien. Les
essais de réforme en avant ont échoué, la réforme en arrière réussira-t-elle
? On le saura en suivant les dramatiques péripéties de la révolution qui
conduira Rome à une nouvelle époque organique, où ses destinées seront fixées
pour quatre siècles.

II. — POMPÉE.
Les dix années que dura la constitution cornélienne furent
une des plus désastreuses époques que la république ait traversées, celle où
chacun fut le moins assuré d’un lendemain.
La haine du peuple et des Italiens, les ressentiments de
l’ordre équestre et quatre guerres dangereuses : telle était la succession de
Sylla. Qui allait recueillir ce difficile héritage ? Un sénat où les
proscriptions des deux partis n’avaient pas laissé une seule tête qui
dépassât le niveau commun de la médiocrité : Metellus Pius, général
malheureux ; Catulus, en qui se trouvait de quoi
faire plusieurs grands hommes[3], mais qui ne sut
pas être, ce qui eut mieux valu pour la république, un grand citoyen ;
Hortensius, qui ne vivait que pour le barreau et ses murènes ; Crassus, moins
occupé d’affaires publiques que de dénaturer sa fortune mal acquise et
d’acheter Rome pièce à pièce ; Philippus, qui avait si bien manœuvré depuis
vingt ans au milieu des écueils et qui, arrivé au faite des honneurs, s’y
reposait ; enfin le plus capable peut-être de tous ces médiocres personnages,
Lucullus, élégant épicurien, Romain d’Athènes, resté jusqu’alors en
sous-ordre dans les affaires, et sans goût pour le premier rôle. Échappés à
de si longues tourmentes, ces sénateurs ne demandaient qu’à jouir en paix de
la vie, de leur beau soleil, de leurs villas dévastées et qu’ils restauraient.
Mais autour d’eux se pressait une génération plus jeune, plus ardente lus
forte pour le bien comme pour le mal ; Cicéron avait alors vingt-huit ans,
César vingt-quatre, Caton dix-sept ; Brutus était plus jeune ; Catilina et
Verrès avaient déjà rempli des charges.
 Par son âge, Pompée appartenait à cette génération[4] ; mais décoré des
noms de Grand, d’Imperator, de Triomphateur, il marchait à part. Et
nous sommes si loin de l’égalité, si près de la monarchie, que, sans avoir
été régulièrement appelé à aucune fonction, sans être sénateur, sans même
pouvoir compter sur un parti politique, Pompée était tout-puissant dans la
cité. Ce personnage froid, irrésolu et aussi incapable que Marius d’une
conception politique, a été cependant trop maltraité par nos historiens
modernes, qui aiment à juger les hommes par les petits côtés, à les peindre
par l’anecdote, même apocryphe, à la façon de Plutarque. Un homme ne
conserve, durant quarante années, la grande situation que Pompée se fit dès
les premiers jours qu’il la condition d’être par quelque côté supérieur à ses
concitoyens. Il est vrai que, jusqu’à sa dernière bataille, il mérita mieux
que Sylla le surnom de favori de la Fortune. Elle fit beaucoup pour lui : ne fit-il
rien pour elle ? S’il rencontra des circonstances propices, il sut aussi en
faire naître et tirer d’elles, par audace ou sagesse, les avantages qu’un
autre aurait laissé perdre. Ces nuits passées dans les veilles, ces études
persévérantes pour préparer et enchaîner d’avance la victoire, ne sont pas
d’un homme qui s’abandonne paresseusement à la faveur des dieux[5]. Par son âge, Pompée appartenait à cette génération[4] ; mais décoré des
noms de Grand, d’Imperator, de Triomphateur, il marchait à part. Et
nous sommes si loin de l’égalité, si près de la monarchie, que, sans avoir
été régulièrement appelé à aucune fonction, sans être sénateur, sans même
pouvoir compter sur un parti politique, Pompée était tout-puissant dans la
cité. Ce personnage froid, irrésolu et aussi incapable que Marius d’une
conception politique, a été cependant trop maltraité par nos historiens
modernes, qui aiment à juger les hommes par les petits côtés, à les peindre
par l’anecdote, même apocryphe, à la façon de Plutarque. Un homme ne
conserve, durant quarante années, la grande situation que Pompée se fit dès
les premiers jours qu’il la condition d’être par quelque côté supérieur à ses
concitoyens. Il est vrai que, jusqu’à sa dernière bataille, il mérita mieux
que Sylla le surnom de favori de la Fortune. Elle fit beaucoup pour lui : ne fit-il
rien pour elle ? S’il rencontra des circonstances propices, il sut aussi en
faire naître et tirer d’elles, par audace ou sagesse, les avantages qu’un
autre aurait laissé perdre. Ces nuits passées dans les veilles, ces études
persévérantes pour préparer et enchaîner d’avance la victoire, ne sont pas
d’un homme qui s’abandonne paresseusement à la faveur des dieux[5].
Sans être Caton, il avait sa frugalité et sa haine des
molles coutumes venues de l’Orient[6], avec moins
d’affectation et une dignité contenue qui annonçait l’homme fait pour le
commandement. Un jour qu’il était malade et dégoûté de toute nourriture, son
médecin lui recommanda de manger une grive ; on en chercha partout, et il ne
s’en trouva nulle part à vendre. Quelqu’un assura qu’on en aurait chez
Lucullus, qui en nourrissait toute l’année : Eh
quoi ! dit Pompée, si Lucullus n’était
pas un gourmand, Pompée ne saurait vivre ? Et il refusa. Il était
éloquent, car à vingt ans, dans un procès difficile, il sauva la mémoire de
son père et conquit son juge, qui, au tribunal même, le prit pour gendre. Il
était brave[7]
: sa vie presque entière se passa dans les camps ; hardi et entreprenant : au
milieu de l’Italie couverte des légions de Carbon, il se déclara pour Sylla
et lui donna une armée qui peut-être le sauva. Cette armée, Pompée sut la
garder à lui, tout en la faisant servir aux intérêts du parti ; il la
conduisit où le dictateur voulut, en Cisalpine, en Sicile, en Afrique ;
partout vainqueur et imposant par ses succès à Sylla même, qui crut
reconnaître, dans ce jeune homme toujours heureux, cette puissance fatale
qu’il aimait à voir respecter en lui.
Le terrible dictateur fut comme subjugué ; pour empêcher
que ce bonheur ne devînt rival du sien, il fit entrer Pompée dans sa famille,
en lui donnant sa petite-fille Æmilia. Cependant il eut un moment de défiance
; quand Pompée eut vaincu Domitius et Hiarbas, il lui ordonna de licencier
ses troupes. Les soldats se révoltaient à la pensée de perdre le plaisir et
les profits d’une entrée triomphale dans Rome ; Pompée les apaisa et revint
seul. Cette confiance le sauva ; Sylla sortit avec tout le peuple à sa
rencontre et le salua du nom de Grand. Mais il voulait le triomphe, un
triomphé magnifique, car il avait ramené d’Afrique des éléphants pour les
atteler à son char ; et il n’était pas même sénateur ! Sylla refusa. Qu’il prenne donc garde, osa dire le jeune
victorieux, que le soleil levant a plus
d’adorateurs que le soleil couchant. Autour de lui, tout le monde
tremblait ; le dictateur, surpris, pour la première fois céda : Qu’il triomphe, s’écria-t-il à deux reprises, qu’il triomphe ! (81) Le peuple applaudissait à cette
audace, et déjà regardait avec complaisance ce général qui ne tremblait pas
en face de celui devant qui tout le monde tremblait.
Pompée n’avait encore géré aucune charge. Aux faisceaux
consulaires il préférait la position qu’il s’était faite sans élection du
peuple ni du sénat. Seul aussi de tous les chefs syllaniens, il n’avait pas
trempé dans les proscriptions, du moins dans le pillage des biens des
victimes. A Asculum, durant la guerre Sociale, il n’avait pris que quelques
livres. C’était encore une singularité heureuse, et comme un reproche pour
les vainqueurs, une espérance pour les vaincus. Aimé des soldats, respecté du
peuple, il avait un crédit dont il refusa de se servir pour lui-même, parce
qu’il n’aurait pas voulu d’un consulat obscurément passé, et qu’il comprenait
que les temps n’étaient pas venus de se signaler, dans cette magistrature,
par quelque acte mémorable. Agé de vingt-huit ans, il n’aurait pu d’ailleurs
la demander qu’en violant la loi ; mais il tint à prouver son influence en
appuyant une candidature hostile au sénat. Malgré les grands, il fit élire
Lépide, qui ne cachait pas sa haine contre les nouvelles institutions (78)[8]. Jeune homme, lui dit Sylla, en le voyant
traverser tout fier la place des comices, tu es
bien glorieux de ta victoire. En vérité, c’est un bel exploit d’avoir fait
arriver au consulat un mauvais citoyen ! Mais veille avec soin, tu t’es
donné un adversaire plus fort que toi. Ces mots faillirent être
une prophétie. Quand on apprit la mort du dictateur, Lépide voulut empêcher
qu’on rendît à sa mémoire des honneurs publics, et déjà il parlait d’abolir
ses lois. C’était aller trop vite pour pompée. Malgré la froideur que Sylla
lui avait montrée dans les derniers temps[9], Pompée se
respectait trop lui-même pour trahir sitôt la cause qu’il avait tant servie ;
il s’unit à l’autre consul, Catulus, et Sylla mort triompha encore une fois.
Mais, au sortir des funérailles, les deux consuls manquèrent en venir aux
mains[10].

III. — LÉPIDE, NOUVELLE GUERRE
CIVILE (78-77).
Ce Lépide, père du triumvir, appartenait à une illustre
maison patricienne, la gens Æmilia. Dans la guerre civile, il se
déclara pour Sylla et fit une fortune considérable avec les biens des
proscrits. Mis en goût par l’abominable curée, il commit dans sa préture de
Sicile, en 81, de telles exactions, que Cicéron lui accorde le premier rang,
après Verrès, parmi les spoliateurs des provinces[11]. Aussi fat-il en
état de construire le plus beau palais de la ville et de le décorer avec des
colonnes en marbre jaune de Numidie, les premières qu’on eût vues à Rome[12]. Riche et de
haute naissance, Lépide avait toutes ses attaches dans le parti des grands.
Mais, de ce côté-là, les premiers rôles étaient pris ; il passa au parti
contraire, conduit à cette résolution par son mariage avec une Apuleia, fille
de Saturninus, par la crainte d’un procès en concussion, dont il était
menacé, surtout par son ambition ; car les réformateurs désintéressés de la
génération précédente n’avaient plus que des ambitieux pour successeurs.
On tue ou l’on proscrit les hommes, mais on ne vient à
bout des idées justes et des besoins vrais qu’en leur donnant satisfaction,
et, la restauration n’ayant tenu compte d’aucune des nouveautés que le passé avait
produites ou que le présent réclamait, il suffit à Lépide de prononcer ces
seuls mots : rétablissement de la loi frumentaire et rappel des bannis, pour
reconstituer le parti que Sylla pensait avoir étouffé dans le sang[13].
Dès qu’on put croire un des consuls disposé à défaire ce
qu’avait fait la dictature, une foule de gens mirent leurs espérances en de
nouveaux bouleversements. Les familles des victimes comptèrent y retrouver
leurs biens perdus ; la jeunesse dorée, des ressources pour ses ruineuses débauches
; les tribuns, de la puissance ; le peuple, des distractions qui rompraient
avec la monotonie de ces journées silencieuses où, durant trois ans, on
n’avait pas vu un orage au Forum. Les chevaliers ne pardonnaient pas aux
grands la suppression de leur pouvoir judiciaire ; les pauvres, celle des
largesses de l’annone ; les fils des proscrits, la perte de leurs droits
civiques, et les ambitieux, que l’oligarchie tenait éloignés du pouvoir, se
promettaient de tirer parti de ces regrets qui étaient aussi des espérances.
Une grande province, l’Espagne, était aux mains de Sertorius ; la Cisalpine avait pour
gouverneur un Junius Brutus d’une fidélité douteuse ; partout, les nombreux
déclassés qu’avaient faits tant de révolutions en appelaient une nouvelle, et
quelques-uns des marianistes les plus en vue osaient rentrer dans Rome.
Perperna, le préteur que Pompée avait naguère chassé de Sicile, César, le
fils du consul Cinna, etc., y étaient déjà revenus, et, comme il arrive aux
proscrits, ils n’avaient rien oublié.
Lépide alla au plus pressé : il remit en vigueur la loi
Sempronienne sur les distributions de blé au peuple[14], pour gagner les
mendiants de Rome ; et il promit de rendre leurs terres à ceux qui en avaient
été dépouillés, afin de s’attacher les Italiens. Aussi, de toutes parts, les
expropriés relevèrent la tète, et quelques-uns amassèrent des armes. Prêts
les premiers, les gens de Fésules se ruèrent sur les vétérans, dans les
postes, castella, où ceux-ci s’étaient
établis, et les chassèrent de leur territoire après en avoir tué bon nombre.
Ce pouvait être le signal d’un grand incendie. Le sénat, que le dictateur
croyait avoir rendu si fort, s’effraya, sans que la peur lui donnât de
l’énergie. Entre Catulus et Lépide, qui déjà se menaçaient, il lie sut intervenir
que par des prières, pour obtenir d’eux le serment qu’ils ne prendraient pas
les armes Pur contre l’autre, et il crut parer à tout péril en décidant que
les deux consuls se rendraient dans leurs provinces : Catulus, en Cisalpine ;
Lépide, dans la Narbonnaise.
On disait que des attaques étaient à craindre de ce dernier
côté, et l’on commit l’imprudence d’allouer une grosse somme, pour décider
l’avide proconsul qu’on y envoyait à gagner son gouvernement. Comme il
devait, en passant, apaiser l’émeute de Fésules, il était autorisé à lever
des troupes : rien ne lui manquait donc pour se faire une armée.
Taudis qu’il s’éloignait lentement, Catulus continuait la
reconstruction commencée par Sylla du temple Capitolin qui dominait
majestueusement le Forum[15], travail immense
dont il ne reste que les substructions massives qui portent aujourd’hui le palais
du Sénateur de Rome, et qui du temps de Catulus portaient le Tabularium ou salle des Archives. Au bas de la
façade, il plaça une Minerve d’Euphranor, que le peuple prit l’habitude
d’appeler la Catulienne
; mais il réserva pour le temple consacré par son père, après la guerre des
Cimbres, à la Fortune
du jour, deux statues de Phidias ravies, comme la précédente, à la Grèce[16]. Les Romains,
qui ne savaient point faire de ces chefs-d’œuvre, savaient du moins les aimer
et surtout les prendre. Le temple fut rempli d’offrandes de toutes sortes
envoyées par les cités, les peuples et les rois. II en manqua une, un meuble
d’or garni de pierres précieuses que le roi de Syrie destinait au Capitole et
que son ambassadeur, en passant à Syracuse, avait eu l’imprudence de montrer
à Ferrés, qui le vola : le don royal, destiné à Jupiter Très Grand, était
allé décorer le boudoir de l’Hirondelle, une des maîtresses du satrape sicilien[17]. Les fêtes de la
dédicace durèrent plusieurs jours et furent marquées par une nouveauté que
Caton aurait maudite. Catulus, pour mettre les spectateurs à l’abri du
soleil, lit couvrir son théâtre de toiles grossières que remplaceront un jour
les immenses et magnifiques velaria de
l’empire[18].
Pendant que son collègue était occupé par ces soins pieux
et cette sollicitude pour les aises du peuple, Lépide parcourait l’Étrurie,
ramassant, au milieu de populations si cruellement traitées par Sylla, des
hommes, des vivres, des armes, et appelant à lui les vétérans de Marius et de
Carbon. Le gouverneur de la
Cisalpine, Junius Brutus, se déclara pour lui. César, qui
arrivait d’Asie, était pressé par le frère de sa femme, L. Cinna, de suivre
cet exemple ; le caractère du chef, les forces du parti, ne lui parurent pas
assez sûrs : il attendit[19]. Cependant, avec
la promesse de casser les actes de la dictature, Lépide eut bientôt grossi
son armée ; et lorsque le sénat enfin inquiet le rappela sous prétexte de lui
faire tenir les comices consulaires, en réalité pour qu’on pût s’assurer de
sa personne, il quitta la toge, prit l’habit de guerre et marcha sur Rome,
précédé de la déclaration qu’il venait rétablir le peuple dans ses droits et
prendre un second consulat, c’est-à-dire la dictature.
Les pères conscrits essayèrent de négocier ; leurs députés
furent reçus de telle sorte, qu’il fallut se résigner à combattre. La
situation à Rome pouvait avoir ses dangers. Un Cethegus et d’autres jeunes
nobles ruinés couraient les mauvais quartiers en parlant de revanche
prochaine. Les tribuns de cette année, élus sous l’empire des lois
syllaniennes, étaient de minces et timides personnages ; mais, si le brait
des armes faisait taire la loi, un d’eux ne retrouverait-il pas, à l’approche
de Lépide, assez d’audace tribunitienne pour ameuter la foule et mettre le
sénat cornélien entre deux périls ? Un sénateur que nous connaissons depuis
longtemps releva les courages par un discours énergique que Salluste nous a
conservé, en l’arrangeant moins peut-être que ceux qu’il met ordinairement
dans la bouche de ses personnages[20]. Philippus
gourmanda les irrésolutions des sénateurs, qui, confiants dans les
prédictions des augures, aimaient mieux souhaiter la paix que la défendre. Ne comprenez-vous pas que votre inertie vous ôte toute
dignité, à lui toute crainte ? Et cela est juste, puisque ses rapines lui ont
valu le consulat ; ses séditieux desseins, une province et une armée.
Qu’aurait-il gagné à bien servir, lui qui, pour ses méfaits, a reçu de telles
récompenses ? Vos ambassades, vos paroles de paix et de concorde, il les
méprise. Naguère ce Lépide n’était qu’un brigand suivi de quelques bandits
prêts à donner leur vie pour un morceau de pain. Aujourd’hui c’est un
proconsul du peuple romain gui a une charge conférée par vous-mêmes, des
lieutenants à qui la loi impose envers lui l’obéissance, et une armée oui se
sont réunis les mauvais citoyens de tous les ordres, ceux que tourmente la
conscience de leurs crimes. Pour eux, la pais est dans les troubles, le repos
dans les séditions, et ils sèment désordre sur désordre, guerre sur guerre.
Voilà l’Étrurie en feu, les Espagnes en révolte, les survivants de nos
derniers combats en mouvement ; et Mithridate, l’épée suspendue sur nos
provinces tributaires, attend le jour où il pourra frapper.
Les injonctions de Lépide vous
troublent. Il lui plaît, dit-il, que chacun recouvre son bien, et il retient
celui des autres ; qu’on abroge des lois imposées par la force, et il veut
nous contraindre par la violence ; que le droit de cité soit rendu, et il nie
que personne l’ait perdu ; que pour maintenir la paix on rétablisse l’ancien
tribunat, et ce tribunat a été la source de tous les désordres.... Si vous
n’opposez aux armes que des paroles, ménagez-vous le patronage de Cethegus et
de ses pareils, qui sont toujours prêts à recommencer les pillages et les
incendies. Pour moi, je pense que l’interroi Appius, le proconsul Catulus et
tous ceux qui ont l’imperium doivent être chargés par vous de veiller à ce
que la république n’éprouve aucun dommage[21].
Le décret passa, et Catulus fit, ou renouvela en
l’étendant, la loi de vi publica, qui interdisait le feu et l’eau aux
auteurs des violences publiques[22] ; et, en même
temps, il multiplia des levées que le concours de Pompée rendit promptes et
faciles. Trop jeune pour briguer le consulat, trop plein de sa gloire pour
consentir à y arriver en passant par les charges inférieures, Pompée saisit
cette occasion nouvelle de braver les lois en les servant. Un décret du sénat
l’adjoignit à Catulus pour le commandement de l’armée, il en fut le chef
véritable. Les troupes proconsulaires, que rejoignirent beaucoup de vétérans
menacés de restitution, s’établit au Janicule, sur les collines du Vatican,
et au pont Milvius, de manière à défendre le passage du Tibre.
Le médiocre personnage qui se portait l’héritier de Marius
n’avait pas su cacher assez longtemps ses projets pour avoir le loisir
d’organiser ses forces, et il ne mit pas dans l’exécution assez de rapidité
pour surprendre ses adversaires. Campé entre la Crémère et
le Tibre, il faisait entrer dans Rome des émissaires qui cherchaient à l’
déterminer une émeute, mais rien ne bougea. Le peuple courut aux remparts et
au bord du fleuve, afin de voir un spectacle bien autrement intéressant pour lui
que des combats de gladiateurs : les deux armées aux prises, en face du Champ
de Mars. La bataille ne dura guère : les vétérans de Sylla et toute la
noblesse chargèrent si violemment les recrues de Lépide, que l’armée
insurrectionnelle fut rompue et s’enfuit avec son chef du côté de Bolsena.
Lépide pensa un moment à faire route par les montagnes pour aller réveiller
la guerre samnite ; les manœuvres de ses adversaires l’enfermèrent en
Étrurie. Il y subit un second échec qui le rejeta vers la mer, et, tandis que
Catulus l’y poussait avec une prudente lenteur, Pompée eut le temps de courir
dans la Cisalpine,
où M. Junius Brutus s’était enfermé dans Modène. Faute de vivres ou forcé par
quelque trahison, Brutus rendit la place en stipulant qu’il aurait la vie
sauve ; le lendemain, Pompée le fat tuer. Un fils de Lépide et un Scipion,
peut-être le consul de 83 qui durant les proscriptions de Sylla s’était
réfugié à Marseille, furent pris dans la ville ligurienne d’Alba et mis à
mort. La Cisalpine
ainsi pacifiée, à la façon romaine, par des égorgements, Pompée alla
rejoindre Catulus, qui venait d’infliger à Lépide un nouvel échec sous les
murs de Cosa.
En face de cette ville s’élève en mer le mons Argentarius, promontoire escarpé de toutes
parts, qui ne tient au continent que par deux bancs de sable enfermant une
lagune[23]. Lépide les
coupa et se trouva dans une île. Cependant il ne pouvait y tenir longtemps
faute de vivres. Une nuit, il s’embarqua pour la Sardaigne, dans la
pensée d’en soulever les habitants, tandis que son lieutenant Perperna
gagnerait la Sicile
; de là ils tendraient la main à Sertorius et tâcheraient d’affamer Rome, que
les deux !les nourrissaient. La fatigue, le chagrin, firent tomber Lépide
malade ; une lettre de sa femme l’acheva. Elle lui était arrivée par mégarde
et ne pouvait lui laisser de doute ni sur la fidélité d’Apuleia, ni sur
l’estime qu’elle nourrissait pour son époux : Ce
pauvre homme, écrivait-elle à son amant, n’a pas le sens commun. Quelques jours après,
il mourut ; le premier acte de la nouvelle guerre civile était achevé (77).
Cette fois le parti vainqueur s’honora par sa modération,
et, quelques années après, le sénat accorda, sur les instances de César, une
amnistie aux partisans de Lépide.
Cette levée de boucliers rattacha Pompée au sénat, qui lui
rendait son armée. Catulus lui ordonna, il est vrai, de la licencier ; mais
il ne tint compte de cet ordre, et le sénat .n’osa insister. Dans le parti
des nobles, Pompée ne voyait donc personne au-dessus de lui ; dans le parti
contraire, les chefs, s’ils triomphaient, l’admettraient-ils même au partage
? Certainement la réaction démocratique l’eût frappé. Si elle devait s’opérer
un jour, il entendait du moins que ce fût par ses mains, et il était assez
bon citoyen pour vouloir qu’elle arrivât lentement, sans secousse, sans
proscriptions nouvelles. Il accepta donc le rôle d’exécuteur testamentaire de
Sylla, et, après Lépide, il alla combattre Sertorius.

IV. — SERTORIUS ; CONTINUATION DE LA GUERRE CIVILE
(80-75).
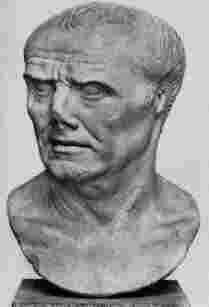 Nous connaissons Sertorius, ce Sabin qui fut, comme
Marius, sans aïeux et sans postérité, et, comme lui, meilleur général
qu’habile politique. Il s’était distingué dans la guerre des Cimbres, et ses
longs services en Gaule l’avaient si bien familiarisé avec la langue et les
habitudes des barbares, que plusieurs fois il pénétra sous un déguisement
dans le camp des Teutons pour observer leurs forces et leurs dispositions.
Durant la guerre Sociale, il fut encore l’intermédiaire entre le sénat et les
Gaulois italiens, qu’il sut retenir dans la fidélité. Il demanda le tribunat
; les syllaniens l’empêchèrent d’y arriver, et ce refus le rejeta pour
toujours dans le parti de son ancien général. Réservé dans ses mœurs, d’une
sobriété africaine, mangeant peu et à l’heure qu’on voulait, brave jusqu’à la
témérité, ce qui lui valut beaucoup de blessures et la perte d’un œil, fécond
en ruses militaires, d’une activité enfile qu’aucune fatigue ne parvenait à
lasser, Sertorius avait toutes les qualités nécessaires au chef d’une armée
irrégulière, et ses antécédents faisaient de lui la dernière espérance des
marianistes[24]. Nous connaissons Sertorius, ce Sabin qui fut, comme
Marius, sans aïeux et sans postérité, et, comme lui, meilleur général
qu’habile politique. Il s’était distingué dans la guerre des Cimbres, et ses
longs services en Gaule l’avaient si bien familiarisé avec la langue et les
habitudes des barbares, que plusieurs fois il pénétra sous un déguisement
dans le camp des Teutons pour observer leurs forces et leurs dispositions.
Durant la guerre Sociale, il fut encore l’intermédiaire entre le sénat et les
Gaulois italiens, qu’il sut retenir dans la fidélité. Il demanda le tribunat
; les syllaniens l’empêchèrent d’y arriver, et ce refus le rejeta pour
toujours dans le parti de son ancien général. Réservé dans ses mœurs, d’une
sobriété africaine, mangeant peu et à l’heure qu’on voulait, brave jusqu’à la
témérité, ce qui lui valut beaucoup de blessures et la perte d’un œil, fécond
en ruses militaires, d’une activité enfile qu’aucune fatigue ne parvenait à
lasser, Sertorius avait toutes les qualités nécessaires au chef d’une armée
irrégulière, et ses antécédents faisaient de lui la dernière espérance des
marianistes[24].
Après l’insurrection des esclaves contre leurs maîtres,
des plébéiens contre les grands, des Italiens contre Rome, nous avons vu tous
les peuples des parties orientales de l’empire aider de leurs vaux ou de
leurs bras Mithridate à renverser une domination odieuse. Pour la fortune de
Rome, il se trouva que, s’il y avait unanimité dans la haine, on ne sut pas
en mettre dans le conseil ni dans l’action. Elle eût succombé sous le poids de
l’univers conjuré, elle triompha d’adversaires qui vinrent successivement
frapper le colosse de coups mal concertés.
Après la défection de l’armée de Scipion, Sertorius
s’était rendu en Espagne (82), avec le titre de préteur qu’il devait aux marianistes et
qui lui donnait l’autorité légale dans ces provinces. Il étudia le pays, ses
ressources, l’esprit de cette race vaillante où les filles choisissaient
elles-mêmes leur époux parmi les plus braves, le préféré étant celui qui
pouvait offrir à sa fiancée la main droite d’un ennemi qu’il avait tué ; et
il les gagna par sa douceur, qui contrastait avec la rapacité et l’insolence
des gouverneurs ordinaires. Il avait déjà servi dans la péninsule comme
tribun militaire et mérité l’estime des Espagnols, en les battant par un
adroit stratagème.
Des soldats romains en garnison à Castula (Cazlona) avaient, par leur
insolence, exaspéré les habitants, qui appelèrent à l’aide leurs voisins et,
une nuit, leur ouvrirent une des portes de la cité. Bon nombre de Romains périrent
: Sertorius s’était échappé à temps ; suivi de tous les légionnaires qu’il
avait pu rallier, il fit le tour de la ville, y rentra par la porte que les
Espagnols n’avaient point fermée, et ceux-ci, surpris à leur tour, furent
égorgés. Le jour venu, avec ses soldats, qui avaient revêtu les habits et les
armes des barbares, il courut à leur ville, dont la population vint, sans
défiance, à la rencontre de ceux qu’elle croyait des amis, et il ne cessa le
massacre que pour vendre les survivants. L’affaire fit du bruit, et le nom de
Sertorius fut, depuis ce jour, fameux en Espagne. Quand on sut qu’il venait y
commander en chef, qu’on le vit diminuer les subsides, dispenser les villes
des logements militaires, en vivant lui et les siens sous la tente, de nombreux
volontaires accoururent à lui. Faciles à l’illusion, ils croyaient que ce
Romain, proscrit à Rome, allait combattre pour eux.
Cependant Sylla ne l’avait pas oublié, et une nombreuse
armée arrivait en Gaule, sous les ordres d’Annius. Un des lieutenants de
Sertorius, Livius Salinator, chargé ; de garder les passages des Pyrénées,
repoussa d’abord toutes les attaques ; mais il fut assassiné par un traître,
et, ses troupes s’étant débandées, Annius pénétra dans la province (81). Sertorius,
trop faible pour lui tenir tête, recula jusqu’à Carthagène.
Partout Sylla triomphait : la terre lui obéissait et
rejetait les proscrits, la mer seule était libre encore. Sertorius s’embarqua
avec trois mille hommes, et pendant plusieurs mois erra des côtes d’Espagne à
celles d’Afrique : une fois il surprit les îles Pityusæ[25], un autre jour
il pilla le pays aux bouches du Buis. Fatigué cependant de cette existence
précaire qui l’assimilait aux pirates ses alliés, il songea un moment à
renoncer à une lutte impossible et à chercher, loin du monde asservi, un
séjour tranquille, dans les îles Fortunées (les Canaries)[26]. Mais ses
soldats avaient peu de goût pour les mœurs de l’âge d’or : ils lui firent
abandonner ce projet, dont il n’avait sans doute parlé que pour provoquer de
leur part la résolution de combattre encore.
Les Marusiens, peuple maure, étaient alors soulevés contre
leur roi Ascalis, qu’un lieutenant de Sylla avait secouru ; Sertorius battit
ce prince, même ses auxiliaires, et emporta d’assaut la ville de Tingis qui
commandait l’entrée de la Méditerranée et d’où l’on voyait l’Espagne.
C’est là qu’il voulait retourner. Le bruit de ses succès s’y était déjà
répandu, et on y ajoutait des circonstances merveilleuses : il avait,
disait-on, découvert le corps du géant Antée et, seul des hommes, vu ces
ossements longs de 60 coudées. Les Lusitaniens, opprimés par Annius,
l’invitèrent à se mettre à leur tête ; il accepta, et, passant au travers de
la flotte romaine, il descendit dans la péninsule avec mille neuf cents
Romains et sept cents Africains ; les Lusitaniens lui fournirent quatre
raille fantassins et sept cents cavaliers ; ce fut avec mous de huit mille
hommes qu’il osa déclarer la guerre au maître du monde romain. Mais ses
soldats avaient la plus entière confiance dans celui qu’ils appelaient le
nouvel Annibal, dans le général qui savait trouver des ressources où d’autres
n’en voyaient pas, tenir son armée dans l’abondance en de pauvres pays, ses
alliés dans la fidélité tout en leur demandant beaucoup ; qui inquiétait l’adversaire
par la rapidité de ses marches, et reparaissait aussi redoutable le lendemain
d’une défaite que la veille d’une victoire.
Sertorius défit d’abord le propréteur de la Bétique, et un de
ses lieutenants vainquit et tua le gouverneur de la Citérieure (80). Metellus,
chargé par le dictateur d’arrêter ces dangereux succès, ne put amener son
adversaire à une bataille (79). Sertorius, qui connaissait les passages des montagnes
aussi bien que le plus habile chasseur du pays, avait adopté la manière de
combattre des habitants ; ses soldats étaient prompts à la retraite comme à
l’attaque. Habitués à profiter de tous les accidents du terrain, ils
menaçaient l’ennemi presque en même temps, malgré leur petit nombre, en tête,
en flanc et sur les derrières. Avec, sa grosse et lourde armée, Metellus ne
pouvait atteindre ces agiles montagnards qui faisaient campagne sans tentes
ni chariots, qui mangeaient à l’aventure, dormaient sous les étoiles, qu’on
trouvait partout et qu’on n’arrêtait nulle part. Il pouvait promener sa
pesante infanterie fun bout à l’autre de sa province, car les Espagnols
n’osaient attaquer ses retranchements toujours construits à l’ancienne mode
romaine, avec fossé et palissades ; mais, en réalité, il ne possédait rien au
delà de l’enceinte de son camp et avait peine à nourrir ses troupes. Les
attaques imprévues de son adversaire, ses rapides mouvements, ses bravades,
déconcertaient le général méthodique. Assiégeait-il une ville, ses convois
étaient coupés, et il se trouvait lui-même comme prisonnier dans ses lignes ;
traversait-il un défilé, de derrière chaque rocher se levait un soldat qui
lançait ses traits, puis fuyait plus léger que le vent. Sertorius donnait aux
siens l’exemple de l’audace : magnifiquement armé,, on le voyait toujours aux
avant-postes, se réservant les coups les plus hardis ; un jour, il provoqua
Metellus en combat singulier. Les Espagnols croyaient aussi voir revivre le
grand adversaire de Rome que Carthage avait envoyé à leurs pères.
Malgré l’assurance qu’il avait d’abord montrée, Metellus
fut contraint d’appeler à son aide le proconsul de la Narbonnaise, L.
Manlius. Il dépêcha au-devant de lui son questeur avec une division pour
recevoir les trois légions et les mille cinq cents cavaliers qui allaient
arriver. Sertorius prévint cette jonction : le questeur et sa division furent
enlevés, et quand Manlius déboucha des Pyrénées, il fut si complètement
battu, qu’il se sauva presque seul à Ilerda (Lérida). La route de la Gaule était ouverte à
Sertorius, une attaque de Metellus sur Lacobriga, dans la Lusitanie, vers
l’embouchure du Douro, le rappela en arrière. Le proconsul croyait avoir bien
pris cette fois toutes ses mesures ; la place n’en fut pas moins secourue et
les légions forcées de sortir de la province.
Malgré la présence de cette grande armée, Sertorius était
véritablement maître de toute l’Espagne : il réglait les contestations des
peuples et des particuliers, levait des troupes, qu’il cantonnait dans des
casernes pour ne pas les rendre à charge aux habitants ; il fortifiait les
villes et les passages des montagnes, exerçait les indigènes à la tactique
romaine et surtout s’appliquait à gagner leur confiance. Il avait su leur
persuader qu’il était en rapport avec les dieux ; une biche blanche qui
toujours le suivait était l’intermédiaire : lui arrivait-il secrètement une
nouvelle importante, la biche s’approchait de son oreille et lui communiquait
le mystérieux message, qu’il répétait tout haut et que l’événement bientôt
confirmait. Ce manège suffisait à la crédulité de ces peuples enfants.
Du reste il commandait leur respect par son attention à ne
souffrir de la part des soldats romains aucune licence : un jour, il fit tuer
toute une cohorte qui s’était rendue odieuse par des excès ; aussi leur
dévouement à sa personne était sans réserve. Comme les chefs aquitains, il
était entouré d’une troupe fidèle prête à mourir pour lui.
Ce n’était pas pourtant une armée facile à tenir en ordre,
mais il y employait tous les moyens. Un jour, ses Espagnols impatients de
combattre engagent l’action malgré ses ordres et sont repoussés. Le
lendemain, il les réunit et fait amener deux chevaux conduits l’un par un
vieillard débile, l’autre par un robuste soldat, et il commande à ces deux
hommes que chacun arrache la queue de son cheval. Le soldat la saisit de ses
deux mains et s’épuise en vains efforts, tandis que le vieillard tirant les
crins l’un après l’autre réussit sans peine. Vous
voyez, leur dit-il, que la patience
vaut mieux que l’impétuosité ; les choses dont on ne saurait venir à bout tout
à la fois se peuvent faire l’une après l’autre. L’armée romaine est
invincible quand vous l’attaquez de front et en masse, aisée à détruire si
vous l’affaiblissez en détail. Cette éloquence en action, dont
Annibal s’était déjà servi, frappa l’esprit des barbares bien plus que de
longs discours ; les Espagnols trouvaient à leur chef autant de sagesse qu’il
avait de vaillance.
La défaite de Lépide en Étrurie valut à Sertorius un
secours important (77)
: Perperna passa en Espagne avec les débris considérables encore de cette
armée ; il voulait agir seul, les soldats le forcèrent à se placer sous les
ordres du plus glorieux des chefs marianistes. Avec lui étaient venus
plusieurs sénateurs et des Romains de distinction. Sertorius en forma un
sénat de trois cents membres, et, pour bien montrer qu’il était resté Romain
au milieu des barbares, il n’admit aucun Espagnol dans cette assemblée, de
mime qu’il leur refusait les grades élevés dans ses troupes[27]. C’était une
faute, car les Espagnols avaient cru que ce Romain exilé combattrait pour
eux, et ils commençaient à comprendre que marianistes et syllaniens, parti
populaire et parti des grands, ne voulaient que la même chose :
maintenir à leur profit la domination de Rome sur les provinces. Sertorius
avait réuni à Osca (Huesca) les enfants
des meilleures familles pour les instruire dans les lettres grecques et
latines ; il se plaisait à suivre leurs travaux et à distribuer aux plus
habiles les bulles d’or qu’on donnait à Rome aux fils des nobles. Ils avaient
regardé ces soins comme un honneur, comme une promesse d’élever un jour leurs
enfants aux charges de la république ; ils en vinrent à penser qu’on pouvait
bien les tenir à Osca à titre d’otages de leur fidélité, et leur zèle en eût
été refroidi, si Metellus n’avait débuté par des menaces et par
l’établissement de nouveaux impôts. Corneille fait dire à Sertorius :
Rome
n’est plus dans Rome ; elle est toute où je suis.
Le vers est beau et ce pouvait être la pensée du banni,
mais il était imprudent de la trop montrer.
A la suite de ses derniers succès, Sertorius avait soulevé
les Aquitains, qui battirent un proconsul et tuèrent un préteur. Il lui fut
aisé d’entraîner aussi la
Narbonnaise, qui récemment avait fourni des recrues à
Lépide[28] et dont tous les
peuples n’étaient pas encore façonnés à l’obéissance. Un de ses lieutenants
alla même garder les passages des Alpes, et, de Rome, il reçut des
sollicitations pressantes pour descendre en Italie, car plus d’un, jusque
parmi les nobles, souhaitaient le renversement d’un ordre de choses qui, tout
en servant l’oligarchie, embarrassait de trop lourdes entraves l’avidité
personnelle des oligarques.
Le sénat tenait une flotte dans les eaux d’Espagne, mais
elle avait fort à faire avec les pirates dont nous parlerons bientôt et qui,
dans cette dissolution apparente du colosse romain, avaient pris la mer pour
leur part. Alliés naturels des ennemis de Rome, ils rendaient à Sertorius
tous les services réclamés d’eux. Il leur avait ouvert à la pointe la plus
avancée de l’Espagne vers l’est, au triple promontoire de Diane, une
forteresse qui leur servait de comptoir pour acheter les prisonniers et
remiser leurs prises, de vigie[29] pour explorer au
loin la mer, et courir sus aux vaisseaux de transport, de repaire où ils
cachaient leurs légers navires à l’approche des gros bâtiments militaires. La
situation devenait donc inquiétante : la guerre civile grondait aux portes de
Rome, et l’œuvre de Sylla menaçait ruine. Malgré sa répugnance à demander de
nouveaux services à Pompée, le sénat l’envoya au secours de Metellus, avec
les pouvoirs proconsulaires et le gouvernement de l’Espagne Citérieure,
violant ainsi la constitution syllanienne en croyant la sauver.
Pompée n’avait pas encore licencié ses troupes ; en
quarante jours il eut achevé ses préparatifs, et il s’achemina vers les Alpes
avec trente mille fantassins et mille cavaliers (76). Pour éviter les passages que
gardaient les détachements de Sertorius et signaler les commencements de son
expédition par une marche hardie, il s’ouvrit une route nouvelle probablement
à travers les Alpes Cottiennes. Les cohortes espagnoles, tournées, se
replièrent sur les Pyrénées, abandonnant la Narbonnaise, qui
expia cruellement sa révolte : elle fut mise à feu et à sang ; l’ancien
lieutenant de Sylla semblait animé de son esprit. Jusqu’à
Narbonne, dit Cicéron, sa route fut
marquée par des massacres. Ensuite vinrent les confiscations : des
populations entières furent chassées ; les Helves et les Arécomiques
perdirent une partie de leurs terres, qui servirent à récompenser la fidélité
de Marseille, les Ruthènes (Rouergue) furent réunis à la Province, et quand il
entra enfin en Espagne, il laissa aux Gaulois, pour les gouverner, l’homme le
plus dur et le plus avide, le proconsul Fonteius[30].
Sertorius ne défendit pas les passages, il assiégeait
alors Lauron (Liria ?)[31], non loin de
Valence ; Pompée se vanta de le chasser aisément de ses positions, et marcha
sur la ville : J’apprendrai à cet écolier,
dit Sertorius, qu’un général doit regarder autant
en arrière qu’en avant. Il lui enleva d’abord une légion, et
l’affama dans son camp, puis battit tous ses détachements, emporta Lauron
sous ses yeux, et le contraignit à retourner prendre ses cantonnements au
pied du Monserrat, dans le pays des Laletans et des Indigètes, qui occupaient
l’angle nord-est de la péninsule. Tels étaient les tristes résultats de la
campagne si pompeusement annoncée (76).
Sertorius passa l’hiver à refaire ses troupes, qu’il exerçait sans cesse selon la vieille méthode de nos
pères[32], et à fortifier
sa position sur l’Èbre, pour empêcher la réunion des deux armées du sénat,
celle du nord sous Pompée, celle du sud sous Metellus. Après avoir soumis
quelques villes celtibériennes, dont une, Contrebia[33], l’arrêta
quarante-quatre jours, il appela dans son camp les députés des villes qui
soutenaient sa cause, leur exposa ses plans et obtint d’eux les moyens de
renouveler son matériel et d’habiller ses soldats. Au retour du printemps, il
envoya Perperna chez les Ilercaons, vers les bouches du fleuve, afin d’ôter à
Pompée le moyen de s’approvisionner par mer ; lui-même remonta la vallée,
pour que son adversaire ne pût tirer des vivres par le haut du pays, et il
chargea deux autres de ses lieutenants, Herennius et Hirtuleius, échelonnés
le long de la côte, de contenir Metellus, qui campait dans la Bétique.
Malheureusement Hirtuleius fut défait par Metellus, près
d’Italica[34],
Perperna par Pompée, et la jonction des deux généraux devint possible. Ils se
rapprochaient l’un de l’autre en suivant la côte orientale, afin de se tenir
à portée de la flotte qui les approvisionnait. Pour se placer entre eux,
Sertorius se jeta dans le pays difficile d’où le Xucar (Sucro) et le
Guadalaviar (Turia)[35] descendent dans
la riche plaine de Valence et d’Elche. Pompée, attaqué le premier, fut vaincu
sur les bords du Sucro ; Sertorius comptait le lendemain l’accabler,
quand Metellus parut : Sans cette vieille femme,
dit-il, j’aurais renvoyé ce petit garçon à Rome,
châtié comme il le mérite ; et, assignant à ses troupes un lieu de
réunion, il les dispersa. La bataille de la Turia était donc moitié victoire, moitié débit,
et il aurait fallu à Sertorius un grand succès pour conjurer le péril où le
mettait la réunion de ces deux puissantes armées ; en réalité il était battu,
puisqu’il avait échoué dans la tentative de séparer ses adversaires.
Les deux généraux se rencontrèrent près de Sagonte. À
l’approche de celui qui lui était supérieur en âge et en dignités, Pompée fit
abaisser ses faisceaux ; mais le vieux consulaire, connaissant la vanité de son
jeune collègue, ne le voulut souffrir. La seule prérogative qu’il se réserva
fut de donner le mot d’ordre quand les armées camperaient ensemble. La
difficulté de faire vivre leurs troupes allait les obliger à se séparer,
quand Sertorius attaqua. Sa biche, présent de Diane, avait disparu depuis la
dernière bataille : des soldats la lui ramenèrent ; il acheta leur silence,
et, annonçant que le retour de la messagère des dieux était le présage d’une
victoire, il s’avança en couvrant sa marche pour enlever les détachements que
l’ennemi enverrait au fourrage. Il tomba en effet sur une division de Pompée,
assez près du camp pour que ce général pût envoyer au secours toute son
armée, qui perdit six mille hommes ; mais, toujours malheureux dans ses
lieutenants, il apprit que dans le même moment Perperna, attaqué par
Metellus, laissait cinq mille morts sur le champ de bataille. Une attaque,
essayée le lendemain sur les lignes de Metellus, prés de Sagonte, ne réussit
pas. Il renvoya encore la plus grande partie des siens, en leur fixant un
rendez-vous, ce qui le dispensait d’avoir un trésor et des magasins ; avec le
reste, il regagna les montagnes et se porta sur le flanc droit de I’armée
combinée, pour gêner ses mouvements, en la menaçant toujours, tandis que les
pirates ses alliés couperaient les convois qui pouvaient lui arriver par mer.
L’hiver approchait, Metellus alla prendre ses quartiers dans la Bétique[36].
Pompée, plus confiant, marcha sur Sertorius, mais ses
légions, épuisées par le froid, par la faim et par des combats continuels, ne
gagnèrent qu’en désordre le pays des Vaccéens (75).
Le monde romain était alors singulièrement troublé.
Laguerre faisait rage partout, sur terre et sur mer, en Asie, en Thrace[37], en Espagne,
tout la long des côtes, où l’on redoutait à chaque instant de voir arriver
les pirates et, avec eux, le pillage, l’incendie, le rapt. La nature même
était pleine de menaces. Une peste sortie d’Égypte frappait les animaux ; la
ruine du bétail et des attelages avait amené celle de l’agriculture, durant
trois années la famine décima les populations. Le sénat épuisait les
ressources du trésor à combattre ces misères, sans venir à bout de nourrir
ses armées, et, dans la ville, le peuple, qui avait faim, faisait des émeutes
; le consul Cotta, un honnête homme, faillit y périr. Il avait osé leur dire
: Eh pourquoi donc seriez-vous à l’aise dans
Rome, pendant que les armées souffrent ? Celle de Pompée était
sans solde depuis deux ans, et elle était menacée d’être bientôt sans pain.
Il écrivit au sénat une lettre menaçante et fière où on lisait : J’ai tout épuisé, mon bien et mon crédit, et vous, dans
ces trois campagnes, vous nous avez donné à peine la subsistance d’une année.
Pensez-vous donc que je puisse suppléer au trésor ou entretenir une armée
sans vivres et sans argent ?... Vous connaissez nos services et, dans votre
reconnaissance, vous nous donnez l’indigence et la faim. C’est pourquoi je
vous avertis et je vous prie d’y réfléchir, ne me forcez pas à ne prendre
conseil que de la nécessité... Je vous
le prédis, mon armée et avec elle toute la guerre d’Espagne passeront en
Italie. Malgré le ton de cette lettre, le consul Lucullus, qui
craignait que Pompée ne vint lui disputer le commandement de la guerre contre
Mithridate, se hâta de lui envoyer du blé, de l’argent et deux légions.
Mithridate suivait d’un œil attentif tous ces mouvements.
Depuis la mort de Sylla, il était décidé à reprendre les armes ; les succès
de Sertorius lui promettant une utile diversion, il envoya offrir à ce
général quarante navires et 3.000 talents : il demandait la cession de
l’Asie. Sertorius ne consentit qu’à l’abandon de la Cappadoce et de la Bithynie. Nos victoires, disait-il à ses conseillers, doivent agrandir et non diminuer l’empire de Rome.
— Que nous commandera donc Sertorius,
répondit le prince, quand il sera à Rome, si,
proscrit, il nous fait de telles conditions ? Cependant il
accepta, et Sertorius lui envoya un de ses officiers, Varius, avec quelques
troupes. Les pirates devaient servir de lien entre les deux alliés.
Heureusement pour la république, tout se borna à ces ambassades. Les pirates
étaient une force indisciplinable, et, à cette distance de 1000 lieues,
Sertorius et Mithridate ne pouvaient rien concerter.
Cette alliance avec un ennemi de Rome servit de prétexte à
Metellus pour mettre à prix la tête de Sertorius : il promit au meurtrier 100
talents et 2.000 jugera sans ébranler la fidélité d’un seul des gardes
du proscrit. Après la bataille de Sagonte, fier d’avoir vaincu là oui son
jeune rival avait éprouvé un revers, il avait pris le titre d’imperator,
demandé aux villes des couronnes d’or et à tous les poètes de la province des
chants pour célébrer ses hauts faits.
Dans le sud et l’est de la péninsule presque tous les
peuples reconnaissaient l’autorité, des généraux de la république ; mais rien
n’était décidé tant que ceux-ci n’avaient pas abattu le grand homme de guerre
qui, avec Annibal et César ; résume en lui toute la science militaire de
l’antiquité. Les deux proconsuls se décidèrent à pénétrer dans la vallée de
l’Èbre supérieur, pays difficile, population à la tête aussi dure que ses
montagnes et attachée à celui qui, malgré tout, semblait être le défenseur de
l’indépendance espagnole. Metellus et Pompée refoulèrent Sertorius devant eux
et crurent un jour l’avoir cerné au bord du Bilbilis grossi par les orages.
Mais il y trouva un passage, fit, en avant du gué, un grand abatis d’arbres
disposé en demi-cercle et y mit le feu pendant que sa troupe passait[38]. Les Romains,
quelque temps arrêtés par cet obstacle d’un genre nouveau, continuèrent la
poursuite sur l’autre bord et si vivement, que Sertorius faillit être pris à
la porte de Calagurris (Calahorra). Les
Espagnols l’enlevèrent sur leurs épaules et se le passèrent de l’un à l’autre
jusqu’à la muraille[39], tandis qu’en
arrière les dévoués, qui formaient sa garde, se faisaient tuer en
contenant l’ennemi.
Au bout de quelques jours, Sertorius sortit de la ville,
malgré la vigilance des assiégeants, retrouva ses bandes au lieu qu’il leur
avait fixé pour rendez-vous, et recommença ses continuelles attaques sur les
derrières et sur les flancs des légions romaines toujours présent et
insaisissable. Les proconsuls, ne pouvant plus nourrir leurs troupes, furent
contraints de se retirer, Metellus sur l’Ultérieure, Pompée jusqu’en Gaule,
où il prit ses quartiers d’hiver (74).
De sérieux périls étaient à craindre de ce côté. Les
Gaulois de la province ne voyant pas finir la guerre d’Espagne avaient repris
les armes et s’étaient jetés sur Marseille et Narbonne que Fonteius avait eu
peine à sauver. Il fallut que Pompée employât l’hiver à étouffer une révolte
qui coupait ses communications avec l’Italie et empêchait la Narbonnaise
d’approvisionner ses légions.
Les événements militaires des années 73 et 72 sont
inconnus. S’il faut en croire des récits propagés par ses adversaires,
Sertorius aurait perdu dans la mollesse et les débauches cette activité qui
jusqu’alors avait fait sa force. L’envie et la haine veillaient autour de
lui. Les sénateurs qu’il avait recueillis se voyaient, avec dépit, forcés
d’obéir à un parvenu. Ils prirent à tâche de le rendre odieux en accablant,
sous son nom, les Espagnols d’exactions. Tout cela est peu vraisemblable.
Cette mollesse, ces débauches qui apparaissent tout à coup dans la vie de ce
rude soldat sont suspectes, et il n’était pas homme à laisser commettre des
dilapidations dont ses projets eussent souffert. Mais quelques-uns de ces
bannis, trouvant qu’ils avaient fait assez de sacrifices à leur cause,
cherchaient une occasion de conclure leur accommodement, fut-ce aux dépens du
vaillant chef qui les avait sauvés. Et puis, la guerre finissait par lasser,
même les Espagnols ; la charge de nourrir et d’habiller l’armée libératrice
paraissait bien lourde ; des signes de mécontentement se montrèrent :
Sertorius les réprima avec dureté, et, aigri par cette résistance inattendue,
rendu soupçonneux, parce qu’il se crut entouré d’invisibles ennemis, il se
laissa aller à des actes qui lui aliénèrent davantage les esprits. Plusieurs
des enfants retenus à Ossa tirent vendus ou égorgés. Un chef proscrit qui se
défend par des supplices est à demi vaincu. Une conspiration se forma,
Perperna en était le chef : ils l’assassinèrent ait milieu d’un festin.
Perperna, qui prit sa place, n’avait ni ses talents ni la
confiance des troupes : il n’éprouva que des revers et tomba entre les mains
de Pompée. Pour racheter sa vie, il offrit de livrer les lettres des grands
de Rome qui avaient invité Sertorius à passer en Italie. Pompée pensait déjà
à rompre avec le sénat ; il ne voulut pas abandonner à ses vengeances des
hommes dont il allait faire ses amis, il brûla les lettres sans les lire et
fit égorger le traître ; les autres assassins finirent de même, un seul
excepté, qui, caché dans un village barbare, y vécut misérablement, haï et
méprisé de ses hôtes. Plutarque aime ces histoires de vengeance divine, et il
a raison : le crime trame après lui son châtiment bien plus souvent qu’on ne
pense.
Cependant il coula encore beaucoup de sang avant que le
repos fût rendu à l’Espagne. Les chefs indigènes, qui, en s’associant à
Sertorius n’avaient combattu que pour eux-mêmes, se jetèrent dans les plus
fortes places, et s’y détendirent une année avec l’acharnement, que, dans les
sièges, les Espagnols ont de tout temps montré : à Galagurris ils égorgèrent
les femmes, les enfants et se nourrirent des cadavres conservés dans le sel[40].
Après la mort de Sertorius, Metellus avait regagné
l’Italie, les dernières opérations de cette guerre furent donc conduites par
Pompée, qui parut seul l’avoir achevée et qui en retira toute la gloire. Dans
la réorganisation des deux provinces, il fonda l’influence qu’il eut depuis
en ce pays où il existe encore plusieurs ares de triomphe auxquels la
tradition a attaché son nom. Il accorda à beaucoup d’Espagnols qui l’avaient
servi le droit de cité ; chez les Vascons, il bâtit une ville de son nom, Pompelon (Pampelune) ; et, dans la vallée supérieure
de la Garonne,
il fonda pour les débris des bandes de Sertorius celle de Lugdunum Canvenarum (Saint-Bertrand de Comminges)[41]. Enfin sur la
dernière crête des Pyrénées, il éleva un trophée fastueux dont l’inscription
portait que, depuis les Alpes jusqu’au détroit d’Hercule, il avait pris huit
cent soixante-seize villes.
Une nouvelle guerre attendait en Italie le vaniteux
général ; Crassus l’appelait contre les gladiateurs, comme Metellus l’avait
appelé contre Sertorius.
|