HISTOIRE DES ROMAINS
SIXIÈME PÉRIODE — LES GRACQUES, MARIUS ET SYLLA (133-79) — LES ESSAIS DE RÉFORME
CHAPITRE XLI — SECONDE RÉVOLTE DES ESCLAVES ET NOUVELLES AGITATIONS DANS ROME (103-91).
I. — SOULÈVEMENTS D’ESCLAVES EN ITALIE ET EN SICILE (103-91).Les deux guerres contre les Numides et les Cimbres avaient
été un sanglant intermède aux luttes intestines. Les résultats en étaient
considérables : la domination romaine consolidée en Afrique, et l’Italie
fermée pour trois siècles aux barbares. Mais beaucoup de honte s’y était
mêlée à un peu de gloire, et cette gloire appartenait tout entière à un seul
homme : l’amour des soldats et du peuple, le respect contraint des nobles,
une immense renommée, des honneurs divins, voilà ce que Marius, cinq fois
consul, rapportait à Rome. Ce que Rome avait été avant les Gracques, elle l’était encore vingt ans après : seulement il y avait plus de misère avec moins d’espérance. La décomposition qui travaillait la société romaine avait atteint les partis eux-mêmes ; au lieu de la lutte régulière et féconde entre les deux grandes fractions du peuple romain, nous ne verrons plus que les discordes sanglantes de quelques hommes puissants qui mettront, comme le Brenn gaulois, le droit à la pointe des glaives. Quel parti, c’est-à-dire quels besoins, quelles idées, représenteront Marius jusqu’à sa mort, Sylla jusqu’à son consulat ? L’histoire de l’homme qui essaya de réveiller à cette époque le souvenir des fils de Cornélie, le tribun qui fut aussi un instant roi dans Rome, Saturninus, montrera cette décadence de la vie intérieure de la cité. Les grandes scènes de la double tragédie des Gracques seront remplacées par les violences d’un factieux vulgaire. Comme le tribunat de Tiberius, celui de Saturninus fut précédé d’une révolte des esclaves. Cette fois le signal partit du centre de l’Italie : c’était une annonce de Spartacus. Un premier complot découvert à Nucérie, un autre à Capoue, furent déjoués. Un soulèvement plus dangereux fut excité par un chevalier romain, Vettius, qui, criblé de dettes, arma ses esclaves et tua ses créanciers. Il prit le diadème et la pourpre, s’entoura de licteurs et appela à lui tous les esclaves campaniens. Le préteur Lucullus accourut en toute hâte avec dix mille hommes. Le rebelle en avait déjà réuni trois mille cinq cents ; trahi par un des siens, il se tua pour ne pas tomber vivant aux mains de l’ennemi (103). Le mouvement était arrêté dans Servilius fut encore moins heureux ; Athénion, qui n’avait été que blessé, remplaça Salvius, mort quelque temps après la bataille, et déploya une activité qui réduisit son adversaire à l’inaction. Rome se vengea en condamnant Servilius à l’exil et se résigna à la honte d’envoyer contre ces rebelles les faisceaux consulaires. Marius Aquillius, digne collègue de Marius, tua Athénion en combat singulier, dispersa ses troupes et fit transporter à Rome ceux qu’on put saisir, pour être livrés aux bêtes ; ils trompèrent les plaisirs du peuple en se tuant les uns les autres ; leur chef égorgea le dernier survivant, puis se frappa lui-même. Un nombre immense d’esclaves avaient péri dans les deux guerres[2]. Des règlements atroces les continrent à l’avenir : il leur fut défendu, sous peine de mort, d’avoir des armes, même l’épieu dont les pâtres se servaient pour se défendre contre les bêtes fauves (102-99). II. — LE TRIUMVIRAT DE MARIUS, GLAUCIA ET SATURNINUS (100).La guerre servile venait, comme celle des Cimbres et de Numidie, de mettre à nu tout à la fois l’impéritie et la vénalité des nobles. Le déshonneur des grands avait rendu aux tribuns la voix et le courage ; Memmius et Mamilius avaient accusé hautement les coupables et cherché à réorganiser le parti populaire, qui, croyant trouver un chef dans Marius, le porta au consulat. Ses succès et la confiance des soldats, qui ne voulurent pas d’un autre général, le firent conserver pendant quatre ans dans cette charge, au mépris de toutes les lois. Dans l’intérêt du salut publie, les grands acceptèrent ces consulats de l’homme nouveau ; mais, à l’abri de son nom et de ses services, les tribuns recommencèrent la guerre contre le sénat, soutenus par les chevaliers, que la perte de la moitié des places de juges avait irrités. Le désastre d’Orange et les concussions de Cépion servirent de prétexte. A peine la nouvelle de sa défaite fut-elle arrivée à Rome, que le peuple voulut lui ôter l’imperium, le déclarer incapable de gérer aucune charge et confisquer ses biens. Le sénat défendit le proconsul qui lui avait rendu une partie de l’autorité judiciaire, mais le tribun Norbanus chassa du Comitium les nobles et deux tribuns qui s’opposaient à la loi. Le tumulte devint tel, que le prince du sénat, Æmilius Scaurus, fut blessé d’un coup de pierre à la tête. Cépion, déposé, fut jeté en prison, et un tribun, son ami, qui l’en tira, dut partager son exil. Suivant d’autres récits, il périt étranglé dans son cachot, et l’on traîna son corps aux Gémonies. Il laissait deux filles qui se déshonorèrent par leur conduite. Cette ruine et cette honte d’une famille naguère illustre parurent une vengeance du dieu gaulois dont Cépion avait dérobé les trésors ; de là le proverbe : Il a de l’or de Toulouse, appliqué à l’homme qu’une longue suite de malheurs semblait marquer du sceau d’une fatalité ennemie[3]. La déposition d’un magistrat en exercice, le refus d’accepter le veto de deux tribuns, étaient deux violations de la loi ; irais on ne les comptait plus : la vieille constitution s’en allait en pièces. En l’an 104, le tribun Domitius transféra au peuple l’élection des pontifes, qui jusqu’alors s’était faite par cooptation. Encore un privilège enlevé à l’aristocratie et un droit nouveau donné à une assemblée vénale : César s’ouvrira l’accès des hautes charges en achetant aux comices le grand pontificat. L’année suivante, Marcius Philippus proposa une loi agraire ; dans son discours se trouvaient les terribles paroles, que nous avons déjà citées : Il n’y a pas dans toute la république deux mille propriétaires[4]. La loi fut rejetée, mais son collègue au tribunat, Servilius Glaucia, pour payer l’assistance des chevaliers, arracha aux sénateurs les places de juges, que Cépion leur avait données. Glaucia, cherchant aussi des appuis parmi les alliés, assura le droit de cité à ceux qui pourraient convaincre un magistrat de concussion[5] et rendit plus sévère la loi de Calpurnius de Pecuniis repetundis, en exigeant la restitution au double de ce qui avait été pris. Le tribunat redevenait donc agresseur : le sang des Gracques semblait lui avoir rendu sa vieille énergie populaire. Telle était la situation intérieure de la république quand
Marius revint de Jusqu’à présent il n’avait été consul que dans les camps, il voulut l’être à Rome, durant toute une année, sous les yeux de ces nobles qui l’avaient si longtemps méprisé. Mais les grands trouvaient que le paysan d’Arpinum avait eu assez d’honneurs : quand il demanda un sixième consulat, ils lui opposèrent son ennemi personnel, Metellus le Numidique. Marius fut réduit cette fois à acheter les suffrages[6]. II ne le leur pardonna pas, et il se jeta dés lors dans de basses et tortueuses intrigues. Calme au milieu des batailles et devant la mort, Marius en face du peuple perdait son assurance. Si les flots de cette mer agitée venaient en grondant battre la tribune, il se troublait : le plus obscur démagogue avait alors plus de courage que le grand général. Cependant, pour être puissant dans la ville, il fallait pouvoir agir sur le peuple : Marius chercha un homme qui parlât pour lui.
Saturninus commença aussitôt la lutte, à l’aide de cette
puissance tribunitienne qui se prêtait à tout. Il renouvela la loi de Caïus
pour les distributions de blé au peuple, mais en réduisant la rétribution à 5/6 d’as le modius.
Le sénat tout entier s’opposa à cette mesure dangereuse, qui allait accroître
la plaie du prolétariat. Le tribun, au lieu de reculer, s’en montra plus
hardi. Il proposa de distribuer aux citoyens pauvres des tribus rustiques
tout le pays occupé par les Cimbres dans Un article additionnel de la rogation présentée par Saturninus portait que, si le peuple votait la loi, les sénateurs seraient tenus d’en jurer, dans les cinq jours, l’exécution, sous peine d’une amende de 20 talents Cette clause inusitée, dont César se servira plus tard, était dirigée contre Metellus. Le jour du vote, un affreux tumulte éclata sur le Forum. Comme au temps de Tiberius, beaucoup, parmi le peuple même, ne voulaient pas d’une loi qui ne devait profiter qu’aux gens de la campagne et aux alliés enrôlés par Marius. On suscita l’opposition d’un tribun, Saturninus passa outre ; on fit parler le ciel : Il a tonné ! annonça un messager des sénateurs. Qu’ils prennent garde, répondit le tribun, qu’après le tonnerre, la grêle n’arrive. Le questeur Cépion, peut-être fils du proconsul condamné naguère, eut enfin recours au moyen qui devenait habituel : avec une bande armée il brisa les urnes et dispersa les suffrages. Mais les vétérans accoururent, chassèrent les nobles du Forum et tirent passer la proposition. Marius réunit aussitôt le sénat, parla contre la loi et promit de refuser le serment. Cependant, lorsque le cinquième jour les sénateurs furent appelés par le tribun à se rendre au temple de Saturne pour faire enregistrer leur serment par les questeurs, le consul jura le premier, sous prétexte de prévenir un soulèvement des tribus rustiques, par une concession sur laquelle il serait d’ailleurs aisé de revenir, puisque la loi n’avait passé que par la violence et malgré les auspices. Les sénateurs l’imitèrent, le seul Metellus resta fidèle à l’engagement qu’ils avaient tous pris. On s’y attendait : Saturninus réclama aussitôt l’amende. Metellus ne voulut ou ne put la payer ; comme autour de lui on s’armait, il s’opposa à ce qu’une goutte de sang fût versée pour sa cause et sortit de Rome ; un plébiscite le condamna à l’exil. Marius avait satisfait son ambition et sa haine. Son ennemi, le Numidique, fuyait devant lui ; le peuple l’applaudissait encore ; ses vétérans lui offraient un dévouement aveugle, et la nullité de son collègue lui livrait le consulat, Glaucia la préture, Saturninus le tribunat. Il était donc tout-puissant. Qu’allait-il faire de cette toute-puissance ? Ici se révèle son incapacité politique[11]. Point de projets, aucune réforme ; sur rien il ne prit l’initiative. Mais il laissa si bien agir Saturnines et Glaucia, que ceux-ci saisirent le premier rôle et que bientôt il ne set plus lui-même s’il était pour le sénat et les nobles, qu’il n’aimait pas, ou pour le peuple, qu’il méprisait. Aristocrate par caractère, démocrate par habitude et par position, il resta inactif entre les deux factions, essayant de les tromper toutes deux et perdant à ce jeu double sa considération et son honneur. Cette politique égoïste porta ses fruits. Il arriva un jour où le vainqueur de Jugurtha et des Cimbres se trouva seul, abandonné de tous, dans cette ville qui retentissait naguère du bruit de ses triomphes. Saturninus n’avait été d’abord qu’un instrument ; la faiblesse de Marius l’enhardit a travailler pour lui-même : ses desseins sont mal connus, peut-être n’en eut-il pas ; sa politique se faisait sans doute comme celle de son ancien patron, au jour le jour. Cependant les Italiens, les étrangers, l’entouraient, et une fois on les entendit le saluer du nom de roi[12]. A la tribune, il parlait sans cesse de la vénalité des grands, et, pour accréditer ses accusations, il insulta publiquement les envoyés de Mithridate, les accusant, au risque d’amener une guerre difficile, d’acheter les sénateurs à prix d’or. Il évoquait aussi le sou~cuir des Gracques : un jour il présenta au peuple un prétendu fils de Tiberius, élevé, disait-il, dans le secret, depuis la mort de son père. La veuve de Scipion Émilien vint du haut de la tribune renier cet étranger pour son neveu. Le peuple refusa de croire à ce témoignage autorisé ; et nomma l’aventurier tribun : c’était un esclave fugitif[13]. Saturninus voulait lui-même se faire réélire, en même temps que Glaucia, toujours mêlé à ses plans, serait élevé au consulat. Il réussit pour lui-même ; mais, quant au consulat, les comices le donnèrent au grand orateur Marcus Antonius, et un autre homme honorable, Memmius, le tribun de l’année 111, allait obtenir la seconde place, quand la bande de Saturninus se rua sur lui au milieu du Forum et le fit périr sous le bâton. Cette fois tout le monde se souleva contre les assassins ; la classe riche, effrayée de ces violences démagogiques, se serra autour du sénat, et Marius fut vivement pressé de sévir contre les coupables. On dit que, les principaux sénateurs s’étant rendus chez lui, Saturninus y vint aussi en secret, et que le consul, allant sous divers prétextes d’une chambre à l’autre, écoutait les deux partis pour les ménager tous deux[14]. L’historiette n’est peut-être pas vraie, mais la duplicité du consul n’était que trop certaine. Il essaya de la faire oublier par une lâcheté. Pendant la nuit, le 10 décembre, jour où les tribuns entraient en charge, Glaucia, Saturninus, le faux Gracchus et le questeur Saufeius, s’emparèrent durant la nuit du Capitole. Le sénat lança la formule, Caveant consules ; toute la noblesse s’arma : on vit jusqu’au vieux consulaire, Scævola, qui portait une âme virile dans un corps ruiné, à marcher, en s’appuyant sur un javelot, à la défense des lois. Marius, entraîné par le mouvement général, vint assiéger ses anciens complices, et, pour en avoir raison sans combat, coupa les conduits qui fournissaient de l’eau à la forteresse. Les conjurés comptaient sur sa protection : ils se rendirent ; le consul les conduisit dans le lieu ordinaire des séances du sénat, et les y enferma, espérant peut-être les sauver. Mais quelques citoyens montèrent sur l’édifice, en arrachèrent les tuiles et lapidèrent les deux tribuns, Glaucia et le questeur, tous encore revêtus des insignes de leurs charges. Comme d’habitude, ce premier meurtre en causa d’autres : bon nombre de gens périrent. Grands ou peuple, dés qu’un parti goûte au sang, il veut s’en rassasier (100). Un chevalier romain, Rabirius, remplaça le bourreau ; il coupa la tête de Saturninus et la promena par la ville au bout d’une pique. Cet exploit, qui lui fit alors beaucoup d’honneur, lui vaudra, trente-sept ans plus tard, d’être cité en justice par un ami de César, Labienus, dont l’oncle avait péri dans le massacre. Avec le prolétariat seul, avec ces masses ignorantes et misérables au sein desquelles fermentent incessamment les convoitises ardentes, les haines implacables, les passions aveugles, on peut détruire, on ne fonde pas. Saturninus venait d’en faire l’expérience, en finissant comme finiront. Sulpicius, Cinna, Clodius et tant d’autres démagogues, dans tous les temps et dans tous les pays. A cette catastrophe, Marius lui-même perdit, et ce fut justice, ce qui lui restait de popularité.
Quelque temps s’écoula dans un repos apparent. Saturninus mort et Marius condamné à un exil volontaire effrayaient les ambitieux qui auraient voulu faire fortune par le peuple. Durant les six dernières années, les tribuns avaient été tout-puissants ; jamais, dans un si court intervalle, plus de lois populaires n’avaient été rendues, et cependant le peuple n’avait pu être tiré de son apathique indifférence. On voyait bien qu’il n’y avait plus de parti populaire et que le tribunat de Saturninus serait la dernière tentative sérieusement faite pour le reconstituer. Ses lois furent rapportées ; ses colonies se réduisirent à un chétif établissement en Corse. De ces tribunats fameux il ne restait qu’une tache de sang dans la curie Hostilienne, la ruine d’une grande renommée et la preuve qu’il n’y avait rien à faire avec la tourbe de Rome. Dés lors, en effet, les plébéiens furent remplacés par les soldats, les tribuns par les généraux, et les émeutes du Forum par les batailles des guerres civiles. Mars avait raison d’agiter sa lance au fond de son sanctuaire[19]. Pour le moment, les nobles semblaient encore une fois
triompher. Diu dedans, tous les efforts du parti populaire avaient échoué :
afin de prévenir les surprises tribunitiennes, une loi consulaire, Cæcilia-Didia (98), remit en vigueur l’ancienne
prescription d’annoncer les projets de loi trois nundines à l’avance, et
déclara inconstitutionnelle toute proposition législative qui s’appliquerait
à des objets différents, comme venait de le faire Saturninus, comme l’avait
fait Licinius Stolon, lorsqu’il opéra la révolution de 367. Il est même
probable que la réaction alla plus loin que nos documents ne le disent. La
fermeture des écoles par le censeur Crassus, grand orateur qui prétendait ne
rien devoir à Au dehors, la politique active et fière du sénat inspirait
toujours aux rois et aux peuples le respect et l’obéissance. En 92, Sylla
rétablissait Ariobarzane sur le trône de Cappadoce, et répondait à une
ambassade du roi des Parthes avec la même hauteur que Marius avait portée à
la cour de Mithridate. Prince, avait
dit celui-ci, ou essayez de devenir plus puissant
que les Romains, ou faites sans murmurer ce qu’ils vous demandent.
Quelques années plus tard (95), cette politique avait gagné à Rome un royaume : Ptolémée
Apion, roi de III. — TRIBUNAT DE LIVIUS DRUSUS (91).
On reprochait aux Gracques d’avoir donné deux têtes à la république, en réservant aux seuls chevaliers l’administration de la justice, qu’ils venaient de déshonorer par la condamnation de l’intègre Rutilius. Drusus, nommé tribun en 91, renonça à cette combinaison, au tertius ordo, lequel, avec l’arme puissante des jugements, tendait à se subordonner les deux autres[21]. Pour fortifier, dans l’État, l’aristocratie, l’élément de durée, il voulait rendre les jugements aux sénateurs et il instituait une enquête en vue de rechercher les crimes de vénalité[22] ; mais il faisait entrer trois cents chevaliers dans le sénat. Pour relever la démocratie, l’élément de force, et tirer le peuple de sa misère, il voulait que les distributions de l’annone fussent augmentées, et il promettait aux pauvres des terres en Italie et en Sicile ; aux alliés, le droit de cité. Donnons tout, disait-il à ses amis de la noblesse, pour qu’il ne reste rien à partager, si ce n’est la boue des rues ou les nues du ciel, cænum aut cælum[23]. Alors il n’y aura plus de factieux soulevant le peuple par des promesses. En quoi Drusus se trompait, parce que les factieux ont toujours des promesses à faire, et la foule, une foi robuste pour y croire. A l’exemple de Licinius Stolon, le tribun fit de toutes ses propositions, celle qui concernait les Italiens exceptée, une seule rogation : c’était contraire à une loi, rendue quelques années plus tôt, qui défendait les motions per saturam, ou comprenant des objets distincts ; mais déclarer ces diverses propositions indissolubles, c’était en assurer le vote par la contrainte exercée sur le grand nombre des votants qui, indifférents aux lois politiques, ne se seraient intéressés, sans cela, qu’à l’augmentation de l’annone. Chacune de ces lois, en effet, mécontentait une portion du peuple : le sénat, qui repoussait de son sein les chevaliers ; l’ordre équestre, pour lequel il ne pouvait y avoir de compensation à la perte des jugements ; les pauvres, qui ne se souciaient ni des lois politiques ni des colonies, c’est-à-dire de l’obligation de travailler pour vivre. Et tous voyaient que, après ce premier succès, Drusus en voudrait un autre, l’élévation des sujets à la condition des maîtres. Parmi les alliés mêmes, beaucoup s’alarmaient de ces colonies promises au peuple de Rome, et qui ne pouvaient être fondées qu’à leurs dépens. Les grands propriétaires étrusques et ombriens, plus particulièrement menacés[24], se souciaient bien moins du titre de citoyen qu’on leur offrait, que des terres qu’on leur voulait citer. Mais les autres Italiens se rattachant à Drusus, comme à leur dernière espérance, accoururent en foule autour de lui. Il y eut des réunions secrètes, un plan arrêté, une conspiration véritable, qui jure avec l’anecdote touchant cette maison de verre oit Drusus aurait voulu vivre sous l’œil de ses concitoyens. On le voit, en effet, stipuler pour lui-même dans le serment que prononçait chaque conjuré[25]. Par Jupiter Capitolin, par les dieux pénates de Rome, par Hercule son protecteur, par le soleil et la terre,… par les demi-dieux fondateurs de son empire, par les héros qui l’ont accru, je jure que je n’aurai pas d’autres amis que les amis de Drusus, pas d’autres ennemis que ses ennemis ; que je n’épargnerai rien, ni mon père, ni mes enfants, ni ma vie, s’il le faut, pour l’avantage de Drusus et de ceux qui ont juré le même serment. Si je deviens citoyen par la loi de Drusus, je tiendrai Rome pour ma patrie et Drusus pour le plus grand des bienfaiteurs. Et ce serment, je le ferai jurer au plus grand nombre de personnes qu’il me sera possible. Si moi-même j’y suis fidèle, que tout me soit prospère ; que tout me soit contraire, si je le fausse. Dans une maladie que fit le tribun, le dévouement des Italiens éclata par des signes non équivoques : toutes les villes firent des vœux solennels pour son rétablissement, comme si en lui seul était leur salut. Il est difficile d’admettre que la pièce qui vient d’être citée soit un faux commis par les adversaires de Drusus pour le perdre de son vivant ou le déshonorer après sa mort, mais il n’est pas nécessaire d’en conclure que le tribun préparait une usurpation. Il avait entrepris une grande œuvre que les riches et les nobles combattaient ; pour vaincre, il lui fallait des alliés, et il les chercha naturellement parmi les intéressés, qu’il organisa en une armée disciplinée. Du fond de leur tombeau, les Gracques lui criaient qu’il avait des précautions à prendre, et il en prenait. Toutefois le moyen était dangereux, et, en agissant ainsi, Drusus pouvait être conduit, malgré lui-même, à de fâcheuses extrémités. Un jour, le Marse Pompedius Silo, un des familiers de sa maison, réunit une troupe, qu’on porta, avec l’exagération de la peur ou de la haine, à dix mille hommes, et l’on raconte qu’il leur fit prendre des armes sous leurs vêtements ; qu’à leur tête, il s’achemina vers Rome par des sentiers détournés ; qu’enfin il avait le dessein d’envelopper le sénat et de lui faire voter sous le glaive le droit de cité pour les alliés, sinon de semer par la ville la mort et l’incendie[26]. En chemin, il fut rencontré par le consulaire Domitius, qui lui demanda pourquoi cette foulé le suivait. Je vais à Rome où le tribun nous appelle, répondit Pompedius. Cependant, sur l’assurance réitérée que le sénat était, de son propre mouvement, décidé à leur rendre justice, il se laissa persuader de renvoyer ses gens. S’il suffit d’un mot pour faire tomber leur colère et leur projet, c’est qu’ils n’étaient pas bien redoutables. A Rome, l’irritation des esprits était extrême : on en a la preuve dans les événements qui vont suivre, mais aussi dans un fait concernant celui qui sera Caton d’Utique et qui n’avait alors que quatre ans. Neveu de Livius Drusus et élevé dans sa maison, il y avait entendu de violentes discussions au sujet des Italiens, et son esprit, déjà rétif aux nouveautés, s’était empreint des haines aristocratiques. Un, jour, Pompedius Silo lui dit : Ne veux-tu pas prier pour nous ton oncle de nous aider à obtenir le droit de cité ? Et, Caton le regardant d’un air farouche, il le prend, le porte à une fenêtre et le menace de l’en précipiter : Promets ou je lâche. L’enfant ne répond pas, et Pompedius le remet à terre. On a vu, dans cette anecdote, un trait précoce de ce caractère intraitable ; mais, si elle était authentique, je verrais, dans cette jeune âme haineuse, un reflet des passions de l’oligarchie, qui ne voulait pas que l’Italie lui donnât des nobles pour concurrents au consulat, ni des pauvres pour soldats d’émeute au Forum. La ville se divisait en deux camps de force très inégale : d’un côté, les amis des alliés ; de l’autre, une partie des nobles et la plupart des riches. C’était des chevaliers, en effet, que venait la plus vive opposition, car ils auraient perdu, par l’acceptation de la loi Livia, les jugements qui les rendaient maîtres de l’honneur des grands, et le monopole de l’exploitation financière du monde, que les riches de l’Italie, devenus citoyens, leur auraient disputé aux enchères ; enfin l’enquête proposée par le tribun était une menace suspendue sur la tête des juges prévaricateurs, nombreux dans leurs rangs, même un danger pour tous ceux qui avaient siégé dans les tribunaux. Quant au sénat, il s’effaçait en ce temps de crise, comme il en avait pris, depuis les Gracques, l’habitude. Cependant il penchait vers Drusus, qui lui rendait les tribunaux, et, à en croire une anecdote peut-être apocryphe, comme tant d’autres, il lui montrait une déférence qui justifiait l’orgueil immense du tribun. Un jour que celui-ci était au Forum, le sénat l’invite à se rendre dans son sein, au lieu où il siégeait. La curie Hostilia est plus près d’ici, répond-il ; dites aux sénateurs que je les y attends ; et ils s’y rendirent. Ils voyaient avec un profond déplaisir le doublement du sénat, mais il fallait bien montrer quelque bon vouloir à qui, en leur rendant les offices de judicature, les arrachait à ces bêtes féroces altérées de leur sang[27]. Les chevaliers avaient appelé à Rome de nombreuses bandes d’Étrusques et d’Ombriens que leur fournissaient les landlords de ces pays, et ils pouvaient en ce moment compter sur le consul Marcius Philippus. Ce personnage ondoyant et divers, par-dessus tout violent, avait en 104 proposé comme tribun une loi agraire et prononcé les paroles fameuses qui sont la justification des Gracques. Plus tard, il s’était montré un des plus animés contre Saturninus, et maintenant, ennemi personnel de Drusus, il s’indignait de la mollesse du sénat et déclarait qu’il était impossible de gouverner avec une pareille assemblée. Cette inconvenante sortie du premier magistrat de la république contre le premier corps de l’État amena, de la part de Crassus, une explosion d’éloquence. Philippe, pour l’arrêter en l’intimidant, envoya un licteur prendre un gage sur ses biens : c’était une menace de procès à courte échéance et d’amende ruineuse. Tu ne me reconnais pas pour sénateur ? s’écria Crassus. Eh bien, moi, je ne te reconnais pas pour consul ! Tu t’imagines, toi qui veux confisquer l’autorité de tout l’ordre sénatorial, que tu vas m’effrayer par une prise de gages sur moi ! Mais ce n’est pas mon bien qu’il faut m’arracher, si tu veux réduire Crassus au silence. Arrache cette langue, et quand il ne me restera plus que le souffle mon âme libre trouvera encore des sons pour combattre tes volontés tyranniques. Il continua longtemps ainsi et enleva, aux acclamations des nobles, cette déclaration qui fut rédigée en décret : Jamais la sagesse du sénat n’a fait défaut à la république. Ce fut le chant du cygne, dit Cicéron. Pendant qu’il parlait, il fut saisi d’une douleur au côté, la fièvre le prit et, sept jours après, l’emporta. Ce chant du cygne était de belles mais inutiles paroles ; des deux côtés les violences continuèrent. Le jour du vote de la loi Livia, Philippus voulut arrêter les suffrages, mais un viateur de Drusus le saisit à la gorge avec tant de force, que le sang jaillit de la bouche et des yeux : Ce n’est que du jus de grives, dit le tribun, faisant allusion aux somptueux festins où se plaisait le consul. La loi passa. On pouvait croire la lutte finie : elle recommença plus vive. Dès que le sénat eut les jugements, il laissa attaquer les autres parties de la rogation. Je pourrais bien, dit le tribun, m’opposer à vos décrets ; mais je n’en fini rien, parce que je sais que ceux qui commettront le mal en seront bientôt punis. Seulement réfléchissez qu’en abolissant mes lois, vous abolissez aussi la loi judiciaire qui assurait la sécurité des gens de bien et la punition des coupables. Prenez donc garde que, par haine pour moi, vous ne vous désarmiez vous-mêmes[28]. Le sénat hésitait ; Ies chevaliers recoururent au grand moyen des temps de révolution. Un soir que Drusus se retirait au milieu de la foule de ses clients, il se sentit tout à coup blessé. Le meurtrier s’échappa laissant le fer dans la plaie : elle était mortelle. Ô mes amis, disait le tribun mourant, quand la république trouvera-t-elle un citoyen qui me ressemble ? Quelque temps auparavant, aux Féries latines, les conjurés italiens avaient voulu tuer le consul, et il n’avait échappé que par un avis de Drusus (91). C’était encore un réformateur qui tombait, cette fois, sous Ies coups de l’oligarchie financière. Quelques mois après, un tribun, ami des grands, célébrait ce meurtre comme un acte de justice. Invoquant le souvenir du premier Drusus, l’adversaire des Gracques, il s’écriait : Ô Livius Drusus ! tu aimais à dire : La république est chose sainte et sacrée, qui y touche doit périr, et chaque citoyen est alors justicier. Sage parole du père confirmée par la témérité du fils. Les mœurs politiques descendaient bien bas, puisque, non contents de tuer, les conservateurs justifiaient l’assassinat. II est inutile d’ajouter qu’aucune enquête ne fut ordonnée pour la recherche du coupable. Les chevaliers profitèrent de la stupeur causée par cet événement pour forcer le sénat à user du singulier privilège que les Pères s’étaient attribué de dispenser de l’observation des lois, et la résolution suivante fut promulguée : Il semble bon au sénat que le peuple ne soit pas tenu par les lois de Drusus, comme étant contraires aux prescriptions de la loi Cæcilia-Didia. En même temps un de leurs agents, le tribun Varius Hybrida, né à Sucrone, d’un citoyen romain, mais d’une mère espagnole, proposa une loi de majesté contre ceux qui avaient favorisé les alliés et contre tout Italien qui s’immiscerait dans les affaires de Rome. Les autres tribuns opposèrent leur veto. Mais les chevaliers, tirant des épées cachées sous leurs robes, forcèrent l’assemblée d’accepter la loi Varia[29]. Le sénat put se souvenir alors des paroles prophétiques de Drusus. Les plus illustres sénateurs se virent accusés. Bestia, C. Cotta, Mummius, Pompeius Ruffus, Mummius, furent bannis ou s’exilèrent. Scaurus lui-même fut accusé par Varias. Pour toute réponse, il dit : L’Espagnol Q. Varias accuse Scaurus, prince du sénat, d’avoir excité les alliés à la révolte. Æmilius Scaurus, prince du sénat, le nie : lequel des deux croirez-vous ? L’explosion de la guerre Sociale arrêta ces vengeances de l’ordre équestre, car éclata alors une tempête qui faillit tout emporter, peuple, nobles et la république même. |
 Il se trouvait alors à Rome un personnage qui allait être
bientôt compté parmi les plus mauvais citoyens, L. Apuleius Saturninus,
habile orateur qu’une disgrâce jeta, sans idées généreuses, mais avec
beaucoup d’ambition et de haine, dans le parti populaire. Questeur et chargé
du département d’Ostie, c’est-à-dire du soin de veiller d la prompte expédition
des blés sur Rome, il avait, par sa négligence durant une famine, forcé le
sénat de le remplacer par M. Scaurus
Il se trouvait alors à Rome un personnage qui allait être
bientôt compté parmi les plus mauvais citoyens, L. Apuleius Saturninus,
habile orateur qu’une disgrâce jeta, sans idées généreuses, mais avec
beaucoup d’ambition et de haine, dans le parti populaire. Questeur et chargé
du département d’Ostie, c’est-à-dire du soin de veiller d la prompte expédition
des blés sur Rome, il avait, par sa négligence durant une famine, forcé le
sénat de le remplacer par M. Scaurus  Il tenta vainement d’arrêter ce mouvement de recul. A son
instigation, un fils d’affranchi, Furius, qui, malgré la tache de sa
naissance, était arrivé au tribunat, opposa son veto au retour de Metellus,
qu’on avait proposé. Accusé, au sortir de charge, il fut mis en pièces par
une populace soudoyée qui ne lui permit même pas de présenter sa défense.
Il tenta vainement d’arrêter ce mouvement de recul. A son
instigation, un fils d’affranchi, Furius, qui, malgré la tache de sa
naissance, était arrivé au tribunat, opposa son veto au retour de Metellus,
qu’on avait proposé. Accusé, au sortir de charge, il fut mis en pièces par
une populace soudoyée qui ne lui permit même pas de présenter sa défense. 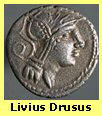 Ainsi, au dedans, au dehors, l’horizon semblait s’être
éclairci. Un noble, Livius Drusus, crut le moment favorable pour reprendre,
avec d’autres idées, le projet des Gracques, la réforme de la constitution
républicaine. Il était fils de ce Drusus à qui sa lutte contre Caïus avait
mérité le titre de patron du sénat, et ses rogations populaires, celui d’ami
du peuple. Par sa naissance et par ses richesses, c’était un conservateur,
mais lin de ces conservateurs qui pensent que le meilleur moyen de conserver
n’est pas de surélever les digues, que les grands courants emportent toujours
; qu’il faut, au contraire, les abaisser à propos, pour éviter les ruptures
violentes. Il ne médita donc point ses réformes en haine de l’aristocratie ;
son esprit élevé voyait plus haut qu’un intérêt de classe. Il se proposa de
résoudre le double problème qui depuis quarante ans s’agitait diversement :
la réconciliation du sénat et du peuple, et la transformation des
institutions municipales de Rome en une constitution d’empire, puisque ces
maîtres d’une cité et de sa banlieue étaient passés maîtres du monde. A la
colossale fortune de la république, il fallait une large base qui fût capable
de la porter, et, comme ce changement, commandé par la force des choses,
était inévitable, tous ceux qui y poussèrent doivent être regardés comme de
prévoyants citoyens.
Ainsi, au dedans, au dehors, l’horizon semblait s’être
éclairci. Un noble, Livius Drusus, crut le moment favorable pour reprendre,
avec d’autres idées, le projet des Gracques, la réforme de la constitution
républicaine. Il était fils de ce Drusus à qui sa lutte contre Caïus avait
mérité le titre de patron du sénat, et ses rogations populaires, celui d’ami
du peuple. Par sa naissance et par ses richesses, c’était un conservateur,
mais lin de ces conservateurs qui pensent que le meilleur moyen de conserver
n’est pas de surélever les digues, que les grands courants emportent toujours
; qu’il faut, au contraire, les abaisser à propos, pour éviter les ruptures
violentes. Il ne médita donc point ses réformes en haine de l’aristocratie ;
son esprit élevé voyait plus haut qu’un intérêt de classe. Il se proposa de
résoudre le double problème qui depuis quarante ans s’agitait diversement :
la réconciliation du sénat et du peuple, et la transformation des
institutions municipales de Rome en une constitution d’empire, puisque ces
maîtres d’une cité et de sa banlieue étaient passés maîtres du monde. A la
colossale fortune de la république, il fallait une large base qui fût capable
de la porter, et, comme ce changement, commandé par la force des choses,
était inévitable, tous ceux qui y poussèrent doivent être regardés comme de
prévoyants citoyens.