|
I. — PRÉLIMINAIRES DE LA GUERRE CONTRE
ANTIOCHUS.
Le fastueux désintéressement que Rome venait de montrer en
Grèce et que personne ne pouvait encore comprendre, était une habile réponse
à la coalition qu’Annibal travaillait à former. Ramené dans Carthage par une
défaite, il s’y trouva encore assez puissant pour saisir le pouvoir et
commencer des réformes qui devaient régénérer sa patrie. Il se fit nommer
suffète, et, avec l’appui de ses vétérans et du peuple, il renversa la
tyrannique oligarchie qui s’était formée durant la guerre[1]. Les centumvirs
étaient inamovibles, il les rendit annuels ; les finances étaient indignement
dilapidées, il y porta un ordre sévère, ordonna des restitutions, et rendit
le trésor assez riche pour acquitter, sans fouler le peuple, le tribut promis
à Rome[2]. Les troupes,
régulièrement payées, furent augmentées, et, en attendant qu’il pût en tirer
de plus sérieux services, il les employa à d’utiles travaux dans les
campagnes. En même temps, pour éviter une rupture prématurée, il condamnait
au bannissement son émissaire Amilcar, qui entretenait la guerre dans la Cisalpine, laissait
les Romains prononcer contre Carthage dans un différend avec Masinissa et
leur envoyait pour la guerre de Macédoine 500.000 boisseaux de blé[3]. Mais ses secrets
messages pressaient Antiochus d’attaquer, tandis que Philippe résistait
encore, que les Grecs hésitaient, que les Cisalpins et les Espagnols étaient
soulevés.
Cynocéphales renversa ses espérances, et bientôt trois
ambassadeurs vinrent à Carthage demander la tète de cet infatigable ennemi de
Rome. Scipion s’était noblement opposé à cette résolution : son fier courage
comprenait Annibal attaqué corps à corps et vaincu, mais non pas frappé à
terre. Depuis longtemps, au contraire, le glorieux proscrit s’y attendait ;
une galère secrètement préparée le porta en Syrie (145).
Antiochus III, enhardi par les succès des premières
années de son règne, ne revendiquait pas moins que tout l’héritage de
Séleucus Nicator : d’abord, en Asie, la Cœlésyrie et la Phénicie, qu’il avait
enlevées au roi d’Égypte, pupille du sénat, et les cités grecques dont les
Romains venaient de proclamer l’indépendance ; en Europe, la Chersonèse de Thrace,
où il fortifia Lysimachie pour en faire le boulevard de son empire ; la Thrace et la Macédoine elle-même,
qu’il osait comprendre dans ses imprudentes prétentions. Il gagna Byzance par
des avantages faits à son commerce, les Galates par des présents et des
menaces, le Cappadocien Ariarathe en lui donnant une de ses filles, et il
essaya d’acheter la neutralité du roi d’Égypte, en lui offrant l’autre avec
la promesse du littoral syrien pour dot.
En vain le sénat multiplia les ambassades, les avis et les
menaces. Antiochus répondit fièrement : Je ne me
mêle point de ce que vous faites en Italie, ne vous occupez pas de ce que je
fais en Asie. L’arrivée d’Annibal décida la guerre. Ce grand homme
offrait de recommencer, avec onze mille hommes et cent vaisseaux, sa seconde
guerre Punique. En passant, il soulèverait Carthage, et, tandis qu’il
occuperait les Romains en Italie, le roi descendrait en Grèce, en réunirait
tous les peuples, et, au premier bruit des défaites de Rome, viendrait porter
le dernier coup à cette domination ébranlée. Ainsi Annibal voulait tenter,
avec l’Orient riche et civilisé, ce qu’il n’avait pu faire avec l’Occident
pauvre et barbare. Si nous n’avions pas perdu les Annales d’Ennius, nous
serions peut-être forcés de rejeter ces conseils belliqueux d’Annibal ;
quelques fragments du poète-soldat montrent le héros carthaginois plus
défiant, et Aulu-Gelle rapporte de lui une parole qui confirmerait ces doutes
: Crois-tu que ceci suffise pour les Romains ?
disait Antiochus en lui montrant ses troupes dorées. Oui, certes, répondit Annibal, si avides qu’ils soient. Mais cette défiance ne
se montra que dans les derniers jours, quand il vit le roi rejeter ses
conseils et le tenir à l’écart.
La clairvoyance de l’envie avait fait comprendre aux
courtisans qu’un tel homme ne pouvait travailler que pour lui-même, et ils
murmuraient à l’oreille d’Antiochus que le Carthaginois, restât-il fidèle,
aurait toute la gloire, s’il réussissait. Déjà les visites qu’Annibal avait
reçues d’un des ambassadeurs romains, et que celui-ci avait multipliées dans
une intention perfide, l’avaient rendu suspect.
Parmi les députés du sénat, la légende a placé Scipion
l’Africain, pour mettre encore une fois en présence le vainqueur et le vaincu
de Zama, dans une conférence qu’ils auraient eue à Éphèse. Quel est, à ton avis, le premier des généraux ?
aurait demandé Scipion. Alexandre de Macédoine,
qui, avec une poignée d’hommes, défit d’innombrables armées et parcourut
victorieusement d’immenses pays. — Et
le second ? — Pyrrhus, qui, mieux que
personne, sut choisir ses positions pour camper, ranger ses troupes en
bataille et combattre. — Et le
troisième ? — Moi, dit
Annibal sans hésiter. Alors Scipion se prenant à rire : Que dirais-tu donc si tu m’avais vaincu ? — Dans ce cas je me mettrais au-dessus de tous les autres.
Il faut raconter ces choses, puisqu’on les répète partout, mais on n’est pas
tenu d’y croire. C’est un de ces dialogues qu’on rédige dans les écoles des
rhéteurs. Annibal et Scipion se retrouvant, après dix ans et à la veille
d’une grande guerre, auraient eu autre chose à se dire que la vaniteuse
question de l’un et le trop ingénieux compliment de l’autre. Un seul des
ambassadeurs, P. Villius, vint à Éphèse et eut avec Annibal de fréquentes
entrevues pour le détacher du service d’Antiochus[4]. Il n’y réussit
pas ; mais le roi conçut des soupçons et, rejetant les conseils du héros,
écouta les magnifiques et vaines promesses de l’Étolien Thoas.
Depuis longtemps les Étoliens se vantaient d’avoir ouvert la Grèce aux Romains et
d’avoir guidé partout leurs pas. A les en croire, ils avaient, à
Cynocéphales, sauvé la vie et l’honneur de Flamininus. Tandis que nous combattions, disait l’un d’eux,
et que nous lui faisions un rempart de nos corps,
je ne l’ai vu, tout le jour, qu’occupé d’auspices, de vœux et de victimes,
comme un sacrificateur[5]. Ils avaient cru
hériter de la domination que Philippe avait perdue, et les Romains ne leur
avaient pas même rendu leurs villes de Thessalie, ni l’Acarnanie, ni Leucade,
ni les cités qu’ils avaient conquises et qui, aux termes du premier traité,
auraient dû leur appartenir.. Froissés dans leurs intérêts, humiliés dans
leur orgueil par la hauteur de Flamininus, qui n’avait pour eux que de dures paroles,
ils osaient se comparer à Rome, rêvaient de guerre contre elle, et la
menaçaient déjà de leur camp des bords du Tibre[6]. A un même jour,
sans déclaration de guerre, trois corps étoliens parurent devant Chalcis,
Démétriade et Lacédémone. Ils espéraient enlever ces places, et de là braver
les Romains. Chalcis les repoussa, Démétriade fut surprise, et à Sparte, où
ils se présentèrent en amis, ils égorgèrent Nabis, mais s’oublièrent au
pillage : ce qui donna le temps à Philopœmen d’accourir et de les envelopper.
Le général achéen réunit Sparte délivrée à la ligue, et
ces expéditions de brigands rattachèrent plus fortement la Grèce au parti de Rome.
Dans le même temps, pour neutraliser la Macédoine, le sénat répandait le bruit qu’il
allait rendre à Philippe ses otages et lui remettre le tribut. En Afrique, il
faisait harceler Carthage par Masinissa, afin de l’empêcher d’entendre les
provocations d’Annibal[7] ; et en voyant sa
faiblesse contre le Numide, le servile empressement de ses grands à effacer,
à prévenir les soupçons de Rome, il cessait de la croire redoutable. En
Espagne, Caton venait de prendre et de démanteler toutes les places jusqu’au
Bætis[8]. Dans la haute
Italie enfin, les Gaulois, écrasés par vingt défaites, laissaient les Ligures
protester seuls contre l’asservissement des Cisalpins[9].

II. — ANTIOCHUS EN GRÈGE ; COMBAT
DES THERMOPYLES (192-191).
Le temps était donc mal choisi pour attaquer Rome, quand
tout cédait à ses armes et qu’elle redoublait de prudence et d’activité,
renvoyant en Grèce l’adroit Flamininus, postant une armée à Apollonie,
couvrant de flottes et de soldats les côtes de la Sicile et de l’Italie,
comme pour repousser la plus formidable invasion. Il est vrai que les
Étoliens avaient promis à Antiochus de soulever la Grèce entière et Philippe
; que les députés du roi le montraient traversant les mers avec toutes les
forces de l’Asie et assez d’or pour acheter Rome elle-même[10] : commerce de
mensonges où tous les intéressés perdirent. Lorsque Antiochus débarqua à
Démétriade (septembre
192), il amenait, au lieu de l’armée de Xerxès, dix mille hommes et
cinq cents cavaliers, qu’il ne put solder qu’en empruntant à gros intérêts,
et qu’il demanda aux Étoliens de nourrir[11]. Quant à
ceux-ci, ils ne lui donnèrent pas un allié. Il fallait gagner Philippe :
Antiochus l’irrita en rappelant les droits qu’il tenait de Séleucus, et en
soutenant les ridicules prétentions au trône de Macédoine du fils
d’Amynander. Dans sa fuite précipitée, Philippe n’avait pu rendre les
derniers honneurs aux soldats tombés à Cynocéphales. Antiochus recueillit
leurs ossements dans un tombeau, qu’il fit élever par son armée. Cette pieuse
sollicitude était pour le Macédonien un amer reproche ; il y répondit en
envoyant demander à Rome qu’on lui permit de combattre[12]. Le roi de Syrie
essaya cependant de faire déclarer les Achéens pour lui ; et dans un panachaïcum tenu à Corinthe, son
ambassadeur, avec l’emphase asiatique, fit la nombreuse énumération des
peuples qui, de la mer Égée à l’Indus, s’armaient pour sa cause. Tout cela, répondit Flamininus, ressemble fort au festin de mon hôte de Chalcis. Au cœur
de l’été, sa table était couverte des mets les plus variés, de gibier de
toute espèce ; mais ce n’étaient que les mêmes viandes déguisées par un art
habile. Regardez bien, et, sous ces noms menaçants de Mèdes, de Cadusiens,
etc., vous ne trouverez toujours que des Syriens. L’activité de
Flamininus fit échouer une conspiration à Athènes ; mais Chalcis, qu’il n’eut
pas le temps de secourir, et l’Eubée tout entière firent défection. La Béotie, agitée par
quelques hommes perdus de dettes, l’Élide et les Athamanes, toujours fidèles
aux Étoliens, suivirent cet exemple. Plusieurs villes thessaliennes, entre
autres la forte place de Lamia, ouvrirent leurs portes à Antiochus.
Cependant Annibal continuait les mêmes conseils. Ce ne sont pas, disait-il, tous ces peuples sans force qu’il faut gagner, mais
Philippe de Macédoine; s’il refuse, écrasez-le entre votre armée et celle que
Séleucus commande â Lysimachie. Appelez enfin d’Asie vos troupes et vos
vaisseaux ; que la moitié de votre flotte stationne devant Corcyre, l’autre
dans la mer Tyrrhénienne, et marchez sur l’Italie[13]. Mais dans ce
vaste plan les Étoliens et leurs petits intérêts disparaissaient ; ils
firent perdre la campagne à reprendre, l’une après l’autre, les villes de
Thessalie, et durant l’hiver Antiochus, malgré ses quarante-huit ans, oublia,
dans les plaisirs d’un nouvel hymen, qu’il jouait contre les Romains sa
couronne.
Le sénat eut le temps d’achever ses préparatifs. Pour lui,
toute guerre était sérieuse, celle surtout où il pouvait avoir Annibal pour
adversaire et encore une fois l’Italie pour champ de bataille. Il ne savait
pas encore ce que cachaient de faiblesse ces grands noms de Grèce et d’Asie,
et le successeur d’Alexandre, le prince qui commandait de l’Indus à la mer
Égée, guidé par l’homme qui avait détruit tant de légions, lui paraissait
très redoutable. Dès que les hostilités commencèrent, le consul défendit aux
magistrats de s’éloigner de Rome, et aux sénateurs de sortir plus de cinq à
la fois de la ville. Sans fouler ni le peuple ni les alliés, de grandes
forces avaient été réunies. Une armée envoyée sur les bords du Pô contenait
les Cisalpins et fermerait au roi les passages des Alpes, s’il tentait d’y
arriver par l’Illyrie ; une autre, autour de Brindes, surveillait la mer
Ionienne et protégeait les côtes contre un débarquement; une troisième, en
réserve à Rome, était prête à courir où se montrerait le danger. La flotte
était nombreuse : chaque jour on l’augmentait. Carthage et Masinissa avaient
offert des vaisseaux, vingt éléphants, cinq cents Numides et d’immenses
convois de blé ; Ptolémée et Philippe, des troupes, de l’argent et des
vivres. Le roi d’Égypte avait envoyé jusqu’à 1.000 livres pesant
d’or et 20.000
livres d’argent ; les deus princes s’engageaient à
passer, an premier ordre du sénat, dans la Grèce. Eumène,
dont le petit royaume était menacé de disparaître bientôt dans le vaste
empire d’Antiochus, et Rhodes, alliée de l’Égypte, avaient mis toutes leurs
forces à la disposition des Romains.
Lorsqu’on sut qu’Antiochus avait débarqué en Grèce avec
une escorte plutôt qu’avec une armée, que par conséquent l’invasion de
l’Italie n’était pas à craindre, le sénat ordonna aux légions de Brindes
d’envoyer une forte avant-garde en Épire, à Apollonie. Ln détachement de deux
mille cinq cents hommes, réuni à un corps macédonien, suffit à chasser les
Syriens loin de Larisse, qu’ils assiégeaient.
Ces préparatifs, ces levées d’hommes, ces marches des
armées, cette guerre commencée, tout avait été fait sans que le peuple eût
été consulté. Les consuls de l’année 191, entrés en charge aux ides de mars,
qui, par suite des erreurs du calendrier, tombaient alors en janvier,
portèrent aux comices une déclaration de guerre contre le roi de Syrie.
Personne ne se plaignit qu’un acte si grave ne fût plus pour l’assemblée
qu’une simple formalité. Le peuple s’était habitué, durant la seconde guerre
Punique, à laisser aux pères conscrits l’absolue direction des affaires
extérieures, qui, en vérité, étaient devenues trop nombreuses et trop
importantes pour pouvoir être traitées dans une réunion populaire. C’était
une première abdication de sa souveraineté, et l’on voit comment la nécessité
y eut plus de part que l’ambition du sénat. La force des choses menait à
cette prépondérance du grand conseil de Rome, comme elle conduira dans un
siècle et demi à la prépondérance d’un homme. L’ambition des corps et des
individus ne fait pas seule, dans les affaires humaines, les situations
durables. Celles-ci deviennent légitimes, quand ce sont les circonstances
historiques qui les établissent et qui les maintiennent. De combien de
déclamations l’histoire sera débarrassée, lorsqu’on aura reconnu ce principe
que la politique est la science du relatif, non de l’absolu, et que le
meilleur des gouvernements est Celui qui répondra le mieux aux besoins
présents d’une société.
Le consul Acilius Glabrion, qui allait commander en Grèce,
fut chargé par le sénat, avant de partir, de négocier avec Jupiter. On ne saurait
donner un autre nom à la scène que Tite-Live raconte et qui était une
répétition de ce que nous avons déjà vu : a Sous la dictée du grand pontife,
le consul prononça les paroles suivantes : Si la
guerre décrétée contre le roi Antiochus se termine au gré du sénat et a du
peuple romain, alors, ô Jupiter ! le peuple romain célébrera en ton honneur
les grands jeux durant dix jours et des dons seront offerts sur tous les
autels[14]. Comme les Juifs
avaient fait alliance avec Jéhovah, les Romains faisaient alliance avec
Jupiter, et le dieu paraissait avoir si bien tenu tant de contrats pareils,
que les sénateurs devaient compter qu’il accepterait encore cette promesse
conditionnelle des honneurs pour la victoire.
Aux ides de mai, l’armée de Brindes acheva de passer
l’Adriatique et se réunit à celle d’Apollonie qui avait repris plusieurs
villes thessaliennes. Acilius Glabrion la commandait. C’était un homme
d’obscure origine, mais un vigoureux soldat qui, parmi ses tribuns
légionnaires, comptait deux anciens consulaires, Caton et Valerius Flaccus.
Ces vaillants hommes acceptaient encore de servir l’État en quelque poste
qu’on les mit.
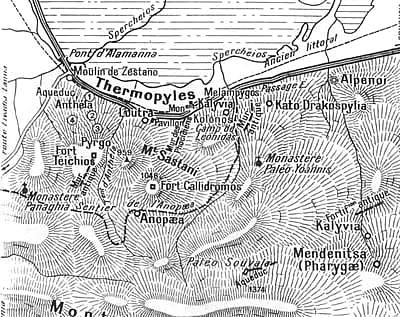 Le consul termina la conquête de la Thessalie et s’avança
jusqu’aux Thermopyles, où Antiochus, qui venait d’échouer en Acarnanie contre
le plus faible des peuples grecs, espéra défendre le passage avec ses dix
mille hommes[15].
Mais Caton surprit deux mille Étoliens postés sur le Callidrome pour défendre
le sentier par lequel Éphialte avait conduit les Perses de Xerxès, pour
tourner Léonidas. A la vue des cohortes romaines descendant de l’Œta,
Antiochus, qui avait arrêté Acilius devant ses lignes dans le défilé,
s’enfuit à travers la
Locride, jusqu’à Élatée, puis à Chalcis, où il arriva avec
cinq cents soldats ; de là il gagna rapidement Éphèse. La bataille des
Thermopyles coûta aux Romains deux cents hommes (juillet 191). Qu’Athènes
nous vante maintenant sa gloire ! s’écriaient les Romains. Dans Antiochus nous avons vaincu Xerxès !
Durant ce combat la flotte romaine avait enlevé près d’Andros un gros convoi
de vivres : Antiochus n’avait même pas su garantir ses communications à
travers la mer Égée. Le consul termina la conquête de la Thessalie et s’avança
jusqu’aux Thermopyles, où Antiochus, qui venait d’échouer en Acarnanie contre
le plus faible des peuples grecs, espéra défendre le passage avec ses dix
mille hommes[15].
Mais Caton surprit deux mille Étoliens postés sur le Callidrome pour défendre
le sentier par lequel Éphialte avait conduit les Perses de Xerxès, pour
tourner Léonidas. A la vue des cohortes romaines descendant de l’Œta,
Antiochus, qui avait arrêté Acilius devant ses lignes dans le défilé,
s’enfuit à travers la
Locride, jusqu’à Élatée, puis à Chalcis, où il arriva avec
cinq cents soldats ; de là il gagna rapidement Éphèse. La bataille des
Thermopyles coûta aux Romains deux cents hommes (juillet 191). Qu’Athènes
nous vante maintenant sa gloire ! s’écriaient les Romains. Dans Antiochus nous avons vaincu Xerxès !
Durant ce combat la flotte romaine avait enlevé près d’Andros un gros convoi
de vivres : Antiochus n’avait même pas su garantir ses communications à
travers la mer Égée.
Pour stimuler le zèle de Philippe, le sénat lui avait
abandonné d’avance toutes les places dont il pourrait s’emparer. Tandis
qu’Acilius tournant ses forces contre les Étoliens, s’obstinait aux sièges
d’Héraclée et de Naupacte, Philippe faisait de rapides progrès. Déjà il avait
conquis quatre provinces. !liais Flamininus veillait sur lui. Il accourt à
Naupacte, montre au consul le danger, et lui persuade d’accorder aux Étoliens
une trêve qui désarme le roi de Macédoine. Quelque temps auparavant, il avait
aussi arrêté une expédition des Achéens contre Messène ; et, en laissant
entrer cette ville dans la ligue, il avait statué qu’elle pourrait recourir,
pour tous ses différends, au sénat ou à son tribunal : tribunal partial
ouvert à toutes les plaintes contre les Achéens. Déjà, en effet, il ne
ménageait plus ce peuple. Ils avaient enlevé file de Céphallénie aux
Athamanes. Comme la tortue retirée sous son
écaille, vous serez invulnérables, leur dit-il, tant que vous ne sortirez pas du Péloponnèse ;
et il leur reprit Céphallénie[16].

III. — BATAILLE DE MAGNÉSIE (190)
; DÉFAITE DES GALATES (180).
A Éphèse, Antiochus avait retrouvé sa sécurité ; Annibal
seul s’étonnait que les Romains ne fussent pas encore arrivés. Pour la
première fois, docile à ses avis, le roi passa dans la Chersonèse, où il
augmenta les fortifications de Sestos et de Lysimachie. En Asie, il acheta
l’alliance des Galates, rechercha celle de Prusias, roi de Bithynie, et
réunit des forces considérables pour soumettre, avant que les Romains se
montrassent, le royaume de Pergame et les villes grecques restées libres.
Mais onze cents Achéens, formés par Philopœmen, défendirent opiniâtrement Pergame[17] ; et Livius, par
une victoire, entre Chios et Éphèse, sur l’amiral syrien Polyxénidas, saisit,
du premier coup, l’empire dans la mer Égée.
Si les Rhodiens furent vaincus à Samos, si Livius échoua
dans ses tentatives sur Éphèse et Patara, les premiers réparèrent leur
défaite dans une bataille navale, où Annibal lui-même fut vaincu ; et le
successeur de Livius détruisit, près de Myonnése, la flotte syrienne, malgré
l’habileté des pilotes de Tyr et de Sidon qui la conduisaient.
Sur ces combats, Tite-Live nous a conservé quelques
détails intéressants pour l’histoire de la guerre maritime dans l’antiquité.
Dans la mer figée, le préteur Livius commandait
quatre-vingt-un navires pontés et à éperon : c’étaient les vaisseaux de
ligne, et un certain nombre de bâtiments armés aussi de l’éperon, mais non
pontés, par conséquent plus légers et pouvant évoluer rapidement, ce qui
était, alors comme aujourd’hui, une des conditions de la tactique navale.
Elle consistait en trois manœuvres : éviter le choc de l’ennemi, briser ses
rames, pour l’assaillir ensuite, comme nous cherchons à briser le gouvernail
ou l’hélice pour rendre le navire immobile, le couler avec l’éperon ou
l’enlever à l’abordage. Aux deux époques, les moyens d’action diffèrent, mais
l’art de s’en servir est le même. Enfin des coureurs très rapides faisaient
le service des reconnaissances[18]. Livius
attendait à Délos que le vent devint favorable pour gagner la côte d’Asie.
L’amiral syrien, Polyxénidas, promptement averti par ses barques d’éclaireurs
qu’il avait postées de distance en distance, à travers la mer des Cyclades,
demanda au roi de réunir à Éphèse un conseil de guerre. Il y représenta que
les navires romains, grossièrement construits, chargés de provisions et
venant naviguer en des parages que leurs chefs connaissaient mal, étaient de
lourdes machines dont on aurait facilement raison. Il obtint la permission de
combattre, bien que la flotte romaine, ayant rallié celle du roi de Pergame,
comptât deux cents galères dont les trois quarts étaient pontées.
A l’approche des Syriens, Livius fit carguer les voiles,
ôter les agrès et abaisser les mâts. Le combat commença entre deux galères
carthaginoises, placées en avant-garde, et trois galères syriennes. Deux de
celles-ci s’attaquèrent à un seul des bâtiments carthaginois, qui, désemparé,
tomba en leur pouvoir. Tout l’équipage fut égorgé et jeté à la mer. C’était
de mauvais augure. Livius poussa aussitôt en avant son navire amiral, en
donnant l’ordre à ses rameurs, quand ils arriveraient sur l’ennemi, d’abaisser
leurs rames des deux côtés pour affermir le vaisseau sur sa base, et aux
soldats de lancer leurs grappins d’abordage. Les deux galères furent prises
et l’action devint générale. Les lourdes machines
romaines, bien manœuvrées par leurs pilotes grecs, évitaient les
coups et en portaient de terribles. En peu de temps treize navires syriens
furent pris, dix coulés, les autres s’enfuirent. L’action s’était passée à la
hauteur de Coryce, non loin de Phocée, et les Romains n’y avaient perdu que
la galère carthaginoise prise au début. L’éperon des anciens produisait donc
des effets comparables à ceux des modernes. Dans une autre affaire, un petit
navire rhodien fit sombrer une galère syrienne à sept rangs de rames[19], comme au combat
de Lissa un navire en bois coula un cuirassé italien, par le choc direct.
Pour consacrer le souvenir du combat de Myonnèse, une inscription, gravée à
Rome sur la muraille du temple des dieux de la mer, raconta que les Romains,
en détruisant sous les yeux d’Antiochus la flotte syrienne, avaient tranché un grand débat et triomphé des rois.
Ils avaient raison de garder mémoire de ces victoires
navales, car elles avaient décidé d’avance la question entre Rome et
Antiochus. La victoire de Myonnèse ouvrait aux Romains la route de l’Asie ;
quel chef allait y conduire les légions ? Les consuls de l’année 190 étaient
Lælius et Lucius Scipion. Celui-ci passait pour un médiocre général. Son
collègue, qui désirait avoir la conduite de cette guerre, demanda au sénat,
dont il se croyait sûr, de ne point, suivant l’usage, tirer les provinces au
sort, mais d’en faire lui-même la distribution. Scipion accepta, et l’on
s’attendait à de vives discussions, lorsque l’Africain déclara que, si son
frère était envoyé contre Antiochus, il lui servirait de lieutenant. Cette
promesse entraîna presque tous les suffrages.
Les deux frères partirent pour la Grèce avec des renforts
qui augmentèrent l’armée d Acilius, dont Lucius Scipion prit le commandement
nominal : cinq mille vétérans de Zama s’étaient volontairement enrôlés pour
suivre leur glorieux général. Les Scipions se débarrassèrent des Étoliens, en
leur accordant une trêve de six mois[20], puis
traversèrent la Thessalie
et la Macédoine.
Philippe, gagné par le renvoi de son fils Démétrius et par
la remise du tribut[21], avait fait
préparer des vivres, ouvrir des routes et jeter des ponts sur les fleuves.
Lysimachie aurait pu arrêter l’armée, Antiochus l’évacua, et les Romains
occupèrent sans combat la
Chersonèse de Thrace au moment où la victoire de Myonnèse
chassait les flottes syriennes de la mer Égée. Le passage de l’Hellespont,
qui aurait dû être si vivement disputé, s’effectua donc sans obstacle. Le
roi, à la fin effrayé, demanda la paix, et chercha à gagner Scipion, en lui
rendant son fils qui avait été fait prisonnier. L’Africain répondit : Il est trop tard, les chevaux sont bridés et les cavaliers
en selle. Pourtant, si le roi paye les frais de guerre et abandonne l’Asie
jusqu’au Taurus[22], la paix se peut faire encore. Une bataille ne
pouvait pas lui ôter davantage ; Antiochus voulut au moins la risquer. Lucius
se hâta de la donner en l’absence de son frère resté malade à Élée. Elle se
livra le 5
octobre 190, prés de Magnésie du Sipyle, dans la vallée de
l’Hermos. Trente mille Romains[23] allaient
combattre quatre-vingt-deux mille Asiatiques, cinquante-quatre éléphants, des
chars à faux, une phalange de seize mille lances, des chameaux montés par des
archers arabes, des cataphractaires bardés de fer, eux et leurs chevaux, etc.
Mais cette armée avait tout, excepté le courage. On dit que cinquante-deux
mille. Syriens furent tués ou pris, et que le consul ne perdit que trois cent
cinquante hommes. Les Galates seuls s’étaient bravement battus[24].
Il ne restait plus qu’à traiter ; les conditions furent
sévères[25].
Le sénat interdit au roi toute guerre dans l’Asie Mineure, lui prit ses
éléphants, qu’il donna à Eumène, et ses vaisseaux, qu’il brûla comme il avait
brûlé ceux de Carthage et de Philippe. Il lui défendit de faire des levées en
Grèce ; c’est-à-dire d’avoir une armée, et, comme autrefois Athènes à
Artaxerxés, de naviguer au delà du promontoire Sarpédon ; enfin, le chassant
de l’Asie Mineure, il fixa au Taurus la limite de ses États. Une contribution
de guerre, pour Rome, de 15.000 talents euboïques (84 millions de francs), pour Eumène,
de 400 talents (2.240.000
francs)[26].
On voulut encore le déshonorer, en lui demandant de livrer Annibal, Thoas,
quelques-uns de ses conseillers et vingt otages, qu’il dut changer tous les
trois ans : parmi eux on eut soin de faire comprendre son second fils.
Antiochus remercia encore le sénat de n’avoir pas demandé davantage ! Pour
abattre la Macédoine
et Carthage, les légions durent s’y prendre à trois fois ; du premier coup la Syrie tomba et, comme si
l’épée de Rome faisait d’inguérissables blessures, jamais plus elle ne se
releva.
Quand Manlius Vulso vint recevoir I’armée des mains de L.
Scipion, il trouva les conditions de la paix à peu près arrêtées et la guerre
terminée (189).
Mais son ambition et son avidité s’allumèrent dans cette riche Asie où les
triomphes étaient si faciles. D’ailleurs il semblait politique d’aller
montrer les armes romaines dans ces pays d’où l’on venait de chasser le roi
de Syrie et où ses satrapes, ses alliés, étaient très disposés à regarder sa
défaite comme une délivrance de toute domination. Les Galates avaient donné
quelques secours à Antiochus, Manlius leur en demanda raison. Pour cette
guerre, il n’avait ni décret du peuple ni autorisation du sénat, il s’en
passa ; et, afin de rendre l’expédition plus productive pour lui-même, en
même temps que plus utile à la république, il évita de prendre par le plus
court chemin, afin. qu’un plus grand nombre de peuples sentissent la main de
Rome sur leur tête. D’Éphèse il gagna la vallée du Méandre, qu’il remonta ;
puis il suivit les pentes du Taurus jusqu’à Termessus, place très forte qui
fermait le défilé par où l’on descend dans la Pamphylie. Après
avoir montré ses enseignes à l’entrée de cette province, ce qui suffit à y
répandre le respect du nom romain, il traversa la Pisidie, la Phrygie et atteignit les
bords du Sangarius. Sur sa route, il rançonnait[27] les villes, les
provinces et tous ces petits princes, indépendants alors comme ils l’ont été
si longtemps dans leurs inaccessibles retraites, et qui ne reconnaissent un
maître qu’autant qu’ils lui payent tribut. Jusqu’au Sangarius, il n’y eut que
des fatigues : au delà du fleuve, la guerre commença.
Les Gaulois étaient depuis quatre-vingt-dix ans environ en
Asie. Leur fougue de courage, leur amour de courses lointaines, étaient
tombés. Mais, si l’on a exagéré leurs forces, comme celles de tous les
adversaires de Rome à cette époque, si la concurrence des Grecs et le bas
prix des mercenaires crétois et étoliens diminuaient leur nombre dans les
armées de Syrie et d’Égypte, si le temps enfin où ils disposaient des
couronnes de ces deux royaumes était passé, ils étaient toujours le peuple le
plus brave de l’Orient. Les populations, qui tremblaient devant eux, voyaient
avec joie les Romains se charger d’en délivrer l’Asie. Dans toute la Phrygie, on courut
au-devant des légions, et, à Pessiliunte, les prêtres de Cybèle promirent au
nom de la déesse une route facile et une victoire assurée. Deux rois
seulement, Ariarathe de Cappadoce, gendre d’Antiochus, et Murzés de
Paphlagonie, comprirent que les Gaulois étaient le dernier boulevard de leur
indépendance ; ils vinrent les joindre avec quatre mille hommes d’élite[28].
Les Galates s’étaient retranchés sur les monts Olympe et
Magaba. Manlius attaqua d’abord les Trocmes et les Tolistoboïes sur l’Olympe.
L’imprudence des Gaulois, qui ne s’étaient point pourvus d’armes de jet,
permit au consul d’en faire de loin un grand massacre. Après ce premier
succès, il se dirigea sur la grande ville d’Ancyre, où il campa. Des députés
tectosages y vinrent pour ouvrir de prétendues négociations qui cachaient un
piège. Le consul faillit y tomber, et pensa périr ; son armée ne fut que plus
ardente à l’attaque, et, comme l’ennemi avilit été aussi imprévoyant à Magaba
qu’au mont Olympe, sa négligence eut les mêmes résultats. Les deux camps
forcés, ce qui restait de la nation demanda la paix. Content d’avoir brisé
leur puissance et répandu au loin, par cette expédition contre un peuple
redouté, la terreur du nom romain, Manlius ne leur imposa ni tribut ni clause
honteuse. Il était habile d’attacher à la fortune de Rome ce peuple ennemi de
tous les peuples de l’Asie. Les Galates rendirent seulement les terres qu’ils
avaient enlevées aux alliés du sénat, s’engagèrent à ne plus sortir de leur
pays et firent alliance avec Eumène.
Parmi les captifs tombés aux mains des Romains s’était
trouvée Chiomara, femme du tétrarque Ortiagon. Un centurion romain l’outragea
; elle obtint cependant qu’il lui rendrait la liberté moyennant une somme
d’argent : un esclave gaulois alla prévenir les siens. La nuit arrivée, le
centurion conduisit Chiomara au bord du fleuve où devait se faire l’échange.
Il était seul, pour n’avoir pas à partager la rançon que deux parents de la
captive avaient apportée. Tandis que le Romain compte son or, Chiomara
ordonne dans sa langue aux deux Gaulois de le tuer, puis prend sa tête et,
arrivée devant son époux, jette cette tête à ses pieds en lui apprenant
l’injure en même temps que la vengeance. Ô femme,
s’écrie Ortiagon, la fidélité est une belle
chose ! — Oui,
répond-elle, mais il y a quelque chose de plus
beau encore : c’est que, moi vivante, deux hommes ne puissent se vanter de
m’avoir possédée[29].
Soit flatterie où joie sincère d’être délivrées de ces
pirates, toutes les villes d’Asie offrirent à Manlius des couronnes d’or. Une
contribution de 300 talents, frappée sur Ariarathe, augmenta l’immense butin
que le consul traînait après lui. Mais cette armée si riche avait perdu sa
discipline. Le général qui, de son autorité, privée, faisait la paix ou la guerre,
ne pouvait réclamer de ses légions l’obéissance qu’il refusait lui-même au
sénat[30]. Malgré les dix
commissaires qu’on lui avait adjoints, il retourna une seconde fois jusqu’en
Pamphylie, tâchant d’attirer Antiochos à une conférence pour l’enlever, et cherchant
un prétexte de guerre pour franchir le Taurus, limite fatale au delà de
laquelle la sibylle ne promettait aux Romains que désastres. Cependant cette
expédition avait montré les aigles romaines aux peuples de l’Asie Mineure et
fait. entrer dans la politique du sénat, ou placé sous son influence, tous
les pays jusqu’à l’Euphrate. De retour à Éphèse, Manlius régla avec les
commissaires le sort des alliés.
Dans la distribution des dépouilles, Eumène eut la
meilleure part[31],
les plus riches provinces de l’Asie Mineure et les possessions d’Antiochus en
Europe ; Prusias, roi de Bithynie, lui rendit ce qu’il avait enlevé de la Mysie. Quelle
brillante fortune pour un roi de Pergame ! De la Thrace à la Cilicie tout maintenant
lui appartenait. Mais le sénat épargnait Prusias et le roi de Cappadoce,
Ariarathe, qui cependant paya 200 talents pour quelques secours fournis à
Antiochus ; il n’imposait aux Galates que d’assez douces conditions, et
refusait à Eumène de lui livrer les colonies grecques, qui seules valaient
plus que toutes ces provinces à demi barbares. Aussi le nouveau royaume
d’Asie, formé de vingt peuples différents, sans unité, sans force militaire,
sans frontières, et entouré de rivaux puissants, n’avait-il aucune des
conditions qui font les États durables. L’alliance de Rome n’était qu’une
dépendance déguisée, car déjà commençait la
coutume d’avoir des rois pour instruments de servitude. Personne
ne s’y trompait, et en plein sénat, en face d’Eumène, on s’écriait : L’empire de Rome s’étend maintenant jusqu’au Taurus.
Les flottes rhodiennes avaient été plus utiles que les
vaisseaux et les trois mille auxiliaires d’Eumène : Rhodes eut moins
cependant, parce qu’elle semblait déjà trop puissante. Elle dut se contenter
de quelques agrandissements dans la
Carie et la
Lycie, où nombre de villes restèrent libres. Le long de la
côte, dans la Troade,
l’Éolide et l’Ionie, Cymes, Colophon et presque toutes les anciennes colonies
grecques obtinrent l’immunité, avec de nouvelles terres et des honneurs.
Milet eut le champ sacré ; Clazomène, l’île Drymusa, qui commande le golfe de
Smyrne ; Ilion, comme berceau du peuple romain, s’agrandit du territoire de
deux villes voisines ; Dardanus dut au même titre sa liberté. Chios, qui
pendant la guerre avait servi d’entrepôt aux Romains pour leurs convois
d’Italie ; Érythrée et Smyrne, qui avaient résisté aux menaces comme aux
promesses d’Antiochus, furent tenues auprès du sénat en singulier honneur.
Phocée, malgré sa défection, recouvra son territoire et reprit ses anciennes
lois ; Adramytte, Alexandrie de Troade, Lampsaque, Elæunte, Magnésie du
Sipyle, etc., furent affranchies de toute domination. Mais Éphèse, qui avait
été le centre des opérations militaires d’Antiochus, Sardes, le rendez-vous
ordinaire de ses armées, et Élée demeurèrent au roi de Pergame. Enfin, les
Pamphyliens, qu’Eumène et Antiochus se disputaient, obtinrent la liberté et
le titre d’alliés de Rome. Quant aux Galates, Rome ne toucha ni à leur
liberté ni à leur territoire, mais elle avait détruit leur force militaire,
le prestige de leur puissance, et elle leur défendit de jamais passer leurs
frontières. Plus loin à l’est, les deux satrapes d’Arménie qui gouvernaient
cette province pour Antiochus furent autorisés à prendre le titre de roi (188)[32].
Tandis que Manlius achevait la guerre d’Asie, son collègue
Fulvius attaquait Ambracie, comme les Galates l’avaient été, sans déclaration
de guerre, pour en finir avec les Étoliens.
Vainement ce peuple, depuis la bataille des Thermopyles,
avait demandé la paix. Le sénat, enveloppant ses réponses de paroles
ambiguës, exigeait qu’il se remit à la foi romaine. Un jour ses magistrats
acceptèrent ; mais, quand le consul Acilius leur eut expliqué que ces termes
voulaient dire qu’il fallait livrer à Rome ceux qui avaient fomenté la
guerre, ils se récrièrent : c’était contraire, disaient-ils, à la coutume des
Grecs. Alors Acilius, haussant le ton, moins par colère que pour faire sentir
aux députés à quoi les Étoliens étaient réduits et leur inspirer une extrême
terreur : Il vous sied bien, petits Grecs, de
m’alléguer vos usages et de m’avertir de ce qu’il me convient de faire, après
vous être abandonnés à ma foi ! Savez-vous qu’il dépend de moi de vous
charger de chaînes ? Et sur-le-champ il en fit apporter, ainsi
qu’un collier de fer qu’il ordonna de leur mettre au cou. Les ambassadeurs
furent si effrayés, que leurs genoux ployaient sous eux. Mais, à la prière du
légat, Valerius Flaccus, et de quelques tribuns, le consul se radoucit (191).
L’affaire ne fût pourtant pas réglée cette fois ni l’année
suivante. Pour ne pas perdre son consulat au siège de quelques places
obscures, L. Scipion accorda aux Étoliens une trêve de six mois, au bout
desquels le sénat leur laissa encore le temps d’enlever à Philippe ses
conquêtes. Quand ils l’eurent rejeté dans la Macédoine et que le
roi de Syrie eut été abattu, Fulvius arriva avec deux légions et s’empara
d’Ambracie malgré une héroïque résistance. Cette ville, ancienne capitale de
Pyrrhus, était riche en chefs-d’œuvre de toutes sortes. Fulvius exigea qu’ils
lui fussent remis. Dans ce butin se trouvaient les statues des Muses ; il les
emporta et, en vrai Romain, donna pour maître aux neuf déesses dans le temple
qu’il leur bâtit, au lieu du dieu de l’harmonie, celui de la force : Hercule
Musagète. C’était bien, en effet, comme butin de victoire que les arts de la Grèce entraient dans Rome.
Les Étoliens, restés seuls, achetèrent la pais au prix de
500 talents, et reconnurent l’empire et la
majesté du peuple romain[33], — Ils ne livreront, disait le traité, passage à aucune armée marchant contre les Romains, leurs
alliés ou leurs amis (socios et amicos) ; ils
auront pour ennemis, les ennemis du peuple romain et prendront les armes
contre eux ; ils rendront les transfuges, les esclaves fugitifs et Ies prisonniers
; ils livreront, au choix du consul, quarante otages de douze ans au moins,
de quarante ans au plus, et, en outre, leur stratège, le commandant de leur
cavalerie et leur scribe public[34]. Au moins ce
petit peuple avait-il honoré sa défaite par son courage et bravé trois ans la
puissance romaine. Les villes qui avaient autrefois fait partie de la ligue
en furent séparées, pour recouvrer ce que le sénat appelait leur liberté ;
mais Céphallénie reçut garnison romaine. Cette île, qui commande l’entrée du golfe
de Corinthe et d’où l’on aperçoit distinctement l’Élide[35], allait devenir
une des étapes des flottes romaines partant de Brindes pour gagner la Grèce. En occupant
Corcyre, Zante et Céphallénie, trois excellents ports, faciles à défendre, le
sénat était maître de l’Adriatique ; il avait bien choisi : les Anglais ont
fait comme lui, quand ils voulurent que, dans cette mer, rien ne passât sans
leur bon plaisir.
Afin de ne pas rester inactif durant les expéditions
continentales des deux consuls, le commandant de la flotte était allé, sans
décret du sénat, menacer les Crétois d’une descente, s’ils ne rendaient les
prisonniers romains amenés ou vendus dans leur île : on lui en livra quatre
mille. Fulvius avait, de son côté, prescrit d’actives recherches pour retrouver
tous les captifs. C’était une règle de la politique romaine, une condition
que les généraux écrivaient dans tous les traités ; et cette sollicitude, qui
les honore, devait leur mériter le dévouement de leurs soldats.
Cependant Manlius revenait d’Asie par la Thrace avec ses légions,
qui suffisaient à peine à escorter le butin. Embusqués le long de la route,
les Thraces enlevèrent la moitié des bagages et mirent deux fois l’armée en
péril. Mais Philippe n’était pas en état d’en profiter. II ouvrit encore la Macédoine aux Romains,
et Manlius repassa l’Adriatique, sans qu’un seul légionnaire restât dans la Grèce ou l’Asie. Le sénat
tenait ce qu’il avait promis : partout, sur les deux continents et dans les
îles, les Grecs étaient libres, et, de tant de conquêtes, Rome ne gardait pas
un pouce de terre. La comédie commencée avec tant de succès par Flamininus
aux jeux Isthmiques était jouée. Mais, en se retirant après avoir abaissé
tout ce qui avait quelque énergie, la Macédoine, les Étoliens, la Syrie et les Galates, les
légions laissaient derrière elles, dans chaque ville, dans chaque l’état, un
parti dévoué qui faisait pour le sénat la police de la Grèce et de l’Asie. Et en
face de cette foule de petits princes et de petits peuples s’élève la
colossale puissance de Rome, avec sa forte organisation militaire et
politique, son sénat si habile et ses légions si braves !
|