|
I. — EXPÉDITIONS ROMAINES AUTOUR DE
L’ITALIE ET DANS LA
CISALPINE.
Rome venait de montrer une admirable constance ; mais il
semblait qu’après de si longs efforts elle dût être épuisée. La population
était tombée, dans l’espace de cinq années, de 297.797 hommes en état de
combattre à 241.212
[1] ; sept cents
galères avaient été détruites avec un nombre immense de vaisseaux de charges[2] ; le trésor était
accablé d’obligations envers les particuliers qui lui avaient fait des
avances et, pour fournir aux dépenses d’une guerre si onéreuse, le sénat
avait dû recourir au dangereux expédient de falsifier les monnaies. Le poids
de l’as avait été successivement réduit de 12 onces à 6, à 4, à 3,
à 2, et comme l’État, à cause de ses armements, était le débiteur universel,
cet affaiblissement de la monnaie lui fit gagner cinq sixièmes sur ses dettes
ou plus de 80 pour 100 : opération qui équivalait, pour les créanciers, à une
banqueroute véritable[3]. Même diminution
de poids pour la monnaie d’argent. En 269, on taillait 40 deniers à la livre
; en 244, on en tailla 75 ; en 241, 84, bien que le denier représentât toujours
10 as[4].
Mais la force de Rome n’était pas dans ses richesses ;
quant aux petites gens, la fondation de plusieurs colonies, une très large
distribution de terres et la formation, en 241, de deux nouvelles tribus, Velina et Quirina,
reconstituèrent la classe des petits propriétaires que la guerre avait
décimée[5]. Aussi Rome se
trouva-t-elle bientôt prête pour de nouveaux combats.
La première guerre Punique avait coûté à Carthage la Sicile et l’empire de la
mer : c’était trop de honte et de pertes pour qu’elle s’y résignât ; au fond,
la paix qui venait d’être signée n’était qu’une trêve. Le sénat le comprit et
employa les vingt-trois années qu’elle dura à fortifier sa position dans la
péninsule, en occupant tous les points d’où elle pouvait être menacée, la Sicile, la Corse, la Sardaigne, la Cisalpine et l’Illyrie.
Il voulait faire de l’Italie une forteresse.
La Sicile,
théâtre de la première guerre Punique, avait vu ses villes tour à tour prises
et reprises, toujours pillées, et leurs habitants vendus. Pendant vingt-trois
ans, elle avait épuisé. ses campagnes pour nourrir des flottes et des armées
qui comptèrent quelquefois plus de deus cent mille hommes ; mais cette terre,
d’une admirable fertilité, eut promptement réparé ses pertes. Le sénat se
hâta de la déclarer province[6] romaine : c’était
une condition nouvelle. Il n’était pas nécessaire, en effet, d’employer, à l’égard
des Siciliens, les ménagements politiques dont les Romains s’étaient servis
avec les peuples d’Italie. Maintenant que le centre de leur empire est
couvert par des municipes, des colonies et des alliés, il n’y aura plus au
dehors que des sujets taillables et corvéables[7]. Lutatius désarma
tous les habitants, fit la part du domaine public, et deux cents villes ne
recouvrèrent leur territoire qu’à la condition de payer un tribut fixé chaque
année par les censeurs romains et la dîme de tous les produits du sol ;
souvent même le sénat exigera double dîme. Lutatius écrivit aussi la formule
qui donna aux cités sujettes une organisation uniforme dans laquelle
dominaient, à l’exemple de Rome, les principes aristocratiques. Chaque année,
un préteur fut envoyé dans la nouvelle province, avec un pouvoir absolu,
duquel on ne put appeler qu’après les faits accomplis. Fidèle cependant à sa
maxime de ne faire jamais peser sur tous un joug égal, le sénat accorda des
privilèges à quelques villes préférées, en petit nombre toutefois, car la Sicile était trop riche
pour que Rome s’ôtât le droit de la spolier à loisir. Ainsi Panorme, Égeste,
Centuripa, Halæsa, Halicyæ furent libres et exemptes du tribut, mais
astreintes au service militaire : la petite république de Tauromenium et
celle des Mamertins restèrent indépendantes comme l’était le royaume de
Syracuse : plus tard, il y eut aussi des colonies. Messine devait cette
faveur à son rôle dans la première guerre Punique, Syraruse, à la longue
fidélité de Hiéron. Quant à Tauromenium, bâtie sur une montagne à 275 mètres au-dessus
de la mer et défendue par une citadelle construite 150 mètres plus haut,
sur un rocher presque inaccessible, elle avait sans doute manifesté dès ce
temps-là les sentiments qu’elle montra plus tard à Marcellus et qui lui valurent
le titre de civitas fœderata.
Comme il avait été fait pour le plus grand nombre des
Italiens, il fût interdit aux habitants d’acquérir hors du territoire de
leurs cités. De là une baisse extrême dans la valeur des terres, dont les
spéculateurs romains, qui peuvent acheter partout, profiteront pour accaparer
les meilleurs domaines. De jour en jour le nombre des propriétaires indigènes
diminuera, et Cicéron en trouvera quelques-uns à peine dans chaque ville. Avec
la petite propriété, la classe des cultivateurs libres disparaîtra de l’île
entière. Des fermes immenses, cultivées, pour quelques riches chevaliers
romains, par une multitude innombrable d’esclaves, des moissons, mais plus de
poètes ni d’artistes, tel sera désormais l’état de la Sicile. Devenue
le grenier de Rome, elle sauvera plus d’une fois de la famine le peuple et
ses armées. Mais aussi de son sein sortiront les guerres Serviles : expiation
cruelle d’une mesure impolitique. C’est une loi de l’humanité : le mal
engendre le mal ; nous l’avons bien vu, de nos jours, dans l’Irlande qui a
été si longtemps, par des causes analogues, une plaie saignante au flanc de l’Angleterre.
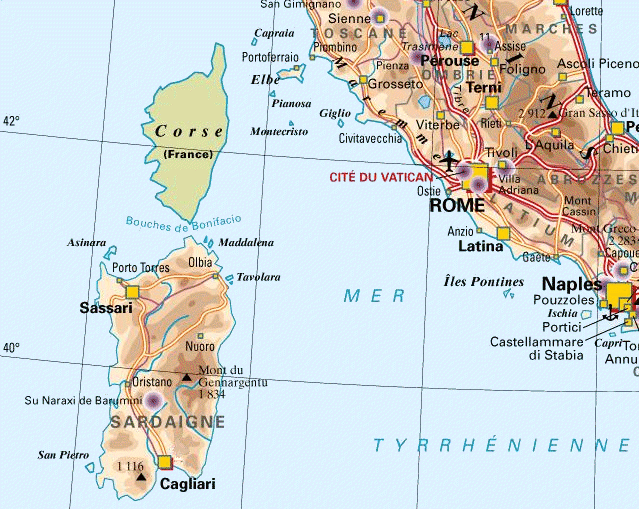
La
Sardaigne et la
Corse furent acquises au prix d’une trahison. A la nouvelle
que les mercenaires de Carthage, ramenés de Sicile en Afrique, s’étaient
révoltés, ceux qu’elle avait laissés en Sardaigne avaient massacré leurs chefs
et tous les Carthaginois répandus dans l’île ; un soulèvement des habitants
contre cette soldatesque la força de se mettre sous la protection de Rome. Le
sénat, qui avait soutenu les révoltés d’Afrique en permettant que de tous les
ports d’Italie ou leur portât des vivres[8], n’hésita pas à
profiter des embarras de sa rivale pour déclarer que la domination
carthaginoise ay1ant cessé dans file, il pouvait, sans rompre le traité,
prendre possession de la
Sardaigne. Puis, sur le bruit que Carthage faisait quelques
Préparatifs, il feignit de croire l’Italie menacée et déclara la guerre, Cette
colère tomba devant l’offre de 1200 talents et de l’abandon de la Sardaigne. Cependant
il fallut conquérir les Sardes, que leurs anciens maîtres soutenaient probablement
en secret. Le sénat y employa huit années, et deux consuls en revinrent avec
le triomphe. L’un d’eux, Pomponius Matho, pour dépister les insulaires dans
leurs retraites les mieux cachées, s’était servi de chiens dressés à chasser l’homme,
expédient que les Espagnols ont renouvelé au nouveau mande. Cette conquête
s’achevait comme elle avait commencé, par des moyens odieux.
La Corse
partagea le sort de l’île voisine : le sénat la déclara province romaine ; en
réalité, elle conserva cette liberté qu’aucun ennemi n’osait aller lui
prendre au fond de ses impénétrables maquis[9]. Trop sauvage et
trop pauvre pour fournir le tribut en blé, comme la Sardaigne, la Corse le paya avec la cire
de ses abeilles ; elle en promit 100.000 livres[10]. La création de
ces deux provinces força de porter à quatre le nombre des préteurs : deux, le
prætor urbanus et le prætor peregrinus, restèrent à Rome ; les
deux autres furent chargés de gouverner l’un la Sicile, l’autre la Sardaigne et la Corse (227).
La Sicile,
la Sardaigne
et la Corse tant
soumises, la mer Tyrrhénienne devenait un lac romain. Sur l’autre mer, le littoral
était gardé, depuis Rimini jusqu’à Brindes, par six colonies[11]. Mais la côte
d’Illyrie, couverte d’îles innombrables, a été habitée dans tous les temps
par de dangereux pirates. A l’époque qui nous occupe, l’Adriatique en était
infestée. Rien ne passait sans payer tribut ; les rivages de la Grèce étaient sans cesse
dévastés, ceux de l’Italie menacés[12]. Peu d’années
auparavant ils avaient battu les Étoliens et les Épirotes, pris Phénice, la
plus riche ville de l’Épire, pillé l’Élide, la Messénie, et attiré les
Acarnaniens dans leur alliance. Sur les plaintes qui s’élevaient de toutes
parts, le sénat envoya des ambassadeurs à la veuve de leur dernier roi,
Teuta, qui gouvernait au nom de son fils Pinéus une partie de l’Illyrie[13]. Elle répondit
avec hauteur que ce n’était pas la coutume des rois d’Illyrie de défendre à
leurs .sujets d’aller en course pour leur utilité particulière. A ces
paroles, le plus jeune des députés, un Coruncanius, répondit : Chez nous, reine, la coutume est de ne jamais laisser
impunis les torts soufferts par nos concitoyens, et nous ferons en sorte,
s’il plait aux dieux, que vous vous portiez de vous-même à réformer les
coutumes des rois illyriens. Teuta, irritée, fit tuer le jeune
audacieux, ceux qui avaient provoqué cette ambassade romaine, et brûler vifs
les commandants des vaisseaux qui l’avaient amenée. Puis les courses recommencèrent
avec plus d’audace : Corcyre fut prise, Épidamne et Apollonie assiégées, une
flotte achéenne battue.
C’était une heureuse occasion pour les Romains de se
montrer aux Grecs. Le sénat vit quel parti il pouvait tirer de ces événements,
et il prit hautement le rôle de protecteur de la Grèce[14] qu’il devait
jouer jusqu’au bout avec tant de succès. Afin de donner une grande idée de sa
puissance, il envoya contre ces misérables ennemis deux cents vaisseaux,
vingt mille légionnaires et les deux consuls (229). Il n’avait pas tant fait au début
contre Carthage. Corcyre fut livrée par un traître, Démétrius ; les Illyriens
assiégeaient Issa, dans l’île du même nom (Lissa), ils en furent chassés, et aucune
des places qui voulurent résister ne put tenir. Teuta, effrayée, accorda tout
ce que Rome lui demanda : un tribut, la cession d’une partie de l’Illyrie, la
promesse de ne pas mettre en mer au delà du Lissus plus de deux navires, et
la tête de ses principaux conseillers pour apaiser par leur sang répandu les
mânes irritées du jeune Coruncanius (228). Les villes grecques soumises par les Illyriens, Corcyre
et Apollonie, furent rétablies dans leur indépendance[15].
Les consuls se hâtèrent de faire connaître ce traité aux
Grecs, en rappelant que c’était pour leur défense qu’ils avaient passé la mer.
Les députés se montrèrent dans toutes les villes aux applaudissements de la
foule : à Corinthe, ils furent admis aux jeux isthmiques ; à Athènes, on leur
donna le droit de cité, et ils furent initiés aux mystères d’Eleusis. Ainsi
se nouèrent les premières relations de Rome et de la Grèce.
Les Romains avaient donné à Démétrius file de Pharos et
quelques districts de l’Illyrie. Ne se croyant pas assez récompensé, il
s’unit aux corsaires et entraîna dans sa révolte le roi Pinéus. La guerre
gauloise dont nous allons parler était finie ; le sénat, libre de toute
inquiétude en Italie, put envoyer encore un consul en Illyrie. Démétrius se
réfugia auprès du roi de Macédoine, qu’il armera bientôt contre les Romains,
et Pinéus se soumit aux conditions du premier traité (219) ; Rome posséda alors sur le
continent grec de bons ports et sine vaste province, poste avancé, qui
couvrit l’Italie et menaça la !Macédoine. L’Adriatique était pacifiée comme
la mer Tyrrhénienne, et les villes marchandes de l’Italie se rattachaient de
cœur à la fortune d’un gouvernement qui donnait à leur commerce la sécurité
et l’essor[16].
De la
Sicile aux extrémités septentrionales de l’Ombrie et de l’Étrurie,
la domination romaine était acceptée ou soufferte en silence. Au delà du
Rubicon et de l’Apennin, tout restait libre : la Cisalpine, malgré la
défaite des Boïes au lac Vadimon en 283, n’avait pas été entamée. La
fertilité de ces plaines, qui fait de la Lombardie un jardin, étonnait Polybe, même
après qu’il eût vu la Sicile
et l’Afrique. On y recueille, dit-il, une si grande abondance de grains, quand on cultive la
terre, que nous avons vu la mesure de froment à 4 oboles, et celle d’orge à
moitié de ce prix. La mesure de vin s’échange contre une égale mesure d’orge.
Le millet y croît en abondance. De nombreux bois de chênes répandus dans la campagne
donnent du gland en telle quantité, que les plaines du Pô produisent une
bonne partie de la viande de porc dont on fait en Italie un si grand usage
soit pour la nourriture du peuple, soit pour l’approvisionnement des armées.
Enfin on peut satisfaire à toutes les nécessités de la vie en dépensant si
peu, que les voyageurs qui descendent dans les hôtelleries n’offrent pas un
prix séparé pour chaque objet de consommation, nais payent leur écot par tête
; et il arrive souvent qu’ils en sont quittes pour la quatrième partie d’une
obole[17].
Dans ce pays plantureux, la race gauloise avait pullulé
avec une incroyable fécondité : Caton comptait cent deux tribus boïennes.
Polybe, qui les vit près d’un siècle après l’époque où notre histoire nous a
conduits, les trouva habitant des bourgs sans murailles, couchant sur l’herbe
ou sur la paille, sans meubles et ne se nourrissent que de viande. La guerre
était leur principale industrie ; de l’or et du bétail, la seule richesse
qu’ils estimaient, parce qu’ils pouvaient la transporter partout où les
menait une vie aventureuse. Des guerres intestines, nées de la rivalité des
chefs, la jalousie des tribus, la haine des Taurins contre les Insubres, des Cénomans
contre les Boïes, des Vénètes contre tous, et le service lucratif dans les
armées de Carthage qui attirait les plus remuants de ces aventuriers, avaient
depuis quarante-cinq ans sauvé la péninsule des dangers d’une invasion
gauloise. Le repos que la paix de 241 avait rendu au monde ne convenait pas à
ces batailleurs. En 258, deux chefs Boïens, soutenus de la jeunesse du pays,
voulurent, malgré les vieillards, entraîner leur peuple dans une guerre
contre Rome. Ils appelèrent quelques tribus des Alpes et les lancèrent sur
Ariminum. Mais les partisans de la paix l’emportèrent ; les deux chefs furent
massacrés, leurs auxiliaires chassés, et le calme était rétabli avant que les
légions fussent arrivées sur la frontière.
A ce moment, les expéditions de Sardaigne et d’Illyrie
n’étaient pas commencées ; les Gaulois semblaient intimidés, et Carthage
abattue ; le sénat, pour la première fois depuis Numa, ferma le temple de
Janus. Presque aussitôt des troubles éclatèrent de toutes parts, et Rome
redevint la cité de Mars.
Les Ligures, descendus de leurs montagnes, pillaient les
plaines étrusques ; pour les rejeter dans l’Apennin, il fallut six années
d’efforts et les talents de Fabius. Cette guerre n’était que fatigante, celle
des Boïes fut dangereuse. Le sénat avait défendu qu’on leur vendît des armes,
et le tribun Flaminius avait proposé le partage, le long de leurs frontières,
des terres du pays sénon restées à peu près désertes depuis la guerre
d’extermination de 283. Cette proposition rentrait dans la politique de Rome
: elle débarrassait la ville de ses pauvres ; elle récompensait les vétérans
de la guerre Punique et elle plaçait aux approches de la Cisalpine une
population romaine qui serait comme un vivant boulevard contre les invasions
gauloises. Mais elle enlevait aux grands des pâturages qu’ils regardaient
comme leur propriété ; ils la repoussèrent avec violence, et lorsque Flaminius
l’eut fait voter dans les comices par tribus, malgré l’opposition du sénat,
ils l’accusèrent d’avoir causé le soulèvement des Boïes. Ceux-ci, effrayés à
l’idée d’avoir les Romains pour voisins, s’unirent aux Insubres et appelèrent
de la Transalpine
une formidable armée de Gésates, guerriers appartenant à diverses tribus que
réunissait le goût des aventures. Jamais,
dit Polybe, plus braves soldats n’avaient passé
les Alpes. Heureusement les Cénomans et les Vénètes trahirent la
cause commune. Rome s’était de longue date aménagé des intelligences chez les
premiers ; les autres avaient été lie tout temps ennemis des Gaulois
cisalpins. Cette diversion fora les confédérés à laisser une partie de leurs
forces à la défense le leurs foyers ; le reste, 50.000 fantassins et 20.000
cavaliers ou soldats montés sur des chars de guerre, prit la route de Rome.
Les Cisalpins étaient commandés par l’Insubrien Britomar ; les Gésates, armés
d’un sabre sans pointe et à un seul tranchant, le gais,
suivaient les rois Concolitan et Anéroeste. Tous avaient juré, chefs et
soldats, de ne point détacher leurs baudriers qu’ils ne fussent montés au
Capitole.
L’effroi fut au comble dans la ville ; les livres
sibyllins consultés demandèrent le sacrifice d’un Gaulois et d’une Gauloise,
d’un Grec et d’une Grecque. On les enterra vivants au milieu du forum Boarium
et l’on crut avoir accompli l’oracle qui avait annoncé que les Gaulois et les
Grecs prendraient possession du sol romain. Mais, dans la croyance populaire,
ces malheureux pouvaient, après leur mort, devenir redoutables ; pour adoucir
leur colère, on institua un sacrifice qui se célébra chaque année sur la fosse gauloise. Le compte, ainsi réglé
avec les dieux et avec les victimes assassinées, Rome se mit en devoir de
faire tête au péril. Les vaines terreurs ne diminuaient pas en elle les
résolutions viriles ; elle se fiait aux dieux, mais surtout elle-même, et
c’est ce qui l’a faite si grande, malgré son esprit superstitieux. Le sénat
déclara qu’il y avait tumulte, et tout
homme en état de tenir une épée s’arma, même ceux des prêtres que la loi
dispensait du service ; 150.000 soldats furent échelonnés en avant de Rome ;
et l’on en tint en réserve 620.000, fournis par les alliés. Les Samnites avaient
promis 70.000 fantassins et 46.000 chevaux ; les Latins, 80.000 fantassins et
5.000 chevaux ; les Japyges et les Messapiens, 50.000 fantassins et 46.000
chevaux ; les Lucaniens, 30.000 fantassins et 3.000 chevaux ; la
confédération marse, 20.000 fantassins et 4.000 chevaux. Les Romains et les
Campaniens pouvaient à eux seuls donner 273.000 hommes. Ainsi l’Italie
entière se levait pour défendre Rome et repousser les barbares.
Deux routes conduisaient de la haute Italie dans la vallée
du Tibre ; pour les fermer, un des consuls : se posta à l’est de l’Apennin en
avant d’Ariminum ; un préteur s’établit à l’ouest, vers Fæsulæ, avec 54.000
Étrusques et Sabins, et l’autre armée consulaire fut rappelée en toute hâte
de la Sardaigne
avec ordre de débarquer à Pise et de garder, si elle arrivait à temps, les
passes de l’Apennin de Ligurie. Tant de précautions et de préparatifs
faillirent être inutiles. Les Gaulois, franchissant l’Apennin par où les
légions ne les attendaient pas, laissèrent derrière eux l’armée prétorienne
qui gardait le passage des montagnes du côté de l’Ombrie et arrivèrent à trois
journées de Rome. Le préteur les avait suivis ; ils se retournèrent contre
lui, lui tuèrent six mille hommes et cernèrent sur une colline les débris de
ses légions. Heureusement, dans la nuit, arriva le consul Æmilius, qui, à la
nouvelle de cette marche audacieuse, était accouru d’Ariminum. Les Gaulois,
embarrassés d’un immense butin et de nombreux captifs, voulurent mettre leur
gain en sûreté chez eux, sauf à revenir ensuite livrer bataille. Cette
résolution les perdit. Ils longeaient la côte, suivis par Æmilius, pour
gagner la Ligurie,
quand le consul Atilius, débarqué à Pise, vint donner avec ses légions, dans
leur avant-garde auprès du cap Telamone (près de l’embouchure de l’Ombrone). Les
Gaulois étaient pris entre trois armées ; ils mirent leurs chariots sur les
flancs pour se couvrir, leur butin et leurs captifs sur une colline au milieu
d’eux, et, tandis que les Gésates et les Insubres faisaient face, en arrière,
à Æmilius, les Boïes et les Taurisques résistaient de front au consul
Atilius. Ce fut un étrange spectacle.
D’innombrables trompettes et les cris de guerre des barbares remplissaient
l’air de bruits terribles que les collines répercutaient ; et l’on voyait ces
grands corps nus agiter violemment leurs armes. Mais, si les cris
effrayaient, les colliers et les bracelets d’or qui chargeaient leurs bras et
leur cou donnaient l’espérance d’un riche butin. Le consul Atilius
fut tué dans un combat de cavalerie qui précéda l’action générale. Celle-ci
fut engagée par les archers des légions qui firent pleuvoir sur la ligne
ennemie une grêle de traits dont pas un n’était perdu, car les Gésates qui,
par ostentation de courage et pour être plus libres de leurs mouvements,
avaient dépouillé leurs vêtements jusqu’à la ceinture, ne pouvaient s’en
garantir sous leur petit bouclier. Après les archers, l’infanterie, couverte
d’une bonne armure, arriva au pas course et attaqua, ave sa courte et forte
épée, bien affilée des deux côtés et à la pointe. Les Gaulois, dont le sabre
pliait à chaque coup, résistèrent quelque temps par leur masse et leur
indomptable courage qui eût mérité de meilleures armes. S’ils avaient eu celles des Romains, ils remportaient la
victoire. Et Polybe, en parlant ainsi, exprimait l’opinion du plus
vieil historien de Rome, Fabius Pictor, qui avait assisté à la bataille[18]. Quand la
cavalerie romaine, brisant la ligne des chars, vint les charger de flanc, une
effroyable confusion se mit dans l’armée barbare pressée de front, en queue
et sur le côté.
Quarante mille barbares restèrent sur le champ de
bataille, dix mille furent faits prisonniers. On prit un des brenns gaulois,
Concolitan ; un autre, Anéroeste, tua de sa main ceux de ses dévoués qui avaient
survécu au combat et se poignarda lui-même (225). On ne sait pas le sort de Britomar.
Les captifs tinrent leur serment : ils montèrent au Capitole couverts de
leurs baudriers, mais précédant le char triomphal d’Æmilius. A mi-chemin, ils
les déposèrent pour entrer au Tullianum,
d’où nul ne sortait vivant.
Rome avait eu peur. Le sénat, décidé à délivrer l’Italie
de pareilles craintes, renvoya l’année suivante les deux consuls dans la Cisalpine pour en
commencer la conquête. Les Gaulois au sud du Pô, affaiblis par le grand
désastre de Telamone, donnèrent des otages et remirent aux Romains trois de
leurs places fortes, parmi elles Modène (224). Mais ceux du Nord, les Insubres,
reçurent vigoureusement, les consuls, lorsque, l’année suivante, ceux-ci
risquèrent pour la première fois les enseignes romaines sur la rive gauche du
fleuve : les Romains furent heureux d’accepter un traité qui leur permit de
se retirer sans combat. Ils gagnèrent le pays des Cénomans, où quelques jours
de repos et d’abondance refirent leurs troupes ; oubliant alors le traité, ils
rentrèrent par le pied des Alpes sur le territoire insubrien. Cinquante mille
hommes marchèrent à leur rencontre pour venger cette perfidie. Ils avaient
tiré des temples leurs drapeaux sacrés, les Immobiles,
qui ne sortaient que dans les plus grands dangers. Un des consuls, Flaminius,
était cet ancien tribun odieux aux grands pour sa proposition du partage des
terres sénonaises. Le sénat, n’ayant pu empêcher son élection, fit parler les
dieux pour la casser ; les miracles se multiplièrent, et les augures
déclarèrent illégale la nomination de Flaminius et de son collègue Furius. Un
décret les rappela ; Flaminius le reçut au moment de livrer bataille et n’en
tint compte ; il ne pouvait échapper à une condamnation que par une victoire
; il en imposa à ses soldats la nécessité, en les postant en avant d’une
rivière profonde dont il fit rompre derrière eux les ponts. Les épées des barbares,
mal trempées et sans pointe, s’émoussaient et pliaient aisément. Après le
premier coup, il fallait que le soldat les appuyât contre terre et les
redressât avec le pied. Sur cette observation faite à la batalle du cap
Telamone, les tribuns distribuèrent aux hommes du premier rang les piques des
triaires, avec ordre de n’attaquer à l’épée que lorsqu’ils verraient que les
sabres des Gaulois se seraient faussés en frappant sur le fer des piques. Les
Insubres perdirent huit mille morts et dix mille prisonniers (223). Ils
demandèrent la paix, et, sur le refus du dénat, appelèrent en toute hâte des
régions transalpine trente mille Gésates commandés par le roi Virdumar, qui
vint fièrement assiéger, au sud du Pô, la forte place de Clastidium, devenue,
entre les mains de Rome, une des entraves de la Gaule Cisalpine.
Le consul romain Marcellus, celui qui gagna, quelques années plus tard,
contre Annibal, le surnom de l’Épée de Rome,
accourut pour la dégager. Comme il rangeait ses troupes en bataille, son
cheval, effrayé des cris confus des barbares, tourna bride tout à coup et
l’emporta malgré lui en arrière. Avec des soldats superstitieux comme
l’étaient les Romains, cet incident naturel pouvait être pris pour le présage
d’une défaite et l’amener. Marcellus, au contraire, en tira avantage. Il
feignit de vouloir accomplir un acte religieux, fit achever le cercle de son
cheval, et, revenu en face de l’ennemi, adora le soleil. Dès lors on pouvait;
combattre, il n’y avait eu qui une des cérémonies ordinaires de l’adoration
des dieux. Quand le roi des Gésates aperçut Marcellus, jugeant à l’éclat de
ses armes qu’il devait être le chef, il poussa son cheval hors des rangs, et
l’appela en combat singulier entre les deux armées.
Le consul venait au moment même de vouer à Jupiter
Férétien les plus belles armes qui seraient prises sur l’ennemi. A la vue de
ce Gaulois, dont l’armure resplendissait de l’éclat de l’or, de l’argent et
de la pourpre, Marcellus ne doute pas que ce ne soient là les dépouilles
promises, et que les dieux n’envoient le barbare à ses coups. Il pousse droit
à lui, au galop de son cheval, le frappe de sa pique en pleine poitrine avec
tant de force, que la cuirasse est percée et que Virdumar tombe. Marcellus
lui porte, avant qu’il se relève, un second coup, puis saute à terre, lui
arrache ses armes et, les élevant vers le ciel : Jupiter,
s’écrie-t-il, reçois les dépouilles que je
t’offre, et daigne nous accorder, dans le cours de cette guerre, une fortune
semblable. Les Romains, excités par l’exploit de leur chef, se jetèrent
impétueusement sur l’ennemi. Après une mêlée sanglante, les Gésates s’enfuirent.
Le désespoir gagna les Insubres. Ils se remirent à la discrétion du sénat,
qui leur fit payer une forte indemnité et confisqua une partie de leur
territoire pour y établir des colonies (222).
Tout ce que l’appareil des fêtes romaines avait de plus
magnifique fut déployé pour célébrer la victoire de Marcellus, le troisième
triomphateur opime ; les rues que devait traverser le cortége étaient
jonchées de fleurs, et l’encens fumait partout ; une troupe nombreuse de
musiciens ouvrait la marche ; puis venaient les bœufs du sacrifice, dont on
avait doré les cornes, et, après une longue file de chariots portant les
armes enlevées à l’ennemi, les captifs gaulois, dont la haute stature et la
figure martiale attiraient les regards. Un pantomime habillé en femme et une
troupe de satyres insultaient par des chants joyeux à leur douleur. Enfin
apparaissait, au milieu de la fumée des parfums, le triomphateur vêtu d’une
robe de pourpre brodée d’or, la. tète couronnée de lauriers et le visage
peint de vermillon comme les statues des dieux ; sur son épaule, il portait,
ajustés autour d’un tronc de chêne, le casque, la cuirasse et la tunique de
Virdumar. À la vue de ce glorieux trophée, la foule faisait retentir les airs
du cri de : Triomphe ! triomphe !
interrompu seulement par les hymnes guerriers des soldats[19].
Dès que le char triomphal
commença à tourner du Forum vers le Capitole, Marcellus fit un signe, et
l’élite des captifs gaulois fut conduite dans une prison, où des bourreaux
étaient apostés et des haches préparées ; puis le cortége, suivant la
coutume, alla attendre au Capitole, dans le temple de Jupiter, qu’un licteur
apportât la nouvelle que les barbares avaient vécu. Alors Marcellus entonna
l’hymne d’actions de grâces, et le sacrifice s’acheva. Avant de quitter le
Capitole, le triomphateur planta de ses mains son trophée dans l’enceinte du
temple, dont il avait fait creuser le pavé. Le reste du jour se passa en
réjouissances, en festins, et le lendemain peut-être quelque orateur du sénat
ou du peuple recommença les déclamations d’usage contre cette race gauloise
qu’il fallait exterminer, parce qu’elle égorgeait ses prisonniers et qu’elle
offrait à ses dieux le sang des hommes[20].
Marcellus avait promis, pour sa victoire, d’élever un
temple à l’Honneur et au Courage. Les pontifes se refusèrent à réunir les
deux divinités dans un même sanctuaire. Que la
foudre y tombe, disaient-ils, ou qu’il
s’y manifeste un prodige, et il sera difficile de faire les expiations,
parce qu’on ne saura à quel dieu offrir le sacrifice et que les rites
ne permettent pas d’immoler une même victime à deux divinités.
Marcellus dédia le temple de l’Honneur, et on en construisit un autre au
Courage dont son fils, dix-sept ans plus tard, fit la dédicace[21].
La défaite des Insubres avançait la conquête de la Cisalpine. Afin
d’y consolider sa puissance, le sénat envoya à Crémone et à Plaisance, en
218, deux colonies, chacune de six mille familles romaines : elles
devaient garder la ligne du Pô que défendaient déjà Tannetum, Clastidium et
Modène. La voie militaire commencée par le censeur Flaminius à travers
l’Apennin, depuis Rome jusqu’au milieu du pays sénon, fut continuée pour
relier ces postes avancés à la grande place d’Ariminum[22]. Ainsi la
domination romaine s’approchait des Alpes, ce
boulevard élevé, disait Cicéron, par
une main divine pour la défense de l’Italie, et la charrue allait
achever dans la Cisalpine
l’œuvre de l’épée, quand l’arrivée d’Annibal arrêta tout.
En 221, les Romains avaient encore occupé l’Istrie : là,
ils étaient maîtres d’une des portes de l’Italie et s’établissaient au nord
de la Macédoine,
qu’ils menaçaient déjà du côté de l’Illyrie.
Depuis la défaite de Pyrrhus, ils étaient en relations
amicales avec les rois d’Égypte. Ceux-ci se rapprochaient naturellement d’un
peuple qui pouvait être un jour l’adversaire redoutable des ennemis que les
Ptolémées avaient en Grèce. Après la première guerre Punique, Évergète
renouvela l’alliance que son père avait conclue avec Rome. Le sénat lui
offrit des troupes auxiliaires contre Antiochus de Syrie[23] : il les refusa,
mais resta fidèle à l’amitié des Romains.

II. — CARTHAGE : GUERRE DES
MERCENAIRES ; CONQUÊTE DE L’ESPAGNE.
Durant ces vingt-trois années si bien mises à profit par
Rome, Carthage aussi avait étendu son empire, mais après avoir passé par une
crise qui avait failli l’emporter et qui ébranla pour toujours sa
constitution.
truand Amilcar signa la paix avec Lutatius, il y avait en
Sicile vingt mille mercenaires que depuis longtemps on ne payait plus qu’avec
des paroles. La guerre finie, ils réclamèrent l’exécution de ces promesses et
leur solde. Le gouverneur de Lilybée, Gescon, les renvoya à Carthage, par
détachements, pour donner le temps au sénat de les satisfaire ou de les
disperser. Mais le trésor était vide ; on les laissa tous arriver, et
lorsqu’ils furent réunis, on leur peignit la détresse de la république, on
fit appel à leur désintéressement. Cependant l’or et l’argent brillaient
partout dans cette opulente métropole de l’Afrique ; les mercenaires
commencèrent à se parer de leurs mains. Le sénat craignit le pillage : il
commanda aux officiers de conduire l’armée à Sicca, en donnant à chaque
soldat une pièce d’or pour les besoins les plus pressants. Les Carthaginois
auraient pu garder comme otages leurs femmes et leurs enfants : ils les
renvoyèrent pour que ces étrangers ne fussent pas tentés de revenir les
chercher. Puis, fermant leurs portes, ils se crurent, derrière leurs hautes
murailles, à l’abri de toute colère.
Les mercenaires, dit Polybe dont nous abrégeons le récit,
étaient réunis à Sicca. Pour de pareilles troupes, l’oisiveté est mauvaise
conseillère : ils se mirent à compter, à exagérer ce qu’on leur devait, ce
qu’on leur avait promis aux heures de péril, et dans ces âmes avides
naissaient d’immenses désirs.
On leur envoya Hannon, qui, au lieu d’apporter de l’or,
demanda des sacrifices, en parlant humblement du dénuement de la république. Des
citoyens auraient pu entendre ce langage. Les mercenaires s’irritèrent, et
une sédition éclata ; les gens de chaque nation s’attroupèrent d’abord, puis
toutes les nations se mêlèrent. On ne se comprenait pas, mais on s’entendait
pour lancer mille imprécations. Hannon essaya de faire parler aux soldats par
leurs chefs : les chefs répétaient toute autre chose que ce qui leur était
dit, et la colère de cette foule croissait. Pourquoi
aussi, demandaient les mercenaires, leur
avait-on député, au lieu des généraux qui les avaient vus à l’œuvre et
savaient ce qui leur était dû, Hannon, qui ne les connaissait pas.
Ils lèvent leur camp, marchent sur Carthage, s’arrêtent à 120 stades de la
ville, au lieu appelé Tunis.
Carthage n’avait ni soldats pour repousser ces barbares ni
otages pour les arrêter. Elle essaya de les adoucir ; elle leur envoya des
vivres, dont ils fixèrent eux-mêmes le prix, et des députés qui leurs
promirent que tout ce qu’ils demanderaient serait accordé. Ces lâchetés
accrurent leur audace. Ils avaient tenu tête aux Romains en Sicile : qui
donc oserait les regarder en face ? A coup sûr, ce ne seraient pas ces Carthaginois....
Et tous les jours, ils inventaient de nouvelles demandes, réclamant, outre
leur solde, le prit de leurs chevaux tués, exigeant qu’on leur payât les vivres
qu’on leur devait au prix exorbitant où ils avaient été pendant la guerre.
Pour en finir, on leur envoya Gescon, un de leurs généraux de Sicile, qui
avait toujours pris leurs intérêts à cœur, et qui vint avec beaucoup d’or. Il
prend les chefs à part, puis réunit chaque nation séparément pour payer la
solde ! L’accommodement allait se faire ; mais il y avait dans l’armée un
certain Spendius, Campanien, autrefois esclave à Rome, qui craignit d’être
livré à son maître, et un Africain, Mathos, auteur principal de ces troubles
; l’un et l’autre s’attendaient, si l’accord avait lieu, à payer pour tous.
Mathos remontra aux Libyens que, les autres nations parties, Carthage ferait
retomber sur eux le poids de sa colère et les châtierait de manière à
épouvanter leurs compatriotes. Une grande agitation suivit ce discours, et,
comme Gescon remettait à un autre temps le payement des vivres et des
chevaux, les Libyens se réunirent tumultueusement. Ils ne voulurent entendre
que Spendius et Mathos ; si quelque autre orateur tentait de parler, il était
lapidé sur-le-champ. Un seul mot était compris de tous ces barbares : Frappe
! Dès que quelqu’un avait dit : Frappe ! tous frappaient, et si vite,
qu’il était impossible d’échapper. Beaucoup de soldats, même des chefs,
périrent ainsi : à la fin Spendius et Mathos furent élus généraux.
Gescon savait que, ces bêtes féroces une fois lâchées,
Carthage serait perdue. Au péril de sa vie, il resta au camp, tâchant de
ramener les chefs. liais un jour que les Africains, qui n’avaient pas reçu
leur solde, la réclamaient insolemment, il leur dit de s’adresser à Mathos.
Eux, à ces mots, se jettent sur l’argent, saisissent Gescon et ses
compagnons, et les chargera de chaînes.
Carthage était dans la terreur. Toute meurtrie de ses
défaites de Sicile, elle avait espéré, une fois la paix faite avec Rome, un
peu de repos et de sécurité, et voilà que la guerre recommençait plus
terrible : car il ne s’agissait plus de la Sicile, mais du salut
même et de l’existence de la patrie. Elle n’avait ni armée ni flotte : ses
greniers étaient vides, son trésor épuisé, ses alliés indifférents ou ennemis.
Sa domination sur les peuples d’Afrique avait été cruelle. Dans la dernière
guerre, elle avait exigé des habitants des campagnes la moitié de leurs
revenus et doublé l’impôt des villes : Leptis Parva lui devait un talent par
jour. Les plus pauvres n’avaient à espérer des gouverneurs carthaginois ni
grâce ni merci ; car, pour être populaire à Carthage, il fallait être impitoyable
envers les sujets, et tirer d’eux beaucoup d’argent.
Aussi, dès que Mathos eut appelé les villes d’Afrique à la
révolte, les femmes mêmes, qui avaient vu tant de fois traîner en prison
leurs maris et leurs proches pour le payement de l’impôt, jurèrent entre
elles de ne rien cacher de leurs effets ; elles donnèrent tout ce qu’elles
avaient de meubles et de parures, et l’argent abonda au camp des mercenaires.
Leurs troupes se grossirent de nombreux auxiliaires ; l’armée monta à soixante-dix
mille hommes, avec lesquels ils assiégèrent Utique et Hippone, les deux
seules villes qui n’eussent pas répondu à leur appel.
Les Carthaginois confièrent d’abord à Hannon la conduite
de la guerre ; mais deux fois il laissa échapper l’occasion de détruire
l’ennemi. On mit Amilcar à sa place ; avec dix mille hommes et
soixante-quinze éléphants, il sut faire lever aux mercenaires le siège
d’Utique, dégager les approches de Carthage et gagner une seconde bataille
contre Spendius. Alors les Numides passèrent à lui, il se trouva maître de la
campagne, et les vivres commencèrent à manquer aux mercenaires. En même temps
il montrait à l’égard de ses prisonniers beaucoup de douceur. Les chefs
redoutèrent des défections : pour les empêcher, ils assemblent l’armée,
font paraître un homme qu’ils prétendent arriver de Sardaigne avec une lettre
où leurs amis les invitaient à observer de près Gescon et les autres prisonniers,
à se défier des pratiques secrètes qu’on faisait dans le camp en faveur des
Carthaginois. Spendius, prenant alors la parole, fait remarquer la douceur
perfide d’Amilcar et le danger de renvoyer Gescon. Il parlait encore
lorsqu’un nouveau messager qui se dit arrivé de Tunis apporte une lettre dans
le sens de la première. Autarite, chef des Gaulois, déclare qu’il n’y a de
salut que dans une rupture sans retour avec les Carthaginois, que tous ceux
qui parlent autrement sont des traîtres, et que, pour s’interdire tout
accommodement, il faut tuer Gescon et les prisonniers.... Cet Autarite avait
l’avantage de parler phénicien et de se faire ainsi entendre du plus grand
nombre, car la longueur de la guerre faisait peu à peu du phénicien la langue
commune, et les soldats se saluaient ordinairement dans cette langue.
Après Autarite, parlèrent des hommes de chaque nation qui
avaient des obligations à Gescon et qui demandaient qu’on lui fit grâce au
moins des supplices. Comme ils parlaient tous ensemble et chacun dans sa
langue, on ne pouvait rien entendre. Mais dès qu’on entrevit ce qu’ils voulaient
dire et que quelqu’un eut crié : Tue ! tue ! ces malheureux intercesseurs
furent assommés à coups de pierres. On prit alors Gescon et les siens au
nombre de sept cents ; ou les mena hors du camp, on leur coupa les mains et
les oreilles, on leur cassa les jambes, et on les jeta encore vivants dans
une fosse. Quand Amilcar envoya demander au moins les cadavres, les barbares
déclarèrent que les députés seraient traités de même, et proclamèrent comme
loi que tout prisonnier carthaginois périrait dans les supplices, que tout allié
de Carthage serait renvoyé les mains coupées, et cette loi fut observée à la
rigueur. Amilcar en représailles fit jeter ses prisonniers aux bêtes.
Les affaires des Carthaginois prenaient une bonne tournure,
quand ces revers soudains se ramenèrent au premier état. La Sardaigne se révolta ;
une tempête submergea un grand convoi de vivres ; Hippone et Utique firent
défection en massacrant leur garnison, et Mathos songeait déjà à ramener ses
mercenaires au pied des murs de Carthage. Mais Hiéron, que la victoire
définitive de cette armée barbare eût effrayé, donna tous les secours que les
Carthaginois lui demandèrent ; Rome même se montra favorable. Le sénat leur
rendit ce qui lui restait de prisonniers laits en Sicile, permit aux
marchands italiens de leur porter des vivres, et refusa l’offre des habitants
d’Utique de se donner aux Romains. Amilcar chassa une seconde fois les
mercenaires des environs de Carthage et, avec sa cavalerie numide, les poussa
dans les montagnes, où il parvint à enfermer une de leurs deux années dans le
défilé de la Hache. Là,
ne pouvant ni fuir ni combattre, ils se trouvèrent réduits par la famine à se
manger les uns les autres. Les prisonniers et les esclaves y passèrent
d’abord ; quand cette ressource manqua, il fallut bien que Spendius, Autarite
et les autres chefs, menaces par la multitude, demandassent un sauf-conduit
pour aller trouver Amilcar. Il ne le refusa point, et convint avec eux que,
sauf dix hommes à son choix, il renverrait les autres, en leur laissant à chacun
un habit. Le traité fait, Amilcar dit aux envoyés : Vous êtes des dix, et il les retint. Les
mercenaires en apprenant l’arrestation de leurs chefs se crurent trahis et
coururent aux armes : ils étaient si bien enveloppés, que, de quarante mille,
il ne s’en sauva pas un. Cependant Mathos, assiégé dans Tunis, fit une
énergique résistance ; dans une sortie, il prit le collègue d’Amilcar,
Annibal, et l’attacha à la croix de Spendius ; trente des principaux
Carthaginois périrent dans d’atroces supplices ; mais, attiré en rase
campagne, il fut vaincu dans une grande bataille, amené dans Carthage et
livré pour jouet à la populace.
La guerre inexpiable,
comme on l’appela, avait duré trois ans et quatre mois. Je ne sache pas, dit Polybe, que dans aucune autre on ait porté si loin la barbarie et
l’impiété. L’homme y était tombé, ce qui lui arrive souvent,
au-dessous de la bête fauve, qui tue pour vivre, mais ne torture pas.
Dans une république commerçante qui se laisse entraîner à de
longues guerres, il se forme nécessairement un parti militaire dont
l’importance croit avec, les services, et qui finit par sacrifier à son chef
les libertés du pays. Ainsi périt la république hollandaise[24] : ainsi devait
finir Carthage. En outre, il faut qu’une constitution soit bien fortement
enracinée dans un pays pour n’être pas ébranlée par une guerre malheureuse.
L’oligarchie carthaginoise porta la peine des désastres de la première guerre
Punique, et la nécessité d’armer les citoyens pour résister aux mercenaires
l’avait encore affaiblie, et fortifiant l’élément populaire. Si l’histoire
intérieure de Carthage nous était mieux connue, nous y trouverions de
curieuses révélations sur là deux grands partis qui la divisaient et que les
historiens nous font à peine entrevoir. Peut-être Hannon et les siens, qu’on
nous représente comme vendus à Rome ou bassement jaloux d’Amilcar et de son
fils, apparaîtraient-ils comme des citoyens justement alarmés de la faveur
croissante, auprès de la populace et des soldats, d’une famille qui sembla investie,
par droit héréditaire, du commandement des armées et qui menaçait Carthage
d’une dictature militaire. Dans la première guerre Punique, Amilcar avait rendu
d’immenses services ; cependant ce fut Hannon qu’on nomma contre les
mercenaires. Quand son incapacité eut contraint le sénat de rendre Amilcar
aux vœux de l’armée, un autre Hannon lui fut donné pour collègue. Mais les
soldats le chassèrent[25], et Amilcar le
remplaça par un général du nom d’Annibal et probablement de sa faction.
Celui-ci mort, le sénat se hâta de renvoyer Hannon, avec trente sénateurs
pour réconcilier les deux chefs et surveiller Amilcar. Il fallut que le héros
partageât avec son rival la gloire de terminer cette guerre. Le sauveur de Carthage
méritait d’éclatantes récompenses, on l’humilia par de honteuses accusations[26]. L’armée et le
peuple étaient pour lui ; mais soit patriotisme, soit conscience de la force
que conservaient encore ces grands qui l’outrageaient, soit désir d’accroître
par de nouvelles victoires sa renommée et l’influence de son parti, il se
laissa exiler avec ses troupes victorieuses, et il partit pour soumettre à
Carthage les côtes de l’Afrique et l’Espagne. Cette conquête serait, pensait-on,
une compensation à la perte de la
Sicile et de la Sardaigne[27].
Amilcar y employa neuf années durant lesquelles, dit
Polybe, il soumit un grand nombre de peuples, par les armes ou par des
traités, jusqu’à ce qu’il périt dans une bataille contre les Lusitaniens, au
bord du Guadiana. Le butin conquis dans la riche Espagne avait servi à
acheter le peuple et une partie du sénat[28]. La faction barcine
grandissait, et comme son principal appui était dans le peuple, elle
favorisait les envahissements de l’assemblée populaire, qui devint peu à peu
prépondérante dans le gouvernement[29]. Aussi le gendre
d’Amilcar, le favori du peuple de Carthage, Asdrubal, hérita-t-il, malgré le
sénat[30], du commandement
de son beau-père. Il continua ses conquêtes avec une armée de cinquante-six
mille soldats et deux cents éléphants, poussa jusqu’à Èbre, où les Romains,
effrayés de ses progrès, l’arrêtèrent par un traité (227), et, pour consolider sa puissance,
il fonda Carthagène[31] dans la plus
heureuse position, au milieu de la côte d’Espagne, en face de l’Afrique,
devant un large port, auprès de mines qui lui livraient chaque jour 300 livres pesant
d’argent. D’immenses travaux en firent en quelques années une grande ville ;
c’était comme la capitale des futurs États de la maison barcine[32].
Cependant Asdrubal fut assassiné par un esclave gaulois
qui vengeait sur lui la mort de son maître tué en trahison. Les soldats
élurent, à sa place, le fils de leur ancien commandant, Annibal, qui depuis
trois ans combattait dans leurs rangs. Le peuple confirma[33], et le sénat
accepta le nouveau roi. L’Espagne et l’armée n’étaient plus en effet qu’un
héritage des Barcas[34].
Telle était en 219 la situation de Carthage. Tout
annonçait une prochaine transformation de cette vieille république. Mais
Annibal, comme César deux siècles plus tard, avait besoin de soldats et de
victoires pour rentrer en maître dans sa patrie. César conquit la dictature
dans les Gaules. Annibal la chercha dans cette seconde guerre Punique que son
père lui avait léguée.
|