|
I. — LES TRAITÉS ENTRE ROME ET
CARTHAGE (509-279).
Rome et Carthage se connaissaient depuis longtemps ; trois
fois elles avaient scellé leur alliance par des traités, car elles avaient
les mêmes ennemis : les pirates qui couraient la mer Tyrrhénienne et
pillaient les côtes du Latium ; plus tard les Grecs italiotes et Pyrrhus.
Nous avons encore ces monuments d’une bien vieille diplomatie
Polybe les a lus sur des tables de bronze conserves dans les archives des
édiles. Ils sont intéressants à double titre pour l’histoire des événements
politiques et pour celle du droit des gens. Le plus ancien, qui est à la fois
un traité d’alliance et un traité de commerce, fut négocié par Tarquin et
conclu par les premiers consuls de la république (509). Entre
les Romains et leurs alliés d’une part, les Carthaginois et leurs alliés de l’autre,
il y aura pais et amitié aux conditions suivantes : les Romains et leurs
alliés ne navigueront pas au delà du Beau Promontoire (cap Bon), à moins qu’ils n’y soient poussés par la tempête ou
chassés par leurs ennemis. Dans ce cas, il ne leur sera permis d’y acheter ou
d’y prendre que ce qui sera nécessaire pour le radoub des vaisseaux et les
sacrifices aux dieux, et ils devront en partir dans les cinq jours. Leurs
marchands pourront trafiquer à Carthage, mais aucun marché ne sera valable qu’autant
qu’il aura été fait par l’intermédiaire du crieur et du scribe publics. Pour
toute chose vendue en leur présence, la foi publique sera garante à l’égard
du vendeur. Il en sera de même en Afrique (sur le
territoire de Carthage), et Sardaigne et dans
la partie de la Sicile
soumise aux Carthaginois. Les Carthaginois ne feront aucun tort aux peuples
d’Ardée, d’Antium, de Laurentum, de Circei et de Terracine, ni à aucun autre
des Latins soumis à Rome. Ils s’abstiendront d’attaquer (dans cette
partie de l’Italie) les villes non sujettes
des Romains ; s’ils eu prenaient une, ils la remettraient aux Romains, sans
lui faire dommage. Ils ne bâtiront aucun fort dans le Latium, et s’ils
débarquaient en armes sur les terres des Latins, ils n’y passeraient pas la
nuit.
Ce traité montre à quel degré de puissance Rome était
arrivée sous ses rois, comme elle protégeait alors ses sujets et ses alliés
latins, et quels avantages elle assurait à leur commerce jusque sur les côtes
lointaines de la Libye,
sans toutefois obtenir de Carthage, pour leurs navires, la libre entrée de la
mer orientale.
Le second traité est postérieur de plus d’un siècle et demi
(348). Rome
avait employé ces cent soixante-deux années à recouvrer ce que l’établissement
de la république lai avait fait perdre. Carthage, au contraire, à l’abri des
révolutions sous son gouvernement aristocratique, avait grandi en force et en
richesse. Parmi ses alliés, elle nomme cette fois Utique et Tyr, parce qu’elle
représente maintenant toutes les ambitions de la race phénicienne, unie
contre ces Grecs qui font aux anciens maîtres de la Méditerranée une si
rude concurrence, qui pleur disputent la Sicile et menacent, en même temps que le
littoral romain du Latium, les comptoirs puniques de la mer Tyrrhénienne. Aussi
ses paroles sont plus fières et ses concessions moins favorables. Par le
premier traité, elle interdisait aux Romains de naviguer dans la Méditerranée
orientale ; elle maintient cette défense et en ajoute une autre, celle de ne
pas franchir les Colonnes d’Hercule. Elle leur retire le droit de trafiquer
en Sardaigne et en Afrique, et ne s’engage plus à ne pas molester les cités
latines qu’elle prendrait hors du territoire romain. Elle consent bien encore
à remettre la place à ses alliés, mais vide de l’or et des captifs, que cette
fois elle entend garder.
Le troisième traité est de l’année 279. Pyrrhus, alors en
Italie, inquiétant à la fois Carthage et Rome, ces deux villes renouvelèrent
leur vieux pacte d’amitié. Elles stipulèrent qu’une des deux nations n’accepterait
du roi des conditions contraires à l’alliance, et que si l’un des deux
peuples était attaqué par les Épirotes, l’autre aurait le droit de le
secourir[1]. Carthage fournira des vaisseaux de transport pour l’aller
et le retour, mais les auxiliaires seront payés par l’État qui les enverra.
Les Carthaginois porteront secours aux Romains sur mer, lorsque ceux-ci en
auront besoin ; toutefois les équipages des navires ne seront pas forcés de
descendre à terre, s’ils s’y refusent.
Ces traités furent confirmés par des serments. Les
Carthaginois jurèrent par les dieux de leurs pères ; les Romains, aux premiers
traités, par Jupiter Lapis, au dernier par Mars et par Enyalius[2]. Le serment par
Jupiter Lapis se faisait ainsi : Le fécial prend
une pierre en sa main et après avoir juré par la foi publique que les
conventions seront fidèlement observées, il ajoute : Si je dis vrai, qu’il m’arrive bonheur ; si je pense autrement
que je ne parle, que tous les autres gardent tranquillement, dans leur patrie
et sous leurs logis, leurs biens, leurs pénates et leurs tombeaux ; que moi
seul je sois rejeté comme je rejette cette pierre. Et en
prononçant ces derniers mots, il lançait la pierre au loin.
On a vu que les Carthaginois, exécutant une des clauses du
traité avant même d’en avoir été requis par Rome, envoyèrent à Ostie cent
vingt galères[3].
Le sénat n’accepta point ce secours ; sous ce refus se cache ou la confiance
qu’avaient les Romains de vaincre seuls, ou la défiance que leur inspiraient
des alliés si empressés. D’Ostie, l’amiral se rendit à Tarente et offrit sa
médiation à Pyrrhus[4]. Les Carthaginois
étaient évidemment fort désireux de rendre le roi aux douceurs de sa royauté
épirote. Lui, au contraire, ne rêvait que combats ; il passa en Sicile, y
guerroya trois ans et en quittant l’île s’écria : Quel
beau champ de bataille nous laissons aux Romains et aux Carthaginois ![5]

II. - OPÉRATIONS EN SICILE (264).
Ni Rome ni Carthage ne pouvaient abandonner à une
puissance rivale la grande île située au centre de la Méditerranée, qui
touche à l’Italie et d’où l’on aperçoit l’Afrique. Si Carthage en était maîtresse,
elle enfermait les Romains dans la péninsule, dont ses intrigues et son or
soulèveraient sans cesse les populations. Si Rome y dominait, le commerce de
Carthage était intercepté, et un bon vent, en moins d’une nuit, pouvait
amener les légions au pied de ses murs.
Trois puissances se partageaient file : Hiéron, tyran de
Syracuse depuis l’an 270, les Carthaginois et les Mamertins, ou fils de Mars.
Ceux-ci, anciens mercenaires d’Agathocle[6], s’étaient
emparés par trahison de Messine, et de ce poste ils infestaient file entière.
Diodore les montre pillant jusque sur la côte méridionale, où ils dévastèrent
Géla, qui relevait ses ruines. Hiéron voulut en débarrasser la Sicile ; il les battit,
les rejeta sur Messine, et allait recevoir leur soumission, quand le
gouverneur carthaginois de Lipari, Hannon, vint lui disputer cette conquête.
Les Mamertins se souvinrent alors qu’ils étaient Italiens, et préférant un
protecteur éloigné à des amis trop voisins, ils envoyèrent une ambassade à
Rome. Ces Mamertins étaient d’infâmes pillards. Ce que la garnison de Rhegium,
si sévèrement punie, venait de faire sur une des rives du détroit, les
Mamertins l’avaient fait, et bien pis encore, sur l’autre bord. Le sénat
hésitait à prendre leur défense. Les consuls, moins scrupuleux, portèrent l’affaire
devant le peuple. Ils rappelèrent la conduite équivoque des Carthaginois à Tarente
et montrèrent les établissements de ce peuple en Corse, en Sardaigne, aux îles
Lipari, en Sicile, comme une chaîne qui déjà fermait la mer Tyrrhénienne et
qu’il fallait briser. L’ambition des Romains était un mélange d’orgueil et d’avidité.
Ils voulaient commander, parce qu’ils se croyaient déjà le plus grand peuple
de la terre ; ils voulaient conquérir, pour satisfaire leur goût de rapine ;
et la Sicile,
Carthage, étaient une proie si riche ! Le peuple décida que des secours
seraient envoyés aux Mamertins ; le consul dépêcha en toute hâte le tribun
légionnaire C. Claudius à Messine.
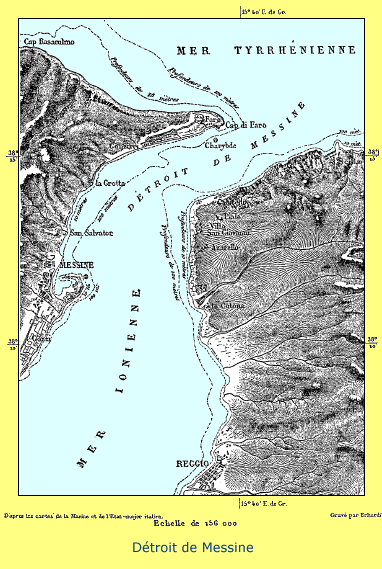
C’était, comme tous ceux de sa race, un homme énergique à
qui rien ne coûtait pour atteindre son but. II passa le détroit au risque d’être
enlevé par l’ennemi en arrivé à Messine, trouva Hannon établi dans la
citadelle, qu’un pari lui avait livrée. Claudius voulut appeler à lui
quelques troupes, mais les vaisseaux carthaginois fermaient le détroit. Pas une barque ne passera, dit Hannon, et pas un de vos soldats ne se lavera jamais les mains
dans les mers de Sicile. Cependant il consentit à une entrevue
avec le tribun ; au milieu ide la conférence, Claudius le fit saisir, et pour
obtenir sa liberté, Hannon rendit la citadelle. A son retour à Carthage, il
fut mis en croix, mais Rome ouvrait la période de ses grandes guerres par une
perfidie qui, avec bien d’autres, sera oubliée de ses orateurs, quand ils flétriront
dans le sénat et au Forum la foi punique.
Hiéron et les Carthaginois s’unirent pour assiéger
Messine. Par une horrible précaution, les Carthaginois massacrèrent leurs
mercenaires italiens ; mais le détroit n’a guère plus de 5 kilomètres dans sa
moindre largeur, les alliés ne surent pas empêcher le consul Appius Caudex[7] de profiter d’une
nuit obscure pour le passer avec vingt mille hommes sur des barques et des
esquifs empruntés à toutes les villes de la côte. Appius battit l’une après
l’autre ou intimida les deux armées assiégeantes, qui étaient peu nombreuses,
car Polybe ne dit pas que leur retraite ait été la suite d’une victoire des Romains.
Le consul poursuivit Hiéron jusqu’aux murs de Syracuse : la place était trop
forte pour être enlevée d’un coup de main et la mal’aria qui s’élevait des marais de l’Anapus le força de se
retirer (264).
Il revint à Messine où il laissa garnison. L’occupation de ce port naturel et
sûr, assez large pour contenir six cents galères des anciens, et assez
profond pour recevoir les plus grands navires des modernes, valait mieux pour
Rome qu’une victoire : là elle tenait la porte de l’île et elle prit ses
mesures pour la bien garder.
Ces heureux commencements engagèrent le sénat à pousser
vigoureusement la guerre. Deux consuls et trente-six mille légionnaires
passèrent l’année suivante en Sicile, où soixante-sept villes, et parmi elles
Catane, au pied de l’Etna, tombèrent en leur pouvoir. Ségeste, la plus
ancienne alliée de Carthage dans l’île, avait massacré sa garnison punique et
invoqué sa prétendue descendance troyenne pour obtenir des romains de favorables
conditions. Le sénat n’eut garde de repousser des gens qui trouvaient le
moyen de se faire très nobles en flattant la vanité romaine, et qui donnaient
de tels gages de leur consanguinité. Les Ségestains furent déclarés liberi et immunes.
Hiéron, effrayé et réfléchissant que Syracuse avait plus à perdre, pour son
commerce, avec Carthage qu’avec Rome, se hâta de traiter ; il rendit tous les
prisonniers, paya 100 talents[8] et resta
cinquante années le fidèle allié des Romains.
Jamais Syracuse ne fit plus heureuse. Théocrite y était
alors, maudissant la guerre et demandant aux dieux de rejeter dans la mer des
Sardes l’ennemi qui détruisait les cités siciliennes[9]. Uri voudrait
croire que ses idylles sont une peinture véritable, du bonheur de ce petit
coin de terre, tandis que le reste du monde était ébranlé par le choc des
deux grands peuples.
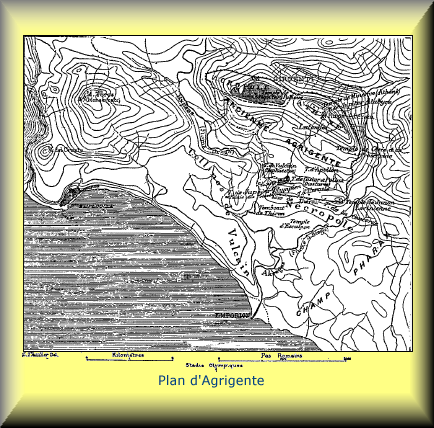
Le traité fait avec Hiéron assurait aux Romains l’alliance
du parti national en Sicile et les dispensait de faire venir du Latium des
vivres et des munitions que les flottes ennemies auraient pu intercepter. L’ambition
du sénat s’en accrut, et il résolut d’expulser les Carthaginois de l’île
entière, oit les excès de leurs bandes barbares avaient depuis deux siècles
rendu leur domination odieuse. Agrigente, fameuse entre toutes les villes
siciliennes par le nombre et les proportions colossales de ses monuments,
était très forte d’assiette, et les Carthaginois en avaient fait leur place d’arbres
dans l’île. Bâtie sur des rochers dont quelques-uns, ceux de la citadelle,
semblaient taillés à pic et entourée de deux cours d’eau qui se réunissaient
au-dessous d’elle pour tomber ensemble à la mer, fume
di Girgenti, elle eût été imprenable, si son éloignement du
rivage, 18 stades ou 3330
mètres, n’en avait rendu le ravitaillement impossible.
Les Romains l’assiégèrent. Ne sachant pas encore prendre une place à l’aide
de machines dont les Grecs avaient depuis longtemps l’usage, ils s’établirent
à l’est et à l’ouest de la ville, en deux camps qu’une double ligne de
défenses protégeait contre les sorties et contre les secours du dehors. Ils y
attendirent sept mois que la faim leur ouvrit les portes. Sans Hiéron,
eux-mêmes auraient plus d’une fois souffert de la disette. Annibal, fils de
Giscon, défendait la place avec une forte garnison ; les vivres n’en
diminuèrent que plus vite. Carthage envoya une armée de secours sous Hannon,
qui s’empara d’Héraclée et d’Herbessus, où les deux consuls avaient leurs
magasins ; les convois d’Hiéron maintinrent l’abondance dans le camp romain,
et Hannon fut réduit à risquer une bataille, qu’il perdit malgré ses éléphants.
Depuis Pyrrhus, les légionnaires ne craignaient plus ces lourdes machines de
guerre ; ils en tuèrent trente et en prirent onze vivants. Profitant de l’obscurité
d’une nuit d’hiver et de la négligence des sentinelles rendues trop confiantes
par la récente victoire. Annibal traversa les lignes romaines avec une partie
des siens. La malheureuse ville fut saccagée par les vainqueurs qui vendirent
comme esclaves vingt-cinq mille de ses habitants.
Ces trois campagnes et ce long siège avaient compromis
déjà les finances de Carthage, et elle fut un instant forcée d’arrêter la
page de ses mercenaires. Pour se débarrasser des trop vives réclamations de
quatre mille Gaulois qui menaçaient de passer à l’ennemi, un général
carthaginois leur promit le pillage d’Entella. Ils y coururent ; mais il
avait fait avertir secrètement le chef romain, et les Gaulois, tombés dans
une embuscade, périrent jusqu’aux derniers. Les légionnaires aussi étaient
sans solde ; mais on n’entendait pas une plainte clans cette armée de
citoyens. Un jour, devant Agrigente, nombre de soldats s’étaient fait tuer
aux portes du camp pour donner aux légions dispersées le temps de se rallier,
et si des querelles s’élevaient entre eux et leurs alliés, c’était pour avoir,
dans le combat, le poste le plus périlleux[10].
Dès la troisième année de la guerre, Carthage ne possédait
plus, en Sicile, que quelques places maritimes. Mais ses flottes ravageaient
les côtes d’Italie, fermaient le détroit et rendaient toute conquête précaire[11]. Le sénat
comprit qu’il fallait aller chercher l’ennemi sur son propre élément (261). Ainsi le but
grandissait en reculant sans cesse. Il ne s’était agi d’abord que d’empêcher
Messine de tomber au pouvoir des Carthaginois, puis de les chasser de l’île ;
maintenant le sénat voulait les chasser de la mer.

III. — OPÉRATIONS MARITIMES ;
DESCENTE DES ROMAINS EN AFRIQUE (260-255).
Les romains n’étaient pas aussi ignorants qu’on l’a
prétendu des choses maritimes. Ils connaissaient la construction et la manœuvre
des trirèmes ; on se rappelle que l’apparition d’une escadre romaine dans le
port de Tarente avait provoqué la guerre de Pyrrhus. Mais ils n’aimaient pas
la mer, ils se défiaient de l’élément perfide,
et comme leur vie militaire s’était passée sur terre, ils n’avaient point de
flotte permanente, quoiqu’ils nommassent des magistrats, duumviri navales, pour veiller à l’entretien d’uni
certain matériel naval. D’ailleurs, quand ils avaient besoin de vaisseaux,
ils en demandaient à leurs sujets étrusques et grecs. Mais, pour lutter conte
Carthage, il fallait une flotte de ligne, c’est-à-dire composée de vaisseaux
de haut bord, à cinq bancs de rameurs. Une quinquérème carthaginoise, échouée
sur les côtes d’Italie, servit de modèle. Telle était alors l’imperfection de
cet art, qui est devenu une science si difficile, que deux mois suffirent
pour abattre le bois, construire et lancer cent vingt navires, former et
exercer les équipages[12]. Tous ces hommes
n’étaient point des marins novices ; les alliés avaient fourni beaucoup de
matelots et de pilotes expérimentés. Il fallait néanmoins du courage pour
aller affronter avec une telle flotte la première puissance maritime du
monde. Le consul Cornelius Scipion fut pris, il est vrai, avec dix-sept
vaisseaux, dans une tentative mal conduite contre les îles Éoliennes (Lipari) ; mais son
collègue Duillius battit, près de Myles (Melazzo), la flotte carthaginoise (260).
Dans les batailles navales de l’antiquité, les vaisseaux,
armés d’un éperon à la proue, cherchaient à se percer vers la ligne de
flottaison ; la légèreté du bâtiment, la rapidité des manœuvres étaient alors
comme à présent, les premières conditions du succès, et la chiourme faisait
plus que les soldats embarqués à bord, habituellement en très petit nombre.
Athènes n’en mettait guère que dix sur ses trirèmes[13]. Dès la première
campagne, le génie militaire des Romains leur fit inventer une nouvelle
tactique. Leurs vaisseaux, grossièrement construits avec du bois vert,
étaient de pesantes machines qu’on pouvait cependant à force de rames
conduire droit à l’ennemi. A l’avant du navire Duillius fit placer un pont[14] qui, s’abattant
sur la galère ennemie, la saisissait avec des crampons de fer, la tenait
immobile et livrait passage aux soldats. La science des pilotes carthaginois
devenait inutile ; ce n’était plus qu’un combat de terre ferme où le
légionnaire retrouvait ses avantages, et Duillius en avait mis jusqu’à cent
vingt sur chaque navire[15]. Quand les
Carthaginois virent s’avancer la flotte romaine, ils coururent comme à une
victoire assurée. Trente vaisseaux, qui formaient l’avant-garde, l’atteignirent
les premiers ; saisis par les corbeaux, pas un n’échappa : la galère amirale,
à sept rangs de rames, fut prise elle-même, et Annibal, l’ancien défenseur d’Agrigente,
qui la montait, n’eut que le temps de se jeter dans une barque. Il lança
cependant ses autres galères sur les flancs et sur l’arrière des vaisseaux
romains. Mais, malgré la rapidité de leurs évolutions, toujours ils
rencontraient en face d’eux le redoutable corbeau. Vingt galères furent
encore prises ; déjà trois mille hommes étaient tués et six mille
prisonniers, le reste s’enfuit épouvanté. L’armée de terre leva en toute hâte
le siége de Ségeste, les troupes qui défendaient Macella laissèrent prendre
la place d’assaut, et le général carthaginois, retiré avec quelques troupes
en Sardaigne, y fut mis en croix par ses mercenaires mutinés.
Ces succès furent les résultats matériels de la victoire ;
mais elle en eut un plus grand. Le prestige de la supériorité maritime de
Carthage était dissipé, et, quelques désastres que l’avenir réserve aux
flottes romaines, le sénat ne renoncera point à la mer. Il sait maintenant
que Carthage peut être vaincue, et les derniers événements lui ont appris que
c’est sur mer qu’on fait la conquête des îles. Déjà il dirigeait une flotte
contre la Sardaigne,
et il méditait une descente en Afrique : des honneurs inusités récompensèrent
Duillius. Outre le triomphe, il eut une colonne au Forum et le droit de se
faire reconduire le soir chez lui à la lueur des flambeaux et au son des
flûtes. La simplicité de ce temps n’avait pas. su mieux faire pour honorer le
premier vainqueur de Carthage[16].
Après la victoire de Myles, les Romains avaient partagé
leurs forces tandis que l’armée de terre délivrait Ségeste, le consul Corn.
Scipion, avec une partie de la flotte, poursuivit jusqu’en Sardaigne les
vaisseaux échappés au premier désastre, les détruisit et commença la conquête
de cette île et de la Corse,
dont il fit la capitale, Aléria. Battue au retour, par une mer furieuse, il
dédia un sanctuaire à Tempestas, la Tempête, et voulut que
sur son tombeau on consacrât le double souvenir de sa conquête et de la
protection dont l’avait couvert cette singulière divinité
Hic
cepit Corsicam Aleriamque urbem
Dedit
Tempestatibus aidem merito.
Carthage envoya alors à Panorme un grand général, Amilcar.
Un jour, par d’habiles manœuvres, il enferma les légions dans un défilé, d’où
elles ne sortirent que grâce au dévouement de Calpurnius Flamma. C’était un
tribun légionnaire qui s’offrit à occuper, avec quatre cents hommes, une
colline d’où il pourrait couvrir la retraite et arrêter l’ennemi. Je donne ma vie à toi et à la république,
dit-il au consul. Tous moururent, excepté le tribun, qui fut retrouvé vivant
sous un monceau de cadavres. Il reçut une couronne de gazon. Alors, dit Pline, c’était
la plus noble récompense[17]. Caton le
compare à Léonidas et se plaint des caprices de la fortune qui a laissé son
nom dans l’obscurité. Il oubliait que c’est le but pair lequel on meurt qui
donne l’immortalité à la victime. Calpurnius, comme tant de soldats dans nos
annales, ne sauvait qu’une légion : Léonidas avait sauvé sa patrie, la Grèce entière et la
civilisation du monde (258).
Cependant la guerre languissait ; Hamilcar avait détruit
la ville d’Éryx, dont il ne laissa subsistera que le temple élevé, disait-on,
par Énée sa mère divine, la
Vénus Érycine, que les Phéniciens confondaient avec leur déesse
Astarté. Il en transporta la population à Drépane et concentra ses forces
dans cette ville et à Lilybée, deux places inexpugnables dont les approches
étaient couvertes par la mer et par plusieurs cités que les Carthaginois
occupaient encore sur les côtes et dans l’intérieur.
La fortune de Rome paraissant baisser, il se produisit de
dangereuses défections. Au centre de l’île, Enna, la ville sainte dont la
divinité poliade, Cérès, était honorée de la Sicile entière sur la
côte méridionale, la grande cité de Camarine, même Agrigente, revinrent aux
Carthaginois. Si les légions, au lieu de retourner à Rome à la fin de l’été,
suivant la coutume, n’avaient pas hiverné dans l’île, tout était compromis. Mais
les consuls de 258 reprirent les places perdues, égorgeant les principaux
citoyens et vendant le reste. C’était l’usage, et des deux côtés on le
pratiquait. Chez les anciens, quand la cité succombait, les particuliers
périssaient. Fortune détruite, famille perdue, plus de foyer domestique, plus
de dieux pénates ; hier dans les honneurs du patriciat, demain dans les
misères de l’esclavage, tel était le sort des vaincus, quand le jour de la
défaite ils n’étaient pas tombés sous l’épée du soldat ou sous la hache du licteur.
Par contre, le caractère atroce de la guerre donnait au patriotisme une
énergie que nous ne connaissons plus.
 Ces succès dans l’intérieur de l’île et une nouvelle
bataille navale que crut avoir gagnée prés de Lipari le consul Atilius
décidèrent le sénat à l’entreprise la plus hardie : trois cent trente
vaisseaux furent armés, cent mille matelots soldats, et les deux consuls, Manlius
Vulso et Atilius Regulus, les montèrent avec la résolution de passer au
travers de la flotte carthaginoise et de descendre en Afrique. Ces succès dans l’intérieur de l’île et une nouvelle
bataille navale que crut avoir gagnée prés de Lipari le consul Atilius
décidèrent le sénat à l’entreprise la plus hardie : trois cent trente
vaisseaux furent armés, cent mille matelots soldats, et les deux consuls, Manlius
Vulso et Atilius Regulus, les montèrent avec la résolution de passer au
travers de la flotte carthaginoise et de descendre en Afrique.
Les deux flottes se rencontrèrent à la hauteur d’Ecnome[18]. C’était le plus
grand spectacle qu’eût encore vu la Méditerranée ; trois cent mille hommes allaient
combattre sur ses flots. L’armée romaine, formée en triangle à double base qui
enveloppait les vaisseaux de transport, ne put être entamée, et les
Carthaginois, malgré une habile manœuvre pour attirer vers la haute mer la tête
de la flotte ennemie et la séparer de sa puissante arrière-garde, perdirent
quatre-vingt-quatorze navires sur trois cent cinquante ; vingt-quatre galères
romaines seulement avaient été coulées (256).
Les débris de l’armée vaincue se réfugièrent à Carthage.
On y arma en toute hâte des vaisseaux, on leva des troupes pour garder la
côte. Mais la plus grande confusion régnait encore dans la ville quand on y
apprit que les Romains, débarqués grès du promontoire de Mercure (cap Bon),
assiégeaient déjà Clypea. Regulus n’avait pris que le temps de radouber les
vaisseaux désemparés et de faire des vivres. Les troupes s’effrayaient d’une
guerre en Afrique, cette terre des monstres, d’où leur venaient de si
terribles récits, Africa portentosa[19] ; un tribun même
avait osé murmurer. Regulus l’avait menacé des haches, et l’armée, malgré ses
craintes superstitieuses, était partie. Clypea prise, et aucune place, aucune
armée ne couvrant le pays, les Romains se répandirent à travers ces riches campagnes,
qui, depuis Agathocle, n’avaient pas vu l’ennemi, et dont un habile système d’irrigations
favorisait la fécondité. En peu de jours, ils firent vingt mille prisonniers
et un immense butin.
Le sénat, trompé par ces premiers succès, rappela Manlius
et set légions : c’était une faute. Regulus, dit-on[20], avait demandé
lui-même à rentrer, parce que le fermier qu’il avait laissé pour cultiver un
champ de 7 arpents, son unique patrimoine, s’était enfui avec la charrue et
les bœufs. Le sénat lui répondit que tout serait racheté, son champ cultivé,
sa femme et ses enfants nourris aux dépens du trésor. Il resta en Afrique
avec quinze mille hommes et cinq cents chevaux : ces forces lui suffirent
pour battre partout l’ennemi, prendre trois cents villes et s’emparer de
Tunis, à 3 lieues de Carthage, après une victoire près d’Ades, qui coûta aux
Carthaginois dix-sept mille morts, cinq cents prisonniers et dix-huit
éléphants. La ville était aux abois. Par l’énormité du tribut imposé à Leptis
Parva, un talent par jour, on peut conjecturer combien le joug de Carthage
était lourd. Au bruit de ses défaites, les sujets s’étaient soulevés, et les
Numides pillaient ce qui avait échappé aux Romains : on se décida à traiter.
Regulus demanda l’abandon de la
Sicile et de la Sardaigne, un tribut annuel, la remise des
prisonniers romains, le rachat des captifs carthaginois, la destruction de
toute la flotte de guerre, la promesse de ne faire ni alliance ni guerre sans
le consentement du sénat, etc. Pour de telles conditions, il était toujours
temps de traiter ; la guerre continua. Le fanatisme du peuple fut excité par
des sacrifices humains et des vaisseaux chargés d’or allèrent en Grèce, en
Espagne, acheter des soldats. Parmi les mercenaires venus de Grèce, se trouva
le Lacédémonien Xanthippe. Carthage avait encore douze mille hommes d’infanterie,
quatre mille chevaux et cent éléphants. Le Lacédémonien se fit fort, avec
cette armée, de battre l’ennemi. Il ne s’agit,
disait-il, que de trouver un champ de bataille
qui nous convienne. Au lieu de camper sur les hauteurs où les
éléphants et la cavalerie étaient inutiles, il descendit en plaine ; et les
légionnaires, rompus par les éléphants, chargés par une cavalerie nombreuse,
tombèrent en foule ; deux mille seulement échappèrent en gagnant Clypea ;
Regulus et cinq cents des plus braves furent faits prisonniers ; le reste
avait péri. Xanthippe, richement récompensé, quitta la ville avant que la
reconnaissance eût fait place à l’envie[21].
Carthage était sauvée. Cependant l’armée victorieuse fut
repoussée au siège de Clypea, et une flotte carthaginoise, encore battue en
vue de cette place. Mais la destruction de toute une année, la captivité d’un
consul et. la difficulté de traverser sans cesse une mer orageuse pour
ravitailler les légions de Clypea décidèrent le sénat à renoncer à l’Afrique.
Au même moment, un affreux désastre leur en fermait la route : deux cent
soixante-dix galères furent brisées par une tempête le long des côtes de
Camarine ; c’était presque la flotte entière. Les Carthaginois se hâtèrent d’accabler
leurs sujets révoltés : les chefs furent mis en croix ; les villes donnèrent
1000 talents et vingt mille bœufs ; puis les préparatifs furent poussés avec
vigueur pour reporter la guerre en Sicile (255).

IV. — LA GUERRE EST REPORTÉE
EN SICILE (254-241).
Une nouvelle flotte, une nouvelle armée et cent quarante
éléphants partirent de Carthage. Agrigente fut reprise, De on coté, lionne,
en trois alois, construisit deux cent vingt galères, et les consuls, longeant
la côte septentrionale de la
Sicile, enlevèrent par trahison la forte place de Cephalœdium[22] et celle de
Panorme, qui leur donna un excellent port. Ceux des habitants de Panorme qui
ne purent payer une rançon de deux mines d’argent (200 drachmes ou prés de 200 fr.)
furent vendus comme esclaves : il y en eut treize mille.
L’année suivante, la flotte alla ravager les côtes
d’Afrique, mais une tempête détruisit encore au retour cent cinquante vaisseaux
près du cap Palinure, sur les côtes de Lucanie (253). Ces désastres répétés semblaient une
menace des dieux ; le sénat renonça à la mer comme il avait renoncé à l’Afrique.
Les deux adversaires, lassés par une lutte qui durait déjà
depuis douze années, se reposaient sur leurs armes ; les Carthaginois, dans
la forte position qu’ils occupaient à l’extrémité occidentale de la Sicile ; les légions, à
quelque distance en arrière, sur les hauteurs d’où elles observaient l’ennemi.
Cette inaction devint fâcheuse pour la discipline romaine. Il fallut une fois
dégrader quatre cents chevaliers qui avaient refusé d’obéir au consul ; une
autre fois, faire passer par les verges un tribun militaire de l’illustre
maison des Valerius[23]. Carthage, de
son côté, occupée sans doute à reconstituer en Afrique sa domination que l’invasion
romaine avait ébranlée, se bornait en Sicile à une prudente défensive. Elle
ne fit même aucun effort, en 252, pour empêcher le vaincu de la première action
navale, Scipion, de prendre sa revanche à Lipari même, en s’emparant de cette
île avec des vaisseaux que le fidèle Hiéron lui avait prêtés. Le coup était
sensible, car de Lipari partaient sans cesse des corsaires qui ravageaient
les côtes italiennes. Aussi, l’an d’après, Carthage fit un vigoureux effort.
Asdrubal, avec deux cents vaisseaux que montaient trente mille hommes et cent
quarante éléphants essaya de reprendre Panorme. Le proconsul Cœcilius
Metellus y tenait son armée enfermée ; mais, par ses troupes légères, il
provoqua l’ennemi, l’attira jusqu’au pied du mur ; et, tandis que les
éléphants, criblés de traits, se rejetaient furieux sur l’armée
carthaginoise, où ils mettaient le désordre, Metellus l’attaquait de flanc
avec toutes ses forces. Vingt mille Africains périrent ; cent quatre
éléphants furent pris ; on les conduisit à Rome, où ils suivirent le char du
vainqueur, et comme on trouva trop coûteux de les nourrir[24], ils furent
chassés dans le grand Cirque pour que le peuple s’habituât à ne plus les
redouter (251).
A son retour à Carthage, l’incapable Asdrubal frit mis en
croix ; à Rome, Metellus reçut de grands honneurs ; il fut deux fois consul,
dictateur, souverain pontife, et lorsque, dans un incendie du temple de Vesta,
il eut perdit les yeux en sauvant le Palladium, le peuple lui accorda le
droit que nul n’avait encore obtenu, de se rendre en char au sénat. Dans l’oraison
funèbre que le fils du vainqueur de Panorme prononça en l’honneur de son
père, on voit ce qu’un Romain de ce temps estimait le souverain bien : Il a eu, dit-il, et
en perfection, dix très grandes choses que les sages passent leur vie à
chercher. Il a voulu être le meilleur soldat, le premier des orateurs, le
plus habile des généraux, le plus éminent des sénateurs, et il a souhaité d’avoir
à gérer sous ses auspices les plus graves affaires, d’arriver aux plus hautes
magistratures, à la suprême sagesse politique et à une grande fortune acquise
par des voies honorables, enfin de laisser après lui beaucoup d’enfants et d’être
le plus considéré de ses concitoyens[25]. Voilà l’idéal
de la vertu romaine. Il n’est pas très élevé ; mais, s’il ne faisait pas des
sages, au sens vrai du mot, il faisait de grands citoyens.
Plusieurs nobles Carthaginois avaient été faits
prisonniers devant Panorme, d’autres l’étaient depuis longtemps. Les
Carthaginois proposèrent un échange, et, pour en appuyer la demande,
envoyèrent à Rome Regulus. Ce général avait noblement soutenu sa captivité.
Il ne voulut pas entrer dans la ville : Je ne
suis plus citoyen, disait-il, comme Postumius après les Fourches
Caudines ; et, quand il parla sur le cartel, il dissuada les sénateurs de l’accepter.
On voulut l’apitoyer sur lui-même : Mes
jours sont comptés, dit-il, ils m’ont
donné un poison lent et il partit en repoussant les embrassements
de sa femme Marcia et de ses enfants.
Horace a célébré cette légende chère à l’orgueil romain : On dît qu’il tint penché vers la terre son mâle visage
jusqu’au moment où son héroïque conseil eût fixé les hésitations du sénat. Alors,
noble exilé ! il quitta sa famille en larmes, bien qu’il sût quelles tortures
lui préparaient les bourreaux africains. Il écarta les amis qui voulaient le
retenir, le peuple qui s’opposait à son départ, du même air que si, après
avoir terminé les longues affaires de ses clients, il allait se délasser dans
les champs de Vénafre ou de Tarente[26]. De retour à
Carthage, il périt, assure-t-on, d’une mort cruelle[27]. Si cette
tradition est vraie, malgré le silence de Polybe., il ne faut oublier ni les
traitements infligés par les Romains eux-mêmes aux chefs ennemis tombés en
leur pouvoir, ni cette autre tradition suivant laquelle deux généraux
carthaginois, livrés à Marcia, auraient été par elle cruellement torturés[28].
Polybe reproche à Regulus de n’avoir pas su se mettre en
garde contre l’inconstance de la fortune, d’avoir imposé des conditions trop
sévères, etc. Sans doute il eût été plus sage de savoir se borner, mais quel
général eût agi autrement ? C’est en visant à un but placé très haut, souvent
au-dessus de leurs forces, que les grandes choses. On ne devient pas un grand
d’être toujours un peuple de sages.
La victoire de Panorme mit fin aux grands chocs d’armées.
Les Carthaginois se replièrent encore une fois à l’extrémité occidentale de l’île,
dans Drépane et Lilybée, où ils transportèrent tous les Sélinontins après
avoir détruit leur ville. Lilybée, entourée des deux côtés par une mer que
des bancs de sable, des écueils à fleur d’eau et de rapides courants
rendaient dangereuse, même pour les plus habiles pilotes, était fermée du
côté de la terre par une haute muraille et couverte par un fossé à la fois très
large et très profond. Dans l’automne de l’année 250, deux consuls, quatre
légions et deux cents vaisseaux de guerre bloquèrent la place, et un nouveau siège
troyen commença. Les Romains cherchèrent d’abord à fermer l’entrée du port,
en y coulant quinze vaisseaux chargés de pierres, mais le courant rejetait
tout. La passe resta libre, et cinquante navires portant à Lilybée des
provisions avec dix mille soldats purent la franchir sous les yeux de la
flotte romaine impuissante. Du côté de la terre, les Romains comblèrent en
plusieurs endroits le fossé et minèrent la muraille ; niais quand leurs
béliers eurent fait brèche, ils se trouvèrent en face d’un autre mur que
Imilcon avait élevé. Quelques mercenaires tramèrent de livrer la ville ;
Imilcon éventa le complot, et dans une sortie brûla les machines des Romains,
qui furent réduits à changer le siège en blocus. Quand le nouveau consul P.
Claudius, fils du censeur Appius, vint en Prendre le commandement, les maladies
avaient enlevé déjà beaucoup de soldats. La flotte carthaginoise stationnait
dans le port voisin de Drépane. Claudius voulut la surprendre. Les présages
étaient sinistres ; les poulets sacrés refusaient de manger : Eh bien, qu’ils boivent, dit le consul ; et il
les fit jeter à la mer. L’armée était vaincue d’avance par cette impiété que
Claudius ne sut pas réparer par d’habiles manœuvres[29] :
quatre-vingt-treize vaisseaux pris ou coulés, huit mille morts et vingt mille
prisonniers, tels furent les résultats de la bataille de Drépane (249). Le collègue
de Claudius, Junius Pullus, ne fut pas plus heureux. Il était à Syracuse avec
huit cents vaisseaux de charge destinés au ravitaillement du camp de Lilybée
; Carthalon, qui en épiait le départ sur la côte d’Agrigente, intercepta d’abord
plusieurs convois, puis, par une manœuvre habile, rejeta toute la flotte de
Junius au milieu des écueils de Camarine, où des vents furieux la brisèrent,
tandis que lui-même, fuyant devant la tempête, allait abriter ses vaisseaux
derrière le cap Pachynum. Tous les navires de transport et cent cinq galères
avaient été détruits. L’occupation, près de Drépane, de la haute colline qui
portait le temple fortifié de la
Vénus Érycine, ne fut point une compensation pour tant de
pertes douloureuses.
Les désastres de l’année 249, la plus triste pour Rome de
toute la guerre, obligèrent le sénat à renoncer encore une fois aux flottes.
Claudius, rappelé, fut obligé de nommer un dictateur ; il choisit le
fils d’un affranchi, Claudius Glicia, son client et son greffier. Le sénat annula
ce choix dérisoire, et une sentence du peuple punit sévèrement ce hardi
contempteur des choses divines et humaines. Junius, accusé comme son
collègue, d’avoir méprisé les auspices, se tua avant sa condamnation ;
Claudius lui avait peut-être donné l’exemple d’une mort volontaire. Trois ans
plus tard, une autre sentence frappa cette race orgueilleuse. La sœur de
Claudius, se trouvant un jour pressée par la foule, s’écria : Plût aux dieux que mon frère commandait encore les armées
de la république ! Les édiles punirent d’une amende ce vœu
homicide.
Par une singulière fatalité, au moment où Rome ne trouvait
plus que des chefs incapables, Cartilage mettait à la tête de ses forces d’habiles
généraux : Imilcon, le défenseur de Lilybée ; Annibal, qui avait si
heureusement ravitaillé cette place ; Adherbal, le vainqueur de Drépane ;
Carthalon, qui, avant de détruire la flotte de Junius, avait incendié une
partie de celle de Lilybée et ravagé les côtes de l’Italie ; enfin, le plus
grand de tous, le père d’Annibal, Amilcar qu’on surnommait l’Éclair, Barca. Malheureusement l’indiscipline était
souvent dans ces armées de Carthage, et une sédition violente de mercenaires
venait de la jeter dans le plus sérieux péril. Amilcar sut trouver le moyen
de satisfaire à leurs exigences ; il les conduisit au pillage de l’Italie.
Quand le butin fait dans le Bruttium lui eut gagné leur confiance, il vint
audacieusement s’emparer du mont Erctè (monte Pellegrino), prés de Panorme (247)[30]. Pendant six
années, toutes les forces des deux républiques furent concentrées dans ce
coin de la Sicile
; les Romains étaient à Panorme, sur le sommet du mont Éryx[31], dans l’ancienne
ville de ce nom, et devant Lilybée et Drépane. Les Carthaginois occupaient
ces deux places et le mont Erctè. Du haut de cette montagne presque
inaccessible, Amilcar épiait tous les mouvements de l’ennemi, et en
descendait rapidement pour arrêter ses convois, couper ses détachements et
porter le ravage jusqu’au cœur de l’île ; ou bien, du port placé au pied
de sa montagne, il partait sur une flotte de légers navires et ravageait le
littoral italien jusqu’au milieu de la Campanie[32]. Ce furent,
durant six années, de continuels et !sanglants combats ; on eût dit deux
athlètes de force égale, luttant sur un rocher, au-dessus des flots[33].
Les armées n’étaient éloignées que de quelques stades ;
elles se rapprochèrent encore. Amilcar surprit la ville d’Éryx et se plaça
entre les deux camps romains établis au pied et au sommet de cette montagne.
La guerre n’en alla pas plus vite : une égale ténacité paralysait tous les
efforts. À la fin, les soldats fatigués de luttes inutiles, et pris des deux
côtés d’une même estime pour leur valeur, tressèrent,
dit Polybe (I, 58), la couronne sacrée qu’on offrait aux dieux
quand la victoire demeurait indécise et, d’un commun accord, s’abstinrent de
combattre.
Depuis le commencement des hostilités, les Romains avaient
perdu bien plus de galères que les Carthaginois ; mais, pour Rome, puissance
continentale, les vaisseaux n’étaient que du bois et du fer qui se
remplaçaient aisément ; pour Carthage, puissance maritime et marchande, c’était
sa force et sa richesse. L’une était donc comme un navire atteint dans les œuvres
vives, l’autre comme une forteresse dont quelques créneaux seulement étaient
tombés. On le vit, bien lorsque, en 241, le sénat se décida à un nouvel effort.
Pour éviter des dépenses qui ne paraissaient plus nécessaires et les reporter
sur leurs flottes marchandes, les négociants de Carthage avaient désarmé ce
qui leur restait de vaisseaux de guerre, et laissant Amilcar tenir seul en
échec, du haut de sa montagne, toutes les forces de Rome, ils avaient repris
leurs longues navigations, leurs affaires avec le monde entier. Ils
oubliaient volontiers cette île dévastée, sans industrie ni commerce, d’où ne
leur venaient que d’importuns bruits de guerre et d’incessantes demandes
d’argent. La mer restait donc libre, une flotte romaine y reparut. Pour la
construire, il avait fallu faire appel au dévouement des citoyens. Le trésor
était vide ; le patriotisme, cette richesse qui vaut mieux que toute autre,
le remplit. Les riches prêtèrent à l’État ou construisirent à leurs frais des
navires ; plusieurs armèrent des corsaires[34] ; deux cents
vaisseaux fuient encore une fois lancés. Lutatius en, prit le commandement et
les conduisit à Drépane. On était à la fin de l’hiver ; la flotte que, par
économie, les Carthaginois rappelaient dans cette saison n’était pas encore de
retour, de sorte que Lutatius n’eut point de peine à s’empare du port et à
serrer étroitement la place. Carthage envoya en toute hâte des navires
chargés de provisions, mais vides de soldats, l’amiral devant embarquer à son
bord les vétérans d’Amilcar. Pour gagner Erctè, il lui fallait passer devant
Drépane ; Lutatius lui barra la route en se plaçant près des îles Ægates. Jamais, dit Florus, il
ne se livra bataille navale plus furieuse. Les vaisseaux carthaginois étaient
surchargés de munitions de bouche, d’armes et d’engins de toutes sortes. La
flotte romaine, au contraire, leste, agile et légère, ressemblait à une armée
de terre. Ce fut comme un combat de cavalerie. Nos navires obéissaient à la
rame ainsi qu’un cheval au frein et, avec leurs éperons mobiles, se lançaient
si adroitement, tantôt contre un vaisseau, tantôt contre un autre, qu’on eût
dit des êtres vivants. Lutatius coulai cinquante de ces navires
sans défense et en prit soixante-dix (10 mars 241). Les Romains redevenaient maîtres incontestés de
la mer, et Drépane, Lilybée, Amilcar, pouvaient être animés. D’ailleurs,
vingt-quatre années de guerres, de dépenses et d’angoisses, c’était assez, c’était
trop, pour ces marchands : une troisième fois, ils demandèrent à traiter.
Lutatius voulait qu’Amilcar livrât ses armes. Jamais,
répondit le héros indigné, je ne vous rendrai ces
armes qu’on m’a données pour vous combattre. Le consul consentit à
ce que l’armée carthaginoise évacuât librement la Sicile[35]. La paix fut
signée aux conditions suivantes : Carthage n’attaquera ni Hiéron ni ses
alliés ; elle abandonnera la
Sicile et les îles Éoliennes[36], rendra sans
rançon tous les prisonniers et payera en dix ans 5200 talents euboïques (près de 19 millions de
francs).
Ainsi finit la guerre des
Romains contre les Carthaginois, au sujet de la Sicile, après avoir duré
vingt-quatre ans, sans interruption : guerre la plus longue et la plus
importante dont nous ayons jamais entendu parler... Quelques Grecs assurent
que les Romains ne doivent leurs succès qu’if la fortune. Mais, après s’être
formés aux grandes entreprises par des expéditions de cette importance, ils n’avaient
rien de mieux à faire que de se proposer la conquête de l’univers, et ce
projet devait leur réussir[37]. Polybe a raison
; et si l’on avait pu lui montrer d’avance ce qu’il a fallu de sang, de
fileurs et de ruines pour bâtir cet édifice de la grandeur romaine, il aurait
sans doute répondu : Avant Rome, autant de sang
avait coulé ; sans elle, il en aurait coulé davantage. Du moins,
après sa victoire définitive, elle ne permit plus, durant des siècles, qu’on
en répandit.
|
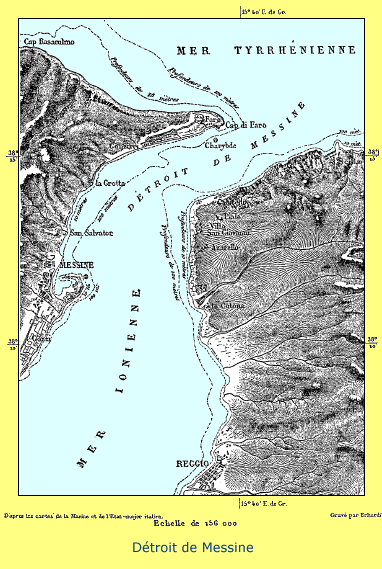
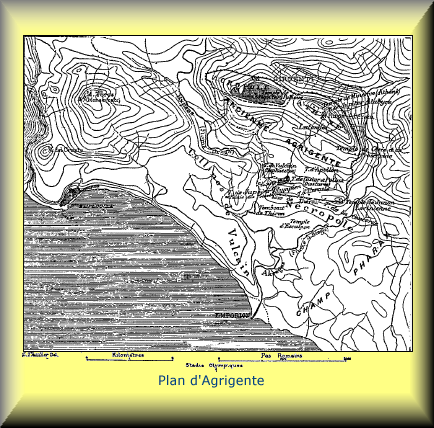
 Ces succès dans l’intérieur de l’île et une nouvelle
bataille navale que crut avoir gagnée prés de Lipari le consul Atilius
décidèrent le sénat à l’entreprise la plus hardie : trois cent trente
vaisseaux furent armés, cent mille matelots soldats, et les deux consuls, Manlius
Vulso et Atilius Regulus, les montèrent avec la résolution de passer au
travers de la flotte carthaginoise et de descendre en Afrique.
Ces succès dans l’intérieur de l’île et une nouvelle
bataille navale que crut avoir gagnée prés de Lipari le consul Atilius
décidèrent le sénat à l’entreprise la plus hardie : trois cent trente
vaisseaux furent armés, cent mille matelots soldats, et les deux consuls, Manlius
Vulso et Atilius Regulus, les montèrent avec la résolution de passer au
travers de la flotte carthaginoise et de descendre en Afrique.