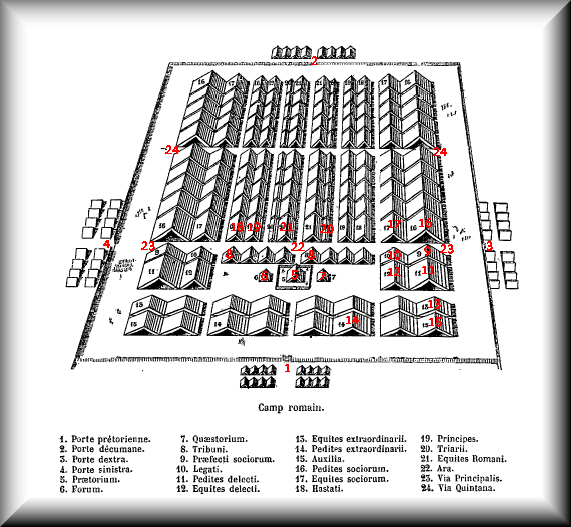|
I. — LES MŒURS.
On a fait de cette époque l’âge d’or de la république.
Suivant la vieille et honorable coutume de louer le temps passé, on a donné
aux Romains de cette époque toutes les vertus. Ils et avaient, surtout de
celles qui font les bons citoyens. Les vainqueurs des Étrusques et de Tarente
ne méprisaient pas la pauvreté ; ces plébéiens qui s’étaient fait reconnaître
tant de droits acceptaient tous les devoirs, et leur patriotisme avait la
force d’un sentiment religieux. Deux Decius ont donné leur vie pour l’armée
romaine, et Postumius, Manlius, ont immolé chacun un fils à la discipline. Le
censeur Rutilius, réélu au sortir de charge (266), convoque le peuple et le censure
tout entier pour avoir conféré deux fois de suite au même citoyen ces
importantes fonctions. Si Corn. Rufinus, malgré deux consulats, une dictature
et un triomphe, s’est fait chasser du sénat pour ses 10 livres de vaisselle
d’argent, quand la loi n’en permettait que 8 onces[1] ; si le consul
Postumius a forcé deux mille légionnaires à couper ses blés ou à défricher
ses bois, Atilius Serranus recevait, à la charrue, la pourpre consulaire,
comme autrefois Cincinnatus la dictature ; Regulus, après deux consulats, ne
possédait qu’un petit champ avec un seul esclave dans le territoire stérile
de Pupinies, et Curius, de ses mains triomphales, comme Fabricius, comme Æmilius
Papus, préparait dans des vases de bois ses grossiers aliments. Le même
Curius, qui déclarait dangereux un citoyen à qui 7 arpents ne suffisaient pas[2], a refusé l’or
des Samnites, Fabricius celui de Pyrrhus ; et Cinéas, introduit dans le
sénat, a cru y voir une assemblée de rois.
En ce temps-là, dit
Valère Maxime, peu ou presque point d’argent :
quelques esclaves, 7 jugères de terres médiocres, l’indigence dans les
familles, les obsèques payées par l’État, et les filles sans dot ; mais
d’illustres consulats, de merveilleuses dictatures, d’innombrables triomphes,
tel est le tableau de ces vieux âges[3]. Disons plus
simplement que, grâce à la loi Licinienne sur la limitation des propriétés[4], Rome n’avait ni
l’extrême richesse qui donne parfois titi insolent orgueil, ni l’extrême
pauvreté qui fait naître l’envie et l’esprit de révolte. Le plus grand nombre
était dans cette heureuse médiocrité qui excite au travail, l’ait sentir le
prix du peu que l’on possède et met au cœur la volonté de le défendre énergiquement.
Ce peuple avait ses défauts ; il aimait le travail, mais
aussi le butin, l’usure, les procès, et il avait dans le sang du lait de la
louve. Le créancier était dur pour son débiteur, le père pour son fils, le
maître pour ses esclaves, le vainqueur pour le vaincu. Ils avaient l’esprit
court du paysan qui vit la tête courbée sur le sillon, avec les passions
brutales des natures pesantes et l’orgueil grossier de la force physique.
!tien de généreux, rien d’élevé ; ni art, ni philosophie, ni religion véritable
; pour idéal, le gain et la domination, qui est la forme publique de l’esprit
de lucre. Leur vie domestique était-elle plus édifiante qu’elle ne le sera
dans la suite ? Le mal se voit mieux dans les sociétés qui sont en pleine
lumière que dans celles dont l’histoire pénètre difficilement les ténèbres.
Mais il est des vices que développent l’excès de richesse, les loisirs d’une
existence trop facile, et des tentations plus nombreuses : toutes choses que
les Romains du quatrième siècle ne connaissaient certainement pas.
Ils étaient probes et observaient la parole donnée. Confiez, disait-on plus tard, un trésor à un Grec, prenez dix cautions, dix signatures
et vingt témoins : il vous volera. À Rome, un magistrat a dans les
mains toutes les richesses publiques, et, pour qu’il n’en détournât rien, il
suffisait de son serment. Cette bonne foi du particulier, cette probité du
magistrat, étaient un reflet d’une vertu plus générale qui existait dans tout
le corps des citoyens : le respect absolu de la loi, I’obéissance préalable à
l’autorité établie, sauf à faire appel d’un ordre arbitraire. Le peuple le plus jaloux de sa liberté que l’univers ait
jamais vu se trouva en même temps le plus soumis à ses magistrats et à la
puissance légitime ![5] Bossuet a raison
d’admirer ces deux idées qui pour tant d’hommes sont contradictoires ; c’est
leur union qui fait les citoyens vraiment libres et les États vraiment forts.
On n’aime pas le Romain, mais on est contraint de
l’admirer, parce que, dans cette société, si l’homme est petit, le citoyen
est grand. Il l’est par des vertus civiques qui lui méritaient l’empire, par
le courage indomptable qui le lui donna, par la discipline, dans le sens le
plus élevé du mot, et par la sagesse politique qui le lui conservèrent. Aussi
son histoire où le poète et l’artiste oint si peu à prendre sera-t-elle
toujours l’école des hommes publics.

II. — LA CONSTITUTION ;
ÉQUILIBRE DES POUVOIRS.
Les dangers de la guerre du Samnium avaient ramené la paix
entre les deux ordres. Les petites rivalités ayant cessé devant le grand
intérêt du salut public, l’émancipation politique des plébéiens s’était
pleinement accomplie, et la nouvelle génération patricienne, élevée dans les
camps, avait perdu le souvenir amer des victoires populaires. Les hommes
nouveaux étaient maintenant aussi nombreux dans le sénat que les descendants
des vieilles familles curiales ; et les services comme la gloire de Papirius
Cursor, de Fabius Maximus, d’Appius Cæcus et de Valerius Corvus, n’effaçaient
ni les services ni Ila gloire des deux Decius, de P. Philo, quatre fois
consul, de C. Mænius, deux fois dictateur, de Cæcilius Metellus, qui
commençait l’illustration de cette famille, dont Nævius devait dire : Les Metellus naissent consuls à Rome, de Curius
Dentatus enfin et de Fabricius, plébéiens qui n’étaient pas même d’origine
romaine.
Il y avait union parce qu’il y avait égalité, parce que
l’on ne connaissait plus l’aristocratie du sang, et qu’on n’honorait pas
encore celle de la fortune. A cette époque la constitution romaine présentait
cette sage combinaison de royauté, d’aristocratie et de démocratie qu’ont
admirée Polybe, Machiavel et Montesquieu. Par le consulat il y avait unité
dans le commandement ; par le sénat, expérience dans le conseil ; par le
peuple, force dans l’action. Ces trois pouvoirs se contenant mutuellement
dans de justes limites, toutes les forces de l’État, autrefois tournées les
unes contre les autres, avaient enfin trouvé, après une lutte de plus de deux
siècles, cet heureux équilibre qui les faisait concourir, avec une
irrésistible puissance, vers un but commun, la grandeur de la république.
Dans la ville, les consuls[6] sont les chefs du
gouvernement ; mais ils sont iceux, d’ordre différent, et leur inévitable
rivalité assure la prépondérance du sénat auquel ils sont contraints par
leurs plus chers intérêts de montrer une prudente déférence. Ils reçoivent
les ambassadeurs des nations étrangères, ils convoquent le sénat et le
peuple, proposent des lois, rédigent les sénatus-consultes et commandent aux
autres magistrats ; mais toute cette puissance, plus honorifique que réelle,
vient se briser contre l’opposition d’un collègue ou l’autorité inviolable du
tribunat, contre la souveraineté du peuple qui fait les lois, contre un
décret du sénat, qui peut annuler les pouvoirs d’un consul en faisant nommer
un dictateur. A l’armée, le consul parait un chef absolu ; il choisit une
partie des tribuns légionnaires, fixe les contingents des alliés et exerce
sur tous le droit de vie et de mort ; mais, sans le sénat, il n’a ni vivres,
ni vêtements, ni solde ; et un sénatus-consulte peut arrêter subitement ses
entreprises, lui donner un successeur ou le proroger dans son commandement,
lui accorder ou lui refuser le triomphe[7]. Il fait des
traités, mais le peuple les ratifie ou les casse. Il agit, il décrète, mais
les tribuns le surveillent et, par leur veto, l’arrêtent, par leur droit
d’accusation le tiennent en de continuelles alarmes. Enfin, sa magistrature
expirée, il doit rendre compte au peuple pour en recevoir des applaudissements
qui lui promettent de nouvelles charges, ou des reproches et des murmures qui
lui ferment à jamais l’accès des grandes fonctions, quelquefois une amende
qui le ruine et le déshonore[8].
Les sujets, les alliés et les rois étrangers, qui ne
traitent jamais qu’avec le sénat réuni dans le temple de Bellone pour leur
rappeler que Rome était toujours prête à la guerre[9], qui le voient
juger leurs différends, répondre à leurs députés, envoyer au milieu d’eux des
commissaires tirés de son sein et accorder ou refuser le triomphe aux
généraux qui les ont vaincus, regardent ce corps comme le maître de la
république[10].
A Rome même, les sénateurs ne paraissant que vêtus de la pourpre royale ;
siégeant dans les temples ; discutant les grandes affaires, les plans des généraux
et le gouvernement des pays conquis ; pouvant ajourner les assemblées du
peuple ou rendre des décrets qui ont force de loi[11] ; recevant
les comptes des censeurs et des questeurs ; autorisant les dépenses, les
travaux, les aliénations du domaine ; veillant à la conservation de la
religion de l’État, à la poursuite des crimes publics, à la célébration des
jeux et des sacrifies solennels ; enfin, décrétant, en cas de péril, des
supplications aux dieux, après la victoire, des actions de grâces et réglant jusqu’aux
affaires du ciel en donnant le droit de cité et des temples à des divinités
étrangères, les sénateurs, dis-je, semblent être les premiers dans l’État par
l’étendue de leurs droits politiques, comme ils l’étaient par leur dignité et
par le respect qu’on attachait à leur nom. Mais, soum s au contrôle
irresponsable des censeurs, le sénat est encore prés clé par les consuls, qui
dirigent à leur gré ses délibérations. Serait-il d’accord avec eux, qu’il ne
pourrait, sans le consentement des tribuns, ni s’assembler ni rendre un
décret ; et l’omnipotence législative du peuple le met dans la dépendance des
centuries et des tribus. Tous ses membres d’ailleurs sont indirectement
nommés par le peuple, puisque c’est lui qui élève aux charges et que c’est
par les charges qu’on entre au sénat[12].
Chez nous le pouvoir exécutif peut être interrogé sur ses
actes aussitôt qu’ils sont accomplis ; pour quelques-uns même avant
l’exécution, ce qui permet de les arrêter. A Rome, le magistrat ne rend
compte qu’après l’expiration de sa magistrature. Il est inviolable, sacrosanctus[13], et ne cède qu’à
l’intercession d’un collègue, au veto d’un tribun ou à celui des auspices. On
ne peut même le poursuivre pour un crime de droit commun.
Le peuple, jury suprême[14], corps électoral
et législatif[15],
en un mot le vrai souverain au Forum, retrouve dans Ies tribunaux civils les
sénateurs pour juges, à l’armée les consuls pour généraux les uns, armés de l’autorité des lois et du
pouvoir discrétionnaire que donne une législation incertaine et obscure ; les
autres, d’une discipline qui commande une obéissance aveugle. Le plébéien se
gardera de blesser ceux qui pourraient se venger sur le plaideur ou sur le
légionnaire des votes hostiles du citoyen. Dans les comices mêmes où le
peuple est roi, rien n’est laissé au nasard du moment. Le magistrat qui
réunit l’assemblée, circonscrit le débat ; il demande soit un non, soit un
oui ; il n’accepte pas de question, et le peuple répond : uti rogas pour approuver, antiquo pour rejeter. Nous dirions aujourd’hui
que l’assemblée n’avait ni le droit d’amendement ni celui d’interpellation. On
ne discutait que dans les conciones,
sorte d’assemblées préparatoires oit l’on ne votait pas. Si pourtant le
peuple souverain entendait faire acte de souveraineté, il pouvait être arrêté
par un double veto dans les comices par tribus, celui des tribuns ; dans les
centuries, celui des dieux, exprimé par les augures. Enfin, fermiers de
l’État polir les domaines, les travaux publics et le recouvrement des impôts,
nombre de citoyens, surtout les plus riches, dépendent encore du sénat et des
censeurs qui adjugent les enchères, font les remises, prolongent les termes
de payement ou cassent les baux[16].
Il n’y a pas jusqu’aux plus pauvres qui n’aient leur jour
de fête et de royauté. La veille des comices, le patricien oublie sa noblesse
pour ce mêler à la foule, pour caresser ces rois de quelques heures qui
donnent les honneurs, la puissance et la gloire. Il prend la main calleuse du
paysan, appelle par son nom le plus obscur quirite[17], et, plus tard,
il rendra au peuple en un jour d’élection tout ce que lui et ses pères auront
gardé du pillage de plusieurs provinces. La brigue, que dans un siècle il
faudra punir parce qu’elle amènera la vénalité, ne fait encore que rapprocher
le riche du pauvre et donner aux grands une leçon d’égalité.
Chaque corps de l’État,
dit Polybe, peut donc nuire à l’autre ou le
servir ; de là naît leur concert et la force invincible de cette république.
Une puissance morale, la censure, elle-même irresponsable
et illimitée dans ses droits, veillait au maintien de cet équilibre. Dans les
législations orientales, le principe conservateur de la constitution est le
sentiment religieux, car la loi n’est que l’expression de la volonté divine.
En Grèce et à Rome, Lycurgue et fuma donnèrent aussi à leurs lois la sanction
des dieux. Mais Solon et les Romains de la république, plus éloignés de
l’époque sacerdotale, confièrent à des hommes ce pouvoir conservateur : Solon
à l’aréopage, la constitution romaine aux censeurs. A Athènes, l’aréopage,
sorte de tribunal placé en dehors de l’administration, ne fut jamais assez
fort pour exercer une influence utile ; à Rome, la censure, chargée de très
graves intérêts matériels, fut une magistrature active dont l’importance politique
accrut et assura l’autorité morale[18]. Ces détails
qu’aucune idée ne peut frapper, ces dangereuses innovations qui ébranlent
sourdement les républiques en détruisant l’égalité, les censeurs surent les
atteindre et les punir. Souvent ils chassèrent du sénat et de l’ordre
équestre, ou privèrent de leurs droits politiques de puissants citoyens, et
dans la répartition des classes ils exerçaient la
législation sur le corps même qui avait la puissance législative[19], et ils
mettaient leurs actes sous la sanction de la religion, en offrant à la
clôture du cens le sacrifice solennel des suovetaurilia.
Par leur autorité sans contrôle, ils venaient en aide au pouvoir exécutif
toujours si faible dans les démocraties.
En tout État, c’est une grave question que de savoir dans
quelles mains doit être le pouvoir judiciaire. Cette question troubla le
dernier siècle de la république romaine aux époques antérieures, elle avait
reçu une solution originale. Le consul d’abord, le préteur ensuite, ne
jugeait pas lui-même. Pour chaque espèce, il donnait la règle de droit qui
devait être appliquée, et les juges désignés par lui, avec l’agrément des
parties, décidaient la question de fait. Ainsi le procès était double, in jure, devant le préteur, in judico, devant les juges. Pour les
causes graves, les juges étaient pris dans le sénat ; pour les affaires moins
importantes, dans le corps des centumvirs élus au nombre de trois par chacune
des trente-cinq tribus. Ainsi, l’organisation de la justice civile était, à
certains égards, celle que nous avons pour la justice criminelle : le
magistrat déclarait, d’après la nature de la cause, quelle décision juridique
elle comportait, et des judices ou
jurés prononçaient sur le point de fait.
La justice criminelle était exercée par le peuple.
Quiconque avait, par un crime, violé la paix publique, était justiciable de
l’assemblée souveraine, qui recevait aussi les appels formés contre les
sentences des magistrats ; ceux-ci, en vertu de leur charge qui les obligeait
à faire respecter la loi, punissaient les délits dont un certain nombre
seraient qualifiés par nous de crimes. Le châtiment était les verges pour les
petites gens, pour les autres une amende. Les consuls et les préteurs avaient
en outre conservé de la royauté le droit de nommer, pour les cas graves et
pressants, des questeurs criminels, juridiction exceptionnelle que nous
verrons devenir permanente, quæstiones
perpetuæ. Du reste, la justice criminelle s’exerçait rarement,
par la justice domestique lui enlevait les crimes de l’esclave, du fils, s’il
n’était pas émancipé, et de l’épouse in manu.
Le maître, le père et le mari prononçaient dans l’intérieur de la maison la
sentence et la faisaient exécuter. Il n’y a donc pas, à l’époque ou nous
sommes de l’histoire romaine, un corps de citoyens qui soient investis de
l’autorité judiciaire et qui, grâce à ce privilège, puissent menacer la
liberté des autres classes. La justice est alors égale pour tous ; dans un
siècle, elle ne le sera plus.
Cette constitution si bien pondérée exposait à pendant
l’Etat à de grands périls. Elle n’était point écrite ; et les doits des
assemblées ou des magistrats n’ayant jamais été clairement définis, il
pouvait arriver que les diverses juridictions empiétassent les unes sur les
autres ; de là des chocs, c’est-à-dire des troubles ; ou bien qu’une seule,
aidée par les circonstances, prit dans l’État une prépondérance dangereuse.
Ainsi Hortensius avait donné une égale autorité aux décisions du sénat et à
celles du peuple : que ces deux pouvoirs se mettent en opposition, et il n’y
aura dans l’État aucune force légale, si ce n’est le remède violent et
temporaire de la dictature, qui pourra sans combats terminer cette lutte.
Mais la prudence du sénat sut pendant un siècle et demi prévenir ce danger.
Il se fit un partage entre lui et le peuple des matières sur lesquelles
devait s’exercer leur omnipotence législative. Au peuple, les élections et
les lois d’organisation intérieure ; ait sénat, l’administration des finances
et des affaires extérieures ; aux magistrats, les droits illimités de l’imperium
pour l’exercice du pouvoir exécutif.
D’ailleurs si ce peuple était continuellement poussé en
avant par des besoins nouveaux, il était constamment aussi retenu en arrière
par son respect des temps anciens. Tant que Rome resta elle-même, elle eut, à
l’image de son dieu Janus, les yeux tournés à la fois vers le présent et vers
le passé. La coutume des aïeux, mos majorum,
y conserva une autorité qui permit souvent de suppléer à la loi écrite ou de
la tourner, et cette autorité de la coutume fut un puissant principe de
conservation sociale.

III. — ORGANISATION MILITAIRE.
Au dehors, ce gouvernement était défendu par les
meilleures armées qui eussent encore paru. Nul adversaire, nulle entreprise,
ne pouvaient effrayer les vainqueurs des Samnites et de Pyrrhus. Ils avaient
triomphé de tous les ennemis et de tous les obstacles : de la tactique
grecque[20]
comme de la fougue gauloise et de l’acharnement samnite ; les éléphants de
Pyrrhus ne les avaient étonnés qu’une fois[21]. Entourés
d’ennemis, les Romains n’avaient, pendant trois quarts de siècle, connu
d’autre art que la guerre, d’autre exercice que les armes. Ils n’étaient pas
seulement les soldats les plias braves, les mieux disciplinés de l’Italie,
mais les plus agiles et les plus forts. Le pas militaire était de 24 milles
en 5 heures ; et durant
les marches ils portaient leurs armes, pour cinq jours de vivres, des pieux
pour camper : en tout, au moins 60 livres romaines. Dans l’intervalle des
campagnes, les exercices des camps continuaient au Champ de Mars. Ils
lançaient des javelots et des flèches, combattaient à l’épée, couraient et sautaient
tout armés, ou traversaient le Tibre à la nage, se servant, pour ces
exercices, d’armes d’un poids double ; de celui des armes ordinaires. Les
plus grands citoyens prenaient part à ces jeux ; des consuls, des
triomphateurs rivalisaient de force, d’adresse et d’agilité, montrant à ce
peuple de soldats que les généraux avaient aussi les qualités du légionnaire.
Toutes les puissances combattaient alors avec des mercenaires
; Rome seule avait elle armée nationale, d’où l’étranger, l’affranchi, le
prolétaire étaient exclus, et qui avait déjà établi cette religion du drapeau
qui a fait accomplir tant de miracles[22].
Tous les citoyen aisés et riches devaient passer par cette
rude école de discipline, de dévouement et d’abnégation. Personne, dit Polybe,
ne peut être élu à une magistrature qu’il n’ait fait dix campagnes. Combien
cette loi ne relevait-elle pas la dignité et la force de l’armée !
Nous venons de suivre les Romains au sénat et au Forum,
nous avons montré leur vie publique, et leur vie privée ; cette étude ne
serait pas complète si nous ne cherchions pas à les voir au camp.
L’organisation militaire est pour tous les peuples une question bien grave.
Sans les soldats formés dans les gymnases de la Grèce, les Perses étaient
vainqueurs à Marathon et à Platées ; sans la phalange de Philippe, Alexandre
ne sortait pas de la
Macédoine ; sans la légion, l’Italie et le monde eussent
été livrés aux barbares avant que la civilisation s’y fût assez fortement
enracinée pour ne pouvoir plus en être arrachée tout entière. Le tableau de
l’armée romaine fait donc nécessairement partie de l’histoire de Rome, et
pour le tracer nous n’avons qu’à abréger, en le complétant sur quelques
points, le récit de Polybe, qui, s’il n’est pas un grand écrivain, a été le
plus intelligent observateur de l’antiquité[23].
Après l’élection des consuls,
24 tribuns, toujours d’ordre sénatorial ou équestre, sont nommés, 16 par le
peuple, par les consuls, pour la levée annuelle, qui est habituellement de
quatre légions[24]. On les choisit de telle sorte, que 14 soient pris parmi
ceux qui ont servi au moins cinq ans. Et cela est facile, puisque tous les
citoyens sont obligés, jusqu’à quarante-six ans, de porter les armes, soit dix
ans dans la cavalerie, soit seize ans dans l’infanterie. On n’excepte que
ceux dont le bien ne passe pas 400 drachmes et qui sont réservés pour la
marine. Quand la nécessité l’exige, on les prend même pour l’infanterie ; et
alors leur obligation militaire est de vingt années de service.
Chaque légion a 6 tribuns, qui
commandent tour à tour la légion pendant deux mois sous les ordres supérieurs
du consul, et l’on a soin que ce collège soit formé en proportion à peu près
égale de jeunes et d’anciens tribuns.
Quand on doit faire une levée,
ordinairement de quatre légions, tous les Romains en âge de porter les armes
sont convoqués au Capitole. Là, les tribuns militaires tirent les tribus au
sort et choisissent dans la première que le sort désigne quatre hommes égaux,
autant qu’il est possible, en taille, en âge et en force. Les tribuns de la
première légion font leur choix les premiers ; ceux de la seconde ensuite, et
ainsi des autres. Après ces quatre citoyens, il s’en approche quatre autres ;
ce sont alors les tribuns de la seconde légion qui font leur choix les premiers
; ceux de la troisième après ; et ainsi de suite. Le même ordre s’observe
jusqu’à la fin d’où il résulte que chaque légion est composée d’hommes de
même âge et de même force, ordinairement au nombre de quatre mile deux cents,
et de cinq mille quand le danger presse[25]. Quant aux cavaliers, le censeur les choisit d’après le
revenu, trois cents par légion. La levée faite, les tribuns assemblent leur
légion, et, choisissant un des plus braves, ils lui font jurer qu’il obéira
aux ordres des chefs et qu’il fera tout pour les exécuter. Les autres,
passant à leur tour devant le font le même serment, en prononçant les mots : Idem
in me. C’était l’équivalent de notre formule :
Je le jure[26].
En même temps, les consuls
font savoir aux villes d’Italie d’où ils veulent tirer des secours le nombre
d’hommes dont ils ont besoin, le jour et le lieu du rendez-vous. La levée se
fait dans ces villes comme à Rome, même choix, même serment. On donne un chef
et un questeur à ces troupes et on les met en marche.
Les tribuns, après le serment,
indiquent aux légions le jour et le lieu où elles doivent se trouver sans
armes, puis les congédient. Quand elles se sont assemblées au jour marqué ;
des plus jeunes et des plus pauvres on fait les vélites ; ceux qui les
suivent en âge forment les hastaires ; les plus forts et les plus
vigoureux composent les princes, et on prend les plus anciens pour en
faire les triaires. Ainsi, chaque légion est composée de quatre sortes
de soldats, qui diffèrent par le noir, l’âge et les armes : six cents
triaires, mille deux cents princes, autant de hastaires ; le reste forme les
vélites.
Les vélites sont armés d’un
casque sans crinière, d’une épée, d’un bouclier rond qui a 3 pieds de diamètre, et
de plusieurs javelots dont le bois a 2 coudées de long et un doigt de grosseur.
La pointe, longue de 1 spithame[27], est si effilée, qu’au premier coup elle se fausse, de
sorte que les ennemis ne peuvent le renvoyer[28].
Les hastaires ont l’armure
complète, c’est-à-dire un bouclier convexe, large de 2 pieds et demi et long
de 4. Il est fait de deux planches collées l’une sur l’autre et couvertes en
dehors d’un linge, puis d’un cuir de veau. Les bords de ce bouclier en haut
et en bas sont garnis de fer, et la partie convexe est couverte d’une plagale
de même métal, pour parer les traits lancés avec une grande force. Les
hastaires portent l’épée sur la cuisse droite ; la lame en est forte et
frappe d’estoc et de taille[29]. Ils ont, en outre, deux pilum, un casque d’airain
et des bottines. De ces deux javelots, l’un est rond ou carré et a 4 doigts
d’épaisseur ; l’autre est plus léger, mais pour tous les deux la hampe a 3
coudées et le fer autant[30]. Sur leur casque se dresse un panache rouge ou noir,
formé de trois plumes droites et hautes d’une coudée, ce qui fait paraître
plus grands et leur donne un air formidable. Les moindres soldats portent en
outre, sur la poitrine, une lame d’airain qui a 12 doigts de tous les côtés.
Mais ceux qui sont riches de plus de 10.000 drachmes ont, au lieu de ce
pectoral une cotte de mailles. Les princes et les triaires ont les mêmes
armes, seulement les triaires n’ont qu’une lance (hasta ou δόρυ).
Dans chacun de ces trois
corps, on choisit, laissant à part les plus jeunes, vingt des plus prudents
et des plus braves pour faire d’eux les centurions. Le premier élu a voix
délibérative dans le conseil. Il y a vingt autres officiers d’un rang inférieur,
optiones, et qui sont choisis par les vingt premiers pour conduire
l’arrière-garde. Chaque corps est partagé en dix manipules[31], à l’exception des vélites qui sont répandus en nombre
égal dans les trois autres corps. Les centurions choisissent dans leur
compagnie, pour porter les enseignes, deux hommes des plus forts et des plus
braves, vexillarii, signiferi[32].
La cavalerie se divise de la
même manière en dix compagnies ou turmes ; chacune d’elles a trois chefs
dont le premier nommé commande la compagnie entière ; ces chefs en
choisissent trois autres d’ordre inférieur pour veiller aux derniers rangs.
Les armes de la cavalerie sont une cuirasse, un bouclier solide et une forte
lance ferrée à son extrémité inférieure, afin qu’elle puisse servir encore quand
la pointe en est brisée[33].
Après que les tribuns ont
ainsi partagé les troupes et donné pour les armes les ordres nécessaires, ils
congédient l’assemblée jusqu’au jour où les soldats ont juré de se réunir.
Rien ne peut les relever de leur serment, si ce n’est les auspices ou des
difficultés insurmontables. Chaque consul marque séparément un rendez-vous
aux troupes qui lui sont, destinées, ordinairement la moitié des alliés
auxiliaires et deux légions romaines. Quand les alliés ont rejoint, douze,
officiers choisis par les consuls, et qu’on appelle préfets, sont chargés
d’en régler la distribution. On met à part les mieux faits et les plus braves
pour la cavalerie et l’infanterie qui doivent former la garde des consuls.
Ceux-là s’appellent les extraordinaires. Quant au nombre total des alliés, il
est pour l’infanterie égal à celui de l’infanterie romaine, et triple pour la
cavalerie. On prend pour les extraordinaires le tiers de celle-ci, et la
cinquième partie de l’infanterie. Les préfets partagent le reste en deux
corps, dont l’un s’appelle l’aile droite et l’autre l’aile gauche.
Sur le champ de bataille, la légion se formait en trois
lignes : à la première, les hastats ; à la seconde, les princes ; à la
troisième, les triaires, tous partagés en dix manipules, rangés sur vingt
hommes de front et six de profondeur. Dans l’ordre serré, confertis ordinibus, les soldats étaient
placés à 3 pieds
l’un de l’autre, dans tous les sens, afin d’avoir l’espace nécessaire pour le
maniement de leurs armes. Un même intervalle séparait les dix manipules de chaque
ligne, de sorte que le front d’une légion en bataille était de 570 mètres, sans
compter l’espace réservé à la cavalerie que le général plaçait ordinairement
aux ailes et qui prenait un espace de 1m,50 par cheval. Dans l’ordre étendu, laxatis ordinibus, les soldats étaient
séparés les uns des aubes par un intervalle de 6 pieds, ce qui doublait
la ligne du front.
A chaque manipule des hastats et des princes étaient
joints quarante vélites qui formaient derrière cette infanterie pesante un
sixième et un septième rang de troupes légères. Les vélites passaient par les
intervalles pour engager l’action de loin, en tirailleurs, y rentraient quand
les hastats en venaient aux mains, ou les fermaient lorsqu’ils pouvaient encore,
de là, lancer utilement leurs traits sur l’ennemi. L’armée romaine n’eut que
plus tard des archers et des frondeurs. Si les hastats pliaient, ils se
retiraient par les intervalles des princes placés derrière eux, et tandis que
ceux-ci combattaient, les triaires, un genou en terre et couverts par leur
bouclier, attendaient le moment d’entrer en action.
Pour le camp, le lieu est
choisi avec soin ; une fois l’emplacement désigné, on cherche l’endroit d’où
le général pourra le plus facilement tout voir et on y plante un drapeau.
Autour, on mesure un espace carré dont chaque côté est éloigné du drapeau de 100 pieds : c’est le prétoire.
A gauche et à droite du prétoire sont le forum ou marché et le quæstorium,
c’est-à-dire le trésor et l’arsenal. On établit les légions du côté qui est
le plus commode pour aller à l’eau et au fourrage. Les douze tribuns, s’il
n’y a que deux légions, se logent sur une ligne droite, parallèle au prétoire
et à une distance de 50
pieds, leurs tentes faisant face aux troupes qui commencent
à s’établir à 100 pieds
plus loin, sur une ligne également parallèle[34].
Cette ligne est coupée
perpendiculairement à son milieu par une ligne droite, et à 25 pieds de chaque côté
de cette ligne, on loge la cavalerie des deux légions vis-à-vis l’une de
l’autre et séparées par un espace de 50 pieds. Derrière la cavalerie, qui est
ainsi établie à la hauteur du milieu des tentes des tribuns, des deux côtés
d’une des grandes rues du camp, sont logés les triaires, une cohorte derrière
un escadron. Ils se touchent, mais en se tournant le dos. À 50 pieds des triaires et
vis-à-vis d’eux, on place les princes de l’autre coté de la seconde et de la
troisième rue, qui commencent, aussi bien que celle de la cavalerie, à la
ligne des tentes des tribuns et finissent au front du camp. Au dos des
princes on met les hastaires, puis à 50 pieds de ceux-ci, le long de la quatrième
et de la cinquième rue, la cavalerie des alliés. Derrière cette cavalerie se
place l’infanterie des alliés, qui fait face au retranchement, de sorte
qu’elle a vue sur deux des quatre côtés du camp.
Entre la cinquième et la
sixième cohorte, il y a une séparation de 50 pieds, laquelle forme
une nouvelle rue qui traverse le camp parallèlement aux tentes des tribuns et
coupe les cinq rues par le milieu. Cette rue transversale s’appelle Quintaine.
A l’extrémité de la ligne que
foraient les tentes des tribuns, et parallèlement aux deux côtés du camp, se
trouve, en face de, la place du questeur et de celle du marché, le logement
de la cavalerie extraordinaire et des cavaliers volontaires. Derrière ces
cavaliers se placent l’infanterie extraordinaire et les fantassins
volontaires qui ont vue sur le retranchement. Ces cavaliers et ces fantassins
sont toujours à la suite du consul et du questeur.
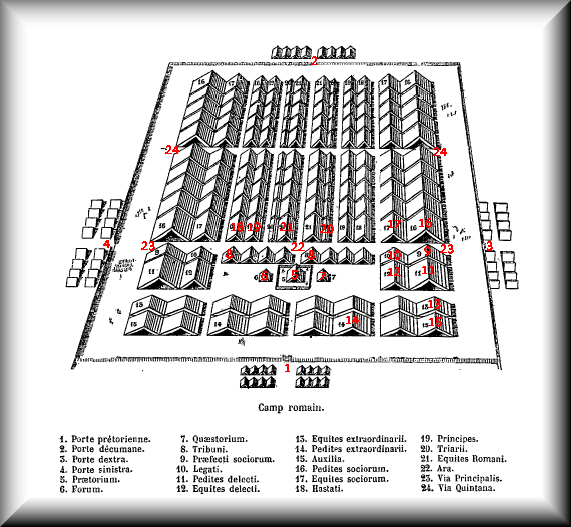
En face des dernières tentes
de ces troupes, on laisse un espace large de 100 pieds, parallèle
aux tentes des tribuns, et qui traverse toute l’étendue du camp. Au-dessous
de cet espace est logée la cavalerie extraordinaire des alliés, ayant vue sur
le marché, le prétoire et le trésor. Un chemin ou une rue large de 50 pieds partage en deux
le terrain de la cavalerie extraordinaire, venant à angle droit du côté qui
ferme le derrière du camp jusqu’au terrain qu’occupe le prétoire. Enfin,
derrière la cavalerie extraordinaire des alliés campe leur infanterie
extraordinaire, tournée du côté du retranchement. Ce qui reste d’espace vide
des deux côtés est destiné aux étrangers et aux alliés qui viennent au camp.
Toutes choses ainsi rangées, on voit que le camp forme un carré qui, par la
disposition intérieure, ressemble à une ville régulière.
Du retranchement[35] aux tentes il y a 200 pieds de distance ;
cet espace sert à faciliter l’entrée et la sortie des troupes. On y met aussi
les bestiaux et tout ce qu’on prend sur l’ennemi. Un autre avantage
considérable, c’est que, dans les attaques de nuit, il n’y a ni feu ni trait
qui puisse arriver aux tentes, si ce n’est très rarement.
S’il arrive que quatre légions
et deux consuls campent ensemble, la disposition est la même pour l’une et
l’autre armée ; seulement il faut s’imaginer deux armées tournées l’une vers
l’autre, et jointes par les côtés où les extraordinaires de l’une et d
l’autre sont placés, c’est-à-dire par le derrière du camp, et celui-ci alors
forme un carré long, occupant un terrain double du premier.
Une fois le camp établi, les
tribuns reçoivent le serment, de tous les hommes libres ou esclaves, qu’ils
ne voleront rien dans le camp, et que, s’ils trouvent quelque chose, ils le prêteront
au prétoire. Ensuite on commande deux manipules, tant des princes que des
hastaires de chaque légion, pour garder la place qui s’étend en face des
tentes des tribuns, et que les soldats remplissent pendant le jour. La tente
et les bagages de chaque tribun sont en outre gardés par quatre soldats.
Trois manipules tirés au soit parmi les princes et les hastaires fournissent
chaque jour cette garde qui est destinée aussi à relever la dignité des
tribuns. Les triaires, exemptés de ce service, veillent sur les chevaux,
quatre par manipule pour l’escadron placé derrière eux. Ils doivent empêcher
que ces chevaux ne s’embarrassent dans leurs liens, ou ne causent, en
s’échappant, du tumulte dans le camp. Un manipule est toujours de garde à la
tente du consul.
Les alliés font deux côtés du
fossé et du retranchement, les Romains les deux autres, un par légion. Chaque
coté se distribue par parties, suivant le nombre des manipules, et pour
chaque partie un centurion préside au travail ; quand tout le côté est fini,
deux tribuns l’examinent et l’approuvent.
Les tribuns sont chargés de la
discipline du camp. Ils y commandent tour à tour deux ensemble pendant deux
mois. Cette charge parmi les alliés est exercée par les préfets. Dès le point
du jour les cavaliers et les centurions se rendent aux tentes des tribuns, et
ceux-ci à celle du consul, dont ils prennent les ordres.
Le mot d’ordre de la nuit se
donne de la manière suivante : on choisit dans les turmes de la cavalerie et
dans les manipules de l’infanterie qui ont leur logement au dernier rang, un
soldat que l’on exempte de toutes les gardes. Tous les jours, un peu avant le
coucher du soleil, ce soldat se rend à la tente du tribun, y prend le mot
d’ordre qui est écrit sur une petite planche de bois et s’en retourne à sa
compagnie. Quand le chef en a pris connaissance, il la porte avec des témoins
au chef de la compagnie suivante, et celui-ci la donne au centurion, qui est
son plus proche voisin ; ainsi des autres, jusqu’à ce que le mot d’ordre
ayant passé par tous les manipules, soit revenu aux tribuns, avant la nuit
close.
La nuit, un manipule entier
veille au prétoire. Les tribuns et les chevaux sont aussi gardés par des
soldats que l’on retire des manipules. D’ordinaire on donne trois gardes au
questeur. La garde de chaque corps se prend dans le corps même. Les côtés
extérieurs sont confiés au soin des vélites, qui pendant le jour montent la
garde le long du retranchement ; de plus, il y en a dix à chaque porte du
camp.
La cavalerie fait les rondes.
Quatre cavaliers du premier escadron se rendent à la tente du tribun, de qui
ils apprennent par écrit quels postes ils doivent visiter ; puis ils
retournent au premier manipule des triaires, dont le centurion est chargé de
sonner de la trompette à chaque heure que la garde doit être montée. Le signal
donné, le cavalier à qui la première garde est échue, fait la ronde
accompagné de quelques amis dont il se sert comme de témoins, et il visite
non seulement les gardes postés au retranchement et aux portes, mais encore
tous ceux qui sont à chaque compagnie de fantassins et de cavaliers. S’il
trouve les sentinelles de la première veille sur pied et alertes, il reçoit
d’elles une petite pièce de bois sur laquelle est écrit le nom de la légion,
le numéro du manipule et de la centurie dont les soldats en faction font
partie. Si quelqu’une est endormie ou absente, il prend à témoin ceux qu’il a
amenés et se retire. Les autres rondes se font de la même manière. A chaque
veille, on sonne de la trompette, afin que ceux qui doivent faire la ronde et
ceux qui font la garde soient avertis en même temps.
Ceux qui ont fait la ronde
portent dès le matin au point du jour, au tribun, les petites pièces de bois
qu’ils ont recueillies. S’il n’en manque aucune, on n’a rien à leur
reprocher, et ils se retirent. S’ils en rapportent moins qu’il n’y a eu de
gardes, on examine ce qui est écrit sur chacune d’elles, quelle garde ne
s’est point trouvée à son poste et l’on appelle le centurion et les hommes de
garde pour les confronter avec l’homme de la ronde qui produit ses témoins,
sans quoi il porte seul toute la peine. On assemble ensuite le conseil de
guerre. Les tribuns jugent, et le coupable est passé par les verges.
Ce châtiment s’inflige ainsi :
le tribun prenant une baguette ne fait qu’en toucher le criminel ; et
aussitôt tous les légionnaires fondent sur lui à coups de verges et de
pierres en sorte que le plus souvent il perd la vie dans ce supplice. S’il
n’en meurt pas, il reste noté d’infamie. Il ne lui est pas permis de
retourner dans sa patrie, et personne de ses parents ou de ses amis n’oserait
lui ouvrir sa maison. Une punition si sévère fait que la discipline à l’égard
des gardes nocturnes est toujours exactement observée. Le même supplice est
infligé à ceux qui volent dans le camp, qui rendent un faux témoignage, se
prêtent à quelque infamie, ou ont été repris trois fois de la même faute. Il
y a aussi des notes d’infamie pour celui qui se vante aux tribuns d’un
exploit qu’il n’a pas fait, qui abandonne son poste ou jette ses armes
pendant le combat. Aussi les soldats, dans la crainte d’être punis ou
déshonorés, bravent-ils tous les périls ; attaqués par un ennemi de beaucoup
supérieur en nombre, ils restent inébranlables à leurs postes. D’autres,
après avoir perdu par hasard leur bouclier ou leur épée dans le combat, se
jettent au milieu des ennemis pour recouvrer ce qu’ils ont perdu ou pour
éviter par la mort les reproches de leurs camarades et la honte attachée à la
lâcheté[36].
S’il arrive que des manipules
entiers aient été chassés de leur poste, le tribun assemble la légion ; on
lui amène les coupables ; il les fait tirer au sort, et tous ceux qui amènent
les chiffres 10, 20, 30, etc., sont passés par les verges. Le reste est
condamné à ne recevoir que de l’orge au lieu de blé, et à camper hors du
retranchement, au risque d’être enlevé par l’ennemi. Cela s’appelle décimer.
Pour les soldats, au contraire, qui se sont distingués soit dans un combat
singulier, avec la permission du général, soit dans une escarmouche où le
chef n’imposait pas l’obligation de combattre, le consul réunit encore la
légion, fait approcher ceux qu’il veut récompenser, et, après leur avoir
décerné de grands éloges, il fait présent d’une lance à celui qui a blessé
l’ennemi, d’une coupe ou d’un harnais à celui qui l’a tué et dépouillé.
Après la prise d’une ville,
ceux qui les premiers sont montés sur la muraille reçoivent une couronne d’or[37]. Il y a aussi des récompenses pour les soldats qui
sauvent des citoyens ou des alliés. Ceux qui ont été délivrés couronnent
eux-mêmes leur libérateur. Ils lui doivent, pendant toute leur vie, tin
respect filial et tous les devoirs qu’ils rendraient d un père. Les
légionnaires qui ont reçu ces récompenses ont droit, au retour de la
campagne, de se présenter clans les jeux et dans les fêtes, vêtus d’un habit
qu’il n’est permis de porter qu’à ceux dont les consuls ont honoré la valeur.
Ils suspendent encore, aux endroits les plus apparents de leurs maisons, les
dépouilles qu’ils ont remportées sur les ennemis, pour être des monuments de
leur courage.
Tels sont le soin et l’équité
avec lesquels on dispense les peines et les honneurs militaires. Doit-on être
surpris, après cela, que les guerres entreprises par les Romains aient un
heureux succès ?
Après une victoire ou la prise
d’une ville, le partage du butin se fait avec la même régularité. Une moitié
des soldats gardent le camp ; les autres se dispersent pour le pillage, et
chacun rapporte à sa légion ce qu’il a pu prendre. Ce butin est vendu à
l’encan, et les tribuns se partagent également le prix entre tous, y compris
les malades et ceux qui sont absents par ordre.
La solde du fantassin est de
deux oboles par jour[38]. Les centurions ont le double, les cavaliers le triple ou
une drachme. La ration de pain pour l’infanterie est des deux tiers d’un
médimne attique de blé par mois, celle du cavalier de 7 médimnes d’orge et de
2 de blé[39]. L’infanterie des alliés a la même ration que celle des Romains
; leur cavalerie, 1 médimne et un tiers de blé et 5 d’orge. Cette
distribution se fait aux alliés gratuitement ; mais, à l’égard des Romains,
on leur retient sur la solde une certaine somme marquée pour les vivres, les
habits et les armes, qu’on doit leur donner.
Comme le camp est toujours
disposé de la manière qui vient d’être dite et que chaque corps y occupe la même
place, il suffit que l’armée, en arrivant au lieu où elle doit camper, voie
flotter le drapeau blanc qui marque l’emplacement de la tente du consul, pour
que tous les manipules sachent où ils devront s’arrêter. Les soldats s’y
rendent comme ils entreraient dans leur cité natale, chacun allant droit à sa
demeure, sans pouvoir se tromper. Aussi les Romains n’ont pas besoin de chercher
comme les Grecs, un lieu fortifié par la nature ; ils peuvent camper
partout, et partout, quand l’ennemi a voulu tenter une surprise nocturne, il
les a trouvés établis dans une forteresse où l’on faisait bonne garde[40].
On voit qu’il n’est pas question, pour l’armée de ce
temps, de la répartition des soldats selon l’ordre des classes. La légion du
premier siècle de la république était constituée aristocratiquement d’après
la fortune. Après l’établissement de la solde en 400, et probablement depuis
les réformes de Camille, les distinctions établies ou réglées par le roi
Servius avaient dû disparaître, et l’égalité semblait régner au camp comme au
Forum. L’âge et la force décidaient de la place que le soldat aurait dans le
rang. Mais Rome tenait trop à ses anciens usages pour les oublier tout en les
modifiant. Les riches qui, dans l’infanterie, ont une armure complète,
fournissent seuls tous les cavaliers, ceux qui se montent à leurs frais, equo privato, à qui l’État donne 7 médimnes
d’orge par mois, et ceux qui reçoivent de lui un cheval, equus publicus, avec une allocation pour
l’entretenir, æs equestre,
équivalent de la ration accordée aux autres en nature. Les pauvres ne sont
reçus que dans les vélites, sortes d’enfants perdus qui ne comptent pas pour
l’action sérieuse, et les indigents sont enrôlés seulement dans les temps de
grave péril[41].
Leur service à l’armée est donc une exception qui deviendra la règle à partir
de. Marius, c’est-à-dire au temps où les ambitieux croiront que les plus
pauvres sont les meilleurs auxiliaires[42]. A l’époque des
guerres Puniques, l’armée était encore l’image de la patrie ; dans deux
siècles elle ne le sera plus.
Notons aussi que nul peuple dans l’antiquité n’a si
fidèlement rempli l’obligation du service militaire. On peut dire que, de la
bataille du lac Régille à celle de Zama, les Romains furent une armée
toujours sur pied. Pour être élevé par eux à une magistrature civile, il
fallait avoir été soldat, et cette coutume durera jusqu’à la fin des
Antonins. Lorsque, au troisième siècle de notre ère, les fonctions civiles
furent séparées des fonctions militaires, ce qui restait de l’esprit de la
vieille Rome disparut, et le règne des aventuriers commença.

IV. — RÉSUMÉ.
Ainsi, au cœur de l’Italie, au milieu de populations
domptées, désunies et surveillées, s’élevait un peuple, fort de son union et
de ses mœurs, qui, après avoir mis près de deux siècles à faire sa constitution
et son armée, avait, en moins de quatre-vingts ans, soumis et organisé la
péninsule entière, du Rubicon au détroit de Messine. Devant ce grand
spectacle, devant ces résultats de l’activité et de la prudence humaines,
nous souvenant de ce que Rome avait d’abord été, nous dirons, avec Bossuet : De tous les peuples du monde, le plus fer et le plus
hardi, mais tout ensemble le plus réglé dans ses conseils, le plus constant
dans ses maximes, le plus avisé, le plus laborieux, enfin le plus patient a
été le peuple romain. De tout cela s’est formée la meilleure milice et la
politique la plus prévoyante, la plus ferme et la plus suivie qui fut jamais.
Voilà de bien glorieuses destinées et une bien grande
histoire. Cependant si, dans Rome, nous avons trouvé beaucoup de grands
citoyens, nous ne saurions dire que nous y ayons jusqu’à présent trouvé un
seul grand homme. Cet empire était, comme Bossuet le montre malgré lui-même,
l’œuvre du temps, des circonstances historiques et de la sagesse collective
du sénat et du peuple. L’union de ceux qui délibéraient à la curie et de ceux
qui votaient au comice, l’esprit de sacrifice et l’esprit de discipline,
c’est-à-dire les grandes vertus civiques, voilà ce qui a donné aux Romains la
victoire sur les Samnites et l’Italie ; ce qui leur donnera la victoire sur
Carthage et le monde. Cette histoire est donc le triomphe du bon sens
appliqué avec persévérance aux choses publiques ; elle est aussi la plus
éclatante protestation contre la vieille doctrine du gouvernement du monde
par les dieux et contre la théorie nouvelle qui attribue tout le progrès
humain aux grands hommes. Ils font beaucoup assurément ; et dans les œuvres
de l’art et de la pensée, ils font tout mais en politique, il n’y a de grands
hommes que ceux qui sont la personnification des besoins de leur temps et qui
dirigent les forces sociales dans le sens où ces forces allaient
d’elles-mêmes. Nous verrons un jour Rome, incapable de conduire ses
destinées, s’abandonner aux mains de ses chers militaires ; mais, pendant un
siècle encore, ses institutions et son vieil esprit la préserveront de ces
guides dangereux.
|