HISTOIRE DES ROMAINS
TROISIÈME PÉRIODE — GUERRE DE L’INDÉPENDANCE ITALIENNE OU CONQUÊTE DE L’ITALIE (343-265)
CHAPITRE XVI — GUERRE DE PYRRHUS (280-272).
I. — RUPTURE AVEC TARENTE. PREMIÈRES CAMPAGNES DE PYRRHUS EN ITALIE (282-278).Nous touchons au moment où Rome et Cette décadence générale de la race grecque avait atteint Le sénat avait adjoint à la garnison romaine de Thurium une escadre de dix galères pour croiser dans le golfe. Un jour que le peuple de Tarente était assemblé au théâtre, en face de la mer, les vaisseaux romains se montrèrent à l’entrée du port. Un démagogue, Philocaris, s’écrie que, d’après les anciens traités, les Romains n’ont pas le droit de dépasser le cap Lacinien. Les Tarentins courent à leurs navires, attaquent les galères romaines, en coulent quatre, et en prennent une autre dont ils massacrent l’équipage, et, enhardis par ce facile succès, vont chasser de Thurium la garnison romaine et pillent la ville. Bientôt un ambassadeur romain se présente, demandant réparation ; il est accueilli par des huées et d’ignobles insultes ; un bouffon ose couvrir de fange la toge de l’ambassadeur. Riez, dit Postumius, riez maintenant, c’est votre sang qui lavera ces taches. (282) Cependant le sénat ne commença qu’avec répugnance cette nouvelle guerre. Les Étrusques tenaient encore tête aux légions. Des bandes armées parcouraient le Samnium, et il fallait punir les Lucaniens de leurs attaques répétées contre Thurium. On prévoyait d’ailleurs que les Tarentins iraient chercher en Grèce des auxiliaires comme ils l’avaient déjà fait trois fois quand ils avaient appelé le roi de Sparte Archidamas, Alexandre le Molosse, et le Lacédémonien Cléonyme. Dans le sénat, la discussion dura plusieurs jours. Le parti de la guerre à la fin l’emporta ; et le consul Æmilius marcha par le Samnium contre Tarente. Avant d’attaquer, il offrit encore la paix ; Ies grands l’acceptaient, le parti populaire qui était le vrai maître de l’État, rejeta toutes les propositions et invita Pyrrhus à descendre en Italie (281). Neveu d’Olympias et fils d’Éacide, roi d’Épire, Pyrrhus
était le plus habile peut-être de tous ceux qui se portaient pour héritiers d’Alexandre.
Mais éprouvé par les fortunes les plus diverses, ayant deux fois déjà perdu
et regagné son royaume, conquis et abandonné
Arrivé à Tarente, Pyrrhus ferma les bains et les théâtres, força les citoyens de s’armer, et les exerça sans pitié, comme ses mercenaires. La ville des plaisirs était devenue une place de guerre. Beaucoup de Tarentins s’enfuirent (280). A Rome, on ne voulu pas entrer en campagne avant d’avoir solennellement
déclaré la guerre à Pyrrhus ; mais l’Épire était loin, le temps pressait. On
s’en tira comme à Caudium, par un subterfuge : un déserteur Épirote acheta un
champ, et sur ce champ les féciaux accomplirent sérieusement les cérémonies
religieuses. La lettre de la loi était exécutée : les dieux devaient se tenir
pour satisfaits ; la conscience publique n’en demandait pas d’avantage. On
fut heureusement plus sérieux pour les préparatifs. Les consuls enrôlèrent,
comme dans les dangers extrêmes, tous les hommes valides, même des
prolétaires. Le droit de cité, récemment accordé à plusieurs peuples, les
colonies répandues dans Cette difficile victoire, les dangers mêmes qu’il avait courus, et ce qu’il apprit de Rome, inspirèrent au roi grec une estime sérieuse pour ces barbares, dont l’ordonnance était si savante. Il avait compté, en passant l’Adriatique, sur une guerre facile, et il trouvait les plus redoutables adversaires; sur de nombreux auxiliaires, et les Italiens l’avaient laissé combattre seul à Héraclée. Après cette bataille, Locres lui ouvrit ses portes ; la légion campanienne, en garnison à Rhegium, massacra les habitants de cette ville et prit leur place, comme les Mamertins avaient fait à Messine ; des Lucaniens, des Samnites, accoururent à son camp ; mais il y avait loin de là aux trois cent soixante-dix mille hommes promis. Pyrrhus renouvela ses premières offres : laisser libres Tarente et tous les Grecs d’Italie, rendre aux Samnites, aux Apuliens, aux Lucaniens et aux Bruttiens les villes et les terres que les Romains leur avaient enlevées. En échange, il offrait son alliance et la rançon de ses prisonniers. Cinéas, dont l’éloquence avait, disait-on, gagné plus de villes à Pyrrhus que la force des armes, fut chargé de porter à Rome ces propositions. Il avait des présents pour les sénateurs et de riches étoffes pour leurs femmes. Mais il ne trouva personne qui se laissât gagner. Cependant le sénat inclinait à la paix. Le vieil Appius, maintenant aveugle, l’apprend et s’indigne. Il se fait porter à la curie : J’étais fâché de ne pas voir, dit-il, aujourd’hui il me fâche d’entendre ; et, après avoir parlé vivement contre ce qu’il appelait une lâcheté, il termina par ces mots, qui devinrent pour l’avenir la règle de conduite du sénat : Que Pyrrhus sorte d’Italie, et l’on verra ensuite à traiter avec lui[6]. Cinéas reçut l’ordre de quitter Rome le jour même. Sous ses yeux, deux légions s’étaient formées de recrues volontaires. La vue de cette grande ville, de ses mœurs austères, de ce zèle patriotique, frappa d’admiration ce Grec, élevé au milieu des basses intrigues, de la vénalité et de la décadence de son pays. Le sénat, disait-il au retour, m’a paru une assemblée de rois. Combattre avec les Romains, c’est combattre avec l’Hydre[7]. Leur nombre est infini, comme leur courage. Pyrrhus tenta un coup de main hardi. Il part de Avant que ce cercle menaçant ne se fermât sur lui, Pyrrhus s’échappa avec son butin, et retourna hiverner à Tarente. Les légions prirent aussi leurs quartiers d’hiver, excepté celles qu’il avait battues à Héraclée. En punition de leur défaite, elles durent rester sur le territoire ennemi, vivant de ce qu’elles pouvaient y enlever. Le sénat se décida cependant à racheter les prisonniers. C’étaient, pour la plupart, des cavaliers que leurs chevaux, effarouchés par les éléphants, avaient désarçonnés. Ils appartenaient d’ailleurs aux meilleures maisons de la ville. Trois commissaires allèrent traiter de leur rachat ou de leur échange, Æmilius Papus, Corn. Dolabella et Fabrioius, le héros des légendaires que nous sommes forcés de suivre pour cette période, où Denys et Tite Live nous manquent, et ou nous n’avons pas encore Polybe. Pyrrhus refusa ; mais, par estime pour Fabius, qu’il tenta vainement de gagner, il permit à ses prisonniers d’aller célébrer à Rome les saturnales. Pas un ne manqua de revenir. Au printemps de l’an 279, il reprit les hostilités dans l’Apulie, et assiégea Asculum, que Ies deux consuls, Sulpicius Saverrio et P. Decius, se décidèrent à sauver par une bataille. Le bruit courut, dit-on, dans les deux armées que Decius imiterait l’exemple de son père et de son aïeul. Le roi donna à ses troupes la description du costume qu’aurait le consul, et commanda qu’on le saisit vivant et sans blessure. En même temps, il avertit les généraux romains qu’après la bataille il livrerait le dévoué à une mort ignominieuse, comme pratiquant des maléfices et faisant une guerre déloyale[8]. Le fragment de Denys d’Halicarnasse, retrouvé naguère au
mont Athos, ne parle pas de la mort de Decius[9], mais raconte la
bataille de manière à nous faire assister d une de ces actions de guerre dont
nous avons eu si souvent à parler, sans être assuré, comme cette fois, que
nous avions, au lieu d’une œuvre de rhéteur, une sorte de compte-rendu
officiel. Il est en effet probable que Denys, qui connaissait les Commentaires
écrits par Pyrrhus, leur a emprunté, au moins en partie, ce récit de bataille
que nous abrégeons[10]. Des hérauts avaient fixé à l’avance l’heure et le lieu du
combat. L’armée royale s’avança en une belle ordonnance. L’infanterie
macédonienne, troupe d’élite, occupait l’aile droite avec les mercenaires
italiens soudoyés par Tarente, les Ambraciotes, la phalange des Tarentins,
qui portaient tous des boucliers blancs, et les auxiliaires du Bruttium et de
Pyrrhus avait soixante-dix mille hommes de pied, dont seize mille grecs qui avaient passé la mer Ionienne, les consuls, à peu près autant, dont vingt mille citoyens romains et huit mille cavaliers. Le roi avait un peu plus de cavalerie et dix-neuf éléphants. Le signal donné, les Grecs entonnèrent le pæan et la cavalerie engagea l’action. Les escadrons grecs tourbillonnaient autour des turmes romaines et les harcelaient sans relâche, attaquant pour fuir aussitôt, revenant vingt fois à la charge, tandis que les Romains cherchaient à combattre de près et ne faisaient que des charges régulières. Des deux côtés on se battit avec un grand courage. Dans l’armée royale, le prix de la valeur fut gagné par les Macédoniens, qui firent reculer la première légion et les alliés Latins ; dans l’armée romaine, il fut mérité par la seconde légion, qui fit plier sous son effort les Molosses, les Thesprotes et les Chaoniens. Pour les soutenir et dégager le centre qui fléchissait, Pyrrhus donna l’ordre d’y ramener les€éléphants. Les chars à faux allèrent à leur rencontre et arrêtèrent un ‘instant leur marche par toutes ces machines dont ils étaient armés et ces feux qu’on dirigeait aux yeux des éléphants. Mais, lorsque les archers postés dans les tours que portaient ces animaux eurent tué les conducteurs et que des soldats armés à la légère, se glissant dans les intervalles, eurent coupé les traits des chars et les jarrets des bœufs, les soldats placés sur les chars, devenus inutiles, sautèrent à terre et se réfugièrent vers leur infanterie, où ils mirent le désordre. Mais, dans le même temps, la quatrième légion faisait tourner le dos aux Lucaniens et aux Bruttiens, qui entraînèrent les Tarentins dans leur fuite, et il fallut que le roi envoyât à leur aide une partie de la cavalerie de l’aile droite. La bataille se maintenait avec
cette alternative de fortunes diverses, quand un secours inattendu arriva aux
Romains. Une troupe de quatre mille hommes de pied et de quatre cents
cavaliers de la ville d’Arpi, cherchant à rejoindre les consuls, arrivèrent
par les hauteurs sur les derrières du camp royal. De là ils voyaient, à une
distance de 20 stades ( Cependant, dans la plaine, le combat continuait. Les royaux tournaient maintenant leurs efforts contre la troisième et la quatrième légion, qui avaient gagné beaucoup de terrain et se trouvaient fort en avant de la ligne romaine. En voyant la masse d’ennemis dont elles étaient menacées, ces légions occupèrent un lieu d’accès difficile, couvert d’arbres et où l’on n’avait rien à craindre des éléphants ai des cavaliers. Ce fut comme une seconde bataille, car le roi et les consuls envoyaient incessamment des secours aux troupes engagées, et le carnage fut très grand. Le roi se lassa le premier et commença, au déclin du jour, à se retirer ; les Romains aussi reculèrent, ils repassèrent le fleuve et rentrèrent dans leur camp. Pyrrhus ne retrouva pas le sien, les tentes, ses bagages étaient brûlés, et beaucoup de blessés périrent faute de secours[11] ; mais il restait maître du champ de bataille. Si les Romains avaient le dessous, ils n’avaient du moins cédé qu’une victoire chèrement achetée (279)[12]. Cette guerre était décidément pour Pyrrhus trop sérieuse et trop lente. Il ne chercha plus qu’un prétexte d’en sortir avec honneur. Fabricius l’ayant averti que son médecin Philippe voulait l’empoisonner, il renvoya tous ses prisonniers sans rançon[13] (278). Après cet échange de bons procédés, il était difficile de se battre. Aussi, laissant Milon dans la citadelle de Tarente et son fils Alexandre à Locres, à pana en Sicile, où les Grecs l’appelaient contre les Mamertins et les Carthaginois. II. — PYRRHUS EN SICILE ; PRISE DE TARENTE (272).Carthage avait récemment envoyé à Ostie une flotte de cent vingt galères, offrant au sénat de l’aider contre Pyrrhus. Les sénateurs avaient refusé, tout en renouvelant l’ancienne alliance. Les deux républiques semblaient avoir alors les mêmes intérêts, elles luttaient contre les mêmes ennemis : l’une contre les Grecs d’Italie, l’autre contre ceux de Sicile. Les Carthaginois assiégeaient encore une fois Syracuse. C’est au secours de cette ville que le gendre d’Agathocle[14] était appelé. Il la débloqua et refoula de poste en poste les Africains jusqu’à Lilybée, qu’il ne lut leur enlever. Là, comme en Italie, après les premières victoires, vinrent la mésintelligence avec les alliés et l’ennui d’une guerre qui ne finissait pas. Pyrrhus avait perdu Cinéas. Poussé par ses nouveaux conseillers à des mesures de violence, il punit sévèrement quelques perfidies, et aliéna par ses hauteurs les Siciliens, auxquels il voulait donner pour roi son fils Alexandre. Cependant il lui restait bien peu de ses vétérans épirotes, les plus braves avaient péri à Héraclée, à Asculum, et dans les combats contre les Carthaginois. Avec une armée de mercenaires grecs et barbares, il ne se sentit point assez fort contre la haine des Siciliens. Les prières des Italiens, vivement pressés par Rome, le décidèrent ; et il laissa encore une fois son entreprise inachevée (278-276). Chaque année depuis son départ, avait été marquée, pour les Romains, par des succès. En 278 Fabricius avait battu les Lucaniens, les Bruttiens, les Tarentins, les Salentins, et fait entrer Héraclée dans l’alliance de Rome. En 277 Rufinus et Bubulcus avaient achevé la dévastation du Samnium et forcé ce qui restait de population à chercher, comme les bêtes fauves, un asile dans les forêts et sur la cime des plus hautes montagnes. De là, Rufinus était allé prendre Crotone et Locres. L’année suivante, nouvelle victoire de Fabius Gurgès sur tous ces peuples, qui rappelèrent Pyrrhus. Au passage du détroit, les Carthaginois battirent sa flotte et prirent sa caisse militaire ; puis il rencontra les Mamertins qui l’avaient devancé en Italie, et au travers desquels il fallut s’ouvrir un passage. Un d’eux, d’une taille gigantesque, s’acharnait à sa poursuite, Pyrrhus se retourna, et d’un coup de hache le fendit de la tête à la selle. A Locres, où il rentra, il pilla le temple de Proserpine pour payer ses mercenaires. Mais ce sacrilège, disait-il lui-même, attira sur ses armes la colère de la déesse[15], et sa fortune vint échouer et Bénévent. Curius Dentatus y commandait l’armée romaine. Les légionnaires s’étaient familiarisés avec les bœufs de Lucanie, comme ils appelaient les éléphants ; ils savaient maintenant les éloigner par une grêle de traits ou par des brandons enflammés : leur victoire fut complète ; le camp royal tomba même en leur pouvoir (275). Pyrrhus ne pouvait plus tenir en Italie ; il laissa une
garnison dans Tarente, et repassa en Épire (274) avec une armée réduite à huit mille
hommes et sans argent pour la payer ; il la mena à de nouvelle entreprises,
tenta de reconquérir On a récemment trouvé[16], à Dodone, l’inscription
suivante : Le roi Pyrrhus et les Epirotes
put consacré à Jupiter Naïos ces dépouilles des Romains et de leurs alliés.
Tandis que s’élevaient dans le plus vénérable des sanctuaires de Les hostilités durèrent quelques années encore dans le sud de l’Italie, toutefois sans importance. Une victoire de Papirius Cursor et de Sp. Carvilius désarma les dernières bandes Samnites. Ce peuple se soumit enfin et donna de nombreux otages. Il y avait soixante-dix ans que la bataille du mont Gaurus avait été livrée, et, dans cette longue guerre, vingt-quatre fois les consuls avaient obtenu le triomphe. La même année, Papirius reçut la soumission des Lucaniens, et Milon (272) livra Tarente, dont les murailles furent détruites, les armes et les vaisseaux enlevés. On conserva la citadelle, où le sénat mit garnison pour contenir la ville, condamnée à un tribut annuel, et éloigner les Carthaginois du meilleur port de l’Italie méridionale. Pyrrhus, en effet, était à peine parti que la défiance naissait entre les deux républiques. Durant le siège de Tarente par les Romains, une flotte carthaginoise s’était montrée en vue du port[17] offrant son assistance ; Papirius avait tout fait pour éloigner ce secours plus redouté que l’ennemi, et la ville avait dû à ces craintes d’être moins durement traitée. Avant huit années, cette défiance se changera en une guerre terrible. La lutte pour la domination de l’Italie était terminée. Des mesures plutôt de police que de guerre auront raison de quelques agitations, qui seront comme les convulsions suprêmes de ce grand corps des nations italiennes. Le sénat sait qu’il n’y a point d’ennemis à dédaigner et que les grands incendies naissent souvent d’étincelles. Placé au centre de l’Italie, il en écoute tous les bruits, il en suit tous les mouvements. Rien n’échappe à cette surveillance,qui ne .s’endort pas dans le succès, et dés qu’un danger se montrera, de grandes forces seront à l’instant dirigées sur le point menacé. Ainsi l’année qui suivit la prise de Tarente, le consul Genucius alla demander compte de leurs méfaits aux légionnaires révoltés de Rhegium ; trois cents d’entre eux, conduits à Rome furent passés par les verges et décapités. Les autres avaient presque tous péri dans l’attaque[18]. En 269 un otage samnite, Lollius, s’échappa ; de Rome, ramassa quelques aventuriers et essaya de soulever les Caracènes dans la haute vallée du Sagrus. Les deux consuls envoyés à la fois contre lui étouffèrent rapidement cette guerre renaissante. L’année d’après, ce sont les Picénins qu’on trouve aux prises avec deux autres armées consulaires, et qui sont forcés de se remettre à la discrétion du sénat ; puis les Sarsinates et toute la nation ombrienne qui reçoivent un dernier coup ; enfin, dans le sud de l’Italie, les Salentins et les Messapiens qui voient arriver les légions moins à cause de leur alliance avec Pyrrhus, que parce qu’ils possédaient le port de Brindes, le meilleur passage d’Italie en Grèce. Déjà le sénat tournait les yeux de ce côté. Des troubles agitaient aussi certaines villes d’Étrurie où deux classes étaient toujours en présence, l’une dominante, l’autre sujette ; celle-ci travaillant la terre, le marbre et le fer pour celle-là qui vivait dans l’abondance, tandis que la plèbe, soumise à une sorte de servitude, restait dans la misère. A Rome, les pauvres étaient arrivés par un progrès lent, mais continu, à l’aisance, à l’égalité politique et à la concorde avec les patriciens ; en Étrurie, ils voulurent la changer par la violence, et le crime ; cette différence explique les destinées contraires des deux peuples. Volsinii, bâtie sur une colline dont son beau lac baignait le pied, était la plus importante des cités étrusques[19], mais aussi une des plus efféminées, et ces mœurs faciles s’alliaient avec des passions violentes. Une révolution démagogique priva les nobles de leurs privilèges, de leurs biens, même de l’honneur de leurs familles, car leurs filles furent contraintes d’épouser les clients et les esclaves de la ville[20]. La noblesse appela les Romains, qui prirent la ville par la famine et la détruisirent, après en avoir enlevé, assure Pline, deux mille statues. Beaucoup de sang coula. Rome réunit dans une commune infortune ces esclaves révoltés contre leurs maîtres, ces clients armés contre leurs patrons, ces nobles traîtres à leur patrie. A ce qui survécut de ce peuple, on interdit d’habiter le lieu où s’élevait l’antique métropole étrusque ; les ruines mêmes de la puissant cité ont disparu. Cette expédition fut le dernier bruit d’armes qui s’entendit en Italie avant l’explosion des guerres Puniques (265). Mais nous y touchons. Les habitudes militaires prises par les Romains durant ces soixante-dix années de combats, ce pillage de l’Italie qui avait enrichi la ville, les grands et le peuple ; ces victoires enfin qui avaient exalté l’ambition, le patriotisme et l’orgueil national, allaient vouer Rome à une guerre éternelle. Le génie des conquêtes plana désormais sur la curie. |
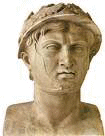 Les Tarentins ne lui épargnèrent ni les présents ni les
promesses. Il devait trouver en Italie 350.000 fantassins et 20.000 chevaux.
Malgré les avertissements du Thessalien Cinéas, son ami, Pyrrhus accepta, et
fit aussitôt partir Milon avec trois mille hommes, pour occuper la citadelle
de Tarente. Durant l’hiver, il prépara un armement considérable : 20.000
hommes de pied, 3.000 cavaliers, 2.000 archers, 500 frondeurs et 20
éléphants. Dans la traversée, une tempête dispersa la flotte et faillit
briser le vaisseau royal sur la côte des Messapiens.
Les Tarentins ne lui épargnèrent ni les présents ni les
promesses. Il devait trouver en Italie 350.000 fantassins et 20.000 chevaux.
Malgré les avertissements du Thessalien Cinéas, son ami, Pyrrhus accepta, et
fit aussitôt partir Milon avec trois mille hommes, pour occuper la citadelle
de Tarente. Durant l’hiver, il prépara un armement considérable : 20.000
hommes de pied, 3.000 cavaliers, 2.000 archers, 500 frondeurs et 20
éléphants. Dans la traversée, une tempête dispersa la flotte et faillit
briser le vaisseau royal sur la côte des Messapiens.