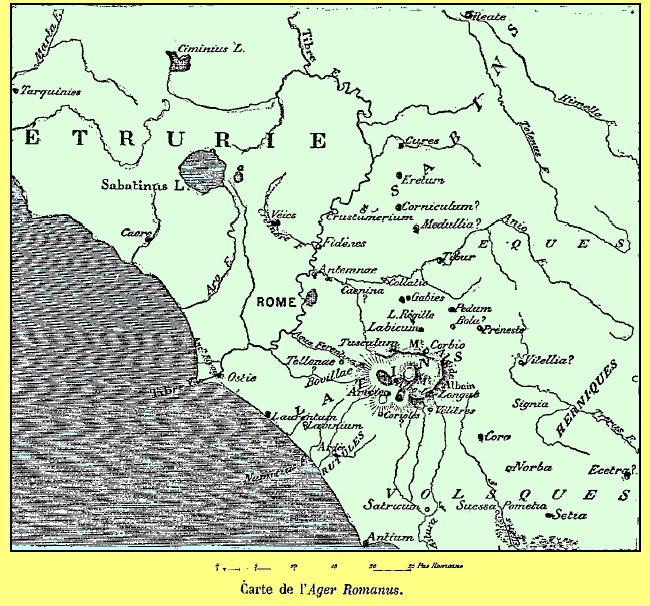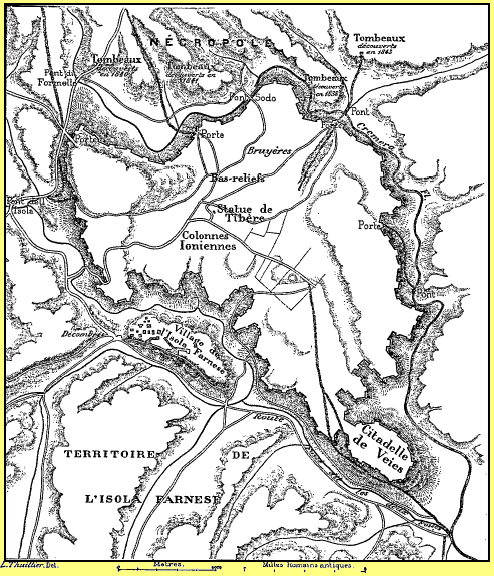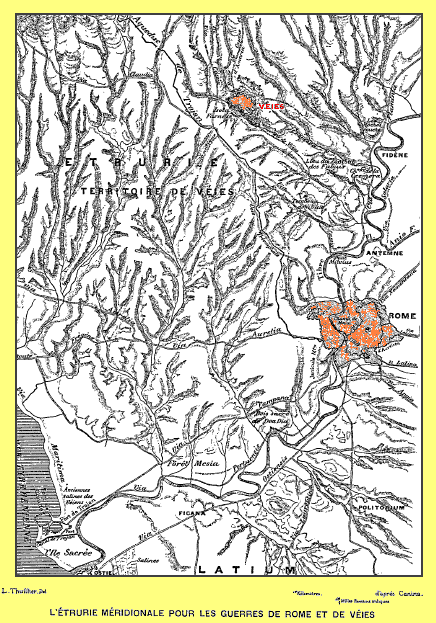|
I. — LE TERRITOIRE ROMAIN EN 493 ;
PORSENNA ET CASSIUS.
La royauté avait donné à Rome une grandeur qui est
attestée par le traité de Tarquin avec Carthage, et aux plébéiens un
bien-être qui résultait du commerce que ce traité révèle[1], des guerres
heureuses faites sous les rois et des immenses travaux accomplis par Ancus,
Servius et les deux Tarquins. La révolution aristocratique de 509 fit perdre
aux Romains cette puissance et cette prospérité. Le peuple tomba dans la
misère, et Rome fut presque réduite à ses propres murailles.
La plus dangereuse des guerres provoquées par cette
révolution fut celle que conduisit Porsenna, le puissant lars de Clusium. Il
vainquit les Romains et leur enleva le territoire des dix tribus établies au
nord du Tibre. Rome cacha sa défaite sous d’héroïques légendes, et ce fut
seulement après être devenue la maîtresse de l’univers qu’elle ne rougit pas
d’avouer qu’elle avait accepté de Porsenna des conditions plus dures
qu’elle-même n’en imposa après ses plus brillantes victoires : il lui
interdit l’usage du fer, excepté pour l’agriculture[2], et exigea en
signe de soumission que le sénat lui envoyât une chaise curule ou trône
d’ivoire, un sceptre et une couronne[3]. Rome soumise,
Porsenna voulut conquérir le Latium, que trois siècles plus tôt les Étrusques
avaient traversé victorieusement et s’ouvrir une route vers les lucumonies du
Volturne. Les Grecs campaniens virent avec effroi se préparer cette invasion
nouvelle et, pour la prévenir, ils vinrent au secours des villes latines qui
résistaient aux Étrusques. Aricie, qui a laissé son nom au pittoresque
village de Laricia sur les pentes méridionales du mont Albain, prés du lac
charmant de la plus florissante cité du Latium. Elle avait résisté à Tarquin
Superbe, et quand le fils du roi de Clusium, Arurs, parut devant ses murs
avec une puissante armée, les habitants allèrent bravement à sa rencontre
avec leurs alliés latins et grecs. Mais ils ne purent soutenir le choc de la
phalange étrusque, et déjà ils reculaient en désordre, lorsque les gens de
Cumes, par une habile manœuvre, prenant à revers l’armée ennemie, changèrent
sa victoire en défaite[4]. Aruns fut tué,
et l’on montre, près de Laricia, les ruines d’un tombeau construit à la mode
étrusque où l’on prétend qu’il fut enseveli[5]. Les débris de
son armée se réfugièrent à Rome, qui profita de ce revers pour se soulever ;
la domination étrusque recula encore une fois derrière le Tibre.
Rome retrouvait sa liberté, mais non sa puissance[6], car les
Étrusques restaient maîtres de la rive droite du fleuve, et, sur la rive gauche,
elle ne recouvra que l’ancien ager Romanus, borné au sud par les terres des
Lains de Gabies, de Bovillæ, de Tellenæ et de Tusculum. De la haute citadelle
de cette dernière ville, qui s’élevait à 15 milles de l’enceinte de Servius,
on voyait tout ce qui sortait de Rome par la porte Capène ; mais de là aussi
les Tusculans, alliés fidèles, signalaient, par des feux allumés sur leurs
remparts, l’approche des Èques et des Volsques.
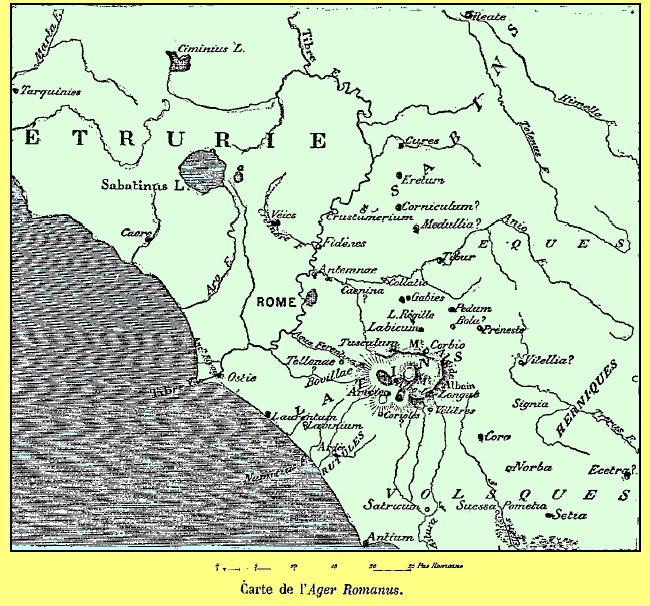
A l’est, quelques expéditions heureuses dans la Sabine portèrent la
frontière romaine jusqu’aux environs d’Eretum, qui resta libre[7]. Tibur, plus près
de Rome, dont elle n’était séparée que par une distance de 20 milles, gardait
aussi son indépendance et promettait de la bien défendre par le culte qu’elle
rendait à sa divinité poliade, l’Hercule des Rochers, Hercules Saxanus, dont le temple s’élevait
au-dessus des chutes de l’Anio. Et elle la défendit en effet durant plus d’un
siècle et demi[8].
Au nord, la limite dépassait ù peine le Janicule. Rome n’était donc plus un
grand État, mais elle était toujours une des plus grandes villes de l’Italie,
et cela fit sa fortune. Dans son enceinte et sur ce territoire de quelques
lieues seulement d’étendue, on comptait, à en croire Denys d’Halicarnasse[9], 130.000 hommes
en état de combattre ; 130.000 hommes réunis sous la main des consuls,
dirigés dans les moments de péril par une seule volonté et toujours soumis à
une admirable discipline. Grâce à cette concentration de leurs forces, les
Romains purent se livrer impunément à leurs querelles intérieures ; car,
s’ils dépensaient au Forum l’énergie qu’ils auraient, très utilement pour
leur puissance, portée sur les champs de bataille, ils étaient trop forts
pour être accablés par quelque ennemi qui les attaquât, une guerre sérieuse
ramenant toujours l’union, et avec l’union une puissance invincible. Aussi ne
cessèrent-ils jamais d’avoir confiance en leur fortune : dès les premiers
temps de la république ils élevèrent un temple à l’Espérance.
Leurs ennemis étaient surtout les Èques et les Volsques.
Montagnards pauvres et pillards, toujours menaçants, et cependant
insaisissables, aujourd’hui dans la plaine, incendiant les moissons, demain
retranchés ou perdus dans leurs montagnes, les Èques étaient l’ennemi, sinon
le plus dangereux, du moins le plus incommode. Les Volsques, riches, nombreux
et maîtres d’un fertile territoire, auraient été plus à craindre, s’ils
n’avaient pas été divisés en une foule de petits peuples qui, ne se
réunissant jamais pour attaquer ou se défendre, ne mirent ni calcul id
persévérance en des expéditions que faisaient souvent échouer l’impatience
des uns on les lenteurs des autres. Cette division et, par suite, le manque
d’une grande capitale dont la prise pût d’un coup terminer la lutte, enfin la
nature du pays, coupé de montagnes et de marais, devaient éterniser la
guerre. Avec de tels ennemis, il n’y avait d’autre moyen d’en finir que celui
dont se servait naguère le gouvernement pontifical contre les brigands des
États romains : raser les villes et y en chasser ou exterminer la population.
Rome procéda ainsi. Mais quand la guerre fut terminée, le pays des Volsques
n’était plus qu’une solitude.
Dans l’Étrurie, les adversaires étaient différents ;
Véies, ville commerçante et industrieuse[10], s’élevait à 4
lieues seulement du Janicule. De ce côté on savait où frapper : il n’y avait
qu’à marcher droit à la ville, l’assiéger et la prendre. Mais le danger pour
Rome était, le même que pour Véies, car ces deux villes se trouvaient dans
des conditions d’existence à peut près semblables : toutes deux grandes,
peuplées, fortes d’assiette, couvertes d’épaisses murailles et pouvant mettre
sur pied des forces considérées. Aussi ce siège, qui devait terminer la
guerre, Rome ne fut en état de l’entreprendre qu’au bout d’un siècle.
Parmi ces ennemis, nous n’avons compté ni les Latins ni
les Herniques, que leur position rendait nécessairement les alliés de la
république. C’était par l’incendie des fermes latines que s’annonçaient
toujours à Rome les courses des Èques et des Volsques ; et les Herniques,
établis entre ces deux peuplés, dans la vallée du Trerus, avaient à souffrir
chaque jour de leurs déprédations. Cette alliance datait de loin (féries latines).
Sous le dernier Tarquin, elle s’était changée pour Rome en une domination que
l’exil du roi renversa et que ne rétablit pas la bataille du lac Régille.
Rome et les Latins restaient séparés, mais la puissance croissante des
Volsques et les brigandages des Èques les rapprochèrent. En 493, durant son
second consulat, Sp. Cassius signa avec les trente villes latines un traité,
omis à dessein, ou mal compris, par les historiens de Rome, parce qu’il
attestait sa faiblesse après les guerres royales, mais qu’on lisait encore,
au temps de Cicéron[11], sur une colonne
de bronze :
Il y aura paix entre les
Romains et les Latins tant que le ciel sera au-dessus de la terre et la terre
sous le soleil. Ils ne s’armeront pas l’un contre l’autre ; ils ne donneront
point passage à l’ennemi à travers leur territoire, et ils se porteront
secours avec toutes leurs forces quand ils seront attaqués. Le butin et les
conquêtes faites en commun seront partagés. Un autre témoignage[12] permet
d’ajouter : Le commandement de l’armée
combinée alternera chaque année entre les deux peuples.
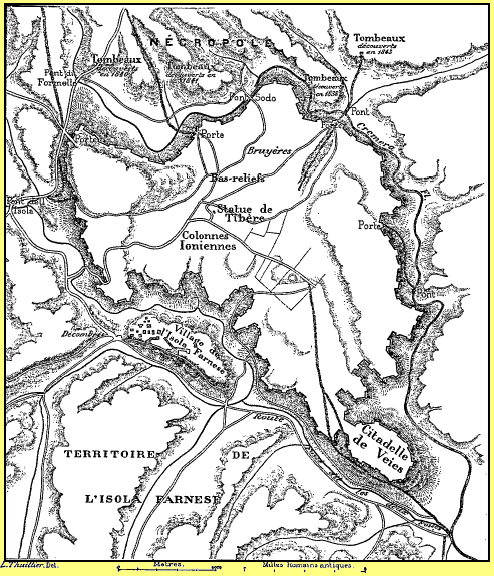
Plan de Véies[13]
Sept années plus tard, durant son troisième consulat,
quelque temps avant de proposer sa loi agraire, Cassius conclut un traité
semblable avec les Herniques[14]. Dès lors, les
Èques et les Volsques ne firent pas titi mouvement que les messagers
Berniques ou latins n’accourussent le dénoncer à Rome, et les légions, en
descendant ou en remontant la vallée du Trerus, purent menacer jusqu’au cœur
le pays ennemi. Ces deux traités ont plus aidé à la future grandeur de Rome
qu’aucun de ceux qu’elle signa plus tard ; car ils assurèrent son existence à
une époque où sa fortune pouvait être étouffée dans son berceau. Tout le
poids de la guerre contre les Èques et les Volsques retomba sur ses alliés,
et de ce côté elle ne joua ordinairement que le rôle d’auxiliaire. De là le
peu l’importance de ces guerres, malgré les actes d’héroïsme et de
dévouement, les grands noms et les merveilleuses histoires dont les écrivains
les ont remplies.

II - CORIOLAN ET LES VOLSQUES.
CINCINNATUS ET LES ÈQUES.
Les Volsques, établis en des montagnes (monti Lepini) qui
atteignent une altitude de 5000
pieds et dont les eaux forment les marais Pontins,
avaient la double ambition de s’étendre à la fois dans la fertile vallée du
Tibre et dans celle du Liris. Après la chute des Tarquins, ils avaient repris
les villes que ce roi leur avait enlevées. Arrêtés, au sud, par la forte
position de Circei, qui cependant tomba en leur pouvoir, et par le pays
impraticable et stérile des Aurunces, ils se rejetèrent sur les riches
plaines du Latium, s’emparèrent de Vélitres, de Cora, malgré ses puissantes
murailles, et portèrent leur avant-postes jusqu’à 10 milles de Rome[15]. La plus
heureuse de leurs invasions, celle à laquelle on a rattaché toutes leurs
conquêtes, fut conduite par un illustre banni romain, de la gens Marcia.
C’était, dit la légende, un patricien distingué par son
courage, sa piété et sa justice[16]. A la bataille
du lac Régille, il avait mérité une couronne civique et gagné, à la prise de
Corioles, le surnom de Coriolan. Un jour que les plébéiens se refusaient aux
levées, il avait armé ses clients et soutenu seul la guerre contre les
Antiates. Cependant, le peuple, qu’il blessait par sa hauteur, lui refusa le
consulat, et Coriolan en conçut une haine qu’il laissa percer par
d’imprudentes paroles. Pendant la retraite sur le mont Sacré, les terres
étaient restées sans culture ; pour combattre la famine on voua un temple à
Cérès et, ce qui valait mieux, on acheta du blé en Étrurie et en Sicile, où
Gélon refusa d’en recevoir le prix. Le sénat voulait le distribuer
gratuitement au peuple : Point de blé ou
plus de tribuns, dit Coriolan. Cette parole fut entendue des
tribuns qui le citèrent aussitôt par-devant le peuple. Ni les menaces ni les
prières des patriciens ne purent les fléchir, et Coriolan, condamné à l’exil,
se retira chez les Volsques d’Antium, puissante et riche cité maritime.
Tullius, leur chef, oublia sa jalousie et sa haine, pour exciter dans le cœur
de l’exilé le désir de la vengeance ; il consentit à n’être que son
lieutenant, et Coriolan marcha sur Rome à la tête des légions volsques.
Aucune armée, aucune place ne l’arrêta, et il vint camper sur le fossé
Cluilius, ravageant les terres des plébéiens, mais épargnant, à dessein,
celles des grands. En vain Rome tenta de le fléchir. Les plus vénérables des
consulaires et les prêtres de dieux, venus à lui en suppliants, n’obtinrent
qu’une dure réponse. Quand la députation rentra désespérée, Valeria, sœur de
Poplicola, priait avec les matrones au temple de Jupiter ; comme si elle
recevait une inspiration d’en haut, elle les entraîne à la demeure de
Coriolan et décide sa mère Veturia, à essayer de toucher au cœur ce proscrit
dont l’âme altière n’a pu être ébranlée par les supplications de la patrie
elle-même et de ses dieux. A l’approche de ces femmes, Coriolan garde
l’aspect farouche. Mais on lui rapporte qu’au milieu d’elles se trouvent sa
vieille mère et sa jeune épouse tenant ses deux enfants par la main. Trop
Romain encore pour manquer au respect filial, il s’avance à la rencontre de
Veturia et fait baisser les faisceaux devant elle : Suis-je devant mon fils, dit la sévère matrone,
ou devant un ennemi ? La jeune femme
n’ose parler, mais elle se jette en pleurant dans les bras de son époux, et
ses enfants s’attachent à lui ; il est vaincu et se retire. Les Romaines
venaient de sauver Rome pour la seconde fois.
La scène est belle, mais n’est pas vraisemblable. Las de
guerre et rassasiés de butin, ou trouvant que la résistance devenait plus
forte à mesure qu’ils s’approchaient de Rome, les Volsques regagnèrent leurs
cités. La légende ajoute qu’ils ne pardonnèrent pas à Coriolan de s’être
arrêté au milieu de sa vengeance, et qu’ils le condamnèrent à mort. Suivant
Fabius, il aurait vécu jusqu’à un âge avancé, en répétant : L’exil est bien dur pour un vieillard.
Ainsi on n’osait nier que Rome eut encore été réduite aux
dernières extrémités et que les Volsques se fussent établis au centre du
Latium ; mais c’était un patricien qui avait vaincu, et l’honneur était sauf.
Quant à Coriolan, il avait raison de trouver amer le pain
de l’étranger, car l’exil romain était une excommunication civile et
religieuse. L’exilé perdait non seulement sa patrie et ses biens, mais ses
dieux domestiques, sa femme, qui avait le droit de se remarier, ses enfants,
pour lesquels il devenait un étranger, ses aïeux, qui ne pouvaient plus
recevoir de lui les sacrifices funèbres. Notre mort civile était moins
terrible[17].
Les montagnes qui séparent les bassins du Liris et de
l’Anio, descendent des bords du lac Fucin jusqu’au-dessous de Préneste, où
elles se terminent à l’Algide par une sorte de promontoire qui domine la
plaine et la vallée dit Tibre. En suivant les sentiers cachés de la montagne,
les Èques arrivaient sans être aperçus jusqu’à l’Algide, dont les bois
couvraient encore leur marche et leurs embuscades[18]. De là ils
fondaient à l’improviste sur les terres latines, et, s’ils étaient assez
nombreux ou l’ennemi trop prudent, ils étaient bientôt au milieu de la
campagne romaine. Chaque année ces incursions se renouvelaient ; ce n’était
pas la guerre, mais il eût mieux valu de sérieux combats que ces éternels
brigandages. Les Latins s’en trouvèrent si affaiblis, que les Èques purent
leur prendre plusieurs villes[19]. Suivant le
traité de Cassius, Rome aurait dû envoyer toutes ses forces à leur secours.
Ses dissensions intérieures et les dangers qu’elle courait dit côté de Véies
retenaient les légions dans la ville ou au nord du Tibre. Cependant le sénat
s’alarma quand il vit les Èques établis sur l’Algide et les Volsques sur le
mont Albain, séparant les Latins des Herniques et menaçant à la fois les deux
peuples[20].
Une trêve de quarante ans, que venaient de signer les Véiens (474) et l’adoption
de la loi Publilia (471)
ayant mis fin pour un temps à la guerre étrusque et aux troubles du Forum, on
put écouter les plaintes des alliés.
Deux membres de la gens
Quinctia, Capitolinus et Cincinnatus, eurent l’honneur de cette guerre.
T. Quinctius Capitolinus, patricien populaire, avait été
le collègue de l’impérieux Appius. Tandis que les Voleros
de celui-ci se faisaient battre par les Volsques, Quinctius enlevait aux
Èques leur butin et rentrait à Rome avec le titre de Père des soldats. Une seconde fois consul en
467, il s’empara d’Antium dont une partie du territoire fut distribuée à des
colons romains et il eut au retour dan si brillant triomphe qu’il en garda le
surnom de Capitolinus. Les Èques restaient en armes ; quatre fois leurs
bandes agiles pénétrèrent audacieusement dans la campagne de Rome ; un jour
même ils enveloppèrent le consul Furius dans une gorge étroite ; deux légions
allient être perdues ; Capitolinus les sauva. A la nouvelle du péril, le
sénat avait investi l’autre consul de la puissance dictatoriale par la
formule : Caveat consul ne quid detrimenti
respublica capiat, et il ne s’en était servi que pour charger
Capitolinus du soin difficile de délivrer l’armée consulaire.
Jamais Rome, depuis Porsenna, n’avait été aussi
sérieusement menacée ; les troubles intérieurs avaient recommencé au sujet de
la proposition Terentilla ; la peste sévissait avec une violence d’autant
plus meurtrière que les courses de l’ennemi remplissaient la ville, durant
les chaleurs de l’été, d’hommes et de troupeaux habitués à l’air pur des
montagnes[21].
En 462, une armée d’Èques et de Volsques campa à 3 milles de la porte
Esquiline ; trois ans plus tard une surprise de nuit livra pour un moment le
Capitole au Sabin Herdonius ; l’an d’après, Antium fit défection, et le
consul Minucius se laissa encore une fois enfermer par les Èques dans un
défilé. Cincinnatus parut seul capable de sauver la république. Il reprit le
Capitole et rendit aux Romains la forteresse qui était aussi leur sanctuaire
; dans cette circonstance, il s’était signalé par une sévérité qui lui avait
gagné la confiance du sénat : on l’élut dictateur.
Les sénateurs qui furent chargés de lui signifier cette
élection le trouvèrent au delà du Tibre, dans le champ qu’on appela longtemps
les prés de Quinctius. Il creusait un fossé et les reçut appuyé sur sa bêche.
Après les salutations accoutumées, ils le requièrent de mettre sa toge pour
recevoir une communication du sénat. Lui
s’étonne, demande si tout ne va pas pour le mieux et envoie sa femme,
Racilia, quérir sa toge dans la cabane. L’ayant revêtue, après avoir essuyé
la poussière et la sueur dont il était couvert, il revient vers les députés
qui le saluent maître du peuple, le félicitent et le pressent de se rendre à
la ville[22]. Si cette scène
n’est pas historique, elle est du moins dans les mœurs du temps et dans le
caractère du personnage. Ce qui suit montre le patricien, si fier de sa race,
prenant possession du pouvoir avec la même simplicité qu’il avait quitté sa
charrue et déployant l’activité et l’énergie de ces hommes faits pour le
commandement. Un bateau l’attendait sur le Tibre, il y monte et est reçu sur
la rive gauche par ses trois fils, ses proches et la plupart des sénateurs.
Avant le jour il descend au Forum, y nomme maître de la cavalerie un autre
patricien aussi pauvre que lui-même et ordonne que toutes les affaires soient
suspendues, que les boutiques se ferment, que les hommes en état de combattre
se trouvent au champ de Mars avant le coucher du soleil, chacun avec cinq
pieux et du pain pour cinq jours. Le soir venu, il part et fait 6 lieues en
quatre heures ; avant que le jour frit levé, les Èques étaient eux-mêmes
enfermés par un fossé et un rempart palissadé : ils furent réduits à passer
sous le joug. Rentré à Rome en triomphe, suivi du consul et de l’armée qu’il
avait sauvés, il força Minucius à se démettre de sa charge, fit briser devant
lui les faisceaux consulaires[23] et, le seizième
jour, déposa la dictature pour retourner à ses champs (457). Malgré ce succès que la vanité
nationale a embelli, comme tant d’autres points de l’histoire militaire de
Rome, la guerre n’était pas terminée : les Èques restaient en possession de
l’Algide, comme les Volsques du mont Albain.
Depuis un demi-siècle que les rois avaient été chassés, la
décadence de la puissance de Rome ne s’était pas un instant arrêtée. En 493
son territoire était au moins couvert par les Latins ; mais des trente villes
latines qui avaient signé le traité de Cassius, treize étaient maintenant ou
détruites ou occupées par l’ennemi et parmi elles quelques-unes des plus
fortes places de l’Italie, telles que Circei, au pied de son promontoire,
Setia, Cora et Norba[24], toutes trois
dans les montagnes des Volsques et entourées de puissantes murailles. Si l’ager Romanus n’était pas encore entamé, la
barrière qui devait le protéger avait été en partie détruite. Rome était-elle
plus heureuse, au nord contre les Étrusques ?

III. - GUERRE CONTRE VÉIES.
Une grande partie de l’Étrurie avait pris part à
l’expédition de Porsenna ; depuis ce temps les courses des Gaulois cisalpins
et la puissance croissante des Grecs et des Carthaginois avaient divisé
l’attention et les forces des villes étrusques : les unes veillant, au nord,
sur les passages de l’Apennin ; les autres, à l’ouest, sur les côtes menacées
par les pirates de Ligurie et, au sud-ouest, sur leurs colonies, qui leur
échappaient l’une après l’autre. La ligue s’était dissoute, et toute idée de
conquête vers le Latium avait été abandonnée. Mais Véies, éloignée des
Gaulois et de la mer, se trouvait trop près de Nome pour rie pas profiter de
son affaiblissement. Ce rie fut cependant qu’en 82 que la guerre éclata. Elle
dura neuf années. Oit n’a conservé que deux faits de cette guerre, plus
sérieuse cependant pour Rome que les courses des Èques et des Volsques : la
fondation, par les Romains, d’une forteresse sur les bords du Crémère, d’où
ils étendirent durant. deux années le ravage jusqu’aux murs de Véies, et
l’occupation du Janicule par les Véiens. On a déjà vu que les annalistes
romains faisaient honneur au patriotique dévouement des Fabius d’avoir seuls
tenu en échec toutes les forces ennemies jusqu’au jour où, surprise dans une
embuscade, la gens entière périt. Les
Véiens à leur tour portèrent l’incendie le long des deux rives du Tibre et
s’établirent sur le Janicule, d’où ils voyaient Rome à leurs pieds. Un jour,
ils passèrent le fleuve et vinrent attaquer les légions jusque dans le Champ
de Mars. Un vigoureux effort les repoussa ; le lendemain, pris entre deux
armées consulaires, ils furent enfin chassés du poste dangereux qu’ils
occupaient. La guerre se trouvait reportée sous les murs de Véies : une trêve
de quarante ans laissa les deux peuples dans la position où ils étaient avant
les hostilités (474).
Dans cette guerre, Véies n’avait pas été soutenue par les
grandes lucumonies du Nord dont l’attention était alors attirée vers d’autres
lieux où se décidait le sort de leurs rivaux. Tandis, en effet, que Rome
préludait à sa grandeur par ces luttes obscures et au pillage du monde par la
conquête d’un butin rustique, les armées de Xerxès ébranlaient l’Asie, et
trois cent mille Carthaginois, ses alliés, descendaient en Sicile (480). La victoire
de Thémistocle à Salamine sauva la
Hellade ; celle de Gélon à Himère assura la fortune de
Syracuse et des Grecs italiotes, qui disputaient aux Étrusques le commerce de
la mer Tyrrhénienne et de l’Adriatique. D’abord ils leur ferai tirent le
détroit de Messine ; puis, l’année qui précéda la trêve de quarante ans, ils
anéantirent leur flotte dans les eaux du cap Misène. Hiéron établit à l’île
d’Ischia une station pour ses galères, qui coupèrent les communications entre
les villes étrusques du Volturne et celles de l’Arno. Ainsi le peuple le plus
redoutable pour les anciens sujets de Porsenna, usait ses forces en des
guerres lointaines, ce qui permettait aux Romains de se livrer impunément à
tous les désordres de la liberté naissante.
Pendant ces premières années de la république, si fécondes
pour les restitutions, rien n’avait été fait pour la puissance. Rome, du
moins, avait duré en gagnant chaque jour force et confiance. Le territoire
proprement dit n’avait pas été entamé, et la population s’était aguerrie dans
ces luttes, au fond peu dangereuses. Les soldats qu’Appius décime sans
résistance, que Cincinnatus charge de cinq pieux, de leurs armes et de leurs
vivres pour une marche de près de vingt milles en quatre heures, sont déjà
les légionnaires qui vaincront les Samnites et Pyrrhus. Rome n’a donc, plus
maintenant à craindre pour son existence, compte au temps de Porsenna, et
elle a le droit d’espérer beaucoup.
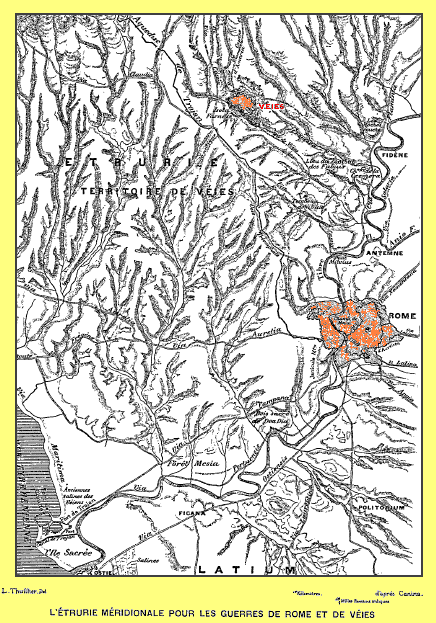
|