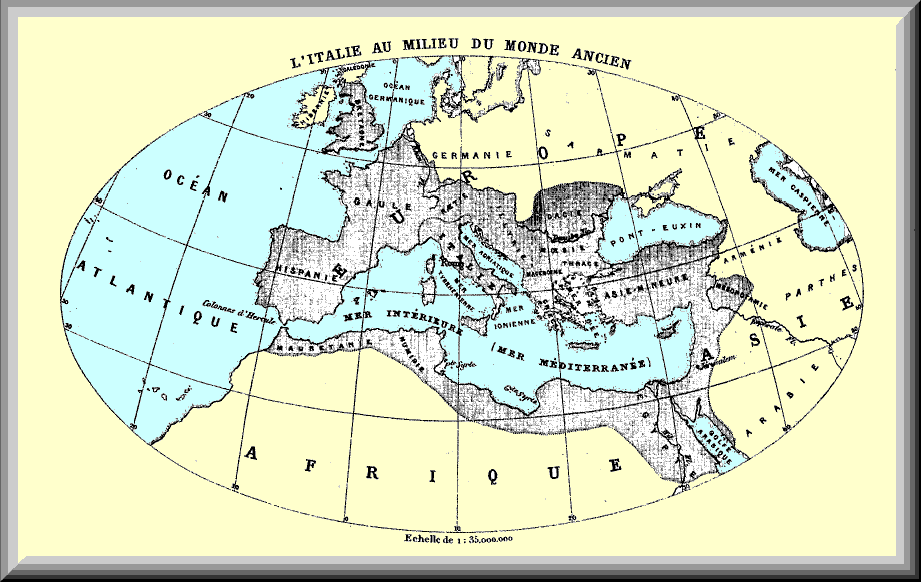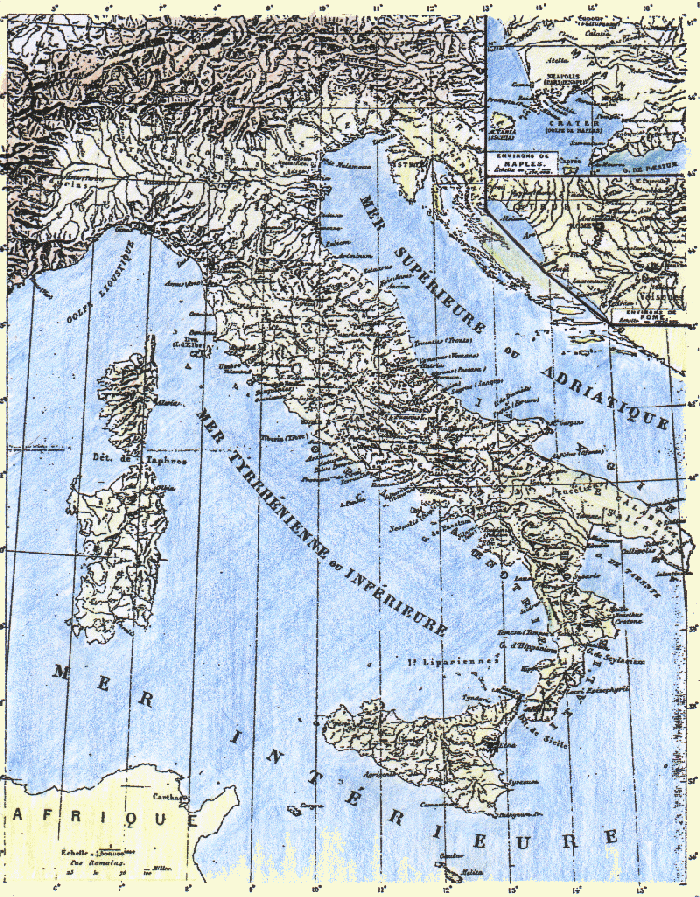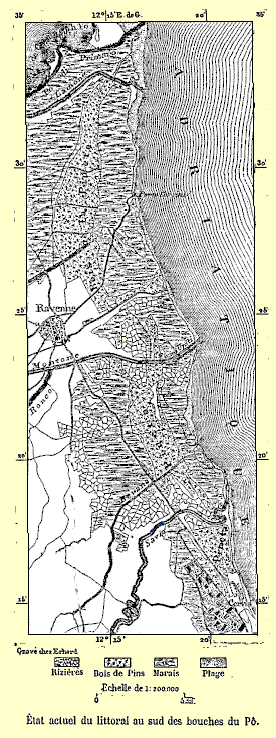|
I. Description géographique de
l’Italie
Horace avait peur de la mer ; il l’appelait l’élément qui sépare, Oceanus dissociabilis, et cependant elle était,
même pour les anciens, l’élément qui réunit.
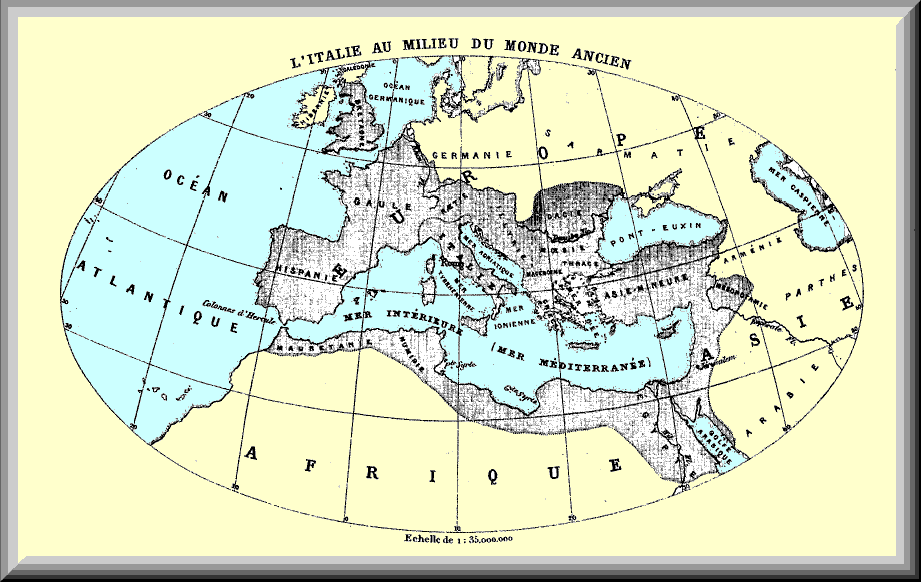
Suivez du regard les montagnes qui courent de la Galice au Caucase, de
l’Arménie au golfe Arabique, de la région des Syrtes aux colonnes d’Hercule,
et vous reconnaîtrez la partie supérieure d’un immense bassin dont la Méditerranée occupe
le fond. Ces limites marquées par la géographie sont aussi, pour l’antiquité,
les limites de l’histoire, qui jamais ne s’éloigna, si ce n’est vers la Perse, des côtes de la Méditerranée. Sans
cette mer, l’espace qu’elle couvre eût été la continuation du Sahara
africain, un infranchissable désert ; par elle, au contraire, les hommes
établis sur ses bords ont échangé leurs idées, leurs richesses, et c’est
autour d’elle qu’ont vécu les premiers peuples civilisés, moins les vieilles
sociétés de l’extrême Orient, qui sont toujours restées en dehors du
mouvement européen. Or, par sa position entre la Grèce, l’Espagne et la Gaule, par cette forme
allongée qui la porte à la rencontre de l’Afrique et la rapproche de l’Asie,
l’Italie est, à vrai dire, le centre du monde ancien, le point le plus voisin
à la fois des trois continents que la Méditerranée baigne et réunit.
La géographie n’explique jamais qu’une partie de
l’histoire, mais elle l’explique bien ; les hommes font le reste. Selon
qu’ils mettent en leur conduite de la sagesse ou de la folie, ils tournent à
bien ou à mal l’œuvre de la nature. Ainsi il est aisé de se rendre compte,
par la situation de l’Italie, de ses doubles destinées aux temps anciens et
jusqu’à une époque récente : l’action énergique qu’elle exerça au dehors
lorsque ses habitants ne formèrent qu’un seul peuple entouré de tribus
divisées, puis, quand ses forces furent épuisées et l’union détruite, les
malheurs qui fondirent sur elle de tous les points de l’horizon ;
l’Italie, en un mot, maîtresse du monde qui l’entoure, et l’Italie que tous
ses voisins se disputent.
Il est une autre considération importante. Si la place
occupée par l’Italie, au vrai centre de l’ancien monde, favorisa sa fortune
dans les jours de farce et lui valut tant d’ennemis dans sa faiblesse, cette
faiblesse même qui livra d’abord la péninsule aux Romains et, après eux,
durant quatorze siècles, à l’étranger, n’est-ce pas sa conformation physique
qui en a été la cause principale ?
Entourée de trois côtés par la mer, du quatrième par les
Alpes, l’Italie est une presqu’île qui s’allonge au sud en deux pointes,
tandis qu’elle s’élargit au nord en un demi-cercle de hautes montagnes, que
domine majestueusement, avec ses neiges étincelantes, la cime quelquefois
appelée par les Lombards la
Rosa dell’ Italia. Sans le mont Blanc, le mont Rose serait
le sommet le plus élevé des Alpes, mais il ne s’abaisse que de 176 mètres au-dessous
du géant de l’Europe[1].
L’Italie a donc une partie péninsulaire et une partie continentale : deux
régions distinctes par leur configuration, leur origine et leur histoire.
L’une, vaste plaine, traversée par un grand fleuve qui l’a formée de ses
alluvions, a été, dans tous les temps le champ de bataille des ambitions
européennes ; l’autre, étroite chaîne de montagnes ravinée par des rivières
torrentueuses et secouée par les volcans, a presque toujours eu des destinées
contraires.
Cette presqu’île, c’est la véritable Italie, un des pays
les plus divisés qu’il y ait au monde. Dans ses innombrables vallées, dont
beaucoup communiquent difficilement entre elles, ses peuples ont pris cet
amour de l’indépendance qu’ont montré dans tous les temps les populations des
montagnes, et aussi ce qui compromet cette liberté tant aimée, le besoin de
la vie à l’écart : autant d’États que de vallées, autant de dieux que de
villages. Jamais l’Italie ne serait sortie de son obscurité, si, du milieu de
toutes ces tribus, ne s’était dégagé un principe énergique d’association. A
force d’habileté, de courage et de persévérance, le sénat et ses légions
triomphèrent des obstacles physiques, comme des intérêts et des passions qui
s’étaient formés derrière ces abris ; ils réunirent tous les peuples italiens
et firent de la péninsule entière une seule cité[2].
Mais, comme le chêne abaissé et entrouvert par Milon, qui
se relève quand les forces de l’athlète vieilli s’épuisent et qui le saisit à
son tour, la nature, un moment vaincue par l’énergie romaine, reprit son
empire, et, quand Rome tomba, l’Italie, rendue à elle-même, retourna à ses
éternelles divisions, jusqu’au jour où l’idée moderne des grandes
nationalités fit pour elle ce que, vingt-trois siècles auparavant, avait fait
la politique la plus habile servie par la plus puissante organisation
militaire.
L’Italie était donc destinée, par sa position
géographique. à jouer un grand rôle dans les affaires du monde, soit qu’elle
agit au dehors, soit qu’elle devînt elle-même le prix de luttes héroïques.
Aussi Rome n’est pas un accident, un hasard, dans l’histoire de la péninsule
; c’est le moment où les Italiens, pour la première fois réunis, ont atteint
le but promis à leurs communs efforts : la puissance par l’union. Sans doute
l’histoire a été souvent forcée de dire, comme Napoléon : L’Italie est trop longue et trop divisée !
Mais lorsque, des Alpes au canal de halte, il ne se trouva plus qu’un seul
peuple et un même intérêt, une fortune incomparable devint le lot glorieux de
ce beau pays, qui avait 600 lieues de côtes, avec de braves populations de
montagnards et de marins, des provinces fécondes et des ports naturels au
pied de forêts séculaires, qui commandait à deux mers et tenait la clef du
passage de l’un à l’autre des deux grands bassins de la Méditerranée. Entre
l’Orient, qui s’effondrait dans l’anarchie, et l’Occident, qui n’était pas
encore né à la civilisation, l’Italie, unie et disciplinée, prit
naturellement la première place Cette phase de l’humanité a mis dix siècles à
naître, grandir et s’étendre, et l’histoire de ces dix siècles est ce qu’on
appelle l’histoire de Rome.
Un poète moderne a fait en un seul vers l’exacte
description de ce pays :
Ch’ Apennin parte e ‘l mar circonda e l’Alpe.
Les Alpes, qui séparent l’Italie du reste de l’Europe,
ont, de Savone à Fiume, un développement de 1150 kilomètres
environ ; leur épaisseur est de 130 à 180 kilomètres
sous les méridiens du Saint-Gothard et du Septimer, de plus de 1260 dans le
Tyrol[3].
Les neiges éternelles entassées sur leurs cimes forment une immense mer de
glace dont la fonte alimente les fleuves de la haute Italie et qui trace sur
le ciel son profil éclatant. Mais la ligne de faîte, plus rapprochée
de l’Italie que de l’Allemagne, ne partage pas cet épais massif en deux
portions égales. Comme toutes les grandes chaînes des montagnes européennes[4],
les Alpes ont leur pente moins rapide au nord, par où sont venues toutes les
invasions, et leur escarpement au sud, du côté qui les a toutes reçues[5].
Sur le versant français et allemand, les montagnes vont à la plaine par de
longs contreforts qui ménagent la descente, tandis que, vu du Piémont, le
mont Blanc se présente comme un mur de granit taillé à pic jusqu’à plus de 3000 mètres
au-dessous de la cime. L’homme s’est arrêté au pied de ces pentes qui ne
retiennent ni l’herbe ni la neige; et l’Italie septentrionale, qui a peu de
pâturages alpestres, n’est pas défendue par une race de vaillants montagnards
comme celle qui couvre le Dauphiné, la Suisse et le Tyrol[6].
Dans cette différence d’inclinaison et d’étendue entre les
deux versants, se trouve une des causes qui ont assuré les premiers succès
des expéditions dirigées contre l’Italie. Maîtres du versant septentrional,
les assaillants n’ont besoin que d’un jour ou deux de marche pour descendre
clans le plus riche pays[7].
Aussi l’Italie ne put-elle jamais échapper aux invasions ni rester en dehors
des guerres européennes, malgré sa formidable barrière des Alpes et leurs
cimes colossales, qui, vues de près, disait
Napoléon, semblent des géants de glace chargés de
défendre l’accès de la belle contrée[8].
Aux Alpes se rattachent, près de Savone, les Apennins, qui
traversent toute la péninsule, ou plutôt qui l’ont formée et qui lui donnent
son caractère. Leur altitude moyenne en Ligurie est de 1000 mètres, du
double en Toscane, où les cols de Pontremoli, entre Sarzane et Parme, de
Fiumalbo, entre Lucques et Modène, de Futa, entre Florence et Bologne sont à
une hauteur de 1000 à 1200
mètres : ce qui explique pourquoi l’Étrurie fut
longtemps protégée par ces montagnes contre les Gaulois cisalpins et quelques
mois contre Hannibal.
Les cimes les plus élevées de toute la chaîne apennine se
trouvent, à l’est de Rome, dans le pays des Marses et des Vestins : le Velino,
2487 mètres,
et le Monte Corno, 2302, d’où l’on découvre les deux mers qui baignent
l’Italie et les monts d’Illyrie sur la rive orientale de l’Adriatique. A
cette hauteur, un pie des Alpes ou des Pyrénées se-rait couvert de neiges
éternelles; sous la latitude de Rome, ce n’est pas assez pour la formation
d’un glacier, et le Monte Corno n’a plus de neiges à la fin de juillet ;
mais il a toujours les paysages alpestres, et les ours, les chamois des
grandes montagnes.
Trois branches se séparent, à l’ouest, de la chaîne
centrale et couvrent de leurs ramifications une partie considérable de
l’Étrurie, du Latium et de la
Campanie. Un de ces rameaux, après s’être abaissé jusqu’au
niveau de la plaine, se relève à son extrémité en un roc presque insulaire,
le promontoire de Circé (Monte
Circello), où l’on montre la grotte de la puissante magicienne.
Tibère, qui, en fait de démons, ne craignait ni ceux du passé ni ceux du
présent, se fit construire une villa près de ce lieu redouté.
Du versant oriental de l’Apennin, il ne se détache que des
collines qui descendent en ligne droite vers l’Adriatique. Mais, comme le
Vésuve sur la côte opposé (1052 mètres),
le Monte Gargano forme, au-dessus du golfe de Manfredonia, un groupe
isolé, dont une cime s’élève à 1614 mètres. D’antiques forêts couvrent cette
montagne, toujours battue par les vents impétueux qui labourent l’Adriatique.
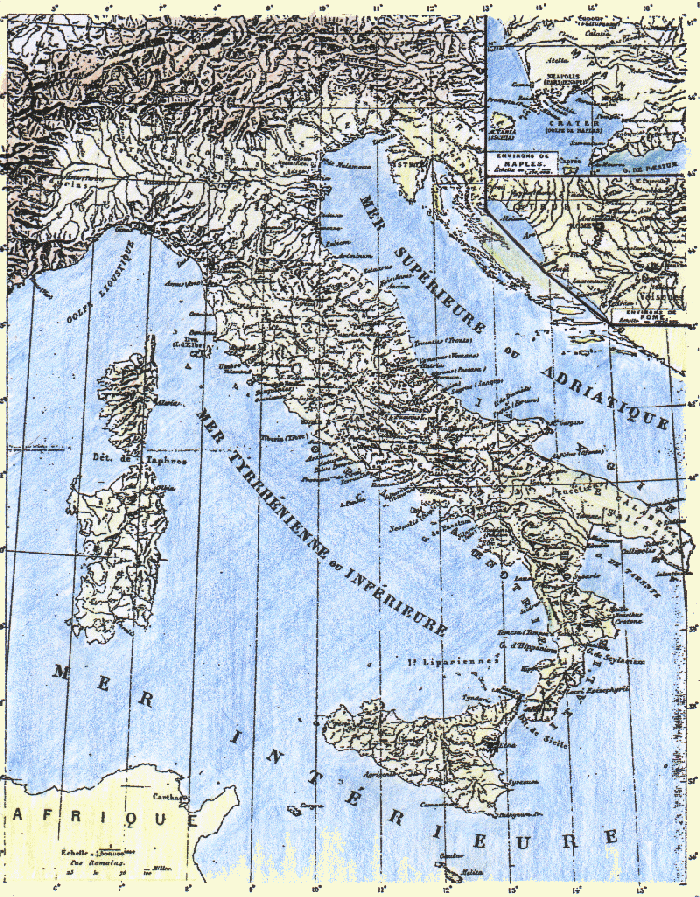
Au-dessous de Venosa (Venusia), l’Apennin se divise en
deux branches qui entourent le golfe de Tarente : l’une parcourt les terres
de Bari et d’Otrante, et va mourir en pente douce au cap de Leuca ; l’autre
forme, à travers les Calabres, une suite de plateaux ondulés dont un seul, la Bila, haut de 1500 mètres, n’a pas
moins de 80
kilomètres de long, de Cosenza à Catanzaro. Couverte
autrefois d’impénétrables forêts, la
Sila était l’asile des esclaves fugitifs (Bruttiens), et fut
la dernière retraite d’Hannibal en Italie, Aujourd’hui de beaux pâturages ont
en partie remplacé ces forêts, d’où Rome et Syracuse tiraient des bois de
construction. Mais la température y est toujours basse pour un pays italien,
et, malgré une latitude de 38 degrés, la neige y séjourne six mois de l’année[9].
Plus au sud encore, une des cimes de l’Aspromonte mesure 1335 mètres
d’altitude. Aussi, tandis qu’au delà du cap de Leuca il n’y a plus que la mer
d’Ionie, par delà le phare de Messine c’est l’Etna et le triangle des
montagnes siciliennes, évidente continuation de la chaîne apennine.
Les
deux versants de l’Apennin ne différent pas moins que les deux revers des
Alpes[10]. Sur l’étroite côte
que baigne la mer Supérieure ou Adriatique sont de gras pâturages, des
collines boisées que séparent les lits profonds des torrents, un rivage uni,
point de port (importuosum littus),
point d’îles au large[11], et une mer
orageuse, enfermée entre deux chaînes de montagnes, comme une longue vallée
où les vents s’engouffrent et s’irritent de tous les obstacles qu’ils
rencontrent. A l’ouest, au contraire, l’Apennin s’éloigne de la mer, et de
grandes plaines, traversées par des fleuves au cours tranquille, des golfes
immenses, des ports naturels, des îles nombreuses et une nier souvent
paisible, invitent à l’agriculture, à la navigation, au commerce. De là trois
populations distinctes et ennemies : les marins prés des ports, les
laboureurs dans la plaine, les pâtres dans la montagne, ou, pour les appeler
par leur nom historique, les Grecs italiotes et les Étrusques, Rome et les
Latins, les Marses et les Samnites[12].
Ces plaines de la Campanie, du Latium, de l’Étrurie et de la Pouille, ne couvrent
cependant, malgré leur étendue, qu’une bien faible partie de la péninsule,
qui se présente, dans son caractère le plus général, comme un pays hérissé de
montagnes et coupé d’étroites vallées. Comment s’étonner qu’on voie si
longtemps le morcellement politique sur un sol que la nature elle-même a tant
divisé ! Ælien y comptait jusqu’à 1197 cités dont chacune avait eu ou avait
rêvé une vie indépendante.
Les Apennins n’ont ni glaciers, ni grands fleuves, ni les
aiguilles élancées des Alpes, ni les finasses colossales des montagnes
pyrénéennes. Leurs cimes nues et tourmentées, leurs flancs souvent décharnés
et stériles, les profondes et sauvages ravines qui les sillonnent,
contrastent avec la douceur des contours et la riche végétation des montagnes
subapennines. Ajoutez, à chaque pas, de belles ruines rappelant d’imposants
souvenirs, l’éclat du ciel, les grands lacs, les rivières qui tombent des
montagnes, les volcans avec des capitales à leur pied, et, partout à
l’horizon, la mer qui scintille, calme et unie, ou terrible, quand ses vagues
soulevées par le sirocco ou par des convulsions sous-marines viennent
déchirer la côte et prendre un jour Amalfi, un autre Baïa ou Pæstum.
L’Europe n’a de volcans en activité que dans la péninsule
et les îles italiennes. Dans l’antiquité, les feus souterrains agissaient
depuis les Alpes carniques, on l’on a reconnu des roches d’origine ignée,
jusqu’à l’île de Malte, dont une partie s’est abîmée dans la mer[13].
Les montagnes basaltiques du Tyrol méridional, du
Véronais, du Vicentin et du Padouan ; près du Pô, la catastrophe de
Velleja ensevelie par un tremblement de terre ; dans la Toscane, les bruits
souterrains, les continuels ébranlements du sol et ses déchirements subits
qui faisaient de l’Étrurie la terre des prodiges ; sur les bords du
Tibre, la tradition de Cacus vomissant des flammes[14],
le gouffre de Curtius, les déjections volcaniques qui forment le sol même de
Rome et toutes ses collines, le Janicule excepté ; les coulées de laves
descendues des collines d’Albe et de Tusculum ; l’immense cratère (60 kilomètres de
tour) dont le bord effondré laisse voir le lac charmant d’Albano et
celui de Nemi que les Romains appelaient le Miroir de Diane ; la légende
de Cæculus élevant à Préneste des murailles de flammes ; l’énorme entassement
de laves et de débris que portent les flancs du Volture[15]
; les îles sorties de la mer, dont parie Tite Live ; les champs Phlégréens,
les antiques éruptions de file d’Ischia, du Vésuve et de l’Etna, et tant de
cratères éteints, montrent l’Italie tout entière comme ayant été autrefois
placée sur un immense foyer volcanique.
Aujourd’hui l’activité des feux souterrains semble s’être
concentrée au milieu de cette ligne, dans le Vésuve dont les éruptions
menacent toujours Ies charmantes villes qui s’obstinent à vivre près de ce
voisin redoutable ; dans l’Etna, qui, par une de ses convulsions,
arracha la Sicile
de l’Italie[16],
et clans les îles Lipariennes placées au centre de la sphère d’ébranlement de
la Méditerranée. Au
nord, on ne trouve plus que des cratères à demi comblés[17],
les collines volcaniques de Rome, de Viterbe et de Sainte-Agathe, près de
Sessa, les eaux charades et les sources inflammables de la Toscane, les feux ou fontaines ardentes de Pietra Mala et de
Barigazzo, ceux enfin du jardin d’Enfer,
Orio dell’ Inferno[18].
Avant
l’année 79 de notre ère, le Vésuve semblait un volcan éteint ; la
population et la culture étaient montées jusqu’à son sommet, lorsque, se
ranimant tout à coup, il ensevelit Herculanum, Pompéi et Stabies sous une
masse énorme de cendres et de débris. En 473, suivant Procope, telle fut la
violence de l’éruption, que les cendres emportées par les vents allèrent
jusqu’à Constantinople. En 1794, un de ces courants de laves incandescentes
qui ont parfois 14.000
mètres de longueur sur 100 à 400 de largeur, et une
épaisseur de 8 à 10, détruisit la belle ville de Torre del Greco. Des pierres
étaient lancées à 1200
mètres, des gaz méphitiques détruisaient au loin toute
végétation, et, à la distance de 16 kilomètres, on
ne marchait en plein jour qu’aux flambeaux.
M. de Humboldt a remarqué que la fréquence des éruptions
est en raison inverse de la grandeur du volcan. Depuis que le cratère du
Vésuve a diminué, ses éruptions, moins violentes, sont devenues presque
annuelles. L’effroi a cessé ; la curiosité reste. De toutes parts les riches
voyageurs accourent, et les Napolitains, qui oublient vite, disent de leur
volcan, tout en exhumant Herculanum et Pompéi : C’est
la montagne qui vomit de l’or.
En 1669, les habitants de Catane ne croyaient pas non plus
aux vieux récits sur les fureurs de l’Etna, lorsqu’une immense coulée de lave
descendit vers leur ville, en franchit les murailles et alla former dans la
mer, en avant du port, une digue gigantesque. Heureusement, ce formidable
volcan, dont la base a prés de 180 kilomètres de circonférence, d’où l’on
découvre un horizon de 1200 kilomètres, et qui s’est élevé lui-même
par l’entassement successif de ses laves à 3300 mètres, n’a que
d’assez rares éruptions. Stromboli, au contraire, dans les îles Lipariennes,
se signale au loin, la nuit par sa couronne de flammes, le jour par l’épaisse
fumée qui l’enveloppe.
Enfermée entre l’Etna, le Vésuve et Stromboli, comme dans
un triangle de feu, l’Italie méridionale est souvent ébranlée jusque dans ses
fondements. Dans les trois derniers siècles, on n’a pas compté moins d’un
millier de tremblements de terre, comme si cette partie de la péninsule
reposait sur une couche de laves mouvantes. Celui de 1538[19]
fendit le sol près de Pouzzoles, et il en sortit le Monte Nuovo, haut de 140 mètres, qui combla
le lac Lucrin, dont un petit étang marque aujourd’hui la place. En 1783, la Calabre tout entière fut
bouleversée, et quarante mille personnes périrent. La mer elle-même prit part
à ces horribles convulsions : elle recula, puis revint haute de 13 mètres. Parfois des
îles nouvelles surgissent : ainsi sont apparues, l’une après l’autre, toutes
les îles Lipariennes. En 1831, un vais-seau de guerre anglais ressentit en
pleine mer, sur les côtes de la
Sicile, de violentes secousses et crut avoir touché ;
c’était un volcan qui s’ouvrait. Quelques jours après, une île se montra,
hante de 10 mètres.
Déjà Anglais et Napolitains se la disputaient, quand la mer reprit dans une
tempête ce que le volcan avait donné[20].
Pour l’Italie du sud, le danger est dans les feux
souterrains; pour celle du nord et de l’ouest, il est dans les eaux, ici
stagnantes et pestilentielles, là débordées, inondant les campagnes et
ensablant les ports. De Turin à Venise la riche plaine que traverse le Pô,
entre l’Apennin et les Alpes, n’offre pas une colline : aussi les torrents
qui se précipitent de cette ceinture de montagnes neigeuses l’exposent, dans
leurs débordements, à d’affreux ravages[21].
Ce sont eux qui l’ont créée, en comblant de leurs alluvions le golfe que
l’Adriatique formait et dont l’existence est prouvée par les débris d’animaux
marins retrouvés aux environs de Plaisance et de Milan[22],
même par des pois-sons de l’Océan qui vivent encore dans ses lacs.
Descendu du mont Viso et rapidement accru par les eaux qui
s’écoulent des flancs du géant alpestre[23],
le Pô est le plus grand fleuve de l’Italie et un des plus célèbres du monde.
S’il avait un libre débouché dans l’Adriatique, il ouvrirait à la navigation
et au commerce un magnifique territoire. Mais la condition de tous les
fleuves descendant à des mers qui, comme la Méditerranée, n’ont
ni flux ni reflux est d’être impropre à la navigation maritime. Les torrents
italiens arrivent au Pô chargés de limon et de sables qui exhaussent son lit[24],
et forment, à son embouchure, ce delta devant lequel la mer recule chaque
année de 70 mètres.
Adria, qui précéda Venise dans la domination de l’Adriatique, est aujourd’hui
à plus de 30
kilomètres dans les terres ; Spina, autre grande
cité maritime, était dès le temps de Strabon à 30 stades de la côte
qu’autrefois elle touchait[25] ;
et Ravenne, station des flottes impériales, n’est plus entourée que de bois
et de marais. Venise aussi a trop longtemps laissé engorger les canaux de ses
lagunes par les atterrissements de la Brenta. Le
port du Lido, par où sortit la flotte qui portait quarante mille croisés,
n’est maintenant abordable que pour les plus petits navires, et celui
d’Albiola s’appelle le Porto secco.
L’extrémité
nord-est de l’Italie est enveloppée d’un demi-cercle de montagnes qui
envoient à l’Adriatique plusieurs cours d’eau[26]
dont les lits profondément ravinés facilitent la défense contre une invasion
partie des Alpes juliennes. De tous ces obstacles le dernier et le plus
redoutable est l’Adige, large déjà au sortir des monts comme un puissant
fleuve.
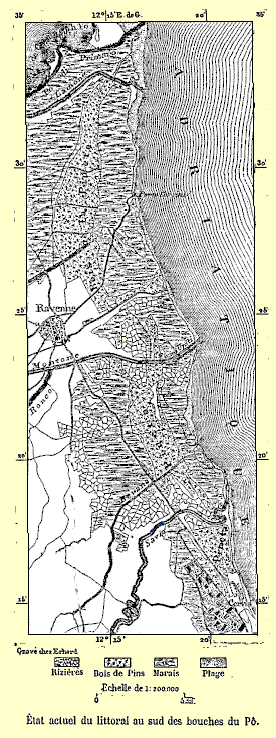
Dans l’Italie péninsulaire, l’Apennin est trop rapproché
des deux mers pour leur envoyer de grands fleuves. Cependant l’Arno a 250 kilomètres de
cours, et le Tibre 370. Mais ce roi des fleuves de l’ancien monde est d’un
triste aspect ; ses eaux, constamment chargées de pouzzolane rougeâtre,
ne peuvent servir ni à la boisson ni au bain, et, pour y suppléer, il fallut
amener dans la ville, par de nombreux aqueducs, l’eau des montagnes voisines.
De là un des caractères de l’architecture romaine : des arcs de triomphe et
des voies militaires pour les légions, des cirques et des aqueducs pour les
villes. Au reste, tous ces cours d’eau de l’Apennin ont le caractère
capricieux des torrents[27]
: larges et rapides au printemps, ils se dessèchent en été et restent dans
tous les temps à peu près inutiles pour la navigation[28].
Mais que de beautés pittoresques le long de leurs rives et dans les vallées
d’où leurs affluents descendent. Les cascatelles de Tivoli, une des plus
charmantes choses qu’on puisse voir, font un délicieux contraste avec la
grandeur farouche de la campagne romaine, et, près de Terni, à la cascade delle
Marmore, le Velino tombe dans la
Nera d’une hauteur verticale de 165 mètres, puis court
en bondissant entre les roches énormes qu’il a détachées de la montagne.
Tous les lacs de la haute Italie sont, comme ceux de la Suisse, de creuses
vallées (lac majeur 62 kilomètres, de
Como 55, d’Iseo 22, de Garda 53), où les eaux des montagnes se sont
accumulées jusqu’à ce qu’elles aient rencontré, dans la ceinture des rochers
et des terres, l’échancrure par où elles se sont échappées en donnant
naissance à des fleuves. Ceux de la péninsule, au contraire, remplissant
d’anciens cratères ou des bassins encaissés entre des montagnes, n’ont point
d’émissaires naturels et menacent souvent d’inonder, après les longues pluies
ou à la fonte des neiges, les campagnes voisines : ainsi, le débordement du
lac d’Albano, signal de la chute de Véies, et ceux du lac Fucin, qui montait
parfois de 16 mètres
et qu’on vient de dessécher. D’autres, comme le lac de Bolsena, sorte de mer
intérieure qui a 40
kilomètres de circonférence, et le lac fameux de
Trasimène, résultent d’un effondrement du sol[29].
Les pluies ont rempli ces cavités naturelles, et, comme les montagnes du
voisinage sont peu élevées, elles y envoient tout juste assez d’eau pour
compenser la perte produite par l’évaporation. C’est à peine s’il en sort
d’insignifiantes rivières. La plus grande profondeur du lac de Trasimène ne
va pas à 30 pieds
aussi aura-t-il bientôt le sort du lac Fucin.
Des eaux stagnantes couvrent une partie du littoral à l’ouest
et au sud : c’est le royaume, de la fièvre. Pline le Jeune parle de
l’insalubrité des côtes d’Étrurie, où recommençait déjà la Maremme que les
Étrusques avaient une première fois desséchée. Dans le Latium, la mer s’était
autrefois étendue jusqu’au pied des monts de Setia et de Privernum à 16.000 mètres de
son rivage actuel[30] ;
et du temps de Strabon, toute la côte d’Ardée à Antium était marécageuse et
insalubre ; au delà d’Antium commençaient les marais Pontins. La Campanie avait les
marais de Minturnes et de Linternum. Plus au sud, les Grecs de Buxentum,
d’Élée, de Sybaris et de Métaponte avaient creuser mille canaux pour
dessécher le sol, avant d’y mettre la charrue. L’Apulie, jusqu’au Volture,
avait été une vaste lagune, comme les pays voisins des bouches du Pô, jusqu’à
100 milles au sud de son embouchure moderne[31].
La Lombardie
fut longtemps aussi un immense marais, et l’on attribuait aux Étrusques les
premiers endiguements du Pô. Les bords de la Trébie, les territoires
de Parme, de Modène, de Bologne, ne furent desséchés qu’après les travaux
Æmilius Scaurus, qui, durant sa censure (109), creusa des canaux navigables entre
Parme et Plaisance[32].
Rien de charmant et de perfide comme ces plaines de la mal’aria :
ciel limpide, terre féconde où ondule sous la brise de mer un océan de
verdure ; partout le calme et le silence, titi air doux et tiède qui
semble apporter la vie, et qui donne la mort. Dans la Maremme, dit le
proverbe italien, on s’enrichit en un an, mais on
meurt en six mois.
…… La Maremma
Dilettevole
molto e poco sana.
Combien
de peuples autrefois heureux et puissants y dorment leur dernier sommeil ! Les cités aussi peuvent mourir, oppida posse mori,
disait le poète Rutilius, en contemplant, il y a quinze siècles, les ruines
croulantes d’une puissante ville d’Étrurie.
Contenir et diriger les eaux fut donc pour les Italiens non
seulement un moyen, comme pour les autres peuples, de gagner des terres à
l’agriculture, mais une question de vie ou de mort. Ces lacs au sommet des
montagnes, ces rivières débordant chaque printemps ou changeant de lit, ces
marais qui, sous le soleil italien, enfantent si vite la peste, les
condamnaient à de constants efforts. Dés qu’ils s’arrêtèrent, ce qu’ils
avaient péniblement conquis retourna à sa première nature[33].
Aujourd’hui Baïa, le délicieux séjour des nobles romains ; Pæstum, avec
ses champs de roses tant, aimés d’Ovide, tepidi
rosaria Pæsti ; la riche Capoue, et Cumes qui fut un temps la
plus puissante cité de l’Italie, et Sybaris qui en était la plus voluptueuse,
sont au milieu d’eaux stagnantes et fétides, dans la plaine fiévreuse, febbrosa, où la terre
pourrie mange plus d’hommes qu’elle ne peut en nourrir. Les miasmes
pestilentiels, la solitude et le silence ont aussi reconquis les bords du
golfe de Tarente, autrefois couverts de tant de villes ; et la lèpre,
l’éléphantiasis, montrent, dans la
Pouille et les Calabres, les maladies hideuses des régions
intertropicales où errent des eaux sauvages.
Dans la Toscane,
100 kilomètres
de côtes ; dans le Latium, 130 kilomètres carrés de pays, furent
abandonnés aux influences délétères. Cette fois la colère de l’homme aida
celle de la nature. Rome avait ruiné l’Étrurie et exterminé les Volsques ;
mais les eaux envahirent le pays dépeuplé ; la mal’aria, gagnant de
proche en proche, de Pise jusqu’à Terracine, s’étendit sur Rome même, et la
ville éternelle expie maintenant, au milieu de son désert et sous son ciel
insalubre, la guerre impitoyable que faisaient ses légions[34].
Au point où se rencontraient naguère la Maremme de Toscane et celle des États de
l’Église, s’étend la plus triste des solitudes : pas une hutte, pas un arbre,
mais d’immenses champs d’asphodèle, la plante des tombeaux. Un jour, il y a
cinquante ans, un bœuf, de son pas pesant, fit écrouler une voûte cachée sous
l’herbe: c’était une chambre funéraire qui s’ouvrait. On continua les
fouilles ; en peu de temps 2000 vases ou objets d’art en sortirent, et la
civilisation étrusque était retrouvée[35].
Mais la riche cité qui avait enfoui tant de merveilles dans ses sépulcres,
aucun des historiens de Rome n’avait prononcé son nom, et nous ne le
connaîtrions pas sans une inscription qui mentionne sa défaite et le triomphe
de son vainqueur[36].
Les Vulcientes avaient livré la dernière bataille de la liberté
étrusque. Quelles lourdes mains que celles de Rome et du temps, et que de
florissantes cités elles ont détruites ! Mais aussi que de surprises réserve
à l’avenir le sol italien, quand la mal’aria en sera chassée et que
les villes tuées par elle livreront leurs secrets[37]
!
Touchant aux grandes Alpes et voisine de l’Afrique,
l’Italie a tous les climats, et peut avoir toutes les cultures. Sous ce
double rapport, elle se divise en quatre régions : la vallée du Pô, les
pentes de l’Apennin tournées vers la mer de Toscane, les plaines de la
presqu’île et les deux pointes qui la terminent[38].
Les Calabres, la Pouille et une partie de la côte des Abruzzes
ont presque le ciel et les productions de l’Afrique : un climat pur et sec,
mais brûlant, et le palmier, qui, à Reggio, mûrit parfois ses fruits,
l’aloès, le caroubier, l’oranger, le citronnier ; sur les côtes, des oliviers
qui font, comme autrefois, la richesse du pays ; plus haut, jusqu’à six cents
mètres, des forêts de châtaigniers qui couvrent une partie de la Sila. Mais de Pise
jusqu’au milieu de la
Campanie, entre la mer et le pied des montagnes, règne le mauvais
air ; abandonné aux pâtres, et pourtant très fertile, il attend le
travail de l’homme pour rendre ce qu’il donnait jadis. Déjà, dans la Toscane, le colmatage
fait reculer la Maremme,
qui, sur les points assainis, se repeuple.
Au-dessus
de ces plaines s’étend, sûr les premières pentes de l’Apennin, de la Provence à la Calabre, la région des
oliviers et des mûriers, des arbousiers, des myrtes, des lauriers et de la
vigne. Celle-ci pousse avec tant de vigueur qu’on la voit s’élever jusqu’à la
cime des peupliers qui la soutiennent, et que du temps de Pline on montrait à
Populonia une statue de Jupiter taillée dans un cep de vigne. Plus haut, dans
la montagne, les noyers, les chênes, les hêtres ; puis les pins, les
mélèzes, la neige longtemps arrêtée et le vent glacial, feraient penser à la Suisse, si l’on n’était
partout inondé de l’éblouissante lumière du ciel italien.
Mais c’est dans la vallée du Pô, à la descente des Alpes,
que le voyageur reçoit ses premières et ses plus douces impressions. De Turin
jusqu’au delà de Milan, il a toujours en vue à l’horizon la ligne des
glaciers, que le soleil couchant colore de vives teintes de pourpre et fait
resplendir comme un magnifique incendie qui courrait le long des flancs et
sur les sommets des montagnes. Malgré le voisinage de ces neiges éternelles,
le froid ne descend pas loin sur cette pente rapide, et quand le soleil
plonge dans le cirque immense de la vallée du Pô, ses rayons, arrêtés et
réfléchis par la muraille des Alpes, élèvent la température, et d’étouffantes
chaleurs succèdent presque subitement à l’air glacial des hautes cimes[39].
Mais l’abondance des eaux, la rapidité de leur cours, la direction de la
vallée qui s’ouvre sur l’Adriatique et en reçoit toutes les brises,
rafraîchissent l’atmosphère et donnent à la Lombardie le plus
délicieux climat. L’inépuisable fécondité du sol, engraissé par le limon que
tant de fleuves ont apporté, développe partout une végétation
puissante ; en une nuit, dit-on, l’herbe broutée la veille repousse[40],
et la terre, qu’aucune culture n’épuise, ne se repose jamais.
Tel est l’aspect général de l’Italie. — Pays de
continuelles oppositions : plaines et montagnes ; neiges et soleil
brûlant ; torrents desséchés ou impétueux ; lacs aux eaux limpides,
dans le fond de vieux cratères, et marais pestilentiels, dont l’herbe cache
des cités autrefois populeuses. — A chaque pas un contraste : la végétation
africaine au pied de l’Apennin, la végétation du Nord sur les cimes. — Ici,
sous le ciel le plus pur, la mal’aria, qui tue en une nuit le voyageur
endormi ; là des terres d’une intarissable fécondité[41],
et au-dessus le volcan avec ses laves menaçantes. — Ailleurs, sur un espace
de quelques lieues, soixante-neuf cratères et trois villes ensevelies. — Au
nord, des fleuves qui noient les campagnes et refoulent la mer ; au sud,
des tremblements de terre qui ouvrent des abîmes ou renversent des montagnes.
— Tous les climats, tous les accidents du sol réunis; en un mot, une image
réduite du monde ancien[42],
et cependant d’une originalité puissante.
Au milieu de cette nature capricieuse et mobile, mais
partout énergique dans le bien comme dans le mal, viendront des hommes dont
la diversité d’origine sera constatée dans les pages suivantes; mais dès à
présent, nous savons, par l’étude du sol italien, que la population placée
dans des conditions de territoire et de climat qui varient à chaque canton,
ne sera point soumise à une de ces influences physiques dont l’action, toujours
la même, produit les civilisations uniformes et réfractaires aux influences
du dehors.
Dans cette description générale de l’Italie nous avons
souvent passé, sans nous y arrêter, près de ces collines de Rome, qui, malgré
leur modeste allure, dépassent en renommée les plus orgueilleuses cimes du
monde. Elles méritent une étude particulière.
La terre est un grand livre où la science étudie des
révolutions à côté desquelles les nôtres ne sont que jeux d’enfants. Quand le
géologue interroge le sol de Rome et de ses environs, il le voit formé, comme
le reste de la péninsule, par la double action des volcans et des eaux. On y
a trouvé des restes d’éléphants, de mastodontes, de rhinocéros et
d’hippopotames, preuve qu’à un certain moment des temps géologiques le Latium
faisait partie d’un vaste continent soumis à une température africaine et où
de puissants fleuves couraient à travers des plaines immenses. A une autre
époque, quand les glaciers descendaient si loin dans la vallée du Pô et que
l’Adriatique arrivait au voisinage de leurs moraines terminales, la mer de
Toscane couvrait aussi la campagne romaine. Elle y formait un golfe
demi-circulaire dont le Soracte et le promontoire Circéien étaient les
extrémités[43].
Au fond de cette mer primordiale s’ouvrirent des volcans
dont les laves fluides furent déposées par les flots en couches horizontales
qu’aujourd’hui on retrouve mêlées à des débris organiques depuis Rome jusqu’à
Radicofani. Ces laves, agglutinées par les eaux et le temps, sont devenues le
péperin, tuf compacte dont la
Rome royale et républicaine a été bâtie ; quand elles sont
restées à l’état granuleux, elles ont donné la pouzzolane qui a servi
à faire le ciment si tenace des murailles romaines. Cette pouzzolane forme
les sept collines de la rive gauche, le Capitole
seul est presque entièrement composé d’un tuf poreux : il fallait un noyau
plus solide à cette colline qui devait être le trône du monde[44].
Quand les redoutables volcans des monts Albains eurent
soulevé le Latium au-dessus de la mer, les laves sorties de leurs cratères
s’épanchèrent sur les flancs de la montagne, et l’un de ces courants
enflammés descendit, à travers la plaine nouvelle, jusqu’à Capo di Bove[45].
De ces laves refroidies Rome a tiré les dalles dont elle a couvert la voie
Appienne, où on les voit encore.
Formée au sein des eaux dont elle reproduit tour à tour
les molles ondulations ou la surface aplanie, remaniée ensuite par les
volcans des monts Albains, la campagne romaine est sillonnée de petites
collines et de bas-fonds, sol bossué, disait
Montaigne, dont les eaux douces remplirent les cavités. C’étaient autrefois
des lacs limpides, ce sont aujourd’hui des mares insalubres[46],
et un savant homme, Procchi, attribue à l’influence de l’aria cattiva
le caractère sombre, violent et irritable de ceux qui couvent dans leurs
veines le germe de la fièvre des Maremmes. Tous les voyageurs l’ont remarqué
: autant, sous son beau ciel et au bord de cette joyeuse nier du golfe
napolitain, la population est rieuse, folle et bruyante ; autant celle
de Rome, au milieu de cette campagne majestueuse et sévère, est triste,
taciturne et prompte à jouer du couteau. Nous retrouverons cette dureté dans
toute l’histoire de Rome, car l’homme a beau se dire intelligent et libre, la
nature qui l’enveloppe met sur lui son empreinte, et, pour le plus grand
nombre, cette empreinte est ineffaçable.
On dirait que la même influence agit sur tous les êtres
animés : les buffles et les grands bœufs, aux cornes formidables, qui errent
dans la campagne romaine, sans pourtant souffrir du mauvais air, sont aussi
farouches que les pâtres qui les conduisent, et il n’est pas prudent à
l’étranger de s’aventurer dans leur voisinage.
Tandis que le volcan travaillait pour fournir à Rome
l’indestructible pavage de ses voies militaires, les cascatelles de Tivoli,
plus puissantes alors qu’elles ne le sont à présent, et les eaux des lacs
voisins saturées d’acide carbonique ou d’hydrogène sulfuré, formaient le
travertin, calcaire léger et blanchâtre qui durcit à l’air en prenant des
teintes chaudes et orangées. Rome en construisit tous ses temples, le Colisée
et les monuments de l’époque impériale.
L’architecture d’un peuple dépend des matériaux qu’il a
sous la main. La brique donne à Londres sa tristesse, comme Paris doit son
élégance à nos calcaires si faciles à travailler. Le marbre faisait Athènes
étincelante de beauté. Rome fut sévère avec son péperin grisâtre, massive
avec soit travertin découpé en larges assises, jusqu’aux jours où, avec les
marbres précieux, débarqués à Ostie elle pourra se donner toutes les
magnificences architecturales ; de sorte que sa
ruine même en glorieuse ; et encore retient-elle, au tombeau, les
marques et l’image de l’empire. (Montaigne)
Le Tibre était bien plus considérable qu’aujourd’hui, car
il recevait alors toute la
Chiana, peut-être une pute de l’Arno, et emportait à la
mer, avec les eaux de la
Sabine, celles d’une grande étendue de l’Apennin toscan.
Ses flots couvraient l’emplacement de Rome d’un lac large et profond. On a
trouvé des coquilles fluviales sur le Pincio, l’Esquilin, l’Aventin et le
Capitole à 40 et 50
mètres au-dessus du Tibre actuel. Le fleuve, barré
sans doute par les collines de Decimo, avait accumulé ses eaux derrière cet
obstacle qu’il finit par emporter.
L’homme parut de bonne heure sur ce sol. Dans les terrains
quaternaires du bassin de Rome, on a trouvé ses restes et des silex qu’il
avait taillés ou polis mêlés à des ossements de cervus
elephas, de renne et de bos primigenius[47].
Aux outils de pierre succédèrent, comme partout, des outils de bronze.
L’homme, alors armé, put combattre les fauves, puis la nature elle-même. Mais
il se passa bien des siècles avant que ce travail produisit quelques effets
utiles.
Aux premiers jours de Rome, le Forum, le Champ de Mars, le
Vélabre, la vallée entre l’Aventin et le Palatin (vallis Murcia)
que le Grand Cirque remplit plus tard en entier, enfin, tous les lieux bas,
au pied des sept collines, étaient des terrains marécageux où le fleuve
revenait souvent et où il revient encore. C’est d’un bourbier que sortira la
plus belle cité du monde.
Pour se défendre, le Capitolin et le Palatin étaient des
refuges assurés ; mais, pour vivre et s’étendre, il fallait descendre
des collines et combattre les eaux vagabondes ou stagnantes, sur lesquelles
planait déjà la mal’aria. La
Fièvre eut de bonne heure, sur le Palatin, un autel où l’on
essayait de conjurer, par des prières et des sacrifices, sa fatale influence[48].
Mais ce peuple superstitieux était en même temps un peuple énergique. Ce
qu’il demandait aux dieux, il le demanda aussi à son travail, et cette lutte
contre la nature, prépara la lutte contre les hommes. Dans cette couvre de
remaniement du sol romain, il fut aidé par les Étrusques, qui savaient
drainer les plaines fangeuses et construire, pour la direction des eaux
souterraines, des monuments impérissables. L’entrée de l’art étrusque à Rome
était une nécessité géographique, comme la vie laborieuse et rude des
premiers Romains en fut une autre, et l’on verra qu’avec l’art y entrèrent
beaucoup d’institutions civiles et religieuses de l’Étrurie.

II. Anciens peuples de l’Italie –
Pélasges et Ombriens
L’Italie n’a point, comme la France, l’Angleterre,
l’Allemagne et la
Scandinavie, gardé les traces nombreuses d’une race
antérieure à l’époque où l’homme savait déjà ouvrir le sein de la terre avec
des instruments de métal : du moins elle semble jusqu’à présent n’avoir eu
qu’en de certains points ce qu’on a appelé l’âge de pierre[49].
Séparée du reste du monde par les Alpes et la mer, elle ne fut peuplée
qu’après les vastes pays d’accès facile; qui bordent par l’est, le nord et
l’ouest, le pied de ses montagnes. Mais, ces régions une fois habitées,
l’Italie a été le point de l’Europe où se sont rencontrées le plus de races
étrangères. Tous les pays qui l’entourent contribuèrent à former sa
population, et chaque révolution qui les troubla lui valut un nouveau peuple.
Ainsi, après de longues guerres, l’Espagne lui envoya les tribus ibériennes
des Sicanes; de la Gaule
vinrent les Ligures, les Celtes Sénonais, Boïens, Insubriens et Cénomans; des
grandes Alpes, les Étrusques; des Alpes juliennes, les Vénètes; de la côte
orientale de l’Adriatique et du Péloponnèse, de nombreuses tribus illyriennes
et pélasgiques; de la Grèce,
ces Hellènes débarqués en si grand nombre dans l’Italie méridionale, qu’elle
en porta le nom de Grande-Grèce ; de l’Asie Mineure, les Pélasges lydiens;
des côtes enfin de la Syrie
et de l’Afrique, les colonies, plus certaines, que Tyr et Carthage établirent
clans les deux grandes îles italiennes. Et, s’il fallait en croire le
patriotique orgueil d’un de ses historiens[50],
ce serait à l’Égypte et au monde lointain de l’Orient que l’Étrurie aurait dû
ses doctrines religieuses, ses arts et son gouvernement sacerdotal.
L’Italie fut donc le commun asile de tous les fugitifs de
l’ancien monde. Tous y vinrent avec leur langue et leurs mœurs ;
beaucoup y conservèrent leur caractère primitif et leur indépendance, jusqu’à
ce que, dit milieu d’eux, s’élevât une cité qui forma à leurs dépens sa
population, ses lois et sa religion : Rome, asile elle-même de toutes les
races et de toutes les civilisations italiennes[51].
Toutes les races italiotes appartenaient à la grande
famille indo-européenne qui, descendue des hautes régions de l’Asie centrale,
a successivement peuplé une partie de l’Asie occidentale et toute l’Europe.
Quand elles pénétrèrent dans la péninsule, elles étaient déjà arrivées à ce
degré de civilisation qui tient le milieu entre l’état pastoral ou nomade et
l’état agricole ou sédentaire. Les noms géographiques les plus anciens en
fournissent la preuve : l’Œnotrie était le pays de la vigne, l’Italie
celui des bœufs, le nom des Opici signifiait travailleurs des champs,
et les premiers moyens d’échange furent les bestiaux, pecus d’où pecunia.
Il semble que Sybaris ait voulu, comme Buxentum, conserver ce souvenir. Une
de ses médailles porte, au droit et au revers, l’image d’un bœuf[52].
Les plus anciennes de ces populations semblent avoir
appartenu au peuple mystérieux des Pélasges[53],
qu’on retrouve confusément à la tête de tant d’histoires, quoiqu’il n’ait
laissé de lui-même que son nom et des constructions indestructibles. Après
avoir porté son industrieuse activité dans la Grèce et ses îles, dans la Macédoine et l’Épire,
dans l’Italie et peut-être jusqu’en Espagne, il disparut, poursuivi, selon
l’antique légende, par les puissances célestes et livré à des maux sans fin.
Au commencement des temps historiques, on ne rencontre de
ce grand peuple que des débris incertains, comme on découvre au sein de la
terre les restes mutilés des créations primitives. C’est tout un monde
enseveli, une civilisation précoce arrêtée et que les tribus victorieuses ont
calomniée après l’avoir détruite. — Des victimes humaines ensanglantaient,
dit-on, leurs autels, et dans un vœu ils offrirent la diane de leurs enfants.
Les prêtres dirigeaient à leur gré les nuages et la tempête, appelaient la
neige et la grêle, et, par leur pouvoir magique, changeaient les formes des
objets ; ils connaissaient les charmes funestes ; leur regard fascinait
les hommes et les plantes ; sur les animaux, sur les arbres, ils répandaient
l’eau mortelle du Styx, et, s’ils savaient guérir, ils savaient aussi
composer les poisons subtils. — Ainsi, dans les mythologies du Nord, les
Goths ont relégué aux extrémités de la terre, sous la figure de nains
industrieux et de magiciens redoutables, les Finnois, qu’ils avaient
dépossédés. Comme les Pélasges, les Finnois ouvrent les mines ou travaillent
les métaux, et ce sont eux qui forgent pour les dieux odiniques les liens
indissolubles du Loup Fenris, comme Vulcain, le dieu pélasgique, avait
fabriqué, pour des divinités nouvelles aussi, les chaînes de Prométhée.
Il semble donc qu’il y eut au nord et au sud de l’Europe
deux grands peuples qui connurent les premiers arts et commencèrent cette
lutte contre la nature physique que notre civilisation moderne continue avec
tant d’éclat. Hais tous deux furent domptés, et maudits après leur défaite,
par des tribus guerrières qui regardaient le travail comme une œuvre servile,
et firent de l’esclavage la loi du monde ancien.
En Italie, où leurs premières colonies arrivèrent à une
époque reculée, les Pélasges couvrirent, sous divers noms, la plus grande
partie du littoral de la péninsule. Au nord, dans les basses plaines du Pô,
et sur les côtes de l’ouest, depuis l’Arno, étaient des Sicules, fondateurs
de Tibur dont un quartier s’appelait le Sicélion[54] ;
au sud-ouest, des Chones, des Morgètes et surtout des Œnotriens, qui avaient,
comme les Doriens de Sparte, des repas publics ; au sud-est, des Dauniens,
des Peucétiens et des Messapiens, divisés en Calabrais et en Salentins,
qu’une tradition fait venir de la
Crète ; à l’est enfin, des Liburnes, de cette race
illyrienne qu’il faut peut-être confondre avec la race pélasgique[55].
Les Tyrrhénien étaient probablement un de ces peuples
pélasgiques. Une tradition grecque, d’accord avec les documents égyptiens,
les faisait venir de Lydie. Aux jours du roi Atys,
fils de Manès, il y eut une grande famille par toute la terre de Lydie… Le
roi se résolut à partager la nation par moitié et à faire tirer lés deux
portions au sort les uns devaient demeurer dans le pays, les autres s’exiler.
Il continuerait de régner lui-même sur ceux qui obtiendraient de rester : aux
émigrants, il assigna pour chef son fils Tyrsènos. Le tirage accompli, ceux
qui étaient destinés à quitter le pays descendirent à Smyrne, construisirent
des navires, y chargèrent tout ce qui pouvait leur être utile et s’en
allèrent à la recherche d’une terre hospitalière. Après avoir suivi bien des
rivages, ils parvinrent dans l’Ombrie maritime, où ils fondèrent des villes
qu’ils habitent jusqu’à ce four. Ils quittèrent leur nom de Lydiens et,
d’après le fils du roi qui leur avait servi de guide, se firent appeler
Tyrséniens[56].
Ces villes, dont parle Hérodote, s’élevaient au nord des bouches du Tibre,
par conséquent fort près de Rome : c’étaient Alsium, Agylla ou Cære[57],
Pyrgi, qui lui servait de port, Tarquinies, qui joua un si grand rôle dans
l’histoire romaine et, peut-être, aux bouches de l’Arno, la cité de Pise dont
la population parlait grec.
Le récit d’Hérodote est fabuleux, mais il peut rappeler
une émigration véritable. Du temps des empereurs, cette tradition était
nationale à la fois à Sardes et dans l’Étrurie[58].
Quoi qu’il en soit de cette origine, les Pélasges tyrrhéniens eurent une
puissance qui étendit au loin leur nom, car, malgré la conquête du pays par
les Rasenas, les Grecs ne connurent jamais entre le Tibre et l’Arno
que le peuple des glorieux Tyrrhéniens[59],
et les Athéniens ont consacré dans la belle frise du monument choragique de
Lysicrate le souvenir des exploits d’un de leurs dieux contre les pirates
sortis des ports de la
Tyrrhénie.
Mais, tout en admettant l’existence de ces Tyrrhéniens, il
n’est pas nécessaire de leur sacrifier Ies Étrusques. Les Romains, qui
certainement ne l’avaient pas appris des Grecs, appelaient Tusci ou Etrusci[60]
les Rasenas, leurs voisins, et les tables Eugubines, monument ombrien, les
nomment également Turscum, preuve évidente que le nom des
Tyrrhéniens était national aussi dans l’Étrurie. Et que peut signifier cet
usage indigène de deux noms, si ce n’est la coexistence de deux
peuples ? Après la conquête, les Tyrrhéniens ne furent ni exterminés ni
bannis ; leur nom même prévalut chez les nations étrangères, comme en Angleterre
le nom des Anglo-Saxons sur celui des conquérants normands ; et les
progrès ultérieurs de la puissance étrusque parurent être ceux des anciens
Tyrrhéniens.
Les Pélasges formèrent donc sur les côtes occidentales de
la péninsule une première couche de population, que recouvrirent bientôt
d’autres peuples. Au milieu de ces nouveaux venus, les anciens maîtres de
l’Italie, comme les Pélasges de la
Grèce, perdirent leur langue, leurs moeurs, leur liberté et
jusqu’au souvenir de ce qu’ils avaient été. Il ne resta d’eux que les
murailles cyclopéennes de l’Étrurie et du Latium, blocs énormes posés sans
ciment, et qui ont résisté au temps comme aux hommes[61].
Quelques Pélasges cependant échappèrent et, cédant au mouvement de l’invasion
qui s’opérait du nord au sud, gagnèrent de proche en proche la grande île à
laquelle les Sicules donnèrent leur nom, et où les Morgètes les suivirent[62].
Pour ceux qui préférèrent à l’exil la domination étrangère, ils formèrent
dans plusieurs parties de l’Italie une classe inférieure, qui resta fidèle,
dans son abaissement, à cette habitude du travail, un des caractères de leur
race. Dans l’Œnotrie, les occupations basses ou serviles, c’est-à-dire toute
l’industrie[63],
demeura leur partage, comme dans l’Attique, olé on leur avait confié la
construction de la citadelle d’Athènes, de sorte que ces arts étrusques si
vantés, ces figures en bronze[64]
et en terre cuite, ces dessins en relief, ces vases peints, semblables à ceux
de Corinthe, etc., seraient l’œuvre des Pélasges restés serfs et artisans
sous les lucumons étrusques.
Leur religion est aussi obscure que leur histoire. Elle se
rattachait au culte des Cabires de Samothrace, Axieros, Axiokersa, Axiokersos
et Casmilos, dieux cosmiques, personnifications du feu terrestre et du feu
céleste, qui convenaient à des peuples mineurs et forgerons. Plus tard, on
identifia les Cabires avec des divinités grecques. Ainsi, sur un Hermès
fameux du Vatican, Axiokersos est associé à Apollon-Soleil, Axiokersa à Vénus
et Casmilos l’ordonnateur à Éros. Le
dieu suprême, Axieros, restait au-dessus de la triade émanée de lui.
On a dit que toutes les religions de l’antiquité ont été
les cultes de la nature naturante et de la nature
naturée. L’expression est barbare, mais elle est juste. De ces
religions, les unes appartenaient au pur naturalisme ; les secondes ont donné
naissance à l’anthropomorphisme, par lequel toutes finissent.
Les Cabires étant considérés comme le principe des choses,
le symbole de la génération, jouait un rôle important dans leur culte et dans
leur histoire figurée[65].
Sur un miroir tusco-tyrrhénien du quatrième siècle avant notre ère, on voit
deux des trois Cabires dont on avait fait les Dioscures Castor et Pollux,
tuant le plus jeune sous les yeux de Vénus, qui ouvre la ciste où sera
enfermée la dépouille du dieu, et en présence de la sage Minerve assistant,
calme et sereine, à cette mort qui n’est pas une mort véritable. La vie, en
effet, sort de la mort : le dieu ressuscitera, quand Mercure l’aura touché de
sa baguette magique.
L’initiation aux mystères de file de Samothrace resta un
acte de haute piété pour les Romains comme pour les Grecs. Rome fat môme mise
en rapport direct, par la légende, avec file pélasgique. Le Palladium et les
dieux Pénates, ravis par Énée aux flammes de Troie et qui étaient le gage de
l’empire pour la ville éternelle, c’était le Pélasge Dardanus, disait-on, qui
les avait apportés de Samothrace aux rives du Scamandre d’où ils passèrent à
Rome.
Vesta, la déesse de la flamme inextinguible, qui joua un
si grand rôle dans les religions italiennes, doit avoir été aussi une
divinité des Pélasges; mais elle appartenait à tous les peuples de la race
aryenne, car elle était la représentation féminine de l’Agni des Védas.
Les Pélasges et ceux qui imitèrent leurs procédés de
construction rendirent aux prétendus descendants des Troyens un service qu’on
n’a point assez remarqué. Les murs cyclopéens dont ils avaient entouré tant
de villes de l’Italie centrale sauvèrent Rome dans la seconde guerre punique,
en empêchant Annibal d’occuper une seule de ces forteresses inexpugnables qui
défendaient les approches de l’Ager Romanus.
Durant seize années, le grand Carthaginois. n’eut guère dans la péninsule que
l’enceinte de son camp[66].
Depuis deux siècles les Pélasges dominaient en Italie,
quand les Sicanes, chassés de l’Espagne par une invasion celtique, et des
Ligures, venus de la Gaule[67],
se répandirent sur le littoral méditerranéen, depuis les Pyrénées jusqu’à
l’Arno. En Italie, ils occupèrent sous divers noms une grande partie de la Cisalpine et les deux
versants de l’Apennin septentrional. Leurs continuelles attaques, surtout
celles des Sicanes[68],
qui s’étaient le plus avancés vers le Sud, forcèrent les Sicules à s’éloigner
des rives de l’Arno. C’était le commencement des désastres de cette nation,
qui s’était dite autochtone, afin de prouver ses droits à la possession de
l’Italie.
Lorsque, quatre siècles plus tard, les Étrusques
descendirent de leurs montagnes, ils chassèrent les Ligures de la riche
vallée de l’Arno, et les repoussèrent jusque sur les bords de la Macra. Toutefois
il y eut, longtemps encore, de sanglants combats entre les deux peuples, et,
malgré leur poste avancé de Luna, les Étrusques ne purent se maintenir en
paisible possession des terres fertiles qu’arrose le Serchio (Ausar)[69].
Prés de là, sur le San Pellegrino, le sommet le plus élevé de l’Apennin
septentrional (1575 mètres),
et dans les gorges impraticables d’où descend la Macra, habitaient les
Apuans, qui, du haut de leurs montagnes, épiant les routes et la plaine, ne
laissaient ni trêve ni relâche aux marchands et aux laboureurs toscans.
Séparés en autant de petits États qu’ils avaient de
vallées et toujours en armes les uns contre les autres, ces peuples
conservèrent cependant le nom général de Ligures et quelques coutumes
communes à toutes leurs tribus : le respect pour le caractère des féciaux et
l’usage de dénoncer la guerre par des ambassadeurs. Leurs moeurs aussi
étaient partout semblables : c’étaient celles de pauvres montagnards auxquels
la nature avait donné le courage et la force, au lieu des biens d’un sol
fertile[70].
Les femmes y travaillaient, comme les hommes, aux plus rudes ouvrages, et
allaient se louer pour la moisson dans les campagnes voisines, tandis que
leurs maris couraient la mer sur de frêles navires, jusqu’en Sardaigne,
jusqu’en Afrique, contre les riches marchands de Marseille, de l’Étrurie et
de Carthage[71].
Point de villes, si ce n’est Gênes, leur marché commun, mais de nombreux et
pauvres villages cachés dans la montagne et où les généraux romains ne trouvèrent
jamais rien à prendre. Quelques rares prisonniers et de longues files de
chariots, chargés d’armes grossières, furent toujours les seuls ornements des
triomphes liguriens[72].
Peu de peuples eurent une telle réputation d’activité
laborieuse, de sobriété et de vaillance. Pendant quarante ans, leurs tribus
isolées tinrent en E échec, clans leurs montagnes, la puissance romaine, et
on n’eut raison d’eux qu’en les arrachant à ce sol ingrat[73]
où ils voyaient toujours la famine menaçante, mais où ils trouvaient ce qui
était pour eux le premier des biens, la liberté.
A l’autre extrémité de la Cisalpine, habitaient
les Vénètes. Les deux peuples contrastent comme les deux pays. Au milieu de
ces belles plaines qu’a fécondées le limon de tant de fleuves, sous le plus
doux climat de l’Italie, les Vénètes ou les Victorieux[74],
comme on les appelait, échangèrent leur pauvreté et leur vaillance contre des
moeurs énervées et timides. Ils avaient, dit-on, cinquante villes, et Padoue,
leur capitale, fabriquait des étoffes en laine fine et des draps que, par la Brenta et le port de
Malamocco, elle exportait au loin ; les chevaux qu’ils élevaient étaient
recherchés pour les courses d’Olympie, et ils allaient vendre, en Grèce, en
Sicile, l’ambre jaune qu’ils tiraient de la Baltique. L’industrie
et le commerce accumulèrent dans leurs mains des richesses qui souvent
tentèrent les pirates de l’Adriatique. Mais aussi jamais on ne les vit en
armes, et ils reçurent honteusement, sans combat, sans résistance, la
domination romaine : une vie trop facile avait amolli leur courage.
Entrés en Italie à la suite des Liburnes de l’Illyrie, ou
venus peut-être des bords du Danube[75],
les Vénètes avaient été repoussés dans les montagnes du Véronais, du Trentin
et du Brescian, par les Euganéens, qui avaient possédé le pays avant eux et
qui ont laissé leur nom à une chaîne de collines volcaniques entre Este et
Padoue.
Au nord des Vénètes, les Carnes, probablement d’origine
celtique, couvraient le pied des montagnes qui ont pris leur nom, et de sauvages
Illyriens avaient occupé l’Istrie.
A une époque probablement contemporaine de l’invasion des
Ligures, arrivèrent les Ombriens[76]
(Amra, les nobles, les vaillants), qui,
après de sanglants combats, s’emparèrent de tous les pays possédés par les
Sicules dans les plaines du Pô. Poursuivant leurs conquêtes le long de l’Adriatique,
ils refoulèrent vers le sud les Liburnes, dont il subsista à peine quelques
restes (Prætutiens et
Péligniens)[77]
sur les bords de la Pescara,
et pénétrèrent jusqu’au Monte Gargano, où se conserve encore aujourd’hui leur
nom[78].
A l’ouest des Apennins, ils soumirent une partie des pays situés entre le
Tibre et l’Arno[79].
Les Sicanes qui s’y étaient fixés se trouvèrent enveloppés dans la ruine des
Sicules, et plusieurs troupes réunies de ces deux peuples émigrèrent ensemble
au delà du Tibre. Mais ils y rencontrèrent de nouveaux ennemis ; les aborigènes,
encouragés par leurs désastres, les repoussèrent peu à peu vers le pays des
Œnotriens, qui, à leur tour, les contraignirent d’aller, avec les Morgètes,
chercher un dernier asile dans l’île qu’ils appelèrent de leur nom. Les
Sicanes partagèrent encore une fois leur sort et passèrent après eux en
Sicile[80].
Héritiers des Pélasges du nord de l’Italie, les Ombriens
dominèrent des Alpes jusqu’au Tibre d’un côté, jusqu’au Monte Gargano de l’autre,
et partagèrent ce vaste territoire en trois provinces : l’Isombrie ou basse
Ombrie, dans les plaines à demi inondées du Pô inférieur ; l’Ollombrie
ou haute Ombrie, entre l’Adriatique et l’Apennin ; la Vilombrie ou Ombrie
maritime, entre l’Apennin et la mer Tyrrhénienne.
A la façon des Celtes et des Germains, ils habitaient dans
des villages ouverts, au milieu des plaines, dédaignant d’abriter leur
courage, comme les Pélasges et les Étrusques, derrière de hautes murailles,
mais exposés aussi, après une défaite, à d’irréparables désastres. On dit que
quand les Étrusques descendirent dans ta Lombardie, les Ombriens vaincus
perdirent d’un coup trois cents bourgades. Cependant, dans les cantons
montagneux de l’Ollombrie, leurs villes, à l’exemple des cités tyrrhéniennes
qui s’élevaient dans le voisinage, étaient montées sur les hauteurs et
s’étaient couronnées de murailles[81]
: ainsi, Tuder près du Tibre, Nuceria au pied de l’Apennin, Narnia sur un
rocher qui domine le Nar, Mevania, Interamna, Sarsina, Sentinum, etc., qui
par leurs constructions annoncent une civilisation plus prudente, mais aussi
plus avancée.
Pendant trois siècles, l’empire des Ombriens subsista et
valut à ce peuple une grande renommée de puissance; hais il fut brisé par l’invasion
étrusque qui leur enleva les plaines du Pô et l’Ombrie maritime, où les
attaques des Tyrrhéniens, restés maîtres d’une partie du pays, avaient
ébranlé leur puissance. Confinés alors entre l’Apennin et l’Adriatique, ils y
subirent l’influence, même la domination de leurs voisins. Des caractères
étrusques se voient sur leurs monnaies ; on en trouve aussi sur leurs
tables d’Iguvium avec des mots qui semblent appartenir à la langue des
Rasenas ; enfin les devins de l’Ombrie n’avaient pas moins de réputation
que les augures toscans[82].
Plusieurs fois ils s’unirent contre les mêmes adversaires.
Ainsi, les Ombriens suivirent les Étrusques à la conquête de la Campanie, où les villes
de Nuceria et d’Acerrœ. rappelaient par leur nom deux cités ombriennes, et
ils prirent part à leur grande expédition contre les Grecs de Cumes[83].
Lorsque l’Étrurie comprit que la cause des Samnites était celle de l’Italie
entière, l’Ombrie ne lui fit pas défaut à ce dernier jour ; soixante
mille Ombriens et Étrusques, restés sur le champ de bataille de Sutrium,
attestèrent l’antique alliance et peut-être la fusion des deux peuples.
Enfin, quand la liberté perdue ne laissa plus d’autre joie que le plaisir et
la mollesse, ils s’Y plongèrent et restèrent encore unis dans une même
réputation d’intempérance[84].
Tous deux aussi avaient eu les mêmes ennemis à combattre, Rome et les Gaulois
: avec, cette différence, due à la disposition des lieux et à la direction de
l’Apennin, qui couvrait l’Étrurie contre les Gaulois et l’Ombrie contre Rome,
que celle-ci avait paru d’abord plus redoutable aux Étrusques qu’aucune
barrière ne séparait d’elle, et ceux-là aux Ombriens dont le pays s’ouvrait
sur la vallée du Pô. Les Sénons en envahirent une partie considérable et
prirent toujours à travers l’Ombrie dans leurs courses vers le centre et le
sud de la péninsule.
Les Ombriens étaient divisés en de nombreuses peuplades
indépendantes, dont les unes habitaient les villes, les autres la campagne.
Ainsi, tandis que la masse de la nation faisait cause commune avec les
Étrusques, les Camertes traitaient avec Rome sur le pied d’une parfaite
égalité ; Ocriculum obtint aussi l’alliance romaine, mais les Sarsinates
osèrent attaquer seuls les légions et fournirent aux consuls deux triomphes.
Pline comptait encore, de son temps, dans l’Ombrie, quarante-sept peuples
distincts[85],
et cette séparation des populations urbaines et rustiques, cette passion de
l’indépendance locale, cette rivalité des villes, furent toujours l’état
normal de la Romagne,
de la marche d’Ancône et de presque toute l’Italie. Au quinzième siècle,
comme dans l’antiquité, il y avait dans la Romagne des communautés de paysans entièrement
libres, et toutes les villes formaient des municipalités jalouses[86].
Aussi, cette race énergique qui ne connut pas l’esprit processif des Romains
et où la force décidait du droit[87],
ces hommes que Napoléon a proclamés les meilleurs soldats de l’Italie,
ont-ils, grâce à leurs divisions, facilement subi l’ascendant de Rome et plus
tard obéi au plus débile des gouvernements.

III. Étrusques
Notre civilisation occidentale a, comme le vieil Orient,
ses mystères ; l’Étrurie est pour nous ce que l’Égypte était avant
Champollion. Nous savons bien qu’elle a été habitée par un peuple
industrieux, commerçant, artiste et guerrier, rival des Grecs tout en
subissant leur influence, longtemps puissant et redouté dans la Méditerranée ;
mais ce peuple a disparu, nous laissant pour énigme une langue inconnue et,
pour preuve de ce qu’il avait été, d’innombrables monuments : vases, statues,
bas-reliefs, ciselures, objets précieux pour le travail et la matière. — Un
peuple assez riche pour ensevelir avec ses chefs de quoi solder une armée ou
bâtir une ville ; assez industrieux pour inonder l’Italie de ses
produits ; assez civilisé pour couvrir d’inscriptions ses monuments et
ses tombeaux[88].
Mais tout cela est muet, et la science moderne, frappée d’impuissance, n’a su
interpréter encore qu’une vingtaine de mots de la langue étrusque[89].
Les portraits qu’ils nous ont laissés d’eux-mêmes sur leurs tombeaux n’en
disent pas davantage. Ces hommes trapus et obèses, au nez courbe et au front
fuyant, n’ont rien de commun avec le type grec ou italiote et ne sont pas de
la même race que les personnages à traits effilés représentés sur leurs vases.
D’où venaient-ils ? Les anciens eux-mêmes
l’ignoraient. Trompés par le nom des Tyrrhéniens, qui avaient précédé les
Étrusques ait nord du Tibre, les Grecs les prirent pour des Pélasges, et les
firent voyager de la
Thessalie et de l’Asie Mineure jusqu’en Toscane. Mais, au
témoignage de Denys d’Halicarnasse, leur langue, leurs lois, leurs usages,
leur religion, n’avaient rien de commun avec ceux des Pélasges. Niebuhr et
Otf. Müller font sortir les Étrusques ou Rasenas, comme ils se nommaient
eux-mêmes, des montagnes de la Rhétie[90].
Rien ne s’oppose en effet à ce que les Étrusques, qui plaçaient au nord la
demeure de leurs dieux et leur donnaient le nom scandinave des Ases[91],
soient regardés comme une tribu asiatique qui, après avoir pénétré en Europe
par les défilés du Caucase où Ies Goths passèrent ensuite, aurait laissé au
sud la presqu’île des Balkans, occupée par les races pélasgiques, et aurait
remonté la vallée du Danube jusqu’aux Alpes du Tyrol. La domination des
prêtres, la division en classes rigoureusement séparées et la prédominance du
dogme de la fatalité sont des caractères qu’on retrouve de plus en plus
prononcés à mesure qu’on recule dans le cours des siècles et qu’on se
rapproche davantage de l’Asie. La civilisation étrusque a de commun aussi
avec les littératures sémitiques l’omission des voyelles brèves, le
redoublement des consonnes, et l’écriture de droite à gauche. Le nain Tagès
fait penser aux nains habiles et aux magiciens de la Scandinavie, en même
temps que les figures à gros ventre, trouvées à Cervetri, les gorgones dont
les représentations sont si nombreuses, ces dieux à quatre ailes, deus
ouvertes et deux abaissées vers la terre, ces sphinx, ces chimères qui
gardent les approches du palais de la mort, ces animaux inconnus à l’Italie,
lions et panthères qui se dévorent, ces scarabées égyptiens, ces génies bons
et mauvais, comme les dews de la Perse, qui conduisent les
âmes dans le monde infernal, enfin quantité de détails d’ornementation
montrent des emprunts faits à l’Orient ou des souvenirs gardés de la patrie
primitive.
On a rapproché plus haut les deux races industrieuses et
partout persécutées des Finnois et des Pélasges, on peut aussi rapprocher les
deux peuples qui ont pris leur place : la langue énigmatique des
Rasenas, des runes scandinaves ; Odin, les Ases et les familles royales
des Goths, des lucumons toscans, à la fois nobles et prêtres. Comme les Germains,
les Étrusques réunissaient ce que l’Orient sépare, la religion et les armes,
la classe des prêtres et celle des guerriers. Si les Goths croyaient à la
mort des dieux et osaient lutter contre eux, les Étrusques prédisaient le
renouvellement du monde et s’imaginaient pouvoir, par leurs formules
magiques, contraindre la volonté divine. Le caractère grave, mélancolique et
religieux de ce peuple, le respect pour les femmes, la douceur envers les
esclaves[92],
la longueur et l’abondance des repas, rappelleraient aussi les mœurs germaniques,
s’il n’était pas à croire que ces ressemblances sont purement fortuites. Le
mot d’un ancien est, en effet, resté le mot de la science moderne : Par leur langue et leurs mœurs, les Étrusques se séparent de
toutes les autres nations.
Nous admettrons sans y croire absolument que les Étrusques
sont descendus des Alpes dans la vallée du Pô, apportant de l’Asie, qu’ils
avaient peut-être quittée depuis peu de siècles, leur gouvernement à demi
sacerdotal, et des montagnes où ils venaient de séjourner, cette division en
cantons indépendants qui a existé, dans tous les temps, chez les peuples des
Alpes. Ils s’arrêtèrent d’abord dans la Cisalpine, où ils possédèrent jusqu’à douze
grandes villes ; puis franchirent l’Apennin et s’établirent entre le
Tibre et l’Arno. Ils trouvèrent là des Pélasges tyrrhéniens en possession des
croyances, des traditions et des arts helléniques; en relation, par leur
commerce, avec les Grecs de l’Italie méridionale et de l’Ionie. Ces Pélasges,
défendus par des villes plus fortes que les bourgades ouvertes des Ombriens,
ne purent être chassés ou exterminés, et formèrent une partie considérable de
la nation nouvelle[93].
Serait-ce aller trop loin que d’attribuer les travaux de desséchement[94],
les constructions cyclopéennes, la prétendue science des présages et
l’activité industrieuse des Étrusques à l’influence, aux conseils et à
l’exemple de ces Pélasges qui creusèrent, dit-on, à travers une montagne les
canaux du lac Copaïs, bâtirent les enceintes, encore debout aujourd’hui,
d’Argos, de Mycènes, de Tyrinthe, et passèrent pour magiciens à cause de leur
savoir ? Ce peuple d’ailleurs n’eut jamais l’esprit d’hostilité contre
l’étranger ; la tradition de Démarate, le mélange des noms ombriens,
osques, ligures et sabelliens, dans les inscriptions étrusques, l’introduction
enfin des dieux et des arts de la
Grèce, montrent avec quelle facilité ils recevaient les hommes
et les choses des autres pays.
Un trait particulier des moeurs étrusques est cependant en
contradiction absolue avec les mœurs grecques. Ce peuple sensuel aimait à
aiguiser le plaisir par des scènes de mort. Il avait l’usage des sacrifices
humains, décorait ses tombeaux de scènes sanguinaires[95]
et a donné à ses voisins des sept collines ces jeux de gladiateurs qu’ont
imités les villes d’une moitié du inonde romain.
C’est 434 ans avant la fondation de Rome, disaient les
annales étrusques[96],
que s’accomplit la ruine des Ombriens. Les Rasenas succédèrent à leur
puissance et l’accrurent par quatre siècles de conquêtes. De la Toscane, siège principal
de leurs douze peuples, ils soumirent l’Ombrie elle-même avec une partie du
Picenum, où l’on trouve des traces de leur occupation[97].
Au delà du Tibre, Fidènes, Crustumeria et Tusculum, colonisées par eux,
ouvrirent la route vers le pays des Volsques et des Rutules[98],
qui furent assujettis, et vers la
Campanie, où, 800 ans avant notre ère, se forma une nouvelle Étrurie
dont Volturnum, qui plus tard se nomma Capoue, Nola, Acerræ, Herculanum et
Pompéi furent les principales cités[99].
Du haut des rochers de Sorrente que couronnait le temple de la Minerve étrusque, ils
guettaient les navires assez hardis pour s’aventurer dans les golfes de
Naples et de Salerne, et leurs longues galères couraient jusqu’aux côtes de la Corse et de la Sardaigne, où ils
eurent des établissements. Alors presque toute la
péninsule, des Alpes au détroit de messine, se trouva sous leur puissance[100],
et les deux mers qui baignent l’Italie prirent et gardent encore, l’une le
nom même de ce peuple Tuscum mare, la
mer de Toscane, l’autre celui de sa colonie d’Adria, l’Adriatique.
Malheureusement l’union manquait à cette vaste domination.
Les Étrusques étaient partout, sur les bords du Pô, de l’Arno et du Tibre, au
pied des Alpes et dans la
Campanie, sur l’Adriatique et sur la mer Tyrrhénienne; mais
l’Étrurie où était-elle ? Comme l’Attique sous Cécrops, comme les
Éoliens et les Ioniens en Asie, les Achéens dans la Grèce, les Salentins et
les Lucaniens en Italie, les Étrusques se divisaient, dans chaque contrée
occupée par eux, en douze peuples indépendants, que réunissait cependant un
lien fédératif, sans qu’il y eût pour toute la nation de ligue générale. Par
exemple, lorsque survenaient dans l’Étrurie propre de graves circonstances,
les principaux de chaque cité s’assemblaient au temple de Voltumna, dans le
territoire de Volsinii, pour y traiter des intérêts du pays ou célébrer, sous
la présidence d’un pontife suprême, des fêtes nationales[101].
Au temps des conquêtes, l’union fut sans doute étroite, et le chef de l’un
des douze peuples, proclamé généralissime, exerçait un pouvoir illimité,
qu’indiquaient les douze licteurs fournis par les douze cités, avec les
faisceaux surmontés des haches. Mais, peu à peu, le lien se relâcha, et les
Étrusques, qui s’étaient présentés d’abord comme un grand peuple, ne surent
point échapper à ce morcellement politique que, jusqu’à nos jours, l’Italie a
tant aimé. A l’époque où Rome menaça sérieusement l’Étrurie, toute union
avait cessé; et on alla jusqu’à déclarer solennellement, dans une assemblée
générale, que chaque cité serait laissée à ses querelles particulières, parce
qu’il serait imprudent, osait-on ajouter, d’engager l’Étrurie entière à la
défense d’un de ses peuples[102].
Chacun de ces douze peuples, représenté par une capitale
qui portait son nom, possédait un territoire étendu et, sur ce territoire,
des villes sujettes, retenues dans la dépendance de la cité principale par
des droits politiques inférieurs; mais dans la capitale même dominait l’ordre
des lucumons, véritables patriciens qui possédaient par droit héréditaire le
pouvoir, la religion et la science. Tantôt quelques-uns d’entre eux comme
magistrats annuels, tantôt un seul comme roi[103],
gouvernaient la cité, mais avec un pouvoir limité par les privilèges de cette
aristocratie sacerdotale qui avait uni en d’indissolubles liens la religion,
l’agriculture et l’État. La nymphe Bygoïs leur avait révélé les secrets de
l’art augural, et le nain Tagès, les préceptes de la sagesse humaine, avec la
science des aruspices. Un jour qu’un laboureur conduisait sa charrue dans les
champs de Tarquinies, un nain difforme, au visage d’enfant sous des cheveux
blancs, Tagès, était sorti du sillon. L’Étrurie entière accourut ; le
nain parla longtemps ; on recueillit ses paroles, et les livres de
Tagès, fondement de la discipline étrusque[104],
furent pour l’Étrurie ce qu’avaient été les Lois de Manou pour l’Inde et le
Pentateuque pour les Hébreux.
Quant au peuple, élevé et maintenu par ses craintes
superstitieuses dans le respect des grands et la soumission aux lois qu’ils
avaient dictées, il ne leur disputa point le pouvoir, et, cette docile
obéissance rendant la violence inutile, l’aristocratie et le peuple ne furent
pas séparés par ces haines implacables qui déchirent les litais. Gomme les
sujets de Venise, si fidèles encore au dernier siècle à la noblesse du Livre
d’or, le peuple combattait pour le maintien d’un ordre social où sa place
n’était cependant qu’au dernier rang. Mais, quand la fortune de l’Étrurie
baissa, l’autorité des lucumons fléchit. A Véies, au commencement de la
guerre de dix ans ; à Arezzo, un siècle plus tard, ces plébéiens osèrent
regarder leurs maîtres en face et demander des comptes.
Les autres peuples italiens vivaient épars dans des
bourgades (vicatim) : les Étrusques eurent toujours
des villes murées et ordinairement placées sur de hautes collines, comme
autant de forteresses qui dominaient le pays. Guerriers, agriculteurs et
marchands, ils combattaient, desséchaient les marais et creusaient des ports.
L’Inde et l’Égypte, qui se croyaient éternelles, dépensaient des siècles à de
grandioses inutilités ; la
Grèce couvrait de temples ses promontoires, de statues ses
routes, de portiques les rues et les places de ses villes. Ici, c’était le
génie désintéressé des arts; lei, le sentiment profondément religieux et
l’espérance d’une durée sans fin. Mais l’Étrurie savait quand elle et ses
dieux devaient mourir, et, pressée de vivre et de jouir avant cette fin
prévue, elle ne prodiguait le tempes et les hommes qu’en des travaux utiles,
perçant des routes, ouvrant des canaux, détournant les fleuves, ou entourant
ses villes d’infranchissables murailles.
Dans la haute Italie, Mantoue s’éleva ainsi au milieu d’un
lac du Mincio, dans une position qui en fait encore aujourd’hui la plus forte
place de la péninsule. Sa métropole Felsina (Bologne), sur le Reno, prétend aussi avoir
fondé Pérouse[105],
et Pline l’appelle la capitale de l’Étrurie circumpadane. Melpum sur l’Adda
put résister deux siècles aux Gaulois, et Adria, entre le Pô et l’Adige, fut
entourée de canaux qui, réunissant les sept lacs du Pô, appelés les sept
mers, assainirent le delta du fleuve. Les eaux, contenues ou détournées,
livrèrent à l’agriculture des terres fertiles ; les villes s’y multiplièrent,
et, du Piémont à l’Adige, on trouve des inscriptions étrusques, des bronzes,
des vases peints, etc., souvenirs de la domination d’un peuple industrieux.
Dans la Toscane,
le val d’Arno et celui de la
Chiana furent desséchés, la Maremme assainie et six
des douze capitales bâties sur cette côte, maintenant inhabitable. Tandis que
les villes taillaient le marbre, coulaient le fer[106]
et le bronze, pétrissaient la terre en vases élégants, sculptaient
d’innombrables bas-reliefs, ciselaient de riches armures ou des bijoux
précieux, et travaillaient le lin pour les prêtres, la laine pour le peuple,
le chanvre pour les cordages, le bois pour les navires ; une agriculture
habile et étroitement liée à la religion, un partage équitable des terres,
qui donnait à chaque citoyen son champ[107],
rendaient les campagnes florissantes et les couvraient d’une population
robuste. Ainsi se réalisait ce problème que l’antiquité n’a presque jamais su
résoudre : de grandes villes au milieu de campagnes fertiles,
l’industrie et l’agriculture, la richesse et la force : sic fortis Etruria crevit[108].
Cependant des ports nombreux de la côte, de Luna, la ville
aux murailles de marbre[109],
de Pise, plus près alors qu’aujourd’hui de la mer, de Telamon, vaste port qui
n’est plus qu’un marécage, de Graviscæ, de Populonia, de Casa, de Pyrgi, des
deux Adria[110],
d’Herculanum, de Pompéi, partaient des navires qui faisaient le négoce ou la
course, depuis les Colonnes d’Hercule jusque sur les côtes de l’Asie Mineure
et de l’Égypte. De plus hardis aventuriers allaient chercher en Gaule l’étain
des îles Cassitérides nécessaire pour la fabrication du bronze; plus loin
encore, sur les bords de la
Baltique, l’ambre jaune dont les femmes faisaient leur
parure et que les Grecs disaient formé par les larmes des filles du Soleil
pleurant la mort de Phaéton. Des monnaies d’argent de Populonia trouvées dans
le duché de Posen montrent la route suivie par les négociants étrusques à
travers le continent européen. Carthage leur ferma le détroit de Gadès, au
delà duquel ils voulaient conduire une colonie dans une grande île de
l’Atlantique qu’elle venait de découvrir[111],
mais elle leur abandonna la mer Tyrrhénienne : tout navire étranger qu’ils
rencontraient au couchant de l’Italie était traité en pirate, à moins qu’une
convention ne le protégeât[112].
Quand les Phocéens vinrent, en 556, chercher dans ces mers une autre patrie,
les Étrusques s’unirent aux Carthaginois contre ces Grecs que les deux
peuples rencontraient et combattaient partout.
Mais cette union ne pouvait durer. Les Carthaginois, qui,
pour leur commerce avec la
Gaule et l’Espagne, avaient besoin de comptoirs en Corse et
en Sardaigne, s’établirent, malgré les traités, dans ces deux îles. De là de
violentes inimitiés et l’empressement des Carthaginois à s’allier aux Romains[113].
La haine de Carthage était dangereuse, moins encore que la rivalité des Grecs
qui occupaient en Sicile, dans l’Italie méridionale et jusqu’au centre de la Campanie, les positions
commerciales les plus importantes, et qui, par Cumes, menaçaient la colonie
étrusque des bords du Volturne. Dés le milieu du sixième siècle, des Cnidiens
s’établirent dans les îles Lipariennes, d’où ils troublèrent tout le commerce
toscan. Attaqués par une flotte nombreuse, ils restèrent vainqueurs, et, dans
la joie de ce triomphe inespéré, ils consacrèrent à Delphes autant de statues qu’ils avaient pris de navires[114].
Rhodes aussi montrait, parmi ses trophées, les rostres ferrés des navires tyrrhéniens,
et le tyran de Rhegium, Anaxilaos, les chassa du détroit de Sicile en
fortifiant l’entrée du Phare[115].
Aussi les Étrusques prirent-ils parti pour Athènes contre Syracuse. Hiéron
leur fit payer chèrement cette alliance. Unie à Cumes, Syracuse infligea aux
Étrusques une défaite qui marqua le déclin de leur puissance maritime (474), et que Pindare
chanta :
Fils de Saturne, je t’en conjure,
fais que le Phénicien et le soldat de Tyrrhénie restent dans leurs foyers,
instruits par l’outrage que leur flotte a reçu devant Cumes et par les maux
que leur fit le maître de Syracuse, alors que, vainqueur, il précipita dans
les flots du haut des poupes rapides toute leur brillante jeunesse et tira la Grèce du joug de
l’esclavage. Hiéron fit offrande au Jupiter d’Olympie du casque d’un
des lucumons tués à cette bataille, avec cette inscription qu’il y avait fait
graver : Hiéron et les Syracusains ont consacré
à Jupiter les armes tyrrhéniennes prises à Cumes[116].
De toutes parts, les ennemis se levaient alors contre les
Étrusques. Menacés au nord par les Gaulois, au centre par Rome, au sud par
les Grecs et les Samnites, ils perdirent la Lombardie, la rive
gauche du Tibre et la
Campanie, où les Samnites s’emparèrent de Volturnum, dont
ils égorgèrent, dans une nuit, les habitants : à la fin du cinquième siècle (av. J. C.), ils ne
gardaient plus que la
Toscane. Encore la division s’était-elle mise entre eux; au
milieu des malheurs publics, la ligue s’était dissoute. Véies, attaquée par
les Romains, était livrée à elle-même, comme on abandonnait Clusium, menacée
par les Gaulois. Tant d’égoïsme porta sa peine. Véies succomba, Cære devint
municipe romain, Sutrium et Nepet furent occupées par des colonies latines.
Ces désastres ne servirent pas de leçon, et l’Étrurie vit avec indifférence
les premiers efforts des Samnites. A la fin cependant elle comprit qu’il
s’agissait de la liberté de l’Italie, et elle se leva tout entière. Mais elle
fut écrasée à Vadimon ; une seconde défaite l’acheva. Ce fut le dernier sang
versé pour la cause de l’indépendance. Quelque temps encore, sous le nom
d’alliés italiens, les Étrusques purent se croire libres ; mais, peu à
peu, la main de Rome s’appesantit sur eux, et au bout d’un siècle, sans qu’il
y eût paru, l’Étrurie se trouva une province de l’empire.
Calme sous le joug et tristement résignée à un sort depuis
longtemps prédit[117],
ce peuple n’essaya pas de lutter contre son destin. Il s’étourdit, par le
luxe et l’amour des arts, sur la perte de sa liberté, et, gardant jusqu’au
milieu de ses plaisirs sensuels l’idée toujours présente de la mort, il
continua de décorer ses nécropoles de peintures et d’y enfouir des milliers
d’objets dont le travail et la matière annoncent une extrême opulence.
L’Étrurie, en effet, était riche encore ; on verra ce que ses villes
donnèrent à Scipion après seize ans de la plus rude guerre.
Mais la révolution économique, suite des grandes guerres
de Rome, gagna ses provinces. Comme dans le Latium et dans la Campanie, l’esclave
prit peu à peu la place de l’homme libre, le pâtre celle du laboureur, et la
petite propriété se perdit dans les grands domaines. Quand Tiberius Gracchus
traversa l’Étrurie, au retour de Numance, il fut effrayé de sa dépopulation.
Sylla l’acheva en l’abandonnant à ses soldats comme prix de la guerre civile ;
les Triumvirs y passèrent encore. L’Étrurie ne s’en releva plus. Son
organisation sociale avait péri ; sa langue aussi disparut. De tant de
puissance, de gloire, d’art et de science, une seule chose survécut :
jusqu’aux derniers jours du monde antique, l’aruspice toscan conserva son
crédit auprès du peuple des campagnes. Nul ne savait mieux lire dans les
entrailles des victimes, dans les éclats de la foudre, dans les phénomènes de
la nature[118].
Vaine science qui reposait sur le dogme énervant de la fatalité et qui
engourdit ce peuple jusqu’à la mort.
Il a pourtant joué un rôle considérable dans la
civilisation de l’Italie : non par les idées, car il n’a rien donné à la
pensée humaine, ni par l’art, puisque, pour les oeuvres élevées, le sien a
peu d’originalité; mais par sa conception utilitaire de la vie, par son
industrie et par l’influence qu’il exerça sur Rome.
Tite Live appelle les Étrusques la plus religieuse des
nations, celle qui excellait dans la pratique des rites établis, et les Pères
de l’Église faisaient de l’Étrurie la mère des superstitions. On verra plus
loin qu’elle méritait ce renom. Leur doctrine augurale était fameuse chez les
anciens. Ils croyaient que des signes annonçaient les grands événements du
monde, et ils auraient eu raison de le croire si, au lieu d’observer les
phénomènes de la nature physique, ils avaient étudié ceux die l’ordre moral,
puisque la bonne politique est celle qui cherche à découvrir les signes du
temps. Mais l’art augural n’était qu’un assemblage de règles puériles qui
enchaînaient l’esprit et ont fait d’eux d’abord, des Romains ensuite, le
peuple le plus formaliste de l’univers.
Si l’on excepte les Grecs établis sur les rives des golfes
de Naples et de Tarente, ils étaient la plus policée des nations italiennes.
Leurs artisans étaient habiles, leurs nobles aimaient la pompe dans les
cérémonies, la magnificence dans les costumes, et ils donnèrent ces goûts à
Rome avec leurs courses de chevaux et leurs combats d’athlètes. Ils lui
donnèrent aussi leur massive architecture, qui était une lourde imitation de
l’ordre dorique. Le temple de Jupiter, sur le Capitole, lui dut cet aspect
écrasé qui convenait si bien à la pesante imagination romaine, mais si peu au
Dieu du ciel immense. La porte de Volterra et la Cloaca
Maxima prouvent qu’ils surent construire des
arcs et des voûtes, ce que les Grecs de la grande époque ne savaient plus
faire. L’ogive grossière de quelques portes cyclopéennes leur en avait sans
doute inspiré la pensée, et l’architecture se trouva dotée par eux d’un
élément nouveau et précieux. Ils ne semblent pas en avoir tiré parti pour les
constructions grandioses, comme le firent les Romains de l’empire; mais ils
utilisèrent la voûte dans leurs canaux et leurs tunnels pour l’écoulement des
eaux et l’assainissement des campagnes.
Les sénateurs de Rome qui logeaient leurs dieux à la mode
étrusque, se logèrent eux-mêmes comme les lucumons de Véies ou de Tarquinies
l’atrium, trait caractéristique des villas patriciennes, est un emprunt fait
aux Étrusques; et de l’atrium romain sont venus le patio des Espagnols
ou des Maures et le cloître catholique. Mais, tandis que les Romains
plaçaient, comme nous, les tombeaux à la surface du sol, les Étrusques
creusaient sous terre ou dans le roc de leurs collines des chambres
funéraires dont quelques-unes, par exemple dans la vallée de Castel d’Asso,
ont un singulier rapport avec celles qu’on voit près de Thèbes en Égypte.
Parfois ils élevaient, au-dessus de la cavité qui renfermait leurs morts, des
constructions bizarres, dont le fabuleux tombeau de Porsenna serait la plus
complète représentation, si l’on pouvait ramener la description que les
anciens nous en ont laissée à des conditions de vraisemblance.
Varron, si Pline l’a bien copié, s’était fait l’écho des
vagues souvenirs que la tradition avait gardés en les embellissant à sa
manière. Porsenna, dit-il, fut enseveli au-dessous de la ville de Clusium, dans le lieu
où il avait fait construire lin monument carré en pierres de taille. Chaque
face est longue de 300
pieds, haute de 50. La base, qui est carrée, renferme
un labyrinthe inextricable. Si quelqu’un s’y engageait sans un peloton de
fil, il ne pourrait retrouver l’issue. Au-dessus de ce carré sont cinq
pyramides, quatre aux angles, une au milieu, larges à leur base de 75 pieds, hautes de 150 ;
tellement coniques, qu’à leur sommet toutes portent un globe d’airain et une
espèce de chapeau auquel sont suspendues par des chaînes des sonnettes qui,
agitées par le vent, rendent un son prolongé comme on en entendait à Dodone.
Au-dessus du globe sont quatre pyramides hautes chacune de 100 pieds. Par-dessus
ces dernières pyramides, et sur une plate-forme unique, étaient cinq
pyramides dont Varron a eu honte de marquer la hauteur. Cette hauteur, selon
les fables étrusques, était la même que celle du monument tout entier[119].
On a essayé d’expliquer cette construction impossible en disant que les
pyramides n’étaient pas superposées l’une à l’autre, mais qu’elles étaient
placées sur des plans en retraite[120].
Cette légende n’était pourtant qu’à demi fabuleuse. A Chiusi même, on a
découvert des chambres sépulcrales formant une sorte de labyrinthe où l’on
circule difficilement par d’étroits couloirs, et la Cucumella
de Vulci permet de supposer que le glorieux roi de Clusium avait eu un
somptueux tombeau.
La Cucumella, située dans une
plaine, aujourd’hui déserte et inhabitable, est un tumulus, amoncellement
conique de terres, haut de 14 à 15 mètres, qui l’était probablement davantage
dans l’antiquité, et de 200
mètres de circonférence. Fouillé à plusieurs reprises,
ce tumulus n’a pas livré son secret. On a bien, dans les déblais, rencontré
des tombeaux; mais des morts obscurs y avaient seuls leur dernière demeure,
et, en serviteurs fidèles, ils gardaient les approches du lieu où reposait
leur maître. Le lucumon et les siens étaient plus loin, dans une crypte
centrale dont l’accès avait été fermé par un mur d’une telle épaisseur, que
les ouvriers ne purent l’entamer. Tous les efforts faits pour découvrir
l’entrée de ce singulier monument, furent inutiles : les pyramides d’Égypte
ont moins bien défendu leurs chambres sépulcrales. Dans les tranchées qu’on
ouvrit autour de l’enceinte, on trouva des animaux en basalte, sphinx ailés,
lions debout ou accroupis, qui veillaient sur ce palais de la dort pour écarter
les audacieux qui auraient tenté d’en franchir la porte. Sur le sommet se
voyait encore la base de tours en partie écroulées. A l’aide de ces débris,
on a pu restaurer avec quelque vraisemblance[121]
cette tombe mystérieuse. L’édifice est sans grâce, mais l’art, vraiment
étrusque, n’avait pas ce don que la
Grèce reçut de Minerve, et, quelque étrange que cette
construction paraisse, elle ne l’est pas plus que le tumulus du roi lydien
Alyatte, sur les bords de l’Hermos[122].
Ensevelir les chefs sous de grands tumuli était une
coutume des Scythes, des Germains, des Celtes et des Lydiens, par conséquent
des Pélasges : il est donc naturel de la retrouver en Étrurie, surtout dans
la région où les Tyrrhènes s’étaient établis. Le type des tombeaux égyptiens
se montre, au contraire, dans la vallée de Castel d’Asso, à 5 milles de
Viterbe[123].
La ville est détruite, mais sa nécropole subsiste, creusée dans le roc comme
les tombes de Médinet-About. La façade est d’ordre dorique, caractère général
de l’architecture étrusque, et les portes, plus petites en haut qu’en bas,
les décorations en relief, les moulures, rappellent les monuments des rives
du Nil. Soana, Norchia, ont, aussi leur vallée des tombeaux ; ceux de
Castel d’Asso étaient encore inconnus en 1808. Un peuple immense s’agitait
autrefois dans ces solitudes où le voyageur n’ose plus s’aventurer dès qu’il
sent les tièdes et mortels effluves du printemps de la Maremme.
Les fouilles étrusques nous ont livré une innombrable
quantité de bronzes, de terres cuites, de bijoux et d’ustensiles domestiques
d’un travail remarquable. Leur toreutique était renommée, même à
Athènes ; partout on recherchait les ciselures, candélabres, miroirs de
bronze gravé, coupes et bijoux d’or, venus du pays des Tyrrhènes, et lorsque,
il y a quelques années, le musée Campana nous a fait connaître ces
merveilles, l’orfèvrerie moderne a dû se mettre, pour un temps, à la mode
étrusque. Leurs figures ont la rigidité de la statuaire égyptienne : ce n’est
même pas encore du style éginétique. Cependant ils fournissaient à l’Italie beaucoup
de statues en bronze et en terre cuite de grande dimension. Les Romains, qui
lésinaient même avec les dieux, trouvèrent que des statues de terre cuite
étaient une suffisante décoration pour leur temple de Jupiter Capitolin, et
ils en placèrent au-dessus du fronton[124].
Ils s’approvisionnèrent à meilleur compte de statues de bronze , lorsqu’ils
en prirent deux mille au sac de Volsinies.
Les anciens, qui n’ont su que fort tard fabriquer des
tonneaux, ont été les premiers potiers du monde; nos musées renferment plus
de quinze mille vases antiques. La poterie rouge d’Arezzo, la poterie noire
de Chiusi sont purement étrusques. La forme est parfois bizarre, mais souvent
aussi très élégante. Les ornements en relief qui les décorent, les animaux
fantastiques qu’on y voit, sphinx, chevaux ailés, griffons, sirènes, rappellent
des motifs familiers aux artistes orientaux et nous conduisent à la conclusion
que nous avons déjà présentée sur les sources diverses de la civilisation
étrusque.
Il est même quelques-uns de ces vases qu’on pourrait
prendre pour des canopes égyptiens, ces urnes dont le couvercle est
une tête d’homme. Parmi les spécimens que nous donnons se trouve une,
aiguière en forme de poisson; le musée Campana en a une autre en forme
d’oiseau. — Les savants s’accordent à considérer ces vases noirs comme fort
anciens, et Juvénal prétendait déjà que le bon roi Numa n’en avait point
d’autres :
………………………………………………………… quis
Simpuvium ridere Numæ, nigrumque catinum…
Ausus erat ? (Saturnales, VI,
343.)
Quant aux vases peints, ils sont unités des vases grecs ou
ont été importés par le commerce très actif que l’Italie faisait avec tous
les pays qui bordent la
Méditerranée orientale : l’Égypte, la Phénicie, Chypre,
Rhodes, surtout avec la Grèce
asiatique et européenne. Les sujets représentés le plus fréquemment sur ces
vases sont empruntés à l’Iliade, à la mythologie et aux traditions
héroïques de la Hellade;
lorsqu’ils reproduisent des mythes particuliers à l’Étrurie, c’est avec des
réminiscences ou des imitations étrangères. Des vases en bronze doré
découverts à Volsinies portent des figures dont l’élégance rappelle les plus
belles médailles de Syracuse.
Nous devons tenir compte aux Étrusques de s’être faits les
élèves de ceux qui, dans le domaine de l’art, ont été les maîtres du monde,
et de nous avoir conservé quelques-uns de leurs chefs-d’œuvre. Le plus
admirable des vases antiques est sorti des fouilles de Chiusi[125],
et puisqu’un habitant de Vulci avait estimé un vase panathénaïque assez précieux
pour le faire ensevelir avec lui, mettons à côté de ce que l’Étrurie a fait,
ce qu’elle a aimé.

IV. Osques et Sabelliens
C’est dans sa partie centrale, à l’est de Rome et du
Latium, que l’Apennin a ses plus hautes cimes, ses plus sauvages vallées. Là,
le Gran Sasso d’Italia, le Velino, la Majella, la Sibilla, le Terminillo Grande, élèvent leurs
tètes neigeuses au-dessus de toute la chaîne apennine, et de leurs sommets
laissent voir les deux mers qui baignent l’Italie. Mais leurs flancs ne sont
pas mollement arrondis ; il semble que l’espace leur ait manqué pour
s’étendre. Leurs lignes se heurtent et se brisent ; les vallées s’y creusent
en abîmes profonds où le soleil ne descend pas ; les passages y sont des
gorges étroites ; les cours d’eau, des torrents. Partout l’image du
chaos. C’est l’enfer ! disent les paysans[126].
Dans tous les temps, ç’a été l’asile de populations braves et intraitables,
et les plus anciennes traditions y placent la demeure des Osques et des
Sabelliens, la véritable race italienne.
Longtemps refoulés par les colonies étrangères, et comme
perdus au fond des plus sombres forêts de l’Apennin, ces peuples réclamèrent
un jour leur part du soleil italien. D’où venaient-ils eux-mêmes ? On ne
sait, mais les probabilités historiques, fortifiées par l’affinité des
langues et des religions[127],
indiquent une commune origine. La différence des pays où en définitive ils
s’arrêtèrent, les Sabelliens dans la montagne, les Osques dans la plaine,
établit entre eux une différence de mœurs et des hostilités perpétuelles qui
cachèrent leur parenté primitive. De ces deux peuples frères, l’un, profitant
de la faiblesse des Sicules, serait descendu, sous les noms identiques
d’Osques, d’Opiques, d’Ausones et d’Aurunces, dans les plaines du Latium et
de la Campanie,
cette vieille terre des Opiques, que jamais peut-être il n’avait
entièrement abandonnée ; l’autre aurait plus tard peuplé de ses colonies
les sommets de l’Apennin et une partie des côtes de l’Adriatique: ceux-ci
conduits, selon leur humeur belliqueuse, par les animaux consacrés à
Mars ; ceux-là, par Janus et Saturne, qui leur apprirent l’agriculture
et dont ils firent les dieux du soleil et de la terre, du soleil qui féconde,
de la terre qui produit.
Au temps de leur puissance, les Sicules avaient possédé la
terre des Opiques, avais les malheurs dont l’invasion avait frappé les
Pélasges des bords du Pô, s’étendirent de proche eu proche sur toute leur
race, et une vive réaction, faisant sortir les indigènes de leurs catacombes
apennines, les remit en possession des plaines qu’avaient occupées les
Sicules. Les Casci ou Aborigènes, c’est-à-dire les plus anciens du pays,
commencèrent ce mouvement qui, plusieurs fois arrêté par les conquêtes des
Étrusques, des Gaulois et des Grecs, reprit enfin son cours avec Rome, et
finit par substituer la race indigène à tous ces peuples étrangers.
Descendus du haut pays situé entre Amiternum et Reate, les
Casci s’établirent au sud du Tibre, où, de leur mélange avec des Ombriens,
des Ausones et des Sicules restés dans le pays, se forma le peuple des Prisci Latini[128],
lequel occupa, de Tibur à la mer (53
kilomètres) et du Tibre au delà du mont Albain (30 kilomètres),
trente villages, tous indépendants[129].
Au premier rang s’éleva Albe la
Longue, qui prenait le titre de métropole du Latium[130],
dont Rome, fondée trois cents ans plus tard, prétendit hériter. Un lien religieux,
à défaut d’autre, unissait ces peuples, et des sacrifices communs les
rassemblaient sur le mont Albain ou à Lavinium, sanctuaire des pénates mystérieux
et des dieux indigètes[131].
Ainsi le peuple d’où home sortira n’était lui-même qu’un
mélange de tribus et de races différentes. Ailleurs, les races, au lieu de se
mêler, se chassent ou se superposent, l’une dominante, l’autre esclave. Chez
les Osques et les Sabelliens, il y a fusion, au contraire, entre les
vainqueurs et les vaincus. Les traditions grecques, toujours si
intelligentes, ont été un fidèle écho de cette origine du peuple latin, et
c’est par des mariages, par des unions pacifiques, que s’établissent Évandre,
Énée, Tibur et les compagnons d’Ulysse, comme plus tard des mariages uniront
Rome et la Sabine. Par
ses traditions locales, comme par sa propre origine, Rome était préparée à
cet esprit de facile association qui lui donne un caractère à part dans
l’antiquité et qui fut la cause de sa grandeur.
Au huitième siècle, la prospérité des Latins déclinait ;
les Étrusques avaient traversé leur pays, les Sabins franchi l’Anio, les
Èques et les Volsques envahi la plaine et enlevé plusieurs villes latines[132].
Albe elle-même, dans la tradition, parait assez faible pour qu’une poignée
d’hommes y fasse une révolution. Cette faiblesse devait favoriser les commencements
de la ville éternelle.
Des liens de parenté et d’alliance unissaient aux prisci Latini les Rutules, dont la capitale,
Ardée[133],
était déjà enrichie par le commerce et ceinte de hautes murailles. Sagonte,
en Espagne, se disait sa colonie.
Autour de ce Latium primitif, qui ne dépassait pas le
Numicius et qui nourrissait une robuste population de laboureurs[134],
s’étaient établis les Èques, les Berniques, les Volsques et les Aurunces,
tous compris par les Romains sous la dénomination générale de peuples latins ;
plus loin, entre le Liris et le Silarus, les Ausones.
Les Èques, petit peuple de pâtres et de chasseurs, pillards
insatiables[135],
n’avaient, au lieu de villes, que des bourgades fortifiées, dans des lieux
inaccessibles. Cantonnés dans le pays difficile que traverse le haut Anio,
ils descendaient en suivant les montagnes jusqu’à l’Algide, promontoire
volcanique d’où se découvre la campagne romaine et dont les forêts couvraient
leur marche. De là, ils fondaient à l’improviste sur la plaine, enlevaient
moissons et troupeaux, et, avant qu’on se fût armé, ils avaient disparu.
Fidèles cependant à la parole donnée, ils avaient établi le droit fécial que
les Romains leur empruntèrent[136],
nais qu’ils ne semblent plus connaître à l’époque où on les voit presque
chaque année distraire le peuple, par leurs rapides incursions, des querelles
du forum. Malgré leur voisinage de Rome et deux siècles et demi de guerres,
ils furent les derniers des Italiens à poser les armes.
Moins belliqueux ou moins pillards, parce que leur
territoire était plus riche, malgré les rochers qui le couvraient[137],
les Herniques formaient une confédération dont les principaux membres étaient
les cités de Ferentinum, d’Alatrium et d’Anagnia[138].
Les impérissables murailles des deus premières de ces villes, les livres
lintéens où Anagnia consignait son histoire, sa réputation de richesse, les
temples que Marc Aurèle y trouvait à chaque pas et le cirque où
s’assemblaient les députés de toute la ligue, attestent leur culture, leur
esprit religieux et leur ancienne puissance[139].
Placés entre deux peuples d’humeur guerroyante, les Herniques montrèrent un
esprit pacifique et s’associèrent de bonne heure contre les Èques et les
Volsques à la fortune des Latins et de Rome.
Les Volsques, plus nombreux, habitaient depuis le pays des
Rutules jusqu’aux montagnes qui séparent les hautes vallées du Liris et du Sagrus.
Les Étrusques, quelque temps maîtres d’une partie de leur pays, y avaient
exécuté, comme dans les vallées de l’Arno, de la Chiana et du Pô, de
grands travaux pour l’écoulement des eaux, et avaient conquis à l’agriculture
des terrains qui rendaient 30 à 40 pour 1. Ces marais, fameux sous le nom de
marais Pontins, n’avaient d’abord été qu’une vaste lagune, séparée, comme
celle de Venise., de la haute mer par les longues îles qui formèrent ensuite
la côte d’Astura à Circeii. Ils se terminaient, à leur extrémité méridionale,
par l’île d’Aea, réunie plus tard au continent sous le nom de promontoire de
Circeii[140].
Les craintes superstitieuses, qui peuplent toujours d’êtres étranges et
menaçants les forêts profondes et les rochers battus des flots, plaçaient sur
ce promontoire la demeure de Circé, magicienne redoutable : comme, dans la
tradition celtique, les neuf vierges de l’île de Sein commandaient aux
éléments dans les mers orageuses de l’Armorique. Cette légende, qui semble
indigène autour de la montagne, ne serait-elle pas une antique croyance
défigurée ? Circé, que les Grecs ont rattachée à la famille néfaste du
roi de Colchide, mais qu’on disait fille du Soleil, sans doute parce qu’au
matin, quand la plaine est encore dans l’ombre, sa montagne s’éclaire des
premiers rayons du soleil levant ; Circé, qui change les formes et
compose des breuvages magiques avec les herbes[141]
dont son promontoire est encore aujourd’hui couvert[142],
ne serait-elle pas quelque divinité pélasgique, une déesse de la médecine,
comme l’Esculape grec, fils aussi du Soleil, et qui, déchue avec son peuple, n’aurait
plus été, pour les nouveaux venus, qu’une magicienne redoutée ?
Avec l’île de Pontia et l’étendue de côtes qu’ils
possédaient ; avec les ports d’Antium, d’Astura et celui de Terracine,
qui n’a pas moins de 12.000
mètres de pourtour[143] ;
avec les leçons ou les exemples des Étrusques, les Volsques du littoral ne
pouvaient manquer d’être d’habiles marins ; du moins devinrent-ils de redoutables
pirates. Toute la mer Tyrrhénienne, jusqu’au phare de Messine, fut infestée
de leurs courses, et les torts qu’ils firent au commerce tarentin faillirent entraîner
une guerre entre les Romains et Alexandre le Molosse, roi d’Épire. Cependant
Rome avait déjà conquis Antium et détruit sa marine.
Les Volsques de l’intérieur ne furent pas moins redoutés
dans les plaines du Latium ou de la Campanie, et, après deux cents ans de guerre[144],
Rome n’en finit avec eux qu’en les exterminant. Au temps de Pline[145],
trente-trois villes avaient déjà disparu dans le Pomptinum, qui n’était plus,
au siècle d’Auguste, qu’une solitude meurtrière[146].
Derrière les Volsques jusqu’au Liris, dans un pays où les
montagnes ne laissent que deux routes étroites pour passer du Latium dans la Campanie, habitaient
les Aurunces. héritiers du nom de la grande race italienne, ils semblaient en
avoir conservé la haute stature, l’aspect menaçant et l’audace[147].
Aussi était-ce sur leurs côtes, à Formies, qu’on plaçait les géants Lestrigons[148].
Mais, depuis les siècles historiques, ce peuple est resté obscur ; Tite
Live n’en parle que pour raconter la guerre impitoyable que Rome lui fit en 314
et la destruction de trois de ses villes.
Au delà du Liris commençait pour les Romains la Campanie, molle et
énervante contrée où les dominations n’ont jamais duré que quelques vies d’hommes,
où la terre elle-même, dans ses continuelles révolutions, semble avoir la
fragilité des choses humaines. Le Lutrin, autrefois si vanté, est devenu un
marais fangeux, et l’Averne, la bouche des enfers, s’est changé en un lac
limpide. A Caserte, on a trouvé, à 90 pieds sous terre, un tombeau; et les
coulées de lave qui portent Herculanum et Pompéi cachent elles-mêmes une
couche de terre végétale et des traces d’anciennes cultures. Là, dit Pline, dans cette
terre de Bacchus et de Cérès, où deux printemps fleurissent, les Osques, les
Grecs, les Ombriens, les Étrusques et les Campaniens, ont lutté de volupté et
de mollesse, et Strabon, étonné que tant de peuples y aient été tour à
tour dominants et asservis, en accusait la douceur du ciel et la fertilité de
cette terre, d’oie sont venus, dit Cicéron, tous les vices[149].
Les Osques de la Campanie ne sont plus dans les temps historiques
qu’une population soumise à des maîtres étrangers, et qui se confond avec eux
: Grecs établis sur la côte, Étrusques dans l’intérieur, Samnites descendus
de l’Apennin. Quelques tribus ausoniennes, comme les Sidicins de Teanum et
les Aurunces de Cales, gardèrent seules leur liberté dans les montagnes qui
séparent le Volturne du Liris. De l’autre côté de la péninsule, en Apulie, le
fond de la population était aussi d’origine ausonienne, comme le prouvent les
noms des villes de l’intérieur et l’usage de l’osque répandu dans une grande
partie de l’Italie méridionale.
Dans l’origine les Sabins, auxquels se rattachent presque
tous les peuples sabelliens[150],
habitaient, aux environs d’Amiternum, le haut pays de l’Abruzze supérieure, d’où
sortent le Velino, le Tronto, la
Pescara, et où la fonte tardive des neiges entretient les
pâturages, quand le soleil brûle déjà la plaine. Ils descendirent de là sur
le territoire de Reate, d’où ils chassèrent les Casci, et parvinrent, par le
mont Lucrétile, jusqu’au Tibre. Au nord, ils rejetèrent les Ombriens au delà
de la Nera; au
sud, ils occupèrent une partie de la rive gauche de l’Anio, et, au huitième
siècle, c’était, après les Étrusques, le plus puissant peuple de la péninsule[151].
Pasteurs et agriculteurs, comme tous les Sabelliens, les
Sabins vivaient épars dans des villages, et, malgré leur nombreuse
population, qui mettait en culture et habitait jusqu’aux cimes des plus âpres
montagnes, ils n’eurent guère d’autres villes qu’Amiternum et Reate. Cures,
le lieu de réunion de tout le peuple, n’était qu’un gros bourg. — C’étaient les
Suisses de l’Italie : mœurs sévères et religieuses, tempérance, courage,
probité ; ils avaient les vertus sans faste mais durables de l’homme des
montagnes, et restèrent aux yeux de l’Italie comme une vivante image des
anciens temps[152].
L’histoire, qui reconnaît en eux un des principaux éléments de la population
romaine, n’hésitera point à leur attribuer la vie frugale et laborieuse, la
gravité austère, le respect pour les dieux, la forte constitution de la
famille, qu’on trouve à Rome dans les premiers siècles et qui s’y
conservèrent longtemps[153].
Ils ressemblaient encore aux premiers Romains par leur dédain pour la culture
de l’esprit. on n’a pas trouvé dans tout leur pays une seule inscription
sabine.
Lorsque, dans ces arides montagnes, la famine était
menaçante ou la guerre malheureuse, on vouait aux dieux, par un printemps
sacré, tout ce qui naissait en mars et avril. Les enfants eux-mêmes
étaient offerts en sacrifice. Plus tard les dieux s’adoucirent; le bétail
seul fut immolé ou racheté, et les enfants, élevés jusqu’à vingt ans, étaient
alors conduits, la tête voilée, hors du territoire, comme ces hordes
scandinaves que la loi chassait à époque fixe du pays pour prévenir la
famine. Souvent le dieu protégeait lui-même ces jeunes colonies, sacranæ acies vel Matmertini, et leur envoyait
des guides divins. Ainsi furent conduits par des animaux consacrés à Mars,
les Picénins par un pivert (picus), les Hirpins
par un loup (hirpus), et les Samnites par un taureau
sauvage[154].
Des Sabins, dit Pline (H. n., III, 13), descendent, par un printemps sacré, les Picénins. Mais
trop de races différentes occupèrent cette côte et s’y mêlèrent, pour qu’il
en sortit un peuple original. Dans leurs fertiles vallées, les Picénins
restèrent en dehors de toutes les guerres italiennes, et y multiplièrent à
loisir. Pline prétend (Ibid.)
que, lorsqu’ils se soumirent Rome, en 265, ils étaient au nombre de 360.000.
Parmi eux l’on comptait les Prætutiens, qui formaient un peuple distinct,
cantonné dans le haut pays. Par un singulier hasard, ce sont ces pauvres montagnards,
à peine connus des historiens de Rome, qui ont donne leur nom au centre de la
péninsule, les Abruzzes.
La vaste province ordinairement désignée sous le nom de
Samnium (Ibid., III,
17), et qui comprend toutes les montagnes au sud de la Sabine et du Picenum
jusqu’à la Grande-Grèce,
était partagée entre deux confédérations formées des peuples réputés les plus
braves de l’Italie. Au nord, celle des Vestins et des Marrucins sur le
littoral, des Péligniens et des Marses dans la montagne; au sud, celle des Frentans,
des Caracénins, des Pentriens, des Hirpins et des Gaudiniens.
Dans la première ligue, les plus renommés pour leur
courage étaient les Marses et les Péligniens. Qui
triompherait des Marses ou sans les Marses ?
[155]
disait-on. Après l’aruspice étrusque, il n’y avait pas de plus célèbres devins
pour expliquer les signes, surtout le vol des oiseaux, que ceux des darses.
On retrouve chez eux les psylles de l’Égypte et les médecins-sorciers des
indigènes du nouveau monde, qui guérissaient avec les simples cueillis dans
leurs montagnes et avec leurs chants magiques, neniæ[156].
Une famille, qui jamais ne se mêlait aux autres, avait le don de conjurer les
vipères dont le pays des Marses était rempli, et de rendre leurs morsures
inoffensives[157].
Au temps d’Élagabal, la réputation des sorciers marses durait toujours ;
maintenant encore les bateleurs qui vont à Rome et à Naples effrayer le
peuple de leurs jeux avec des serpents dont ils ont arraché les crochets
venimeux, partent des environs de ce qui était naguère le lac de Celano[158]
(Fucinus).
Aujourd’hui, c’est un saint Dominique de Cullino qui donne ce pouvoir ;
il y a trois mille ans, c’était une déesse en grande vénération dans les
mêmes lieux, la magicienne Angitie, sœur de Circé, ou peut-être Médée
elle-même, de la sinistre famille d’Aétès. Les noms changent, mais la
superstition reste, quand l’homme demeure sous l’influence des mêmes lieux et
dans la même ignorance.
Le pays des Marses et des Péligniens, situé au coeur de
l’Apennin, était le plus froid de la péninsule[159] :
aussi les troupeaux quittant, l’été, les plaines brillées de l’Apulie,
venaient, alors comme aujourd’hui, paître dans les fraîches vallées des
Péligniens, qui récoltaient aussi d’excellente cire et le plus beau lin[160].
Leur forte place de Corfinium fut choisie pendant la guerre Sociale pour
devenir, sous le nom significatif d’Italica,
la capitale des Italiens soulevés contre Rome.
L’autre grande ligue sabellienne formait le peuple
samnite, qui eut de plus brillantes destinées, de grandes richesses, un nom
redouté jusqu’en Sicile, jusqu’en Grèce, mais qui paya toute cette gloire par
d’affreux désastres. Conduits, suivant leurs légendes, de la Sabine aux montagnes de
Bénévent par le taureau sauvage dont on retrouve le signe sur les médailles
de la guerre sociale, les Samnites se mêlèrent aux tribus ausones restées
dans l’Apennin, et s’étendirent de colline en colline jusqu’à la Pouille. Tandis
que les Caudiniens et les Hirpins[161]
se fixaient sur les pentes du mont Tuburuno, dont le pied touchait à une
vallée qu’ils rendirent fameuse sous le nom de Fourches Caudines, les
Frentans s’établissaient vers la mer supérieure, et des bandes irrégulières allaient
former au delà du Silarus le peuple des Lucaniens, qui se séparèrent de bonne
heure de la ligue. Celle-ci resta composée de quatre peuples (Caraceni, Pentri, Hirpini et Caudini)
auxquels appartient plus particulièrement le nom glorieux de Samnites.
Leur pays, entouré par le Sangro, le Volturno et le
Calore, est couvert de montagnes abruptes (le Matese), qui conservent la neige
jusqu’en mai et dont une cime, le mont Miletto, s’élève à 2000 mètres. Aussi
les troupeaux trouvaient-ils dans ces hautes vallées, durant les étés
brûlants, de frais pâturages et des sources abondantes. C’était la richesse
du pays. Leurs produits, vendus dans les villes grecques qui bordaient la
côte, les soldes militaires qu’ils reçurent souvent à titre d’auxiliaires, mais
surtout le butin qu’ils rapportaient de leurs courses dans la Grande-Grèce,
accumulèrent dans les mains de ces pâtres belliqueux de grandes richesses. Au
temps de la guerre contre Rome, telle était l’abondance de l’airain dans le Samnium,
que le jeune Papirius en enleva plus de deux millions de livres[162],
et que son collègue Garvilius, avec les seules armures prises aux fantassins
samnites, fit fondre le colosse de Jupiter, qu’il plaça dans le Capitole et
qu’on pouvait apercevoir du haut du mont Albain[163].
Comme tous les peuples guerriers, les Samnites mettaient leur luxe dans les
armes ; de vives couleurs brillaient sur leurs vêtements de guerre, l’or
et l’argent sur leurs boucliers. Chaque soldat des premières classes,
s’équipant à ses frais, voulait prouver son courage par l’éclat de ses armes.
Aussi la richesse de l’armée ne prouve pas celle du peuple.
En calculant d’après les nombres fournis par les
historiens de Rome, on a évalué à deux millions d’hommes la population du
Samnium[164].
Ce chiffre est évidemment exagéré, comme les bases sur lesquelles il repose.
Si les Samnites n’ont pu armer contre Rome plus de 80.000 fantassins et 8.000
cavaliers, leur population devait s’élever au plus à 600.000 habitants. Mais
c’était assez pour que ces hommes robustes et braves, quelquefois réunis sous
le commandement suprême d’un embradur (imperator),
étendissent tout autour de leurs montagnes leurs courses et leurs conquêtes.
Leur principale ressource était leurs troupeaux ; mais durant six à sept
mois la neige couvrait les pâturages des montagnes, il fallait donc descendre
dans les plaines[165].
De là une cause de guerres continuelles avec les peuples voisins.
Réunis dans une même ligue, les quatre peuples samnites
formaient cependant, chacun sous son meddix
tuticus, une société distincte et souveraine, qui oubliait souvent
l’intérêt général pour suivre des entreprises particulières. Ces fils du dieu
Mars, ces hommes dont la religion et la politique avait proscrit les aïeux,
restèrent fidèles à leur origine : ils préférèrent, aux liens qui font la
force, l’isolement qui donne d’abord la liberté, mais prépare la servitude.
Si les treize peuples sabelliens avaient été unis,
l’Italie leur appartenait. Mais les Lucaniens étaient ennemis des Samnites,
ceux-ci de la fédération marse, les Marses des Sabins, et les Picentins
restaient étrangers à toutes les querelles des montagnards. Cependant Rome,
qui représentait, comme ne le fit avant elle aucun État de l’antiquité, le
principe contraire de l’unité politique, ne triompha qu’après les plus
douloureux efforts et en exterminant cette population indomptable[166],
encore lui fallut-il s’y prendre à deux fois pour cette oeuvre de
destruction. La guerre du Samnium et la seconde guerre Punique avaient fait
déjà bien des ruines et des solitudes ; mais, quand les vengeances de Sylla
eurent passé sur cette terre désolée, Florus put dire : Dans le Samnium même on chercherait vainement le Samnium.
Cette ruine fut si complète, qu’il nous est à peine resté quelques monuments
de ce peuple et que plus de vingt de ses villes ont disparu sans laisser de
vestiges d’elles-mêmes.
Au sud-est, Tarente et les grandes villes de l’Apulie
arrêtèrent les Samnites; mais, à l’ouest, les Étrusques de la Campanie ne surent pas
défendre contre eux ce riche territoire. Fatigués par leurs continuelles
excursions, ils crurent acheter la paix en partageant avec les Samnites leurs
champs et leur ville. Une nuit, ils furent surpris et égorgés (vers 423) ;
Volturnum prit le nom de Capoue, et celui de Campaniens désigna les nouveaux maîtres
du pays[167].
Cumes, la grande cité grecque, fut ensuite enlevée d’assaut, et une colonie
campanienne remplaça une partie des habitants massacrés, sans toutefois faire
prévaloir l’osque et les usages sabelliens sur la langue et les mœurs grecques[168].
Ces pâtres, qui élevaient dans leurs montagnes[169]
de belles races de chevaux, devinrent au milieu des plaines de la Campanie les meilleurs
cavaliers de la péninsule, et le renom que cette conquête leur valut en
prépara d’autres. Au nord, à l’est et au sud, ils étaient entourés de pays
difficiles et de populations belliqueuses qui leur fermaient la route à de
nouvelles entreprises; mais la mer restait ouverte, et ils savaient qu’au delà
des golfes de Pæstum et de Terina il y avait en Sicile du butin à faire, des
aventures à courir. Sous l’ancien nom expressif de Mamertins, les cavaliers
campaniens se mirent à la solde de qui voulait les payer. La rivalité des
cités grecques, l’ambition des tyrans de Syracuse, les invasions
carthaginoises et la guerre sans relâche qui désolait l’île entière, leur
firent toujours trouver à qui vendre leur courage. Et ce métier de
mercenaires leur devint si lucratif, que ce qu’il y avait de plus brave dans
la jeunesse campanienne passa dans l’île, où les Mamertins furent bientôt
assez nombreux pour faire la loi et prendre leur part.
Mais, tandis qu’ils devenaient au delà du détroit une
puissance contre laquelle luttèrent vainement Carthage, Syracuse et Pyrrhus,
leurs villes des bords du Volturne s’affaiblissaient par les migrations mêmes
dont s’augmentait la colonie militaire de Sicile. Dès le milieu du quatrième
siècle, à Cumes, à Nole, à Nucérie, les anciens habitants redevenaient les
maîtres, et si Capoue conserva la suprématie sur les villes voisines, ce fût
en perdant tout caractère sabellique. La mollesse des anciennes mœurs
reparut, mais mêlée de plus de cruauté. Dans les funérailles, des combats de
gladiateurs pour honorer les morts ; au milieu des plus somptueux
festins, des jeux sanglants pour égayer les convives[170],
et toujours, dans la vie publique, le meurtre et la trahison. On a vu les
Samnites s’emparer de la ville en égorgeant leurs hôtes; les premiers soldats
romains qu’on y placera voudront, à leur exemple, en massacrer les habitants.
Durant la seconde guerre Punique, Capoue scelle son alliance avec les Carthaginois
du sang de tous les Romains établis dans ses murs, et Perolla veut poignarder
Annibal à la table de son père. Lorsque enfin les légions y rentrent, c’est
tout le sénat de Capoue qui célèbre ses propres funérailles dans un joyeux
festin et boit le poison à la dernière coupe. Il n’y a pas d’histoire plus
sanglante, et nulle part il n’y eut de vie plus molle.
Les Lucaniens eurent une destinée à la fois moins triste
et moins brillante. En suivant la chaîne des Apennins, ce peuple était entré
dans l’ancienne Œnotrie, dont les côtes étaient occupées par ales villes
grecques et où Sybaris dominait du golfe de Pæstum à celui de Tarente. Après
s’être lentement accrue dans les montagnes, leur population se jeta sur le
territoire cultivé des cités grecques, et vers le milieu du cinquième siècle,
Pandosie, avec les villes voisines, tomba en leur pouvoir. Maîtres des côtes
de l’Ouest, ils se tournèrent vers celles du golfe de Tarente, et placèrent entre
deux dangers les villes grecques déjà menacées au sud par les tyrans de
Syracuse. Vers 430, ils luttaient déjà contre Thurium, et tels furent leurs
progrès dans l’espace de trente-six ans, malgré leur petit nombre qui ne
dépassait pas 34.000 combattants[171],
qu’une grande ligue défensive, la première que les Grecs de cette côte
eussent conclue, fut formée contre eus et contre Denys de Syracuse. La peine
de mort fut prononcée pour le chef de la ville dont les troupes ne seraient
pas accourues au premier avis de l’approche des barbares (394)[172].
Ces mesures furent infructueuses : trois ans après, toute la jeunesse de
Thurium, en voulant reprendre la ville de Laus, fut détruite dans une
bataille qui livra aux Lucaniens la Calabre presque entière[173].
Denys le Jeune, à son tour effrayé, malgré un traité conclu avec eux en 360[174],
traça, du golfe de Scylacium à celui d’Hipponium, une ligne de défense
destinée à couvrir contre eux ses possessions d’Italie[175].
Cette époque fut celle de la plus grande extension des
Lucaniens. Dès lors ils ne firent plus que reculer, affaiblis qu’ils étaient
par le peu d’accord de leurs divers cantons, dont chacun avait ses lois
particulières et son chef (meddix ou præfucus). Vers 356, apparaissent les
Bruttiens, dont Denys de Syracuse favorisa la révolte, et peu à peu la
frontière de la Lucanie
remonta jusqu’au Laus et au Crathis. Contenus, au sud, par les Bruttiens,
aussi braves qu’eux-mêmes, ils cherchèrent à se dédommager aux dépens des
Grecs des bords du golfe de Tarente ; mais ce fut pour appeler sur eux
les armes d’Archidamos, d’Alexandre le Molosse et du Spartiate Cléonyme. Plus
tard, leurs attaques sur Thurium amenèrent la guerre avec Rome, qui leur
coûta l’indépendance.
De tous les peuples sabelliens, les Lucaniens semblent
être restés les plus grossiers, les plus avides de guerre et de destruction.
La civilisation qui les entourait ne fut pas assez forte pour pénétrer dans
ces âpres montagnes, dans ces forets profondes, où ils envoyaient leurs fils
chasser l’ours, le sanglier et les bêtes fauves, pour les habituer de bonne
heure au danger[176].
Peu nombreux et souvent divisés, ils tinrent néanmoins la population vaincue
durement asservie, et éteignirent en elle jusqu’à cette culture grecque,
cependant si vivace. Devenus barbares, dit
Athénée (XIV, 31)
des habitants de Posidonie, ayant perdu jusqu’à leur
langue, ils avaient du moins conservé une fête grecque, pendant laquelle on
se réunissait pour réveiller les anciens souvenirs, rappeler les noms aimés
et la patrie perdue ; puis l’on se quittait en pleurant. Triste et
touchant usage qui atteste une bien dure servitude !
A l’extrémité de la Calabre orientale (terre d’Otrante) on a trouvé des
inscriptions qu’on n’a put rattacher à un dialecte connu. Elles y avaient été
laissées par les Iapyges, un des plus anciens peuples de la péninsule. Il
semble avoir dominé jusque dans l’Apulie ; mais il subit de bonne heure
l’influence hellénique et alla perdre sa nationalité au milieu des colons
grecs.

V. Grecs et Gaulois
Nous venons de parler des races vraiment italiennes, de
celles du moins qui, Ies Étrusques exceptés, se servaient d’une langue soeur
de la langue hellénique et qui donnèrent à Rome sa population, ses moeurs et
ses lois. Il reste à étudier deux peuples, les Grecs et les Gaulois, qui
s’établirent plus tard dans la péninsule : ceux-ci qui la troublèrent
longtemps par leurs incursions et leurs pillages ; ceux-là qui
l’ouvrirent à la civilisation hellénique. Il y a bien peu d’années, on
parlait encore grec aux environs de Locres[177] ;
dans les Calabres, une sorte de danse sacrée ressemble à celle qui est
représentée sur des vases antiques, et, à Cardeto, les femmes ont si bien
conservé le type de la beauté hellénique, qu’on dit d’elles : Ce sont des Minerves. De même on a cru retrouver,
de Turin à Bologne, dans les traits du visage, dans l’accent, comparativement
rude et guttural des Piémontais, des Lombards et des Romagnols, la trace
persistante de l’invasion celtique[178].
L’histoire des colonies grecques en Italie se divise en
deux parties l’une, commençant au huitième siècle avant notre ère, ne peut
être l’objet d’aucun doute ; l’autre, remontant au quatorzième siècle, a
contre elle toutes les probabilités historiques. Sans doute, il se peut que,
dans les temps qui suivirent la guerre de Troie, après ce grand ébranlement
de la Grèce,
des troupes d’Hellènes, chassées par les révolutions de la mère patrie, aient
débarqué sur les côtes de l’Italie. Mais ce que l’on rapporte de
l’établissement de Diomède dans la
Daunie ou chez les Vénètes, qui du temps de Strabon lui
sacrifiaient chaque année un cheval blanc, des compagnons de Nestor à Pise,
d’Idoménée à Salente, bien que Gnosse dans la Crète montrât son tombeau,
de Philoctète à Pétélie et à Thurium, d’Épéos à Métaponte, d’Ulysse à Scylacium,
d’Évandre, de Tibur, de Telegonus, fils d’Ulysse, dans le Latium, à Tusculum,
Tibur, Préneste, Ardée, etc., ces légendes, disons-nous, ne peuvent être
regardées que comme des traditions poétiques inventées par les rhapsodes,
afin de donner à ces villes une origine illustre.
Rien ne manqua pour accréditer ces généalogies glorieuses
: ni les chants des poètes, ni la crédulité aveugle ou intéressée des
historiens, ni même les reliques vénérées des héros. Sur les bords du
Numicius, les contemporains d’Auguste allaient voir le tombeau d’Énée, devenu
le Jupiter Indigète, et tous les ans les consuls et les pontifes romains y
offraient des sacrifices. Circeii montrait la coupe d’Ulysse et le tombeau
d’Elpenor, un de ses compagnons[179] ;
Lavinium, le vaisseau incorruptible d’Énée[180]
et ses dieux pénates; Thurium, l’arc et les flèches d’Hercule donnés par
Philoctète ; Macella, le tombeau de ce héros ; Métaponte, les outils de fer
dont s’était servi Épéos pour construire le cheval de Troie[181] ;
Lucérie, l’armure de Diomède[182] ;
Maleventum, la tête du sanglier de Cardon ; Cumes, les défenses du
sanglier d’Érymanthe. Ainsi les habitants d’une ville d’Arménie montraient à
qui les voulait voir les débris de l’arche de Noé[183].
Personne ne tient plus à ces fabuleuses origines, si ce
n’est ces gens de Rome, qui disent encore fièrement : Semo Romani, et diraient volontiers comme les
Padouans : Sangue Troiano. — D’ailleurs,
lors même qu’on tiendrait pour authentiques les premiers établissements de la
race grecque en Italie, on ne pourrait leur accorder aucune importance
historique ; car, restés sans relations avec la mère patrie, ils
perdirent le caractère de cités helléniques, et quand les Grecs arrivèrent au
huitième siècle, ils ne trouvèrent plus trace de ces incertaines colonies. A
cette classe de récits légendaires appartiennent les traditions sur le Troyen
Anténor, fondateur de Padoue, et sur Énée apportant dans le Latium le
palladium de Troie. Les nobles romains voulaient dater de la guerre de Troie,
comme les nôtres des croisades.
Suivant Hérodote, les premiers Grecs établis dans la Iapygie seraient des
Crétois qu’une tempête y aurait jetés. Séduits par la fertilité du sol, ils
auraient brûlé leurs vaisseaux et bâti Iria dans l’intérieur des terres. Mais
la plus ancienne colonie grecque dont l’établissement soit hors de doute, est
celle des Chalcidiens, fondateurs de Cumes. Conduits par Hippoclès et Mégasthénès,
ils s’avancèrent, dit la tradition, à travers des mers inconnues, guidés le
jour par une colombe, et la nuit par le son de l’airain mystique[184].
Ils bâtirent Cumes sur un promontoire qui domine la mer et les plaines
voisines, en face de l’île d’Ischia. Sa prospérité fut si rapide, grâce à sa
position au milieu de la côte tyrrhénienne, devant les meilleurs ports et
dans le plus fertile pays de l’Italie, qu’elle put devenir métropole à son
tour[185],
aider Rome et les Latins, au temps de Porsenna, à repousser le joug des
Étrusques du Nord et, pour son compte, lutter avec ceux de la Campanie. La
bataille de l’an 474 retentit jusque dans la Grèce, où Pindare la célébra. Mais en 420 les
Samnites entrèrent à Cumes. Toutefois, malgré l’éloignement et malgré les
Barbares, Cumes resta longtemps grecque de langue, de mœurs et de
souvenirs ; et, chaque fois qu’un danger menaçait la Grèce, elle croyait, dans
sa douleur, voir pleurer ses dieux[186].
Ces larmes payaient les chants de Pindare.
Sur cette terre volcanique, près des champs Phlégréens et
du sombre Averne, les Grecs se crurent aux portes des enfers. Cumes, où,
selon Homère, Ulysse avait fait l’évocation des morts, devint le séjour d’une
des sibylles et des nécromanciennes les
plus habiles de l’Italie ; chaque année, de nombreux pèlerins visitaient
avec effroi le saint lieu au grand profit des habitants[187].
C’est là aussi, dans ce poste avancé de la civilisation grecque, au milieu de
ces Ioniens tout pleins de l’esprit homérique, que s’élaborèrent les légendes
qui amenèrent en Italie tant de héros de la Grèce.
Après Cumes et ses colonies directes dont la plus fameuse
est la Ville Neuve, Naples, les
autres cités chalcidiennes forent Zancle, nommée plus tard messine, et
Rhegium, qui gardaient toutes deux l’entrée du détroit de Sicile, mais dont
la position militaire était trop importante pour ne point attirer sur elles
de nombreux malheurs. Les Mamertins, qui surprirent Messine et en massacrèrent
toute la population mâle, ne firent que ce qu’exécuta, quelques années plus
tard, une légion romaine à Rhegium.
Les Doriens, qui dominaient en Sicile, étaient peu nombreux
en Italie ; mais ils avaient Tarente, qui rivalisa de puissance et de
richesse avec Sybaris et Crotone et qui conserva plus longtemps que ces deux
villes son indépendance[188].
De riches offrandes, déposées au temple de Delphes, attestaient encore, au
temps de Pausanias, ses victoires sur les Iapyges, les Messapiens et les Peucétiens.
Aussi avait-elle élevé à ses dieux, en signe de son courage, des statues de
taille colossale et toutes dans l’attitude du combat ; mais ils ne
purent la défendre contre Rome et le vainqueur qui rasa ses murailles lui
laissa par dérision les images de ses belliqueuses divinités. Ancône, fondée
vers 380, dans le Picenum, par des Syracusains qui fuyaient la tyrannie de
Denys l’Ancien, était aussi dorienne.
La plus florissante des colonies achéennes fut d’abord
Sybaris, qui avait soumis la population indigène des pays du vin et des bœufs
(Œnotrie et Italie).
Au bout d’un siècle, vers 620, elle possédait un territoire couvert de
vingt-cinq villes et pouvait armer trois cent mille combattants. Mais, un
siècle plus tard, en 510, elle fut prise et détruite par les Crotoniates.
Toute l’Ionie, qui trafiquait avec elle, pleura sa ruine, et les Milésiens
prirent des vêtements de deuil. Son territoire rendait cent pour un[189] :
ce n’est plus qu’une plage déserte et marécageuse. Sur la côte occidentale de
la Lucanie,
Laus, que les Lucaniens détruisirent après une grande victoire sur les Grecs
confédérés, et Posidonia, dont les ruines grandioses[190]
ont rendu célèbre la ville aujourd’hui déserte de Pœstum, étaient des colonies
de Sybaris. D’autres Achéens, appelés par elle, s’étaient établis à
Métaponte, qui dut de grandes richesses à son agriculture et à son port aujourd’hui
transformé en lagune[191].
Crotone eut une prospérité aussi rapide que celle de Sybaris, sa rivale, mais
qui se soutint plus longtemps. Son enceinte, double en étendue (100 stades), accuse
une population plus nombreuse, que sa renommée pour les luttes du pugilat nous
ferait aussi regarder comme plus énergique (Milon de Crotone). Les tyrans de Syracuse
la prirent trois fois, et elle avait perdu toute importance lorsque les
Romains l’attaquèrent. Locres, d’origine éolienne, n’arriva jamais à autant
de puissance. Sa ruine, commencée par Denys le Jeune, fut achevée par Pyrrhus
et Annibal.
Les Ioniens n’avaient que deux villes dans la Grande-Grèce :
Élée, célèbre par son école de philosophie, et Thurium, dont les Athéniens
furent les principaux fondateurs. Ennemie des Lucaniens et de Tarente, Thurium
devait entrer de bonne heure comme sa métropole, dans l’alliance de Rome.
Il est remarquable que toutes ces villes eurent un rapide
accroissement et que peu d’années leur suffirent pour devenir des États
comptant par cent mille le nombre de leurs combattants. Ce n’est pas
seulement l’heureux climat de la Grande-Grèce, la fertilité du sol, qui, dans
les vallées et les plaines des deux Calabres, surpassait celle de la Sicile[192],
ni même la sagesse de leurs législateurs Charondas, Zaleucos, Parménide et Pythagore,
qui firent ce prodige ; mais l’habile politique qui admit dans la cité
tous les étrangers[193],
et transforma, pour quelques siècles, les populations pélasgiques du sud de
l’Italie en un grand peuple grec. Sans doute des distinctions s’établirent,
et il y eut probablement dans les capitales des plébéiens et des
nobles ; dans les campagnes, des serfs de la glèbe, et dans les villes
conquises, des sujets ; mais ces différences n’empêchaient ni l’union ni
la force. C’est par ce moyen aussi, par cette assimilation des vaincus aux
vainqueurs, que Rome grandit. Mais Rome conserva longtemps sa discipline,
tandis que les villes de la
Grande-Grèce, minées au dedans par les divisions
intestines, menacées au dehors par Carthage et Syracuse, par les tyrans de la Sicile et les rois de
l’Épire, sans cesse inquiétées par les Gaulois italiens et les Samnites,
surtout par les Lucaniens, s’affaiblirent encore eu des rivalités qui
préparèrent aux Romains une facile conquête.
Si l’Ombrie doit son nom à une peuplade gauloise, nos
pères auraient une première fois passé les Alpes en corps de nation à une
époque fort ancienne[194].
L’invasion du sixième siècle est plus certaine. On dit que les tribus
gauloises du Nord-Ouest, refoulées sur les Cévennes et les Alpes par des
envahisseurs d’outre-Rhin, s’y accumulèrent et, comme des flots longtemps
amoncelés, débordèrent au nombre de trois cent mille par-dessus les Alpes
dans la vallée du Pô. Sur les bords du Tessin, le Biturige Bellovèse écrasa
une armée étrusque et établit son peuple, les Insubriens, entre ce fleuve, le
Pô et l’Adda[195].
Bellovèse avait montré la route; d’autres la suivirent.
Dans l’espace de soixante-six ans, des Cénomans, sous un chef surnommé
l’Ouragan (Elitovius), des Ligures, des Boïes, des
Lingons, des Anamans et des Sénons[196]
chassèrent les Étrusques des bords du Pô et les Ombriens des côtes de
l’Adriatique jusqu’au fleuve Esino (Æsis). Quelques débris
de la puissance étrusque et ombrienne subsistèrent cependant au milieu des
populations gauloises et formèrent de petits États libres, mais tributaires
et toujours exposés, par les mobiles affections de ces barbares, à de
soudaines attaques. Ainsi, Melpum fut surprise en trahison et détruite le
jour même, dit-on, où les Romains entraient dans Véies
Comme conquérants, les Gaulois ne dépassèrent pas les
limites où s’était arrêtée l’invasion des Sénons. Mais cette race vigoureuse,
ces hommes avides de bruit, de butin et de combats, troublèrent longtemps la
péninsule, comme tout l’ancien monde, avant que les légions pussent les
saisir au milieu de leurs forêts et les fixer au sol. Ils habitaient des
bourgs sans murailles, dit Polybe, dormaient sur l’herbe ou la paille et ne
savaient que combattre ou un peu labourer. Vivant surtout de chair, ils
n’estimaient que les troupeaux et l’or, richesses mobiles qui ne gênent point
le guerrier, et qu’il transporte partout, avec lui. Sous leur domination, la Cisalpine retourna à
la barbarie d’où les Étrusques l’avaient tirée : les forêts, les marécages
s’étendirent ; les portes des Alpes surtout restèrent ouvertes, et il en
descendit continuellement de nouvelles bandes, qui réclamèrent leur part du
pays de la vigne. Leur haute taille, leurs cris sauvages, leurs gestes
emportés et menaçants, et cette ostentation de courage qui, les jours de
bataille, leur faisait dépouiller tout vêtement pour combattre nus,
effrayèrent si fort les Italiens, qu’à leur approche il n’était personne qui
ne s’armât. Que dire de plus ? A Alexandre, jeune, heureux et menaçant,
les Gaulois du Danube répondirent qu’ils ne craignaient que la chute du
ciel ; et la première armée romaine qui vit ceux d’Italie s’enfuit épouvantée.
Rome cependant devait les rencontrer partout, à Carthage, en Asie, autour
d’Annibal, à ses portes même, et jusqu’au pied du Capitole !
L’Italie, à ce premier âge, n’a que cette histoire crépusculaire
dont les lueurs incertaines percent difficilement les ténèbres où se cache le
commencement des peuples. Cependant, à cette lumière encore douteuse, on peut
reconnaître quelques faits importants pour l’histoire générale et en
particulier pour celle de Rome.
Ainsi, tous ou presque tous les Italiotes appartenaient à
la race aryenne. Ils étaient plus rapprochés des tribus helléniques que les Germains
ne le sont des Celtes et des Slaves, rameaux détachés aussi de ce tronc
puissant. Niais si cette parenté avec les Grecs les disposait à subir un jour
l’influence de la civilisation hellénique, ils n’ont emprunté à leurs frères
de la Hellade
ni leur langue, ni leur culte, ni leurs institutions des premiers jours.
En ce qui concerne Rome, nous noterons les points suivants
:
Prépondérance, au huitième siècle, sur les deux rives du
Tibre, des Sabins et des Étrusques, et par conséquent leur influence sur les
institutions et les moeurs du peuple qui va s’élever auprès d’eux et qui
grandira à leurs dépens.
Faiblesse des Latins, qui favorisera les commencements de
la ville éternelle.
Puissance, mais génie indisciplinable des Sabelliens.
Divisions politiques des peuples italiens, entretenues par
la division même du sol et par la diversité de leurs origines.
Que maintenant, au milieu de ces peuplades rendues
étrangères les unes aux autres par un long isolement, on place un petit
peuple qui se fera de là guerre une nécessité, de l’exercice des armes une
habitude, de la discipline militaire une vertu, et l’on comprendra que ce
peuple, formé pour la conquête, triomphe de toutes ces tribus dont beaucoup
ont d’ailleurs avec lui communauté d’origine et qui, attaquées
successivement, s’apercevront trop tard que la ruine de l’une était la menace
et l’annonce de la ruine prochaine de l’autre.

VI. Organisation politique des
anciens peuples de l’Italie
En Italie, comme dans le reste de l’Europe, la plus
ancienne civilisation paraît retenir quelque chose des formes théocratiques
de l’Asie, d’où elle est venue, avec cette différence, toutefois, qu’on n’y
trouve pas un ordre de prêtres distinct du reste des citoyens. Les mêmes
hommes furent chefs du peuple, en même temps que ministres des dieux; de sorte
que, selon le génie plus humain, plus politique de l’Occident, les
rapports étaient inverses de ce qu’ils avaient été dans l’Orient : le
guerrier primait le prêtre ; avant d’être pontife, augure, le noble fut
patricien ; il ne s’enferma pas dans le sanctuaire, mais vécut sur la place
publique ; il ne resta pas lié à des formes immuables, mais les modifia
suivant les besoins de l’État ; la religion, enfin, ne fut pas pour lui
seulement un but, mais aussi un moyen, instrument d’autant plus redoutable,
qu’il était employé par des croyants et que la politique pouvait s’aider
encore du fanatisme religieux.
Chez les Étrusques, ces deux caractères du prêtre et du
guerrier paraissent dans un parfait équilibre. Leurs lucumons, seuls
instruits de la science augurale, seuls éligibles par droit héréditaire aux
fonctions publiques, gardiens des mystères et maîtres de toutes les choses
divines et humaines, forment une théocratie militaire fondée sur le droit
divin et l’ancienneté des familles. Chez les peuples osques et Sabelliens,
l’équilibre semble rompu au profit du guerrier. Le chef, c’est l’homme vénéré
pour l’antiquité de sa race et la grandeur de sa maison, puissant par
l’étendue de ses domaines, par le nombre de ses proches, de ses serviteurs et
de ses clients.
Les peuples pasteurs et agriculteurs, par cela même qu’ils
restent plus près de la nature, la suivent davantage dans leurs institutions;
pour eux, Juifs et Arabes, Celtes de l’Écosse et de l’Irlande, ou indigènes
du Latium et de la Sabine,
la famille est le premier élément de la société, et l’autorité patriarcale du
chef qui, comme Abraham, combat et sacrifie tour à tour, est le premier des
gouvernements. A Rome, tous les droits vinrent de la famille : les chefs de
l’État furent les Pères, patres et patricii ; la propriété fut le patrimonium ; la patrie, la chose commune
des pères, res patria. Toutefois le
droit d’aînesse, qu’on trouve chez tant de peuples, était inconnu aux bords
du Tibre. A la famille se rattachent les serviteurs, dévoués pour la vie et
la mort à celui qui les nourrit et les protège, qui les mène au combat et les
enrichit de butin, comme les comites germaniques, les soldurii aquitains, les membres des clans
écossais, comme, enfin, les clients italiens l’étaient à leur patron. Le
patronat, patrocinium[197],
et le patriciat doivent donc être élevés du rang d’une institution particulière,
où les historiens les ont tenus longtemps, à la hauteur d’une loi de
l’organisation même des sociétés primitives. Alors que les institutions
manquent, il faut bien, pour que l’État se forme, qu’il y ait entre le fort
et le faible, entre le riche et le pauvre, une première association :
association aux obligations variées, accordant ici plus, là moins, à la
liberté du protégé et aux droits du protecteur. A Rome, cette relation
s’appela la clientèle ; au moyen âge, ce fut la féodalité.
Comme les lucumons étrusques, les patriciens latins et
sabins étaient les prêtres de leurs familles et de leurs clients; ils
sacrifiaient aux pénates domestiques; ils accomplissaient les rites publics
et occupaient les magistratures; en un mot, ils avaient l’autorité religieuse
comme l’autorité politique. Mais, dans le Latium, la religion protégeait
moins qu’en Étrurie leurs privilèges, parce qu’elle était plus populaire.
Aussi les grands de Rome se hâteront-ils d’emprunter aux Étrusques leur
science augurale et d’acheter bien cher les livres sibyllins, afin de placer
à côté de la religion populaire, accessible à tous, une religion d’État,
réservée pour eus seuls.
De cette union entre la politique et la religion, de ce
double caractère de l’aristocratie italienne, surtout en Étrurie, il résulta
que le droit public et le droit privé furent étroitement unis au droit
religieux ; que la religion fut, comme dans l’Orient, le lien de toute cité,
le principe de toute jurisprudence, et que les vieilles législations placées
sous la sanction divine en eurent une autorité plus respectée. En outre,
comme il est de l’essence de toutes les religions, de celles surtout qui sont
entre les mains des chefs de l’État, d’aimer le mystère, les lois civiles,
enveloppées dans les lois religieuses[198],
furent secrètes et mystérieuses. Conservées dans un
langage muet, et ne s’expliquant que par des cérémonies saintes, dont
quelques rites subsistèrent dans les acta legitima, elles furent
longtemps obéies avec les scrupules de la piété (Vico, II, 285). L’aristocratie,
qui en était seule dépositaire, y trouva un pouvoir que, durant des siècles,
la plèbe n’osa lui disputer.
La plus grande force de cette aristocratie était cependant
la possession du sol, hème en Étrurie, où l’industrie et le commerce avaient
créé la richesse mobile de l’or à côté de la richesse immuable de la terre.
Posséder la terre était, comme au moyen âge, non seulement le signe de la
puissance, mais la puissance même, parce que de vastes domaines donnaient
toute une armée de serviteurs et de clients. Primitivement ces domaines
étaient égaux[199],
et ces aristocraties formaient elles-mêmes, par le nombre et l’égalité de
leurs membres, de véritables démocraties. Dans les États gréco-italiens,
ordinairement nés de migrations peu nombreuses, colonies ou printemps
sacrés, la société préexistait à la propriété. Il y avait des citoyens
avant qu’il y eût des possesseurs du sol, et, lorsqu’une ville s’élevait, la
terre pouvait être géométriquement divisée : chaque citoyen en recevait
une portion égale. Ce principe de l’Europe féodale et constitutionnelle, que
les droits politiques découlent de la propriété, était donc pris dans un sens
inverse par l’antiquité. A Lacédémone, c’est comme Doriens, comme citoyens
fondateurs de l’État, que les Spartiates obtiennent 9000 lots, et aucun droit
nouveau ne sort pour eux de cette concession de propriétés. Avant d’avoir
chacun leur part de la terre promise, les Hébreux sont tous égaux, tous
membres du peuple de Dieu, et ils restent après le partage ce qu’ils étaient
auparavant. En Égypte, à Cyrène, dans toutes les colonies grecques, de
semblables partages ont lieu sans impliquer aucune conséquence politique[200].
Chez nous, ces lois agraires seraient une mesure
souverainement inique, parce que la propriété y représente les fruits
accumulés du travail de soixante générations; dans l’antiquité, elles
n’avaient pour résultat que d’augmenter le nombre des citoyens, de revenir
sur des usurpations injustes, de ramener l’État à l’égalité primitive. Elles n’en
furent pas moins repoussées avec violence là où se forma, comme à Rome et
dans l’Étrurie, au-dessous du peuple primitif, un second peuple pauvre et
opprimé qui serait devenu trop redoutable, si à la puissance du nombre il
avait joint celui de la fortune. Pour prévenir ces réformes, la religion même
fut appelée en aide à la loi civile, et elle imprima à la propriété
territoriale un caractère sacré. C’est elle qui divisait les terres, qui, par
des prières, des libations et des sacrifices, marquait les bornes qu’on ne
pouvait déplacer sans encourir l’indignation divine[201].
Numa… statu eum qui terminum exarasset, et ipsum
et boves sacros esse. Cette religion de la propriété eut son dieu,
Terminus, le gardien immuable des limites, qui, dans la tradition, ne veut pas
reculer, même devant le maître de la terre et du ciel. Malheur, disait une vieille prophétie, à celui qui déplacera Terminus pour augmenter son
domaine ! Sa terre sera battue des orages, son blé rongé par la nielle,
sa maison renversée, et toute sa race s’éteindra. Jamais la propriété
territoriale n’a été plus énergiquement protégée, et avec elle la puissance
héréditaire des riches. Aussi la société romaine resta-t-elle jusqu’à son
dernier jour profondément aristocratique.
Cette consécration de la propriété fut surtout l’œuvre des
Étrusques ; leurs conquêtes ou leur influence en étendirent l’usage dans une
grande partie de la péninsule, et nulle divinité, dit Varron, ne fut plus
honorée par toute l’Italie que le dieu des Limites[202].
Sur cette double base de la religion et de la propriété
s’éleva donc la vieille aristocratie italienne et plus tard celle de Rome.
Réunissant ces deux éléments de force, qui, séparés, donnent encore chacun la
puissance, quels ne devaient pas être son ascendant et sa durée ? Aussi,
tant que la cité ne prit pas des proportions d’empire, il ne s’y éleva point
de familles possédant la puissance par droit héréditaire. Les magistrats sont
électifs, presque toujours annuels, comme les lucumons de l’Étrurie, le meddix tuticus des Campaniens[203],
le préteur ou le dictateur des cités latines. Dans les circonstances graves,
on élisait un chef suprême, tel que l’embradur
(imperator)
des Sabelliens, le roi que nommaient les douze cités étrusques, en lui
envoyant chacune un licteur en signe du pouvoir qui lui était donné sur la
nation entière (Tite
Live, I, 8), tel enfin que ce dictateur de Tusculum, Egerius, qui fut
reconnu chef de la confédération latine, pour faire la dédicace du temple
commun d’Aricie. Durant l’époque héroïque, la légende montre des rois dans le
Latium; mais, au temps de la fondation de Rome, il en reste seulement dans les
petites villes de la Sabine[204].
Albe même n’avait plus que des dictateurs, et déjà se répétaient, en haine du
nom royal, des récits populaires sur les cruautés de Mézence et de ces tyrans
qui, frappés par la colère divine, avaient été ensevelis avec leurs palais au
fond du lac d’Albano. Quand les eaux baissaient, on croyait voir ces demeures
coupables[205].
Sur une colline, au bord d’un lac ou sur les rives
escarpées d’un fleuve, mais toujours dans une position d’un accès difficile[206],
s’élevait la capitale de chaque État, ordinairement peu étendue et fortifiée,
surtout en Étrurie, avec tout l’art du temps. Fæsulæ, Rusellæ, Populonia,
Cosa, dont on peut reconnaître encore l’enceinte, n’avaient que trois quarts
de lieue de tour, Volaterræ une lieue et demie, et Véies, la plus grande des
cités étrusques, moins de deux lieues et demie. Les cités latines n’étaient
pas, à beaucoup prés, aussi vastes. Encore réservait-on, suivant le rituel
étrusque, suivi dans le Latium, un espace libre entre les premières
constructions et les murailles, comme au dehors entre le mur et les champs
cultivés. C’était le pomerium,
l’enceinte sacrée de la cité, dans laquelle n’habitaient que les citoyens
véritables, c’est-à-dire les chefs de famille, les pères ou patriciens avec
leurs serviteurs et leurs clients (gentes patriciæ). Les
plébéiens, les étrangers, restaient au delà du pomerium, en dehors de la cité
politique.
Sur une place réservée au centre de la ville, les
patriciens se rassemblaient en armes[207],
comme les Germains et les Gaulois, pour délibérer sur leurs communs intérêts.
Suivant les rituels étrusques[208],
ils devaient être partagés en tribus, curies et centuries, dont le nombre
était déterminé par une sorte d’arithmétique sacrée. Les tables Eugubines
montrent que cette division avait lieu aussi dans l’Ombrie ; mais les Osques
et les Sabelliens, plus libres que les Étrusques des entraves sacerdotales,
ne paraissent pas avoir connu cette mystérieuse autorité du nombre qui jouera
un grand rôle à Rome.
Dans les États soumis à une aristocratie puissante, il se
trouve souvent à côté du peuple docile un peuple révolté qui habite les
forêts profondes et qui vit de pillages. Ces outlaws, les héros des temps barbares,
durent être nombreux dans l’ancienne Italie, où d’ailleurs, au milieu de tant
de cités rivales, l’esprit militaire, entretenu par des guerres continuelles,
donna naissance à des bandes de mercenaires qui vendaient leurs services,
comme les condottieri du moyen âge, ou qui guerroyaient pour leur compte[209].
On verra la fortune des Mamertins en Sicile. Celle de quelques chefs toscans
ne fut pas moins brillante[210],
et le condottiere étrusque Mastarna, gendre et héritier de Tarquin l’Ancien,
rappelle involontairement cet autre condottiere, François Sforza, gendre
aussi et successeur d’un duc de Milan. Romulus lui-même, proscrit dès sa
naissance, rejeté de la caste patricienne d’Albe, associé, dans la tradition[211],
à d’autres condottieri également repoussés par l’aristocratie étrusque, ne
semble pas autre chose qu’un de ces chefs de guerre qui sut choisir avec un
merveilleux instinct l’admirable position de Rome, et cacher son nid d’aigle
entre ce fleuve, ces collines boisées et les plaines marécageuses qui, de
leur pied, s’étendaient jusqu’au Tibre.

VII. Organisation religieuse
L’Italie primitive n’a eu, excepté dans l’Étrurie, ni
mystères ni doctrines profondes. La religion y fut simple ; elle
dérivait des nécessités de la vie, des travaux des champs[212],
des impressions d’admiration ou d’effroi que causait cette belle et mobile
nature. Dans cette religion essentiellement rurale, tout le culte se passait
en plein air. C’étaient les prémices du champ et du troupeau offertes au dieu
sur l’autel des sacrifices qui s’élevait en avant du temple, des chants
pieux, des prières, des danses religieuses, des guirlandes de fleurs et de
feuillage suspendues aux murs sacrés et, lorsque les fidèles étaient assez
riches pour pareille dépense, quelques grains d’encens bridés sur l’autel et
des parfums dans l’intérieur du sanctuaire où la présence réelle du dieu
remplissait l’âme d’une pieuse terreur.
Un des traits qui distinguent ces cultes de l’Italie
centrale est la supériorité morale de leurs dieux : ainsi, Vesta, la vierge
immaculée, qui conserve à la fois le foyer domestique et le foyer public (focus publicus)[213]
; les dieux pénates, protecteurs de la vie humaine et de la cité; Jupiter,
arbitre du monde physique et du monde moral, père nourricier et suprême
conservateur; le dieu Terme et la
Fidélité, qui punissent la fraude et la violence; la Bonne Déesse, qui
faisait fructifier la terre et rendait les unions fécondes, bien qu’elle-même
fût restée toujours vierge[214] ;
et ce culte touchant des Mânes, dii manes,
qui, rendant la vie aux êtres qu’on avait aimés, montrait les aïeux veillant,
par delà le tombeau, sur ceux qu’ils avaient laissés parmi les vivants. Trois
fois chaque année les mânes quittaient les enfers, et le fils qui avait imité
les vertus de ses pères pouvait voir les ombres vénérées.
Les dieux de la
Grèce sont si près de l’homme, qu’ils en ont toutes les
faiblesses; ceux de l’Orient en sont si loin, qu’ils ne se mêlent point
véritablement à sa vie, malgré leurs nombreuses incarnations. Les dieux
italiens, gardiens de la propriété, de la foi conjugale et de la justice,
protecteurs de l’agriculture, dispensateurs de tous les biens terrestres,
président aux actions des hommes sans partager leurs passions, mais aussi
sans élever leur esprit au-dessus des préoccupations égoïstes. L’art et la
science y perdent ; la moralité y gagne[215].
L’Olympe romain ne sera ni brillant de vie, de lumière et de beauté, comme
celui de la Grèce
; ni profond, mystérieux et terrible, comme ceux de l’Égypte ou de l’Inde.
Ses dieux seront des dieux obscurs et utiles[216],
à qui, pendant de longues années, des adorateurs intéressés n’oseront
adresser que de justes prières. Leur culte sera pour cette société sans
enthousiasme un moyen de conservation, il ne sera pas un élément de progrès.
Ces divinités modestes ne pouvaient montrer les
redoutables exigences qu’on trouve dans de plus puissantes théogonies. Elles
ont bien rarement demandé du sang humain sur leurs autels ; mais elles
acceptent un sacrifice volontaire, le rachat du peuple par le dévouement
d’une victime, Curtius, qui ferme, en s’y précipitant, le gouffre ouvert au
sein de la ville[217],
et Decius, qui par sa mort change la défaite en victoire.
Un autre caractère des dieux italiens est leur multitude
infinie. Chaque ville a sa divinité protectrice. C’est Visidianus à Narnia,
Valentia à Ocriculum, Delventius à Casinum, Marica à Minturnes, Palina chez
les Frentans, Matuta Mater à Satricum ; dans la Sabine, Nerio, qui fut
identifiée par la gens Claudia avec la Bellone romaine, épouse
ou sœur de Mars[218].
Il y faut joindre les nombreux Semones
et Indigetes, les nymphes, les héros,
les vertus déifiées : Concordia, Mora, Pomona, Juventas, Pollentia, Rumina, Mena,
Numeria, et la foule des divinités locales que Tertullien appelle énergiquement
decuriones deos, et les dieux du monde
souterrain, Larves et Lémures, et ceux des indigitamenta,
ces livres qui étaient à la fois des recueils de prières dont les prêtres
gardaient le secret et des listes d’êtres divins que Tertullien compare aux
anges de la Bible ;
on pourrait dire qu’ils font aussi penser à quelques-uns des saints de nos
croyances populaires.
Non seulement chaque ville, mais chaque famille, chaque homme,
honorait des dieux particuliers et des génies protecteurs de sa vie et de ses
biens (Lares,
Pénates) : on en avait pour tous les actes de l’existence, depuis la
naissance jusqu’à la mort[219].
Aussi, à la fin de la république, Varron put compter jusqu’à trente mille
dieux. Chez les peuples dans l’enfance, la langue, trop pauvre, supplée par
la variété des termes particuliers à l’absence du terme général qui aurait
représenté l’unité de l’espèce. Les Italiens n’avaient tant de divinités que
parce que leur esprit était incapable de s’élever à la conception d’un Dieu
unique : impuissance qui, pour eux, dura bien longtemps et qui, pour d’autres,
dure toujours.
Cette démocratie divine échappait nécessairement à
l’autorité et au contrôle des grands dieux et de leurs prêtres. C’est
pourquoi la tolérance religieuse fut une des nécessités du gouvernement
romain; et si les patriciens n’avaient eu le secret de la science augurale,
des formules et des cérémonies symboliques, ils n’auraient pu joindre à
l’ascendant de la naissance et de la fortune celui de la religion.
Quelques dieux avaient de plus nombreux adorateurs, tels
que Jupiter, le dieu de l’air et de la lumière ; Janus, le Soleil, qui
ouvrait et fermait le ciel et l’année ; Saturne, le protecteur du
travail rustique dont la statue creuse était remplie de l’huile des oliviers
qu’il avait fait pousser ; Mars ou Maspiter, le symbole de la force
virile, appelé aussi Mavors, le dieu qui tue ; Bellona, la terrible sœur du dieu
de la guerre ; Juno Regina, la reine du ciel, et aussi la secourable, Sospita,
en qui la femme, à tous les moments de sa vie, trouvait assistance, mais qui
ne favorisait que les chastes amours et les unions inviolées ; etc.
Le culte de ces divinités était souvent lé seul lien qui
rattachât les unes aux autres des cités d’une même origine. Ainsi les
Étrusques s’assemblaient au temple de Voltumna ; les Latins, au bois sacré de
la déesse Ferentina, dans le temple de Jupiter Latialis, sur le raout Albain,
et dans ceux de Vénus, à Lavinium et à Laurentum[220] ;
les Èques, les Rutules et les Volsques, au temple de Diane, à Aricie. De
semblables réunions avaient lieu chez les Sabins, les Samnites, les
Lucaniens, les Ligures, etc. C’étaient de véritables amphictyonies que la
religion présidait et que les Romains rompirent après qu’ils se furent
eux-mêmes servis des féries latines pour assurer leur suprématie sur le
Latium.
En religion comme en politique, les Étrusques se distinguaient
primitivement du reste des peuples italiens, auxquels, dans la suite, ils
prirent ou donnèrent des dieux. Leurs doctrines religieuses, écho lointain
des grandes théogonies asiatiques, proclamaient l’existence d’un être suprême,
Tinia, l’âme du monde, qui avait pour conseillers les dii consentes, personnifications des forces de
la nature présente et destinés à périr avec elle ; car la croyance scandinave
et orientale de la destruction et du renouvellement du monde se trouvait
aussi dans l’Étrurie.
Ces dii consentes
pouvaient lancer la foudre, mais pas plus d’une à la fois. Seul, Tinia, qui
se confondit avec Jupiter, manifestait sa volonté par trois éclairs
consécutifs. Aussi était-il représenté tenant un foudre à trois pointes. A
côté de lui siégeaient Thalna ou Junon, Menafru ou Minerve, sa famille
divine. Vejovis était le soleil malfaisant ; Summanus, le dieu de la nuit
et des tonnerres nocturnes ; Sethlans ou Vulcain, le grand
forgeron ; Nortia, le Sort ou la Fortune, etc. Par un contraste bizarre, Nortia
prêtait les parois de son temple pour qu’on y enfonçât le clou sacré qui
marquait l’ordre inflexible du temps et le retour régulier des années. Plus
haut, cachés dans les profondeurs insondables du ciel, des déités
mystérieuses dont on ne prononçait pas le nom, les dii involuti ou voilés jouaient le rôle du destin auquel les
dieux mômes étaient soumis ; ils servaient à expliquer l’inexplicable
mystère de la vie.
L’homme de tous les temps a voulu franchir par la pensée
le seuil de la mort et regarder, par delà, dans le grand inconnu. Plus sa vue
était incertaine et confuse, plus son esprit y plaçait de vagues fantômes.
Croyant que la mort sépare deux choses distinctes, niais non point absolument
différentes : le corps, qui tombe
inanimé, et l’autre moi, celui des rêves, des souvenirs et des espérances,
qui subsiste[221],
on regardait cet autre moi comme formé d’une substance corporelle. A
l’exception de Pythagore et de Platon, toutes les philosophies, toutes les
religions de l’antiquité classique, même quelques-uns des premiers pères de
l’Église, admettaient la corporalité de l’âme. Ombres impalpables et pourtant
matérielles, les génies étaient comme une secondé humanité qui peuplait
l’univers invisible. On en voit un dans une peinture étrusque qui représente deux
vieillards pleurant un mort dont le génie vole au-dessus d’eux, sous la forme
d’une femme ailée.
Les Lares étaient les génies de la famille ; les
Mânes, ceux des morts qu’on avait perdus. Des génies habitaient les bois, les
sources, les grottes mystérieuses ; les Romains en donneront même à tout
ce qui aura une sorte de vie collective, à la curie, à la légion, à la
cohorte. Alors tout homme et toute chose aura le sien.
Quand les dieux sortirent de la pénombre qui les
enveloppait aux anciens jours et que les théogonies mirent l’ordre dans le
peuple divin, les génies devinrent les ministres de leurs volontés
bienfaisantes ou terribles. La sombre imagination des Étrusques se plaisait à
figurer, sur leurs vases et sur leurs peintures murales, des génies infernaux
armés de serpents, des monstres hideux, un Charon grimaçant qui traînait les
défunts aux enfers ou qui, armé d’un lourd marteau, assistait aux sacrifices
humains pour achever les victimes que le couteau aurait épargnées. Quelque
chose de ce génie lugubre semble avoir survécu dans la Toscane moderne.
Qu’est-ce que les gorgones et les pentures hideuses des Étrusques à côté des
formidables tableaux de Dante et de Buonarotti ?
Une différence essentielle entre cette religion art les
cultes asiatiques était la science augurale. L’inconnu fait peur à l’enfant
et attire l’homme, qui le redoute encore, mais y cherche, suivant l’âge du
monde, le merveilleux ou la science. Or les hommes de ce temps étaient dans
l’âge du merveilleux, et ils demandaient aux phénomènes physiques, au lieu
d’une révélation des lois de la nature, celle de l’avenir.
Les Assyriens croyaient lire dans les étoiles ces secrets
impénétrables; lés Étrusques les cherchaient dans les phénomènes terrestres,
dans le vol des oiseaux et les entrailles des victimes. Les Grecs et les
Italiens pratiquaient les deux derniers genres de divination; mais les
Étrusques en précisèrent les règles et en firent un art compliqué. Ils
étaient surtout habiles à interpréter les signes fournis par la foudre et les
éclairs[222].
Quand les échos de l’Apennin répétaient les éclats du tonnerre nocturne,
c’était le dieu Summanus qui parlait,
et il fallait comprendre sa voix.
Ce pays si souvent effrayé alors par les tremblements de
terre et où, à raison de la fréquence des orages, la foudre fait encore tant
de victimes, cette terre, si fertile et toujours si menacée, devait plus
qu’une autre nourrir les terreurs religieuses. On eut foi en une puissance
occulte qui manifestait sa volonté en dehors de l’ordre régulier des choses,
et l’art d’expliquer les prodiges, de gagner la faveur de cette redoutable
puissance, devint la science suprême[223].
Les grands seuls la connurent, et, dans leurs plains, elle devint une arme
longtemps infaillible contre les innovations populaires. Dans ces rituels
tout était prévu, car le prêtre, pour mieux assurer son pouvoir, ne voulait
pas qu’il y eût une seule action indifférente ; et une honteuse
superstition s’appesantit sur le peuple, enchaîna sa langue, son esprit et
jusqu’à ses gestes. Mais plus lourd avait été le joug, plus violente aussi
fut la révolte : à la foi aveugle succédera, dans le dernier siècle de la
république, la plus audacieuse incrédulité. On ne croira qu’au hasard, à la
fortune ; plus tard encore, à rien, si ce n’est au plaisir effréné, puis
au repos dans la mort ; des voluptés sans nom et, après la satiété, le
suicide.
Ainsi, chez les Osques et les Sabelliens, un culte simple,
avec des dieux sans nombre ; dans l’Étrurie, une religion qui voulait
rendre compte de la vie et de la mort, du bien et du mal, qui, montrant
partout l’intervention arbitraire des dieux et, dans les phénomènes naturels,
une manifestation de leurs volontés capricieuses, rendait nécessaire une
classe d’hommes voués, pour le salut publie de la cité, pour les intérêts
privés de chaque citoyen, à l’interprétation et à l’expiation des présages.
Tout cela devait entrer dans Rome, le sacrificateur latin ou sabin et
l’augure toscan, le culte populaire et la religion sacerdotale.
Mais nous n’y voyons pas entrer ces oracles de la Grèce qui ont été si
souvent la voix de la sagesse et du patriotisme, ni ces poètes sacrés de
l’Orient dont les chants épuraient les croyances nationales. En Italie, la
religion, qui était un contrat avec les dieux bien plus qu’une prière et un
acte de reconnaissance, n’ouvrit jamais les larges horizons où l’esprit prend
des ailes, et le génie latin fut frappé par ce culte sans grandeur d’une
incurable stérilité. Les hautes facultés lui manquèrent, au moins pour
l’invention, et il n’eut ni la philosophie, cette compagne meurtrière mais
inévitable des grandes religions, parce qu’elle est la recherche de l’idéal
dans la pensée, ni l’art, qui est la recherche de l’idéal dans le sentiment
et dans la nature. Tandis que les glorieux artistes de la Grèce pénétraient du
regard au fond de l’Olympe pour y prendre l’image de Zeus et d’Athéné, le
Romain se voilait la tête en accomplissant les rites sacrés ; il
craignait de voir ses dieux, et jamais il n’a tenu en grande estime ceux qui
essayaient de les lui montrer en marbre ou en bronze.
On pourrait revendiquer encore, au nom des anciennes
populations de la péninsule, les institutions religieuses de Numa, et
regarder les Douze Tables comme un monument des vieilles coutumes italiennes.
Les lois sur le mariage, sur la puissance du père et de l’époux, sur l’usure,
appartiennent certainement aux temps les plus reculés, et l’atrocité des peines
rappelle la froide cruauté des âges héroïques, comme d’autres lois et
certains usages paraissent pris à une société de pasteurs encore nomades[224].
N’oublions pas non plus le droit fécial établi par les Èques, l’ordre de
bataille (acies) des Étrusques, dont l’infanterie
serrée en lignes profondes ressemblait à une muraille d’airain (murum ferreum) ; leurs couronnes d’or imitant
les feuilles du chêne, pour récompense militaire ; l’armement du soldat
samnite, qui devint celui du légionnaire, et le culte simple, la vie frugale,
l’éducation sévère des pâtres et des laboureurs de la Sabine et du Latium ; le
luxe et les arts de l’Étrurie, une foule enfin de coutumes qui montreraient
déjà Rome dans l’ancienne Italie, s’il n’y fallait ajouter quelque chose de très
romain, l’idée de l’État dominant tout et cette admirable discipline qui,
d’éléments si divers, formera une société originale et le plus puissant
empire que le monde eût encore connu.

VIII. Résumé
Voici une bien lente excursion dans l’ancienne
Italie ; mais, si nous ne nous trompons, ce détour n’aura fait
qu’abréger notre route. Quoique nous n’ayons marché dans ce long voyage
qu’éclairés par des lueurs confuses, nous avons pu entrevoir les origines
mêmes de Rome, les institutions d’où les siennes sont sorties, les peuples
qui, après avoir formé sa population, lui ont donné ses plus grands hommes.
Dans les fastes consulaires, on trouve, parmi les consuls des années 510 à
460, des Volsques, des Aurunces, des Sicules, des Sabins, des Rutules, des
Étrusques et des Latins. Parmi les grandes familles :
Les Jules, les Servilius, les Tullius, les Geganius, les Quinctius,
les Curatius, les Clœlius, viennent d’Albe ;
Les Appius, les Postumius, et probablement les Valerius,
les Fabius, et les Calpurnius, qui se disaient descendants de Numa, de la Sabine ;
Les Furius et les Hostilius, de Medullia dans le
Latium ;
Les Octavius, de Vélitres ;
Les Cilnius (Mécène était de cette famille) et les Licinius,
d’Arezzo ;
Les Cœcina, de Volaterræ ;
Les Vettius, de Clusium ;
Les Pomponius, les Papius, les Coponius, de l’Étrurie ;
Les Coruncanius et les Sulpicius, de Camerium ;
Les Porcius, les Mamilius, la prétendue postérité d’Ulysse
et de Circé, de Tusculum, etc. ;
Parmi les grands noms de la littérature romaine, deux
seulement, ceux de César et de Lucrèce, appartiennent vraiment à Rome ;
tous les autres sont Italiens : Horace est Apulien ; Ennius,
Messapien ; Plaute, de l’Ombrie ; Virgile, de Mantoue ; Stace,
d’Élée ; Nœvius, de la
Campanie ; Lucilius, de Suessa-Aurunca. Cicéron est
Volsque, comme Marius ; Ovide, Pélignien ; Caton, Tusculan ; Salluste,
Sabin ; Tite Live, de Padoue ; les deux Pline, de Como ; Catulle,
de Vérone. Térence était même Carthaginois. Voilà pour les hommes, passons
aux choses.
De l’Étrurie vinrent à Rome: la division en tribus, curies
et centuries, l’ordonnance de bataille, les ornements des magistrats, le laticlave,
la prétexte, la toge, l’apex[225],
les chaises cupules, les licteurs, tout l’appareil des triomphes et des jeux
publics, les nundines[226],
le caractère sacré de la propriété et la science augurale, c’est-à-dire la
religion d’État. — Du Latium, les noms de dictateur et de préteur, le droit
férial, une religion simple qui plaçait sous la protection des dieux tous les
travaux de la vie champêtre, le culte de Saturne, protecteur de
l’agriculture, et celui de Djanus et de Djana, le Soleil et la Lune, réunis dans le double
Janus, enfin des habitudes agricoles et la langue mérite. Du Samnum et de la Sabine, le titre d’imperator, l’amure et les traits des soldats,
des mœurs sévères et religieuses et des divinité guerrières. — De tous les
peuples qui l’entouraient, le patriciat ou le patronat, la division en gentes, la clientèle, l’autorité paternelle, le
culte des dieux lares et des dieux fétiches, tels que le pain ou Cérès, la lance
ou Mars, les divinités des fleuves, des lacs et des eaux thermales. Enfin,
comme expression fidèle de cette formation de, la société romaine, Romulus et
Tullus sont Latins ; Fuma et Ancus, Sabins ; Servius et les deux
Tarquins, Étrusques.
On trouve dans Plutarque cette belle et expressive légende
: Romulus, dit-il, appela de l’Étrurie des hommes qui lui enseignèrent les
cérémonies saintes et les formules sacrées. Ils firent creuser un fossé
autour du Comitium, et chacun des
citoyens de la nouvelle ville y jeta une poignée de terre apportée de son
pays natal. Puis on mêla le tout et l’on donna au fossé, comme à l’univers,
le nom de monde[227].
Ainsi devaient tomber dans le sein de Rome et s’y mêler,
toutes les nationalités italiennes, toutes les puissances, toutes les
civilisations de l’ancien monde.
|