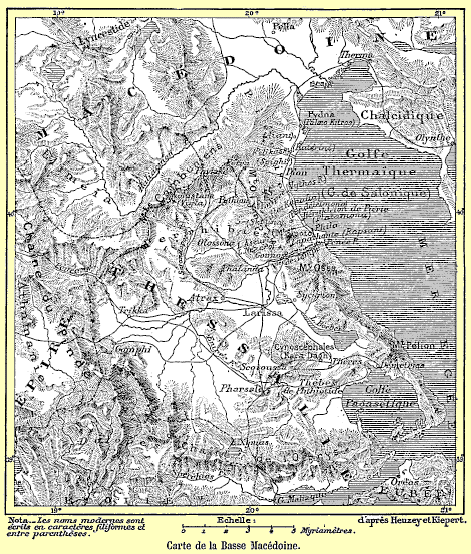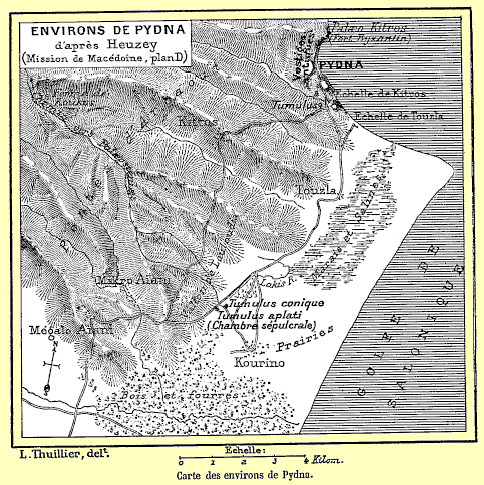|
I. Derniers jours de Philippe ; Persée
La défaite d’Antiochus et la ruine des Étoliens avaient
satisfait l’orgueil humilié de Philippe, mais lui avaient enlevé les seuls
auxiliaires qui auraient pu le sauver. Il restait seul maintenant en face de
Rome ; et, aux outrages qu’elle lui prodiguait, il devait comprendre que sa
ruine était résolue. Pour prix de son alliance durant la guerre d’Antiochus,
le Sénat lui avait abandonné les conquêtes qu’il pourrait faire ; à
peine la victoire des Thermopyles eut-elle été gagnée qu’on arrêta ses
progrès. Il allait prendre Lamia, en Thessalie ; Acilius lui ordonna d’en
lever le siège ; il avait conquis l’Athamanie, on laissa aux Étoliens le
temps de l’en chasser. Trop bien surveillé dans la Grèce, il se détourna sur la Thrace, et y fit à petit
bruit des conquêtes importantes. Les villes maritimes d’Ænos et de Maronée
reçurent ses garnisons[1]. Mais, de ce
côté, Eumène épiait toutes ses démarches et le dénonça à Rome. Dés qu’on sut
que les bannis de Maronée et d’Ænos y étaient bien accueillis, des
Thessaliens, des Magnètes, des Athamanes, etc., accoururent[2], et le Sénat
envoya trois commissaires, qui, pour montrer à tous les Grecs son humiliation
et sa faiblesse, forcèrent le roi à comparaître devant eux comme un accusé
ordinaire[3]. Il leur avait
enlevé, disaient les Thessaliens, cinq cents jeunes gens des premières
familles; il avait ruiné le port de Thèbes, en Phthiotide, au profit de
Démétriade, et tendu des piéges à tous les députés envoyés par eux à
Flamininus. Comme des esclaves tout à coup
affranchis, répliqua le roi, ces gens ne
savent user de la liberté que pour insulter leur maître ; au reste,
ajouta-t-il fièrement, le soleil ne s’est pas encore couché pour la dernière
fois[4].
Est-il nécessaire de dire que les commissaires prononcèrent contre lui (185) ? Tite Live et
Polybe l’accusent d’une cruauté qui était habituelle à tous ces rois[5], et le premier
raconte en preuve une histoire où l’on voit combien la vie de ce temps était
dure : Philippe avait fait tuer un des principaux Thessaliens et ses deux
gendres. Les veuves avaient chacune un fils en bas âge; l’une refusa de se
remarier; l’autre épousa Poris, le plus considérable des citoyens d’Inia en
Chalcidique, et mourut après lui avoir donné plusieurs enfants. Sa sœur,
Théoxène, afin de veiller de plus près à l’éducation de ses neveux, unit sa
destinée à celle de Poris et fut une véritable mère pour tous ses enfants.
Survint un ordre du roi prescrivant que les fils de ceux qu’il avait fait
périr lui fussent remis. C’était la mort ou l’infamie qui les attendait.
Théoxène déclara qu’elle les tuerait plutôt que de les livrer, et Poris
essaya de fuir. Il s’embarqua de nuit avec tous les siens pour les conduire à
Athènes : mais le vent était contraire; quand le jour parut, ils se
trouvaient encore en vue du port, et un navire courut à leur poursuite.
Théoxène, prévoyant ce danger et résolue à y soustraire ses enfants, avait emporté
des armes et du poison. La mort, leur
dit-elle, est notre unique ressource : voici deux
moyens d’y arriver. Les uns prennent le poison, d’autres le
poignard ; elle les jette mourants à la mer et s’y précipite elle-même
avec son époux[6].
Quelque accoutumé qu’on fût à de pareils destins, cette
fin tragique d’une famille entière excita l’horreur, et le pieux historien
veut que de ce jour les dieux aient marqué Philippe pour être leur victime.
Rome allait se charger d’exécuter l’arrêt d’en haut.
L’intervention des dieux n’était pas nécessaire, la
politique suffisait, et le roi la mettait contre lui par d’imprudentes
démarches que Rome dut regarder comme des provocations. Il était bien d’ouvrir
des mines, d’établir de nouveaux impôts, de favoriser le commerce : il ne l’était
pas d’essayer d’accroître la population de son royaume par des procédés
asiatiques qui soulevèrent contre lui des haines sans lui apporter beaucoup d’avantages.
Les villes maritimes lui étaient peu affectionnées; il en transporta les
habitants dans la Pæonie
et les remplaça par des barbares. Sous prétexte de porter secours aux
Byzantins, il fit une incursion dans l’intérieur de la Thrace, battit plusieurs
petits rois et ramena de ce pays une colonie nombreuse, où il espérait
recruter des soldats. Prusias était en guerre contre le roi de Pergame, il
lui envoya des auxiliaires ; et, se souvenant des plans d’Annibal, il excita,
par de secrets émissaires, les barbares du Danube à se liguer avec lui pour
marcher sur l’Italie. Leur chef promit de donner sa soeur en mariage au fils
du roi. En vue d’appuyer ces négociations et d’assurer son influence dans la Thrace, il fonda la ville
de Philippopolis sur les bords de l’Hébre, non loin de l’Hæmus. On disait que
du haut de cette montagne le regard embrassait le Pont-Euxin, l’Adriatique,
le Danube et les Alpes. Philippe voulut la gravir pour reconnaître de là le
plus court chemin vers l’Italie, car, comptant peu sur la Grèce, qu’il connaissait
bien, il rêvait de recommencer l’expédition d’Annibal. Il mit trois jours à
atteindre la cime cachée dans un épais brouillard et y éleva deux autels à
Jupiter et au Soleil, mais il ne vit rien que les plaines fécondes de la Mœsie et de la Thrace[7]. Quand il
redescendit, la nouvelle de cette étrange expédition, de cette impuissante
menace, courait déjà vers Rome. Quelque temps auparavant, Philippe, pour
endormir la vigilance du Sénat, lui avait envoyé son fils Démétrius, que son
séjour à Rome comme otage et des prévenances calculées avaient rendu tout
dévoué aux intérêts romains. Avec son habileté meurtrière, le Sénat, jetant
la division et la haine jusque dans la maison royale, répondit qu’il
pardonnait au père par considération pour le fils. Démétrius devait payer de
sa vie ces perfides égards[8].
Chaque jour Philippe se faisait lire son traité avec les
Romains pour nourrir son ressentiment. Ses émissaires étaient revenus des
bords du Danube. Une peuplade nombreuse et renommée par son courage, les Bastarnes,
acceptait ses offres. Il promettait à ces barbares une route sûre par la Thrace où il avait
imprimé la terreur de ses armes, il leur assurait des vivres, une solde de
guerre et des terres fécondes dans le pays des Dardaniens. Ce dernier peuple
détruit, il comptait pousser les Bastarnes sur l’Italie, tandis que lui-même
soulèverait la Grèce
et appellerait tous les rois à la liberté.
Mais la sinistre prévoyance du Sénat allait porter ses
fruits. Démétrios, de retour en Macédoine, y trouva une faction puissante qui
voulait à tout prix la paix et qui plaça à sa tête l’ami des Romains. Les
partisans de la guerre avaient pour chef un frère aîné de Démétrius, Persée,
qui, né d’une femme de basse naissance, craignait que Philippe ne laissât sa
couronne à Démétrius. Pour perdre ce rival, il le peignit au roi comme un
traître pressé, par Flamininus et par son ambition, de lui ravir le pouvoir. Le
malheureux père hésitait entre ses deux enfants. Mais un jour Persée
accourt ; dans un tournoi, son frère, dit-il, a voulu le tuer, et la
nuit suivante il a assailli sa demeure avec des gens armés. D’ailleurs il
veut fuir chez les Romains pour revenir sans doute avec les légions. Philippe
interroge ; le crime semble prouvé ; et le jeune prince ayant tenté
de s’enfuir à Rome, le roi se résolut à le faire secrètement périr. Invité
par le gouverneur de la
Pæonie, dépositaire des ordres du père, à un repas de
sacrifice, Démétrius se rendit à Héraclée où se faisait la fête. On mêla du
poison aux viandes sacrées, et, comme la douleur lui arrachait de grands cris,
on l’étouffa sous des couvertures (182). On dit que plus tard Philippe reconnut son innocence,
et que la douleur le conduisit au tombeau (179).

II. Persée (177-168)
 Les
Romains ont voulu déshonorer Persée après l’avoir vaincu. Leurs historiens
ont usé contre lui du droit de la guerre, væ
victis, et les modernes ont fait comme eux. Mais Tite Live n’accuse-t-il
pas Annibal d’impéritie? Cependant il vante dans Persée la pureté des moeurs,
la majesté toute royale de sa personne, son habileté dans les exercices et
les travaux de la paix et de la guerre[9]. Il l’accuse vaguement
d’avoir tué sa femme, et lui reproche le meurtre de Démétrius. Mais, d’après
son récit même, Persée devait se croire véritablement menacé. Il le
représente comme un avare tenant plus à ses trésors qu’à sa couronne; et
quand les villes de Macédoine vinrent spontanément lui offrir des subsides,
il les refusa[10]
; quand Cotys l’eut servi six mois avec deux mille auxiliaires, il lui donna
pour sa cavalerie 100 talents de plus qu’il ne lui en avait promis. Nous
verrons plus loin si rien ne justifie sa conduite avec Gentius et les
Bastarnes. Dans son royaume, Persée sut gagner l’affection et le dévouement
de ses sujets ; au dehors, il releva si haut la considération de la Macédoine, que pendant
dix années il tint les regards du monde fixés sur lui[11]. Quant aux
meurtres qu’on lui attribue, ou bien les preuves manquent, comme pour
l'histoire de Rammius de Brindes ; ou bien ils rentrent dans cette
politique de perfidies et d'assassinats que suivaient alors tous les rois et
Rome elle-même. Ceux qui avaient fait tuer Annibal, Philopœmen et Brachyllas
étaient mal venus à lui reprocher l'assassinat d'Eumène. On a mis en doute
jusqu'à son courage. Mais il se trouva à tous les combats, conduisit toutes
les expéditions, en Thrace, en Illyrie, en Épire, contre les Dardaniens et
l'Étolie. A Pydna, il avait été blessé la veille, et il se jeta sans cuirasse
au milieu de sa phalange rompue. Persée n'était donc ni meilleur ni pire que
les principaux personnages de son temps. Les
Romains ont voulu déshonorer Persée après l’avoir vaincu. Leurs historiens
ont usé contre lui du droit de la guerre, væ
victis, et les modernes ont fait comme eux. Mais Tite Live n’accuse-t-il
pas Annibal d’impéritie? Cependant il vante dans Persée la pureté des moeurs,
la majesté toute royale de sa personne, son habileté dans les exercices et
les travaux de la paix et de la guerre[9]. Il l’accuse vaguement
d’avoir tué sa femme, et lui reproche le meurtre de Démétrius. Mais, d’après
son récit même, Persée devait se croire véritablement menacé. Il le
représente comme un avare tenant plus à ses trésors qu’à sa couronne; et
quand les villes de Macédoine vinrent spontanément lui offrir des subsides,
il les refusa[10]
; quand Cotys l’eut servi six mois avec deux mille auxiliaires, il lui donna
pour sa cavalerie 100 talents de plus qu’il ne lui en avait promis. Nous
verrons plus loin si rien ne justifie sa conduite avec Gentius et les
Bastarnes. Dans son royaume, Persée sut gagner l’affection et le dévouement
de ses sujets ; au dehors, il releva si haut la considération de la Macédoine, que pendant
dix années il tint les regards du monde fixés sur lui[11]. Quant aux
meurtres qu’on lui attribue, ou bien les preuves manquent, comme pour
l'histoire de Rammius de Brindes ; ou bien ils rentrent dans cette
politique de perfidies et d'assassinats que suivaient alors tous les rois et
Rome elle-même. Ceux qui avaient fait tuer Annibal, Philopœmen et Brachyllas
étaient mal venus à lui reprocher l'assassinat d'Eumène. On a mis en doute
jusqu'à son courage. Mais il se trouva à tous les combats, conduisit toutes
les expéditions, en Thrace, en Illyrie, en Épire, contre les Dardaniens et
l'Étolie. A Pydna, il avait été blessé la veille, et il se jeta sans cuirasse
au milieu de sa phalange rompue. Persée n'était donc ni meilleur ni pire que
les principaux personnages de son temps.
Philippe avait, dit-on, voulu laisser le trône au neveu de
son ancien tuteur, Antigone. Persée se hâta de faire disparaître un rival
dangereux. Mais il se garda de rompre en face avec le Sénat; il mit à ses
pieds sa couronne, renouvela le traité conclu avec son père et durant six
années ne parut occupé que du soin de détourner de lui l'attention de Rome.
Cependant il sentait qu'une menace était toujours suspendue sur sa tête et
que les causes qui avaient amené la seconde guerre de Macédoine en
préparaient une troisième. L'achèvement de l'œuvre commencée en Grèce par
Flamininus exigeait la ruine du royaume macédonien. Les sénateurs romains
n'étaient pas hommes à se demander si cela serait une chose honnête. Il
suffisait qu'elle parût une chose utile, et ils ont eu l'art, souvent
pratiqué depuis, de faire de leur victime l'agresseur. Persée n'a jamais
conçu la folle pensée de jouer le rôle d'Annibal ou d'essayer celui
d'Antiochus. Il ne disposait même pas des ressources que son père possédait
au moment de ses premiers combats contre Rome. Il ne pouvait donc songer qu'à
organiser la défense de ses États dans le silence et l'ombre ; mais il la
prépara énergiquement[12].
Son père lui avait laissé un trésor bien rempli ; il
l'augmenta, et amassa assez de richesses pour soudoyer pendant dix ans dix
mille mercenaires. Il n'avait pas de flotte; en créer une eût été une
déclaration de guerre : il y renonça; mais il ruina toutes ses villes
maritimes qui n'étaient pas en état de se défendre. Dans ses arsenaux il
réunit de quoi équiper et nourrir trois armées[13]. Par ses
expéditions en Thrace, Philippe avait recruté et aguerri ses troupes ;
il les exerça en écrasant les Dolopes, qui voulaient se mettre sous la
protection de Rome, et il put compter sur quarante-cinq mille bons soldats.
Enfin, pour réunir autour de lui tous les Macédoniens, il ouvrit les prisons,
remit les sommes dues au fisc et rappela les bannis; des édits publiquement
affichés à Delphes, à Délos et dans le temple de Minerve-Itonienne, leur promirent
sûreté pour leur personne et la restitution de leurs biens.
Philippe n’avait jamais pu faire oublier aux Grecs sa
cruauté. Persée envoya à toutes les villes des ambassadeurs pour demander l’oubli
du passé et une sincère alliance. Prévenant par ses bienfaits leur amitié, il
rendit aux Athéniens et aux Achéens ceux de leurs esclaves auxquels Philippe
avait ouvert un asile dans son royaume. La Thessalie était incapable
de se gouverner; il profita de ses divisions, soutint les pauvres contre les
grands, les débiteurs contre leurs créanciers, et des garnisons macédoniennes
rentrèrent dans la plupart des villes d’où les Romains les avaient chassées.
L’Épire ne s’était tournée qu’à regret contre Philippe ; il la ramena
secrètement dans son alliance. Les Béotiens avaient rejeté l’amitié de son
père ; ils acceptèrent publiquement la sienne par un traité qu’on
afficha à Thèbes, à Délos et à Delphes. Sans quelques avisés et prudents
personnages, l’Achaïe faisait de même, et c’est à lui que les Étoliens s’adressaient
quand leur pays était troublé. Genthios, petit roi d’Illyrie, qu’effrayaient
le voisinage et les menaces des Romains, promit des secours en échange de
quelques subsides, et Cotys, roi des Thraces-Odryses, s’engagea à partager
tous ses périls. Le roi de Syrie lui donna pour épouse sa sœur qu’une flotte
rhodienne lui amena ; Prusias, son beau-frère, n’attendait qu’une
occasion d’attaquer en Asie le protégé du sénat, Eumène, qui trouvait bien lourde
l’amitié de Rome et tâchait de regagner celle d’Antiochus[14]. Rhodes, mal
récompensée de ses services, et qui dans le soulèvement des Lyciens contre elle
reconnaissait la main du Sénat, se rapprochait de Persée. Ce prince eut à
Samothrace, durant plusieurs jours, une secrète entrevue avec les députés des
villes d’Asie[15].
A Carthage, le Sénat reçut la nuit, dans le temple d’Esculape, ses
ambassadeurs[16].
Enfin, trente mille Bastarnes approchaient, et le bruit de leur marche jetait
l’effroi en Italie.
Ainsi, ce que n’avait pas fait Annibal, Persée semblait
prêt à l’accomplir. Encouragé par cette haine universelle que l’ambition de
Rome avait soulevée, il marcha plus hardiment. Pour montrer aux Grecs les
enseignes macédoniennes, qu’ils n’avaient pas vues depuis vingt ans, il
pénétra avec une armée, sous prétexte de sacrifices à Apollon, jusqu’au
temple de Delphes. En Thrace, en Illyrie, le Sénat avait des alliés, il dépouilla
le Thrace Abrupolis, et fit tuer le chef illyrien Arthétauros.
Deux Thébains voulaient retenir la Béotie dans l’alliance de
Rome, ils tombèrent sous les coups de meurtriers inconnus. Eumène, alarmé de
cette résurrection de la puissance macédonienne[17], vint la
dénoncer à Rome. Il révéla dans le Sénat les préparatifs de Persée, ses
intrigues pour s’attacher partout le parti populaire, au détriment des amis
de Rome, ses crimes vrais ou supposés. Voyant,
dit-il, que vous laissez le champ libre en Grèce et
que rien n’a lassé votre patience, il se tient pour assuré de passer en
Italie sans trouver un seul combattant sur son chemin. Eumène termina
ce discours haineux par l’habituelle invocation aux dieux. A vous, Romains, de décider ce que réclament votre sûreté
et votre honneur. Pour moi, il me reste à prier les dieux et les déesses de
vous inspirer le désir de défendre nos intérêts et les vôtres.
Persée avait fait suivre Eumène en Italie par ses propres
ambassadeurs; ils demandèrent à répondre et le firent avec hauteur, presque
avec menace. Le roi, dirent-ils, est fort en peine de se justifier. Il tient à ce qu’on ne
voie dans ses paroles ou dans ses actes rien d’hostile ; mais, si l’on s’obstine
à chercher un prétexte de guerre, il saura bravement se défendre. Les faveurs
de Mars sont à tout le monde et l’issue de la guerre est incertaine.
Eumène, comblé de présents, parmi lesquels étaient les
insignes consulaires, la chaise curule et le bâton d’ivoire, retourna par la Grèce dans ses États, et
Persée, certain qu’il monterait à Delphes offrir un sacrifice à Apollon,
aposta sur le chemin des meurtriers. Pour donner accès à ce temple fameux,
les Romains eussent construit une grande et large voie; les Grecs ne s’étaient
pas donné ce souci. Au-dessus de Cirrha, la route s’élevait rapidement et, en
un certain endroit, prés d’une masure, se réduisait à un sentier qu’un éboulement
venait de rétrécir encore. Quatre brigands se cachent derrière les ruines et
y attendent le roi, qui arrivait, suivi de ses amis et de ses gardes. A
mesure que l’on montait, la suite royale s’allongeait ; près de la
masure, Eumène se trouva seul en tête avec le chef étolien, Pantaléon. A cet
instant, les bandits font rouler de grosses pierres, dont l’une frappe le roi
à la tête, l’autre à l’épaule ; il tombe évanoui, on le croit mort, et
tous, d’abord, s’enfuient ; même les assassins, qui ne croient pas avoir
besoin de s’arrêter pour achever leur victime. Ils gravissent rapidement les
pentes du Parnasse, et l’un d’eux les suivant avec difficulté, ils le tuent
pour qu’il ne tombe pas vivant aux mains des gardes qui avaient reconnu leur
petit nombre et s’étaient mis à leur poursuite.
Cependant l’Étolien était resté près du roi, le couvrant
de son corps; les amis, les serviteurs, reviennent. On porte Eumène, toujours
évanoui, à son vaisseau, de là à Corinthe et de Corinthe à Égine, en faisant
passer le navire par-dessus l’isthme. On s’arrêta dans l’île et l’on garda un
profond silence sur l’événement. Les Pergaméniens, qui avaient bien compris d’où
le coup était parti, se trouvaient trop près de la Macédoine pour ne pas
cacher les progrès du mal ou de la guérison. La nouvelle de la mort du roi
courut à Pergame, et déjà Attale, son frère, réclamait la main de la reine et
la couronne.
Un commissaire romain, Valerius, se trouvait alors en
Grèce. Il vint rendre compte aux sénateurs de ce nouvel attentat, amenant
avec lui deux témoins contre le roi de Macédoine. Le premier était l’hôtesse
habituelle de Persée à Delphes, qui, sur une lettre de lui, avait mis à la
disposition de ses gens la maison près de laquelle le crime avait été commis.
Le second, Rammius de Brindes, chez qui descendaient les Romains de
distinction allant d’Italie en Grèce et les députés des nations étrangères,
déposa que, invité par Persée à le venir trouver, il en avait reçu les plus
magnifiques promesses, à la condition d’empoisonner ceux des Romains logés dans
sa maison que le roi lui désignerait. Persée, fort malmené par Tite Live, a
naturellement trouvé des apologistes à outrance. Je ne puis lui accorder que
l’assassinat d’Eumène ait été une invention des Romains ou une spéculation d’obscurs
bandits. Supprimer le roi de Pergame était un coup fort utile où Persée
trouvait en outre le plaisir de la vengeance : deux motifs qui, en ce
temps-là, suffisaient. Je crois donc qu’il faut laisser à son compte l’aventure
manquée de Delphes, sauf à concéder que Rammius, trouvé en Grèce au retour d’un
voyage en Macédoine, a imaginé une fable qui expliquait sa présence à Pella,
servait les projets de Rome et sa propre fortune. Car, d’après les habitudes
romaines, cette délation devait lui rapporter beaucoup[18].
Persée devait-il prendre hardiment l’offensive et, dans l’espoir
de soulever la Grèce,
sortir de ses montagnes macédoniennes qui semblaient d’inexpugnables
remparts ? Sans doute l’audace aurait pour quelque temps réussi, et son
armée se serait grossie de quelques volontaires[19]. Mais ces rois
et ces peuples qui faisaient tant de voeux pour lui n’auraient osé lui donner
un soldat. Antiochus, dont le frère était retenu comme otage à Rome, l’oubliait
pour disputer à Philométor la
Cœlésyrie ; et Masinissa, qui venait d’enlever à
Carthage (174)
une quatrième province avec soixante-dix villes, achetait le silence
complaisant de Rome au prix de secours importants. Eumène avait entraîné
Ariarathe ; Rhodes n’osait refuser au Sénat des vaisseaux ;
Ptolémée en offrait. Tout manquait à Persée. Si Cotys, roi des Odryses, était
pour lui, d’autres chefs thraces étaient pour Rome ; Gentius, prince
cruel et débauché, voulait faire payer au poids de l’or une assistance
dérisoire[20],
et les Bastarnes demandaient pour les fantassins cinq pièces d’or par homme,
dix pour les cavaliers, mille pour les chefs de bande. Ces auxiliaires
rappelaient par leurs exigences les Galates de l’Asie Mineure dont les rois d’Orient
avaient eu tant à souffrir ; Persée en conçut de vives défiances et
traîna la négociation en longueur[21]. Ainsi, au
moment de la lutte, il se trouvait seul.

III. Bataille de Pydna (168)
Le Sénat n’envoya d’abord qu’un préteur avec cinq mille
hommes. Mais sept commissaires précédaient l’armée; ils parcoururent la Grèce, où leur seule présence
suffit pour détruire l’effet de six années de prudence et de concessions :
preuve évidente de la fragilité de l’appui auquel on voudrait que Persée eût
confié sa fortune. Dans la
Thessalie, toutes les villes non occupées par les
Macédoniens donnèrent des otages, que les Romains enfermèrent à Larisse. Dans
l’Étolie, où de sanglantes dissensions[22] enlevaient au
peuple le peu de force qui lui restait, ils firent nommer stratège un de
leurs partisans, et ils déportèrent en Italie tous ceux qu’on leur désigna
comme ennemis de Rome; en Béotie, ils rompirent la ligue et regagnèrent
toutes les villes à leur alliance ; dans le Péloponnèse, les Achéens,
quelque temps incertains, promirent d’envoyer mille hommes à Chalcis pour la
défendre ; enfin l’Acarnanie, l’Épire même, montraient un empressement
de bon augure. Du haut de ses montagnes, Persée voyait ces courses, ces menées
des ambassadeurs romains ; et il se laissait enlever la Grèce sans risquer pour
elle un combat, comme si elle ne valait pas même l’honneur d’une bataille. Au
lieu d’agir, il négociait ; et, après avoir provoqué son implacable
ennemi, il s’arrêtait, perdant volontairement la seule chance qu’il eût, non
de triompher, mais de tomber avec gloire, après avoir, quelque temps
peut-être, ébranlé le monde.
Tandis que le préteur, avec sa faible armée, prenait
position dans la
Dassarétie, Persée envoyait deux ambassades en Italie et
sollicitait une trêve, que Marcius, le chef de la députation romaine, se hâta
de lui accorder, pour que le Sénat eût le temps d’achever ses préparatifs[23]. A Rome, on fit
attendre durant cinq mois une réponse à ses députés ; mais dès que le printemps
ouvrit la campagne, ils reçurent l’ordre de quitter l’Italie. Derrière eux,
le consul Licinius débarqua près d’Apollonie. Il traversa sans obstacle l’Épire,
l’Athamanie et les défilés de Gomphi ; Persée l’attendait au pied du
mont Ossa, à l’entrée de la vallée de Tempé, le seul chemin pour passer de la Thessalie en
Macédoine. Cette gorge étroite et longue où le Pénée se fraye avec effort un passage
que lui disputent les derniers rochers de l’Ossa et de l’Olympe était dans l’antiquité
le site le plus fameux pour ses beautés pittoresques et sa sauvage grandeur.
C’est aux abords de ce lieu poétique, à Sycurion, que se rencontrèrent pour
la première fois les soldats de Persée et ceux de Rome. L’avantage ne fut pas
pour ceux-ci. Licinius eut le dessous dans une escarmouche qui aurait pu
devenir une bataille générale, si Persée avait engagé sa phalange. En
repassant durant la nuit le Pénée, le Romain laissa sur l’autre rive plus de
deux mille quatre cents des siens morts ou prisonniers.
La Grèce
attentive applaudit à ce premier succès[24]. Mais Persée s’arrêta
et demanda la paix, offrant le tribut et l’abandon de ses conquêtes[25]. Le consul
vaincu exigea qu’il se remit lui-même et son royaume à la discrétion du
Sénat. Cependant il ne sut pas justifier cette fierté de langage ; il éprouva
un second échec près de Phalana, et alla hiverner en Béotie après la prise de
quelques villes thessaliennes. Une victoire navale remportée à la hauteur d’Orée,
et des succès en Thrace sur un lieutenant d’Eumène, terminèrent cette
campagne en faveur de Persée. L’odieuse conduite du consul et du préteur
Lucrétius, qui pillaient sans pudeur les alliés, accrut le mécontentement ;
plusieurs cantons d’Épire[26] se déclarèrent
ouvertement pour Persée ; l’Étolie, l’Acarnanie, remuèrent.
Un nouveau consul, aussi incapable que le précédent, A.
Hostilius, arriva. En traversant l’Épire, il faillit être enlevé par un parti
ennemi. La campagne répondit à ces commencements ; Hostilius débuta par
un échec, et perdit l’année à chercher un passage pour entrer en Macédoine.
Partout Persée faisait face dans des positions inexpugnables. Les deux
lieutenants qui attaquaient par mer et du côté de l’Illyrie ne furent pas
plus heureux : l’un ne se signala que par le sac d’Abdère ; l’autre,
Cassius, posté à Lychnidus, perdit six mille hommes dans une entreprise mal
conduite contre Uscana. Dés qu’il sut les Romains retirés prématurément dans
leurs quartiers, Persée courut châtier les Dardaniens, auxquels il tua dix
mille hommes, et employa l’hiver à enlever plusieurs places de l’Illyrie,
dans laquelle il fit six mille Romains prisonniers[27]. Il voulait
fermer de ce côté les approches de la Macédoine, et décider peut-être la défection de
Gentius. Le roi barbare demandait avant tout de l’argent : Persée refusa. L’Épire
paraissait soulevée; il espéra entraîner aussi l’Étolie, et pénétra jusqu’à
Stratos avec dix mille hommes. Mais les Romains étaient entrés dans la place.
Cette activité, ces succès, invitaient les peuples
irrésolus à saisir l’occasion de se sauver avec lui : et ce fut le moment on
les ambassadeurs affluèrent à Rome ! Athènes, Milet, Alabanda, la Crète, renouvelaient leurs
promesses de services ou offraient des dons ; Lampsaque sollicitait le titre
d’alliée. Les Carthaginois avaient offert un million cinq cent mille
boisseaux de blé ; Masinissa en promettait autant, et en outre mille
deux cents Numides et douze éléphants ; déjà il avait envoyé vingt-deux
éléphants et deux mille auxiliaires[28]. Persée restait
seul encore.
Cependant, grâce à l’impéritie des généraux, cette guerre
devenait sérieuse ; l’inquiétude gagna Rome ; il fut défendu aux
sénateurs de s’éloigner de la ville de plus d’un mille, soixante mille hommes
furent levés en Italie, et le nouveau consul Martius emmena de nombreux
renforts, afin de combler les vides faits dans l’armée par les congés que les
consuls et les préteurs avaient vendus. Pour détruire l’effet des exactions
dont les Grecs avaient été victimes, il se fit précéder d’un sénatus-consulte
qui défendait de rien fournir aux généraux au delà de ce que le Sénat avait
fixé.
Les monts Cambuniens et l’Olympe ferment au sud la Macédoine, où Marcius
était décidé à porter la guerre : c’est une barrière formidable. Avant de l’aborder,
il interrogea les gens du pars sur les routes, ou plutôt sur les sentiers
abrupts qui y courent, s’assura de guides perrhèbes, puis tint un conseil de
guerre. Les uns proposaient de passer par Pythion, entre l’Olympe et les
monts Cambuniens ; d’autres, de tourner ces montagnes où Persée avait
accumulé les moyens de défense et d’entrer dans le royaume par l’Élymée, à la
passe des Quarante-Gués (Sarandaporos),
que gardait la Vigla
ou la Sentinelle. La
route de Pythion conduisait au défilé de Pétra, que fermait une forteresse
placée sur une aiguille de rocher, au-dessus de laquelle l’Olympe élève des
cimes qui montent à 5000
mètres. Il eût été imprudent d’engager l’armée entière
dans des gorges si aisées à défendre et qui menaient bien loin des magasins
formés en Thessalie. En partant d’Olossona, on arrivait plus vite en Piérie
par les Kanalia ; mais c’était un passage difficile à atteindre,
pour une armée, et d’où il lui aurait été plus difficile encore de descendre,
car elle aurait eu à longer quatre torrents qui avaient creusé, sur le
versant oriental, d’impraticables ravines ; vues d’en bas, ces gorges
montrent l’immense montagne comme entr’ouverte de la base au sommet. Quant au
défilé de Tempé, un voyageur pouvait bien y passer, mais non pas une légion,
si la moindre troupe le gardait : sur un espace de 5 milles, une bête de
somme y trouve à peine l’espace nécessaire pour elle et son bagage[29].
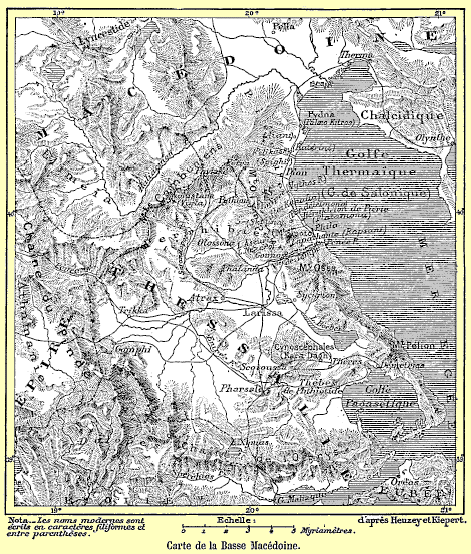
Ces défenses naturelles accumulées sur la route par où
venaient les Romains semblaient devoir leur interdire l’entrée de la Macédoine. En
outre, tous les sentiers étaient gardés. Persée, avec une habileté
qu’on a méconnue, avait placé dix mille hommes sur la Volustana, pour
commander les deux défilés de Sarandaporos et de Pétra. Il en avait posté
douze mille, avec Hippias, au-dessus du marais Ascuris, probablement sur le
mont Sipoto, afin d’intercepter, de ce côté, les sentiers de la montagne. Il
avait encore jeté des troupes dans la vallée de Tempé, et lui-même s’était
établi à Dion, en arrière de ces défenses, pour les soutenir partout on elles
faibliraient ; de peur d’être pris à revers par les équipages de la
flotte romaine, il couvrit le littoral de sa cavalerie légère.
Marcius hésita quelque temps sur le point où il devait
couper cette ligne formidable; il se décida pour une entreprise audacieuse
qui, par sa hardiesse même, devait donner de plus grands résultats, si elle
réussissait. Il résolut de tourner avec sa cavalerie, ses éléphants, ses
bagages et un mois de vivres, le vaste marais Ascuris, et de franchir le
plateau d’Octolophe ou des Huit-Sommets, dont un, aujourd’hui appelé mont de la Transfiguration,
mesure une altitude de 1481
mètres. De là, dit l’historien,
on aperçoit tout le pays, depuis Phila jusqu’à Dion,
et toute la côte de la Piérie[30]. Pendant que le
consul traverserait les montagnes, le préteur devait, avec sa flotte, menacer
la côte et y faire des descentes. Marcius avait trente-sept mille hommes ; il
en porta rapidement une partie contre la division d’Hippias, pour l’écraser
ou la contenir. Un corps d’élite par lequel il fit tourner le marais Ascuris
lui ouvrit, au sud, la route vers Rapsani, que défendait la forteresse
Lapathonte ; un autre attaqua, par l’ouest, les Macédoniens sur les hauteurs.
Pendant deux jours on s’y battit, sans que le roi osât quitter la côte pour
profiter de la dangereuse position où les Romains s’étaient placés. Ceux-ci s’en
tirèrent à force d’audace. Tandis qu’Hippias, sous la pression de cette rude
attaque, concentrait ses forces pour une résistance désespérée, Marcius,
masquant ses mouvements par un cordon de troupes, se jeta à travers rochers
et forêts sur le versant oriental de l’Olympe, d’où il descendit avec des
dangers et des peines extrêmes dans les plaines de la Piérie[31]. Ses
communications étaient coupées, mais il avait forcé le passage et vaincu la
nature.
C’était bien d’elle qu’il venait de triompher. Les Romains, dit le savant voyageur qui a suivi pas
à pas les traces de l’armée de Marcius dans ces montagnes, sont descendus dans la Macédoine par des précipices.
Je n’ai jamais rien vu de plus sauvage et de plus magnifique que les pentes
du bas Olympe sur lesquelles ils s’engagèrent : c’est une forêt immense
enveloppant de son ombre toute une région d’escarpements et de ravins. Dans
des gorges boisées jusqu’au fond passent avec bruit des eaux claires et
rapides. La vigueur et la variété de la végétation sont incroyables : les
arbres de la plaine, qu’on est étonné de rencontrer si haut, les chênes verts
et surtout d’énormes platanes montent le long des torrents jusqu’au milieu
des châtaigniers et presque jusqu’aux sapins. On conçoit qu’en traversant ces
impénétrables solitudes, toute une armée ait trompé l’ennemi qui la croyait
retournée en arrière... Ces bois sont les restes de la forêt Callipeucè de
Tite Live.... De Skotina[32] jusqu’au pied de la montagne, je cherchais à me figurer
la large trouée ouverte à la hache et tout le désordre de cette armée qui
déroulait, nous dit Tite Live, plutôt qu’elle ne descendait. La cavalerie,
les bagages, les bêtes de somme, qui étaient le grand embarras, marchaient en
avant avec les éléphants, qu’on faisait glisser à grand’peine sur des plans
inclinés ; les légions venaient ensuite. De Skotina nous mimes au moins
quatre heures pour arriver au pied des dernières pentes. Là, sur le bord de
la plaine, s’élèvent quelques mamelons plantés d’oliviers, avec les ruines d’un
petit monastère de la
Panaghia. Ce sont les collines où le consul romain, après
avoir employé trois jours à cette descente, fit enfin établir son camp; l’infanterie
occupait ces collines ; la cavalerie campait en avant au bord de la
plaine[33].
Une forte arrière-garde laissée sur les hauteurs avait
caché au corps d’Hippias cette manoeuvre audacieuse. Ainsi, dix jours après
avoir reçu l’armée des mains de son prédécesseur, Marcius avait arrêté ses
plans, réuni ses vivres, livré deux combats dans l’Olympe et forcé l’entrée
de la Macédoine ;
c’est une belle page d’histoire militaire
Durant ces opérations, Persée était à Dion avec la moitié
de ses troupes ; effrayé à la vue des légions[34], il abandonna la
forte position qu’il occupait et se replia vers Pydna, en commettant l’impardonnable
faute de rappeler à lui les corps qui gardaient les défilés. Aussitôt Martius
s’en saisit : il était sauvé. Rassuré sur ses communications, le consul
avança jusqu’à Dion, mais le manque de vivres et l’approche de l’hiver l’arrêtèrent ;
il cessa les hostilités, et prit hardiment ses quartiers dans la Piérie. La Macédoine
était enfin entamée.
Pour n’être point troublé sur la position qu’il avait
prise, et, en même temps, pour assurer ses communications avec la Thessalie d’où il
attendait ses convois, il fit enlever par ses lieutenants les petites places
qui gardaient la vallée de Tempé, entre autres Phila, où Persée avait réuni
de grands approvisionnements de blé. Se trouvant même trop en l’air à Dion,
où la plaine de la Piérie
commence à s’élargir, il se concentra derrière l’Énipée, qui lui offrait pour
l’hiver une bonne ligne de défense. Ce torrent,
dit Tite Live, descend d’une gorge du mont Olympe.
Faible en été, les pluies d’hiver en font un torrent impétueux. Il
tourbillonne au pied de roches immenses, et dans le ravin où il s’engouffre, entraînant
les terres, creusant profondément son lit, il a fait de ses deux rives des
précipices. Les habitants l’appellent l’Abîme (Vythos), et il
mérite ce nom.
Le bruit de ces succès arrivait à Rome quand les députés
rhodiens, se présentant au Sénat, déclarèrent que, ruinés par cette guerre,
ils voulaient en voir la fin, et que si Rome ou Persée refusaient d’y mettre
un terme, ils aviseraient aux mesures qu’ils auraient à prendre à l’égard de
celui des deux adversaires qui s’opposerait à la paix. Pour toute réponse, on
leur lut un sénatus-consulte qui déclarait libres les Cariens et les Lyciens,
leurs sujets. Eumène aussi, blessé dans son orgueil, venait d’abandonner le
camp romain, et Prusias s’interposait comme médiateur. Il était temps d’en
finir avec la Macédoine.
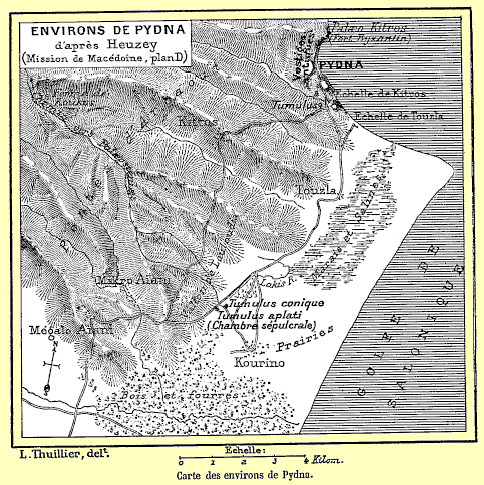
Les comices portèrent au consulat Paul Émile, homme d’une
vertu antique, lettré cependant, comme l’étaient déjà tous les nobles de
Rome, et ami de la civilisation et des arts de la Grèce. Malgré ses
soixante ans, il déploya l’activité d’un jeune et prudent capitaine. Il
envoya inspecter la flotte, l’armée, la position de l’ennemi et des légions,
l’état des magasins, les dispositions des alliés. Genthios, trompé par une
promesse de 300 talents, s’était enfin déclaré contre Rome. Eumène avait
ouvert avec Persée de ténébreuses négociations; les Rhodiens étaient presque
ouvertement passés de son côté, et la flotte macédonienne dominait dans la
mer Égée et les Cyclades. Mais Persée venait de se priver de l’appui des
vingt mille Gaulois qu’il avait appelés des bords du Danube; il leur refusait
la solde promise, au moment où il eût fallu la doubler pour obtenir leur
assistance, dût même cette assistance devenir dangereuse après la commune
victoire.
Sur ces renseignements, Paul Émile disposa son plan. Avec
l’armée de Marcius il devait attaquer de front la Macédoine et pousser
le roi devant lui. Octavius, avec la flotte, formerait l’aile droite, et,
après avoir balayé la mer Égée, menacerait les côtes et inquiéterait Persée
sur ses derrières. Anicius, avec deux légions en Illyrie, formerait l’aile gauche,
écraserait Genthios et se rabattrait par la Dassarétie sur la Macédoine. Quatre-vingt
mille hommes au moins allaient être aux prises[35], et l’autre
consul, Licinius, tenait une armée prête sur les côtes de l’Adriatique pour,
au besoin, voler au secours de son collègue.
Au camp, Paul Émile s’occupa de rendre à la discipline
romaine son ancienne vigueur[36]. Il remplaça par
des travaux les loisirs des soldats et remit en honneur les exercices
militaires; il retira aux sentinelles leur bouclier pour augmenter leur
vigilance. Le mot d’ordre se donnait tout haut et pouvait être entendu de l’ennemi ;
il décida que les centurions se le passeraient à voix basse. Les gardes
avancées se fatiguaient à rester tout le jour sous les armes ; il les fit
relever le matin et à midi,
pour que l’ennemi trouvât toujours aux avant-postes des troupes fraîches et
reposées.
Persée campait derrière l’Énipée, dans la forte position
que nous avons décrite. Par une fausse attaque qui dura deux jours, le consul
essaya de l’y retenir, tandis que Scipion Nasica, avec un corps d’élite de
onze mille hommes, rentrait dans la vallée de Tempé et, tournant toute la
masse de l’Olympe, arrivait par la route de Pythion au défilé de Pétra. Le
roi avait soupçonné cette marche, et douze mille Macédoniens barraient la
route. C’étaient de mauvaises troupes, les meilleurs soldats étant restés
dans la phalange en face de Paul Émile; elles ne surent pas même prendre de
bonnes positions, et Nasica en eut facilement raison. Il poussa vivement les
fuyards, enleva la forteresse de Pétra, qu’ils ne cherchèrent point à
défendre, et descendit dans la plaine de Katérini. Persée allait être pris
entre deux attaques ; il leva son camp de l’Énipée et se retira sur
Pydna, au nord de Katérini.
Une plaine faite à souhait pour la phalange s’étendait en
avant de la ville ; Persée, qui ne pouvait plus reculer sans honte ni
dommage, résolut d’y livrer bataille. Dans la nuit qui précéda l’action, une
éclipse de lune alarma les Macédoniens ; par l’ordre de Paul Émile, le
tribun Sulpicius Gallus expliqua aux légionnaires la cause physique de ce
phénomène (22 juin
68)[37].
Quelques jours auparavant, l’armée souffrait de la soif ; le consul,
guidé par la direction des montagnes, avait fait creuser dans le sable, et on
avait trouvé de l’eau en abondance. Les soldats croyaient leur chef inspiré
des dieux, et demandaient à grands cris le combat. Mais, enfermé entre la
mer, une armée de quarante-trois mille hommes et des montagnes impraticables
pour lui s’il était vaincu, Paul Émile ne voulait rien donner au hasard; ce
ne fut que quand il eut fait de son camp une forteresse qu’il se décida à
risquer une affaire décisive[38]. Les Macédoniens
attaquèrent avec fureur. La plaine étincelait de l’éclat des armes; le consul
même ne put vair sans un certain effroi ces rangs serrés et impénétrables, ce
rempart hérissé de piques. Il dissimula ses craintes, et, pour inspirer confiance
aux troupes, affecta de ne mettre ni son casque ni sa cuirasse. D’abord la
phalange renversa tout ce qui lui était opposé ; mais le succès l’entraînant
loin du terrain que Persée lui avait choisi, les inégalités du sol et le
mouvement de la marche y ouvrirent des vides où Paul Émile lança ses soldats.
Dès lors ce fut comme à Cynocéphales : la phalange ébranlée, désunie, perdit
sa force ; au lieu d’une lutte générale, il y eut mille combats partiels; la
phalange entière, c’est-à-dire vingt mille hommes, resta sur le champ de
bataille; un ruisseau qui le traversait roulait encore le lendemain des eaux
sanglantes. Les Romains n’avouèrent qu’une perte de cent hommes, ce qui est
invraisemblable, et firent onze mille prisonniers. Pydna fut mise à sac et à
pillage; ses ruines mêmes ont disparu, mais, comme il convenait à un pareil
endroit, des tombeau marquent la place où s’élevait la florissante cité, et
le souvenir de la journée où la
Macédoine succomba vit encore confusément dans une légende
demi gracieuse demi terrible que l’on raconte à Palæo-Kitros. Au lieu qui fut
certainement le théâtre de l’action principale, des liliacées d’une espèce
particulière tapissent le sol ; les gens du pays l’appellent le vallon
des fleurs, Louloudia, et disent que ces fleurs sont nées du sang
humain répandu là dans un grand combat.
Du champ de bataille Persée s’enfuit à Pella. Cette capitale,
située sur une hauteur dont l’approche est couverte par des marais
impraticables l’été comme l’hiver, était de facile défense ; mais il n’avait
plus d’armée, et les habitants cédaient au découragement général. On lui
conseilla de se retirer dans les provinces montagneuses qui touchent à la Thrace et d’essayer d’une
guerre de partisans ; il fit sonder les dispositions des Bisaltes et
engagea les citoyens d’Amphipolis à défendre leur ville, afin de se conserver
pour lui-même un accès vers la mer[39]. Partout il
essuya des refus ou de dures paroles, et il apprit que toutes les places
ouvraient leurs portes, avant même d’être attaquées. Abandonné, sans
ressources, il demanda la paix au consul, et, en attendant sa réponse, se
réfugia, avec sa famille et ses trésors, dans le temple sacré de Samothrace.
Dans sa lettre Persée prenait encore le titre de roi; Paul
Émile la renvoya sans la lire; une seconde où ce titre était effacé obtint
pour toute réponse qu’il devait livrer sa personne et ses trésors. Il essaya
de fuir pour rejoindre Cotys, en Thrace. Mais la flotte du préteur Octavius
cernait l’île, et un Crétois qui lui promit de l’enlever sur son navire
disparut avec l’argent porté d’avance à son bord. Enfin un traître livra au
préteur les enfants du roi, et Persée lui-même vint se remettre avec l’aîné
de ses fils. Paul Émile, touché d’une telle infortune, l’accueillit bien[40], le reçut à sa table
et l’invita à mettre espoir dans la clémence du peuple romain (168).
Avant même la bataille de Pydna, Anicius avait assiégé
Genthios dans Scodra, sa capitale, et forcé ce prince à se rendre : trente
jours avaient suffi pour cette conquête, qui n’avait pas conté même un
combat.
En attendant l’arrivée des commissaires du Sénat, Paul
Émile parcourut la Grèce
pour en visiter les merveilles. Il monta à Delphes, où il fit élever sa statue
sur le piédestal destiné à celle de Persée ; il vit l’antre de
Trophonios, Chalcis et l’Euripe, avec ses phénomènes étranges de marée ;
Aulis, le rendez-vous des mille vaisseaux d’Agamemnon ; Athènes, où il offrit
un sacrifice à Minerve, comme, à Delphes, il avait sacrifié à Apollon ;
Corinthe, encore riche de tous ses trésors ; Sicyone, Argos, Épidaure et
son temple d’Esculape, Mégalopolis, la ville d’Épaminondas, Sparte et
Olympie, évoquant partout les glorieux souvenirs et rendant hommage par son
admiration à cette Grèce maintenant si abaissée. A Olympie, il crut voir
Jupiter en contemplant la statue de Phidias, et il sacrifia avec la même
pompe qu’au Capitole. Il voulut vaincre aussi les Grecs en magnificence. Celui qui sait gagner des batailles, disait-il, doit savoir ordonner un festin et une fête. Il fit
préparer à Amphipolis des jeux grecs et romains, qu’il annonça aux
républiques et aux rois de l’Asie et auxquels il invita les principaux chefs de
la Grèce. Il
y vint de toutes les parties du monde les acteurs les plus habiles, des
athlètes et des chevaux fameux. Autour de l’enceinte des jeux étaient exposés
les statues, les tableaux, les tapisseries, des vases d’or, d’argent, d’airain,
d’ivoire et toutes les curiosités, tous les chefs-d’œuvre trouvés dans les
palais de Persée. Les armes des Macédoniens avaient été réunies en un immense
monceau, Paul Émile y mit le feu, et la fête se termina aux lueurs sinistres
de l’incendie. Cet holocauste annonçait à la Grèce et au monde la fin de la domination
macédonienne, comme l’incendie du palais de Persépolis, par Alexandre, avait,
un siècle et demi plus tôt, annoncé à l’Asie la destruction de l’empire de
Cyrus.
Cependant les commissaires du Sénat étaient arrivés ;
Paul Émile régla avec eux le sort de la Macédoine, et, ayant réuni à Amphipolis, devant
son tribunal qu’entourait une foule immense, dix des principaux citoyens de
chaque ville, il leur déclara les volontés du peuple romain. Il s’exprimait
en latin, le vainqueur devant parler sa langue aux vaincus ; mais le préteur Octavius
répétait en grec ses paroles. Les Macédoniens seront libres et conserveront
leurs villes avec des magistrats annuels, leurs territoires, leurs lois, et
ils ne payeront au peuple romain que la moitié des anciens tributs; mais la Macédoine, réduite en
province romaine et gouvernée par un proconsul, sera divisée en quatre
districts, avec interdiction aux habitants de contracter mariage, de vendre
ou d’acheter hors de leur territoire. Les cantons voisins des barbares
pourront seuls armer quelques troupes. Ceux du troisième district
approvisionneront de sel les Dardaniens, à un prix convenu d’avance[41]. Les amis et les
courtisans du roi, ses généraux, ses commandants de flotte, ses gouverneurs de
places, tous ceux qui ont exercé quelque emploi, suivront le consul en Italie
avec leurs enfants; et il les désigna tous par leurs noms. Puis il donna aux
Macédoniens un code de lois appropriées à leur nouvelle situation, et dans
chaque district l’administration locale fut confiée à un sénat, c’est-à-dire
à un petit nombre d’hommes choisis parmi les partisans de Rome, de peur que le peuple ne fît dégénérer en licence la
liberté réglée qu’il devait aux Romains[42], puis il partit
pour l’Épire. Anicius appliqua les mêmes dispositions à l’Illyrie, qui fut
partagée en trois cantons.
La
Macédoine était trop riche pour être abandonnée au pillage
des soldats; on ne leur avait livré que quelques villes qui, après Pydna,
avaient hésité à ouvrir leurs portes. Le consul avait cherché d’ailleurs à
séparer la cause du roi de celle du peuple ; il fallait paraître n’avoir
combattu que Persée, et ne vouloir que ses dépouilles, pour ébranler d’avance,
par cette politique, tous les trônes qui restaient encore debout. La Macédoine et l’Illyrie
furent donc épargnées; mais les soldats murmuraient : on leur livra l’Épire. La
politique des assemblées nombreuses est souvent impitoyable, parce que, de
tous ceux, qui concourent à leurs actes, aucun n’en est personnellement
responsable. Les Épirotes avaient fait défection ; le Sénat, pour
effrayer à jamais ses alliés, voulut les traiter ainsi qu’il faisait des
transfuges toujours frappés de la hache : il se contenta cependant de les
vendre comme esclaves. Mais quelle exécution : celle d’un peuple tout
entier ! Paul Émile versa, dit-on, des larmes en lisant le décret. Des
cohortes envoyées dans les soixante-dix villes de l’Épire[43] reçurent l’ordre,
au même jour, à la même heure, de les livrer au pillage et d’en abattre les
murailles. Le butin fut si considérable, que chaque fantassin, après qu’on
eut mis à part pour le Trésor l’or et l’argent, reçut 200 deniers, chaque
cavalier 400. Cent cinquante mille Épirotes furent vendus.
Paul Émile rentra à Rome en remontant le Tibre sur la
galère du roi ornée des boucliers d’airain de la phalange. La solennité du
triomphe dura trois jours, tant le butin était immense. Le premier, passèrent
les statues et les tableaux sur deux cent cinquante chariots : le second, une
longue file de voitures chargées d’armes, et trois mille hommes portant sept
cent cinquante vases, dont chacun contenait 5 talents en argent
monnayé ; d’autres avec des cratères et des coupes d’argent remarquables
par leur grandeur et leurs ciselures. Le troisième jour, des soldats portant
l’or monnayé dans soixante-dix-sept vases qui renfermaient chacun 3 talents;
quatre cents couronnes d’or données par les villes de Grèce et d’Asie ;
une coupe du poids de 10 talents d’or incrustée de pierreries ; et les
antigonides, les séleucides, les thériclées et les autres coupes d’or qui
ornaient la table des rois de Macédoine ; puis le char du roi chargé de
ses armes et de son diadème. La foule des captifs suivait ; parmi eux le
fils de Cotys et les enfants de Persée, auxquels leurs gouverneurs apprenaient
à tendre vers la foule des mains suppliantes. Derrière ses enfants marchait
Persée vêtu de deuil et l’air égaré comme si l’excès de ses maux lui avait
fait perdre tout sentiment. Il avait demandé à Paul Émile de le soustraire à
cette ignominie. C’est une chose qui a toujours été
et qui est encore en son pouvoir, avait durement répondu le Romain. Jeté
dans un cachot de la ville d’Albe, il comprit ce qu’était la clémence de
Rome, que Paul Émile lui avait vantée; et, dans l’année qui suivit le
triomphe, il se laissa mourir de faim ou périt sous les lentes tortures de
ses geôliers. Son fils aîné, Philippe, mourut avant lui ; l’autre, pour
gagner sa vie, apprit le métier de tourneur ; plus tard cet héritier d’Alexandre
parvint à la charge de greffier !
Quant à Genthios, après avoir paru au triomphe du préteur
Anicius, il avait été emprisonné à Iguvium, au milieu des montagnes de l’Ombrie.
Une fin plus triste fut celle de ce glorieux peuple qui
avait conquis la Grèce
et l’Asie. Jamais la
Macédoine ne remonta au rang des nations, et, jusqu’à nos
jours, durant vingt siècles, l’histoire n’a plus prononcé son nom.

IV. Fin de la ligue achéenne ; réduction de la Macédoine et de la Grèce en provinces
romaines
Le peuple romain n’avait encore rien pris, cette fois, si ce
n’est les 45 millions versés par Paul Émile dans le Trésor, et les tributs
imposés à la Macédoine,
qui permirent au Sénat de ne plus demander d’impôt aux citoyens ; mais
il n’avait pas besoin de réunir de nouveaux territoires à son empire pour
étendre sa domination. La
Macédoine avait paru le dernier boulevard de la liberté du
monde; maintenant qu’il était tombé, tous couraient au-devant de la
servitude, les rois en tête.
Les Rhodiens, qui avaient voulu imposer leur médiation,
redoutaient la guerre, bien qu’ils eussent mis à mort les partisans avoués de
Persée et apporté à Rome de riches présents. Le Sénat n’envoya pas d’armée
contre eux, mais la Lycie
et la Carie
leur furent définitivement enlevées, et on leur imposa le titre d’alliés, qui
faisait si rapidement tomber au rang de sujets. Ils n’en dressèrent pas moins
dans leur principal temple la statue colossale du Peuple romain[44] ; plus
tard, Smyrne éleva un temple à la ville de Rome. Dans l’île de Lesbos,
Antissa fut rasée pour avoir fourni quelques vivres à la flotte de Persée. En
Asie, toutes les villes s’empressèrent de bannir ou de mettre à mort les
anciens partisans du roi. Dans la
Grèce, il ne restait d’autre État libre que la ligue
achéenne, elle aussi destinée à périr. Philopœmen n’avait pu lui-même croire
sérieusement à sa durée. Quand les Romains, dit Polybe, demandaient des
choses conformes aux lois et aux traités, il exécutait sur-le-champ leurs
ordres ; quand leurs exigences étaient injustes, il voulait qu’on fit
des remontrances, puis des prières, et, s’ils demeuraient inflexibles, qu’on
prit les dieux à témoin de l’infraction des traités et qu’on obéît. Je sais, ajoutait-il, qu’un
temps viendra où nous serons tous les sujets de Rome[45] ; mais ce temps, je veux le retarder. Aristénès, au
contraire, l’appelle, car il voit l’inévitable nécessité, et il préfère la
subir aujourd’hui plutôt que demain. Cette politique d’Aristénès, que
Polybe ose appeler sage[46], Callicratès la
suivit, mais dans le seul intérêt de son ambition et avec un hideux cynisme de
servilité. La faute en est à vous, pères conscrits,
osa-t-il dire dans le Sénat, si les Grecs ne sont
pas dociles à vos volontés. Dans toutes les républiques il y a deux partis :
l’un qui prétend qu’on doit s’en tenir aux lois et aux traités, l’autre qui
veut que toute considération cède au désir de vous plaire ; l’avis des
premiers est agréable à la multitude : aussi vos partisans sont-ils
méprisés ; mais prenez à coeur leurs intérêts, et bientôt tous les chefs
des républiques, et avec eux le peuple, seront pour vous. Le Sénat
répondit qu’il serait à désirer que les magistrats de toutes les villes
ressemblassent à Callicratès, et, comme pour justifier ses paroles, les
Achéens l’élurent stratège à son retour de Rome.
Cela se passait quelques années avant la guerre de Persée.
Ce prince rendit l’espoir aux partisans de l’indépendance hellénique : aussi
les Achéens voulurent-ils d’abord garder une exacte neutralité ; mais,
quand Marcius eut forcé les défilés de l’Olympe, Polybe accourut lui offrir
le secours d’une armée achéenne[47] : il était trop
tard ; les Romains voulaient vaincre seuls, pour n’être point gênés par
la reconnaissance. Polybe lui-même fut du nombre des mille Achéens détenus en
Italie, et il aurait eu pour prison quelque ville obscure, loin de ses livres
et des grandes affaires qu’il aimait tant à étudier, si les deux fils de Paul
Émile n’avaient répondu de lui au préteur.
Pendant les dix-sept années que dura cet exil, sur lequel
le Sénat ne voulut jamais s’expliquer, Callicratès resta à la tête du
gouvernement de son pays. Il y faisait bien mieux les affaires de Rome que si
le Sénat eût envoyé à sa place un proconsul. Laisser aux pays vaincus ou
soumis à l’influence romaine leurs chefs nationaux, gouverner par les
indigènes, comme les Anglais le font dans l’Inde, fut une des maximes les
plus heureuses de la politique romaine. Content de cette apparente
indépendance, de ces libertés municipales qui s’accordent si bien avec
le despotisme politique, les peuples tombaient sans bruit, sans éclat, à la condition
de sujets, et le Sénat les trouvait tout façonnés au joug, quand il voulait
serrer le frein et faire sentir l’éperon. Ainsi la Grèce allait devenir, sans
qu’elle s’en aperçût, comme tant de cités italiennes, une possession de Rome,
lorsque, à la mort de Callicratès, Polybe, appuyé de Scipion Émilien,
sollicita le renvoi des exilés d’Achaïe. Es n’étaient plus que trois cents :
le Sénat hésitait. Caton s’indigna qu’on délibérât si longtemps sur une
pareille misère ; le mépris lui donna de l’humanité. Il ne s’agit, disait-il, que
de décider si quelques Grecs décrépits seront enterrés par nos fossoyeurs ou
par ceux de leur pays. On les laissa partir (150)[48]. Caton avait
raison : c’était bien au tombeau qu’après un dernier combat la Grèce allait descendre,
et, elle aussi, polir vingt siècles.
Chez quelques-uns de ces exilés, l’âge n’avait ni glacé l’ardeur
ni calmé le ressentiment. Diéos, Critolaos et Damocritos rentrèrent dans leur
patrie, le coeur ulcéré, et parleur audace imprudente précipitèrent sa ruine.
Les circonstances leur paraissaient, il est vrai,
favorables. Un aventurier, Andriscos, se donnant pour fils naturel de Persée,
venait de réclamer l’héritage paternel (152). Repoussé par les Macédoniens dans
une première tentative, il s’était réfugié auprès de Démétrius, roi de Syrie,
qui l’avait livré aux Romains. Ceux-ci, contre leur habitude, le gardèrent
mal; il s’échappa, recruta une armée en Thrace, et se donnant cette fois pour
Philippe, ce fils de Persée qui était mort chez les Marses, il souleva la Macédoine et occupa
une partie de la
Thessalie. Scipion Nasica le chassa de cette province (149) ; mais il y
rentra, battit et tua le préteur Juventius, et fit alliance avec les
Carthaginois, qui commençaient alors leur troisième guerre Punique. L’affaire
devenait sérieuse. Rome combattait en ce moment dans l’Espagne et l’Afrique ;
on pouvait craindre que le mouvement ne s’étendît de proche en proche à la Grèce entière et à l’Asie.
Une armée consulaire fut donnée au préteur Metellus, qui gagna une nouvelle
victoire de Pydna et conduisit à Rome Andriscos chargé de chaînes (148).
Une année avait suffi pour terminer cette guerre, au fond
peu redoutable, qu’un second imposteur tenta vainement de renouveler quelques
années plus tard (142).
Le Sénat, croyant enfin mûrs pour la servitude les États que depuis un
demi-siècle il avait vaincus et enlacés dans ses intrigues, réduisit la Macédoine en province (146).
La nouvelle province s’étendit de la Thrace à l’Adriatique, où
les deux florissantes cités d’Apollonie et de Dyrrachium lui servirent de
ports et comme de points d’attache avec l’Italie. Son impôt resta fixé à 100
talents, moitié de ce que la
Macédoine payait à ses rois et qu’elle leva elle-même ;
ses villes conservèrent leurs libertés municipales, et, au lieu des guerres
civiles et étrangères qui l’avaient si longtemps désolée, elle allait jouir,
durant quatre siècles, d’une paix et d’une prospérité qui ne fut que de loin
en loin troublée par les exactions de quelque proconsul républicain.
L’armée de Metellus le Macédonique était encore
cantonnée au milieu de sa conquête, quand un des bannis achéens, de retour
dans le Péloponnèse, Diéos, fut élu stratège. Durant sa magistrature, l’éternelle
querelle entre Sparte et la ligue, quelque temps assoupie, se renouvela, grâce
aux secrètes intrigues de Rome ; Sparte voulut encore sortie de la
commune alliance. Aussitôt les Achéens armèrent, mais les commissaires
romains arrivèrent, apportant un sénatus-consulte qui séparait de la ligue
Sparte, Argos et Orchomène : lés deux premières comme peuplées de Doriens, l’autre
comme étant d’origine troyenne, toutes trois, par conséquent, étrangères par
le sang aux autres membres de la confédération. A la lecture de ce décret,
Diéos souleva le peuple de Corinthe ; les Lacédémoniens trouvés dans la ville
furent massacrés, et les députés romains n’échappèrent au même sort que par
une fuite précipitée. Ce peuple, qui depuis quarante ans tremblait devant
Rome, retrouva enfin quelque courage dans l’excès de l’humiliation ; il
entraîna dans son ressentiment Chalcis et les Béotiens ; et, quand Metellus
descendit de la Macédoine
avec ses légions, les confédérés marchèrent à sa rencontre jusqu’à Scarphée,
dans la Locride
(146). Cette
armée fut taillée en pièces ; mais, en armant jusqu’aux esclaves, en
prenant l’argent des riches et les bijoux des femmes, Diéos réunit encore
quatorze mille hommes, et acheva ses préparatifs de défense ; posté à
Leucopétra, à l’entrée de l’isthme de Corinthe, il attendit le nouveau consul
Mummius. Sur les hauteurs voisines, les femmes, les enfants, s’étaient placés
pour voir leurs époux et leurs pères vaincre ou mourir : ils moururent.
Corinthe, abandonnée des Achéens, fût prise sans combat, et, pour épouvanter la Grèce par une exécution
féroce, le consul fit égorger les hommes, vendre les enfants et les femmes,
après quoi il livra la ville au pillage et à l’incendie[49] ; Thèbes,
Chalcis et le territoire des trois cités furent réunis au domaine public du
peuple romain. Les ligues achéenne et béotienne furent dissoutes; toutes les
villes qui avaient pris part à la lutte, démantelées, désarmées, soumises au
tribut et à un gouvernement oligarchique, qu’il était plus aisé au Sénat de
tenir dans la dépendance que des assemblées populaires[50]. Les territoires
sacrés, Delphes et Olympie, dans l’Élide, gardèrent leurs privilèges ;
mais le crédit de ces dieux qui ne savaient plus sauver leurs peuples
baissait, et l’herbe allait pousser autour de leurs parvis.
Encore un peuple rayé de la liste des nations ! Les Grecs,
par la main de Rome, étaient arrivés à la fin de leur existence politique, et
ils n’avaient pas même le droit d’en accuser la fortune. Il en coûte de le
dire, à nous surtout, mais ceux qui ont tort, sans que les vainqueurs aient
toujours raison, sont le plus souvent les vaincus. Qu’on se reporte au
tableau que nous avons tracé de la
Grèce, avant que les Romains n’y missent le pied, et l’on
reconnaîtra que ce peuple avait, de ses mains, creusé son tombeau. Qui ne
peut se gouverner obéira, qui n’a point de prévoyance sera exposé à tous les
hasards : c’est la loi universelle. L’anarchie fit justement esclaves ceux qu’en
des temps meilleurs le patriotisme et la discipline avaient faits glorieux et
forts.
En vérité, cette race dégénérée ne méritait pas que Rome
dépensât tant de prudence pour l’amener insensiblement sous son empire. Comme
si le Sénat avait eu toujours présents à l’esprit les exploits jadis
accomplis par la Grèce,
comme s’il avait redouté qu’en précipitant les choses, quelque beau désespoir
ne renouvelât les lauriers de Marathon et de Platée, il avait mis un
demi-siècle à agir et à parler en maître. La guerre contre les Illyriens
terminée, il avait fait savoir aux Grecs que c’était pour les délivrer de ces
pirates que les légions avaient traversé l’Adriatique, et, clans la lutte
avec la Macédoine,
il avait prétendu combattre pour leur indépendance. Après Cynocéphales,
Flamininus transforma doucement cette amitié des premiers jours en
protectorat; et ce ne fut qu’après que toute force eut été détruite en Macédoine,
en Asie, en Afrique, que Mummius fit du protectorat une domination. Même
alors, la Grèce
ne fit pas formellement réduite en province[51]. Ce grand nom
imposait. D’ailleurs les cités les plus glorieuses, Athènes, Sparte, d’autres
encore, étaient restées étrangères à la lutte engagée par les Achéens, et
beaucoup de ceux-ci l’avaient soutenue avec mollesse : Si nous n’eussions été perdus promptement,
disaient-ils, nous n’aurions pu nous sauver[52]. Ils entendaient
par là qu’une résistance opiniâtre aurait rendu les Romains implacables,
tandis qu’une facile victoire avait désarmé leur colère. Une fois, en effet,
les exécutions des premiers jours accomplies, et les auteurs, les complices
de la guerre, punis de manière à ôter l’envie de recommencer, les Grecs furent
traités en vaincus dont home voulait gagner l’amitié. Ils perdirent la
liberté, mais ils en conservèrent l’apparence, en gardant leurs lois, leurs
magistrats, leurs élections, même leurs ligues qu’au bout de quelques années
le Sénat leur permit de renouer. Point de garnison romaine dans leurs villes,
point de proconsul dans leur pays. Seulement, du fond de la Macédoine, le
gouverneur écoutait tous les bruits, surveillait tous les mouvements, prêt à
descendre sur l’Hellade avec ses cohortes et à renouveler par quelque mesure
rigoureuse l’effroi laissé dans les âmes par la destruction de Corinthe. En
réalité, Rome n’ôtait aux Grecs que le droit de dévaster leur pays par la
continuité des guerres intestines.
Metellus avait enlevé de Pella vingt-cinq statues en
bronze qu’Alexandre avait commandées à Lysippe pour consacrer la mémoire de
ses gardes tombés sur les bords du Granique. Il les plaça en face de deux
temples qu’il bâtit à Jupiter et à Junon et qui furent les premiers édifices
de marbre que Rome posséda. Après ces constructions, il lui resta, sur la
part de butin qu’il s’était faite, assez d’argent pour élever encore un
magnifique portique.
Mummius était un Romain de vieille roche ; il avait
conservé toute la rusticité antique et ne comprenait rien aux élégances de la Grèce. Afin d’obéir
à la coutume, bien plus que par goût pour les chefs-d’œuvre de l’art, il
enleva de Corinthe, avant l’incendie et le pillage, les statues, les vases[53], les tableaux,
les ciselures, et ce qu’il n’avait pu vendre au roi de Pergame[54], il le fit
transporter à Rome, où ce butin de guerre servit à décorer les temples et les
lieux publics. Pour lui-même, il ne garda rien et resta pauvre, de sorte que
la république fut obligée de doter ses filles. Jamais il ne se douta qu’il
avait commis un crime en détruisant la plus belle ville de la Grèce, après un combat
sans péril et par conséquent sans gloire. Il crut toujours avoir accompli un
exploit mémorable, et, dans son inscription consulaire, qu’on a retrouvée, on
lit ces mots, où il mettait l’honneur de son consulat : deleta Corintho. Ce barbare eut bien raison
de consacrer, après son triomphe, un temple au dieu de la force, à Hercule
vainqueur.
Quant aux auteurs de la guerre d’Achaïe, l’un, Critolaos,
avait disparu à Scarphée ; l’autre, Diéos, s’était donné la mort, qu’il
n’avait pu trouver sur le champ de bataille. De Leucopétra il s’était enfui à
Mégalopolis, avait égorgé sa femme et ses enfants, mis le feu à sa maison et
s’était lui-même empoisonné. En suscitant une lutte insensée, ces hommes
avaient appelé bien des maux sur leur patrie, mais ils tombèrent avec elle et
pour elle. Le dévouement absout de l’imprudence, et nous aimons mieux que la Grèce ait ainsi fini, sur
un champ de bataille, que dans le sommeil léthargique on tant d’autres
victimes de Rome se sont éteintes. Pour les nations comme pour les individus,
il faut savoir bien mourir. Les Achéens, restés seuls debout au milieu des
peuples grecs abattus, devaient ce dernier sacrifice à la vieille gloire de l’Hellade.
Politiquement la
Grèce est morte. A l’Agora, plus de luttes orageuses et de
sentences d’exil contre la faction vaincue ; au Pirée, plus de galères
chargées de soldats; au Parthénon, plus de chants de triomphe ; au
Céramique, plus d’éloges funèbres : Rome commande la paix. Et pourtant
quelques restes du génie grec vivent encore. Si l’élan donné par les grands
hommes des siècles précédents s’est ralenti jusqu’à paraître s’arrêter,
partout des rhéteurs dissertent, des grammairiens subtilisent, des
philosophes disputent et, dans Athènes, les plus distingués des Romains
viennent achever ou refaire leur éducation : un d’eux, un ami de Cicéron, y
prend le nom d’Atticus. Pergame fonde une nouvelle école de sculpture; Rhodes
croit enseigner les secrets de l’éloquence ; Alexandrie est une fabrique de
poésie, et les villes de la côte asiatique s’emplissent de praticiens qui, à
beaux deniers comptants, copient les chefs-d’œuvre consacrés, pour décorer
les villas des proconsuls. Par la science, l’art et la philosophie des
anciens maîtres, la Grèce
va conquérir l’Occident qu’aux jours de sa puissance, son génie n’avait point
entamé, et elle y règne toujours.
Græcia
capta ferum victorem cepit.
Mais cette seconde vie de la Grèce, cette action
exercée par elle sur Rome appartiennent à l’histoire de la nouvelle capitale
du monde ; je l’ai déjà racontée et j’y renvoie[55].
|