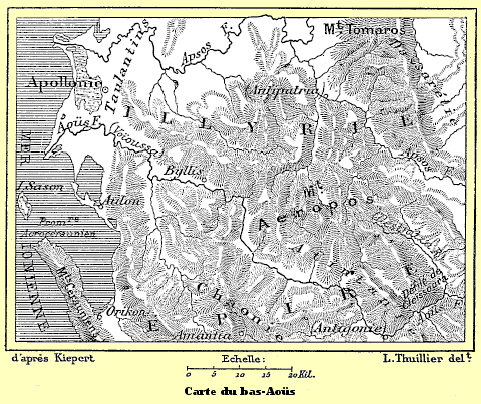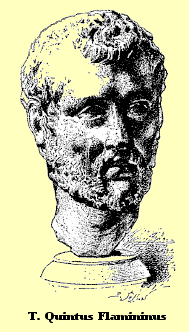|
I. Première guerre de Macédoine
En 217, Philippe s’était rendu à Argos et y assistait à la
célébration des jeux néméens, lorsque un courrier, arrivé de Macédoine, lui
donna avis que les Romains avaient perdu une grande bataille, celle de
Trasimène, et qu’Annibal était maître du plat pays. Le roi ne montra cette
lettre qu’à Démétrios de Pharos, qui le pressa d’attaquer aussitôt les
Illyriens et de passer ensuite en Italie. Il lui représentait que la Grèce, déjà soumise,
continuerait à lui obéir; que les Achéens étaient entrés d’eux-mêmes et de
plein gré dans ses intérêts ; que les Étoliens, effrayés de la guerre
présente, ne manqueraient pas de les imiter; qu’enfin, s’il voulait se rendre
maître de l’univers, noble ambition qui ne convenait à personne mieux qu’à
lui, il fallait traverser l’Adriatique et accabler les Romains à demi abattus
par Annibal. Et l’historien ajoute : De telles
paroles charmaient un roi jeune, hardi, heureux dans ses entreprises, et né d’une
race qui s’était toujours flattée de parvenir à l’empire universel. (Polybe)
C’étaient donc les ambitieux desseins où avaient échoué
deux vaillants hommes, Alexandre le Molosse et Pyrrhus, que l’Illyrien
voulait faire reprendre par le faible héritier du trône de Macédoine. Ni le
prince ni son conseiller ne s’inquiétaient de sentir le monde ébranlé par le
choc de Rome et de Carthage. Trompés par leurs chimériques espérances, ils ne
voyaient pas que dans ce livre des destins, que la prudence et le courage
écrivent, les Romains étaient portés comme les héritiers d’Alexandre. Pour
avoir les mains libres dans cette occurrence, Philippe accorda la paix
sollicitée par les Étoliens vaincus. S’il eût vu sainement les choses, il eût
agi de même, mais dans la pensée de défendre l’indépendance de la Grèce. Cependant,
à l’assemblée, où le traité de paix fut conclu à la condition que chacun
conserverait ses positions, une voix s’éleva pour signaler le péril : Que la
Grèce s’unisse, disait Agélaos de Naupacte ; qu’elle considère ces armées immenses qui se disputent les
champs de bataille de l’Italie ; cette lutte bientôt finira : Rome ou
Carthage sera victorieuse ; quels que soient les vainqueurs, ils viendront
nous chercher dans nos foyers. Soyez attentifs, ô Grecs, et toi surtout, ô
roi Philippe ! Que les discordes cessent, et travaillons tous en commun
à prévenir le danger !
On écouta l’orateur, mais ses paroles passèrent ; l’ambition,
la jalousie, la haine, restèrent dans les cœurs. L’Étolie et Sparte ne
pardonnaient pas à la ligue achéenne son recours aux étrangers, à Philippe
son intervention et ses succès. Philippe lui-même oublia les sages avis d’Agélaos,
de respecter la liberté des Grecs et de se faire loyalement leur défenseur.
Ses ministres, et particulièrement Démétrius de Pharos, lui conseillaient d’asservir
le Péloponnèse.
Un jour, à Messène, il avait obtenu qu’on le laissât
entrer dans la citadelle d’Ithome avec ses gardes, pour y faire un sacrifice.
Démétrius et Aratus l’accompagnaient. La victime égorgée, il leur en montra
les entrailles en disant : Ne marquent-elles pas qu’il
faut garder ce fort ? Démétrius lui répondit : Si tu n’es ici qu’un devin, sors au plus vite ; mais si tu
es un roi, demeure. Maître d’Ithome et de l’Acrocorinthe, tu tiens le bœuf par
les cornes. Aratus, lui, restait pensif. Pressé de répondre : Fais-le, dit-il, si tu
peux le faire, sans violer aucun serment. Philippe rougit et après un
moment d’hésitation : Allons ; il faut
reprendre le chemin par où nous sommes venus. L’ascendant d’Aratus l’emportait
encore.
Ce fut le dernier succès de ce prudent politique qui, en
butte aux grossiers outrages des courtisans, perdait chaque jour de son influence.
Gâté par le pouvoir, ce dangereux maître, Philippe s’abandonnait à tous les
excès. Il fit au jeune Aratus un sanglant outrage, en portant la honte dans
sa maison. Aratus lui-même finit par paraître importun, et, s’il faut en
croire un récit heureusement peu certain, le roi songea à se défaire de lui.
N’osant, dit-on, frapper ouvertement ce vieillard respecté, il chargea un de
ses officiers de lui donner un poison lent. Aratus s’aperçut
qu’il était empoisonné ; mais il n’eût servit à rien de se plaindre ;
il supporta donc patiemment son mal, comme si c eût été une maladie
ordinaire. Un jour seulement qu’un de ses amis s’étonnait de lui voir cracher
du sang : Mon cher Céphalon, lui dit-il, voilà le fruit de l’amitié
des rois. Il mourut à Égion, étant pour la dix-septième fois
stratège (213).
On porta son corps à Sicyone, au lieu que, quatre siècles plus tard, on
appelait encore l’Aration, et où le culte des héros lui était rendu par
des sacrifices solennels. Même aujourd’hui,
dit Plutarque, il subsiste quelque chose de ces
cérémonies.
Aratus avait vu, avant de mourir, la lutte engagée entre
Philippe et Rome. Quelque temps après la paix conclue avec les Étoliens, le
roi avait fait équiper cent vaisseaux sur l’Adriatique, pour chasser les Romains
du continent grec. La bataille de Cannes (216) accrut ses espérances. Il envoya à
Annibal des députés qui conclurent un traité d’alliance, par lequel il s’engageait
à fournir deux cents vaisseaux et à ravager les côtes d’Italie. Après la
victoire, Rome, l’Italie et les dépouilles appartiendraient à Annibal et aux
Carthaginois ; ceux-ci devaient alors passer en Grèce, faire la guerre à
tous ceux, rois ou peuples, que Philippe leur désignerait, lui soumettre les
villes du continent et lui abandonner les îles voisines de la Macédoine. Philippe
exécuta mal ce traité imprudent, qui lui imposait toutes les charges du
présent pour un avenir fort incertain. Il n’équipa point les deux cents
vaisseaux promis, il donna le temps aux Romains d’armer une flotte de cent
vingt galères, supérieure à la sienne, et l’année suivante, assiégeant
Apollonie, il se laissa surprendre et vaincre, à l’embouchure de l’Aoüs, par
le préteur Lévinus, qui le força de brûler ses vaisseaux (214). Une seule
légion avait suffi à chasser le roi de ces parages.
Après avoir fermé à la Macédoine la route de l’Adriatique,
Lévinus s’occupa de lui créer des embarras en Grèce. Les Étoliens acceptèrent
l’alliance du Sénat, qui leur promit de ne réserver pour Rome que les
dépouilles, et de leur laisser toutes les villes, avec l’Acarnanie et la
moitié de l’Épire. Les Éléens suivirent, comme toujours, le parti des
Étoliens. Les Messéniens, Pleurate, roi d’Illyrie, acceptèrent la protection
qui leur était offerte. Sparte, enfin, par haine contre la ligue achéenne, et
Athènes, jalouse aussi de ces petites villes qui faisaient maintenant plus de
bruit qu’elle dans le monde, passèrent du côté de l’étranger (211).
Depuis ce moment jusqu’au traité de 205, rien de grand
dans la Grèce. On
n’y déploie même plus l’énergie de la guerre des deux ligues, comme si l’ombre
de Rome La s’étendait déjà sur cette contrée ; ses armes ont affaibli
Philippe et sa politique en a divisé les peuples. En attendant qu’elle
intervienne d’une manière plus décisive, chacun guerroie contre tous, sans
résultat, mais avec beaucoup de cruauté. Anticyre, Dyme, Oreos, Égine sont
affreusement saccagées et leurs habitants vendus. Si Philippe remporte
quelques avantages sur les Étoliens, Attale, roi de Pergame, lui enlève
plusieurs villes. Dans le Péloponnèse, Sparte, achevant son évolution
révolutionnaire, se livre au tyran Machanidas, qui fait contre les Achéens
une guerre de pillages. La ligue n’a vécu encore qu’un âge d’homme, et déjà
elle est vieille. Le luxe et la mollesse s’y sont introduits ; l’armée
est désorganisée, le service militaire négligé, même des chevaliers. Un
homme, le Mégalopolitain Philopœmen, bon citoyen et capitaine habile,
parvient cependant à rendre quelque ardeur à cette association d’où la vie se
retire, depuis qu’elle ne sait plus se défendre elle-même. Philopœmen ravive
l’esprit militaire, réforme l’armure et l’ordonnance des soldats, et se
compose une petite phalange achéenne, à l’instar de la macédonienne. Cette
réforme lui donne, près de Mantinée, où Polybe combattit à côté de lui, la
victoire sur Machanidas, qu’il tue de sa main. A quoi bon ? Il s’éloigne
ensuite et va faire la guerre en Crète, laissant les événements se suivre d’eux-mêmes,
sans direction, dans sa patrie.
Après ces guerres languissantes, on fit la paix en 205;
Philippe signa d’abord une convention séparée avec les Étoliens, puis il
traita avec les Romains : le pays des Parthéniens et plusieurs cantons de l’Illyrie
furent ajoutés à l’Illyrie romaine.

II. Seconde guerre contre la
Macédoine (200-197)
Les Romains ne voyaient dans cette paix qu’une suspension
d’armes qui leur permettait de se débarrasser de toute affaire, jusqu’à ce
que leur grande querelle avec Carthage fût vidée. Philippe ne comprit pas que
ce n’était qu’un délai qui lui était laissé ; au lieu de préparer ses
forces, il les dissipa dans une guerre inutile contre Attale et Rhodes. Il
assiégea vainement Pergame et fut battu sur mer par les Rhodiens ; mais
il s’empara, sur les côtes de Thrace, de plusieurs places, et, dans la Mysie, de six villes
maritimes, parmi lesquelles Abydos. Se couvrir de la Thrace contre un allié de
Rome, dangereusement placé pour la Macédoine, c’était bien; aller conquérir en
Asie Mineure, c’était inutile et imprudent. Il ne fallait pas s’étendre, c’est-à-dire
se rendre plus vulnérable, mais se concentrer. Et puis pourquoi provoquer
Rome par un faible secours de quatre mille hommes, envoyé à Annibal fuyant de
l’Italie ? Il était bien tard pour essayer de sauver Carthage.
Les alliés de Rome en Grèce révélèrent au Sénat cet envoi
de secours aux Carthaginois; dans le même temps, les Étoliens, les Athéniens,
accusèrent Philippe d’avoir ravagé leur territoire et le roi Attale, les
Rhodiens lui reprochaient ses tentatives sur l’Asie. Philippe avait
évidemment de l’ambition et peu d’affection pour Rome. On aurait pu s’en
douter depuis longtemps; mais il n’avait convenu au Sénat de s’en apercevoir
qu’après Zama.
La guerre lui fut déclarée, afin, dirent les consuls aux
Romains, de ne point attendre ce nouvel adversaire en Italie, comme on v
avait attendu Pyrrhus et Annibal. A peine respirait-on de la guerre d’Afrique
et d’une lutte sanglante de seize ans. Ce peuple infatigable se rendit
pourtant, malgré son désir de repos, aux spécieuses raisons du consul
Sulpicius. Il avait ce grand et rare courage de ne se point reposer tant qu’il
restait quelque chose à faire.
Philippe s’était allié avec Antiochus III de Syrie et
Prusias de Bithynie pour dépouiller de ses possessions de Thrace et d’Asie le
roi d’Égypte, Ptolémée Épiphane, que défendaient Rhodes et Attale de Pergame.
En Grèce, Sparte, sous Nabis, l’odieux successeur de Machanidas, Athènes, qui
venait d’échanger avec Rhodes le droit de cité, les Étoliens, qui dominaient
à peu près d’une mer à l’autre[1] et occupaient les
Thermopyles, étaient ses ennemis déclarés, et ses excès ne lui avaient laissé
que de tièdes amis. Sulpicius Galba, chargé de le combattre, emmena seulement
deux légions ; Carthage lui donna du blé, Masinissa des Numides, Rhodes et
Attale leurs vaisseaux, les Étoliens, après quelque hésitation, leurs
cavaliers, les meilleurs de la Grèce. Nabis, sans se déclarer pour Rome, était
déjà en guerre ouverte avec les Achéens.
Dès que les opérations commencèrent, malgré son activité,
se trouva comme enveloppé d’un réseau d’ennemis. Un lieutenant de Sulpicius,
envoyé au secours d’Athènes, brûla Chalcis, la principale ville de l’Eubée ;
les Étoliens, unis aux Athamanes, saccagèrent la Thessalie ; Pleurate,
roi d’Illyrie, et les Dardaniens descendirent en Macédoine; enfin un autre
lieutenant poussa une reconnaissance jusque dans la Dassarétie. Ce
fut de ce côté que Sulpicius attaqua, c’est-à-dire par Lychnidus et là route
que suivra la future voie Égnatienne, en se dirigeant sur la forte place d’Héraclée
(près de Monastir).
Philippe arriva à temps pour la couvrir et ferma aux Romains le défilé d’où
ils auraient pu descendre dans les fertiles plaines de la Lyncestide. brais,
dans ces montagnes, la phalange macédonienne était inutile, et, bien que
Philippe eût réuni jusqu’à vingt-six mille hommes, il ne put empêcher le
Romain de tourner sa position par le nord et de déboucher dans la plaine par
la route de la
Pélagonie. Sulpicius se trouva donc, au bout de quelques
mois, au coeur de la
Macédoine. Mais l’hiver approchait; sans magasins, sans
places fortes, il ne pouvait hiverner au milieu du pays ennemi : il revint à
Apollonie.
Pendant l’été, la flotte combinée avait chassé des
Cyclades les garnisons de Philippe, pris Orée et pillé les côtes de la Macédoine (200). Quelques
ravages dans l’Attique, de légers avantages sur les Étoliens, qui s’étaient
jetés sur la Thessalie,
et la prise de Maronée, riche et puissante cité de la Thrace, ne supprimaient
pas pour Philippe le danger d’avoir laissé l’ennemi arriver jusqu’au coeur de
son royaume.
Le nouveau consul Villius trouva l’armée romaine mutinée
et passa la campagne à rétablir la discipline (199). Il n’y réussit sans doute qu’en
donnant leur congé aux mutins qui, partis pour cette guerre dans l’espérance
d’une expédition rapide et d’un riche butin, n’avaient eu ni l’une ni l’autre;
du moins, le successeur de Villius dut amener neuf mille nouveaux soldats.
Encouragé par cette inaction, le roi prit I’offensive et vint occuper sur les
deux rives de l’Aoüs, prés d’Antigonie, une position presque inexpugnable qui
couvrait la Thessalie
et l’Épire, et d’où il pouvait couper aux Romains leurs communications avec
la mer, s’ils recommençaient l’expédition de Sulpicius.
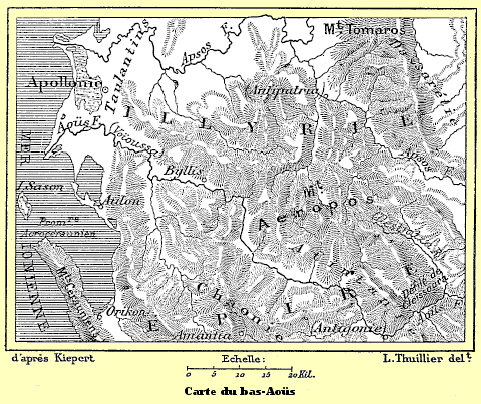
A Rome, on s’irrita de ces retards et on éleva au consulat
T. Q. Flamininus, bien qu’il n’eût encore exercé que la questure, mais sa réputation
avait devancé ses services. Bon général, meilleur politique, esprit souple et
rusé, plutôt Grec que Romain, Flamininus fut le véritable fondateur de la
politique machiavélique qui livra la
Grèce presque désarmée aux Romains.
Il ne fit pas mieux d’abord que son prédécesseur. L’inutile
tentative de Sulpicius avait montré que la Macédoine était
difficilement abordable par les montagnes du Nord-Ouest et l’attaque du Sud
par la flotte n’avait conduit qu’à des pillages qui ne terminaient rien.
Restait à tenter le passage de front. Mais Philippe s’était établi dans une
gorge serrée entre deux montagnes, dont les flancs abrupts et nus
descendaient jusqu’au fleuve, qui occupait presque toute la largeur de la
passe[2].
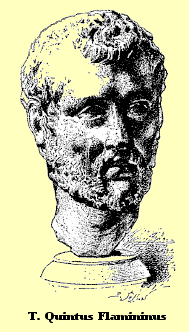 Durant
six semaines, Flamininus resta en face du camp inattaquable des Macédoniens. Chaque
jour des escarmouches avaient lieu ; mais quand
les Romains se perforceoyent de gravir contre mont, ils estoyent accueilliz
de force coups de dards et de traicts, que les Macédoniens leur donnoyent de
çà et de là par les flancs : si estoyent les escarmouches fort aspres pour le
temps qu’elles duroyent, et y demouroyent plusieurs blessez et plusieurs tuez
d’une part et d’autre; mais ce n’estoit pas pour décider ni vuider une guerre[3]. Le découragement
arrivait, lorsque Champs, un chef épirote, dont l’armée macédonienne épuisait
le pays, fournit au consul les moyens de renoncer à cette dangereuse inaction.
Il lui envoya un berger qui, habitué à conduire son troupeau dans le défilé
de Cleïssoura, connaissait tous les sentiers de la montagne, et qui offrit de
mener les Romains en trois jours à un endroit où ils se trouveraient
au-dessus du camp ennemi. Après s’être assuré que le pâtre venait bien de la
part du roi, Flamininus forma un corps d’élite de quatre mille fantassins et
de trois cents chevaux, lui commanda de ne marcher que la nuit, la lune, en
cette saison, suffisant à éclairer le chemin, et, arrivé au lieu désigné par
le pâtre, d’allumer un grand feu dont la fumée annoncerait aux légions le
succès de l’entreprise. Le consul s’était assuré du guide par deux moyens
efficaces : promesse de grandes récompenses, s’il restait fidèle ; ordre aux
soldats de le tuer, s’il les conduisait à une embuscade. Pour attirer l’attention
des Macédoniens vers le bas du fleuve, des attaques qui semblaient devenir
sérieuses se renouvelèrent incessamment durant deux jours. Le troisième, au
signal convenu, un cri immense s’élève du fond de la vallée et, en même temps,
descend des hauteurs qui dominent le camp royal. Les Macédoniens, attaqués de
front et menacés d’être tournés, s’épouvantent ; ils fuient et ne s’arrêtent
que dans la Thessalie,
derrière la chaîne du Pinde[4]. Durant
six semaines, Flamininus resta en face du camp inattaquable des Macédoniens. Chaque
jour des escarmouches avaient lieu ; mais quand
les Romains se perforceoyent de gravir contre mont, ils estoyent accueilliz
de force coups de dards et de traicts, que les Macédoniens leur donnoyent de
çà et de là par les flancs : si estoyent les escarmouches fort aspres pour le
temps qu’elles duroyent, et y demouroyent plusieurs blessez et plusieurs tuez
d’une part et d’autre; mais ce n’estoit pas pour décider ni vuider une guerre[3]. Le découragement
arrivait, lorsque Champs, un chef épirote, dont l’armée macédonienne épuisait
le pays, fournit au consul les moyens de renoncer à cette dangereuse inaction.
Il lui envoya un berger qui, habitué à conduire son troupeau dans le défilé
de Cleïssoura, connaissait tous les sentiers de la montagne, et qui offrit de
mener les Romains en trois jours à un endroit où ils se trouveraient
au-dessus du camp ennemi. Après s’être assuré que le pâtre venait bien de la
part du roi, Flamininus forma un corps d’élite de quatre mille fantassins et
de trois cents chevaux, lui commanda de ne marcher que la nuit, la lune, en
cette saison, suffisant à éclairer le chemin, et, arrivé au lieu désigné par
le pâtre, d’allumer un grand feu dont la fumée annoncerait aux légions le
succès de l’entreprise. Le consul s’était assuré du guide par deux moyens
efficaces : promesse de grandes récompenses, s’il restait fidèle ; ordre aux
soldats de le tuer, s’il les conduisait à une embuscade. Pour attirer l’attention
des Macédoniens vers le bas du fleuve, des attaques qui semblaient devenir
sérieuses se renouvelèrent incessamment durant deux jours. Le troisième, au
signal convenu, un cri immense s’élève du fond de la vallée et, en même temps,
descend des hauteurs qui dominent le camp royal. Les Macédoniens, attaqués de
front et menacés d’être tournés, s’épouvantent ; ils fuient et ne s’arrêtent
que dans la Thessalie,
derrière la chaîne du Pinde[4].
Au bruit de cette victoire, qui donnait l’Épire à
Flamininus, les Étoliens se jetèrent sur la Thessalie, et
Amynander, roides Athamanes, ouvrit aux Romains l’entrée de cette province
par le défilé de Gomphi. Philippe, n’osant risquer un nouveau combat, s’était
retiré dans la vallée de Tempé, après avoir pillé le plat pays, brûlé Ies
villes ouvertes et chassé les populations dans les montagnes. Cette conduite
offrait un dangereux contraste avec celle des Romains, auxquels Flamininus
faisait observer la plus exacte discipline, et qui avaient souffert de la
faim plutôt que de rien enlever dans l’Épire[5]. Aussi plusieurs
places ouvrirent leurs portes, et Flamininus était arrivé déjà sur les bords
du Pénée, quand la courageuse résistance d’Atrax arrêta sa marche
victorieuse. Près de là s’élevait l’importante ville de Larisse que les
Macédoniens occupaient en force. Le consul recula.
Dans cette campagne, la flotte alliée avait pris, en
Eubée, Caryste et Érétrie (198), d’où elle enleva quantité de
statues, des tableaux d’anciens maîtres et des chefs-d’œuvre de toute sorte.
Les Macédoniens trouvés dans ces places durent livrer leurs armes et payer
une rançon de 300 sesterces par homme.
Au lieu de perdre l’hiver, comme ses prédécesseurs, en
retournant prendre ses quartiers autour d’Apollonie, Flamininus conduisit ses
légions à Anticyre, sur le golfe de Corinthe, où les vaisseaux de Corcyre (Corfou), son port
de ravitaillement, lui apporteraient en toute sécurité les provisions dont il
avait besoin. Il se trouvait là au centre de la Grèce. Tandis que
ses troupes enlevaient les petites villes de la Phocide et assiégeaient
la forte place d’Elatée, qu’elles finirent par prendre, ses négociations, ses
menaces, les conseils des amis de Rome et de nouvelles hostilités de Nabis
obligeaient les Achéens à accepter son alliance[6]. Il avait promis
de leur rendre Corinthe, mais la garnison macédonienne repoussa toutes les
attaques et enleva même Argos, qu’elle céda à Nabis. Cet affreux tyran y
proclama deux lois : l’une pour l’abolition des dettes, l’autre pour le
partage des terres; ce qui montre bien le caractère que prenaient, en Grèce,
toutes les révolutions de ce temps. Nabis, ayant tiré de Philippe ce qu’il en
pouvait espérer, passa aussitôt dans le parti romain ; déjà le reste du
Péloponnèse y était entré.
Flamininus tenait à terminer lui-même cette guerre par une
paix ou, mieux encore, par une victoire. Philippe lui ayant demandé une
conférence, il l’accorda, et on y prit, de part et d’autre, les précautions
soupçonneuses dont on usa tant au moyen âge. Elle eut lieu sur le bord de la
mer, dans le golfe Maliaque. Le roi s’y rendit sur un vaisseau de guerre
escorté de cinq barques, mais refusa d’en descendre et parlementa du haut de
la proue de sa galère. Nous sommes bien mal ainsi,
lui dit Flamininus, si vous veniez à terre nous
pourrions mieux nous entendre.
Le roi s’y refusant, il ajouta : Que
craignez-vous donc ? — Je ne crains,
reprit-il, que les dieux immortels, mais je n’ai pas
confiance en ceux qui vous entourent. Le jour se passa en vaines
récriminations ; le lendemain le roi consentit à quitter son navire, à
condition que Flamininus éloignerait les chefs alliés, et il descendit à
terre avec deux de ses officiers. Le consul ne se fit suivre que d’un
tribun ; on convint d’une trêve de deux mois durant laquelle le roi et
les alliés enverraient une ambassade au Sénat. Les Grecs exposèrent d’abord
leurs griefs; quand les Macédoniens voulurent répliquer par un long discours,
ils furent sommés de dire seulement si leur maître consentait à retirer ses
garnisons des villes grecques, et, sur leur réponse qu’ils n’avaient point d’instructions
à cet égard, on les congédia. C’est ce que Flamininus souhaitait.
Dans la
Grèce centrale, les seuls Béotiens hésitaient encore[7]. Flamininus leur
demande une conférence, et lorsque le stratège Antiphile sort à sa rencontre
entouré des principaux Thébains, il s’avance presque seul, avec le roi de
Pergame, parle à chacun des députés, les flatte, les distrait; tout en
causant, il arrive aux portes et les mène jusqu’à la place publique,
entraînant après lui tout le peuple, avide de voir un consul et d’entendre un
Romain qui parle si bien leur langue. Mais deux mille légionnaires suivaient
à quelque distance : tandis que Flamininus tient la foule sous le charme, ils
s’emparent des murs : Thèbes était prise.
Dans cette campagne d’hiver, d’une espèce nouvelle,
Flamininus avait conquis la
Grèce et réduit Philippe aux seules forces de son royaume.
Il pouvait maintenant l’attaquer de front. Au retour du printemps, il l’alla
chercher jusqu’à Phères en Thessalie, à la tête de vingt-six mille hommes,
dont six mille étaient Grecs et parmi eux cinq cents Crétois. Philippe, qui
depuis vingt ans usait ses forces dans de folles entreprises, ne put réunir
vingt-cinq mille soldats qu’en enrôlant jusqu’à des enfants de seize ans[8] ; sur ce nombre l’armée
comptait seize mille phalangistes.
La diplomatie du Sénat plutôt que ses armes avait eu les
honneurs de la première guerre de Macédoine. Cette fois, la légion, avec ses
mouvements rapides et ses armes de jet, les javelots et le terrible pilum,
se trouvera aux prises avec la phalange d’Alexandre, qui, depuis près d’un
siècle et demi, était réputée le plus formidable engin de guerre que l’homme
eût encore trouvé.
Les Romains étaient sur les bords du golfe Pagasétique, à
portée de leur flotte ; Philippe à Larisse, son quartier général. Les deux
armées allèrent à la rencontre l’une de l’autre et, deux jours durant
marchèrent côte à côte, séparées par une chaîne de collines, sans qu’aucune
se doutât de ce dangereux voisinage.
La bataille se livra en juin 197, près de Scotussa, dans
une plaine parsemée de collines nommées les Têtes de Chien, Cynocéphales. La cavalerie
étolienne engagea l’action, et Philippe n’eut ni le temps ni les moyens de
ranger sa phalange. Sur ce terrain accidenté, elle perdait sa force avec son
unité ; le choc des éléphants de Masinissa, une attaque habilement
dirigée sur ses derrières, et la pression inégale des légionnaires la
rompirent ; huit mille Macédoniens restèrent sur le champ de bataille. La
destruction de cette phalange que les Grecs croyaient invincible leur inspira
pour le courage et la tactique des Romains une admiration que Polybe lui-même
partage.
Philippe se réfugia avec ses débris dans la ville de
Gonnos, à l’entrée des gorges de Tempé, où se trouve la route habituelle de
Thessalie en Macédoine. Il y couvrait son royaume ; mais, n’ayant plus
assez de force pour continuer la lutte, il demanda à traiter. Les Étoliens
voulaient pousser la guerre à outrance. Flamininus leur répondit en vantant l’humanité
des Romains. Fidèles à leur coutume d’épargner les
vaincus, ils ne renverseraient pas, disait-il, un royaume qui couvrait la
Grèce contre les Thraces, les Illyriens et les Gaulois
; et dont l’existence, n’osait-il ajouter tout haut, était nécessaire à la
politique du Sénat pour contenir la turbulence des Étoliens. Philippe rappela
ses garnisons des villes et des îles de Grèce et d’Asie qu’elles occupaient
encore, laissa libres les Thessaliens, et donna aux Perrhèbes, c’est-à-dire
aux Romains, Gonnos, la vraie porte de son royaume. Il livra sa flotte, moins
cinq vaisseaux de transport, licencia son armée, moins cinq mille hommes, s’engagea
à ne point dresser un seul éléphant de guerre, paya 500 talents, en promit 50
comme tribut annuel pendant dix ans, et jura de ne faire aucune guerre sans l’assentiment
du Sénat.
Après l’avoir désarmé, on l’humilia comme roi, en le
forçant de recevoir et de laisser libres et impunis les Macédoniens qui l’avaient
trahi. Flamininus stipula même l’indépendance des Orestins, tribu macédonienne
qui s’était soulevée durant la guerre, et dont le pays était une des clefs du
royaume du côté de l’Illyrie romaine. Pour sûreté de ces conditions, Philippe
donna des otages, parmi lesquels les Romains firent comprendre son jeune fils
Démétrius.
Au moment où la Macédoine subissait ce traité désastreux, le
roi de Syrie, Antiochus, à l’instigation d’Annibal, apprêtait ses forces. Flamininus, dit Plutarque, en
plaçant à propos la paix entre ces deux guerres, en terminant l’une avant que
l’autre eût commencé, ruina d’un seul coup la dernière espérance de Philippe
et la première d’Antiochus.
Les commissaires adjoints par le Sénat à Flamininus
voulaient que des garnisons romaines remplaçassent celles du roi à Corinthe,
à Chalcis et à Démétriade : c’eût été trop tôt jeter le masque. Les Grecs eussent
vite compris que, avec les entraves de la Grèce remises
aux mains de Rome, toute liberté serait illusoire. L’opinion publique, si
mobile en un tel pays, était à craindre. Déjà les Étoliens, les plus
audacieux de tous, l’agitaient par des discours et des chansons. Ils
prétendaient que leur cavalerie avait gagné la bataille de Cynocéphales,
accusaient les Romains de méconnaître leurs services et raillaient les Grecs,
qui se croyaient libres parce qu’on leur avait mis au cou les fers qu’ils
portaient aux pieds. Flamininus vit bien que le meilleur moyen de faire tomber
ces accusations et de vaincre d’avance Antiochus, qui menaçait de passer en
Europe, c’était d’employer contre lui l’arme qui avait si bien réussi contre
Philippe, la liberté des Grecs.

III. Proclamation de la liberté de la Grèce
Durant la célébration des jeux isthmiques, auxquels la Grèce entière était
accourue, un héraut imposa tout à coup le silence et promulgua le décret
suivant : Le sénat romain et T. Quinctius,
vainqueur du roi Philippe, rendent leurs franchises, leurs lois et l’immunité
de garnisons et d’impôts aux Corinthiens, aux Phocidiens, aux Locriens, à l’île
d’Eubée et aux peuples de Thessalie. Tous les Grecs d’Europe et d’Asie sont
libres. Une joie immense éclata à ces paroles. Deux fois l’assemblée
fit répéter le décret, et Flamininus faillit périr étouffé sous les fleurs et
les couronnes[9].
Il y avait donc, s’écriaient-ils, une nation sur la terre qui combattait, à ses risques’ et
périls, pour la liberté des peuples, qui passait les mers pour faire
disparaître toute domination tyrannique, pour établir en tous lieux l’empire
du droit, de la justice et des lois ! Au libérateur de la Grèce on éleva, comme à un
demi-dieu, des temples, que Plutarque trouva encore debout trois siècles plus
tard et qui avaient leurs prêtres, leurs sacrifices et leurs chants. Chantez, jeunes filles, le grand Jupiter, et Rome, et
Titus notre sauveur.
Ainsi ce peuple, qui ne savait plus faire de grandes
choses pour la liberté, savait encore l’aimer avec passion et en payait d’une
apothéose la trompeuse image. Quand Flamininus s’embarqua, les Achéens lui
amenèrent douze cents prisonniers romains des guerres d’ Annibal, qui avaient
été vendus en Grèce et qu’ils venaient de racheter de leurs deniers. Des
Grecs seuls savaient remercier ainsi.
Rome ne prenait rien des dépouilles de la Macédoine. La
Locride et la Phocide
retournaient à la ligue étolienne ; Corinthe à la ligue achéenne. Au roi d’Illyrie,
Pleurate, étaient donnés Lychnidus et le pays des Parthéniens, limitrophe de la Macédoine et pouvant
par conséquent y conduire; au chef des Athamanes, Amynander, toutes les
places qu’il avait prises durant la guerre ; au Pergaméen Eumène, fils d’Attale,
l’île d’Égine ; à Athènes, Paros, Délos et Imbros ; à Rhodes, les
villes de Carie[10] ;
Thasos était déclarée libre. Si les légions restaient dans la Grèce, c’est qu’Antiochus
approchait, et que les Romains voulaient, disaient-ils, la défendre après l’avoir
délivrée.
Flamininus avait d’autres vues encore. Malgré le don de
Corinthe, les Achéens étaient incapables de résister à Nabis, maître de
Gythion. de Sparte et d’Argos. Ce Nabis était un abominable tyran, dont la
cruauté est fameuse[11]. Rome ne l’en
avait pas moins reçu dans son alliance; elle l’en chassa lorsqu’elle crut n’avoir
plus besoin de lui. Dans une assemblée réunie à Corinthe, le proconsul
représenta aux alliés l’antiquité et l’illustration d’Argos : Devait-on laisser une des capitales de la Grèce aux mains d’un
tyran ? Du reste, qu’elle fût libre ou asservie, il importait peu aux
Romains. Leur gloire d’avoir affranchi la Grèce en serait moins pure sans doute ;
mais, si les alliés ne redoutaient pas pour eux-mêmes la contagion de la
servitude, les Romains n’auront rien à dire, et ils se rangeront à l’avis de
la majorité. Les Achéens applaudirent à ces hypocrites conseils et
armèrent jusqu’à onze mille hommes. Il en vint bien d’autres : l’armée
coalisée monta, dit Tite Live, à cinquante mille hommes. Ce zèle alarma
Flamininus ; il voulait bien abaisser Nabis, non le détruire. Ses
lenteurs calculées, ses demandes d’argent et de vivres, fatiguèrent les
alliés; ils le laissèrent traiter avec le tyran, qui livra l ‘Argolide, Gythion
et ses villes maritimes (195).
Ainsi Nabis restait dans le Péloponnèse contre les
Achéens, comme Philippe dans le Nord contre la ligue étolienne. Rome pouvait rappeler
maintenant ses légions ; car, avec ce mot trompeur, la liberté des
peuples, elle avait rendu l’union encore plus impossible et les haines plus
violentes. Dans chaque ville elle avait d’ailleurs ses partisans[12], comme à Thèbes,
où ils venaient d’assassiner le béotarque Brachyllas; et ces hommes, dans
leur aveuglement, poussaient la
Grèce au-devant de la servitude. Il n’était donc plus
nécessaire de la tenir dans les entraves : Flamininus évacua sans crainte
Chalcis, Dénlétriade et l’Acrocorinthe.
Avant de quitter l’Hellade, il offrit une couronne d’or au
dieu de Delphes et il consacra dans son temple des boucliers d’argent, sur
lesquels il avait fait graver des vers grecs qui célébraient, non pas la
victoire de Cynoscéphales, mais la liberté rendue aux nations helléniques. C’était
le mot d’ordre : les Romains voulaient paraître des libérateurs, et les Grecs
se prêtaient à cette illusion. En réalité, lorsque Flamininus retourna
triompher à Rome, il y porta cet utile protectorat de la Grèce que tous les
successeurs d’Alexandre s’étaient disputé, sans le pouvoir saisir[13] (194).

IV. Intervalle entre la seconde et la troisième guerre de Macédoine (195-172)
Nous arrivons enfin au dernier acte de cette histoire.
Tout à l’heure nous avons laissé la
Grèce rêvant qu’elle était revenue à la liberté, à la
jeunesse. Elle s’était en effet ranimée un moment dans une folle joie.
Mourante, elle avait fêté la vie et cru à l’avenir. D’ailleurs, nous l’avons
dit, il y avait encore de la force en Étolie, même dans la ligue achéenne, et
la Macédoine
n’avait pas été entamée. Mais maintenant nous ouvrons le tombeau on vont
descendre ces dernières espérances. Rome, la cité du glaive, va dépouiller le
masque de fausse douceur qu’elle avait pris avec Flamininus, ce Romain d’Athènes,
et paraîtra dans toute sa rudesse sous les traits du farouche et ignorant
Mummius.
Nous avons à raconter trois péripéties, les trois chutes
successives de l’Étolie, de la
Macédoine et de la ligue achéenne. La première disparaîtra
d’abord ; les deux autres tomberont à peu prés ensemble et presque du même
coup. Quand Flamininus eut retiré ses légions, les Étoliens laissèrent
éclater leur mécontentement. On avait proclamé la liberté de toute ville : ce
n’était pas leur compte. Ils avaient cru hériter de la Macédoine, et on ne
leur donnait ni la Thessalie
qu’ils convoitaient, ni l’Acarnanie, ni Leucade, ni toutes les cités que le traité
d’alliance leur avait promises, mais deux pauvres pays, la Locride et la Phocide. C’était bien
peu pour tant de services. Ils le disaient du moins, se vantant d’avoir
ouvert la Grèce
aux Romains et guidé partout leurs pas. A les en croire, ils avaient seuls
vaincu à Cynocéphales ; seuls ils avaient sauvé l’honneur et la vie de
Flamininus. Tandis que nous combattions,
disait l’un d’eux avec dédain, et que nous lui
faisions un rempart de nos corps, je l’ai vu tout le jour occupé d’auspices,
de vœux et de victimes, comme un sacrificateur.
Froissés dans leurs intérêts, humiliés dans leur orgueil par la hauteur de
Flamininus, qui n’avait pour eux que de dures paroles, ils en vinrent à la
pensée de punir tant d’ingratitude et d’amener en Grèce un allié qui perdrait
moins vite la mémoire.
Thoas, le personnage le plus influent parmi eux, fut envoyé
auprès du roi de Syrie, Antiochus III, dont la haine contre les Romains,
avivée par Annibal, était bien connue, et l’engagea à placer en Grèce le
théâtre de la guerre. Les Étoliens, disait le député, lui en donneraient tous
les peuples pour alliés. Il revint avec un envoyé d’Antiochus, qui,
magnifiquement, étala les plus éclatantes promesses : les forces de l’Asie,
les éléphants de l’Inde, et assez d’or pour acheter Rome même. Flamininus fit
d’abord avertir les Étoliens par des gens d’Athènes, qui engagèrent le
Panétolicon à persister dans sa première alliance. Le conseil ne plut pas;
Flamininus vint lui-même et ne réussit pas mieux; Thoas et sa faction firent
décréter, en présence même du général romain, la guerre contre Rome. Et comme
il demandait une copie de ce décret : Bientôt,
lui dit le stratège Damocritos avec une folle insolence, bientôt je vous rendrai réponse de mon camp des bords du
Tibre.
Les Étoliens ne s’en tinrent pas à des discours. Ils
commencèrent les hostilités avec leur vivacité habituelle, et firent en un
même jour, sans déclaration de guerre, une triple attaque sur Chalcis,
Démétriade et Sparte. Ils échouèrent devant Chalcis, mais prirent Démétriade.
Appelés dans Sparte par Nabis, ils s’y présentèrent comme des alliés, puis
égorgèrent le tyran, envahirent son palais, prirent ses trésors et pillèrent
la ville. Les Lacédémoniens indignés s’armèrent contre ces bandits, tuèrent
les uns, chassèrent les autres. Philopœmen saisit habilement cette
conjoncture ; il courut à Sparte avec une armée et la fit entrer dans la
ligue. Les Lacédémoniens, en reconnaissance, lui
envoyèrent 120 talents qu’avait produits la vente des biens de Nabis. Il leur
conseilla de garder leur argent pour acheter le silence des gens qui, par
leurs discours clans le conseil, jetaient le trouble et la confusion dans la
ville.
Restait Antiochus, l’espoir des Étoliens; il arriva. Mais
ce fut le moment pour les uns et les autres de reconnaître leurs mutuelles fanfaronnades
et leur commune faiblesse. Tous ces alliés promis par les Étoliens à
Antiochus se réduisirent aux Magnètes , aux Athamanes, à quelques habitants de
l’Élide et de la
Béotie. Pour lui, au lieu de millions d’hommes, il en
amenait dix mille qu’il ne put solder qu’en empruntant à gros intérêts, et qu’il
demanda aux Étoliens de nourrir. En s’unissant étroitement avec le roi de
Macédoine, suivant le conseil d’Annibal, il pouvait propager en Grèce un
incendie difficile à éteindre : loin de là, il blessa Philippe par des actes
insultants et des propositions insensées. Il parla des droits qu’il tenait de
Séleucus, et soutint les ridicules prétentions au trône de Macédoine du fils
d’Amynander. Dans sa fuite précipitée, Philippe n’avait pu rendre les
derniers honneurs à ses soldats tombés à Cynocéphales. Antiochus recueillit
leurs ossements dans un tombeau qu’il fit élever par son armée. Cette pieuse
sollicitude était pour le Macédonien un amer reproche ; il répondit à toutes
ces provocations en envoyant demander à Rome qu’on lui permit de combattre[14]. Le roi de Syrie
essaya cependant de faire déclarer les Achéens pour lui; et dans un
panachaïcon tenu à Corinthe, son ambassadeur, avec l’emphase asiatique, fit
la nombreuse énumération des peuples qui, de la mer Égée à l’Indus, s’armaient
pour sa cause. Tout cela, répondit
Flamininus, ressemble au festin de mon hôte de
Chalcis. Au coeur de l’été, sa table était couverte des mets les plus variés,
des gibiers de toute espèce ; ce n’étaient que les mêmes viandes
déguisées par un art habile. Regardez bien, et, sous ces noms menaçants de
Mèdes, de Cadusiens, etc., vous ne trouverez toujours que des Syriens.
L’activité de Flamininus fit échouer une conspiration à Athènes ; mais
Chalcis, qu’il n’eut pas le temps de secourir, ouvrit ses portes, et l’Eubée
tout entière fit défection. La
Béotie, agitée par quelques hommes perdus de dettes, l’Élide
et les Athamanes, toujours fidèles aux Étoliens, suivirent cet exemple.
Cependant Annibal continuait au roi les mêmes conseils. Ce ne sont pas, disait-il, tous
ces peuples sans force qu’il faut gagner, mais Philippe de Macédoine ; s’il
refuse, écrasez-le entre votre armée et celle que Séleucus commande à
Lysimachie. Appelez enfin d’Asie vos troupes et vos vaisseaux; que la moitié
de votre flotte stationne devant Corcyre, l’autre dans la mer Tyrrhénienne et
marchez sur l’Italie[15]. Mais, dans ce
vaste plan, les Étoliens et leurs petits intérêts disparaissaient ; ils
firent perdre la campagne à reprendre l’une après l’autre les villes de
Thessalie, et, durant l’hiver, Antiochus, malgré ses quarante-huit ans,
oublia, dans les plaisirs d’un nouvel hymen, qu’il jouait contre Ies Romains
sa couronne. Le Sénat eut le temps d’achever ses préparatifs.
Au printemps de l’année 191, le consul Acilius Glabrion
passa l’Adriatique et pénétra par l’Épire et la Thessalie jusqu’au
mont Œta, dont l’extrémité forme le défilé des Thermopyles. Antiochus, qui
venait d’échouer en Acarnanie contre le plus faible des peuples grecs, espéra
défendre le passage avec ses dix mille hommes. Caton, lieutenant consulaire,
surprit deux mille Étoliens postés sur le Callidrome pour défendre le sentier
d’Éphialte ; à la vue des cohortes romaines descendant de l’Œta, le roi,
qui avait arrêté Acilius devant ses lignes, dans le défilé, s’enfuit à
Élatée, puis à Chalcis, et de là à Éphèse. La bataille des Thermopyles coûta
au consul cent cinquante hommes (juillet 491). Qu’Athènes nous vante
maintenant sa gloire, s’écriaient les Romains : dans Antiochus nous avons
vaincu Xerxès.
Pour stimuler le zèle de Philippe, le Sénat lui avait
abandonné d’avance toutes les places dont il pourrait s’emparer. Tandis qu’Acilius,
tournant ses forces contre les Étoliens, s’obstinait aux sièges d’Héraclée et
de Naupacte, Philippe faisait de rapides progrès. Déjà il avait conquis
quatre provinces : l’Apérantie et le pays des Dolopes, des Perrhœbes et des
Athamanes ; mais Flamininus veillait sur lui. Il accourt à Naupacte,
montre au consul le danger, et le décide à accorder aux Étoliens une trêve
qui désarme le roi de Macédoine. Quelque temps auparavant, il avait aussi
arrêté une expédition des Achéens contre Messène ; et, en laissant
entrer cette ville dans la ligue, il avait statué qu’elle pourrait recourir,
pour tous ses différends, au Sénat ou au tribunal de l’habile homme qui
restait son principal agent en Grèce : tribunal partial ouvert à toutes les
plaintes contre les Achéens. Déjà Flamininus ne ménageait plus ce peuple. Ils
avaient enlevé l’île de Céphallénie aux Athamanes. Comme
la tortue retirée sous son écaille, vous serez invulnérables, leur
dit-il, tant que vous ne sortirez pas du Péloponnèse
; et il leur reprit Céphallénie[16].
A Éphèse, Antiochus avait retrouvé sa sécurité; L. Scipion
alla l’y chercher, et, par la victoire de Magnésie, le rejeta au delà du Taurus
(190). L’an d’après,
Manlius Vulso brisa, par ses victoires sur les Galates, la dernière
résistance de l’Asie Mineure ; cette contrée appartint alors à Rome,
sous la servile royauté d’Eumène de Pergame.
On avait accordé une trêve aux Étoliens. Après qu’on se
fut débarrassé d’Antiochus, on reprit contre eux la guerre avec activité.
Vaincus, ils envoyèrent au consul des députés pour demander la paix : ils
consentaient à s’en remettre à la foi romaine. C’étaient les termes qu’exigeait
le sénat. Mais quand le consul Manius Acilius leur eut expliqué que cela
voulait dire : livrer à Rome ceux qui avaient fomenté la guerre, ils se
récrièrent et déclarèrent que c’était contraire à la coutume des Grecs. Ici Manius, haussant le ton, moins par colère que pour
faire sentir aux députés à quoi les Étoliens étaient réduits et leur inspirer
une extrême terreur : Il vous sied bien, vraiment, petits Grecs, de m’alléguer
vos usages, et de m’avertir de ce qu’il a me convient de faire, après vous
être abandonnés à ma foi. Savez-vous qu’il dépend de moi de vous charger de
chaînes ? — Et sur-le-champ il en fit apporter, ainsi qu’un collier
de fer qu’il ordonna qu’on leur mit au cou. Phénéas et les autres députés
furent si effrayés que leurs genoux ployaient sous eux. Quelques tribuns qui
étaient présents prièrent Manius d’avoir des égards pour le caractère d’ambassadeur
dont ces Grecs étaient revêtus, et de ne pas les traiter avec rigueur. Le
consul se radoucit et laissa parler Phénéas... (Polybe)
Les Étoliens se débattaient en vain : il fallut en passer
par les conditions que le Sénat imposait. Ils durent reconnaître la
suprématie de Rome, avoir mêmes amis et mêmes ennemis, livrer leurs armes et
leurs chevaux, payer une contribution de 1000 talents, enfin remettre aux
Romains, comme garantie, quarante otages désignés par le Sénat.
Encore un nom rayé de l’histoire.
Ce rude coup frappé près d’eux, et sur les premiers amis
de Rome, était un avertissement pour les Achéens, désormais à découvert de
tous côtés. Leur rôle devenait difficile. Différents systèmes de conduite
étaient soutenus dans leur assemblée. Il n’est pas
possible, leur disait Aristène, que vous
restiez les amis des Romains, en leur présentant à la fois le caducée et la
lance. Si nous sommes assez forts, marchons contre eux, sinon obéissons. Il y
a deux buts à toute politique : le beau et l’utile. Ne peut-on atteindre l’un,
qu’au moins on saisisse l’autre. Ou bien montrons que nous sommes assez forts
pour ne pas obéir ; ou, si nous obéissons, que ce soit de bonne grâce et avec
empressement. Philopœmen se refusait à mettre cette bonne grâce dans
la servitude. Il ne se faisait pas illusion au point de croire sérieusement à
la durée de la ligue ni à son indépendance : Quand
les Romains, dit Polybe, exigeaient une chose
conforme aux lois et aux traités, sur-le-champ et sans chicane il l’exécutait.
Mais quand leurs prétentions passaient ces bornes, il voulait que d’abord on
leur fit connaître. les raisons qu’on avait de ne pas s’y rendre, ensuite qu’on
en vint aux prières et qu’on les suppliât de se renfermer dans les traités; s’ils
demeuraient inflexibles, qu’on prît les dieux à témoin de l’infraction et que
l’on obéît... Devons-nous nous unir de toutes nos forces à des maîtres,
disait-il encore, et subir sans opposition les ordres les plus durs, ou bien
nous roidir tant que nous pourrons et retarder notre esclavage ? ... Il
viendra, je le sais, un temps pour les Grecs où il faudra obéir, mais ce temps,
faut-il en accélérer la venue ou la retarder ? ... Es-tu donc, disait-il
encore un jour à Aristène, es-tu donc si pressé de voir le dernier jour de la Grèce ? Ces
deux politiques, ajoute Polybe, étaient sages et sûres. Mais, à côté de ces
deux partis, qu’une nuance seulement séparait, il y en avait un troisième que
bientôt nous entendrons s’exprimer par la bouche de Callicratès, un de ces
lâches prêts à subir toutes les hontes en échange des faveurs de Rome.
Se renfermer dans le Péloponnèse pour y vivre aussi libres
que possible et éviter d’y introduire les Romains, tel était le but de Philopœmen.
Pendant la guerre d’Antiochus, il arriva que Sparte, toujours mal disposée
pour la ligue, essaya de s’en détacher. Le préteur achéen Diophanès marcha
contre elle et appela à son secours Flamininus. Malheureux !
lui dit Philopœmen, garde-toi donc d’appeler les
Romains parmi nous ! Et comme Diophanès ne tenait pas compte de
ses remontrances, il s’enferma dans Sparte et la défendit, même contre les
Achéens. Une autre fois, le Sénat pria les Achéens de faire rentrer les
bannis dans Sparte. Philopœmen s’y opposa, non qu’il fût contraire à la cause
de ces exilés, mais afin qu’ils n’eussent pas cette obligation à Rome.
Lorsque Lacédémone, qui, de ses anciennes institutions,
gardait, même dans sa décadence, un vif sentiment de nationalité, demanda au
Sénat de la délivrer du joug de l’alliance achéenne, Philopœmen sévit contre
elle avec une rigueur qui indigne Plutarque. Pour la première fois il impute
à son héros injustice et cruauté : Philopœmen avait mis à mort quatre-vingts
Spartiates, ou même trois cent cinquante selon un autre historien; il avait
abattu les murailles de la ville, détruit ses institutions, donné une portion
de son territoire aux Mégalopolitains, transporté en Achaïe une partie des
citoyens et vendu trois mille autres à l’encan. Il avait voulu assouplir
cette ville réfractaire, étouffer cette voix qui s’élevait dans le
Péloponnèse contre la ligue et appelait les Romains.
Si la hauteur des sentiments de Philopœmen pouvait être
douteuse on serait tenté de voir dans cette conduite un effet de la haine du
Mégalopolitain contre Sparte. On attribuerait à un motif semblable une
modification fort grave qu’il apporta à la constitution de la ligue : je veux
parler de la loi par laquelle l’assemblée, au lieu de se tenir exclusivement
à Égion, serait convoquée à tour de rôle et successivement dans toutes les
villes de la confédération. Philopœmen voulait par cette mesure donner
satisfaction à ces cités, dont quelques-unes, comme Sparte, n’étaient pas encore
faites à l’idée de reconnaître pour leur capitale et leur centre une petite
ville perdue au bout du Péloponnèse, sans gloire dans le passé. Cette mesure
était excellente, et peut-être, si Aratus l’avait prise, l’unité du
Péloponnèse eût-elle été réalisée.
Il est certain que la ligue, grâce à Philopœmen, reprit assez
de puissance et d’éclat pour qu’il lui arrivât des ambassades des rois d’Orient
: de Séleucus Philopator, d’Eumène, de Ptolémée Épiphane. On accepta l’alliance
de ces rois; mais point leurs dons. Eumène, perfide allié, avait envoyé 420
talents pour être placés à intérêts et produire une rente annuelle qui
défrayerait les dépenses des membres du conseil achéen. Apollonidas de
Sicyone rappela que la loi défendait aux Achéens de recevoir les présents des
rois.
Rome avait vu de mauvais œil l’énergie déployée par Philopœmen,
et des Lacédémoniens étaient venus se plaindre de la révolution violemment
opérée chez eux ; le Sénat envoya des ambassadeurs pour décider lui-même
ces questions. Appius Claudius se présenta dans l’assemblée générale des
Achéens, accompagné des dénonciateurs spartiates que cette assemblée venait
de condamner à mort. Lycortas, le père de Polybe, alors stratège, rappela la
liberté proclamée aux jeux isthmiques par Flamininus et osa dire, aux
applaudissements de tous les députés, que si Rome en Italie frappait de la
hache les sénateurs campaniens, la ligue achéenne pouvait, dans le
Péloponnèse, revendiquer un droit semblable contre les traîtres. A quoi
Appius répondit qu’il conseillait fortement aux Achéens de se rendre le Sénat
favorable, tandis qu’ils étaient encore maîtres de leurs actions, s’ils ne
voulaient pas être bientôt réduits à agir malgré eux.
A Messène, Philopœmen avait protégé le parti démocratique,
favorable à la ligue. Dès que l’oligarchie connut le bon accueil fait par le
Sénat aux dénonciateurs spartiates, elle s’empressa d’envoyer son chef
Dinocratès à Rome. Il revint accompagné de Flamininus, qui allait demander à
Prusias la tête d’Annibal. Le Romain s’arrêta à Messène tout juste le temps
nécessaire pour y produire une révolution. La ville rompit avec la ligue et
envoya des troupes s’emparer de Coronis. Philopœmen, âgé de soixante-dix ans,
et stratège pour la huitième fois, était alors malade de la fièvre à
Argos ; à cette nouvelle, il part pour Mégalopolis et arrive le même
jour, ayant fait vingt lieues d’une traite. Il rassemble un corps de
cavalerie, marche à l’ennemi, le repousse, mais entouré par des forces
supérieures, il est obligé de reculer et couvre lui-même la retraite des
siens. Au passage d’un défilé, ceux-ci se retirant trop vite, il est abandonné
au milieu des ennemis ; son cheval trébuche et le jette violemment à
terre, où il reste privé de connaissance ; les Messéniens le saisissent,
et quand il est revenu à lui, l’accablent d’indignes outrages. On l’emmène à
Messène chargé de fers comme un criminel, et on le jette dans une prison
souterraine, sans air et sans lumière. Bien des Messéniens s’intéressaient à
lui. On ne doit pas oublier, disait-ils, qu’il nous a rendu la liberté en chassant le tyran Nabis.
Mais quelques-uns, pour plaire à Dinocratès, voulait qu’il fût mis à la
torture. Cela eût pris du temps, et Dinocratès, redoutant un retour des
Achéens, était pressé d’en finir. Aussi dès que, la nuit venue, les
Messéniens se furent retirés, il fit ouvrir la prison et commanda à l’exécuteur
d’y descendre pour porter du poison à Philopœmen. Le captif était couché sur
son manteau. En voyant la lumière et cet homme, debout devant lui, une coupe
à la main, il se releva avec peine à cause de sa faiblesse, et prit le poison
en demandant à l’exécuteur s’il ne savait rien de ses cavaliers, surtout de
Lycortas. L’homme lui répondit que la plupart s’étaient sauvés. Philopœmen le
remercia d’un signe de tête et, le regardant avec douceur : Quelle satisfaction pour moi, dit-il, d’apprendre que notre malheur à des bornes ! (Plutarque)
La nouvelle de sa mort répandit la consternation, parmi les
Achéens, mais aussi le désir de la vengeance. L’assemblée, réunie à
Mégalopolis, élut Lycortas pour stratège et l’on courut à Messène, en mettant
toute la campagne à feu et à sang. La ville effrayée ouvrit ses portes ;
Dinocratès, sans attendre l’ennemi, se tua lui-même ; beaucoup de ses
partisans l’imitèrent; ceux qui avaient demandé des tortures pour le glorieux
captif furent condamnés à les subir : Lycortas fit pendre les uns et expirer
les autres sous les verges. On brûla le corps de Philopœmen
; et, après avoir recueilli ses cendres dans une urne, l’armée partit de
Messène, sans confusion, en mêlant à ce convoi funèbre une sorte de pompe
militaire et triomphale. Les Achéens marchaient couronnés de fleurs, mais
fondant en larmes ; ils étaient suivis des prisonniers messéniens
chargés de chaînes. Polybe, fils de Lycortas, entouré des plus considérables
d’entre les Achéens, portait l’urne, qui était couverte de tant de
bandelettes et de couronnes, qu’on pouvait à peine l’apercevoir. La marche
était fermée par les cavaliers revêtus de leurs armes et montés sur des
chevaux richement enharnachés. Ils ne donnaient ni des marques de tristesse
qui répondissent à un si grand deuil, ni des signes de joie proportionnés à
une si belle victoire.
Les habitants des villes et des
bourgs qui se trouvaient sur leur passage sortirent au-devant des restes du
grand homme, avec le même empressement qu’ils avaient coutume de lui montrer
quand il revenait de ses expéditions, et après avoir touché son urne, ils
accompagnèrent le convoi jusqu’à Mégalopolis. Beaucoup de vieillards, de
femmes et d’enfants, mêlés dans la foule, jetaient des cris perçants qui, de
l’armée, retentissaient dans la ville. Les habitants répondaient à ces cris
par des gémissements; car ils sentaient bien qu’avec ce grand citoyen ils
avaient perdu leur prééminence parmi les Achéens. (Plutarque)
Petite affaire que cette mesquine prééminence ! La
véritable perte fut celle que fit la
Grèce du dernier soutien de sa dignité. Comme on dit que les mères aiment mieux le fils qu’elles
ont porté dans l’âge mûr, la
Grèce avant enfanté Philopœmen dans sa vieillesse, après
tous les grands hommes qu’elle avait déjà produits, l’aima d’un singulier
amour et l’appela le dernier de ses enfants.
Après lui, les hommes qui mettaient dans Rome l’espérance
de leur fortune levèrent la tête, et la trahison parla à haute voix.
Callicratès, envoyé à Rome, dit en plein sénat : Pères
conscrits, c’est à vous-mêmes qu’il faut vous en prendre, si les Grecs ne
sont pas plus dociles à vos ordres. Il y a dans toutes les républiques deux
partis : l’un qui conseille d’oublier les lois, les traités, et toutes les
autres considérations, lorsqu’il s’agit de vous plaire; l’autre qui prétend
que l’on doit s’en tenir aux lois et aux traités. L’avis de ces derniers est
beaucoup plus agréable au peuple et vos partisans sont méprisés et sans
honneur. Mais si le Sénat romain donnait quelque signe de désir sur ce point,
aussitôt les chefs embrasseraient son parti, et la crainte ferait marcher le
reste. Le Sénat répondit qu’il serait à
souhaiter que dans chaque ville les magistrats ressemblassent à Callicratès.
Cet homme, revenu dans sa patrie, avec des lettres du Sénat, fut élu stratège
(179). Rome
pouvait donc, sans crainte, laisser la ligue vivre quelques jours encore de
cette vie misérable, tandis qu’elle allait porter le coup décisif à la
puissance renaissante de la
Macédoine.
|