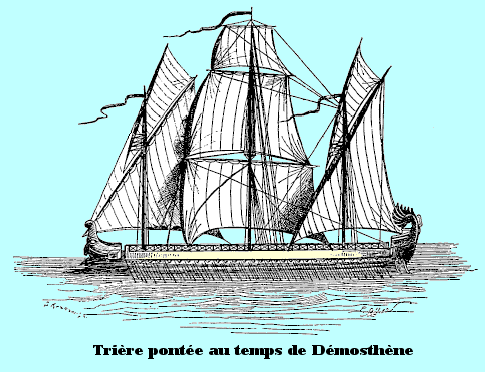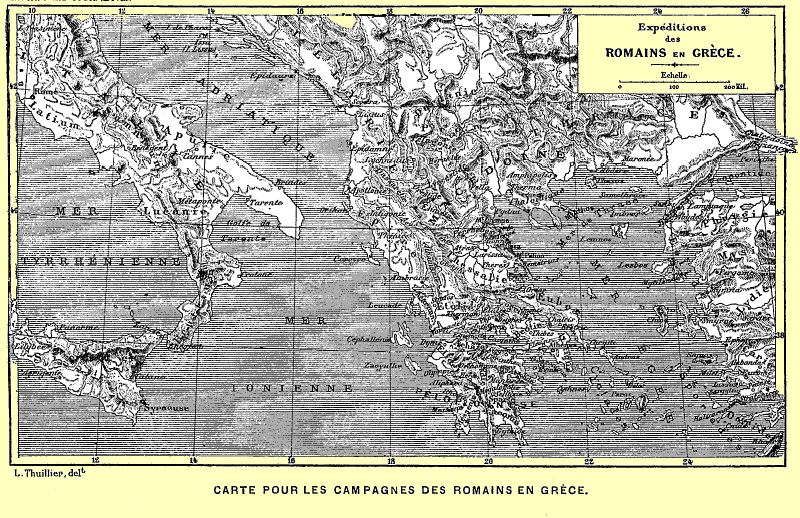|
I. Faiblesse générale
On sait quels éléments de force politique et morale la Grèce possédait encore,
avant que la Macédoine
eût étendu sur elle sa froide et lourde main, mais aussi que de causes de
faiblesse renfermaient ces villes plus ennemies d’elles-mêmes que de l’étranger.
Voyons ce qu’elle était devenue après cent trente années de cette domination,
combattue ou subie, au moment où de nouveaux conquérants s’approchent.
On sait déjà qu’elle s’épuisait en luttes intestines,
comme si elle tenait absolument à n’avoir plus de sang dans les veines quand
viendront ces robustes ennemis. Mais il faut regarder de plus prés pour bien
s’assurer que cette fois la
Grèce ne pouvait plus vivre et, chose plus triste à dire,
ne le méritait pas.
Durant les trois quarts de siècle qui suivirent la mort d’Alexandre,
la Grèce
avait été une proie vingt fois prise et reprise, une part du grand butin que
se disputaient les successeurs. Puis un homme était venu, Aratus, qui avait
essayé de rendre ce pays à lui-même en chassant les tyrans, et de l’unir en
une association fraternelle pour le sauver.
Mais les institutions sont des rouages qui ne valent que
par la force qui les met en jeu, et cette force réside dans les moeurs
publiques. Pour la ligue achéenne, on a vu le séduisant tableau tracé par
Polybe de son gouvernement : on a oublié les rivalités intestines et la
faiblesse générale. C’était l’œuvre d’un homme, faible et périssable, comme
tout ce qui en politique n’a pour appui que le génie d’un législateur ou d’un
conquérant. Sans doute, si les Spartiates s’étaient sincèrement ralliés à la
ligue ; si les Étoliens s’en fussent montrés moins ennemis ; si
Démétrius et Philippe, au lieu d’attenter à la liberté des cités grecques,
les avaient rattachées à leur cause; enfin si le corps des nations
helléniques, ayant pour tête la
Macédoine et armant ses mille liras de l’épée de Marathon
et des Thermopyles, s’était tenu prêt à défendre contre toute invasion le sol
sacré, sans doute il eût fallu que Rome envoyât plus de deux légions à Cynocéphales.
Je vois, disait un député de Naupacte devant
les Grecs assemblés[1], je vois s’élever de l’Occident une nuée orageuse ;
hâtons-nous de terminer nos puérils différends avant qu’elle n’éclate sur nos
têtes. Mais l’union et la paix n’étaient pas possibles entre les
tendances pacifiques des Achéens et l’esprit révolutionnaire de Lacédémone;
entre les marchands de Corinthe et les klephtes de l’Étolie; entre toutes ces
républiques et les ambitieux rois de Macédoine. Philopœmen, malgré ses
talents et ses louables efforts pour régénérer son peuple, aurait-il pu
détruire la haine séculaire des Messéniens contre Sparte et de Sparte contre
Argos ? Aurait-il fait oublier aux Éléens leur origine étolienne, aux
Arcadiens leurs querelles héréditaires ! Et puis, il faut le dire
encore, la division était même au sein des cités et d’autant plus profonde,
qu’on ne se disputait pas le pouvoir, mais la fortune. Chaque ville avait son
parti des riches et son parti des pauvres : Ies premiers toujours prêts à s’armer
contre les seconds, et ceux qui n’avaient rien, à se jeter sur ceux qui
possédaient. De là des haines violentes dont le Sénat sut profiter.
Continuellement menacés d’une révolution sociale, les grands tournèrent vers
Rome leurs espérances, et, dès que les légions paraîtront, il y aura en Grèce
un parti romain.
Pour amener ces peuples à une union fraternelle, il aurait
fallu effacer de leur souvenir toute leur histoire, et arrêter la dissolution
des moeurs, la ruine du patriotisme. Il aurait fallu surtout empêcher le
contact avec cet Orient si riche et si corrompu, qui enlevait à la Grèce ce qui lui restait
de poètes et d’artistes, pour les écoles d’Alexandrie et de Pergame; ce qu’elle
avait encore d’hommes de talent et de courage, pour les cours des Ptolémées
et des Séleucides : ceux-ci n’avaient pas un ministre, un général, un
gouverneur de ville ou de province qui ne fût Grec. L’Hellade donnait le
meilleur de son sang, et recevait des vices en échange. Partout en ce pays, dit Polybe, les grandes dignités s’achètent à peu de frais ; confiez
un talent à ceux qui ont le maniement des deniers publics ; prenez dix
cautions, autant de promesses et deux fois plus de témoins, jamais vous ne reverrez
votre argent[2]. Ailleurs il cite
ce Dicéarchos, digne ami de Scopas, qui, envoyé par Philippe pour piller les
Cyclades, malgré la foi jurée, élevait partout où il abordait deux autels : à
l’Impiété et à l’Injustice[3].
Cette soif de l’or avait produit une. dépravation morale
qui supprimait le dévouement pour les intérêts publics. Aussi, quelle torpeur
dans la plupart des villes! Athènes, la vive et intelligente cité qui jadis
prenait l’initiative des plus glorieuses mesures, refuse maintenant d’associer
ses destinées à celles de la Grèce[4] ; et par les
honneurs sacrilèges qu’elle rend à Démétrius, à Attale, à tous ces rois qu’elle
nomme des dieux sauveurs, elle prouve combien elle-même était mûre pour la
servitude. Aratus la délivre de la garnison macédonienne du Pirée et lui rend
Salamine, sans pouvoir la tirer de son apathique indifférence. Il ne lui
manquait plus que d’interdire par décret public à ses citoyens de jamais s’occuper
des affaires générales de la
Grèce, comme les Béotiens, qui, pour n’être pas troublés
dans leurs grossiers plaisirs, faisaient du patriotisme un crime d’État : A Thèbes, dit Polybe, on
laissait ses biens non à ses enfants, mais à ses compagnons de table, à condition
de les dépenser en orgies ; beaucoup avaient ainsi plus de festins à
faire par mois que le mois n’avait de jours. Pendant près de vingt-cinq ans
les tribunaux restèrent fermés[5] ... » On est allé
plus loin que Polybe, et la stupidité béotienne est devenue un proverbe.
Cependant Pindare et Épaminondas, Leuctres et Chéronée sont, pour ce peuple,
des titres d’honneur, et les très gracieuses figurines trouvées dans la
nécropole de Tanagra révèlent un sentiment de l’art qui est digne de la Grèce.
Depuis le premier Philippe, Corinthe ne s’appartenait
plus. Une garnison occupait ses murs, une autre sa citadelle, et Aratus
prenait et vendait l’Acrocorinthe, sans que les citoyens intervinssent même
au marché. Leurs arsenaux étaient vides ; mais les statues, les vases
élégants, les palais de marbre, brillaient partout, et ils mettaient leur gloire
à ce qu’on vantât leur ville comme la plus voluptueuse de la Grèce. Leur temple
de Vénus était si riche qu’il avait à son service plus de mille courtisanes.
Après avoir détruit ou asservi les autres cités de l’Argolide, Argos avait eu
elle-même des tyrans. On a vu les Achéens pénétrer trois fois dans la ville
pour les délivrer. Du haut de leurs maisons, les habitants, spectateurs
indifférents d’une lutte où se jouaient leurs destinées, applaudissaient aux
coups les mieux portés. Ils semblaient, dit
Plutarque, assister aux jeux Néméens.
Sparte n’était qu’une révolution perpétuelle. En quelques
années, quatre fois les éphores avaient été massacrés, et la royauté rendue
absolue, abolie, puis rétablie, achetée et laissée enfin aux mains d’un
tyran, Machanidas, que Philopœmen abattra. Mais Sparte, malgré son abaissement,
est trop fière de sa vieille gloire pour consentir à aller se perdre dans la ligue
achéenne. A Machanidas succédera Nabis, et les Spartiates resteront les
alliés des Étoliens.
Faut-il parler des petits peuples ? Égine a disparu
de la scène politique. Mégare n’est qu’une annexe obscure de la ligue béotienne
ou achéenne. Les Éléens, comme Messène et une partie de l’Arcadie, dépendent
des Étoliens. La faiblesse de la
Phocide atteste encore, après quatre générations, l’effet
terrible des colères sacrées; l’Eubée, la Thessalie, sont sans
force[6] ; la Crète, livrée aux
désordres et à toutes les mauvaises passions : on disait crétiser pour mentir[7].
Même avec des mœurs meilleures et du patriotisme, les
Grecs ne se lussent pas encore sauvés; et la paix, l’union eussent régné du
cap Ténare au mont Orbélos, que Rome n’en eût pas moins, avec un peu plus de
temps et d’efforts, mis la
Grèce à ses pieds.
En s’appuyant de l’autorité de Montesquieu, on s’est
étrangement mépris sur les forces de la Grèce à cette époque; on a pris au sérieux les
craintes de Rome; dans les ménagements politiques du Sénat, on a vu l’aveu et
la preuve de la puissance de la
Grèce et l’on a compté par cent mille le nombre de ses
guerriers. Illusion d’optique produite par les grands noms de la vieille
histoire : de loin, vaisseaux de haut bord ; de près, bâtons flottants.
Athènes ne peut arrêter les courses des pirates de Chalcis ni celles de la
garnison de Corinthe. En l’année 200, quelques bandes d’Acarnaniens mettent
impunément l’Attique à feu et à sang, et deux mille Macédoniens tiennent la
ville assiégée. Quand Philippe ravage la Laconie jusque sous les murs de Sparte,
Lycurgue n’a que deux mille hommes à lui opposer. Philippe lui-même entre en
campagne avec cinq mille sept cents soldats en 219, et avec sept mille deux
cents l’an d’après. Le contingent d’Argos et de Mégalopolis est de cinq cent
cinquante hommes, et toute la confédération achéenne ne peut mettre sur pied
durant la guerre des deux ligues, la plus vive de cette époque, que trois
mille cinq cents hommes de troupes nationales[8]. En 219, trois
cités se séparent de la confédération, pour leur défense il suffit d’une
armée de trois cent cinquante soldats. Les Éléens n’ont jamais plus de
quelques centaines d’hommes sous les armes; au combat du mont Apélauros, ils
étaient deux mille trois cents, les mercenaires compris[9]. Plutarque dira
plus tard : Aujourd’hui la Grèce ne pourrait mettre
sur pied trois mille hoplites[10].
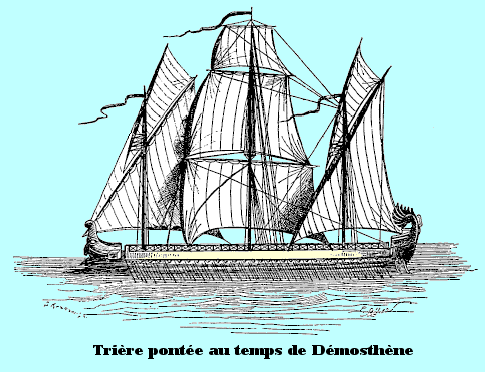
La marine était tombée encore plus bas. Les Athéniens, qui
montaient deux cents vaisseaux à Salamine, ont maintenant pour flotte trois
navires non pontés. Nabis n’en possède pas davantage[11]. La ligué
achéenne, qui comprenait l’Argolide, Corinthe, Sicyone et toutes les villes
maritimes de l’Égialée, ne parvient à armer que six bâtiments, trois pour
garder le golfe de Corinthe, trois pour le golfe Saronique. On peut voir dans
Tite Live la ridicule flotte de Philopœmen, dont le vaisseau amiral était une
quadrirème qui depuis quatre-vingts ans pourrissait dans le port d’Ægion[12]. Les Étoliens n’ont
pas même un navire[13]. Rhodes même,
dont la puissance paraissait si grande comparée à tant de petitesse, ayant un
grave différend avec Byzance, n’envoie que trois galères dans l’Hellespont ;
et cependant les partis ennemis, dans cette guerre, étaient deux républiques
célèbres, trois rois, Attale, Prusias, Achæos, et je ne sais combien de chefs
gaulois et thraces[14]. Depuis la chute
de l’empire d’Athènes la piraterie désolait la mer Égée, et l’on se rappelle
que les corsaires illyriens poussaient impunément leurs ravages jusque dans
les Cyclades.
Cette faiblesse n’était pas accidentelle. Je n’ose dire
que l’esprit militaire était mort dans la Grèce ; mais depuis deux siècles elle s’épuisait
d’hommes, et le meilleur de son sang était versé pour des causes qui lui
étaient étrangères. L’appât des honneurs et des richesses attirait dans les
cours orientales les Grecs les plus braves et les plus habiles, et ce métier
lucratif faisait déserter la patrie. C’est au moment où périssait le roi de
Sparte, Areus, on les derniers restes de la liberté hellénique tombaient sous
les coups d’Antigone, que Xanthippe emmenait au secours de Carthage les plus
braves Lacédémoniens. Plus tard, durant la seconde guerre des Romains contre Philippe,
Scopas vint enrôler au nom de Ptolémée six mille Étoliens, et toute la
jeunesse l’aurait suivi sans l’opposition du stratège Damocrite[15]. Au temps d’Alexandre,
Darius avait déjà cinquante mille mercenaires grecs; nous avons vu qu’ils
faisaient aussi la seule force des Ptolémées et des Séleucides. Il y avait
donc entre l’Orient et la
Grèce un échange également funeste aux deux pays : l’un
prenait les hommes et perdait la confiance et l’appui des forces nationales;
l’autre recevait de l’or et, avec cet or qui ruinait ses mœurs, achetait à son
tour des soldats pour ses querelles particulières. Le condottiérisme, cette
plaie mortelle des États, qui tua Carthage et les républiques italiennes du
moyen âge, s’était étendu sur la
Grèce entière. La Macédoine elle-même soudoyait des étrangers ; à
Sellasie, Antigone en avait cinq à six mille. Dans les armées achéennes, ils
formaient toujours plus de la moitié des troupes. Les rois et les tyrans de
Sparte n’avaient pas d’autres soldats[16].
La richesse arrivée par des voies mauvaises s’en va
habituellement comme elle est venue. L’or asiatique et africain ne restait
pas en Grèce, parce que le travail n’y était plus. Les villes étaient
dépeuplées et misérables. De Mégalopolis on disait : Grande
ville, grand désert[17]. La misère était
partout. Mantinée entière, hommes et choses, n’était pas estimée 300 talents,
et Polybe (II, 62)
n’en donnerait pas six mille de tout le capital imposable du Péloponnèse. L’Attique
était, deux siècles plus tôt, le pays le plus riche de la Grèce. Une récente
estimation de ses biens-fonds et des valeurs mobilières n’en avait porté le
chiffre qu’à 5750 talents, la moitié de ce que Périclès tenait d’or en réserve
dans le trésor des Athéniens, avant la guerre où leur fortune sombra[18]. Et ce même
peuple qui donnait alors 1000 talents pour un seul temple, aujourd’hui
condamné par des arbitres à une amende, n’en pouvait trouver que 500 pour se
libérer.
Ainsi, de petites armées et de petites affaires : peu de
bruit pour rien; tandis que, de l’autre côté de l’Adriatique, retentissaient
les éclats de la grande lutte d’Annibal et de Rome. Véritablement, quand on
regarde à l’Occident le peuple nouveau qui monte sur la scène du monde et qu’en
face de cette société si sévèrement organisée, remplie encore de fortes
vertus, de discipline et de courage, on voit cette Grèce si dégradée qu’elle
n’a plus ni poètes, ni artistes, ni citoyens; si anarchique, qu’on ne peut
saisir un intérêt sérieux dans ses rivalités, ni un plan concerté dans ses
guerres; si dépeuplée, qu’elle s’en va mourir faute d’hommes[19] ; on ne
peut se défendre d’un sentiment de douleur, car on prévoit la fin inévitable
et prochaine d’un peuple autrefois glorieux. Tous les raisonnements, tous les
souvenirs tirés d’un autre temps ne peuvent faire qu’on croie la Grèce forte et capable
encore de dévouement et d’héroïsme. C’était un peuple usé, livré à l’esprit
de trouble et de vertige. Il était temps que Rome s’en saisit avant que la
barbarie n’en reprit possession, avant que tous ses chefs-d’œuvre ne
tombassent sous la hache de Philippe, comme ceux de la Macédoine et du
Péloponnèse sous la main sacrilège des Étoliens[20].
Au moins, sous la domination romaine, trouvera-t-elle le
repos et la paix[21].
Sans doute il y avait encore des Grecs éclairés,
patriotes; et quand la question sera clairement posée entre la Grèce et Rome, entre la
liberté et l’obéissance, nous retrouverons des sentiments et des courages
dignes d’un grand peuple, mais trop tard pour le sauver. Ce n’est plus de la
ligue achéenne que pouvait venir le salut, le moment était passé; ni d’un
système fédératif, où il est trop aisé d un agresseur habile de porter le
trouble et l’anarchie; mais d’une réforme impossible dans les moeurs et les
idées des Grecs, et d’une étroite union avec la Macédoine sous un
grand prince.

II. La Macédoine ;
dispersion des forces de la
Macédoine ; les Romains en Illyrie
Entourée par la mer et par d’impraticables montagnes,
habitée par une race guerrière, affectionnée à ses rois, et toute fière
encore du rôle qu’ils lui avaient fait jouer dans le monde, la Macédoine était
vraiment un puissant État. Comme avec Carthage, il fallut que Rome s’y prît à
trois fois pour l’abattre. Si Philippe n’eût possédé que la Macédoine, sa conduite
sans doute eût été simple, comme ses intérêts. Mais il avait encore la Thessalie et l’Eubée,
Opunte en Locride, Élatée et la plus grande partie de la Phocide, l’Acrocorinthe
et Orchomène d’Arcadie[22]. Il tenait
garnison dans trois des Cyclades, Andros, Paros, Cythnos, dans Thasos et
quelques villes des côtes de Thrace et d’Asie; enfin une partie considérable
de la Carie
lui appartenait[23]
: possessions lointaines et dispersées qui multipliaient les contacts
hostiles. Ses villes de Thrace et Sestos, Abydos, les clefs du passage d’Europe
en Asie, le rendaient dangereux pour Attale de Pergame; ses villes de Carie
et file d’Iasos, pour les Rhodiens; l’Eubée, pour Athènes; la Thessalie et la Phocide, pour les
Étoliens ses possessions du Péloponnèse, pour Lacédémone ; enfin sa
puissance le faisait l’ennemi des Ptolémées d’Égypte.
Avec plus de suite dans ses desseins et un plus sage
emploi de ses forces, il aurait pu dominer sur la Grèce, car il en occupait
tous les postes importants ; il en tenait les entraves, comme disait
Antipater. Mais toujours il fit la guerre moins en roi qu’en chef de bande,
courant dans une même campagne de la 1liacédoine à Céphallénie, de cette île
à Thermos, de l’Étolie à Sparte, n’abattant aucun ennemi et laissant toute
entreprise inachevée. Dans ces guerres, ses forces ne dépassent jamais
quelques milliers d’hommes, et Plutarque parle des difficultés qu’il trouvait
à lever des soldats. Il ne pouvait non plus dégarnir la Macédoine, car, chaque
fois qu’ils le sentaient absent, les Thraces, les Dardaniens et les peuples d’Illyrie
se jetaient sur son royaume.
Dompter ces barbares, écraser lés Étoliens, chasser les
tyrans de Sparte et gagner le reste des Grecs par la douceur, tel était son
rôle. Un Grec avait dit nettement dans une grande assemblée le mot de la
situation : Il faut que Philippe n’ait plus besoin d’entretenir
parmi nous la division pour régner, et qu’il puisse compter sur l’affection
de l’Hellade entière pour veiller sur elle, comme sur son bien[24]. Le roi lui-même
sentait la nécessité de cette politique : Ne vous
alliez pas aux barbares, disait-il, les
Romains sont des étrangers qu’il ne faut pas accoutumer à se mêler de nos
affaires. Ils n’ont ni votre langue, ni vos mœurs, ni vos lois. Nous, au
contraire, Macédoniens Étoliens, Achéens, nous ne sommes qu’un seul peuplé.
Si quelques différends passagers nous divisent, nous n’en devons pas moins
être unis par une haine commune et éternelle contre les barbares[25].
Il pensait juste, mais il agissait mal. S’il ne fit pas
empoisonner Aratus[26], il s’aliéna ses
alliés par des excès ou de la perfidie. Un roi,
osait-il dire, n’est obligé ni par sa parole ni par
la morale. Les yeux les moins exercés voyaient s’approcher la tempête que les Étoliens attiraient de l’Occident.
Philippe aussi la voyait niais semblait si peu en comprendre le péril qu’il
se prépara fort mal à en conjurer les effets. Même après sa première guerre,
quand il avait déjà senti le poids des épées romaines, il se laissa prendre
encore au dépourvu. Lorsque le Sénat lui envoya dénoncer les hostilités, il
était à
batailler en Asie contre Attale et les Rhodiens, pour
quelques places inutiles de la
Thrace et de la Carie. Sa réponse au député Æmilius peint sa
légèreté moqueuse au milieu des plus graves affaires. Il lui pardonnait,
disait-il, la hauteur de ses paroles pour trois raisons : d’abord il était
jeune et sans expérience ; puis il était le plus beau de ceux de son
âge; enfin il portait un nom romain[27].
L’Italie et la
Grèce, ces deux moitiés du monde ancien, avaient commencé
depuis longtemps à mêler leurs intérêts. Alexandre le Molosse, roi d’Épire
avait essayé de faire en Italie ce que son neveu, le fils de Philippe,
accomplissait en Orient. Il fut tué en 326 par un Lucanien, et ses projets
tombèrent avec lui. Les étranges succès des Macédoniens en Asie causèrent
quelque inquiétude dans Rome, si l’on en croit Tite Live qui se demande quel
consul le Sénat aurait opposé à Alexandre. Au temps de Pyrrhus, autre
Épirote, le danger fut plus grand, les Romains s’en tirèrent par la victoire
de Bénévent, et, dans les années suivantes, ils achevèrent la conquête de la Grande-Grèce, ce
qui les plaça entre deux mers dont ils eurent à faire la police. Par la
conquête de la Corse
et de la Sardaigne,
après la première guerre Punique, la mer occidentale devint un lac romain,
et, par les mêmes raisons de garantie à donner au commerce de leurs nouveaux
sujets, ils furent conduits à envoyer, dans la mer orientale, leurs flottes
et leurs légions.
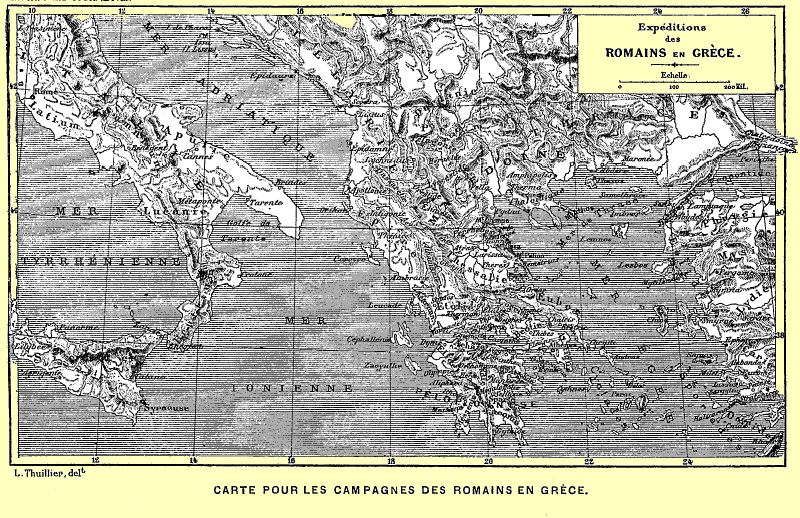
La côte d’Illyrie, couverte d’îles innombrables a été
longtemps habitée par de dangereux bandits qui, selon l’occurrence, faisaient
la course tantôt sur mer, tantôt sur terre. Les Italiens qui naviguaient sur
l’Adriatique, avaient à se plaindre de ces pirates, mais plus encore la Grèce, qui, comme les
corps en dissolution, pouvait être la proie d’ennemis misérables. Les
Illyriens n’avaient pas craint de se mesurer avec les Étoliens et les
Épirotes. Ils avaient pris Phénice, la plus riche ville de l’Épire, pillé l’Élide,
la Messénie
et attiré les Acarnaniens dans leur alliance. Ces succès n’étaient pas pour
inspirer à ces écumeurs de mer plus de réserve à l’égard des négociants d’Adria,
de Brindes et de Tarente, qui jetèrent de si hauts cris que le sénat romain,
déjà peu tolérant, envoya des ambassadeurs à la veuve de leur dernier roi.
Teuta gouvernait au nom de son fils Pinéus une partie de l’Illyrie, elle
répondit avec hauteur que ce n’était pas la coutume des rois d’Illyrie de
défendre à leurs sujets d’aller en course pour leur utilité particulière. A
ces paroles, le plus jeune des députés, un Coruncanius, répartit : Chez nous, reine, la coutume est de ne jamais laisser
impunis les torts soufferts par nos concitoyens, et nous ferons en sorte, s’il
plaît aux dieux, que vous vous portiez de vous-même à réformer les coutumes
des rois illyriens. Teuta, irritée, fit tuer le jeune audacieux, ceux
qui avaient provoqué cette ambassade romaine, et brûler vifs les commandants
des vaisseaux qui l’avaient amenée. Puis les courses recommencèrent avec plus
d’audace : Corcyre fut prise, Épidamne et Apollonie assiégées, une flotte
achéenne battue.
C’était une heureuse occasion pour les Romains de se
montrer aux Grecs. Le sénat vit quel parti il pouvait tirer de ces événements
et il prit hautement le rôle de protecteur de la Grèce, qu’il devait jouer jusqu’au
bout avec tant de succès. Afin de donner une grande idée de sa puissance, il
envoya contre ces misérables ennemis deux cents vaisseaux, vingt mille légionnaires
et les deux consuls (229),
c’est-à-dire bien plus qu’il n’avait fait au début contre Carthage. Corcyre
fut livrée par un traître, Démétrius ; les Illyriens assiégeaient Issa dans l’île
du même nom (Lissa) ; ils en furent chassés, et aucune des places qui
voulurent résister ne put tenir. Teuta, effrayée, accorda tout ce que Rome
lui demanda : un tribut, la cession d’une partie de l’Illyrie, la promesse de
ne pas mettre en mer au delà du Lissus plus de deux navires, et la tête de
ses principaux conseillers pour apaiser par leur sang répandu les mânes
irritées du jeune Coruncanius (228). Les villes grecques soumises par les Illyriens, Corcyre
et Apollonie, furent rétablies dans leur indépendance.
Les consuls se hâtèrent de faire connaître ce traité aux
Grecs, en rappelant que c’était pour leur défense qu’ils avaient passé la
mer. Les députés se montrèrent dans toutes les villes aux applaudissements de
la foule : à Corinthe, ils furent admis aux jeux isthmiques ; à Athènes, on
leur donna le droit de cité, et ils furent initiés aux mystères d’Éleusis.
Ainsi se nouèrent les premières relations de Rome et de la Grèce.
Les Romains avaient donné à Démétrius l’île de Pharos et
quelques districts de l’Illyrie. Ne se croyant pas assez récompensé, il s’unit
aux corsaires et entraîna dans sa révolte le roi Pinéus. Le sénat envoya
encore un consul en Illyrie. Démétrius se réfugia auprès du roi de Macédoine,
qu’il armera bientôt contre les Romains, et Pinéus se soumit aux conditions
du premier traité (219).
Rome posséda alors sur le continent grec de bons ports et une vaste province,
poste avancé, qui couvrit l’Italie et menaça la Macédoine.
|