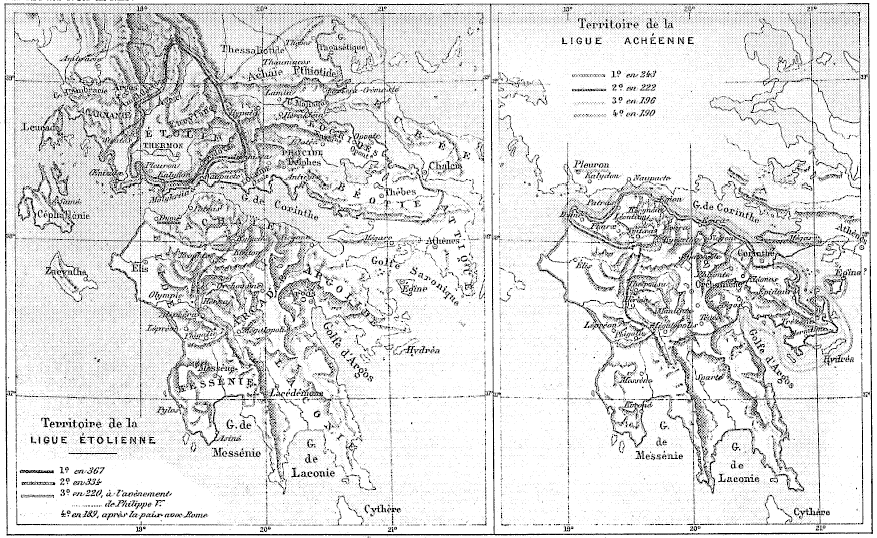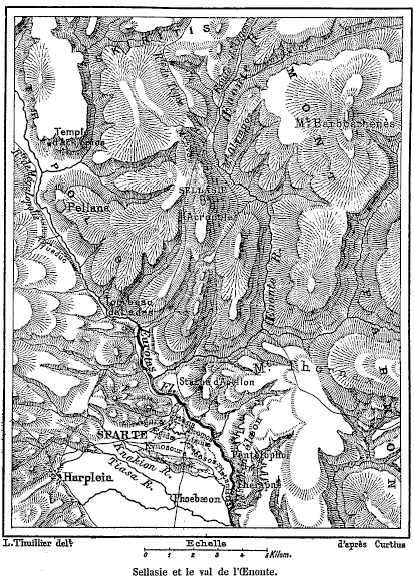HISTOIRE DES GRECS
HUITIÈME PÉRIODE — LA LIGUE ACHÉENNE (272-146) – EFFORTS IMPUISSANTS
POUR S’UNIR ET SE SAUVER.
Chapitre XXXV — Depuis la mort de Pyrrhus jusqu’à l’arrivée des Romains en Grèce (272-214).
I. La ligue Achéenne et la ligue ÉtolienneAthènes, Sparte et Thèbes sont tombées ; deux peuples jusqu’alors inconnus montent, à leur place, sur la scène laissée vide, mais rétrécie et embarrassée de décombres, les Achéens et les Étoliens. La côte septentrionale du Péloponnèse est une bande de
terre étroite, resserrée entre le golfe de Corinthe et la chaîne de montagnes
qui encadre l’Arcadie du nord. Sa fertilité n’a rien de remarquable, excepté
du côté de Sicyone. Ses cours d’eau, fort nombreux, descendent en droite
ligne des montagnes à la côte. Le rivage, mieux découpé qu’à l’ouest du
Péloponnèse, laisse pénétrer la mer au milieu des rochers qui la bordent.
Mais quels débouchés pouvait avoir le commerce de ces villes ? Serait-ce
avec l’Élide ou la pauvre Arcadie ? Quels moyens de communication au
milieu des montagnes? D’ailleurs Corinthe, bien mieux située, attira de bonne
heure à elle tout le commerce de son golfe qui passa devant les villes
achéennes sans y déposer ni la fortune, ni le luxe. Elles vivaient donc
pauvres mais unies. Hérodote nous apprend que dès la plus haute antiquité les
douze cités de l’Égialée formaient une confédération. C’était un pays ionien,
et le mystérieux nombre douze s’y retrouve. Si obscurité signifie bonheur,
ces villes furent longtemps heureuses. Au milieu des sanglantes discordes de On ne peut féliciter l’Achaïe d’être restée étrangère à la
lutte nationale contre les Perses, et elle eût souhaité que Sparte et Athènes
lui laissassent le repos qu’elle aimait. Elle en fut cruellement tirée par la
guerre du Péloponnèse, qui ne souffrit pas de neutres. Patras se déclara pour
Athènes ; Pellène pour Sparte ; l’influence dorienne s’étendit sur
le reste. La confédération était déjà ébranlée. Elle le fut bien davantage
quand vinrent les rois de Macédoine, qui parurent vouloir punir les Achéens
d’avoir combattu contre eux, à Chéronée avec Athènes, à Mantinée, en 330,
avec Sparte. Son affaiblissement. fut tel, qu’elle ne put prendre part à la
guerre Lamiaque. Le nombre de ses villes
était réduit à dix, depuis qu’en 373 un tremblement de terre avait détruit Hélicé, l’ancienne capitale, et qu’Olénos avait été abandonnée par ses
habitants. Démétrius, Cassandre, Antigone Gonatas, mirent garnison dans
quelques-unes, et livrèrent les autres à des tyrans ; car c’est de cet Antigone, dit Polybe, que sont venus tous les tyrans de Vers 280, les Achéens profitèrent des malheurs de Sicyone avait été autrefois gouvernée par l’aristocratie dorienne ; la chute de ce parti amena de longs désordres, du milieu desquels sortirent des tyrans. Sicyone réussit cependant à recouvrer son indépendance à la mort de l’un d’eux, Cléon, et remit alors le pouvoir aux mains de deux citoyens estimés, Timoclès et Clinias. Le premier étant mort, un certain Abantidas s’empara de la tyrannie, mit Clinias à mort et chercha à faire subir le même sort à son fils Aratus, âgé de sept ans. L’enfant, sauvé par la sœur même du tyran, se réfugia à Argos, où les hôtes et les amis de son père le reçurent. Il y passa treize années, goûtant peu les philosophes, mais fort assidu aux exercices du gymnase. Il y excella et fut vainqueur dans les cinq combats du pentathle. Sa taille, son corps, étaient athlétiques : mais l’athlète était aussi un prudent et avisé personnage, se plaisant, en politique comme à la guerre, aux embuscades, aux surprises ; craignant le grand jour, les décisions rapides et les voies droites de la guerre en rase campagne ; brave soldat et médiocre général ; grand citoyen et peut-être mauvais politique.
De bonne heure, Aratus médita l’affranchissement de sa patrie. Toutes ses mesures étaient déjà prises, quand le tyran Nicoclès, qui régnait alors d Sicyone, eut vent du complot et envoya à Argos des espions déguisés. Aratus, informé qu’ils étaient dans la ville, fit enlever ü grand bruit, au marché, des mets délicats, des parfums, et louer des joueuses de flûte pour organiser chez lui une fête et une orgie. Les espions revinrent à Sicyone, riant de la crédulité soupçonneuse du tyran. Ils n’avaient pas encore rendu compte de leur mission qu’Aratus partait d’Argos, et rejoignait des soldats qui l’attendaient à la tour de Polygnote. Il les conduit à Némée, leur découvre son projet, excite leur courage, et les mène droit à Sicyone, réglant sa marche sur celle de la lune, pour n’arriver aux murailles qu’après qu’elle serait couchée. Un Sicyonien échappé des prisons de Nicoclès l’avait instruit que, en un endroit, le mur était peu élevé et sa crête de plain-pied avec l’intérieur de la ville. Mais de ce côté se trouvait la maison d’un jardinier, gardée par des chiens vigilants. Un des siens qu’il envoya pour s’en saisir n’y réussit pas, et cet accident décourageait sa troupe ; mais il promit de renoncer à l’entreprise si les chiens devenaient trop importuns. Ils continuèrent d’avancer, précédés de ceux qui portaient les échelles ; quand ils les appliquèrent aux murailles, les chiens aboyèrent avec force. Un autre danger survint. Les premiers montaient déjà, lorsque l’officier qui devait être relevé le matin passa au-dessus de leur tête, avec une clochette et beaucoup de torches allumées, suivi de soldats qui faisaient un grand bruit : les assaillants se tapirent comme ils étaient sur leurs échelles, et on ne les aperçut pas. La garde du matin, qui venait relever celle de la nuit, passa de même sans les voir. Lorsqu’ils se furent tous éloignés, les conjurés escaladèrent la muraille, et, maîtres des deux côtés du chemin, envoyèrent presser la marche d’Aratus. Il y avait peu de distance de la muraille au jardin et, dans une des tours, un grand chien de chasse faisait le guet : cet animal n’avait pas reconnu l’approche des conjurés; mais les chiens du jardinier l’ayant comme provoqué, en aboyant d’en bas, il répondit par un aboi sourd et prolongé, puis, quand les premiers qui avaient franchi le mur passèrent par devant la tour, un hurlement furieux. La sentinelle demanda au veneur à qui son chien en avait et s’il était survenu quelque chose de nouveau. Le veneur répondit que les torches des gardes et le son de la clochette avaient irrité son chien. Encouragés par cette réponse, les soldats d’Aratus ne doutèrent pas que le veneur ne fût d’intelligence avec leur chef et qu’un grand nombre d’habitants ne favorisât leur entreprise. Quand toute la troupe voulut monter, ils coururent un nouveau danger, les échelles pliaient ; il fallut aller lentement les uns après les autres. Cependant l’heure pressait; déjà les coqs chantaient, et on allait voir arriver les gens de la campagne portant leurs provisions au marché. Dés qu’il y eut une quarantaine de soldats sur le mur, Aratus y monta, attendit encore quelques-uns de ceux qui étaient en bas, puis courut au palais du tyran dont il chargea si brusquement les gardes, au milieu de leur sommeil, qu’il les prit tous. Aussitôt il envoya presser les amis qu’il avait dans la ville de venir le rejoindre, et comme le jour commençait à paraître, le théâtre se remplit d’une multitude considérable qui ne savait encore rien de ce qui s’était passé. Alors un héraut s’avança au milieu de la foule et cria qu’Aratus, fils de Clinias, appelait les citoyens à la liberté. A la nouvelle de l’événement qu’ils attendaient depuis si longtemps, ils coururent au palais du tyran et y mirent le feu. Il n’y eut pas, dans toute l’affaire, un seul homme tué ou blessé, pas même Nicoclès qui s’échappa de son palais en flammes par un souterrain. Aratus rappela ceux qui avaient été bannis par Nicoclès, au nombre de quatre-vingts, et ceux qui l’avaient été par les autres tyrans. On n’en comptait pas moins de cinq cents, qui avaient erré loin de leur patrie pendant près de cinquante années ; ils revinrent la plupart dans une extrême misère, et se remirent en possession de leurs maisons, de leurs terres. et de tous les biens qu’ils avaient possédés avant leur exil... (Plutarque) Ce récit montre un côté de la vie politique de De la part de Ptolémée, ce service était intéressé. L’Égyptien voyait avec dépit l’influence du roi de Macédoine en Grèce ; pour entraver ses progrès et l’y tenir constamment occupé, il soutenait tous ceux qu’il croyait ennemis des Macédoniens. Aratus avait accepté avec empressement l’appui qui s’offrait de lui-même. On n’était pas à une époque où il fût possible à une cité de vivre longtemps isolée et indépendante. Aratus vit qu’Antigone rôdait autour de Sicyone comme autour d’une proie. Ce prince s’était rendu maître d’Athènes, après une guerre ou plutôt un siège de six années, bravement soutenu encore par les Athéniens (263), et il possédait Corinthe, Sicyone lui eût donc convenu. Pour la sauver, Aratus ne vit d’autre ressource que de l’incorporer à la ligue achéenne, faible alors sans doute, mais qui, par cette réunion, devenait respectable. Le territoire de Sicyone semblait la continuation de celui des Achéens, de sorte que rien n’était plus naturel que cette alliance. Elle eut lieu sur le pied d’une égalité parfaite, quoique Sicyone fût de beaucoup plus puissante qu’aucune autre cité de la ligue ; mais en y accédant, en vue d’obtenir des secours, elle avait dû accepter et non faire les conditions. Cette ligue était, après la confédération olynthienne, la secondé tentative sérieusement faite en Grèce pour garantir, par l’union politique, la sécurité de plusieurs peuples. Voici le résumé de la constitution qu’elle se donna, telle du moins que les renseignements insuffisants ou contradictoires fournis par les écrivains anciens permettent de l’établir. La souveraineté résidait dans l’assemblée générale, à laquelle tous les hommes âgés de trente ans étaient admis. Cette assemblée décidait de la paix et de la guerre, ratifiait ou rejetait les alliances, faisait les règlements de la confédération, nommait les magistrats supérieurs et fixait le chiffre de l’impôt avec celui de l’armée fédérale, quand il fallait en lever une. Les suffrages y étaient comptés par ville, non par tète, de sorte que l’assemblée était une véritable assemblée représentative, à laquelle il n’était pas nécessaire que tous les citoyens de chaque cité assistassent, un petit nombre suffisant pour que la voix de leur peuple ne frit pas perdue(1). Mais ce petit nombre qui avait le loisir et les ressources nécessaires pour se déplacer et aller voter au loin, c’étaient les riches, les citoyens aisés. De là le caractère conservateur et modéré de cette démocratie. Le lieu de réunion était, dans le principe, à Hélice ; après la ruine de cette ville, ce fut à Égion, dans un bois consacré à Jupiter, et près du sanctuaire de Cérès Panachéenne. Polybe néanmoins montre l’assemblée tenue aussi à Cleitor, à Sicyone, à Corinthe, à Mégalopolis et l’on attribue à Philopœmen la proposition, qui semble avoir été acceptée, de s’assembler alternativement dans chacune des villes de la confédération. Il y avait deux sessions par an, l’une au printemps, l’autre en automne. Dans les cas graves et urgents, le magistrat suprême pouvait convoquer l’assemblée. Elle ne délibérait jamais que sur les questions proposées par la majorité des magistrats, et ses membres semblent avoir reçu une indemnité, comme les jetons de présence qui étaient touchés à Athènes[1]. Chaque session durait trois jours. Les pouvoirs permanents étaient : un sénat dirigeant, dont on ignore la composition, dont l’existence même a été révoquée en doute; un conseil de dix démiurges, de douze avant la ruine d’Hélice et d’Olénos, ce qui prouve qu’ils étaient, au moins dans l’origine, les représentants des cités, puisque leur nombre variait en même temps que celui des villes, enfin le magistrat suprême, ou stratège, qui d’abord eut un collègue et qui, dépositaire du sceau de la ligue, commandait les forces militaires, convoquait et présidait l’assemblée. Les autres magistrats étaient l’hipparque, l’hypostratège (peut-être une seule magistrature sous deux noms différents), le secrétaire. Quant à l’esprit qui animait cette ligue, Polybe le montre dans le passage suivant : «Dès le temps passé, bien des gens avaient tâché de persuader aux peuples du Péloponnèse de s’unir; mais, comme ils agissaient bien plus en vue de leur intérêt particulier que pour la liberté commune, la division durait toujours. Maintenant, au contraire, la concorde s’est si heureusement établie, qu’entre eux il y a non seulement alliance et amitié, mais mêmes lois, mêmes poids, mêmes mesures, même monnaie, mêmes magistrats, mêmes sénateurs, mêmes juges. En un mot, à cela près que tous les peuples du Péloponnèse ne sont pas renfermés dans les mêmes murailles, tout le reste est parfaitement uniforme et égal. De quelle manière le nom des
Achéens est-il devenu dominant dans le Péloponnèse ? Ce n’est certainement
point par l’étendue du pays, le nombre des villes, les richesses ou le
courage des habitants : car les Achéens ne l’emportent par aucun de ces
avantages sur les autres peuples. L’Arcadie et Ainsi Une question dont Polybe ne donne pas la solution, non plus qu’aucun historien de l’antiquité, est celle des rapports qui existaient entre la confédération et ses membres. Les villes conservaient leur administration municipale et une certaine liberté d’action, pourvu que les intérêts généraux de la ligue ne s’y trouvassent pas contraires. Ce que Polybe dit de leur régime intérieur et uniforme a soulevé aussi des objections. Chaque ville avait encore ses deux factions démocratique et aristocratique ; et l’accession à la ligue achéenne était sans doute toujours précédée ou suivie, sans intervention directe des confédérés, du triomphe de l’un des deux partis. Ainsi, au temps de la lutte de Sparte et d’Athènes, une révolution intérieure dans un État faisait prévaloir l’alliance avec l’une ou l’autre cité, suivant le parti qui avait été vainqueur. Le caractère de la ligue achéenne et celui de ses grands hommes, tous ennemis de la démagogie et des tyrans, deux puissances mauvaises qui se donnent la main, fait penser que c’était la faction aristocratique qui inclinait plus volontiers vers les Achéens ; l’autre cherchait, au contraire, assistance auprès des Étoliens[2]. Ceux-ci formaient une confédération, à certains égards, pareille à la ligue achéenne. Leurs diverses peuplades ou villes avaient une assemblée commune, à laquelle probablement n’étaient admis que les hommes d’âge mûr. Cette assemblée, appelée panétolicon, se réunissait tous les ans à Thermos, à l’équinoxe d’automne, décidait alors de la paix ou de la guerre et nommait les magistrats. Outre cette assemblée annuelle, il y avait l’assemblée permanente des apoclètes ou députés, qui formaient un conseil semblable à celui des démiurges en Achaïe, niais plus nombreux. Le premier magistrat était le stratège, commandant des forces militaires. Après lui venaient l’hipparque, le grammateus ou secrétaire, etc. La ligue étolienne s’associait des villes fort éloignées, et leur laissait certainement une grande liberté d’action intérieure, mais dans quelle mesure ? On l’ignore. L’expression συντελεϊν είς τό Αίτωλιxόν montre seulement que leurs alliés, comme ceux d’Athènes deux siècles auparavant, avaient aliéné une partie de leur indépendance. Ensuite tous les droits, tous les devoirs n’étaient point parfaitement déterminés ; et parmi ces villes il y avait encore, comme dans l’empire d’Athènes, bien des conditions différentes. Dans quelques-unes on voit une garnison et un gouverneur étoliens. Les Étoliens étaient, comme les Achéens, un peuple neuf,
en ce sens, du moins, qu’il n’avait pas encore épuisé sa sève. Par leur
position, excentrique vers la frontière occidentale de Le portrait que Polybe trace de ce peuple n’est point
flatté; mais le sage Polybe était Achéen et du parti des grands, c’est-à-dire
le mortel ennemi des Étoliens, qui s’appuyaient sur le parti populaire et lui
durent leur fortune. On peut donc croire que, sans les calomnier, il les a
peints en laid. Ils avaient une qualité qui, en ce temps-là, n’était point
commune en Grèce : ils ne refusaient jamais à la patrie les services qu’elle
demandait : ils osèrent résister aux Gaulois, à Chez les Achéens, les mœurs publiques étaient meilleures, et
leurs chefs, Aratus, Philopœmen, Lycortas, le père de Polybe, voulurent véritablement
le salut de II. Succès des Achéens ; Agis, roi de SparteAvant d’être réunie à la ligue achéenne, Sicyone avait été
menacée par les Étoliens. Devenu en 246, à l’âge de 26 ans, stratège de la confédération,
Aratus en tourna les armes contre ses turbulents adversaires ; il alla au
secours de Cet avilissement de la population béotienne livrait Il continua sa guerre contre la démagogie et les tyrans. Ces hommes avaient excité une telle haine, que le sage et modéré Polybe écrivait : Leur nom seul comprend tous les crimes dont la nature humaine est capable. Il osait même dire : Le meurtre d’un tyran est un titre de gloire[4]. Argos en avait un alors, Aristippos, vrai type de la tyrannie soupçonneuse. Cet homme entouré, le jour, de ses satellites, s’enfermait, la nuit venue, dans une chambre haute, où il montait par une échelle qui était aussitôt retirée, et où il entrait par une trappe sur laquelle il plaçait sa couche. On comprend ce qu’un homme vivant ainsi, dans les soupçons et la crainte, devait avoir de cruauté. Telle était cependant l’apathique indifférence des Argiens, qu’ils ne faisaient rien pour secouer ce joug insupportable. Aratus renouvela contre Aristippos les tentatives qu’il avait déjà faites contre Aristomachos, son prédécesseur. Par surprise, il monta jusque sur les murs d’Argos : la moindre assistance des habitants lui eût donné la victoire. Ils laissèrent le tyran assaillir de tous côtés les Achéens, comme s’ils eussent assisté, spectateurs désintéressés, aux jeux néméens et fussent juges du combat. Cet échec décida Aratus à livrer bataille hors des murs, mais il perdait en rase campagne son assurance, et fut deux fois vaincu. Pourtant, dans une troisième rencontre, il battit et tua Aristippos. Malheureusement la mort du tyran n’entraîna pas sur-le-champ la chute de la tyrannie; il eut un successeur, Aristomachos le jeune. Ce qu’il tentait à Argos, Aratus se proposait de l’exécuter partout. II rendait la vie si difficile aux tyrans, qu’un d’eux, Lydiadès, maître de Mégalopolis, aima mieux abdiquer que de vivre dans ces continuelles alarmes. Il invita Aratus à venir le trouver, déposa devant lui le pouvoir et fit entrer Mégalopolis dans la ligue des Achéens, qui, pour le dédommager de ce sacrifice, le nommèrent stratège. Peu s’en fallut qu’ils n’eussent à s’en repentir. Lydiadès apporta dans la ligue une ambition fâcheuse; il se mit en opposition avec Aratus, et poussa sans utilité à une rupture avec Sparte, qui pourtant fut vaincue dans une nouvelle bataille de Mantinée (243). Pendant six ans, ils alternèrent dans le commandement : ce ne fut qu’au bout de ce temps qu’on reconnut tout ce qu’il y avait de personnel dans les vues de Lydiadès, et qu’Aratus reprit un ascendant décisif. Rien n’était plus sage que de ménager Sparte. On le vit bien lorsque les Étoliens, en 238, se présentèrent à l’isthme de Corinthe. Agis vint avec des troupes lacédémoniennes se joindre aux Achéens. Il voulait livrer bataille ; Aratus s’y opposant, le roi irrité se retira, et les Étoliens eurent les passages libres. Aratus répara du moins glorieusement sa faute, en leur tuant dans une surprise sept cents hommes. Antigone Gonatas était mort en 239, laissant le trône à
son fils Démétrius Il. Le nouveau prince, maître de l’Attique et de Ainsi, vers l’an 229, les Achéens comptaient comme alliés ou
comme membres de leur ligue[6] : dans Loin de là, ce fut en ce moment qu’ils se divisèrent à
jamais ! Il eût été salutaire pour Ce qu’on appelait la constitution de Lycurgue n’était plus qu’un souvenir. Cet édifice artificiel qui avait pour base, dans le principe, l’égalité des fortunes, par suite du partage des terres en un nombre fixe de lots, s’était écroulé. La guerre qui moissonnait les Spartiates et la loi de l’éphore Épitadéos, qui permettait de disposer de son bien, avaient produit ce singulier résultat que les femmes et un petit nombre de citoyens avaient attiré à eux toutes les fortunes. Sous le règne d’Agis IV, Lacédémone n’avait plus que sept cents Spartiates, dont cent à peine possédaient de la terre, et au temps d’Aristote, les deux tiers du territoire étaient aux mains des femmes[7]. La foule, n’ayant plus les ressources nécessaires pour
remplir les obligations auxquelles étaient attachés les droits politiques, ne
pouvait prendre part à aucune affaire; il en résultait que le gouvernement
tout entier était aux mains de quelques riches. Cette dégradation avait deux
fâcheuses conséquences : les pauvres, objet de mépris, étaient en campagne de
fort mauvais soldats et, dans la ville, des conspirateurs épiant sans cesse
l’occasion de bouleverser l’État. Les mœurs, on le pense bien, avaient aussi
changé. Le roi Areus et son fils Acrotatos introduisirent ouvertement à
Sparte le luxe des cours orientales. Sparte ne fut plus Sparte, mais une
ville comme beaucoup d’autres, molle, oisive et corrompue, mélange odieux
d’extrême richesse et d’extrême misère. Platon prétend qu’elle renfermait
plus d’or et d’argent que Elle se distinguait pourtant par une certaine tradition
héroïque et guerrière qui, plus d’une fois la sauva, de Démétrius, par exemple,
plus tard de Pyrrhus, et qui se manifestait même à l’extérieur par les
expéditions de Cléonymos dans Un Eurysthénide, Agis IV, devenu roi en 244, à l’âge de vingt ans, crut possible de régénérer Sparte, en la ramenant aux institutions et aux moeurs des anciens jours. Il voulait commencer par refaire un partage des terres : c’était s’attaquer, dès le premier pas, à la question la plus périlleuse, car il s’agissait de déposséder les uns au profit des autres. La plupart des riches, habitués au luxe et ennemis de toute innovation, surtout leurs femmes, effrayées au seul souvenir de la vie sévère qu’avaient imposée les coutumes primitives, formaient le parti contraire à la réforme : à sa tête se plaçait un Eurypontide, le roi Léonidas, collègue d’Agis, qui avait passé une partie de sa vie dans les cours asiatiques, et enseigné à ses concitoyens de nouvelles délicatesses. Pour Agis étaient les pauvres, les ambitieux, mais aussi quelques jeunes gens qui, avec la générosité de leur âge, voyaient dans ces réformes le bien de la patrie. Il gagna à ses idées sa mère Agésistrate et son aïeule Archidamie, les deux femmes les plus riches de la ville. Lui-même, élevé par elles dans le luxe, possédait de vastes propriétés et un trésor de 600 talents. Il renonça à ses habitudes, prit le vêtement, les habitudes des anciens Spartiates, et déclara qu’il mettait ses biens en commun. Sa mère et son aïeule s’associèrent à cet esprit de sacrifice. Le plan proposé par Agis était celui-ci : abolition des
dettes ; partage de L’année suivante, l’éphorat échappa à Agis. Ses ennemis en remplirent toutes les places et accusèrent Lysandre de mesures illégales. Agis se décida à agir révolutionnairement; il reprocha aux éphores d’excéder de beaucoup leurs primitives attributions, qui se bornaient à intervenir quand les rois n’étaient pas d’accord, les chassa et mit à leur place de nouveaux éphores parmi lesquels Agésilas. Les jeunes gens furent armés, les prisonniers délivrés et Agis se trouva maître absolu, sans qu’il eût coulé une goutte de sang. C’était le moment d’exécuter les réformes. Malheureusement, parmi les trois conseillers d’Agis, il y en avait un qui ne travaillait que pour lui-même. Agésilas avait à la fois beaucoup de terres et beaucoup de dettes. Il voulait bien être débarrassé des unes, mais il entendait garder les autres ; par de spécieuses raisons, il persuada à Agis de commencer par l’abolition des dettes; tous les titres de créances, mis en tas sur la place publique, furent brûlés en présence de la foule. Agésilas déclarait, dans sa joie, qu’il n’avait jamais vu feu plus clair ni plus pur. Quand vint ensuite la question du partage des terres, il trouva des expédients pour différer l’exécution. Les choses traînèrent jusqu’au moment où les Athéniens attaqués par les Étoliens, en 238, appelèrent les Spartiates à leur secours. Agis se rendit sur l’isthme. Tandis qu’il allait faire admirer à tous les pays qu’il traversait sa simplicité, son courage, la discipline de ses soldats, Agésilas discréditait le parti par ses désordres et sa scandaleuse tyrannie. La foule pauvre, qui avait tout espéré des réformes, crut avoir été trompée ; les partisans de Léonidas reprirent le dessus et, quand Agis revint, une révolution avait rétabli son rival. Il se réfugia avec Cléombrote dans un temple ; celui-ci fut sauvé par sa femme, fille de Léonidas ; mais Agis, attiré traîtreusement hors du sanctuaire et traduit devant un tribunal exceptionnel, fût condamné à mort après qu’il eut refusé de désavouer sa généreuse tentative. Traîné en prison, il y fut étranglé, et l’on fit subir le même supplice, sur son cadavre, à sa mère et à son aïeule. Cet acte de cruauté fut suivi d’une période de terreur, pendant laquelle, pour la première fois, il n’y eut à Sparte qu’un roi, Léonidas. Mais, du sein même de sa famille, sortit un ennemi. L’âme d’Agis sembla entrer dans sa maison avec Agiatis, l’épouse de ce malheureux prince, que Léonidas avait épargnée à cause de sa grande fortune, et qu’il donna pour femme à son jeune fils Cléomène. III. Cléomène ; succès des Étoliens ; alliance des Achéens avec Philippe de Macédoine ; bataille de Sellasie (222)Cléomène avait l’esprit ardent et était à cet âge où l’on veut tout avec emportement, le mal, si une nature mauvaise vous y pousse, le bien, si une main chère ou respectée vous le montre. Il écoutait d’une oreille avide les récits qu’Agiatis lui faisait des desseins et des vertus de son premier époux. Il s’enflammait à ces paroles, et se sentait saisi d’indignation quand il voyait comment et pourquoi le jeune martyr était tombé, et la tyrannie oligarchique dont la victoire de son père avait été le signal, et la corruption des grands, leur mollesse, leur mépris des vieilles institutions, leur oubli de toute vertu, de tout patriotisme. Un philosophe stoïcien, Sphéros d’Olbia, disciple de ce Cléanthe, le dernier des grands hommes d’Athènes[8], s’était alors établi à Sparte, où il paraît que la philosophie avait pénétré avec les moeurs nouvelles. Cléomène suivit ses leçons. Il puisa, sans doute, dans les enseignements austères de l’école du devoir, de nouveaux encouragements pour les pensées qu’il roulait dans son esprit, peut-être aussi cette hâte du bien, cette violence de vertu, si j’ose dire, et cet oubli des conditions réelles de l’homme et de la société qui caractérise la noble doctrine de Zénon. Le stoïcisme comprend mal l’homme, dont il exagère certaines vertus jusqu’à en faire des défauts ; Cléomène comprit mal son temps, et son impatience du bien lui inspira des mesures coupables qui détruisirent tout[9]. Devenu roi en 236, il reprit les projets d’Agis, mais avec la pensée qu’une réforme aussi hostile à des intérêts puissants ne réussirait que le jour où il aurait une armée capable de l’imposer. Pour avoir cette armée, il lui fallait une guerre, des succès, de la gloire. Agis avait voulu réformer l’État, afin de refaire l’armée et la puissance de Sparte ; Cléomène prit la même route, mais par l’autre bout. Il se proposa de relever l’empire pour corriger ensuite la constitution. Si l’on pouvait rapprocher Sparte de Rome, et un faux héros d’un grand homme, nous dirions qu’Agis fit comme les Gracques et périt comme eux, tandis que Cléomène tenta ce qui réussit à César et fut sur le point de réussir comme lui. Mais cette guerre glorieuse dont Cléomène avait besoin, il
ne pouvait la trouver que dans une tentative pour rendre à Lacédémone la
suprématie, et cette tentative le conduisait forcément à une lutte contre la
ligue achéenne : nécessité fatale ! car cette rivalité allait détruire la
dernière espérance de Les Étoliens poussèrent à cette rupture. Rassurés du côté
de L’assemblée des Achéens rompit aussitôt avec Sparte et avec l’Étolie. « Il leur parut beau, dit Polybe, de ne devoir la défense de leurs villes et de leur pays qu’à eux-mêmes, et de n’implorer le secours de personne. » Aristomachos, alors stratège, entra en campagne avec vingt et un mille hommes, et attaqua l’Arcadie spartiate, que le roi, envolé par les éphores, vint défendre avec cinq mille soldats (227). Cléomène se montra général énergique et habile. Il battit honteusement les Achéens, et fut, l’année suivante, près du mont Lycée, vainqueur d’Aratus qui prit la fuite, et, prés de Mégalopolis, de Lydiadès qui périt. Il avait eu soin d’emmener de Sparte ceux qui lui étaient le plus hostiles; après les avoir à dessein fatigués par des marches nombreuses, il leur accorda un repos qu’ils réclamaient à grands cris. A cet instant, il les quitta comme pour courir à une autre entreprise, et, avec ses mercenaires, marcha sur Sparte, où il surprit les éphores qu’il égorgea ; un seul, laissé pour mort, put se réfugier dans un sanctuaire et fut ensuite banni avec quatre-vingts des partisans de l’oligarchie. Il mit en commun tous les biens, à commencer par les siens et ceux de son beau-père et de ses amis. E compléta le nombre des citoyens, en appelant les habitants des pals voisins, dont il forma un corps de cinq mille fantassins armés de longues piques à deux mains, au lieu de javelines. Il leur partagea toutes les terres, et réserva des portions même pour les bannis, qu’il promit de rappeler dés que les circonstances le permettraient, mêlant ainsi la justice et l’humanité à l’extrême énergie de ses mesures. Il remit en vigueur, d’après les anciennes lois, la discipline, l’éducation, les repas publics, les exercices et Ies autres usages, donnant lui-même l’exemple. La royauté fut aussi rétablie dans ses droits primitifs, usurpés par les éphores ; et, pour se conformer aux vieilles institutions, il fit nommer un second roi, qu’au lieu de choisir dans la race des Proclides, il prit à ses côtés, son frère Euclidas (226). Cléomène est représenté comme un ambitieux. Certainement
il le fut ; mais il eut l’ambition élevée qui désire le pouvoir, moins
pour les richesses ou les plaisirs qu’il donne que pour les grandes choses qu’il
permet de faire : avant tout, il voulait régénérer l’État. A ne considérer
que l’avantage spartiate, nulle entreprise plus belle ne pouvait être
accomplie ; par malheur, ce point de vue n’était pas assez large.
Sparte, depuis trop longtemps étrangère aux affaires générales de l’Hellade,
ne comprit pas que l’intérêt grec devait désormais, pour le salut de tous,
l’emporter sur l’intérêt lacédémonien. A des temps nouveaux il fallait une
organisation nouvelle : c’était un devoir de se faire Achéen. Avec Cléomène avait hâte de montrer la force que Sparte venait de recouvrer ; il entra en Arcadie, détacha Mantinée de la ligue, battit les Achéens à Hécatombéon, dans l’Achaïe même (224), et l’année suivante s’empara d’Argos et de toute l’Argolide. A Corinthe, à Sicyone, les pauvres s’agitèrent. Aratus y courut; dans la première de ces villes, il ordonna plusieurs exécutions ; dans l’autre, il faillit être tué. Corinthe se donna à Cléomène qui bloqua aussitôt la citadelle. Aratus, de son côté, appela Antigone, et le roi de Macédoine fut déclaré généralissime des troupes de terre et de mer de la ligue, avec un pouvoir absolu ; encore ne voulut-il accepter cette charge qu’à la condition qu’on lui donnerait, pour salaire, la citadelle de Corinthe imitant en cela le chasseur d’Ésope, qui brida le cheval avant de le monter. A l’approche d’Antigone, Cléomène se posta sur l’isthme. Entre l’Acrocorinthe et la mer, il fit tracer un fossé pour fermer le passage aux Macédoniens ; mais, sur ses derrières, les grands, qu’il n’avait point bannis, soulevèrent Argos, et la perte de cette ville le força de quitter ses positions. Antigone, trouvant le passage libre, entra à Corinthe, où il mit garnison, et de là dans l’Arcadie, où prit Tégée, Orchomène et Mantinée, que les Achéens, sous la conduite d’Aratus, saccagèrent de fond en comble (223)[11]. Tandis qu’Antigone se retirait à Égine pour y passer l’hiver, Cléomène, sans tenir compte de la saison, rentrait en campagne. Il surprit Mégalopolis, mais n’en eut que les murailles, grâce à Philopœmen dont nous rencontrons alors le nom pour la première fois ; par sa résistance désespérée dans les rues et les maisons, il donna le temps aux femmes, aux enfants, aux habitants désarmés, de fuir jusqu’à Messène, où lui-même se retira avec les hommes valides. Cléomène les rappela vainement dans leur ville et dans son alliance ; il se vengea sur les murailles et les édifices qu’il fit détruire. Les Achéens, à ce moment, tenaient conseil à Égion. Aratus paraît : on l’interroge ; il fond en larmes et se couvre le visage de sa chlamyde ; on le presse ; il parle enfin : Mégalopolis, dit-il, vient d’être détruite par Cléomène. Grâce à Philopœmen, le désastre se trouva moins funeste qu’on ne Pavait cru d’abord. Si la grande ville était en ruines, les Mégalopolitains étaient en armes et altérés de vengeance. Ils allaient en être rassasiés. Pour soutenir cette lutte redoutable, Cléomène avait été
forcé de recourir aux dernières ressources. Il affranchissait les
hilotes ; il sollicitait Ptolémée, qui, depuis le rapprochement
d’Antigone et des Achéens, était devenu favorable à Sparte ; et il lui
livrait en otage sa famille pour des secours qu’il n’obtint pas, ou qui
furent peu de chose. Il ne réussit qu’à réunir environ vingt mille hommes
pour la campagne décisive qui allait s’ouvrir, tandis qu’Antigone en put
rassembler près de trente mille, parmi lesquels, outre la phalange de dix
mille Macédoniens, beaucoup d’alliés et de mercenaires de tous pays, Achéens,
Mégalopolitains, Béotiens, Épirotes, Acarnanes, Illyriens, Agrianes, Gaulois.
Cette armée se dirigea vers les monts Éva et Olympe, au nord-est de
Ptolémée Évergète subit d’abord l’ascendant de cette forte nature. Il promit des secours au Spartiate et lui fit une pension annuelle. Mais à Évergète succéda son fils, Philopator, prince misérable, ivrogne, dissolu, qui fit mettre à mort sa mère Bérénice et laissa le gouvernement aux femmes. Cependant en Grèce tout changeait de face. Après être entré à Lacédémone, où il s’était empressé de rétablir les éphores, de ressusciter les abus et toutes les causes de faiblesse et de ruine, Antigone avait mis dans Orchomène et Corinthe des garnisons qui tenaient le Péloponnèse à sa discrétion ; puis il s’était rendu en Macédoine où l’appelait une attaque des Illyriens. Il avait été vainqueur de ces barbares, mais il était mort d’une hémorragie, les cris qu’il avait poussés dans le combat ayant fait rompre une veine dans sa gorge. Il laissait le trône à son neveu, Philippe III, âgé de dix-sept ans[12]. Le champ était donc libre. Cléomène songea à rentrer dans sa patrie. Il avait conservé, au milieu de la corruption de l’Égypte, les moeurs austères d’un Spartiate des anciens jours. Cette conduite, reproche vivant pour le prince et ses courtisans, l’avait rendu odieux ; on eut peu de peine à persuader au soupçonneux Philopator que l’exilé voulait faire une tentative sur Cyrène. On l’enferma avec treize de ses amis dans une vaste maison isolée, où on les garda comme les Turcs ont gardé Charles XII à Bender. Cléomène, qui a plus d’une analogie avec ce roi aventurier, fit comme lui : ne pouvant supporter la captivité, il trompa ses gardiens et sortit armé, avec ses compagnons, qui se répandirent dans Alexandrie, en poussant le cri de liberté ! Ce peuple hébété applaudit et ne bougea point. Les Spartiates tuèrent le gouverneur de la ville et un autre courtisan; mais ils furent enveloppés et se donnèrent la mort pour n’être pas pris vivants. Le corps de Cléomène fut écorché et mis en croix. Plus tard, on rendit à ses restes des honneurs expiatoires, et les Alexandrins le vénérèrent comme un héros. Ainsi périt le dernier des Spartiates, entraînant dans son
tombeau sa patrie et Antigone, on l’a vu, n’avait guère survécu à son triomphe,
et Les deux ligues se regardaient d’un oeil hostile et méfiant, à travers leur détroit. Les Étoliens, incorrigibles pillards, avaient hâte de voir recommencer les troubles, et, après la bataille de Sellasie, par une sorte de convention tacite, une paix générale avait régné en Grèce ; ce n’était pas leur compte. Ils possédaient, comme associée à leur ligue, la ville de
Phigalie, située dans les montagnes sur la commune frontière de l’Arcadie et
de Dorimachos et son partisan Scopas, dit Polybe, déclarèrent irrégulièrement les hostilités ; sans attendre l’assemblée, sans consulter les magistrats, ils entrèrent en campagne et traversèrent, en le pillant, le territoire achéen de Patras, Pharées et Tritée. Ces villes et les Messéniens portèrent leurs plaintes à l’assemblée générale. Aratus fit déclarer la guerre et vint livrer aux Étoliens, prés de Mégalopolis, la bataille de Caphyes, perdue par sa faute. Les vainqueurs pénétrèrent en Achaïe jusqu’à Pellène, et, après avoir ravagé les terres de Sicyone, se retirèrent par l’isthme. Le succès accrut leur confiance ; ils étendirent
leurs brigandages, et quand on les leur reprochait,
ils ne daignaient même pas se défendre. Ils se moquaient de ceux qui leur
demandaient raison de ce qu’ils avaient fait, ou de ce qu’ils avaient dessein
de faire... Ariston, leur stratège, se tenait en repos chez lui, feignant de
ne rien savoir, et répétant qu’il n’y avait pas de guerre, qu’on était en
pleine paix. Les Achéens, depuis l’intervention d’Antigone, avaient
malheureusement appris à compter sur les autres plus que sur eux mêmes. En
face d’un nouveau danger, ils crièrent encore : Les Lacédémoniens jouaient alors double jeu. Tandis qu’ils
envoyaient des troupes aux Achéens, ils signaient un traité secret avec les
Étoliens, et préparaient à Sparte même, contre Philippe prépara activement la guerre. Les Thessaliens, les Phocidiens, les Béotiens, les Acarnanes, les Eubéens, les Messéniens, et tous les membres de la ligue lui promirent assistance. Il obtint celle des Illyriens que les Étoliens avaient entraînés naguère dans une entreprise de pillage, sans les associer ensuite au partage du, butin. Les Étoliens avaient pour eux les Éléens, les Ambraciotes et les Spartiates, qui, Accomplissant à cette époque la révolution depuis quelque temps méditée, massacrèrent les chefs de la faction macédonienne et nommèrent deux rois. Les partisans de l’indépendance avaient jusque-là laissé les trônes vacants parce qu’ils avaient conservé l’espérance de voir revenir Cléomène. La nouvelle de sa mort les décida à partager le pouvoir royal entre Agésipolis, enfant de la famille des Eurysthénides, et Lycurgue, parmi les ancêtres duquel il n’y avait jamais eu de roi : la qualité de successeur d’Hercule et de roi de Sparte ne lui coûta qu’autant de talents qu’il y avait d’éphores. (Polybe) Au commencement de l’été (220), alors qu’Aratus eut pris le commandement, il y eut
guerre par toute la terre : Annibal marchait contre Sagonte les Romains,
sous la conduite de L. Æmilius, furent envoyés en Illyrie contre Démétrius de
Pharos ; Antiochus pensait à la conquête de Philippe fit avec succès cette guerre obscure, qui n’a
pour nous nul intérêt. Malgré les invasions répétées des Dardaniens, qui le
rappelèrent dans son royaume, malgré les trahisons de ses ministres Apellas,
Léontios, Ptolémée, Mégaléas, qui conspirèrent contre sa vie, parce qu’ils
n’avaient pu ruiner le crédit d’Aratus, il s’empara de Thermos, la capitale
même des Étoliens, les chassa de Le premier Philippe semblait avoir été moins maître de |