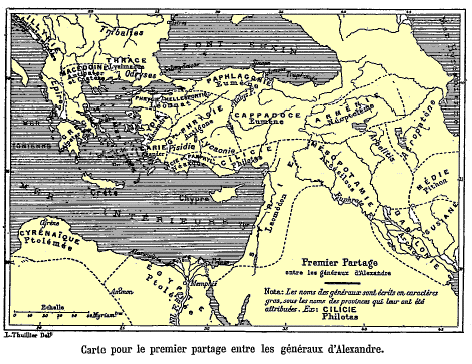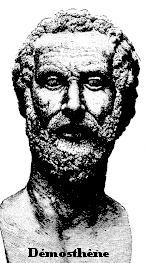|
I. Partage des satrapies occidentales entre les généraux
Alexandre avait beaucoup conquis, rien fondé : il n’en
avait pas eu le temps. L’Asie, enlevée par une course rapide, comme un
immense butin, était là, attendant de cette main puissante une forme, une organisation,
une civilisation nouvelles : mais cette main, la mort venait de la glacer.
Comme ces grands peintres dont nous possédons les rapides esquisses,
Alexandre n’avait pu que jeter sur tous les points de sa conquête quelques
indications de génie, quelques traits puissants, que les plus habiles de ses
successeurs devaient recueillir : tout était ébauché, rien n’était fini.
Qui pouvait penser que le dieu périrait, et si tôt, dans
la force de l’âge et des conceptions ? Sa mort frappa le monde de stupeur.
Dans la nuit qui suivit, l’armée resta sous les armes, par un vague instinct
de crainte, comme si l’on eût été dans le voisinage des ennemis. Les
habitants de Babylone fermèrent leurs portes, n’éclairèrent point leurs
maisons, se tinrent chez eux immobiles, inquiets, écoutant tous les bruits,
et croyant à toute heure que cette armée terrible, jusqu’alors enchaînée par
le respect du maître vivant, allait se répandre maintenant en violences et en
pillages.
Quand le jour parut, les gardes du roi, dont le nombre
était réduit à sept depuis la mort d’Héphestion, se réunirent et convoquèrent
les autres officiers; mais les soldats, qui entendaient prendre part à la
délibération, envahirent les avenues de la salle du conseil. A la vue du
trône vide, où l’on avait déposé le diadème, la robe royale et l’armure du
conquérant, les cris de douleur éclatèrent. On fit silence lorsque entra
Perdiccas. Il tenait l’anneau d’Alexandre qui servait de cachet pour les affaires
importantes et que le mourant lui avait donné ; il le déposa sur le
trône, comme s’il le mettait à la disposition de l’assemblée, et il ajouta
que, en attendant que Roxane eût donné le jour à l’enfant qu’elle portait
dans son sein, il fallait, dans l’intérêt de tous, choisir un chef à qui tous
obéiraient.
Perdiccas espérait que ce discours modeste recommanderait
sa candidature[2].
Son espoir fut trompé. Néarque, gendre de Barsine[3] par son mariage
avec une des trois filles de la veuve du Rhodien Memnon, proposa
naturellement de ne point attendre la postérité incertaine de Roxane. L’héritier d’Alexandre, disait-il, est déjà né : c’est Hercule, fils de Barsine : le diadème
lui appartient. Cet avis ne plut pas ; les soldats le
témoignèrent par des cris tumultueux. Ptolémée mit en avant une autre thèse :
les Macédoniens ne pouvaient obéir à un fils de Barsine ou de Roxane; il
fallait laisser le trône vacant et donner le gouvernement aux hommes qui
avaient formé le conseil du roi. La proposition convenait aux chefs, mais
blessait l’amour des soldats pour le sang d’Alexandre. On la rejeta, et il
fut décidé que la régence serait remise à Perdiccas et à Léonnat pour l’Asie,
à Antipater et à Cratère pour l’Europe, en attendant la naissance de l’enfant
de Roxane.
Durant cette scène, un ennemi de Perdiccas, Méléagre,
était allé vers l’infanterie qui, jalouse de la cavalerie, portion
aristocratique de l’armée, sur laquelle s’appuyait Perdiccas, voulut à son
tour choisir un prétendant. Son candidat fut Arrhidée, fils de Philippe et de
la
Thessalienne Philinée ; il n’avait pas de sang barbare
dans les veines : cela le fit accueillir, malgré l’obscurité où l’avait tenu
Alexandre à cause de sa faiblesse d’esprit. Méléagre l’amena; l’infanterie
lui fit cortège jusqu’à la salle où les généraux délibéraient. Ils refusèrent
de sanctionner ce choix ; mais les soldats menacèrent, et Arrhidée s’assit
sur le trône. Six cents hommes d’élite, apostés par Perdiccas, gardaient la
porte de la chambre où était le corps d’Alexandre. La foule voulut forcer le
passage, une lutte s’engagea : les traits volaient déjà sur Perdiccas et le
sang coulait ; l’intervention des autres chefs prévint de plus grands
malheurs. La cavalerie mécontente quitta Babylone ; Perdiccas, menacé
lui-même, en sortit et, pendant plusieurs jours, on put craindre une sanglante
collision. Pourtant le danger de cette situation amena un rapprochement :
Perdiccas et les cavaliers rentrèrent. On convint qu’Arrhidée partagerait le
trône avec l’enfant de Roxane, si elle avait un fils ; qu’Antipater
serait à la tête des forces d’Europe ; que Cratère dirigerait les
affaires sous l’autorité d’Arrhidée, et que Perdiccas commanderait la garde à
cheval, commandement qui équivalait, ce semble, dans la cour de Perse, à un premier
ministère. Méléagre était associé en sous-ordre à Perdiccas.
Quelque temps après, Perdiccas fit passer une revue de l’armée
par Arrhidée, sur lequel il avait bien vite pris un grand ascendant. Au milieu
de la revue, comme s’il agissait par un ordre royal, il fit saisir trente des
plus mutins qui furent écrasés sous les pieds des éléphants. Méléagre, averti
par cette exécution, s’enfuit dans un temple, où on l’égorgea.
Voilà de quelles scènes de désordre fut suivie la mort d’Alexandre.
C’était le commencement de ces funérailles sanglantes qu’il avait
lui-même annoncées. On voit les prétentions des chefs, les sentiments des soldats,
surtout le vide immense laissé par l’illustre mort et l’incertitude où l’absence
d’un héritier de quelque valeur mettait toutes choses. Un enfant à naître qui
sera le jeune Alexandre, un enfant naturel à peine né, un frère imbécile :
tels seront les hommes de cette déplorable famille. Les femmes étaient :
Olympias, mère du conquérant; Cynané, Cléopâtre et Thessalonice, ses
sœurs ; Eurydice, sa nièce ; enfin sa concubine Barsine, la mère d’Hercule,
et ses deux femmes, Roxane et Stateira. De tous ces personnages, pâles et
muettes figures pour la plupart, Olympias seule eut de l’énergie, mais elle n’en
montra que pour l’intrigue et le crime.
Il fallait compter bien plus avec les chefs dont treize
années de guerre avaient développé les talents et accru l’ambition. Au
premier rang était Perdiccas, qui venait d’établir son autorité de régent par
un coup d’audace; derrière lui, les généraux dont les plus habiles se
tailleront des royaumes dans cet immense empire, mais qui, pour le moment, se
contenteront de prendre des provinces où ils s’attribueront, suivant l’usage
asiatique, les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires. Les gouvernements
de l’Europe et de l’Asie occidentale seront seuls distribués ; dans la
haute Asie, moins convoitée à cause de son éloignement, on laissera à peu
près tous les satrapes établis par Alexandre.
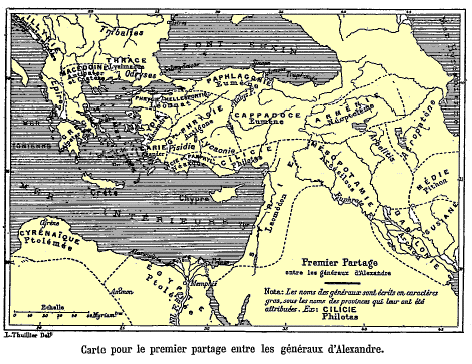
Trente-quatre généraux furent admis au partage : les
principaux étaient Ptolémée, fils de Lagos, qui eut l’Égypte et la Cyrénaïque ; Laomédon
le Mytilénien, la Syrie ;
Philotas, la Cilicie ;
Pithon, la Médie ;
Eumène, la Paphlagonie,
la Cappadoce
et le littoral pontique jusqu’à Trapézonte, qu’Alexandre, pressé par le
temps, n’avait pu encore visiter et soumettre; Néarque, la Pamphylie et la Lycie, qu’il laissa
peut-être sous les ordres d’Antigone, pour garder le commandement de la
flotte; Antigone, la grande Phrygie, où il commandait depuis dix ans ;
Asandras, la Carie ;
Ménandre, la Lydie ;
Léonnat, la Phrygie
hellespontique, qui commandait le grand passage d’Europe en Asie ;
Lysimaque, la Thrace
et les nations limitrophes des bords du Pont-Euxin ; Antipater et
Cratère, la Macédoine
et la Grèce
avec les provinces sur l’Adriatique. Séleucus, qui allait bientôt jouer un
rôle important, eut le commandement des hétaires ; quant à Perdiccas,
pour se distinguer dans la foule des généraux, il ne prit pas de province,
mais il se réserva le commandement de l’armée stationnée en Asie, avec la
tutelle des rois et les pouvoirs illimités que lui donnait la possession de l’anneau
royal.
Sur ce premier arrangement, Roxane mit une tache de sang :
elle fit tuer la dernière épouse d’Alexandre, Stateira, et sa sœur Drypétis,
veuve d’Héphestion. Chaque traité nouveau sera scellé de la même manière.
Le chaos ainsi débrouillé, au gré des partageants, et une
sorte d’hiérarchie et de forme de gouvernement établie, qu’allait-on
faire ? Exécuterait-on les projets d’Alexandre consignés dans ses
papiers ? Ils étaient gigantesques. Il s’agissait de construire mille
vaisseaux, d’attaquer les Carthaginois et les autres peuples de la Libye, de porter les armes
des Macédoniens jusqu’à l’océan Atlantique, et de tracer tout le long du
littoral de l’Afrique une route praticable aux voitures ; il s’agissait
encore d’opérer d’Europe en Asie, et réciproquement, des migrations nombreuses
pour mêler les populations ; enfin, de construire en divers lieux six
temples magnifiques et, pour tombeau à Philippe, une pyramide égale à la plus
haute des pyramides égyptiennes. Ces projets, communiqués aux soldats, furent
unanimement rejetés. On avait enduré assez de fatigues : il était temps de se
reposer ; les généraux eux-mêmes étaient pressés de se mettre en possession
de leurs provinces, où ils entrevoyaient déjà pour eux des souverainetés
indépendantes.
Durant un demi-siècle, notre attention sera détournée de la Grèce, qui n’est plus qu’un
point dans l’immensité de l’éphémère empire. Nous ne la retrouverons, avec un
reste de vie, qu’après la destruction du colosse qui l’écrase. Le récit des
luttes qui se produiront dès le premier jour entre les successeurs du
conquérant est une histoire presque étrangère à la Grèce : on y trouve des
ambitions sans frein et des crimes éclatants; on s’y bat pour de l’or, du
pouvoir ou des lambeaux de royauté; pas une idée généreuse, élevée, ne s’y
montre ; pas un établissement durable ne s’y fonde, si ce n’est en
Égypte; pas une ville ne s’y élève pour continuer l’œuvre de la Grèce, si ce n’est
Alexandrie et Pergame, l’une qui sera un centre fécond pour les lettres et la
philosophie, l’autre, pour l’art et la science; encore à quelle distance
restent-elles d’Athènes ! Ce qui aurait pu être une grande chose, si le
conquérant avait vécu : l’Asie hellénisée et la barbarie qu’elle renferme,
contenue, deviendra un vaste champ de pillage et de dévastation. La langue
grecque, il est vrai, en prendra possession jusqu’à l’Euphrate, mais ce sera
moins pour marquer les frontières de la civilisation que les bornes de l’influence
occidentale. Les véritables héritiers d’Alexandre seront les Césars de Rome.
Il faut cependant raconter cette histoire, bien qu’elle
appartienne plus réellement à l’Orient qu’à la Grèce ; du moins le
ferons-nous très rapidement.

II. Révoltes contre la domination macédonienne ; mort de Démosthène (10 novembre 322)
Il était inévitable qu’à la mort du conquérant quelques
protestations s’élèveraient contre la domination macédonienne : il y en eut
cinq, dont une seule nous intéresse, celle de la Grèce.
Dans la haute Asie, vingt-trois mille Grecs mercenaires,
cantonnés dans les colonies qu’Alexandre avait fondées, prirent les armes et
s’apprêtèrent à rentrer dans leur patrie. Pithon, gouverneur de la Médie, marcha contre eux,
d’après les ordres de Perdiccas, et les extermina.
En Cappadoce, le roi Ariarathe refusa de livrer ses États
à Eumène ; il fut vaincu et envoyé au supplice avec tous les siens.
Les Pisidiens avaient massacré leur gouverneur macédonien.
Perdiccas décida que leurs deux principales villes, Laranda et Isaura,
seraient détruites et leurs habitants égorgés. Ceux d’Isaura soutinrent trois
assauts, puis mirent le feu à leur ville et se jetèrent dans les flammes.
Le satrape d’Arménie, Néoptolème, affectait l’indépendance ;
Eumène alla le réduire.
La révolte la plus sérieuse fut celle qui éclata en Grèce,
et qui a reçu le nom de guerre Lamiaque.
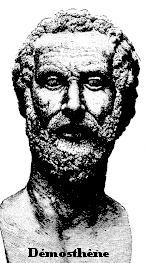 Tous les
peuples grecs, excepté les Lacédémoniens, avaient accepté la suprématie
macédonienne. Athènes, vaincue mais dédommagée de sa défaite par les
flatteries de son vainqueur, lui avait prêté son concours. Cependant, tout en
courbant la tête sous ce joug, qu’on faisait léger pour elle, elle ne se
dissimulait pas que les conquêtes de la Macédoine changeraient sa dépendance en
servitude. Le parti des patriotes avait perdu ses chefs militaires :
Éphialte, mort au siège d’Halicarnasse en combattant Alexandre, Charidémos,
que Darius avait fait tuer pour un conseil qui lui parut une insulte. II
restait à Athènes deux hommes qui, sans pouvoir la sauver, honoraient du
moins ses derniers jours. Démosthène avait compris que l’Asie regagnerait par
les mœurs ce qu’elle perdait par les armes ; que l’influence orientale
dompterait les conquérants, et qu’au lieu d’un prince grec, on aurait bientôt
pour maître un souverain asiatique. Pendant le règne d’Alexandre, la
politique du grand orateur avait reçu une consécration solennelle par l’issue
du fameux procès de la
Couronne, où il avait fait entendre un dernier et
magnifique écho de cette éloquence qui avait honoré la tribune d’Athènes un
siècle auparavant, quand Périclès y montait (330). Que devait
faire notre ville en voyant Philippe marcher à l’empire, à la domination de la Grèce ? Et moi, que
devais-je dire, quels décrets devais-je proposer, moi, conseiller d’Athènes ?
Car c’est d’Athènes qu’il s’agit. Je savais que dans tous les temps, jusqu’au
jour où je montai à la tribune, ma patrie avait combattu pour l’honneur et la
prééminence ; que, par amour de la gloire et dans l’intérêt des autres
Grecs, elle avait sacrifié plus d’hommes et plus d’argent que tous les Grecs
ensemble pour leur propre salut. Je voyais Philippe, à qui nous avions affaire,
endurer tout pour devenir le maître. Je le voyais, un oeil de moins, l’épaule
rompue, la main et la cuisse fracassées, abandonner facilement, gaiement, à la
fortune, tout ce qu’elle voudrait de son corps, pourvu qu’avec le resté il
vécût glorieux. Et pourtant, qui eût osé dire qu’un barbare, nourri dans
Pella, misérable lieu, jusqu’alors inconnu, aurait l’âme assez haute pour
espérer, pour entreprendre de commander aux Grecs ; et que vous, qui
êtes Athéniens, vous que l’on entretient chaque jour du courage de vos
ancêtres, qui trouvez partout ce souvenir, dans les discours de vos orateurs
et dans les spectacles offerts à vos yeux, vous seriez assez lâches pour
aller au-devant de Philippe et lui livrer la liberté de la Grèce ? Non, personne
n’oserait le dire. Vous n’aviez donc qu’un seul parti à prendre, et il
fallait le prendre ; c’était d’opposer une résistance légitime à ses
injustes entreprises, Athéniens, vous l’avez fait dès le principe, comme vous
le deviez, comme l’honneur vous le commandait, et moi, je vous y ai poussés par
mes décrets et mes conseils. Il y avait du courage à parler ainsi,
quand Darius était fugitif ou mort et Alexandre maître de l’Asie. Tous les
peuples grecs, excepté les Lacédémoniens, avaient accepté la suprématie
macédonienne. Athènes, vaincue mais dédommagée de sa défaite par les
flatteries de son vainqueur, lui avait prêté son concours. Cependant, tout en
courbant la tête sous ce joug, qu’on faisait léger pour elle, elle ne se
dissimulait pas que les conquêtes de la Macédoine changeraient sa dépendance en
servitude. Le parti des patriotes avait perdu ses chefs militaires :
Éphialte, mort au siège d’Halicarnasse en combattant Alexandre, Charidémos,
que Darius avait fait tuer pour un conseil qui lui parut une insulte. II
restait à Athènes deux hommes qui, sans pouvoir la sauver, honoraient du
moins ses derniers jours. Démosthène avait compris que l’Asie regagnerait par
les mœurs ce qu’elle perdait par les armes ; que l’influence orientale
dompterait les conquérants, et qu’au lieu d’un prince grec, on aurait bientôt
pour maître un souverain asiatique. Pendant le règne d’Alexandre, la
politique du grand orateur avait reçu une consécration solennelle par l’issue
du fameux procès de la
Couronne, où il avait fait entendre un dernier et
magnifique écho de cette éloquence qui avait honoré la tribune d’Athènes un
siècle auparavant, quand Périclès y montait (330). Que devait
faire notre ville en voyant Philippe marcher à l’empire, à la domination de la Grèce ? Et moi, que
devais-je dire, quels décrets devais-je proposer, moi, conseiller d’Athènes ?
Car c’est d’Athènes qu’il s’agit. Je savais que dans tous les temps, jusqu’au
jour où je montai à la tribune, ma patrie avait combattu pour l’honneur et la
prééminence ; que, par amour de la gloire et dans l’intérêt des autres
Grecs, elle avait sacrifié plus d’hommes et plus d’argent que tous les Grecs
ensemble pour leur propre salut. Je voyais Philippe, à qui nous avions affaire,
endurer tout pour devenir le maître. Je le voyais, un oeil de moins, l’épaule
rompue, la main et la cuisse fracassées, abandonner facilement, gaiement, à la
fortune, tout ce qu’elle voudrait de son corps, pourvu qu’avec le resté il
vécût glorieux. Et pourtant, qui eût osé dire qu’un barbare, nourri dans
Pella, misérable lieu, jusqu’alors inconnu, aurait l’âme assez haute pour
espérer, pour entreprendre de commander aux Grecs ; et que vous, qui
êtes Athéniens, vous que l’on entretient chaque jour du courage de vos
ancêtres, qui trouvez partout ce souvenir, dans les discours de vos orateurs
et dans les spectacles offerts à vos yeux, vous seriez assez lâches pour
aller au-devant de Philippe et lui livrer la liberté de la Grèce ? Non, personne
n’oserait le dire. Vous n’aviez donc qu’un seul parti à prendre, et il
fallait le prendre ; c’était d’opposer une résistance légitime à ses
injustes entreprises, Athéniens, vous l’avez fait dès le principe, comme vous
le deviez, comme l’honneur vous le commandait, et moi, je vous y ai poussés par
mes décrets et mes conseils. Il y avait du courage à parler ainsi,
quand Darius était fugitif ou mort et Alexandre maître de l’Asie.
Après ce débat, où le peuple athénien avait applaudi au
patriotisme éloquent de Démosthène, malgré la décision contraire des armes,
Eschine, condamné à une amende de 1000 drachmes, parce qu’il n’avait pas
réussi dans son accusation, s’était exilé (330) ; et l’année suivante,
Démosthène avait obtenu aux Dionysies la couronne d’or demandée pour lui
après la bataille de Chéronée.
Un peu plus tard, un autre procès avait agité la ville. L’accusateur
était Lycurgue, dont l’intégrité et l’administration féconde ont été déjà
rappelées[4]. Léocratès, un de
ces lâches qui avaient fui d’Athènes avec leurs biens, après Chéronée, parce
qu’ils pensaient ce que dira le poète latin Pacuvius, que la patrie est là où
l’on vit bien, osa revenir au bout de sept ans. Lycurgue lui intenta une
accusation capitale et le fit condamner.
Le même homme, si terrible aux lâches, rédigeait pour un
bienfaiteur d’Athènes ce mâle décret : Considérant
qu’Eudèmos de Platée a promis au peuple que, s’il manquait quelque chose pour
la guerre, il fournirait 2000 drachmes; qu’en outre il a mis à son service
mille journées de chariots attelés, pour la construction du Stade ; le
peuple, afin d’honorer Eudèmos, lui accorde une couronne, la permission d’acquérir
en Attique, de payer l’impôt des citoyens et de combattre dans les armées d’Athènes[5]. Il était digne d’Athènes,
même mourante, que de tels honneurs fussent regardés comme la plus belle des
récompenses.
On s’étonne qu’avec ces sentiments cette ville ne se soit
pas associée à la prise d’armes de Lacédémone, vers l’époque de la bataille d’Arbèles.
Mais Démade, Phocion, ses conseillers alors le mieux écoutés, n’eurent pas de
peine à démontrer qu’en face d’une Macédoine si forte, la politique imposait
la prudence. Elle se renferma donc en elle-même, attendant l’issue de l’audacieuse
et peut-être téméraire entreprise d’Alexandre. Quand le conquérant voulut
imposer aux Grecs la reconnaissance de son titre de fils d’Ammon et l’étiquette
asiatique du prosternement devant sa personne, ils ne lui firent pas la même
opposition que les Macédoniens. Que leur importait, après tout ? Alexandre veut être dieu ? dirent les
Spartiates. Qu’il le soit. » Dans Athènes, il
y eut de plus vives paroles. Quelle espèce de dieu
nous propose-t-on ? dit Lycurgue ; il
faudra se purifier en sortant de son temple ; et Démosthène
demanda de ne reconnaître que les dieux transmis par les ancêtres[6]. Mais Démade
exhorta les Athéniens à ne pas risquer de perdre la terre à propos d’une
contestation sur la possession du ciel. La question ne fut pas décidée.
Cependant on se préparait sans bruit à une lutte nouvelle : vers 330, Athènes
avait réuni au Pirée, où l’architecte Philon achevait un nouvel arsenal, de
nombreuses galères[7].
Une autre question, celle des exilés, agita plus vivement la Grèce. Dans ces
petits États déchirés par les factions, il y avait toujours une partie de la
population proscrite par l’autre. On comptait alors plus de vingt mille
bannis. Alexandre s’était dit que rendre leur patrie et leurs biens à ces
proscrits, c’était s’assurer dans chaque ville un parti dévoué, et il avait
envoyé Nicanor de Stagire aux jeux olympiques de 324 pour y lire une lettre
qui décrétait leur rappel. On accueillit mal cette proposition qui était
contraire au pacte conclu à Corinthe, par lequel Philippe et Alexandre
avaient garanti aux États particuliers leur souveraineté, et qui, tout en
affectant d’être généreuse, l’était aux dépens d’autrui. Partout le
bannissement avait été suivi de la confiscation des biens. Mais ces biens n’étaient
pas restés dans les mains de l’État ; ils avaient été distribués ou
vendus par lui à des citoyens qui, à leur tour, les avaient aliénés, donnés
en dot ou cédés en payement d’une créance. Les bannis allaient les réclamer
et, alors, quelles perturbations dans les cités ! Les Étoliens, les Athéniens
surtout, menacés du retour d’un nombre considérable de proscrits, furent dans
l’alarme. Les premiers avaient chassé la puissante famille des Œniades et
confisqué ses biens ; les seconds avaient partagé entre leurs colons le
territoire de Samos, et n’étaient pas disposés à le rendre. Ils n’osèrent
répondre à cette violation de leur autonomie par une prise d’armes contre
Alexandre, mais ils lui envoyèrent des députés pour le faire revenir sur sa
décision. L’affaire traîna en longueur; puis survint l’aventure d’Harpalos,
ce satrape de Babylone qui s’était enfui en Grèce avec 5000 talents volés à
Alexandre. Il avait laissé au cap Ténare ses 6000 mercenaires et son trésor,
dont il n’emporta que 550 ou 720 talents à Athènes pour y acheter un asile,
en achetant des consciences. Démosthène était toujours l’âme du parti
contraire à la Macédoine
et fomentait les sentiments d’indépendance. Ses ennemis politiques l’accusèrent
de s’être vendu au satrape et le firent condamner à une amende de 50 talents.
Ne pouvant la payer, il se retira en exil. Avait-il reçu l’argent d’Harpalos ?
Chose improbable, puisqu’il s’opposa à la réception du fugitif dans Athènes,
et proposa, quand il y fut entré, de l’emprisonner et de séquestrer ses biens
pour les restituer à Alexandre. Hypéridès, dans son discours contre
Démosthène, dont on a, il y a quelques années, retrouvé des fragments, lui
reproche d’avoir fait échouer les projets d’Harpalos. Un fait qui semble
concluant, c’est qu’après la mort de cet intrigant, un de ses familiers,
tombé aux mains des Macédoniens, et forcé de nommer ceux qu’Harpalos avait
corrompus, ne prononça pas le nom de Démosthène. Lui-même, dans le Discours
sur la Paix,
avait fièrement parlé de son intégrité : Je défie
mes ennemis de prouver qu’un présent ait jamais exercé la moindre influence
sur mes paroles et sur mes conseils[8].
Les choses en étaient là quand Alexandre mourut. Antipater
maintint le décret qu’il avait provoqué touchant les bannis. Mais la confiance
revenait maintenant à Athènes ; le parti national y reprit le dessus.
Démade fut condamné à une amende de 10 talents pour avoir proposé de rendre à
Alexandre des honneurs divins ; des amis du prince furent bannis, et l’on
fit partir des députés qui parcoururent la Grèce pour former une ligue contre les
Macédoniens et les exilés. Démosthène, alors à Mégare, se joignit à eux,
enflamma les esprits, et mérita par ce service d’être rappelé dans sa patrie.
Les seuls peuples qui restèrent neutres furent l’Arcadie, l’Achaïe, dont Alexandre
avait cependant supprimé les assemblées générales, et Sparte encore, Sparte
quelquefois héroïque mal à propos, comme en 330, plus souvent égoïste. D’ailleurs,
elle avait en Macédoine cinquante otages, appartenant tous à de nobles
familles, et qui, en cas de déclaration de guerre, couraient risque de la
vie. Les Béotiens soutinrent le parti de la Macédoine, craignant d’être
dépouillés du territoire de Thèbes qu’Alexandre leur avait donné. Les
Thessaliens se prononcèrent dans le même sens, mais dès le début de la guerre
passèrent du côté des Grecs. Le reste de la Grèce, et un grand nombre d’Illyriens et de
Thraces, accédèrent à la confédération. Le commandement général fut donné à l’Athénien
Léosthénès, qui avait servi sous Alexandre, et ramené d’Asie huit mille
mercenaires, soldats éprouvés par de longues campagnes. Athènes déploya une
énergie qui rappelait des temps meilleurs. Elle enrôla tous les citoyens
au-dessous de quarante ans, en état de porter les armes, et mit sur pied cinq
mille hoplites, cinq cents chevaux, deux mille mercenaires, soutenus par une
flotte de quarante trirèmes et de deux cents vaisseaux à quatre rangs de
rames. Un décret du peuple fut porté par toute la Grèce : Les Athéniens sont disposés à combattre encore pour la
liberté grecque, ils aideront toute cité qui voudra chasser sa garnison
macédonienne. Les riches, Phocion à leur tête, s’étaient en bain
opposés à cette héroïque témérité.
Beaucoup de peuples entrèrent dans la ligue et le début
des opérations fut brillant. Léosthénès battit les Béotiens, puis courut aux
Thermopyles et en Thessalie au-devant des Macédoniens. Ceux-ci arrivaient au
nombre de treize mille fantassins et de six cents chevaux : c’était tout ce
qu’Antipater avait pu réunir de soldats dans le royaume épuisé. Il s’était
empressé d’appeler de la
Phrygie Léonnat, et de la Cilicie Cratère ;
mais savait-on si l’état des affaires en Asie permettrait à ces généraux d’arriver
à temps ! Déjà Rhodes avait repris sa liberté en chassant sa garnison
macédonienne ; d’autres villes pouvaient l’imiter ; et il y avait
bien des divisions parmi les héritiers du conquérant. L’entreprise des
Athéniens n’était donc pas si insensée que le soutenaient les pacifiques. Les
talents de Léosthénès, la supériorité de ses forces, qui montaient à trente
mille hommes, surtout la défection de Ménon de Pharsale, commandant de la
cavalerie thessalienne, qui passa aux Grecs, valurent à ces derniers la
victoire de Lamia. Antipater se réfugia dans les murs de la ville, près de
laquelle le combat s’était livré, et s’y vit si étroitement bloqué qu’il
envoya demander la paix aux Athéniens. Le peuple, dans l’ivresse du succès,
eut l’imprudence d’exiger qu’il se rendit à discrétion. Il est juste d’ajouter
que cette paix, désavouée sans doute par Léonnat et Cratère, n’eût été qu’une
trêve qui eût brisé l’élan de la ligue et désarmé les Athéniens.
Le siège continua, ou plutôt le blocus, car les
assiégeants n’avaient point de machines pour battre les murs. Par malheur,
Léosthénès, en repoussant une sortie, fut tué. Hypéridès prononça l’éloge
funèbre du général et des citoyens morts avec lui ; c’est un beau
morceau d’éloquence, bien qu’il ne soit qu’une pâle copie des discours de
Périclès. Jamais hommes, dans les temps passés, n’ont
combattu ni pour une cause plus noble, ni contre des adversaires plus
puissants, ni avec des ressources plus faibles ; ils pensaient que la
vertu fait la force et que la grande armée est celle où se trouve, non pas le
plus de soldats, mais le plus de courage. Que serait-il arrivé s’ils n’avaient
pas réussi ? Le monde appartiendrait à un maître ; ses caprices
seraient la loi, et l’insolence macédonienne l’emportant sur la justice,
personne, ni femmes, ni filles, ni jeunes garçons, n’échapperait aux
outrages! ... Plus donc étaient terribles les maux qui nous étaient réservés,
plus nous devons rendre d’honneurs à ceux qui sont morts pour nous ; à
celui-ci surtout, Léosthénès, qui a déterminé ses concitoyens à subir de
telles épreuves. Ceux qui se sont montrés les dignes compagnons d’un tel général
ne sont-ils pas heureux d’avoir sacrifié un corps mortel en échange d’une gloire
qui ne finira pas, et d’avoir, par leur courage, assuré la liberté de tous
les Grecs ? Des hommes libres n’auront plus à craindre d’être accusés,
mais seulement d’être convaincus ; et la sûreté de chacun ne dépendra
pas de ceux qui flattent le maître et qui calomnient leurs concitoyens; elle
sera placée sous la protection des lois. Voilà en vue de quels avantages ceux
dont nous parlons ont affranchi à jamais des craintes de l’avenir leur patrie
et la Grèce ;
ils ont donné leur vie pour que nous vivions avec honneur. Telle était
l’exaltation des esprits, qu’on rapporte que la fiancée de Léosthénès se
donna la mort, en disant : Vierge encore et déjà
veuve, je n’appartiendrai pas à un autre.
Belle journée sans lendemain ! Le discours d’Hypéridès
était la dernière parole libre qu’Athènes devait entendre.
Cependant Démosthène rentra alors dans sa patrie. II n’avait
pu, durant son exil, s’éloigner beaucoup d’Athènes. On l’avait vu errant sur
la plage de Trézène ou sur les montagnes d’Égine, les yeux tournés du côté de
l’Attique, ou, plus prés encore, à Mégare. Son retour fut un triomphe. On envoya une galère à trois rangs de rames le prendre à
Égine. Quand il aborda au Pirée, les magistrats, les prêtres, suivis du
peuple entier, allèrent au-devant de lui, et le reçurent avec les plus vives
démonstrations de joie... Cependant le jugement qui le condamnait à une
amende subsistait, et le peuple ne pouvait légalement lui faire grâce de la
peine. On imagina un moyen d’éluder la loi : il était d’usage, dans le
sacrifice fait tous les ans à Jupiter Sauveur, de donner une certaine somme à
celui qui avait soin de préparer et d’orner l’autel du dieu ; ils en
chargèrent cette année Démosthène, et lui comptèrent pour cet office les 50
talents auxquels montait son amende. (Plutarque)
Démosthène goûta pleinement le bonheur de revoir Athènes,
mais ce bonheur allait lui coûter la vie. Avec Léosthénès les Grecs avaient
perdit un bon général; en outre, la retraite des Étoliens, rappelés
momentanément chez eux, avait réduit leur armée à vingt-deux mille hommes.
Les Macédoniens, que la guerre commencée quelques mois plus tard eût trouvés
armés les uns contre les autres, voyaient au contraire arriver de l’Asie, sur
l’instante prière du vaincu de Lamia, Léonnat à la tête de vingt mille hommes
de pied et de deux mille cinq cents chevaux. Pour prévenir la jonction de ce
général et d’Antipater, Antiphilos, successeur de Léosthénès, leva le siège
de Lamia, et courut au-devant de Léonnat, qui périt dans un combat de
cavalerie. Mais Antipater réunit ses forces à celles de l’armée vaincue; et
lorsque Cratère arriva à son tour, les Macédoniens comptèrent près de
cinquante mille hommes. Les Grecs en avaient moitié moins ; ils furent
vaincus à Crannon (322).
Les écrivains, qui ont toujours de bonnes raisons au service du succès, ont
condamné ce suprême effort de la
Grèce ; nous y applaudissons : c’était finir
virilement.
La défaite de Crannon fut décisive, non par le nombre des
morts, du côté des vaincus, qui fut peu considérable, mais parce qu’elle
acheva de jeter parmi eux le découragement. D’ailleurs, la fortune leur était
également contraire sur mer ; Clitus, commandant de la flotte royale,
venait de détruire les forces maritimes d’Athènes. Des négociations s’engagèrent,
et Antipater ayant très habilement déclaré qu’il ne traiterait qu’isolément
avec les membres de la ligue, les cités rivalisèrent à qui ferait la première
soumission : la confédération tomba.
A Athènes, le parti de la guerre vit bien lui-même qu’il n’y
avait plus qu’à traiter; Démosthène et quelques autres s’éloignèrent, et on
laissa reprendre le dessus au parti macédonien, qui, seul, pouvait servir de
médiateur. Ce parti avait alors pour chefs deux hommes considérables : Démade
et Phocion, celui-ci, le Caton athénien, personnage intègre et sage, mais d’une
sagesse étroite, sans illusion comme sans enthousiasme. Au milieu des éclats
de joie qu’avaient naguère provoqués les heureux succès des armes grecques,
jamais un rayon de l’allégresse générale n’était venu illuminer cette froide
et soucieuse figure, et l’on n’avait recueilli de sa bouche que des paroles
ironiques et désolantes. Allons, disait-il
après la victoire de Léosthénès, voilà que nous
devenons conquérants ! Jamais il ne rechercha la popularité, qui est
une force, mais qui a perdu tant d’ambitieux : M’est-il
échappé quelque sottise ? demanda-t-il un jour que le peuple l’applaudissait.
Il ne flattait pas davantage les troupes qu’on lui donnait à conduire : Trop de capitaines, disait-il, et pas assez de soldats. Cependant Phocion était un
homme de bien ; il fut élu quarante-cinq fois général, sans l’avoir
sollicité, et il servit loyalement sa patrie, tout en grondant sans cesse;
dans l’occasion même, il battait ses amis les Macédoniens, comme il venait de
le faire à Marathon, où il avait rudement renvoyé à ses vaisseaux un corps
qui ravageait la plaine. On recourut encore à lui pour adoucir Antipater,
avec qui il était lié. Il ne refusa pas sa médiation, en disant toutefois, ce
qui n’était pas généreux, que si les Athéniens avaient suivi ses conseils,
ils n’eussent pas été réduits à solliciter ses services. Du vivant d’Alexandre,
il avait refusé 900 talents que le roi lui offrait et lui avait demandé en
échange la liberté de quatre Grecs retenus prisonniers à Sardes.
Démade était un bien autre homme. C’était le talent dans
la corruption. Riche d’une fortune mal acquise, il recevait de toutes mains
et l’avouait sans pudeur ; mais sa parole égalait presque celle de
Démosthène, et, au sentiment de quelques-uns, il le surpassait par la
soudaineté et l’entraînement. On le voyait proposer coup sur coup des mesures
illégales, se riant de la rigueur des lois avec l’impudente audace d’un homme
qui sait son ascendant sur le peuple et qui en use. II avait été si loin,
cependant, qu’on avait fini par le condamner, mais à une simple amende de 10
talents : dérision, si l’on considère sa richesse. Il est vrai que l’incapacité
politique y avait été jointe ; lui, peu soucieux de la honte, était
demeuré à Athènes, ne prenant plus part aux affaires publiques, mais vivant
avec un luxe effronté, dont l’argent macédonien faisait les frais. Dans le
danger présent, on lui rendit ses droits de citoyen; le premier usage qu’il
en fit fut de proposer un décret de mort contre Démosthène, dans une
assemblée où ce jour-là le parti macédonien vint seul. Il partit ensuite avec
Phocion pour aller trouver Antipater.
Le vainqueur traita les Athéniens comme naguère ils l’avaient
lui-même traité. Il établit pour base des négociations une soumission entière
et imposa trois conditions principales. Les Athéniens devaient livrer leurs
orateurs, y compris Hypéridès et Démosthène, réformer leur constitution sur
un plan tracé par le vainqueur, enfin recevoir une garnison macédonienne dans
Munychie. En outre, ils devaient payer les frais de la guerre.
Ces conditions furent acceptées. Elles étaient l’arrêt de
mort, non de Démosthène seulement, mais d’Athènes. En recevant une garnison
macédonienne, les Athéniens perdirent cette liberté d’action dont ils avaient
souvent mal usé, mais qui, chez un peuple, même dégénéré, est la seule
garantie qui reste d’un avenir meilleur, le seul moyen, le seul espoir de
réformes qui puissent un jour relever l’État. Ils s’habituèrent à courber la
tête et à fléchir le genou devant des maîtres; plus malheureux qu’au temps
des Trente, ils durent obéir, non plus à leurs concitoyens, mais à des
étrangers. Ce fut surtout la réforme introduite dans la constitution qui
altéra à jamais le caractère des Athéniens, en mutilant ce peuple réduit à la
plus faible partie de lui-même. Cette réforme ôtait les droits politiques à
quiconque ne possédait pas au moins 2000 drachmes. Il ne s’en trouva que neuf
mille dont la fortune égalât ou excédât ce chiffre. Ces 2000 drachmes s’entendaient
probablement des biens-fonds, de sorte que les artisans et les marchands, qui
vivaient de leur industrie et de leur commerce, demeurèrent en dehors des
neuf mille, sans former pour cela une foule famélique. Aux citoyens dégradés
de leurs droits, Antipater offrit des terres en Thrace, en Illyrie, sur les
côtes d’Italie et jusqu’en Afrique : beaucoup consentirent à les accepter, c’est-à-dire
furent bannis de l’Attique et déportés au loin. Quant
aux neuf mille, ils restèrent maîtres de la ville, ainsi que de son
territoire, et ils adoptèrent un mode de gouvernement conforme aux lois de
Solon[9].
Cette conformité aux lois de Solon n’était qu’un leurre. La démocratie était
brisée du coup ; Antipater savait bien ce qu’il faisait en dépeuplant la
cité qui avait eu tant d’héroïques folies, en livrant toutes choses à cette
minorité riche, qui, par haine des institutions nationales, avait si souvent
favorisé la domination étrangère. Athènes tombait du rang d’État souverain à
la condition d’une modeste commune s’administrant elle-même.
Restait à exécuter la clause par laquelle les orateurs
devaient être remis aux mains du vainqueur : après avoir désarmé le
peuple qui avait applaudi leurs paroles éloquentes, il fallait étouffer ces
voix dangereuses. Les proscrits s’étaient dispersés de divers côtés.
Antipater envoya, pour les prendre, des soldats conduits par un certain
Archias, ancien acteur tragique. Ayant trouvé à Égine l’orateur Hypéridès,
Aristonicos de Marathon, Eucratès et Himéréos, frère de Démétrius de Phalère,
qui s’étaient réfugiés dans le temple d’Éaque, il les en arracha et les
envoya à Cléones, où était Antipater, qui ordonna leur mort. On dit que,
contrairement aux coutumes des Grecs, il fit arracher la langue d’Hypéridès
avant qu’on le tuât et jeter ses restes aux chiens; d’autres disent que l’orateur,
mis à la torture, se coupa lui-même la langue.
Archias, informé que Démosthène s’était réfugié auprès du
temple de Neptune, à Calaurie, y passa : il voulut lui persuader de sortir de
son asile, et de venir trouver Antipater, l’assurant qu’il ne lui serait fait
aucun mal. Mais Démosthène rentra dans l’intérieur du temple, et, prenant ses
tablettes comme pour écrire, il porta le poinçon à sa bouche et le mordit : c’était
son habitude quand il composait ; il y avait caché un poison énergique.
Après l’avoir tenu quelque temps clans sa bouche, il se couvrit la tête de sa
robe. Les soldats qui étaient à la porte du temple se moquaient de lui et le
traitaient d’homme faible et lâche. Archias même s’approcha, l’engagea à se
lever, en lui répétant qu’il le réconcilierait avec Antipater. Quand Démosthène
sentit que le poison avait produit son effet, il se découvrit, et le regard
fixé sur Archias : Tu peux maintenant jouer le
rôle de Créon dans la tragédie et faire jeter ce corps aux chiens sans lui
accorder les honneurs de la sépulture ! Ô Neptune ! ajouta-t-il,
je sors vivant de ton temple ; mais Antipater
et les Macédoniens ne l’auront pas moins souillé par ma mort. Il
finissait à peine ces mots qu’il se sentit trembler et chanceler ; il
demanda qu’on le soutînt pour marcher ; et, comme il passait devant l’autel
du dieu, il tomba et mourut, en poussant un profond soupir. C’était le 16 du mois de pyanepsion (10 nov. 322), le
jour le plus triste et le plus funeste de la fête des Thesmophories, où les
femmes qui la célèbrent, assises à terre dans le temple de Cérès, jeûnent
jusqu’au soir.
Peu de temps après, le peuple athénien, rendant à sa
mémoire les honneurs qu’il méritait, lui fit dresser une statue de bronze, et
ordonna, par un décret, que l’aîné de sa famille serait à perpétuité nourri
dans le Prytanée, aux dépens du public. Ce décret, dont on croit avoir l’original,
portait en substance : Il a, dans les malheurs
publics ou la disette, donné à l’État 13 talents (prés de 70 000
francs) et trois trirèmes. Il a racheté des
citoyens prisonniers, fourni des armes à des citoyens pauvres, aidé de son
argent à réparer les remparts, à agrandir les fossés. Il a gagné de nombreux
alliés à Athènes et arrêté, par son éloquence et ses largesses, les
dispositions malveillantes des Péloponnésiens. Il a mieux défendu l’indépendance
nationale qu’aucun de ses contemporains ; et, banni par l’oligarchie,
quand le peuple eut perdu ses droits, il est mort sans rien faire qui fût
indigne d’Athènes. Sur le piédestal de sa statue on grava une épitaphe
dont le sens était : Démosthène, si ton
pouvoir eût égalé ton éloquence, la
Grèce aujourd’hui ne porterait pas des fers.
Tant qu’en Grèce on eut souvenir du passé, Démosthène y fut honoré presque à l’égal
des anciens héros. Un monument lui fut élevé à Calaurie, et aujourd’hui
encore, près du bourg de Pæanée, lieu de sa naissance, on voit un lion de
marbre brisé, avec ce reste d’inscription encastrée dans le mur de l’église :
οΰνεxα
πιστός έφυς, parce que tu as été fidèle. Il s’est peint
lui-même à la fin de son discours sur la Couronne, lorsqu’il
dit : Deux choses peuvent être exigées d’un honnête
homme : vouloir en politique la grandeur de son peuple et, en tout temps, en
toute circonstance, avoir au coeur un ardent amour pour son pays. Nous
qui avons aussi connu l’amertume de la défaite, honorons en lui le grand
patriote. Il a, durant trente années, combattu pour la liberté de son pays
et, après lui avoir donné sa vie, il lui donna sa mort, comme s’il eût voulu
dire encore une fois que, pour la patrie, il faut lutter jusqu’au sacrifice
suprême[10].
Démade ne jouit pas longtemps de sa triste victoire; comme
il était, en 520, dans la
Macédoine, pour négocier le retrait de la garnison
macédonienne de Munychie, on découvrit une lettre par laquelle il avait
invité Perdiccas à délivrer la
Grèce, qui ne tenait qu’à un fil à moitié pourri; c’est
ainsi qu’il désignait Antipater. Cassandre le fit égorger avec son fils.
Lycurgue était mort quelques années auparavant; Phocion ne survécut à la
chute de sa patrie que pour avoir bientôt, lui aussi, une fin misérable ;
Eschine vieillissait exilé, et ne revit jamais Athènes. Ainsi disparut
violemment cette génération d’hommes, les uns d’une vertu austère, les autres
profondément atteints par la corruption générale, tous d’ailleurs pleins de
génie, qui firent briller l’éloquence du plus grand éclat qu’elle ait jamais
jeté, et marquèrent à leur siècle une place peu éloignée de celui de
Périclès. Avec eux, avec Démosthène surtout, tomba, pour Athènes, non
seulement l’indépendance, mais la dignité; on verra cette cité, désormais
humble et servile, acclamer, avec une égale docilité, tous les vainqueurs et
tous les maitres. A ce prix, elle acquit la paix et elle échangea contre des
avantages matériels la gloire éclatante des siècles passés.
Les peuples de la
Grèce centrale et du Péloponnèse s’étaient tous soumis à l’arrêt
des armes. Dans les cités, où cela parut nécessaire, on modifia les
institutions au gré des Macédoniens, et l’autorité fut remise à leurs
partisans. Seul un peuple du Nord, plus rude et plus jeune, parce qu’il s’était
tenu à l’écart de la civilisation qui l’enveloppait, tint une conduite
différente. Réfugiés dans leurs montagnes et dans les villes fortes qui en
couronnaient les cimes, les Étoliens résistèrent, au milieu d’un hiver
rigoureux, aux forces bien supérieures queue Cratère, devenu le gendre d’Antipater,
mena contre eux. Les événements de l’Asie les délivrèrent, et ils furent
récompensés de leur courage par la conservation de leur indépendance.

III. Efforts des régents pour maintenir l’unité de l’empire ;
renversement de l’oligarchie en Grèce
Les rebelles, soit d’Asie, soit d’Europe, étaient ramenés
à l’obéissance, mais les ambitions rivales des généraux entraient en lutte.
On voit se produire alors un double fait qui, pendant quarante ans, se
renouvellera sans cesse : d’une part, les efforts d’un des généraux,
quel qu’il soit d’ailleurs, pour se faire l’héritier d’Alexandre;
de l’autre, la résistance de ses collègues, et les ligues qu’ils formeront
entre eux afin de ne point subir un maître. Ces ligues seront toujours
victorieuses; l’empire sera donc brisé. Tant que durera la famille d’Alexandre,
c’est auprès d’elle et à l’abri de l’ascendant qu’elle conserve sur les
Macédoniens que se placera le prétendant à l’empire universel; c’est-à-dire
que les régents successifs se transmettront cette prétention en même temps
que la tutelle. Mais quand cette famille aura été anéantie, ce sera simplement
le plus puissant, sans autre recommandation que sa puissance, qui héritera de
ce rôle.
Perdiccas tenta le premier de réaliser ces ambitieux
desseins. Il ne vit pas sans inquiétude ses anciens collègues jeter dans
leurs provinces les bases d’établissements durables. Ainsi Ptolémée s’affermissait
en Égypte. Ce général, que ses grands talents et la douceur de son caractère
rendaient propre à une telle entreprise, attirait autour de lui tous ceux qui
cherchaient un maître moins impérieux que Perdiccas. 8000 talents qu’il avait
trouvés dans les mains du trésorier Cléomène lui avaient fourni les moyens d’acquérir
une nombreuse armée de mercenaires. Déjà même il avait fait une conquête
importante vers l’Ouest, en ramenant à l’Égypte la Cyrénaïque, où un parti
l’avait appelé contre le Spartiate Thibron qui, assassin d’Harpalos et
héritier de ses mercenaires, surtout de son argent volé, avait cherché pour
lui-même dans la
Cyrénaïque un établissement royal. Enfin il avait placé son
gouvernement sous l’invocation des mânes d’Alexandre, en gardant dans
Alexandrie le corps du conquérant, que Perdiccas avait dirigé vers le temple
de Jupiter Ammon.
D’un autre côté, Antipater et Cratère, vainqueurs des
Grecs et unis par un mariage qui faisait de l’un le gendre de l’autre,
élevaient en Europe une puissance redoutable. Perdiccas, jusque-là en bonnes
relations avec Antipater, dont il devait épouser la fille, résolut de s’appuyer
plus encore sur la famille d’Alexandre, de s’y introduire même pour qu’elle
servit à ses desseins. Il venait d’éprouver ü ses dépens combien le sang du
conquérant exerçait d’empire sur l’armée. L’une des trois sœurs d’Alexandre,
Cynané, était par sa mère d’origine illyrienne, et intrépide comme cette race
de hardis montagnards. Le bruit des armes, les blessures, le sang, ne l’effrayaient
pas ; dans une action contre une peuplade ennemie, elle conduisit une
charge furieuse et tua de sa main la reine qui, elle aussi, menait les siens
au combat. Ambitieuse autant qu’Olympias, elle résolut de marier sa fille
Eurydice, aussi guerrière qu’elle-même, au roi Arrhidée et elle partit pour l’Asie,
en passant au travers des troupes d’Antipater et de Perdiccas qui voulaient l’arrêter.
Elle atteignit le camp des Macédoniens, qui reçurent avec de vives
acclamations cette fille du père d’Alexandre. Le régent, plus que jamais
inquiet, ne recula pas devant l’idée de verser un sang royal : il la fit
tuer. A cette nouvelle, l’armée, qui confondait sa plus glorieuse histoire
avec le souvenir de ses rois et le respect de leur race, se souleva, et elle
ne consentit à rentrer dans le devoir qu’à la condition qu’Eurydice serait
donnée pour épouse à Arrhidée. Perdiccas fut obligé d’y consentir, et trouva
dès lors des adversaires dans la nouvelle reine et dans son époux. Pour réparer
cet échec, il se mit secrètement en rapport avec Olympias, la vieille ennemie
d’Antipater, qui s’était réfugiée en Épire, et lui promit d’épouser
Cléopâtre, seconde sœur d’Alexandre.
Cette intrigue nouée, il en commença une autre. Il eût
voulu se défaire de ses rivaux un à un, et d’abord du gouverneur de la Phrygie qu’il
soupçonnait d’entretenir de secrètes relations avec Antipater, en vue de
former une coalition contre le régent. Il accusa auprès de l’armée Antigone,
et le cita à comparaître devant un tribunal impartial, disait-il, pour y
rendre compte de sa conduite indocile. Au lieu de comparaître, Antigone s’enfuit
en Grèce, où il jeta le premier cri d’alarme et suscita la première ligue.
Les chefs en furent Antipater, Ptolémée, Antigone et Cratère ; ce
dernier abandonna l’expédition commencée contre l’Étolie. C’était la
guerre ; Perdiccas l’accepta en renvoyant la fille d’Antipater pour
épouser Cléopâtre.
Ce mariage le rapprochait du but; car un vrai Macédonien,
de sang royal et de grande renommée, acquérait, en devenant le beau-frère du
conquérant, des droits sur son héritage qui balançaient ceux de l’enfant d’une
étrangère. Vrais tous les anciens chefs étaient contre lui, excepté un homme
dont le rôle mérite attention : Eumène de Cardie, en Thrace. Philippe avait
distingué de bonne heure en lui des qualités semblables aux siennes. Passé au
service d’Alexandre, Eumène était devenu son secrétaire, et, sans beaucoup de
bruit, il avait acquis une influence considérable. Il n’avait pas fait son
chemin par des actions d’éclat ; on le considérait comme plus propre aux
affaires qui s’écrivent qu’à celles qui se dénouent par l’épée. Il était
froid et rien moins que prodigue. Ses traits délicats et réguliers rendaient
bien la finesse de son esprit. A la mort du conquérant, il comprit l’extrême
réserve que son origine étrangère lui imposait et se tint à l’écart. On lui
donna cependant un gouvernement, la Paphlagonie et la Cappadoce ; mais
sa politique ne pouvait être celle des généraux que leur naissance ou leurs
exploits avaient mis en vue. Ce parvenu devait se rattacher à la famille
royale et aux régents. Dans le conflit qui se préparait il se prononça pour
Perdiccas, et fut chargé par lui de défendre l’Asie Mineure contre Cratère
qui arrivait de la
Macédoine et contre le satrape d’Arménie, Néoptolème, qui s’était
joint aux ennemis du régent.
Quand les deux armées se rencontrèrent, Eumène dépensa
beaucoup d’adresse pour ne pas mettre en présence de Cratère les Macédoniens,
tout prêts à se laisser séduire par cet ancien ami d’Alexandre. Il le fit
assaillir par un corps de barbares qui le surprirent, et, ne le connaissant
point, l’égorgèrent; à l’autre aile, il se prit corps à corps avec
Néoptolème, le renversa sous lui et le perça de deux coups d’épée.
Mais si la cause du régent triomphait en Asie, lui-même
périssait sur les bords du Nil. Il y avait trouvé un adversaire qui n’avait
rien épargné pour préparer la résistance et que les Macédoniens n’attaquaient
qu’à regret. Repoussé devant la petite forteresse appelée le Mur des Chameaux, Perdiccas s’avança plus
au sud et voulut franchir le Nil par un gué où l’eau était assez profonde
pour que ses soldats en eussent jusqu’aux épaules. Le gué s’étant creusé sous
les pieds des hommes et des chevaux, deux mille soldats et officiers périrent
entraînés dans le fleuve ou dévorés par les crocodiles accourus à cette
curée. L’armée, témoin de ce spectacle, fut exaspérée contre Perdiccas, dont
elle était déjà mécontente. Pithon, Antigénès, Séleucus et environ cent
autres conspirèrent contre lui, le surprirent dans sa tente et l’égorgèrent (321).
Les soldats de Perdiccas étaient, au contraire, si
contents de Ptolémée leur ennemi, qui venait de leur, envoyer pieusement les
cendres des morts arrachés au fleuve et aux crocodiles, qu’ils lui offrirent
la régence. Trop prudent pour échanger, contre les périls de cette position
suprême, le lot plus sûr et suffisamment riche qui lui était échu en partage,
il la refusa, et la fit accepter à Pithon, satrape de la Médie, et au général
Arrhidée. Au bout de quelque temps, ceux-ci à leur tour, entravés à chaque
pas par les intrigues d’Eurydice, s’en démirent et l’armée la donna à
Antipater (321).
Voilà donc un premier prétendant abattu et un nouveau
régent établi.
Il y avait un autre vaincu que Perdiccas : c’était l’empire.
L’idée d’une vaste domination, étendue de l’Indus à l’Adriatique, et
gouvernée par une seule volonté, au profit des Macédoniens, n’était point
perdue; l’armée, qui imposait encore sa volonté, en gardait le souvenir et
cherchait ce chef qui lui distribuerait les dépouilles du monde[11]. Mais la
dernière lutte avait accru, dans l’esprit des gouverneurs, l’espoir d’être
bientôt les maîtres de leurs provinces ; et ce sentiment était
inévitable en face d’une royauté qui, représentée par des enfants, n’avait
pas la force de contenir les ambitions subalternes. Antipater allait
recommencer l’histoire de Perdiccas, rêver comme lui l’autorité suprême et
mourir sans l’avoir consolidée.
Après les événements d’Égypte, il fallait rendre aux choses
la régularité apparente dont on venait de voir la fragilité. On fit à Trisparadisos,
ville de la Cœlésyrie,
une nouvelle distribution des provinces qui changea peu de chose aux
principales dispositions de la première. Antipater, Ptolémée, Lysimaque, Antigone,
conservaient leurs gouvernements; seulement la Babylonie était donnée
à Séleucus, qui allait y fonder un puissant État. De plus, Antipater confia
le commandement des anciennes troupes de Perdiccas à Antigone, avec ordre de
poursuivre Eumène : mais comme dans ces guerres civiles, et c’est là un
de leurs résultats déplorables, nul fond n’était à faire sur la foi et la
reconnaissance des hommes, Antipater tenait déjà Antigone pour suspect; afin
de le surveiller, il plaça à côté de lui son fils Cassandre, qu’il chargea du
commandement de la cavalerie.
Antigone se mit sur-le-champ à la poursuite d’Eumène, qui,
dans cette guerre, déploya toutes les ressources de son esprit. Vaincu par la
trahison de plusieurs de ses généraux, privé de l’appui des derniers partisans
de Perdiccas qu’Antigone avait accablés, réduit enfin à quelques soldats qu’épuisait
une guerre de tactique et de mouvements rapides, Eumène se décida à s’enfermer
avec sept cents hommes dans Nora, petite forteresse de Cappadoce, située sur
un rocher inexpugnable. Il y résista pendant un an à l’armée qui l’assiégeait,
refusant de traiter à moins qu’on ne lui rendît son gouvernement. Par d’ingénieux
stratagèmes, il entretenait la vigueur de ses hommes et de ses chevaux dans
cet étroit espace, et son activité soutenait toute la garnison.
Sur ces entrefaites, Antipater mourut (319) avant d’avoir
eu le temps d’alarmer les généraux et de donner lieu à une ligue nouvelle. On
vit alors, non sans surprise, la régence traitée comme une propriété et
léguée par Antipater à son ami le vieux Polysperchon, issu des rois d’un
petit pays de la Macédoine
orientale. Chose étrange, tous les généraux, excepté un, acceptèrent cette
disposition, et celui qui protesta fut le fils d’Antipater, Cassandre. A quel
titre ? Parce qu’il se crut dépouillé d’un droit héréditaire, bien qu’en
le nommant chiliarque, ou lieutenant du régent, son père lui eût donné la
seconde place dans le gouvernement. Il dissimula d’abord et feignit de ne
songer qu’aux plaisirs ; mais ses parties de chasse étaient des
complots, où il tramait avec ses amis le renversement du nouveau régent. Il
se mit secrètement en relation avec Ptolémée, qui avait épousé sa sœur, et
lui demanda d’envoyer dans l’Hellespont les forces maritimes que la conquête
de la Syrie
et de la Phénicie
sur Laomédon venait de donner à l’Égypte. Il correspondait aussi avec
Antigone et jetait les bases d’une seconde ligue.
Antigone était tout disposé à profiter de la faiblesse de
Polysperchon. Il ambitionnait de réunir sous ses lois toute l’Asie Mineure.
Mais cette entreprise voulait une prompte exécution, afin de devancer le
moment où Polysperchon serait en mesure d’y mettre obstacle. Il résolut de s’aider,
dans l’exécution, d’Eumène dont les talents venaient de se révéler, et il lui
envoya un de ses amis, Hiéronyme de Cardie, pour lui offrir la restitution
des provinces qui lui avaient été attribuées[12]. Le traité ne
mentionnait que pour la forme la famille d’Alexandre et engageait la fidélité
d’Eumène envers Antigone. Eumène feignit de considérer cette disposition
comme une inadvertance et changea les termes du traité de telle sorte qu’il s’engageait
non plus envers Antigone, mais envers la famille royale. Les Macédoniens qui
l’assiégeaient, toujours dévoués à cette maison, le laissèrent sortir de sa
forteresse. Dés qu’Antigone connut la fraude, il dépêcha sur-le-champ l’ordre
de serrer plus étroitement la place, mais il n’était plus temps : Eumène
courait déjà la campagne avec deux mille chevaux rassemblés de toutes parts.
Il avait en effet tout à perdre dans une alliance avec un prétendant et,
comme il s’était dévoué au régent Perdiccas, il se dévoua au régent Polysperchon
: s’attachant aux choses, non aux hommes ; à la royauté légitime qui lui
eût fait un sort brillant, non aux usurpateurs dont le premier soin eût été
de se débarrasser de lui ou de le reléguer à un rang obscur.
Pour combattre la ligue nouvelle, Polysperchon prit trois
moyens : se concilier la Grèce
en la rendant à la démocratie qu’Antipater avait abolie, et qui, par reconnaissance,
serait ennemie de Cassandre ; soutenir Eumène dans sa guerre contre
Antigone ; enfin rappeler Olympias de l’Épire, rassembler en Macédoine
toute la famille d’Alexandre pour en lier tous les membres à une même
politique, et peser, de tout le poids de leur influence réunie, sur les ambitions
rivales.
Il commença par adresser solennellement à la Grèce, au nom des rois, un
édit qui ordonnait le rappel des bannis de la cause démocratique et le
rétablissement des formes politiques qui existaient du temps de Philippe et d’Alexandre ;
il rendait même Samos à Athènes. Ce manifeste eut pour effet de produire,
contre les partisans d’Antipater, devenus ceux de son fils Cassandre, une
réaction immédiate ; particulièrement à Athènes contre les Neuf-Mille et
Phocion. Ces citoyens, exclus depuis 322 de la place publique, y rentrèrent
avec des sentiments de vengeance plutôt que de patriotisme, et le silence qui
régnait depuis plusieurs années dans les villes fut tout à coup changé en un
concert de discours furieux et de voix audacieuses, parmi lesquelles aucune
ne rappelait celle de Démosthène ou de Lycurgue. Phocion, dont la conduite
dans ces derniers temps avait été au moins imprudente, fut chargé, comme
stratège en fonction de défendre le Pirée, les arsenaux et la flotte contre
les entreprises de son ami Nicanor, qui commandait la garnison de Munychie.
Cet officier de Cassandre réussit à s’emparer du port d’Athènes, qu’il se
hâta d’isoler de la ville par une muraille. Pour les Athéniens, c’était le
coup le plus sensible. On s’en prit à Phocion qui n’avait rien prévu et
peut-être n’avait rien voulu prévoir. La démocratie renaissante lui inspirait
des craintes, et il ne se sentait pas en sûreté dans une ville qui allait
sans doute lui demander un compte sévère de sa conduite. Il s’enfuit avec
plusieurs de ses partisans dans le camp d’Alexandre, fils de Polysperchon,
qui l’envoya à son père. L’orateur Agonidès et quelques autres l’y suivirent,
comme accusateurs, au nom d’Athènes.
Polysperchon avait placé Arrhidée, entouré de ses
courtisans, sous un dais d’or. Devant ce tribunal, les Athéniens furent autorisés
à plaider leur cause. Comme ils parlaient tous en même temps, s’accusant les
uns les autres : Ô roi ! dit Agonidès, ordonnez qu’on nous enferme tous dans une cage et qu’on
nous renvoie à Athènes pour y rendre compte de notre conduite. Le
silence se rétablit et chacun prit à son tour la parole. Mais Polysperchon
fut d’une partialité révoltante contre Phocion : il l’interrompait à
chaque moment, et, frappant violemment la terre de son bâton, il le força
enfin de se taire. Hégémon, autre accusé, osa prendre Polysperchon lui-même à
témoin de son affection pour le peuple ; le régent s’emporta comme si on
l’eût offensé. Arrhidée, pauvre roi à ressorts, se leva à la voix de son
tuteur et voulut percer de sa lance l’insolent. Cet incident fit rompre l’assemblée,
et les accusés furent renvoyés à Athènes sous la conduite de Clitos, l’ancien
amiral d’Antipater, en apparence pour y être jugés,
dans le fait pour y recevoir la mort.
Plutarque, qui aime les beaux récits et n’aime pas la
foule populaire, dit que de l’assemblée qui eut à prononcer sur leur sort on
ne fit sortir ni les esclaves, ni les étrangers, ni les hommes notés d’infamie[13]. D’abord on lut la lettre du roi, qui déclarait tous les
prisonniers convaincus de trahison et en renvoyait le jugement aux Athéniens,
comme à un peuple libre. Lorsque Phocion entra, les bons citoyens, baissant
les yeux et se couvrant le visage, versèrent des larmes amères; un seul eut
le courage de se lever et de dire que, puisque le roi avait renvoyé au peuple
un jugement de cette importance, il était juste d’exclure du tribunal les étrangers
et les esclaves. Mais la populace rejeta hautement cette proposition et s’écria
qu’il fallait lapider ces partisans de l’oligarchie, ces ennemis du peuple.
Personne n’osa plus parler en faveur de Phocion, et lui-même ne parvint qu’avec
beaucoup de peine à se faire écouter : Athéniens, dit-il, est-ce
justement ou injustement que vous voulez nous faire mourir ? — C’est
justement, répondirent
quelques-uns. — Eh ! comment pourrez-vous en être sûrs, si
vous ne voulez pas nous entendre ? Mais, ne les voyant pas plus disposés
à l’écouter, il leur dit : Je confesse que je vous ai fait des injustices
dans le cours de mon administration ; et, pour les expier, je me condamne
moi-même à la mort. Mais ceux qui sont avec moi, pourquoi les feriez-vous
mourir, puisqu’ils ne vous ont fait aucun tort ? — Parce qu’ils
sont tes amis, répondit la populace. Agonidès lut le décret qu’il avait
préparé ; il portait que le peuple donnerait ses suffrages pour
prononcer si les accusés étaient coupables, et que, s’ils étaient déclarés
tels, ils seraient exécutés sur-le-champ. Quelques-uns voulaient encore que
Phocion fût appliqué à la torture avant d’être mis à mort ; et déjà ils
commandaient qu’on apportât la roue, qu’on fît venir les exécuteurs. Mais
Agonidès, voyant l’indignation que cette demande causait à Clitos, s’y opposa
: Quand nous aurons, dit-il, à punir un scélérat tel que Callimédon,
nous l’appliquerons à la torture ; contre Phocion je ne demande rien de
semblable. Alors un homme de bien s’écria : Tu as raison, car si nous
mettons Phocion à la torture, à quoi donc te condamnerons-nous ? Le
décret fut adopté, et lorsqu’on demanda les suffrages, ils furent tous pour
la mort (318).
L’assemblée congédiée, on
conduisit les cinq condamnés à la prison. Attendris par leurs parents et
leurs amis qui étaient venus les embrasser pour la dernière fois, ils
fondaient en larmes et déploraient leur infortune : Phocion seul conservait
le même visage que lorsque, sortant de l’assemblée pour aller commander les
troupes, il était reconduit avec honneur par les Athéniens. Ceux qui le
voyaient passer ne pouvaient s’empêcher d’admirer sa grandeur d’âme et son
impassibilité. Plusieurs de ses ennemis le suivaient en l’accablant d’injures ;
un d’eux vint même lui cracher au visage. Phocion, se tournant vers les
magistrats, leur dit d’un air tranquille : Personne ne réprimera-t-il l’indécence
de cet homme ? Quand ils furent dans la prison, Thudippos, à la vue
de la ciguë qu’on broyait, éclata en plaintes amères, disant que c’était bien
à tort qu’on le faisait mourir avec Phocion. Eh quoi ! repartit l’homme
de bien, n’est-ce pas une assez grande consolation pour toi que de mourir
avec Phocion ? Quelqu’un de ses amis lui demanda s’il n’avait
rien à faire dire à son fils Phocos : Sans doute ; j’ai à lui
recommander de ne conserver aucun ressentiment de l’injustice des Athéniens.
Nicoclès, le plus fidèle de ses amis, le pria de lui laisser boire la ciguë
le premier. Votre demande est bien dure et bien triste, répondit
Phocion ; mais, puisque je ne vous ai rien refusé pendant ma vie, je
vous accorde à ma mort cette dernière satisfaction. Quand tous eurent bu
la ciguë, elle manqua pour Phocion, et l’exécuteur déclara qu’il n’en
broierait point d’autre à moins qu’on ne lui donnât 12 drachmes, qui étaient
le prix de chaque dose. Comme cette difficulté causait quelque retard, Phocion
appela un de ses amis : Puisqu’on ne peut mourir gratis à Athènes, lui
dit-il, je vous prie de donner à cet homme l’argent qu’il demande.
C’était le 19 du mois de
munychion. Ce jour-là les chevaliers faisaient une procession à cheval en l’honneur
de Jupiter. Lorsqu’ils passèrent devant la prison, les uns ôtèrent leurs
couronnes; les autres, jetant les yeux sur la porte, ne purent retenir leurs
larmes ; les plus endurcis regardaient comme une impiété qu’on n’eût pas
renvoyé cette exécution au lendemain, afin que, dans une fête si solennelle,
la ville ne fût pas souillée par une mort violente. Les ennemis de Phocion
avaient fait décréter que son corps serait porté hors du territoire de l’Attique,
et que nul Athénien ne pourrait donner du feu pour faire ses funérailles.
Aucun de ses amis n’osa toucher à son corps ; un certain Conopion,
accoutumé à vivre du produit de ces sortes de fonctions, transporta le corps
au delà d’Éleusis, et le brûla avec du feu pris sur les terres de Mégare. Une
femme du pays, qui se trouva par hasard à ces funérailles avec ses esclaves,
lui éleva, dans le lieu même, un cénotaphe, y fit les libations d’usage, et
mettant dans sa robe les ossements qu’elle avait recueillis, elle les porta
la nuit dans sa maison et les enterra sous son foyer en disant : Ô
mon foyer, je dépose dans ton sein ces précieux restes d’un homme vertueux.
Conserve-les avec soin pour les rendre au tombeau de ses ancêtres, quand les Athéniens
seront revenus à la raison. Ce temps vint, avec le retour au pouvoir du
parti oligarchique, après l’occupation de la ville par Cassandre. Les os de Phocion
furent rapportés à Athènes, on lui éleva une statue de bronze, et le peuple
condamna à mort l’accusateur Agonidès ; deux autres tombèrent sous les
coups de son fils.
Plutarque, dont nous venons d’analyser le récit, est plus
favorable que de raison à son héros. Phocion, adversaire de la démocratie, a
eu le malheur d’être l’ami de tous les ennemis d’Athènes : de Philippe, d’Alexandre,
d’Antipater, en dernier lieu de Nicanor, qui venait de surprendre le Pirée,
et du fils de Polysperchon, qui l’avait envoyé à son père comme un de leurs
plus dévoués partisans. Il fut un grand homme peut-être, mais non un grand
citoyen. Sa fin fait oublier sa vertu revêche et cette politique désespérée
qui perd d’avance toutes les causes. Il sut bien mourir, c’est la plus belle
partie de sa gloire, mais cette gloire-là, Socrate et Démosthène la partagent
avec lui.
Dans la plupart des villes, de pareilles scènes eurent
lieu. L’oligarchie relevée par Antipater fut partout renversée et proscrite.
La faiblesse de Polysperchon était aussi meurtrière que l’ambition de
Cassandre ou celle d’Antigone.

IV. Ruine du parti royal et de la famille d’Alexandre
Tandis que le parti démocratique reprenait un instant le
dessus, soutenu qu’il était par Polysperchon, une flotte montée par Cassandre
et par des troupes qu’Antigone avait fournies, arrivait au Pirée. Le régent
se rapprocha au plus vite d’Athènes pour appuyer sa résistance, avec
vingt-cinq mille hommes et soixante-cinq éléphants ; mais, les vivres lui
manquant pour nourrir cette multitude au milieu d’un pays stérile, il laissa
dans l’Attique un détachement sous les ordres de son fils Alexandre, et passa
dans le Péloponnèse où Mégalopolis refusait de reconnaître son autorité.
Cette ville, dévouée à Philippe et à Alexandre, en qui elle avait eu des
protecteurs contre Sparte, s’était attachée aussi aux régents, prédécesseurs
de Polysperchon ; mais elle avait reçu d’Antipater un gouvernement
aristocratique qui fut assez fort, assez national, pour ne pas tomber au
moment où une révolution démocratique était provoquée dans toute la Grèce. Les habitants
des campagnes voisines accoururent dans ses murs ; et elle compta jusqu’à
quinze mille défenseurs, citoyens, étrangers ou esclaves. Damis, ancien
officier d’Alexandre, dirigeait la défense. Il se servit de tous les moyens
alors en usage dans les sièges. Il garnit le rempart de balistes et de
catapultes pour contrebattre les hautes tours remplies d’archers que l’ennemi
poussait vers la place ; il sema sur le glacis des chausse-trapes,
dissimulées sous un peu de terre ; et lorsque le mur, miné par les
Macédoniens, s’écroula, il construisit, en arrière de la brèche, dans l’espace
d’une nuit, une nouvelle muraille. En vain le régent poussa deux fois ses
troupes à l’assaut; dans la dernière tentative, les éléphants qui tenaient la
tête de la ligne, blessés par les pointes de fer sur lesquelles ils
marchaient, hurlèrent de douleur et, se rejetant en arrière, au travers de l’armée,
y causèrent un tel désordre qu’il fallut lever le siège.
Cependant de nouvelles forces arrivèrent de l’Asie au
secours de Cassandre; Clitos, chargé de les intercepter, remporta dans l’Hellespont
une victoire navale. Mais, tandis qu’il s’abandonnait à la confiance que lui
inspirait ce triomphe, Antigone, improvisant à la hâte une flotte nouvelle
avec des vaisseaux de charge, tomba subitement sur lui, et détruisit si
complètement la flotte royale, que Clitos seul échappa ; il périt, peu
de temps après, dans la
Thrace (octobre 318).
Ce désastre, ajouté à l’échec de Mégalopolis, ruina la
cause de Polysperchon en Grèce. Les Athéniens, sans port ni vaisseaux,
étaient comme l’abeille sans aiguillon : ils ne pouvaient se défendre ;
un traité avec Cassandre leur conserva la ville, son territoire, ses revenus,
sa flotte et quelques-unes de leurs possessions. La base du gouvernement
resta la même que dans la constitution d’Antipater, mais elle fut élargie par
la réduction du cens exigible pour prendre part au gouvernement, que l’on
ramena de 2000 drachmes à 1000. Cassandre gardait en outre une garnison dans
Munychie transformée en forteresse puissante, et était autorisé à désigner un
citoyen d’Athènes à qui serait confiée l’administration de la cité. Son choix
tomba sur Démétrius de Phalère, homme sage et modeste, ami des lettres et des
arts, qui gouverna les Athéniens pendant onze années, les plus paisibles,
mais non les plus honorables, de leur orageuse existence.
Vaincu en Grèce, Polysperchon ne fut pas beaucoup plus
heureux en Asie, quoiqu’il eût en ce pays pour lieutenant l’habile Eumène. L’ordre
avait été envoyé, de la part des rois, aux trésoriers royaux, en Cilicie, de
lui compter 500 talents comme indemnité personnelle, ainsi que tout l’argent
qu’il demanderait pour les affaires de l’État ; les trois mille
argyraspides, en garnison dans cette province, furent aussi placés sous son
commandement. Dans le même temps, Olympias lui écrivait comme au véritable
soutien de la famille royale, et lui demandait si elle devait retourner en
Macédoine : il lui conseilla de rester en Épire.
Sur Eumène semblait donc reposer tout l’avenir du parti
des rois. Mais la grande importance qu’il avait acquise n’aveuglait pas cet esprit
froid et prudent. Il se montra plus que jamais modeste et réservé. Il refusa
les 500 talents qui lui étaient offerts pour lui-même et tint aux
argyraspides des discours faits pour désarmer tout esprit de résistance à son
autorité. Il convenait qu’il n’était qu’un étranger, et qu’en cette qualité
il n’avait aucun droit d la puissance. Aussi n’avait-il pas sollicité le
fardeau que les rois lui imposaient, et qu’il acceptait par résignation,
malgré la faiblesse de sa santé usée par de pénibles campagnes. Il évita avec
soin de blesser la susceptibilité des officiers macédoniens ; il fit
même déposer dans la salle du conseil un trône d’or sur lequel étaient mis le
diadème, le sceptre et les autres ornements royaux, comme pour donner à l’ombre
d’Alexandre la présidence perpétuelle : reproche éloquent contre tous ces
généraux qui brûlaient de prendre la place de celui que nul n’égalait ;
symbole aussi de concorde et signe de ralliement offert à tous les
Macédoniens.
Eumène eut bientôt sous ses ordres une armée de quinze
mille hommes avec laquelle il s’empara de la Phénicie. Il y
trouva un grand nombre de vaisseaux qui lui formèrent une flotte pour se
mettre en communication avec Polysperchon. Mais c’était le moment où le
régent n’éprouvait plus que des revers en Europe, et Eumène se vit abandonné
à lui-même en Asie. Antigone et Ptolémée, inquiets de sa puissance, envoyèrent
des orateurs chargés de promesses aux argyraspides et à leurs chefs. Cette
troupe, l’élite et comme le noyau de l’armée d’Eumène, formait un des plus
admirables corps de vétérans qu’on eût jamais vus. Triés par la guerre, ils
ne connaissaient ni la maladie ni le péril, et, avec le sang-froid que
donnent l’âge et la longue expérience des combats, ils avaient l’audace des
plus jeunes, n’ayant jamais été vaincus. L’importance de ce corps aux boucliers d’argent était considérable
dans un temps où, par l’impuissance des institutions civiles, la force
militaire décidait toutes les questions. Mais les argyraspides, sans cesse
courtisés, étaient prêts à mettre leur courage à l’encan et à trouver que les
offres les plus brillantes étaient les meilleures. Déjà les séductions et les
menaces de Philotas, agent d’Antigone, les ébranlaient, lorsque Eumène se
montra. Toute son habileté fut nécessaire pour les retenir fidèles à la cause
royale ; et elle fut telle, qu’il parvint à leur inspirer, pour quelque temps
au moins, jusqu’à du dévouement à sa personne.
Sans espoir de secours du côté de l’Europe, et menacé sur
les bords de la
Méditerranée par les forces supérieures d’Antigone et de
Ptolémée, Eumène résolut d’aller chercher de l’argent et des soldats dans la
haute Asie. H entra en Mésopotamie, et invita Pithon, gouverneur de Médie,
Séleucus, gouverneur de Babylone, à se rallier à lui pour la défense des
rois. Ces deux généraux n’osèrent se déclarer ouvertement contre le
lieutenant du régent; mais, ce qui était à peu prés la même chose, ils
annoncèrent qu’ils n’obéiraient pas à Eumène, naguère proscrit par le conseil
des Macédoniens. Arrêté un moment par eux au passage du Tigre, il traversa le
fleuve de vive force, et trouva dans la Susiane la plupart des satrapes de la haute
Asie, ligués contre Pithon, qui avait fait périr un d’entre eux et prétendait
imposer aux autres sa suprématie. Peucestas, gouverneur de la Perside et le plus
habile des chefs de ces régions, était à la tête de cette ligue avec trois mille
fantassins exercés à la macédonienne, mille cavaliers, et il avait laissé
dans son gouvernement dix mille archers qu’il pouvait appeler à son aide. Les
autres satrapes étaient suivis de moindres troupes ; mais un d’eux,
Eudémos, avait amené de l’Inde cent vingt-cinq éléphants de guerre (317).
Dans cette circonstance encore il fallut à Eumène une
extrême adresse pour conjurer les discordes prêtes à éclater entre les
généraux et leur faire oublier son origine, qui affaiblissait en sa personne
l’autorité du commandement. Peucestas revendiqua pour lui-même la direction
suprême. Antigénès, chef des argyraspides, répondit que le choix du chef
appartenait aux seuls Macédoniens, eux aussi anciens compagnons d’Alexandre.
Eumène fit résoudre qu’il n’y aurait pas de commandant en chef et que tous
les satrapes délibéreraient en commun, à la majorité des voix, en présence du
trône d’Alexandre, comme dans une ville gouvernée
démocratiquement.
Antigone avait suivi Eumène ; Pithon et Séleucus s’étant
déclarés pour lui, il franchit le Tigre et arriva à Suse. L’autorité des
lettres royales, même dans les mains d’un étranger, était encore si grande,
que le gardien de la citadelle et des trésors qui s’y trouvaient refusa d’ouvrir
ses portes à Antigone, parce qu’Eumène le lui avait défendu au nom des rois.
Son adversaire continuant sa marche sur la Perside, Eumène lui tua quatre mille hommes
dans une rencontre et le rejeta sur la Médie. Mais, pour se défendre contre les
intrigues de ses alliés, surtout de Peucestas, il fut réduit à supposer des
lettres qui annonçaient la mort de Cassandre, le triomphe d’Olympias, le
passage de Polysperchon en Asie, et il profita de I’effroi jeté par ces
fausses nouvelles pour prendre quelques mesures énergiques qui étouffèrent
les prétentions ambitieuses.
Cependant Antigone revenait de la Médie avec de nouvelles
forces. Eumène alla à sa rencontre dans la Parétacène et lui
livra une première bataille sans résultat. Au printemps suivant (316), une action
décisive eut lieu. La victoire fut longtemps disputée : la trahison de
Peucestas, qui se retira avant la fin, avait d’abord compromis les affaires d’Eumène,
que les argyraspides rétablirent ; ils mirent en désordre l’infanterie d’Antigone,
et, selon Diodore, tuèrent cinq mille ennemis sans perdre un seul homme.
Mais, pendant le combat, Antigone, à la faveur d’une poussière épaisse, avait
fait tourner l’armée ennemie par un corps de cavalerie mède qui s’était
emparé des équipages. Quand les argyraspides apprirent que leurs femmes,
leurs enfants et leur butin étaient tombés au pouvoir de l’ennemi, ils
passèrent dans le camp du puissant satrape de la Phrygie et lui livrèrent
Eumène. Antigone fit périr ce fidèle soutien de la famille d’Alexandre,
égorger ses amis, brûler vif Antigénès, le chef des Argyraspides, et se
débarrassa de cette troupe indocile, en l’usant dans de petites expéditions
contre les peuples des provinces orientales.
En Europe, en Asie, la cause des rois était donc perdue,
et comme pour accélérer cette chute, la famille d’Alexandre s’était décimée
de ses propres mains.
Dans le parti des rois, il y avait deux factions ennemies,
celle d’Arrhidée dont le chef véritable était sa femme Eurydice, et celle du
jeune Alexandre, ce fils de Roxane, auquel s’était attaché Olympias. Le
premier était dans les mains de Polysperchon ; mais Eurydice, voyant
baisser le crédit et la puissance du vieux général, qui d’ailleurs, en ce
moment, se rapprochait d’Olympias, entra en relations avec Cassandre, alors
victorieux. Elle l’appela en Macédoine et, au nom de son époux, lui donna le
commandement des troupes royales. Polysperchon, directement menacé, alla
chercher Olympias en Épire : à la vue de la mère d’Alexandre, les soldats d’Eurydice
passèrent de son côté. Depuis longtemps Olympias haïssait le bâtard idiot, le
fils d’une danseuse thessalienne, et sa femme, l’Illyrienne qui prétendait
régner sur la
Macédoine. Elle les fit murer dans un cachot si étroit, qu’il
pouvait à peine contenir les deux captifs, et avec une seule ouverture, par
où on leur jetait quelque nourriture. Quand ce long supplice commença à
exciter la compassion des Macédoniens, Olympias fit tuer Arrhidée à coups de
flèches par des soldats thraces, puis elle commanda de présenter à la reine
une épée, un lacet et de la ciguë, c’est-à-dire le choix de la mort. Après
avoir appelé la vengeance des dieux sur son affreuse ennemie, et lavé, comme
elle le put, les blessures de son époux, Eurydice se pendit avec sa ceinture (317). D’autres
meurtres suivirent : un fils d’Antipater et cent des amis de Cassandre furent
immolés.
A ces nouvelles, celui-ci quitta le Péloponnèse, où il
tenait tête au fils de Polysperchon, et accourut en Macédoine. Olympias, qui
n’avait point d’armée, s’enferma dans Pydna avec Roxane et son fils, Thessalonice,
sœur d’Alexandre, et une cour nombreuse. Elle comptait sur Polysperchon et
sur Éacide, roi d’Épire, qui venait à son secours. Mais les soldats de
Polysperchon passèrent à Cassandre et les Épirotes, infidèles pour la
première fois aux descendants d’Achille, qui, croyait-on, régnaient depuis
des siècles sur les Molosses, prononcèrent la déchéance de leur roi et du
fils de ce prince, Pyrrhus, alors âgé de deux ans. Bloquée par terre et par
mer, sans espoir de délivrance, Olympias fit une résistance énergique, jusqu’au
moment où la garnison, réduite par la famine et les maladies, lui arracha la
permission de se rendre. Cassandre lui promit la vie sauve, mais suscita
contre elle les parents de ses victimes, qui l’accusèrent de différents
meurtres. Il lui fit passer l’avis secret et pressant de s’enfuir par mer,
dans le dessein de la faire périr au milieu des flots et de tout rejeter sur
la tempête. Elle déclara fièrement qu’elle ne fuirait pas et qu’elle était
prête à se présenter au jugement des Macédoniens. Cassandre n’osa tenter cette
épreuve et envoya deux cents soldats pour la tuer. Quand ils arrivèrent, elle
leur parut si imposante, vêtue de sa robe royale, et debout, appuyée sur deux
de ses femmes, que, saisis de respect, ils se retirèrent. Les parents de ceux
qu’elle avait tués n’eurent pas ces scrupules ; ils vinrent l’égorger, mais
ne lui arrachèrent pas une marque de faiblesse (316).
Cassandre eût bien voulu se débarrasser en même temps de
Roxane et de son fils. Il les éloigna d’abord de la vue des Macédoniens et les
enferma, sous une garde sûre, dans la citadelle d’Amphipolis. Pour se frayer
à lui-même le passage au trône, il épousa Thessalonice, sœur du
conquérant ; et, jouant d’avance le rôle de roi, bâtit, au fond du golfe
Thermaïque, une ville nouvelle, Cassandrea, qui devint vite importante.
Durant ces tragédies, Polysperchon s’était retiré chez les
Étoliens, qui envoyèrent un corps garder les Thermopyles. Cassandre força le
passage, et, arrivé en Béotie, releva Thèbes pour gagner un renom de
clémence. Toute la Grèce
contribua à la restauration de cette ville ; de l’argent fut même envoyé
de la Sicile
et de l’Italie. A Athènes, le peuple s’était couronné de fleurs à la nouvelle
que cette antique rivale allait sortir de ses ruines. Voilà de ces mouvements
de coeur qui font beaucoup pardonner au peuple grec, parce qu’il est le seul
dans l’antiquité chez qui on les trouve. Cassandre débarqua ensuite dans le
Péloponnèse, força Argos et Hermione à entrer dans son parti, mais échoua
contre Ithome en Messénie. Il ne resta plus à Polysperchon et à son fils
Alexandre que l’Achaïe, Sicyone et Corinthe. Sparte, l’Étolie et l’Arcadie,
seules en Grèce, demeuraient indépendantes (316) ; la première, sentant bien que le
temps de sa fière insouciance du péril était passé, venait de s’entourer de
murailles.
|