|
I. Alexandre et Aristote ; destruction de Thèbes (333)
 Alexandre ne pouvait échapper aux faiseurs de légendes. On dit que Philippe étant à Samothrace, dans sa première
jeunesse, y fut initié aux mystères, avec Olympias, alors enfant, et
orpheline de père et de mère. Il en devint épris, et plus tard ayant obtenu
le consentement d’Arymbas, frère de cette princesse, il l’épousa. La nuit qui
précéda celle de leur entrée dans la chambre nuptiale, Olympias songea qu’à
la suite d’un coup de tonnerre la foudre était tombée sur elle et avait
allumé un grand feu, qui, après s’être divisé en plusieurs traits de flamme,
se dissipa promptement. » Ce prodige serait bien l’image de la vie d’Alexandre
et de cette puissance qui devait s’élever si vite, éblouir le monde, et sitôt
disparaître. On disait donc que Jupiter, était le vrai père d’Alexandre, qui,
déjà, descendait des dieux et des héros : d’Hercule, par Caranos, et d’Achille,
par Olympias[2].
Il vint au monde le 29
juillet 356, le jour même où le temple de Diane, à Éphèse, fut
brûlé par Érostrate. Alexandre ne pouvait échapper aux faiseurs de légendes. On dit que Philippe étant à Samothrace, dans sa première
jeunesse, y fut initié aux mystères, avec Olympias, alors enfant, et
orpheline de père et de mère. Il en devint épris, et plus tard ayant obtenu
le consentement d’Arymbas, frère de cette princesse, il l’épousa. La nuit qui
précéda celle de leur entrée dans la chambre nuptiale, Olympias songea qu’à
la suite d’un coup de tonnerre la foudre était tombée sur elle et avait
allumé un grand feu, qui, après s’être divisé en plusieurs traits de flamme,
se dissipa promptement. » Ce prodige serait bien l’image de la vie d’Alexandre
et de cette puissance qui devait s’élever si vite, éblouir le monde, et sitôt
disparaître. On disait donc que Jupiter, était le vrai père d’Alexandre, qui,
déjà, descendait des dieux et des héros : d’Hercule, par Caranos, et d’Achille,
par Olympias[2].
Il vint au monde le 29
juillet 356, le jour même où le temple de Diane, à Éphèse, fut
brûlé par Érostrate.
Alexandre avait ce que les Grecs regardaient comme un don
des dieux, la beauté : ses yeux étaient doux et limpides, sa peau très
blanche, et il inclinait légèrement la tête sur l’épaule gauche. Les grands
traits de son caractère se montrèrent dès l’enfance dans les petites choses. Il
était encore aux mains de son premier précepteur, Léonidas, qui l’élevait
dans les sévères habitudes des Spartiates, lorsqu’un jour, sacrifiant aux
dieux, il jeta l’encens à pleine poignée. Attendez,
lui dit le parcimonieux mentor, attendez, pour faire
de telles offrandes, que vous possédiez le pays où croît l’encens.
Plus tard, maître de l’Asie, Alexandre envoya à Léonidas 100 talents pesant d’aromates,
en l’invitant à ne plus être chiche avec les dieux.
Quand on amena à la cour le cheval Bucéphale, que lui seul
put réduire, il émerveilla ceux qui furent témoins de son audace, et Philippe
le saisissant dans ses bras s’écria : Cherche un
autre royaume, ô mon fils, le mien n’est pas assez grand pour toi !
C’était dire beaucoup pour un cheval dompté, si cette scène est authentique,
mais il est certain qu’Alexandre révéla de bonne heure les dispositions
héroïques de son âme impétueuse.
Elles furent augmentées par un autre précepteur, l’Acarnanien
Lysimachos, qui lui donna le goût d’Homère et qui comparait Philippe à Pélée,
Alexandre à Achille. Achille devint le modèle de celui qui devait laisser
bien loin derrière lui le héros de la vaillance. Comme Achille, Alexandre
excellait à la course et dans les exercices du corps ; mais, quand on
lui demanda s’il disputerait le prix à Olympie : Oui,
dit-il, si pour rivaux j’y devais trouver des rois.
Comme lui, il jouait de la lyre, même de tous les instruments, sauf de la
flûte. Il savait par cœur l’Iliade et une partie de l’Odyssée.
Pindare et Stésichore étaient, avec Homère, ses poètes favoris. La musique
exerçait sur lui un grand empire : un jour qu’on chantait, avec
accompagnement musical, un hymne guerrier, il bondit et saisit ses armes[3].
Il eut un autre maître illustre, Aristote. Le plus savant
et le plus profond des philosophes de l’antiquité n’eut point de répugnance à
se charger de l’éducation d’un fils de roi. Il avait étudié toutes les formes
de gouvernement ; il les admettait toutes, lorsqu’elles étaient d’accord
avec les circonstances de temps et de lieux. Mais, pour la Grèce de son époque, il
croyait que les constitutions républicaines désorganisaient l’État, en
laissant trop libre carrière aux factions ; que la tyrannie, sortie de
la faveur populaire, courait toujours le risque d’aboutir à la violence,
tandis que la royauté, fondée sur un vieux droit héréditaire, était capable
de maintenir la justice, de réprimer l’insolence et de garantir la sécurité
des biens et des personnes.
Aristote n’avait donc pas besoin d’être gagné à la cause
de la royauté, mais il fallait former l’homme dans le prince en cultivant
dans son esprit les dispositions sérieuses : elles ne manquaient pas. Encore
enfant, Alexandre avait étonné les ambassadeurs perses en les questionnant
sur les routes, les distances, les forces de l’empire du grand roi. Aristote
lui apprit, dit-on, beaucoup de sciences : la politiqué, la morale, même l’éloquence,
qui ne s’enseigne pas, mais qui se règle. Médecin, comme son père Nicomachos,
il lui inspira du goût pour la médecine, si bien qu’Alexandre pratiqua
quelquefois cet art sur ses amis et ses soldats, quoiqu’il n’ait pas su en
profiter pour lui-même. On ajoute qu’il l’initia à ses plus profondes
spéculations et qu’à la nouvelle qu’il venait de les publier, Alexandre, qui
voulait en tout être au-dessus des autres hommes, lui reprocha de n’avoir pas
réservé pour eux seuls les mystères de la science.
Je ne sais tout ce qu’Aristote apprit à son royal
disciple, car Alexandre ne fut que durant trois Alexandre jeune ou quatre
années son élève, et le quitta avant sa dix-septième année[4] ; mais ce
dont je suis sûr, c’est que le philosophe agrandit et éleva son esprit, qu’il
lui ouvrit des horizons immenses, qu’il augmenta en lui la soif des grandes
choses, dans la paix comme dans la guerre. Le philosophe qui voulait tout
savoir et tout régler fut le digne maître du roi qui voulut tout conquérir
pour tout renouveler. Cependant quand nous verrons Alexandre concevoir de si
hautes et si libérales pensées pour l’ordonnance de son empire, nous nous
souviendrons quel était, pour Aristote, l’idéal d’un État : un petit nombre
de citoyens servis par des esclaves. Sur ce point l’élève est plus grand que
le maître.
Quand Philippe mourut, en 336, Alexandre était à peine âgé
de vingt ans. Néanmoins il avait déjà fait ses preuves : quatre années
auparavant, régent du royaume, tandis que son père assiégeait Périnthe et
Byzance, il avait vaincu des tribus thraces révoltées et, à Chéronée, on
avait remarqué son courage. Les circonstances de son avènement étaient des
plus difficiles : à l’intérieur et à l’extérieur, tout l’édifice élevé par
son père chancelait. Mais Alexandre avait pour lui les soldats charmés de sa
brillante valeur, le peuple gagné par ses largesses, et mieux que tout cela,
son génie[5].
Son premier soin fut de se débarrasser des complices réels
ou supposés de Pausanias. On enveloppa aussi dans un complot Amyntas, ce fils
de Perdiccas à qui Philippe avait pris la couronne, et il fut mis à mort.
Aussitôt que Philippe était tombé, Olympias s’était vengée de ses affronts
sur Cléopâtre et son fils. Elle tua l’enfant dans les bras de sa mère, et
força celle-ci à se pendre avec sa propre ceinture. L’oncle de Cléopâtre
commandait un corps macédonien en Asie, Alexandre n’attendit qu’une occasion
favorable pour se débarrasser de lui. Ces exécutions étaient des garanties
pour le nouveau roi, mais plusieurs aussi d’atroces injustices. Alexandre
oubliera ainsi quelquefois Alexandre, pour montrer le roi barbare.
Cependant la
Grèce s’agitait : Athènes et, dans Athènes, Démosthène
avaient donné le signal. Le grand orateur était en deuil de sa fille morte
depuis sept jours, quand un courrier secret lui annonça le meurtre de
Philippe. II prend des vêtements blancs, se couronne de fleurs, et court
annoncer aux Cinq-Cents que les dieux lui ont révélé par un songe la mort du
Macédonien. Bientôt la nouvelle se confirme, et Démosthène, malgré Phocion,
fait décerner une couronne à l’assassin. C’étaient deux mauvaises choses à la
fois une ruse inutile, et une offense à la moralité publique. Mais, d’abord,
le récit du prétendu songe est d’Eschine, un ennemi, par conséquent suspect[6] ; ensuite il
faut bien reconnaître qu’en montrant la joie que cet assassinat lui causait,
Démosthène ne blessait ni la moralité de son temps ni celle de l’antiquité
tout entière, qui honorait Harmodios et Timoléon comme des héros, et qui ne
craignait pas de dire par la bouche du sage Polybe : Le meurtre d’un tyran est un titre de gloire[7].
Aussitôt des émissaires partent d’Athènes, et Démosthène
sème l’or persan et la révolte. Argos, l’Arcadie, l’Élide, rejettent la
suprématie macédonienne. Thèbes renverse son gouvernement oligarchique et
attaque la Cadmée,
encore tenue par les troupes que Philippe y a mises ; Sparte sort de son
immobilité et cherche des alliés ; les Étoliens offrent des secours aux
bannis des Acarnaniens ; les Ambraciotes chassent les garnisons
macédoniennes; Démosthène, enfin, négocie la révolte du général qui
commandait l’armée envoyée par Philippe en Asie.
Au milieu de cette effervescence, Alexandre paraît et
déconcerte tout par sa rapidité. Une armée formidable le suit. Il gagne les
Thessaliens, convoque aux Thermopyles les amphictyons, qui reconnaissent sa
suprématie, promet aux Ambraciotes l’autonomie, et se montre tout à coup sous
les murs de Thèbes, qui se tait, frappée d’effroi. Athènes lui députe des
ambassadeurs, parmi lesquels on mit Démosthène, qui, soit crainte, soit
pudeur, ne se serait pas avancé au delà du Cithéron, et elle lui vote deux
couronnes d’or, une de plus qu’elle n’en avait décerné à Pausanias[8]. Enfin Alexandre
convoqua dans Corinthe l’assemblée générale de l’Hellade, même les
Spartiates, qui répondirent avec plus de dignité que de prudence : Notre habitude est de conduire les autres et non pas de
les suivre. Sans doute Alexandre sourit en entendant ces théâtrales
paroles. Mais Sparte n’était plus qu’un souvenir ; il le respecta, afin
de n’être pas détourné un seul instant de sa grande affaire. L’assemblée le
nomma chef suprême des Grecs dans la guerre contre les Perses. Quant à
Attale, il l’avait fait assassiner (336).
Un homme étonna cependant le jeune victorieux. On conte qu’à
Corinthe Alexandre alla voir Diogène dans son tonneau. Que veux-tu de moi ? demanda-t-il au
philosophe. — Que tu t’ôtes de mon soleil !
Sur quoi le prince aurait dit à ceux qui l’accompagnaient : Si je n’étais Alexandre, je voudrais être Diogène.
Ce n’est pas probable ; mais il est vrai qu’il n’y a que deux moyens de
se mettre au-dessus de la fortune : par le dédain ou par la force, et le
premier est le plus sûr[9].
Puisque nous en sommes aux mots historiques, qui,
peut-être, ne le furent jamais, disons encore qu’Alexandre, venu à Delphes à
une époque de l’année où le dieu du soleil s’éloignait de son temple assombri
par l’hiver, voulut, malgré l’absence d’Apollon, consulter l’oracle. La Pythie s’y refusant, il
la saisit et, de force, il la menait à l’antre prophétique, quand elle s’écria
: Ô mon fils, tu es irrésistible !
Alexandre, à ces mots, s’arrête ; il avait reçu l’oracle qu’il
souhaitait. Les Grecs avaient trop d’esprit pour n’en pas prêter à ceux qu’ils
faisaient parler. Je ne garantis pas l’authenticité de tous les mots à effet
qu’ils ont mis dans la bouche de Philippe, d’Alexandre et de tant d’autres.
Ils aimaient à jeter ces fleurs légères, au milieu de la grave histoire, pour
en atténuer la sévérité, et ils y ont réussi.
En quelques semaines, Alexandre avait tout pacifié au sud
de son empire; mais au nord les peuples barbares remuaient. Il courut de ce
côté, arriva en dix jours au pied de l’Hémos (Balkan), qu’il franchit, malgré la
résistance des Thraces indépendants, et battit complètement les Triballes,
dont les débris s’enfuirent dans l’île de Peucé, sur le Danube, où, malgré
quelques vaisseaux qu’il avait fait venir de Byzance, il ne put les forcer.
Il passa audacieusement le grand fleuve et détruisit une ville des Gètes,
qui, effrayés, reculèrent dans la profondeur de leurs déserts ; mais il
ne resta qu’un jour sur la rive gauche ; c’était assez pour que le bruit
de cet exploit répandit au loin la crainte de ses armes. Il relut des
ambassades de plusieurs peuples de ces régions, même des Celtes, voisins du
golfe Adriatique. Que craignez-vous ?
demanda à ceux-ci le jeune conquérant, qui attendait un hommage à sa valeur. —
Que le ciel ne tombe, dirent ils. — Les Celtes sont fiers, répliqua Alexandre. Il leur
donna pourtant le titre d’alliés et d’amis ; puis s’éloigna des rives du
Danube, où il avait établi le respect de son nom, et alla le porter à l’ouest
chez les Illyriens, tribus vaillantes, mais barbares, qui sacrifièrent avant
le combat trois jeunes gens, trois jeunes filles et trois béliers noirs.
Alexandre venait de faire le tour de ses États, en battant
sur son passage les peuples environnants. Il apprend tout à coup que, sur le
bruit mensonger de sa mort chez les barbares, les bannis sont rentrés dans
Thèbes, qu’ils ont surpris et égorgé un des chefs de la garnison
macédonienne, mais que la
Cadmée tient encore.
En treize jours, il arrive en Béotie avec trente-trois
mille hommes. Les Phocidiens et les habitants de Thespies, d’Orchomène et de
Platée, ennemis héréditaires de la grande cité béotienne qui leur avait fait
un sort si dur, étaient accourus à la curée. Démosthène
m’appelait un enfant quand j’étais chez les Triballes, dit Alexandre, et jeune homme quand j’arrivai en Thessalie ; je lui
montrerai sous les murs d’Athènes que je suis un homme. Il chercha
pourtant à éviter l’effusion du sang, et laissa aux Thébains le temps de
revenir à la soumission. Ils répondirent par une proclamation où ils appelaient
à eux tout homme qui voudrait, avec l’aide du grand
roi, travailler à rendre la liberté aux Grecs et à renverser le tyran de la
patrie. Quoiqu’ils n’eussent point reçu les secours qu’Athènes leur
avait votés sur la proposition de Démosthène, ni ceux de l’Élide et de l’Arcadie,
qui s’arrêtèrent à l’isthme de Corinthe, ils présentèrent la bataille aux
Macédoniens en avant de leurs murs. La lutte fut acharnée et longtemps
indécise. Alexandre, ayant aperçu une poterne laissée sans gardes, lança de
ce côté Perdiccas avec une troupe d’élite. A la vue de leur ville ouverte à l’ennemi,
les Thébains rentrèrent précipitamment ; mais la garnison de la Cadmée fit une sortie, et
ils furent enveloppés. Il n’y avait plus à combattre pour vaincre, ni même
pour se sauver; du moins ils moururent en gens de coeur. Aucun ne demanda
quartier. Pendant tout le jour on tua. Plus de six mille Thébains périrent :
trente mille furent pris.
Thèbes allait avoir le sort qu’elle avait infligé à
Platée, qu’elle avait demandé pour Athènes. Elle n’avait pas de grand et
noble souvenir qui pût la sauver. Dans le conseil des alliés on n’en rappela
qu’un, c’est qu’elle avait été mise jadis au ban de la Grèce pour son alliance
impie avec Xerxès. Le décret suivant fut rendu : La
ville de Thèbes sera détruite de fond en comble ; les captifs seront
vendus à l’enchère ; les fugitifs seront arrêtés partout où on les
trouvera, et aucun Grec ne pourra recevoir un Thébain sous son toit.
Orchomène et Platée seront rebâties. En conséquence de ce décret, dicté
par une haine séculaire plutôt que par la récente victoire, Alexandre fit
raser la ville, moins la
Cadmée où il mit garnison et la maison de Pindare, dont le
génie plaisait au sien. Il laissa libres les prêtres, ceux qui avaient des
liens d’hospitalité avec ses Macédoniens, et une noble Thébaine, Timocléia,
qu’un de ses officiers avait outragée. Comme celui-ci exigeait encore qu’elle
lui révélât le lieu où ses trésors étaient cachés, elle l’avait mené à un
puits, lui disant : Ils sont là ; et
après qu’il y fut descendu, elle l’y avait tué à coups de pierres ; le
roi lui donna raison. Le reste de la population fut vendu aux enchères, qui
produisirent 400 talents d’argent (2.495.000 francs ; c’était 83 francs seulement par tête[10]) ; enfin le
territoire thébain fut partagé entre les alliés d’Alexandre (automne 555).
Une des plus vieilles cités de l’Hellade était donc
détruite; d’antiques légendes, chères au génie hellénique, ne savaient plus
où se placer, et certains dieux perdaient leurs honneurs accoutumés. C’était
une mutilation de la Grèce
qui laissait de la tristesse dans les coeurs et de la crainte dans l’esprit
de ceux qui redoutaient le courroux des divinités poliades. Aussi, moins de
trente ans après, Cassandre, un des successeurs d’Alexandre, rebâtira la cité
de Dionysos et des Labdacides.
Pour le moment, cette terrible exécution jeta l’effroi
dans la Grèce,
et de toutes parts affluèrent les marques de soumission et de repentir.
Athènes elle-même envoya féliciter le conquérant sur son heureux retour.
Alexandre, en réponse, demanda que neuf de ses ennemis lui fussent livrés.
Cette proscription est, pour les patriotes qu’elle frappait, un titre d’honneur.
Leurs noms méritent d’être conservés : c’étaient Démosthène, Lycurgue,
Hypéridés, Polyeucte, Charès, Charidèmos, Éphialtès, Diotimos et Héroclés.
Les Athéniens hésitèrent en face de cette lâcheté, et Démosthène leur conta
la fable du loup qui demandait aux brebis de lui livrer leurs chiens. L’honnête
Phocion exhortait les victimes à se dévouer pour le salut public ;
ajoutons qu’il eût fait, sans hésiter, ce qu’il demandait aux autres. La
circonstance était grave : Alexandre n’en avait pas d’abord exigé
davantage des Thébains Athènes cependant résista, et Démade proposa un décret
habilement rédigé, qui, tout en renfermant la résolution de ne pas livrer les
orateurs, promettait de les punir suivant la rigueur des lois, s’ils étaient
jugés coupables. Il fut chargé de le faire agréer par Alexandre. L’heure de
la colère était passée; le roi trouvait déjà qu’il y avait eu assez de sang
versé à Thèbes. Démade réussit; il obtint même pour Athènes la permission de
recevoir quelques Thébains fugitifs. Mais Éphialtès et Charidèmos, les deux
chefs militaires du parti, furent contraints de s’exiler. Alexandre retrouvera
le premier en Asie, à Halicarnasse, où le proscrit arrêtera un moment la
fortune du conquérant.
Bien sûr désormais de la Grèce, Alexandre revint en Macédoine. Il y
rassembla le conseil des chefs de son armée, pour les consulter sur l’expédition
d’Asie, ou plutôt pour leur exposer ses projets et ses plans. Il les enflamma
par ses discours, et la guerre étant résolue, il offrit de magnifiques
sacrifices aux dieux, dans la ville de Dion, dans celle d’Ægées, et il
célébra des jeux scéniques en l’honneur de Jupiter et des Muses, selon les
rites institués anciennement par Archélaos. Des repas splendides, donnés aux
généraux macédoniens et aux envoyés de la Grèce, des fêtes magnifiques à l’armée entière,
précédèrent le départ de l’expédition et les longues fatigues que tous
ensemble allaient partager.
Mais nous sommes en Macédoine ; la politique de l’Orient,
qui compte la vie pour si peu, y domine ; il nous faut donc mentionner
une autre précaution prise par Alexandre avant son départ : il fit tuer les
parents de sa belle-mère Cléopâtre et tous ceux des siens qu’il lui sembla
dangereux de laisser en arrière. Les grands hommes sont comme les grands
chênes : ceux-ci tiennent par leurs racines au sol qui les porte, comme
ceux-là, par certains côtés du caractère, aux mœurs et à la société d’où ils
sont sortis.

II. Situation de l’empire Perse ; bataille du Granique (334) ;
conquête de l’Asie-Mineure (333)
L’empire qu’Alexandre allait attaquer était depuis bien
longtemps prés de sa ruine. La retraite des Dix Mille avait révélé sa
faiblesse; et depuis cette expédition, que de secousses, sans parler de l’entreprise
d’Agésilas, avaient ébranlé cet empire caduc ! En premier lieu, la
révolte d’Évagoras, qui s’étant rendu indépendant à Salamine, en Chypre, s’allia
avec le roi d’Égypte, Acoris, et résista aux forces du grand roi, même après
que celui-ci, par le traité d’Antalcidas, eut fait reconnaître
des Grecs ses droits à la possession de Chypre. Battu d’abord,
Évagoras se releva, grâce aux divisions des satrapes qui commandaient l’armée
ennemie, et se rit, au bout de dix ans, reconnaître comme prince souverain (385). Tout l’empire
avait, encore une fois, luttée en vain contre un seul homme et une seule
ville.
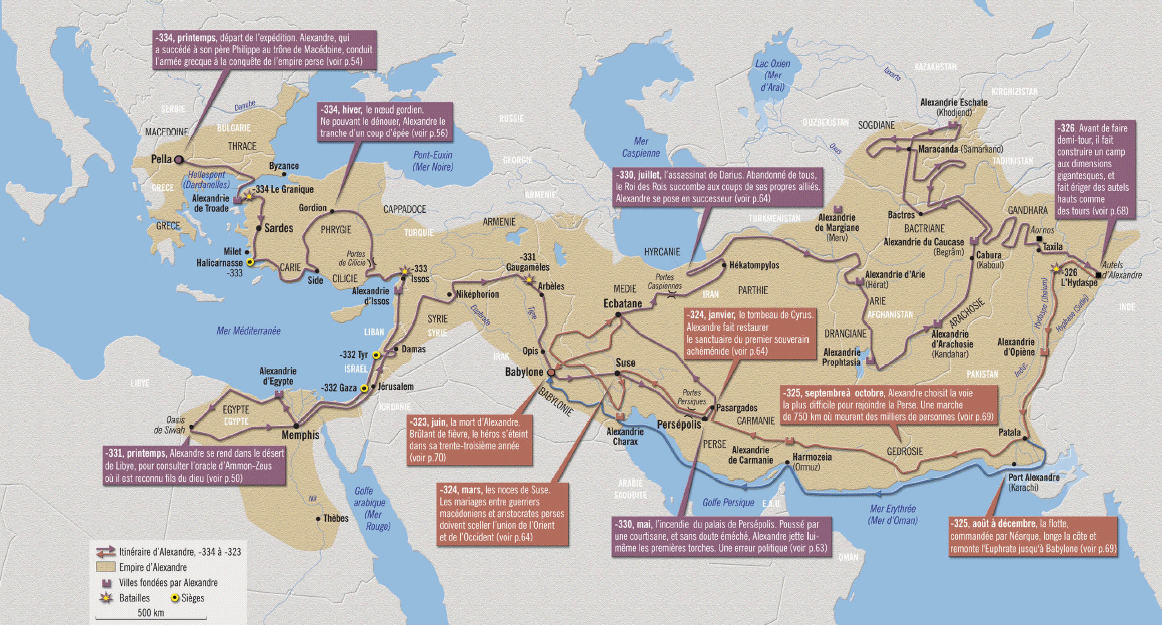
Une autre guerre, celle d’Egypte, ne finit pas mieux. Cette
province avait, depuis l’an 411, ses rois particuliers. En 386 Acoris y
régnait depuis six années ; Artaxerxés le fit attaquer en même temps qu’Évagoras,
avec aussi peu de succès. Menacé de nouveau en 377, Acoris prit à sa solde l’Athénien
Chabrias, que, sur la plainte du roi, Athènes rappela. Pharnabaze, chargé de
réduire l’Égypte avec deux cent mille hommes et vingt mille Grecs
auxiliaires, obtint qu’Iphicrate vint commander sous lui. Quand le général
athénien arriva, les vingt mille Grecs n’étaient pas encore réunis : Quoi ! dit-il à Pharnabaze, vos paroles et vos actions sont-elles si peu d’accord ? — Je suis maître de mes paroles, répondit le satrape,
mais mes actions dépendent du roi. Souvent
ainsi les ordres inintelligents et despotiques de celui qu’on appelait l’homme semblable aux dieux paralysaient l’action
des généraux. Le retard qu’avaient éprouvé les levées fit échouer l’expédition.
En 362, ce fut l’Asie Mineure presque entière qui faillit
se détacher de l’empire. Le satrape de Phrygie, Ariobarzane, qui possédait
Périnthe, sur la
Propontide, et les deux rives de l’Hellespont, s’était
révolté contre son maître et, pour obtenir l’alliance des Athéniens, il leur
avait cédé Sestos, la huche du Pirée[11], avec une partie
de la Chersonèse.
Sous prétexte de le faire rentrer dans le devoir, les
satrapes de Lydie et de Cappadoce et Mausole, prince de Carie, avaient
attaqué Adramytte et la forte place d’Assos, qui s’étaient déclarées pour
lui; en réalité, ils voulaient profiter, eux aussi, de la vieillesse d’Artaxerxés
Memnon et des troubles du palais, pour se rendre indépendants. Dans le même
temps, les Phéniciens remuèrent, et toute la partie occidentale de l’empire
sembla perdue. La trahison rompit le lien des coalisés ; mais Datame,
satrape de Cappadoce, se défendit longtemps, et ne succomba que sous le
poignard d’un assassin. Quelques années plus tard, en 550, Artabaze, satrape
révolté de Phrygie, s’enfuit en Macédoine, auprès de Philippe, auquel sans
doute il apporta d’utiles renseignements.
La fin du règne d’Artaxerxés fut troublée par des
conspirations domestiques et des assassinats. Ochus, son fils, monté par
cette voie sur le trône en 558, fit périr ses cent dix-huit frères et tous
ceux de ses parents qui lui portaient ombrage. Il eut à combattre une ligue
des petits rois phéniciens d’Arados, de Tyr et de Sidon. Cette ligue fut
dissoute par la trahison ; les Sidoniens brûlèrent eux-mêmes leur ville
où le vainqueur ne trouva que quarante mille cadavres ; Chypre aussi
succomba, malgré huit mille mercenaires que Phocion y avait amenés. Pour
achever cette reconstruction de l’empire, Ochus attaqua l’Égypte, où Agésilas
avait fait roi Nectanébos. Il prit à son service dix mille Grecs de Thèbes, d’Argos
et d’Asie Mineure ; Nectanébos en avait vingt mille. Placés en face les
uns des autres, dans des querelles étrangères, les mercenaires s’entendaient
et s’épargnaient, comme les condottieri italiens du quinzième siècle, et les
guerres étaient sans fin, à moins que l’or ne décidât la victoire, en
déterminant la défection d’une de ces troupes vers l’autre. Ochus, plus
heureux que ses prédécesseurs, réduisit l’Égypte, mais il blessa profondément
ses sentiments religieux en pillant les sépultures et les temples : comme
Cambyse, il tua le boeuf Apis (344). Devenu odieux, même aux Perses, il fut empoisonné par l’eunuque
Bagoas qui mit à sa place le plus jeune fils de sa victime, Arsès. Au bout de
trois ans, Arsès périt de la même main avec tous ses frères, vers le temps où
mourait Philippe de Macédoine, et l’eunuque éleva au trône Codoman, neveu d’Artaxerxés
II, qui prit le nom de Darius. Le nouveau prince mit fin à ces meurtres, en
faisant boire à Bagoas le poison que ce meurtrier de rois lui avait à son
tour préparé.
Ce rapide tableau montre l’empire des Perses mal joint
dans ses parties; formé de peuples indifférents au sort du grand roi ;
ébranlé au centre par les meurtres et les intrigues, aux extrémités par les
révoltes ; livré à un despotisme violent, aux caprices des mercenaires
qu’il prend à sa solde, aux rivalités des satrapes, dont beaucoup sont
héréditaires; ne se soutenant enfin contre tant de secousses et de causes de
déchirement que par les divisions de ses ennemis, les trahisons suscitées
chez eux, les assassinats, ou l’emploi temporaire de soldats achetés. La
puissance qui allait attaquer cet empire ne donnait aucune prise à ces moyens
bas et odieux et avait le pouvoir d’entraver beaucoup, sinon d’empêcher les
levées de Grecs mercenaires. Enfin, le grand roi avait bien encore d’innombrables
multitudes à opposer aux Macédoniens, mais ces Asiatiques n’avaient rien
appris de leurs défaites : ils avaient gardé l’habitude de combattre sans
ordre et de loin, avec des armes de jet, tactique qui, malgré leur nombre, ne
pouvait prévaloir contre une troupe docile à ses chefs, accoutumée aux
évolutions militaires et formée à combattre de près. Il n’y avait alors d’armées
redoutables que celles-là, et c’est pourquoi Ies hoplites grecs d’abord, la
phalange d’Alexandre ensuite, enfin la légion romaine, ont passé partout.
Au commencement du printemps de l’année 334, Alexandre
partit de Pella pour aller porter à Suse et à Persépolis la réponse de la Grèce aux guerres
Médiques. En vingt jours il arriva à Sestos, où l’armée passa le détroit.
Elle se composait, en infanterie, de douze mille Macédoniens, parmi lesquels
se trouvaient deux corps d’élite, les Hypaspistes et les Argyraspides, aux
boucliers d’argent, de sept mille alliés et de cinq mille mercenaires soldés,
tous sous le commandement de Parménion. Cette infanterie régulière était
suivie de cinq mille Odryses, Triballes ou Illyriens et de mille archers
agrianes, ce qui formait un ensemble de trente mille fantassins. La
cavalerie, très supérieure en nombre, proportionnellement à celle qu’on
trouvait d’habitude dans les armées helléniques, et commandée par Philotas,
fils de Parménion, comptait quatre mille cinq cents chevaux, savoir quinze
cents Macédoniens, et parmi eux les Hétaires ou compagnons du roi, fournis
par la noblesse macédonienne, quinze cents Thessaliens, six cents cavaliers
grecs et neuf cents coureurs thraces ou péoniens. Pour la flotte, Alexandre
avait réuni cent soixante trirèmes, dont vingt athéniennes et quantité de
vaisseaux de charge. L’artillerie, balistes et catapultes, qui allait être
employée dans les sièges et les batailles, suivait l’armée[12]. Alexandre avait
laissé en Europe douze mille hommes d’infanterie et quinze cents chevaux sous
les ordres d’Antipater, dont il eut soin d’emmener les trois fils avec lui[13]. Il avait
distribué à ses amis tous ses biens, et sa caisse militaire était vide[14] : Que gardez-vous donc ? lui dit Perdiccas. — L’espérance ! Les Perses avaient une flotte de
quatre cents navires de guerre montés par les marins expérimentés de la Phénicie, de Chypre et
de l’Égypte. Un fort habile homme, qui connaissait bien la Grèce et avait déjà rendu
de signalés services à l’empire, jusqu’à battre en Asie le corps macédonien
expédié par Philippe, Memnon, de Rhodes, voulait qu’on disputât le passage de
la mer. Alexandre ne trouva pas dans l’Hellespont une barque armée contre
lui.
Pendant la traversée, il immola un taureau, et fit, avec
une coupe d’or, des libations à Neptune et aux Néréides. Arrivé à portée de
la côte, il y lança son javelot, comme pour en prendre possession, et sauta
le premier à terre. Ce lieu était voisin des ruines de Troie; il s’y rendit,
offrit des sacrifices à Pallas, et suspendit ses armes dans le temple de la
déesse; en échange, il prit celles qu’on y avait consacrées et, dans les
batailles, quelques-uns de ses gardes les portèrent toujours auprès de lui.
Il sacrifia aussi à Priam pour apaiser le ressentiment de son ombre contre la
race de Néoptolème, à laquelle les rois macédoniens appartenaient. Ainsi le
verra-t-on partout sacrifiant aux dieux, consultant les oracles et pratiquant
les cérémonies de tous les cultes. Chez le disciple d’Aristote, était-ce
croyance, était-ce politique? L’une et l’autre à la fois. Ici, c’était
surtout un hommage rendu par sa vive et poétique imagination, pleine des
souvenirs d’Homère, aux brillantes fictions de la mythologie grecque.
Alexandre couronna le tombeau d’Achille, Éphestion celui de Patrocle. Heureux Achille, s’écria le prince, d’avoir eu Homère pour chantre de ta gloire !
L’armée persique était réunie derrière le Granique, petit
fleuve de la Troade
qui descend de l’Ida et se jette dans la Propontide, à l’ouest
de Cyzique. Memnon, de Rhodes, héritier de la satrapie de son frère Mentor
dans l’orient de l’Asie Mineure, avait proposé de faire un désert devant
Alexandre, et de le harceler incessamment, sans engager d’action, tandis que
la flotte ferait sur ses derrières une diversion puissante en Macédoine et en
Grèce. Je ne souffrirai point, s’était écrié
Arsitès, satrape de Phrygie, que l’on brûle une
seule habitation où je commande. Le conseil du Rhodien était bon, mais
difficile à exécuter. Les Perses ne pouvaient tout détruire et reculer
toujours. Les soldats d’Alexandre ont d’ailleurs montré que le désert ne les
effrayait pas. Il est vrai qu’au moment où ils le franchirent si allégrement,
ils avaient, derrière eux, trois victoires, et, devant, I’espoir d’un immense
butin.
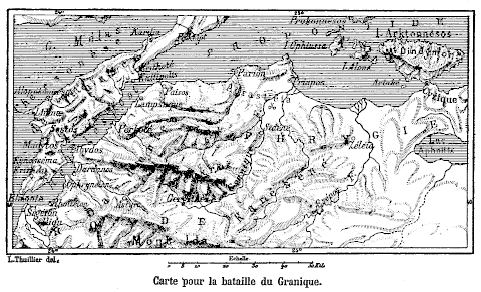
Les Perses avaient, selon Arrien, vingt mille chevaux, et
à leur solde presque autant d’étrangers qui composaient la meilleure part de
leur infanterie ; selon Diodore, dix mille cavaliers et cent mille
fantassins. La cavalerie était rangée le long du cours d’eau, et l’infanterie
en arrière, sur une éminence. Alexandre se jeta des premiers dans le fleuve,
à la tête d’un corps d’élite. Cette avant-garde engage, en abordant, une
lutte sanglante. Elle est d’abord repoussée à cause de la nature du terrain
escarpé et glissant. Dans un choc, la lance d’Alexandre
se rompt ; il veut prendre celle de son écuyer Arès : Cherchez-en
d’autres, dit Arès en lui montrant le tronçon de la sienne, avec lequel
il faisait encore des prodiges. Le Corinthien Démarate, un des Hétaires,
donne sa lance au roi, qui court à Mithridate, gendre de Darius, et le
renverse d’une blessure au visage. Un Perse lui décharge sur la tête un
violent coup de cimeterre que le casque amortit : Alexandre le perce d’outre
en outre. Un autre allait le frapper par derrière, et levait déjà le bras :
Clitus le lui coupe d’un seul coup près de l’épaule. Cependant les
Macédoniens passaient le fleuve en foule et rejoignaient leur roi. Les
Perses, enfoncés parla cavalerie, percés par les hommes de trait qui étaient
mêlés dans ses rangs, commencèrent à fuir. Dès que leur centre plia, les deux
ailes étant déjà renversées, la déroute de cette première ligne fut complète;
Alexandre poussa aussitôt vers l’infanterie, restée à son poste. La phalange
et la cavalerie chargèrent à la fois : en peu de moments tout fut tué ou s’enfuit.
Beaucoup s’échappèrent en se cachant sous les cadavres; deux mille tombèrent
vivants au pouvoir du vainqueur...
Du côté des Macédoniens il périt,
dans le premier choc, vingt-cinq hétaires. Alexandre leur fit élever, à Dion,
des statues d’airain de la main de Lysippe. Le reste de sa cavalerie ne
perdit guère plus de soixante hommes, et l’infanterie trente; Alexandre les
fit ensevelir avec leurs armes, et exempta leurs pères et leurs enfants de
tout impôt. Il eut le plus grand soin des blessés, les visitant, examinant
les plaies, et leur donnant toute liberté de l’entretenir de leurs exploits.
Il accorda aussi les derniers honneurs aux généraux perses, même à ceux des
Grecs à leur solde qui avaient péri; mais il fit mettre aux fers les
mercenaires pris vivants, et les envoya en Macédoine pour être esclaves,
parce que, violant le décret rendu par l’assemblée de Corinthe, ils
avaient combattu contre la
Grèce, en faveur des barbares. Il offrit à Athènes
trois cents trophées des dépouilles des Perses, pour être consacrés dans le
temple de Minerve, avec cette inscription : Sur les barbares de l’Asie,
Alexandre et les Grecs, à l’exception des Lacédémoniens. (Arrien)
Le roi mit aussitôt la main sur la Phrygie sans aggraver l’impôt
de la province, et marcha vers le sud. En Lydie, il rendit à Sardes et au
pays entier leurs vieilles lois. A Éphèse, il remplaça l’oligarchie par la
démocratie et donna au temple de Diane, pour les constructions qui restaient
à faire, le tribut que les Éphésiens payaient aux barbares ; il sacrifia
plusieurs fois à la déesse ainsi vengée et il étendit le droit d’asile
reconnu à son sanctuaire jusqu’à un stade de l’édifice. Plus tard, il offrit
de se charger de l’achèvement du temple à condition que son nom y serait
gravé, comme celui du fondateur : les Éphésiens refusèrent. Cependant des
corps détachés allaient recevoir la soumission des villes d’Éolide, d’Ionie,
celle de Magnésie, de Tralles, etc., rétablissant partout les constitutions
libres, et remettant le tribut payé aux Perses, par respect pour le nom
hellénique, mais aussi pour gagner l’utile alliance des Grecs asiatiques.
A partir d’Éphèse, Alexandre longea la côte. La vie, la
richesse et la force de l’Asie Mineure étaient sur les bords : il fallait les
y saisir, achever de réunir le monde hellénique sous le protectorat macédonien,
en y faisant entrer les Grecs asiatiques, enfin, intercepter à l’or et aux
intrigues de la Perse,
l’accès de la Grèce,
en fermant les portes qui y conduisaient. La première ville qui l’arrêta fut
Milet. Il en fit le siège. Nicanor se plaça avec cent soixante vaisseaux
macédoniens à l’entrée du port, des deux côtés de l’île de Lada, pour couper
aux habitants toute communication avec la flotte persique de quatre cents
navires, qui arrivait enfin, mais le trouva trop fortement établi pour
essayer de forcer le passage. Grâce à cette mesure et à la vivacité des
attaques, la ville fut bientôt prise.
Malgré les services que sa flotte venait de lui rendre,
Alexandre renonça à s’en servir davantage, soit manque de fonds pour payer
les équipages, soit bien plutôt qu’il se fiât médiocrement à ces vaisseaux,
ramassés de tous côtés, sur lesquels il ne pouvait mettre sa phalange et que
montaient des hommes dont il avait raison de suspecter la fidélité. Le
conquérant ne voulait pas remettre sa fortune en des mains si peu sûres. On
verra plus loin qu’il trouva un autre moyen d’annuler et de prendre la flotte
ennemie. Il ne conserva que quelques bâtiments pour le transport des machines
de guerre, et particulièrement les vingt galères athéniennes.
Memnon s’était jeté avec le banni athénien Éphialtès, dans
Halicarnasse de Carie, capitale du satrape Rhoontopatès[15]. Il s’y défendit
bravement, et n’abandonna la place qu’en la livrant aux flammes. L’hiver
approchant, Alexandre renvoya en Macédoine ses soldats nouveaux mariés, qui s’engagèrent
à revenir au printemps avec ceux qu’aurait gagnés le récit de leurs exploits,
des richesses de l’Asie,
et de la libéralité du conquérant. La Lycie, la Pamphylie
successivement soumises, il remonta vers le nord par la Pisidie, jusqu’à la
petite Phrygie, pour établir sa domination dans le centre de la péninsule et
son influence dans les satrapies du Nord-Est. A Gordion, au fond d’une gorge
que remplissaient des ruines d’un âge inconnu, il trouva le tombeau du roi
Midas et son char considéré comme un symbole de domination. D’un coup d’épée,
il trancha le nœud gordien, et crut avoir accompli l’oracle qui promettait l’empire
de l’Asie à qui saurait le dénouer (mars 555). De là, il redescendit par Ancyre et la Cappadoce, jusqu’au
Taurus. Cette montagne enveloppe la Cilicie d’une barrière insurmontable, excepté
en deux points qu’une poignée d’hommes pourrait défendre ; ni l’un ni l’autre
n’était gardé et Alexandre gagna sans peine le littoral de la mer de Chypre.
Il avait donc traversé trois fois, du nord au sud et du sud au nord, puis en
revenant au midi, cette
large péninsule, de manière à n’y laisser aucun foyer de résistance.
Cependant des dangers sérieux le menaçaient encore sur ses
derrières. Les Perses conservaient l’empire de la mer, et Memnon, à la tête
de leur flotte, voulait débarquer en Grèce et reporter la guerre chez les
agresseurs. Il commença par agir sur les îles pour avoir des points d’appui,
s’empara de Chios, soumit presque tout Lesbos, et mit le siège devant
Mytilène ; il allait s’en rendre maître, quand une maladie l’emporta. L’empire
perdit avec lui son seul soutien. Ses successeurs prirent bien Mytilène,
Ténédos et Cos, mais s’arrêtèrent là, ordre leur étant venu d’envoyer à l’armée
royale les Grecs mercenaires qu’ils avaient à bord de la flotte.
Darius appelait alors du fond de l’Asie toutes les forces
de l’empire. Cinq à six cent mille hommes se réunirent autour de lui dans les
plaines de la Mésopotamie[16], et en voyant
cette foule immense, sa confiance fut sans bornes, comme semblait l’être son
pouvoir. Ses courtisans accrurent encore cet orgueil par leurs flatteries
serviles. Un exilé athénien, Charidèmos, reconnaissant dans cette cohue celle
de Xerxès, laissa seul percer des craintes et conseilla au roi de se fier
plutôt à ses trésors et aux Grecs mercenaires. On se récria contre cette
insulte faite aux Perses et à leur courage. Le roi exaspéré saisit lui-même
Charidèmos et le livra à ses gardes. Vous
reconnaîtrez trop tard, disait l’Athénien en marchant à la mort, la vérité de mes paroles ; la main de mon vengeur est
déjà sur vous.
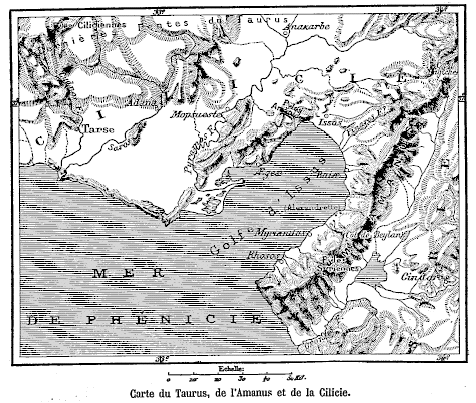
Darius n’avait rien fait depuis le Granique pour sauver l’Asie-Mineure ;
il se résolut à défendre la
Syrie et avança avec son immense armée jusqu’au mont Amanus
qui la couvre. Il s’était établi d’abord dans les vastes plaines de Sochos, à
deux jours de marche des montagnes ; comme il ne vit pas venir
Alexandre, il se persuada que son approche seule avait effrayé le Macédonien
et, traversant les portes Amaniques, il se dirigea sur le golfe d’Issus par
des lieux coupés de collines, fort mal choisis pour sa cavalerie, laquelle,
du reste, ne fit pas mieux à Arbèles, sur un terrain contraire. Ce sol
tourmenté ne convenait pas davantage à la phalange, mais entre les deux
adversaires la nature du champ de bataille importait peu : les Perses
devaient être vaincus partout où ils rencontreraient Alexandre, et il n’y
avait qu’une voie de salut pour eux, c’était de ne le point rencontrer ;
de profiter, par exemple, de la barrière presque inexpugnable du Taurus ou de
l’Amanus, pour en fermer vigoureusement les passages, tandis que l’or et la
flotte perses agiraient en Grèce. Mais auprès du grand roi se trouvaient des
gens de coeur, et Darius lui-même en était[17], comme ceux qui
s’étaient si bravement fait tuer au Granique, et il ne leur convenait point
de refuser le combat.
Alexandre, avant franchi sans y trouver un ennemi les
défilés du Taurus, était descendu dans la plaine cilicienne ; il y fut
arrêté à Tarse par une maladie qui compromit sa vie et faillit changer le
sort du monde. On dit que, tout échauffé et couvert de sueur, il s’était jeté
imprudemment dans les froides eaux du Cydnus ; saisi, à la suite de
cette imprudence, d’une forte fièvre, il devint si malade qu’on désespéra de
sa vie. Un Acarnanien, le médecin Philippe, ami du roi, tenta de le sauver,
en lui préparant un breuvage qui devait agir violemment. Alexandre reçut au
même moment une lettre de Parménion, qui l’avertissait de se méfier du
médecin, vendu aux Perses. Darius avait récemment promis à un des généraux d’Alexandre,
en échange de la vie du roi, 100 talents et le trône de Macédoine. Le complot
avait été découvert, un autre pouvait être ourdi. Alexandre n’en voulut rien
croire, et d’une main présentant à Philippe la lettre qui l’accusait, de l’autre
il porta la coupe à ses lèvres et la vida d’un trait, montrant ainsi, avec un
courage plus rare que celui du champ de bataille, sa confiance en ses amis et
sa foi dans la vertu.

III. Bataille d’Issus (29 novembre 333) ; conquête de
l’Asie ; prise de Tyr (août 332) ; occupation de
l’Égypte ; bataille d’Arbèles (2 octobre 331)
Rendu à la santé, il courut, en soumettant la Cilicie, au-devant de
Darius. On entre de Cilicie dans les pays du bassin de l’Euphrate par deux
gorges qui ouvrent le mont Amanus; l’une au sud, appelée les Pyles ou portes
de Syrie, l’autre au nord, les Pyles Amaniques. Les deux adversaires allant à
la rencontre l’un de l’autre franchirent en même temps ces passages : les
Macédoniens, celui du sud, ce qui les conduisit en Syrie; les Perses, celui
du nord, ce qui les mena à Issus où Alexandre avait laissé ses malades. Alors
il arriva que, quand Alexandre revint sur ses pas pour combattre, les armées
se trouvèrent dans une position inverse de celle qu’elles auraient dû avoir,
Darius tournant le dos à la
Grèce, comme s’il en venait, et les Macédoniens à la Perse, comme s’ils étaient
chargés d’en défendre les approches.
Le choc eut lieu sur les bords du petit fleuve Pinaros,
qui se jette dans le golfe d’Issus. Darius appuya son aile droite au rivage
de la mer, et y porta presque toute sa cavalerie. Sur sa gauche, il fit
passer le fleuve à trente mille hommes de cavalerie et à vingt mille de
trait, dans le dessein de tourner l’armée ennemie. Au centre, il défendit par
des palissades les points les plus abordables du fleuve, et opposa à la
phalange macédonienne trente mille Grecs et soixante mille Carduques
pesamment armés. Le reste de ses troupes forma en arrière une masse épaisse
et inutile. Alexandre appuya aussi sa droite aux montagnes, de manière à
déborder la gauche ennemie, sa gauche à la mer, pour n’être pas tourné, et s’avança
lentement, de peur qu’une marche trop rapide ne mît du désordre dans sa
phalange. Parvenus à la portée du trait, ceux qui l’entouraient et lui-même
coururent à toute bride vers le fleuve, pour en venir aux mains plus tôt et
se garantir ainsi des flèches. L’ennemi céda bien vite; mais, dans ce
mouvement précipité, une partie seulement des Macédoniens suivit le roi, le
reste ayant rompu ses rangs au passage du fleuve, les Grecs, à la solde de
Darius, saisirent ce moment pour tomber sur la phalange entr’ouverte. Le
combat fut acharné. Ptolémée, fils de Séleucus, et cent vingt Macédoniens de
distinction y furent tués. Pendant cette lutte au bord du fleuve, l’aile droite
avait renversé tout ce qui était devant elle ; elle se tourna alors contre
les Grecs, les prit de flanc, et en fit un horrible carnage. La cavalerie
perse avait elle-même passé le fleuve, et tombant à toute bride sur les
Thessaliens, combattit vaillamment, jusqu’à ce qu’elle vit son infanterie et
les Grecs taillés en pièces. Alors la déroute fut générale ; et comme
cette immense multitude se précipita à la fois vers les défilés, il en périt
une foule, écrasés sous les pieds des chevaux.
Dès que Darius avait vu son aile gauche enfoncée, il s’était
sauvé sur un char qu’il ne quitta point, tant qu’il courut à travers la
plaine. Arrivé dans des gorges difficiles, il abandonna son bouclier, sa robe
de pourpre, son arc même, et s’enfuit à cheval. La nuit, qui survint, le
déroba à l’ardente poursuite du vainqueur, entre les mains duquel son char
tomba. Alexandre l’eût pris lui-même, si, avant de courir aux fuyards, il n’eût
attendu prudemment le rétablissement de sa phalange ébranlée, la défaite des
Grecs et la déroute de la cavalerie perse. On évalua à cent mille le nombre
des morts ; on traversa, en effet, des ravins qui avaient été comblés
par les cadavres. La perte des Macédoniens fut seulement de trois cents
fantassins et de cent cinquante cavaliers (29 novembre 333)[18].
Dans le camp de Darius, on trouva
sa mère, sa femme, sa sœur, son fils jeune encore, deux de ses filles,
quelques femmes des principaux de son armée et, seulement, 3000 talents, le
trésor royal avec tous les bagages ayant été conduit à Damas ;
Parménion, aussitôt envoyé dans cette ville, l’y saisit. Le lendemain
Alexandre, quoique souffrant d’une blessure qu’il avait reçue à la cuisse,
visita les blessés, ordonna l’inhumation des morts, avec pompe, en présence
de son armée rangée en bataille, dans le plus grand appareil, et fit l’éloge
des actions héroïques dont il avait été témoin ou que la voix générale de l’armée
publiait. Chacun de ceux qui s’étaient distingués reçut des largesses selon
son mérite et son rang ; Balacros, un des gardes, fut nommé satrape de
Cilicie...
Quelques historiens rapportent qu’Alexandre,
après la poursuite, étant entré dans la tente de Darius, qu’on lui avait
réservée, entendit des cris de femmes et des gémissements sortir des
appartements voisins. Il demande pourquoi ces cris, et quelles sont ces
femmes. On lui répond que la mère de Darius, la reine et ses enfants,
apprenant que l’arc du roi, son bouclier, son manteau, sont au pouvoir du
vainqueur, ne doutent plus de sa mort et le pleurent. Il leur envoie aussitôt
un des hétaires, pour leur annoncer que Darius est vivant, et que les Grecs
ne possèdent que les dépouilles laissées par lui sur son char. L’envoyé
ajoute que le vainqueur leur conserve les honneurs, l’état et le nom de
reines, attendu qu’il n’a pas entrepris la guerre contre Darius par haine
personnelle, mais pour lui disputer l’empire de l’Asie. Le lendemain
Alexandre entra dans l’appartement des femmes, accompagné du seul Éphestion.
La mère de Darius ne sachant quel était le roi, car nulle marque ne le distinguait,
et frappée du port majestueux d’Éphestion, se prosterna devant celui-ci.
Avertie de sa méprise par ceux qui l’entouraient, elle reculait confuse,
lorsque le roi lui dit : Vous ne vous êtes point trompée ; celui-là
est aussi Alexandre. (Arrien[19])
Alexandre avait trouvé parmi les prisonniers faits à Damas
deux députés de Thèbes, un d’Athènes et un de Sparte. Il pardonna aux trois
premiers et les renvoya ; quant à l’ambassadeur spartiate, il le tint
quelque temps en prison.
Tandis que Darius fuyait par Thapsaque, au delà de l’Euphrate,
Alexandre s’avançait, le long des côtes, vers les villes de Phénicie. Cette
marche laissait à Darius le loisir de réunir une nouvelle armée, mais
Alexandre savait ce que valaient les armées persiques, il lui importait bien
davantage de continuer le plan habile qu’il avait tout d’abord conçu : isoler
la Perse de la Grèce; lui fermer l’accès
de la mer en s’emparant des villes maritimes ; prendre ainsi sans coup
férir la flotte ennemie, qui se tenait toujours menaçante au milieu de la mer
Égée, et qui, composée surtout de vaisseaux phéniciens, partagerait le sort
des cités d’où elle était sortie. Toutes ouvrirent leurs portes, Tyr
exceptée, qui sollicita bien la paix et une alliance, mais refusa de laissa
entrer un seul Macédonien, pas même Alexandre, pour sacrifier à Hercule. Le
vainqueur d’Issus était peu disposé à recevoir des conditions, et comme il
lui importait d’avoir Tyr en sa puissance, il l’attaqua. Ce siège était
difficile, car la ville se trouvait sur un rocher, à 3 stades, ou près de 600 mètres, de la
côte. Il fallut construire un large môle entre l’îlot et le continent : pour
encourager ses soldats, Alexandre remplit le premier gabion. Les Tyriens
harcelèrent sans relâche ses soldats, et brûlèrent deux tours de bois élevées
pour les protéger. Mais Alexandre avait conquis la mer par la terre; il
obligea les Phéniciens qui avaient fait soumission de rappeler leurs
vaisseaux de la mer Égée. Cette défection en amena une autre, celle du prince
de Chypre. Alexandre eut alors deux cents galères, avec lesquelles il bloqua
la flotte de Tyr, dans ses deux ports, ce qui lui permit d’achever le môle,
qui subsiste encore. Les murs, hauts de 140 pieds, s’écroulèrent
sous les coups des machines, et la brèche livra passage aux soldats irrités
de cette résistance de sept mois et de la mort de quelques prisonniers que
les Tyriens avaient égorgés sur leur muraille, en vue de l’armée
macédonienne. Alexandre entra un des premiers dans la ville. Les Tyriens ne s’abandonnèrent
pas encore : avec l’opiniâtreté de leur race, ils barricadèrent les rues,
changèrent en forteresse la chapelle d’Agénor
et se défendirent comme leurs frères le feront à Carthage
devant Scipion, et les Juifs à Jérusalem en face de Titus. Huit mille Tyriens
furent égorgés; il n’y eut d’épargnés que le roi Azémilcos, les principaux de
la ville et quelques Carthaginois venus pour sacrifier à Hercule. Le reste
fut vendu comme esclaves, au nombre de trente mille. Il en coûte d’ajouter
que deux mille de ces braves gens, qui avaient résisté d une agression
injuste, furent, par ordre du conquérant, pendus le long du rivage.
Après les massacres, les remercîments aux dieux, selon l’usage
impie de tous les temps, Alexandre sacrifia à
Hercule ; la pompe fut conduite par les troupes sous les armes ; la
flotte même y prit part. On célébra des jeux gymniques, à l’éclat de mille
flambeaux portés par les coureurs, et la catapulte qui avait ouvert la brèche
fut dédiée au dieu. (Arrien) Mais une grande et glorieuse cité n’était plus qu’un monceau
de ruines et un des peuples anciens de la terre, un de ceux qui avaient
contribué à l’avancement de la civilisation générale, venait d’être immolé à
l’orgueil d’un conquérant (août 332).
Avant le siège de Tyr, Darius avait écrit au roi de
Macédoine, pour lui reprocher cette guerre injuste et réclamer sa mère, sa
femme, ses enfants, en offrant son amitié en échange. Alexandre avait répondu
par une énumération des griefs de la Grèce. Il ajoutait que si Darius voulait se
livrer à lui, il éprouverait sa générosité, recevrait de ses mains toute sa
famille, et obtiendrait aussitôt tout ce qu’il pourrait demander ; mais
que lui, Alexandre, entendait être traité comme le maître de l’Asie dans
toutes les lettres que Darius lui enverrait. Pendant le siège, le grand roi,
sentant bien la portée du nouveau coup que sa puissance allait recevoir,
offrit à Alexandre 10.000 talents pour la rançon des siens, l’empire de tout
le pays entre la mer Égée et l’Euphrate, enfin son alliance et la main de sa
fille. Parménion était d’avis d’accepter ces propositions : Je le ferais, disait-il, si
j’étais Alexandre. — Et moi aussi,
reprit le roi, si j’étais Parménion. Et il
répondit qu’il ne devait point y avoir deux maîtres pas plus qu’il n’y avait
deux soleils.
Après de tels messages, il ne restait qu’à combattre.
Alexandre pourtant ne daigna pas se tourner encore contre son adversaire. Les
côtes de la Palestine
et l’Égypte n’étaient pas conquises; il voulut les soumettre avant de
pénétrer dans la haute Asie, pour ne rien laisser d’incertain derrière lui.
La forte place de Gaza fut prise après deux ou trois mois de siège (déc. 331).
Quinte-Curce raconte qu’Alexandre, irrité de la longue résistance de Bétis,
le gouverneur de la ville, lui fit passer une courroie dans les talons et le
traîna sept fois autour des murs pour imiter Achille[20]. La mauvaise
réputation de Quinte-Curce a fait rejeter cette histoire et l’on a eu raison
de n’y pas croire ; Alexandre grièvement blessé devant Gaza n’a pu y
jouer le rôle d’Achille. Ce conte ne jure pourtant pas avec le caractère du
héros, dont il ne faut pas vanter outre mesure la bonté. On a vu de lui bien
des meurtres, on en verra d’autres encore. Quand son amiral lui amena
prisonniers les chefs des villes qui avaient pris le parti des Perses, il les
renvoya dans leurs cités pour y être jugés. C’était un arrêt de mort : tous
périrent.
De son côté, l’historien juif Josèphe montre Alexandre se
détournant de sa route pour visiter Jérusalem, s’inclinant devant le
grand-prêtre Jadduah, et se reconnaissant dans les prophéties de Daniel, qui
promettaient l’empire de l’Asie à un homme de l’Occident. Les Juifs d’alors
étaient bien petits pour mériter cette attention du conquérant de l’Asie, et
ce récit, flatteur pour eux, est trop bien arrangé dans l’intérêt de leur
vanité pour n’être pas très suspect, quoiqu’il ne soit pas en contradiction
avec la politique d: Alexandre. On l’a vu honorer l’Hercule tyrien ;
bientôt il sacrifiera au boeuf Apis[21], et, dans toutes
les occasions, il rendra aux cultes et aux prêtres indigènes des hommages que
ceux-ci prennent pour eux, et que lui ne rend réellement qu’à sa propre
ambition, ou à la divinité qu’il adore dans toutes ses manifestations
nationales, toujours la même pour lui, sous les formes les plus diverses.
L’Égypte, si maltraitée par les rois de Perse, se soumit
sur-le-champ. Alexandre entra à Péluse, à Memphis, et descendit le Nil jusqu’au
petit village de Racotis, prés de la bouche de Canope et du lac Maréotis,
pour visiter une île, chantée par Homère, celle de Pharos, qui forme en cet
endroit le meilleur port de toute la côte africaine. Ce n’était ni par Thèbes
ni par Memphis qu’un Grec pouvait tenir l’Égypte, mais par une cité maritime.
Alexandre trouva le site très favorable pour porter une grande ville facile à
aborder par mer pour le commerce ; facile à défendre par terre, grâce au
lac ; en communication rapide avec l’intérieur, par les canaux et le
Nil. Il en traça lui-même l’enceinte, et marqua l’alignement des rues qui
durent se couper à angles droits, pour mieux recevoir le souffle
rafraîchissant des vents étésiens. Il voulait en faire une ville moitié
grecque et moitié égyptienne, qui servît de lien aux deux peuples, et il y
fit construire des temples aux divinités des deux pays. Elle devint
rapidement une des cités les plus fameuses de la terre, Alexandrie, l’émule
et l’héritière de Tyr, l’entrepôt du commerce entre l’Orient et l’Occident,
le point de rencontre de toutes les doctrines et de tous les cultes.
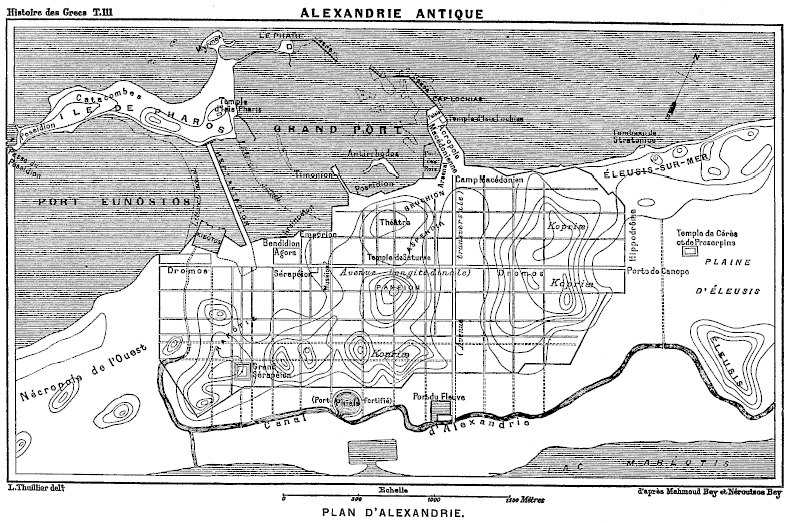
Cependant les meilleures nouvelles arrivaient de la Grèce. Les îles de
Chios, de Cos, de Lesbos étaient revenues à l’alliance macédonienne, et les
forces maritimes des Perses n’existant plus ou étant dans les mains d’Alexandre,
la mer Égée était redevenue un lac grec, qui lui appartenait. Il était donc
bien le maître incontesté de la moitié occidentale de l’empire, et pouvait,
sans crainte, pénétrer maintenant au milieu de l’Asie. Avant d’en prendre le
chemin, il jugea bon de conquérir un oracle fameux, et de se faire décerner
une apothéose qui serait un nouvel instrument de domination. Il l’alla
chercher à travers les sables d’Afrique, jusqu’au temple de Zeus Ammon, où le
prêtre le salua du nom de fils du dieu[22]. Apollon n’avait
pas eu plus de fierté que son père : l’oracle des Branchides avait déjà
reconnu la naissance divine d’Alexandre. L’humain et le divin sont si mal
séparés dans le polythéisme, et la philosophie avait déjà montré tant de
fois, dans les divinités locales, un même dieu honoré sous des noms et avec
des rites différents, que l’élève d’Aristote était préparé à mêler toutes ces
religions, comme il allait confondre toutes ces provinces dans un seul
empire. Les pharaons et, après eux, les rois de Perse maîtres de l’Égypte
avaient porté le titre de fils d’Ammon ; il prit ce nom comme un butin de
victoire, pour ne pas déchoir aux yeux de ses nouveaux sujets des bords du
Nil et de l’Euphrate. Exalté par d’étonnants succès, il parut même, en
certains moments, croire à sa divinité, comme le jour où il renia celui qui
lui avait donné la vie, un royaume et les moyens de soumettre le plus vaste
empire du monde. Dans une lettre écrite aux Athéniens, au sujet de Samos, il
leur dit : Pour moi, je ne vous aurais jamais
abandonné cette illustre cité, mais gardez-la, puisque vous l’avez reçue de
celui qui était alors le maître et qu’on appelait mon père (332)[23]. Même alors il y
eut probablement dans ses paroles moins de sincérité que de secrète moquerie
pour le peuple flatteur par excellence. D’ailleurs tout se concilie si l’on
se souvient de ce mot qu’on rapporte de lui : Zeus
est le père de tous les hommes, mais il n’adopte pour ses fils que les
meilleurs[24]. Alexandre avait
droit à ce dernier titre au sens où les anciens l’entendaient, ce qui l’autorisait
à prendre le premier. Aristote, son maître, n’avait-il pas écrit : Le prince doué d’un génie supérieur est un dieu parmi les
hommes[25].
Par cette marche vers l’Ouest, jusqu’à l’oasis d’Ammon,
Cyrène avait pu se croire menacée ; elle fit porter au roi des promesses
d’obéissance.
Alexandre était libre maintenant de se mettre à la
poursuite de Darius et de s’enfoncer au cœur de l’empire : aucune
complication fâcheuse n’était plus à craindre sur ses derrières. Il laissa en
Égypte deux satrapes indigènes pour que l’administration fût nationale, et
des forces militaires, quatre mille hommes avec une escadre de trente
trirèmes, sous des chefs macédoniens, pour qu’une révolte fût impossible. Il
retourna à Tyr, y célébra avec pompe des jeux scéniques accompagnés de
sacrifices et remonta par la
Cœlésyrie, pour atteindre Thapsaque, le passage habituel de
l’Euphrate, qu’il franchit à la fin d’août 331. De ce même point, le jeune
Cyrus avait tourné au sud, parce que l’armée ennemie se trouvait aux environs
de Babylone[26].
Celle de Darius était derrière le Tigre, presque à la hauteur de Thapsaque et
de Nisibe ; Alexandre prit droit à l’est, à travers la Mésopotamie
septentrionale (Mygdonie),
afin de n’avoir à parcourir qu’un pays bien arrosé, abondant en vivres et en
fourrages. On était vers la fin de septembre ; à cette époque de l’année,
les neiges des montagnes d’Arménie ne fondant plus, le fleuve est guéable en
mille points : le passage du Tigre ne fut donc pas difficile, et les Perses
ne le disputèrent pas plus que celui de l’Euphrate. Tournant alors au sud, il
alla au-devant de l’immense armée des barbares, un million de fantassins et
quarante mille ou, selon Diodore, deux cent mille cavaliers, qu’il rencontra
à 50 kilomètres
à l’ouest de la ville d’Arbèles, dans la plaine de Gaugamèle. Là s’était
élevée Ninive, capitale autrefois d’un grand empire oriental, à présent une
ruine et un présage sinistre pour l’héritier des rois d’Assyrie. Darius avait
eu soin de faire niveler le sol afin de faciliter les évolutions de ses deux
cents chars de guerre, de sa cavalerie et de ses éléphants que les Grecs
allaient voir pour la première fois.
Alexandre avait reçu de continuels renforts venus de la Grèce, où ses agents
recrutaient, avec l’or conquis en Asie, de nombreuses troupes de mercenaires.
Son armée comptait quarante mille hommes d’infanterie et sept mille
cavaliers. Le soir venu, les feux innombrables des barbares firent ressortir
plus encore la disproportion des forces. Parménion proposait d’attaquer de
nuit et par surprise; le roi rejeta cet avis comme indigne de lui : la prudence
même lui conseillait de ne point commettre aux ténèbres, et dans des lieux
mal connus, le succès d’une attaque décisive.
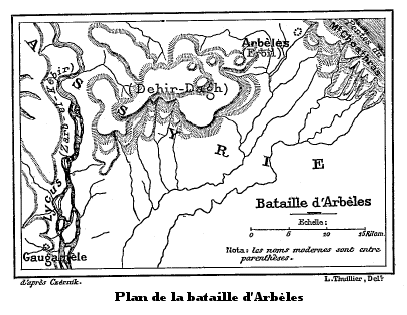
C’est le 2 octobre 331 que se livra la bataille. Au matin de
cette journée, on eut grand’peine à réveiller Alexandre, qui, tout entier aux
préparatifs de l’action du lendemain, n’avait pu s’endormir qu’à l’aurore. Au
centre de sa première ligne, il plaça sa phalange comptant seize mille hommes
armés de la longue sarisse, auxquels Darius opposa, comme à Issus, les mercenaires
grecs; derrière sa ligne de bataille, il en disposa une seconde, qui devait
se porter partout où les Perses tenteraient de tourner les Macédoniens. «
Darius prit bravement position en face du roi, qui appuya d’abord sur sa
droite. Les Perses répondirent à ce mouvement en prolongeant leur aile
gauche, et comme la manoeuvre des Grecs allait les faire sortir du terrain
aplani, Darius accéléra le mouvement de sa gauche pour essayer d’envelopper
par sa cavalerie la droite de l’ennemi. Alexandre fit charger les cavaliers
scythes et bactriens, dont les chevaux mêmes étaient couverts, comme leurs
cavaliers, les cataphractaires, de plaques de métal imbriquées, bonnes contre
les flèches, insuffisantes contre la lance ou l’épée. Ils plièrent; d’autres,
accourus à leur secours, les ramenèrent au combat, et il fallut un vigoureux
effort pour les rompre. A ce moment, Darius lança ses chars armés de faux
contre la phalange ; les Macédoniens avaient été prévenus de la manière
dont ils devaient les combattre. Dès que
les chars s’ébranlèrent, les Agriens et les frondeurs firent pleuvoir sur les
conducteurs et sur les chevaux une grêle de traits qui les arrêtèrent.
Quelques-uns pourtant traversèrent les rangs, qui s’étaient ouverts à leur
passage, et furent pris, sans avoir fait aucun mal, par les hypaspistes et
les palefreniers.
Darius ébranla alors toute son
armée. Alexandre avança à la tête de l’aile droite, et ordonna à Arétès de se
porter avec sa cavalerie légère contre la cavalerie perse prête à le tourner.
Une charge à fond entrouvrit les rangs des barbares ; Alexandre la
suivit et, formant le coin avec la cavalerie des hétaires et la phalange,
pénétra au milieu de l’ennemi. La mêlée dura peu; Darius recula en face de
cette troupe serrée, profonde, partout hérissée de fer, et prit la fuite
quand il vit sa cavalerie en déroute.
Cependant, au centre, la ligne
des Grecs avait été forcée par une partie de la cavalerie indienne et
persique qui s’était fait jour jusqu’aux bagages. Un moment, le désordre y
fut extrême, car les prisonniers se tournèrent contre ceux qui les gardaient.
Mais la seconde ligne fit volte-face, prit les Perses à dos, en tua une
partie, embarrassée dans les bagages, et chassa le reste. A la gauche, l’aile
droite de Darius avait enveloppé les Grecs et menaçait Parménion, qui envoya
prévenir Alexandre du danger qu’il courait ; le roi se porta vivement, à
la tête des hétaires, de la droite à la gauche. Dans ce mouvement, il tomba
sur une colonne épaisse de Parthes, d’Indiens et de Perses qui se retiraient en
faisant bonne contenance. Le choc fut terrible, car ces cavaliers étaient
tous pris s’ils ne s’ouvraient un chemin. Soixante hétaires périrent ;
Éphestion fut blessé. Les Macédoniens à la fin l’emportèrent, et des
cavaliers perses, il n’échappa que ceux qui se firent jour à travers les
rangs. Quand Alexandre arriva à l’aile gauche, la cavalerie thessalienne
avait rétabli les affaires. Sa présence étant inutile, il laissa Parménion s’emparer
du camp des barbares, et ramasser le butin, tandis qu’il se remettait à la
poursuite de Darius. La nuit venue il s’arrêta pour donner quelques instants
de repos à sa troupe, puis il reprit la route d’Arbèles, où il espérait
surprendre Darius. Il y arriva le lendemain, mais le roi en était déjà parti,
y laissant ses trésors, son char et ses armes. En deux jours Alexandre avait
livré une grande bataille et parcouru six cents stades, plus de cent
kilomètres. Dans le combat il n’avait perdu que cent hommes et environ mille
chevaux tués par l’ennemi ou morts de fatigue. Plus de la moitié de cette
perte tomba sur la cavalerie des hétaires. Du côté des barbares, on compta,
dit-on, trois cent mille morts ; le nombre des prisonniers fut plus
considérable[27]. (Arrien)
La vallée de l’Euphrate et du Tigre sépare deux mondes que
la politique a très rarement réunis. Comme Alexandre, après Arbèles, s’est
élancé, d’une course rapide, des rives du Tigre à celles de l’Indus, nous
courrons vite à travers ces provinces qui ont été l’objet de tant de
conquêtes éphémères et où la
Grèce n’est apparue qu’un instant. La géographie et l’histoire
de ces pays n’appartiennent pas à l’antiquité classique d’oie nous n’avons
pas à sortir.

IV. Occupation des capitales persiques, mort de Darius ; défaite des
Lacédémoniens (330) ; soumission des provinces
orientales (329)
Après Arbèles, comme après Issus, Darius avait échappé aux
vainqueurs; Alexandre le laissant fuir avec quelques milliers d’hommes,
descendit au sud, le long du Tigre, pour mettre la main sur les capitales et
sur les trésors qu’elles renfermaient. Quand il approcha de Babylone, les
prêtres, les magistrats, les habitants, sortirent à sa rencontre, les mains
chargées d’offrandes. Il s’entretint avec les mages, sacrifia à Bel et
ordonna de relever son temple ainsi plage ou roi de que tous ceux que Xerxès
avait détruits. De l’or trouvé dans cette ville, il donna 600 drachmes par
tête à la cavalerie macédonienne, 500 à la cavalerie étrangère, 200 à l’infanterie
nationale, un peu moins aux fantassins étrangers : c’était un acompte
sur les profits de la conquête.
Après avoir pourvu au gouvernement des provinces soumises,
il tourna à l’est, vers les pays qui étaient le centre et comme le sanctuaire
de l’empire; en vingt jours il gagna Suse, où il trouva 40.000 talents en
lingots, 9000 en numéraire et les statues d’Harmodios et d’Aristogiton, qu’il
renvoya aux Athéniens. Quinze mille Macédoniens, Thraces ou Péloponnésiens,
levés par Antipater avec l’argent qu’Alexandre lui avait envoyé, le
rejoignirent dans cette ville et comblèrent les vides faits dans son armée,
moins par le fer ennemi que par les garnisons qu’il laissait derrière lui.
Entre Suse et Persépolis la route était difficile et dangereuse, à cause des
plaines arides à traverser, des montagnes escarpées à franchir, des défilés
étroits à forcer sous les quartiers de roc qu’un brave satrape, échappé d’Arbèles
avec trente ou quarante mille hommes, Ariobarzane, y faisait rouler.
Alexandre n’eut pas seulement contre lui la nature ; la population
belliqueuse des Uxiens, dont le grand roi ne passait les montagnes qu’en
payant tribut, essaya de l’arrêter et il dut s’ouvrir de vive force les
Portes persiques : mémorables combats où il montra cette audace téméraire qui
lui gagnait le coeur de ses soldats.
Persépolis (Istakar), métropole de l’empire, était
alors la plus riche de toutes les cités que le soleil éclaire[28]. (Diodore) On dit qu’en
approchant de ses murs, les Macédoniens rencontrèrent quatre mille Grecs
asiatiques qui avaient été relégués dans ce lointain exil, après avoir été
affreusement mutilés; que, cette vue enflammant la colère des vainqueurs,
Persépolis fut livrée au pillage et que la nuit suivante l’orgie augmenta les
ruines, lorsque Alexandre, entraîné par la courtisane Thaïs, incendia le
palais des rois, pour venger la
Grèce de l’incendie de ses temples[29]. Ces histoires
sont-elles vraies? Si nous abandonnons quelques détails trop bien arrangés
pour l’intérêt dramatique, il restera vraisemblable qu’Alexandre voulut
annoncer à tout l’Orient, par cette destruction du sanctuaire national, la
fin de la domination persique. Quant à la ville, elle ne fut pas détruite,
comme le dit Quinte-Curce, puisqu’on voit, peu de temps après la mort du
conquérant, le satrape Peucestès y sacrifier aux mânes de Philippe et d’Alexandre.
Pour sa part de butin, le nouveau maître de l’Orient mit la main sur 120.000
talents, monceau d’or que Darius n’avait pas su utiliser, et, afin d’achever
la prise de possession des villes saintes des Akhéménides, il gagna de
Persépolis, Pasargade qui gardait le tombeau de Cyrus et où se faisait le
couronnement des rois (mai
et juin 330)[30].
Babylone, Suse et Persépolis occupées, Alexandre n’avait
plus rien à faire au sud de l’empire, il se remit sur les traces de Darius,
remonta vers Ecbatane (Hamadan),
et atteignit cette ville huit jours après que Darius en était parti. Il y
déposa son butin de guerre, 180.000 talents, sous la garde de Parménion, et
en fit sa nouvelle base d’opérations. Six mille Grecs l’y rejoignirent, mais
d’autres le quittèrent pour retourner en leur pays ; outre leur solde et
leur butin, ils emportèrent 2000 talents qu’Alexandre leur donna.
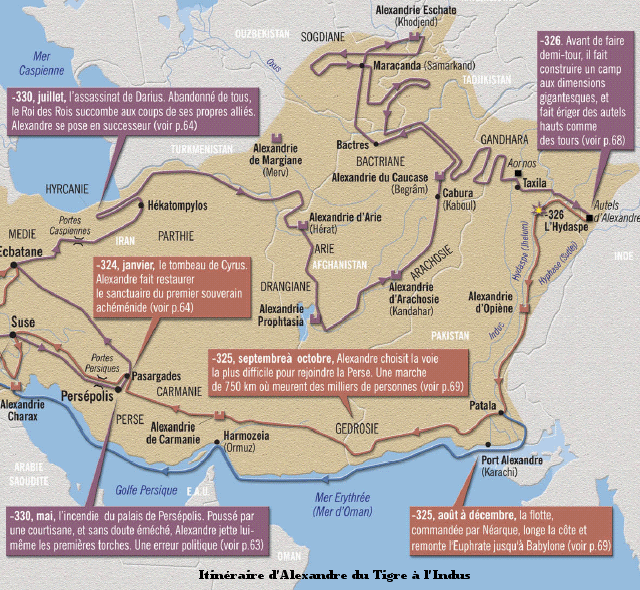
Autant le conquérant avait montré de dédain pour le roi
fugitif tant qu’il avait eu à prendre ses capitales et ses trésors, autant il
montra d’ardente activité à le poursuivre quand il n’eut plus que lui à
saisir. En onze jours il fit quatre cent quatre-vingts kilomètres, et
atteignit Rhagées (Rei, près de Téhéran), à
quelque distance des Portes Caspiennes. Darius venait de les franchir. Il
fallait désespérer de l’atteindre ; mais deux serviteurs du roi vinrent
annoncer que Bessus, satrape de la Bactriane, avait enchaîné Darius et le traînait
à sa suite, sur la route de l’Arie (Khoraçan) qui conduisait à son gouvernement. Alexandre
reprend aussitôt la poursuite, marche trois jours et trois nuits presque sans
s’arrêter, et le quatrième jour, avec cinq cents de ses meilleurs soldats,
montés sur ce qui lui restait de chevaux valides, il atteint les Perses, non
loin d’Hécatompylos. A sa vue, l’épouvante les disperse, et il se trouve en
face de Darius, mais de Darius égorgé. Bessus, n’ayant pu décider le roi à
partir avec lui, avait laissé sur la route son cadavre percé de coups (juillet 330).
Alexandre lui fit de royales funérailles.
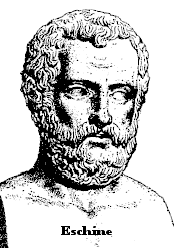 Avant que
la nouvelle de cette triste fin du dernier des successeurs de Xerxès eût
franchi la mer Égée, Eschine s’était écrié dans Athènes[31] : Nous sommes nés pour fournir à la postérité d’incroyables
récits. N’est-ce pas le roi des Perses, celui qui creusa l’Athos et enchaîna
l’Hellespont, celui qui demanda à nos pères la terre et l’eau, qui dans ses
messages osait se dire le maître du monde, depuis les lieux où le soleil se
lève jusqu’à ceux où il se couche, n’est-ce pas lui qui maintenant cherche à
sauver non plus son empire, mais sa vie dans une lutte désespérée ?
Eschine se trompait ; il n’y avait pas eu de lutte désespérée : le grand
roi avait péri victime d’un vulgaire assassinat et son immense empire était
tombé comme une tour ruinée à sa base, qui, au premier choc, s’écroule. Avant que
la nouvelle de cette triste fin du dernier des successeurs de Xerxès eût
franchi la mer Égée, Eschine s’était écrié dans Athènes[31] : Nous sommes nés pour fournir à la postérité d’incroyables
récits. N’est-ce pas le roi des Perses, celui qui creusa l’Athos et enchaîna
l’Hellespont, celui qui demanda à nos pères la terre et l’eau, qui dans ses
messages osait se dire le maître du monde, depuis les lieux où le soleil se
lève jusqu’à ceux où il se couche, n’est-ce pas lui qui maintenant cherche à
sauver non plus son empire, mais sa vie dans une lutte désespérée ?
Eschine se trompait ; il n’y avait pas eu de lutte désespérée : le grand
roi avait péri victime d’un vulgaire assassinat et son immense empire était
tombé comme une tour ruinée à sa base, qui, au premier choc, s’écroule.
Pendant qu’Alexandre gagnait un empire, il faillit perdre
son patrimoine. C’est à Chéronée que les Spartiates auraient dû venir; ce qu’ils
n’avaient pas fait en face de Philippe, ils le tentèrent quand ils virent son
fils engagé au fond de l’Asie. Ils avaient refusé de reconnaître le congrès
de Corinthe, et tenaient toujours des députés auprès de Darius. La défaite d’un
général macédonien par les Scythes du Danube, qui lui tuèrent un grand nombre
d’hommes, et la révolte du gouverneur de la Thrace, les décidèrent à profiter des embarras
d’Antipater. Les Éléens, les Achéens, moins Pellène, et les Arcadiens,
excepté ceux de Mégalopolis, s’unirent à eux, de sorte que leur roi Agis put
assiéger Mégalopolis avec vingt mille fantassins et deux mille chevaux. Ce
réveil inattendu de Lacédémone fit-il hésiter Athènes, qui ne souhaitait pas
plus l’hégémonie de Sparte que celle de la Macédoine? Démosthène
du moins garda le silence, et quand un orateur demanda l’armement des
galères, Démade, alors administrateur du théoricon, répondit qu’il
avait bien dans sa caisse de quoi y pourvoir, mais que, si on dépensait l’argent
à ces préparatifs, il ne pourrait plus distribuer à chaque citoyen la demie
mine qu’il avait réservée pour la fête des Choès. Je ne sais si l’espérance
de cette gratification décida le dèmos à la prudence ; je croirais plus
volontiers que des gens avisés lui montrèrent la ville tenue en échec par la
garnison macédonienne de la
Cadmée ; son port bloqué par les flottes d’Alexandre,
maintenant maîtresses de la mer ; les bénéfices de la victoire, si on la
gagnait, réservés à Lacédémone; enfin les bannis partout ramenés et les
gouvernements démocratiques renversés.
Antipater fit face à tout ; il arrangea les affaires
de Thrace, et accourut encore à temps avec quarante mille hommes pour sauver
Mégalopolis. Le roi spartiate fut tué avec cinq ou six mille des siens. Comme
Agis, qui, blessé, s’était un instant relevé et, appuyé sur un genou, avait
combattu encore jusqu’au coup mortel, la Grèce retombait frappée à mort aux pieds des
Macédoniens (sept.
330). Le congrès assemblé à Corinthe décida que des députés iraient
demander au roi de régler le sort des vaincus. Ils se souvint des conseils d’Aristote
qui lui recommandait de rester pour les Grecs un généralissime et de ne
gouverner en maître que les barbares : il se montra clément. Les Achéens, les
Éléens et les Arcadiens qui, membres de la ligue, avaient violé le pacte
fédéral, furent punis d’une amende de 120 talents envers Mégalopolis ;
de Sparte, qui n’en faisait point partie, il n’exigea que les cinquante
otages réclamés par Antipater.
Alexandre avait appris la défaite des Spartiates presque
en même temps que leur soulèvement et, au milieu de sa grande entreprise, de
telles agitations lui avaient paru misérables. Pendant
que nous abattions l’empire des Perses, dit-il à ses soldats, il s’est livré en Arcadie, une bataille de rats ;
et ce dédain était, pour les Spartiates, une seconde défaite. En ce moment,
Alexandre avait raison de ne prendre aucun souci des affaires de la Grèce ; il se
préoccupait bien plus de Bessus, qui pouvait établir un centre de résistance
dans la Sogdiane
et la Bactriane,
on il avait pris le titre de roi. Il se résolut à ne pas lui donner le temps
de s’y fortifier, mais, suivant sa tactique de ne laisser derrière lui ni un
centre de résistance ni un peuple d’une fidélité suspecte, il s’avança plus
encore dans le Nord pour fermer la route de l’Asie Mineure et de l’Euxin à
ceux qui voudraient exciter quelque trouble dans l’Occident. Hécatompylos paraît
avoir été située aux environs de Shahroud, au sud d’Asterabad. Entre ces deux
villes s’étendent des montagnes dont les eaux méridionales de la Caspienne baignent le
pied et qui séparent la
Parthie (Kohistan) de l’Hyrcanie (Mazendéran). En se continuant à l’est
pour rejoindre, par le Caucase indien ou Paropamisos (Hindou-Koush), les masses
colossales de l’Himalaya, cette chaîne court, avec des altitudes qui varient
beaucoup, entre deux contrées très différentes[32], le Touran et l’Iran,
ou la Bactriane
et la Sogdiane
au fiord, la Perse
et l’Afghanistan au sud. Après avoir rapidement dompté les Parthes, les
Mardes et les Hyrcaniens, Alexandre se remit à la poursuite de Bessus et
soumit, en passant, l’Arie, où il fonda une Alexandrie qui, sous le nom de
Hérat, est restée un des grands marchés de l’Orient, une des portes de la Perse et de l’Inde. Un
complice de Bessus gouvernait la
Drangiane et l’Arachosie (Séistan) ; il le chercha et se le fit
livrer par les Indiens. Une tragédie l’arrêta un moment : Philotas, fils de
Parménion, reçut l’avis d’un complot formé contre la vie d’Alexandre ;
pendant trois jours il garda le secret, qu’un autre transmit au roi. Ce
retard inexplicable, une lettre obscure de Parménion, les propos pleins d’amertume
et les sarcasmes que Philotas répandait depuis longtemps contre le roi,
firent croire à sa complicité, et Alexandre l’accusa lui-même devant l’armée.
Mis à la torture, il fit des aveux que la douleur peut-être arrachait[33] : l’armée le
lapida. Plusieurs de ses amis, tous officiers de haut rang, périrent avec
lui. Ce qu’il y eut de plus odieux dans cette lugubre et ténébreuse affaire,
ce fut le meurtre du vieux Parménion : il gardait à Ecbatane, à trente
journées de là, d’immenses trésors ; on craignit une révolte ; un
messager, monté sur un dromadaire rapide, traversa en onze jours le
désert ; il lui portait une fausse lettre de son fils, et l’égorgea
pendant qu’il la lisait (330).
De Prophthasia (Farrah ?), théâtre de ces tristes scènes,
Alexandre gagna les défilés du Paropamisos, qui le séparait de la Bactriane, laissant
derrière lui deux autres Alexandries, dont l’une, encore aujourd’hui
florissante, garde le nom de son fondateur, Kandahar[34]. Une révolte des
Ariens ne l’arrêta pas ; il envoya contre eux un détachement et entra
clans la Bactriane.
Les grandes plaines de l’Asie centrale étaient dés lors
bien loin derrière lui, et il arrivait en des pays hérissés de montagnes,
coupés de ravins où il trouvait, au lieu des masses confuses qu’il avait si
aisément dispersées d Arbèles, des montagnards, ici comme partout énergiques
et braves. Aux grandes batailles succèdent les combats isolés, les sièges,
les luttes contre la nature, au milieu des monts couverts de neige du Caucase
indien, avec des froids tels que les Macédoniens n’en avaient jamais connus.
Durant quatorze jours, ils souffrirent toutes les misères et quand ils
arrivèrent, en débouchant de ces passages par le nord, à la première ville de
la Bactriane,
Adrapsa (Anderab ?)
ils trouvèrent tout le pays dévasté : Bessus avait fait le désert devant l’armée
envahissante. Cependant, Aornos, l’imprenable,
Bactres même, furent prises : les Macédoniens étaient dans la vallée de l’Oxus.
Le puissant fleuve fut franchi sur un pont qu’Alexandre improvisa avec la peau
des tentes transformées en outres remplies de paille qui portèrent quelques
poutres et planches sur lesquelles l’armée passa. Le Sogdien Spitamène, allié
de Bessus, voyant sa cause perdue, le livra au roi, qui le fit battre de
verges à la vue de toute l’armée, puis l’abandonna aux cruelles vengeances
des parents de Darius (329).
Ces tortures et ce meurtre n’étaient que des représailles.
Le massacre des Branchides fut un acte abominable. C’étaient des Grecs,
descendants d’une famille qui, cent cinquante ans auparavant, avait livré à
Xerxès les trésors du temple d’Apollon, près de Milet, dont elle avait la
garde. Après Salamine et Platée, ils avaient échappé par la fuite d la haine
de leurs concitoyens, et le grand roi leur avait donné des terres dans la Bactriane. Ils v
avaient conservé leurs traditions et leur langue. Aussi, à la nouvelle qu’une
armée grecque approchait, ils accoururent joyeusement au-devant d’elle.
Alexandre, pour venger le dieu et la
Grèce trahis par leurs pères, les fit, hommes, femmes et
enfants, égorger jusqu’au dernier, renversa leur ville et coupa les arbres
pour que le lieu habité par la race sacrilège fût voué à la désolation[35].
Après la
Bactriane, la
Sogdiane subit le joug, et les vainqueurs occupèrent sa
capitale, Maracanda (Samarcande ?).
Mais Alexandre ne s’y arrêta pas ; il poussa jusqu’à l’Iaxarte, qu’il
franchit, et au delà duquel il battit les Scythes. Dans les mêmes lieux, et
sur les bords de ce fleuve, il jeta une Alexandrie nouvelle (Kliodjend ?)
; ce fut le point le plus avancé qu’il atteignit vers le nord[36]. Des
chroniqueurs, qui croyaient aux vieilles légendes, ont placé en cet endroit
une visite intéressée de la reine des Amazones à Alexandre. Cette Amazone
était, comme le roi le raconta lui-même à Antipater, une fille du chef des
Scythes offerte par son père au harem du vainqueur[37].
Une insurrection provoquée par Spitamène rappela le Macédonien au sud ; un
corps de son armée avait été détruit par le satrape, qui échappa à sa
poursuite. Alexandre punit la province de ce soulèvement, auquel elle était
peut-être étrangère, par d’affreux ravages (329). Le mouvement eut, l’année suivante,
encore plus d’étendue; un de ses officiers, Peithon fut enlevé avec sa troupe
par Spitamène ; mais la prise en un jour du roc Sogdien, forteresse
fameuse dans ce pays, effraya quelques-uns des révoltés. A la sommation d’Alexandre,
le gouverneur avait répondu : As-tu des ailes ?
et il semblait qu’il en fallût pour atteindre l’inaccessible citadelle. Le
roi promit 42 talents au premier qui toucherait les murs, et une petite
troupe escalada le roc à pic.
Dans la forteresse, Alexandre trouva la famille d’un
seigneur perse dont la fille, Roxane, était d’une incomparable beauté. La
politique du conquérant était d’unir les deux peuples; dans les villes qu’il
fondait, il mêlait toujours des Grecs aux indigènes. Il donna lui-même l’exemple
de cette fusion des deux races en épousant Roxane. Le père, flatté d’un tel
honneur, accourut faire sa soumission, qui entraîna celle d’une partie de la
province. Pour mieux assurer le repos de ce pays, il chargea Héphestion d’y
fonder douze villes qui servissent de rempart contre les Scythes, pendant que
lui-même fouillait tous les points de la Sogdiane, n’y laissant ni une forteresse fermée
contre lui, ni un ennemi en armes. Une surprise que tenta encore Spitamène
lui devint fatale : il fut battu, et les Massagètes, à l’approche des
Macédoniens, sauvèrent leurs tribus du pillage en envoyant au conquérant la
tête du hardi partisan. Alexandre avait employé deux années à soumettre ces
belliqueuses peuplades ; il passa quelques mois encore dans la Bactriane, où
plusieurs chefs refusaient de poser les armes ; il n’en partit que pour
commencer son expédition contre l’Inde (328).
Derrière lui il laissait dans ces régions de grands, mais
aussi de terribles souvenirs. Dans les déserts de l’Oxus on l’avait vu, après
une longue marche à pied, à la tête de ses troupes, mourant de soif, refuser
un peu d’eau qu’un des siens avait trouvée, et la répandre à terre parce qu’il
ne pouvait la partager avec ses soldats. Dans les combats, il était au
premier rang et fut souvent blessé ; il ne s’en remettait jamais à d’autres
du soin de conduire ces marches prodigieuses qui tant de fois lui permirent
de frapper l’ennemi de coups inattendus et décisifs. Dans une grande chasse,
attaqué par un lion, il refusa le secours de Lysimaque et l’abattit ;
cette fois, l’armée inquiète décréta que le roi ne pourrait plus chasser à
pied ni sans escorte. Sa libéralité était sans bornes, comme son courage; et
il avait, au besoin, autant de persévérance que d’impétueux élan. Il avait
habitué les Macédoniens à ne rien regarder comme impossible ; aussi,
parmi les soldats, surtout parmi les nouveaux venus, beaucoup, en voyant de
si grandes choses accomplies, se souvenaient des bruits répandus sur sa
naissance divine, sur les réponses d’Ammon, sur le serpent mystérieux que
Philippe avait trouvé le premier jour dans la chambre nuptiale, et de lâches
flatteurs essayaient d’y faire croire le roi. Un jour d’orage, Anasarque d’Abdère
lui dit : N’est-ce pas toi qui tonnes la haut, ô
fils de Zeus ? Mais l’entourage du conquérant restait incrédule.
Ses compagnons d’enfance, ses vieux généraux, cette fière noblesse de
Macédoine, naguère si libre avec ses rois, ne voyait pas sans un profond
dépit cette apothéose.
Quand Alexandre, après la mort de Darius, adopta les
usages perses, ceignit le diadème, revêtit la tunique blanche et fit porter à
ses favoris des robes de pourpre ; quand il apprit le langage des
vaincus et admit dans sa garde les fils des plus illustres familles du pays,
il ne céda pas au vain désir d’égaler la magnificence des grands rois,
il fit ce que la politique commandait. D’ailleurs, cette étiquette orientale
était pour les Perses ; au milieu de l’armée, il gardait la simplicité
militaire. Un soir, dans la
Parætacène, par une température glaciale qui avait tué
plusieurs soldats, Alexandre se réchauffait au feu d’un bivouac. Il voit s’approcher,
d’une marche indécise, un vétéran que le froid avait saisi et que ses yeux
guidaient à peine ; il l’arrête, prend ses armes, le fait asseoir à sa
place, et quand le soldat, revenu à lui, se trouble en reconnaissant
Alexandre : Camarade, lui dit-il en
riant, chez les Perses s’asseoir sur le siège du
roi, c’est un cas de mort ; pour toi, ce sera un cas de vie, car ce feu t’aura
sauvé. Petit fait, bonnes paroles, qui souvent se renouvelaient et
aidaient à faire de grandes choses. Mais des Macédoniens s’indignaient de l’abandon
des coutumes nationales, et se montraient jaloux des Perses qu’ils
regardaient comme injustement favorisés. Malgré son ferme et lucide génie,
Alexandre ne réussit pas à concilier ses droits de conquérant de l’Asie avec
les égards que la prudence lui conseillait d’avoir pour ceux qui lui avaient
assuré cette éblouissante fortune. Il lui était difficile de jouer deux rôles
à la fois, d’être dans le même temps le grand roi pour les Perses, tout en
restant pour ses compagnons d’armes le roi de Macédoine, et de ne pas
entendre les sourdes rumeurs qui couraient contre lui. Il ne l’était pas
moins, à quelques-uns de ceux qui avaient vu les Héraclides si pauvres d’autorité
et de richesse, d’accepter sans murmures la situation nouvelle que leur
imposait l’ordre de choses qu’eux-mêmes avaient fondé. L’un s’abandonna à l’orgueil
et aux accès de colère d’un despote oriental ; les autres à l’indiscipline
et à l’insolence. Déjà il avait cru trouver des traîtres et des
conspirateurs ; il avait fait mourir Philotas et assassiner Parménion.
Une scène déplorable montra, en 328, les progrès de ce double mal.
A Maracanda, pendant une fête des Dioscures, quelques-uns
de ces bas personnages, devins ou sophistes, dont les flatteries
nourrissaient l’orgueil du roi, s’avisèrent d’exalter Alexandre, au point de
le mettre au-dessus des deux divinités dont on célébrait les exploits, même
au-dessus d’Hercule. Clitus, indigné, s’écrie qu’Alexandre n’a pas tout fait
à lui seul ; qu’une bonne part de la gloire appartient aux Macédoniens.
Et, comme on rabaissait les actions de Philippe pour glorifier celles de son
fils, le vieux général ne garde plus de bornes; ils commence l’éloge du père,
fait la satire d’Alexandre, et tendant le bras vers le roi : Sans le secours de ce bras, lui crie-t-il, tu périssais dès le Granique. Ivre de vin et de colère,
Alexandre ne se contient plus ; il arrache une pique à un de ses gardes
et en percé son ami, son sauveur. Dans cette généreuse nature, le repentir
suivit de près. On dit que ses yeux se dessillant aussitôt, il tourna contre
sa poitrine la pointe de la lance et allait s’en percer lui-même, quand on l’arrêta.
Pendant trois jours il demeura dans sa tente, sanglotant, appelant Clitus, se
maudissant lui-même et refusant toute nourriture. Mais l’armée entière se fit
son complice, en décrétant que le sauveur d’Alexandre avait été justement
assassiné. Tout le monde conspira pour arracher au plus vite le remords de sa
conscience : les prêtres en attribuant le crime commis dans l’ivresse à la
vengeance de Bacchus, dont il négligeait les autels ; le sophiste Anaxarque
en lui reprochant d’abaisser les droits d’un conquérant au niveau de la
morale vulgaire. Le juste, osait-il dire, est ce que veulent et font les rois ; c’est pourquoi,
dans l’Olympe, la Justice
est à côté de Zeus, parce que tous les actes de Zeus sont bustes et bons.
Le sang n’en était pas moins versé, et Alexandre allait en
répandre d’autre. Les Perses qui, en approchant du prince, se prosternaient
devant le fils d’Ammon ou plutôt, selon leur coutume nationale, devant le
Grand Roi, voyaient les Macédoniens aborder librement Alexandre. Ces procédés
différents maintenaient entre les deux peuples la barrière qu’il eût fallu
détruire pour effacer, chez les uns, le souvenir de la défaite, et diminuer,
chez les autres, l’orgueil de la victoire : deux sentiments qui empêchaient
le conquérant de consolider sa conquête. Soumettre la Perse lui avait été
facile, changer ses mœurs ne l’était pas ; et comme c’était un empire
oriental qu’il fondait, ce fut aux Grecs qu’il demanda de sacrifier leurs
usages à l’intérêt général. Les vieux généraux, habitués à faire la part des
nécessités, y consentirent. Un philosophe ou plutôt un sophiste, qui suivait
l’expédition pour en écrire l’histoire, s’y refusa. Callisthène d’Olynthe,
disciple et neveu d’Aristote, combattit, à la table même du roi, sa politique
de conciliation par des raisons qui, excellentes à Athènes ou à Sparte, ne l’étaient
plus au fond de la Perse,
mais qui faisaient impression sur les jeunes nobles, les enfants royaux, auxquels la garde de la
tente royale était confiée. Un d’eux, Hermolaos, écoutait avidement les
paroles du rhéteur; châtié pour une faute, il conspira contre la vie du roi
avec cinq de ses compagnons; découverts, ils furent condamnés et lapidés par
les Macédoniens. Callisthène, impliqué dans le complot, fut pendu[38]. C’était un
homme de bien, une âme droite et fière, d’une vertu rigide ; mais Aristote,
qui lui reconnaissait beaucoup d’éloquence, ajoute que le bon sens lui
manquait[39],
ce qui n’est pas contradictoire; et si, comme Aristobule et Ptolémée l’en
accusaient dans leurs Mémoires, il a connu la conjuration et encouragé les
auteurs à y persévérer, il était un complice et fut légitimement condamné (327).
Dans la
Sogdiane, Alexandre avait reçu une ambassade d’un prince
indien, Omphis, roi du pays entre le haut Indus et l’Hydaspe, dont la
capitale, Taxila, s’élevait près de la ville moderne d’Attock; il appelait le
Macédonien à son secours contre un autre roi du voisinage, Porus, et offrait
de lui ouvrir la porte des Indes. Alexandre laissa en Bactriane dix mille
fantassins, et trois mille cinq cents cavaliers pour contenir le pays jusqu’à
l’Iaxarte, et à la tête de cent vingt mille hommes de pied et de quinze mille
chevaux, il traversa encore une fois le Paropamisos pour gagner la vallée du
Cophène (le Caboul),
où se trouvent les défilés fameux de Khaïber. Tandis que Perdiccas et
Héphestion descendaient à l’est le long de ce fleuve jusqu’à la ville moderne
de Peschawar et au confluent du Cophène avec l’Indus, il remonta au nord la
vallée du Choaspe (affluent
du Cophène à Djelalabad) pour réduire les belliqueuses tribus des
Aspiens, des Assacéniens et des Guréens. Cette expédition, où les Macédoniens
se heurtaient, en chaque défilé, à des forteresses presque inaccessibles,
occupa le reste de l’année 327 et le commencement de 326. Une seconde Aornos,
devant laquelle Hercule, disait-on, avait échoué, fut prise après des
prodiges d’audace et des travaux qui prouvent qu’Alexandre avait, à côté de
ses incomparables soldats, d’habiles ingénieurs et une artillerie de siège
formidable. A Nysa, il crut trouver des traces du passage de Bacchus et se
servit de ces souvenirs mythologiques pour exalter le courage de ses
Macédoniens. Il semblait, en effet, marcher sur les pas d’un dieu ou d’un
héros et effacer leur gloire par la sienne, en livrant à ces hardis
montagnards des combats de géants. Le Choaspe a ses sources dans les
montagnes dont le revers septentrional est longé par l’Oxus. Alexandre tenait
donc, dans le Caucase Indien, la tête des vallées qui, par l’Indus,
descendaient à l’Océan et, par l’Oxus, à la mer Caspienne. C’est la position
que les Russes voudraient prendre et qu’ils prendront probablement un jour
pour s’ouvrir l’accès des mers méridionales.
Au printemps de 526, Alexandre franchit enfin l’Indus,
traversa les États du prince de Taxila, où il vit avec surprise les brahmanes
livrés à leurs austérités, et arriva prés de la ville moderne de Djalalpour,
aux bords de l’Hydaspe. La fonte des neiges avait rempli ce large bassin d’eaux
rapides et recouvert tous les gués. Sur la rive gauche se tenait Porus, avec
une armée formidable et des éléphants de combat dont la taille et les cris
étaient pour effrayer des troupes qui n’avaient pas
encore eu à lutter contre ces machines de guerre vivantes.
Porus, très brave de sa personne, arrêta quelque temps son adversaire et ne
céda la victoire qu’après un sanglant combat où il fut blessé et pris.
Quinte-Curce met dans la bouche des deux princes des paroles qui, sans doute,
ne sont pas véridiques, mais qu’on aime à répéter. Comment
prétends-tu être traité ? demanda le vainqueur à son captif. — En roi. — Je le ferai pour
moi-même ; à présent que puis-je faire pour toi ? Parle. — J’ai tout dit. — Je te
rends ton royaume et j’y ajouterai encore. Alexandre le fit ; sa
générosité, d’accord avec sa politique, plaçait en face du prince de Taxila
un rival qui pouvait le contenir (mai 326). Il fonda en ces lieux deux villes : l’une appelée Nicée,
pour rappeler sa victoire, l’autre Bucéphalie, en mémoire de son
fidèle et vieux coursier, qui venait de mourir des blessures reçues dans le
combat.
Dans ces deux campagnes, Alexandre avait montré son
courage ordinaire, mais aussi des qualités militaires plus rares que celles
des premières années de la conquête. Le passage de l’Hydaspe et la bataille
qui suivit sont pour des juges compétents, les généraux anglais qui ont
combattu dans ces régions, les habiles manoeuvres d’un chef accompli[40].

V. Retour d’Alexandre (326) ; son arrivée à Babylone
(324) ; sa mort (323)
La victoire sur Porus livrait à Alexandre la fertile
région des Cinq-Rivières ; il continua à marcher dans la direction de l’est,
et, après avoir traversé l’Hydaspe, il franchit en combattant l’Acésine, l’Hydraote
et arriva au bord de l’Hyphase, qui fut la limite extrême de son expédition.
Il s’arrêta, non qu’il fût las d’aller, mais parce que ses soldats,
assure-t-on, l’y forcèrent. Épuisés de fatigue, maltraités par 70 jours d’orages
et de pluies continuelles[41], n’ayant plus
que des lambeaux pour vêtements et des armes usées, ils s’effrayèrent des
entreprises nouvelles où leur chef voulait les entraîner, à travers un désert
immense, contre ces Gangarides et ces Prasiens, dont le roi pouvait conduire
contre eux deux cent mille fantassins, vingt mille chevaux et plusieurs
centaines d’éléphants. Plutôt que de passer le fleuve profond et rapide qui
se trouvait devant eux, ils formèrent des groupes et murmurèrent. Alexandre
convoqua aussitôt les chefs et leur dit : Nous n’avons
pas loin d’ici au Gange et à la mer Orientale, qui se réunit à celle des
Indes et embrasse le monde. Du golfe Persique, nous remonterons jusqu’aux
colonnes d’Hercule, et, soumettant l’Afrique comme l’Asie, nous prendrons les
bornes de l’univers pour celles de notre empire... Si je ne partageais ni vos
fatigues ni vos dangers, votre découragement aurait un motif. Vous pourriez
vous plaindre d’un sort inégal qui placerait d’un côté les peines et de l’autre
les récompenses. Niais, périls et travaux, tout est commun entre nous, et le
prix est au bout de la carrière. Ce pays : il est à vous. Ces trésors : ils
sont les vôtres. L’Asie soumise, je remplirai, je surpasserai vos espérances.
Ceux qui voudront revoir leurs foyers, je les reconduirai moi-même ;
ceux qui voudront rester, je les comblerai de présents inestimables.
Ce discours est suivi d’un profond silence. Que celui, dit-il, qui n’approuve
pas ce dessein, parle. Nouveau silence. Enfin, un des vieux officiers,
Cœnos, exprime les sentiments de tous en le suppliant de les laisser
retourner en Macédoine : là il trouverait toute une
jeunesse avide de gloire et prête à remplacer des soldats vieillis.
Ces paroles sont reçues par d’universels applaudissements ; Alexandre,
irrité, se retire.
Le lendemain, il réunit de nouveau le conseil des chefs : Je ne contrains personne à me suivre ; votre roi marchera
en avant; il trouvera des soldats fidèles. Que ceux qui l’ont désiré se
retirent, ils le peuvent ; allez annoncer aux Grecs que vous avez
abandonné votre prince. Il se renferme alors dans sa tente ; il y
reste pendant trois jours, sans parler à aucun de ses Hétaires ; il
attend qu’une de ces révolutions qui ne sont pas rares dans l’esprit des
soldats en change les dispositions. Mais l’armée continue de garder le
silence. Néanmoins il fait les sacrifices accoutumés pour obtenir un trajet
favorable. Les auspices sont contraires. Alors, rassemblant les plus âgés et
les plus intimes des Hétaires : Puisque tout me
rappelle, allez annoncer à l’armée le départ.
A cette nouvelle, la multitude
pousse des cris de joie; ils accourent à la tente d’Alexandre et le bénissent
d’être assez généreux pour ne céder qu’à l’amour de ses soldats. Il divise
alors son armée en douze corps, et fait dresser par eux douze autels
immenses, aussi hauts que les plus grandes tours, comme un monument de ses
victoires et un témoignage de sa reconnaissance envers les dieux. Ce travail
achevé, il ordonne des sacrifices selon le rit grec, des jeux gymniques et
équestres, range tout le pays jusqu’à l’Hyphase sous la domination de Porus
et donne enfin le signal du départ. (Arrien)
La scène est belle et c’est le véridique Arrien qui la
raconte. Je crains cependant qu’elle n’ait été rendue plus dramatique qu’elle
ne le fut en réalité. Il se peut qu’Alexandre ait voulu passer l’Hyphase et
voir ce qui se trouvait par delà. Mais plusieurs raisons devaient l’empêcher
d’aller beaucoup plus loin. Entre le pays des Cinq-Rivières, où il campait,
et la vallée du Gange s’étend un vaste désert sans herbe et sans eau, dont
Porus a dû lui dire que la traversée serait très difficile. Les nouvelles
arrivées des régions occidentales signalaient des agitations qui rendaient le
retour de l’armée nécessaire, et certains faits nous donnent le droit de dire
qu’Alexandre lui-même comprenait qu’il avait atteint l’extrême limite de sa
conquête. Jusqu’à l’Indus, il avait organisé toutes les provinces en
satrapies, avec un chef civil indigène, un chef militaire macédonien, et une
garnison mi-partie de Grecs et de barbares. Ainsi venait-il de faire encore
dans le Paropamisos, et cette satrapie de l’Inde citérieure avait donné à son
empire la formidable barrière de l’Afghanistan actuel. Entre l’Indus et l’Hyphase,
il avait changé de système, laissant aux peuples leurs gouvernements
nationaux, il n’avait demandé aux princes que d’être ses alliés et de lui
payer un léger tribut. Enfin, au lendemain de sa victoire sur Porus, il avait
fait couper, dans les montagnes qui bordent l’Hydaspe, des forêts entières
dont le fleuve amena les bois à Bucéphalie et à Nicée, où Cratère avait été
chargé de construire deux mille navires. Pourquoi une telle flotte, si ce n’était
pour porter Alexandre aux bouches de l’Indus et non pas à celle du
Gange ? Il s’embarqua avec une partie de son armée sur l’Hydaspe.
Monté sur son vaisseau, il prend
une coupe d’or, s’avance à la proue, et fait des libations dans le
fleuve ; il en invoque le dieu et celui de l’Acésine, qui se réunit à l’Hydaspe
pour se précipiter dans l’Indus ; il invoque aussi l’Indus, et, après
les libations en l’honneur d’Hercule, père de sa race, d’Ammon et des autres
dieux qu’il révère, la trompette sonne, les rames s’agitent et la flotte se
met en mouvement. (Arrien) Le reste de l’armée suivait les rives (novembre 326).
En traversant de nouveau l’Hyphase, l’Hydraote et l’Acésine,
il arriva au bord de l’Hydaspe qu’il descendit jusqu’à l’Indus. Tout en
avançant il recevait la soumission des peuples riverains. Quelques-uns
résistèrent, entre autres les Malliens et les Oxydraques : au siège d’un fort
des Malliens, son impétueux courage faillit lui coûter la vie. Il étain
parvenu le premier sur la muraille ; trois de ses officiers l’y
suivirent. Mais les échelles se rompirent, et Alexandre, en butte, sur la
crête du rempart, à tous les traits, se précipita seul dans l’intérieur du
fort. Acculé au mur et protégé par un tronc d’arbre, il tint les ennemis à
distance, tua les plus audacieux qui l’approchèrent, mais enfin tomba atteint
d’une flèche. Heureusement ses trois compagnons l’avaient rejoint et le
couvrirent de leurs boucliers. Cette résistance donna aux soldats le temps de
franchir le mur et d’accourir en foule. Alexandre fut emporté, évanoui, dans
sa tente. Le bruit de sa mort se répandit dans le gros de l’armée, qui était
à quatre journées de là sur le bas du fleuve. A cette nouvelle, il y eut de
tels éclats de douleur qu’il fallut leur conduire le glorieux blessé dans un
navire, qui descendit le courant sans rames afin d’éviter tout ébranlement et
tout bruit. Lorsque, enfin, ils le virent s’avancer debout sur sa galère,
prendre terre et monter à cheval, ils se précipitèrent autour de lui avec des
cris de joie pour baiser ses mains, son manteau et le couvrir de fleurs. Ce
jour-là Alexandre fut payé de sa blessure.
Après une navigation heureuse sur le bas Indus, mêlée
encore de quelques combats, on atteignit l’île de Pattala, qui n’est autre
que le delta formé par les bouches du grand fleuve et dont le sommet (à Hyderabad) est à 200 kilomètres de
l’Océan (fin de
juillet 325). Arrivé à ce terme, Alexandre reprit enfin le chemin de l’Occident.
Il laissait dans ces contrées, que les maîtres de l’Asie ne visitaient pas
avant lui, des traces nombreuses de son passage et de ses grandes vues de
civilisation. Il avait semé sur son chemin, dans toutes les positions
avantageuses, des villes où il mêlait ses soldats aux indigènes, et dont
plusieurs devaient garder quelque temps la civilisation grecque qu’il y
déposait, plusieurs même survivre aux siècles et aux révolutions. Son projet
était maintenant de retourner par terre avec le gros de son armée ;
mais, tandis qu’il traversera des provinces que n’ont pas encore vues ses
soldats, il veut que sa flotte, sous les ordres de Néarque, explore les côtes
méridionales de son empire, et revienne de l’Indus aux bouches du Tigre. Dès
que la mousson du nord-est, qui souffle durant l’hiver, commença de se faire
sentir dans les premiers jours d’octobre, Néarque s’embarqua sur cet Océan
dont le flux et le reflux, chose nouvelle pour les Grecs, les avaient d’abord
effrayés. Alexandre, qui se proposait de relier par une route connue les
bouches de l’Euphrate à celles de l’Indus, prépara au commerce des lieux de
refuge et de ressources. Avant de quitter file de Pattala, il y éleva une
forteresse pour s’en assurer la soumission ; il y creusa des puits, pour
procurer de l’eau douce à la population, et construisit un port, des
magasins, des chantiers. A la fin d’août 325, ou au commencement de
septembre, il s’enfonça vers l’ouest à travers le pays des Arabites et des
Orites, où il laissa une nouvelle Alexandrie, à Rhambacia, puis il entra dans
les déserts de la
Gédrosie.
Les troupes éprouvèrent, dans les sables brûlants et
mobiles de cette région, de grandes souffrances, par la chaleur, la soif et
la faim[42].
On abandonna beaucoup de bêtes de somme, d’équipages, même de soldats. L’armée, dit Strabon, fut
sauvée par les dattiers qui croissaient en grand nombre dans le lit des
torrents. Alexandre partagea tous ces maux, et il est plus grand dans
ces patientes et difficiles épreuves que lorsqu’il montre sur les champs de
bataille le courage vulgaire d’un soldat. Au bout de deux mois, on atteignit la Carmanie, et l’on
rencontra les convois de vivres que les satrapes voisins avaient envoyés.
Alors, s’il faut en croire Diodore et Quinte Curce, aux privations
succédèrent les orgies, et une marche triomphale de sept jours, rappelant ce
que l’on contait de Bacchus revenant de la conquête des Indes. Arrien traite
de fables ces récits, parce que Ptolémée et Aristobule n’en parlaient point.
Ces orgies sacrées et militaires sont cependant bien dans le goût d’Alexandre
et des soldats de tous les temps. Marche triomphale ou seulement fête du
retour, les Macédoniens et leur chef ont certainement honoré Dionysos par de
larges libations ; mais ils ont aussi célébré la fin de leurs immortelles
campagnes par des sacrifices, des hymnes sacrés et les jeux habituels aux
Grecs dans leurs solennités. Le roi rayonnant de bonheur et de génie
présidait à tout, joutes et banquets. Un autre chef, cependant, attira un
moment tous les regards. Néarque, entré dans le détroit d’Harmozia (Hormouz), venait d’aborder
à l’embouchure de l’Anamis (fin décembre 325) et, apprenant qu’Alexandre était à cinq
journées de marche dans l’intérieur, il s’était rendu prés de lui. Le roi lui
fit raconter à l’armée cet étonnant voyage, où ses marins avaient éprouvé
tant de fatigues, vaincu tant de difficultés et bravé les terribles ouragans
de la mer des Indes. Au prix de ces misères, ils avaient ouvert au commerce
de nouvelles routes entre l’Orient et l’Occident, et tous, soldats et
matelots, étaient fiers du chef qui leur avait fait accomplir cette grande
chose.
A Pasargades, où il passa, Alexandre fit réparer le
tombeau de Cyrus qui avait été pillé, puis gagna Suse par Persépolis (printemps de 324).
Il y punit du dernier supplice plusieurs satrapes infidèles ou coupables d’exactions,
qui avaient espéré ne jamais le revoir. Un d’eux, Harpalos, satrape de
Babylone, n’osa l’attendre. Il s’enfuit avec 5000 talents, et prit six mille
mercenaires à sa solde. Beaucoup de Grecs étaient ainsi épars en Asie,
vendant au plus offrant leurs services. Alexandre défendit à ses satrapes d’avoir
aucune garde de ce genre, et essaya de se rendre maître de cette force
flottante, indisciplinée et dangereuse, en fondant avec ces mercenaires des
colonies dans la
Perside. Le projet ne reçut qu’un commencement d’exécution.
Malgré son exemple et ses efforts, l’union entre les deux
peuples n’avançait pas. Il avait déjà pris pour femme Roxane ; il épousa
encore Barsine[43],
fille aînée de Darius. Il donna à Héphestion la main de Drypétis, sœur de
Barsine, et maria, avec de riches dots, les femmes les plus distinguées de la Perse à ses généraux. Plus
de quatre-vingt-dix mariages se firent ainsi en un jour, et il n’y eut qu’une
seule cérémonie pour mieux resserrer les liens qui unissaient Alexandre et
ses officiers. Il invita tous les soldats à suivre cet exemple, et fit des
présents de noces à ceux qui épousèrent des Asiatiques : dix mille se firent
inscrire. Un spectacle inaccoutumé suivit ces fêtes splendides. A Taxila, les
Macédoniens avaient vu des ascètes brahmaniques qui, bourreaux de leur corps,
faisaient de leur vie un lent suicide, pour sortir plus rapidement, à force
de macérations cruelles, de cette existence terrestre qu’il méprisaient. Un d’entre
eux, Calanos, qu’Alexandre avait ramené de l’Inde, monta sur un bûcher en
présence de l’armée. Il avait soixante-treize ans, et une maladie venait de
le saisir. Il aima mieux faire de sa mort une fête, que de l’attendre triste
et douloureuse. Il y perdait peu de jours, et sa vanité y gagnait du bruit
autour de son nom, par cette glorification de la doctrine du renoncement
faite en face de ceux qui, amoureux de la vie, ne croyaient qu’aux mérites de
l’action.
Ces mariages étaient un excellent moyen de fondre ensemble
les deux peuples. Comme dans une coupe d’amour se
mêlaient la vie et les mœurs des différentes races, et les peuples en y
buvant oubliaient leur vieille inimitié[44]. Alexandre
essaya la même fusion dans l’organisation de l’armée. Les satrapes lui
envoyèrent un corps de trente mille jeunes Perses, qu’il appela ses épigones
et fit armer et discipliner comme les Macédoniens. Ceux-ci virent d’un œil
jaloux cette troupe nouvelle. Oubliant les bienfaits d’Alexandre, qui venait
encore de payer leurs dettes, 20.000 talents, avec la délicatesse d’un ami[45], ils se mutinent
et demandent tous à partir. Alexandre, indigné, descend de son siège suivi de
ses gardes, saisit les plus mutins au milieu de la foule qui murmure, et les
livre au supplice. Puis il remonte, leur rappelle longuement tout ce qu’ils
doivent de puissance, de bien-être, de gloire à Philippe et à lui-même : Partez, ajoute-t-il ; allez
dire aux Grecs qu’Alexandre, abandonné par vous, s’est remis à la foi des
barbares qu’il avait vaincus ! » Il rentre alors dans sa tente et
refuse pendant deux jours de voir ses plus intimes amis. Le troisième, il
convoque les principaux chefs, leur distribue les commandements et se compose
une armée toute persique. A cette nouvelle, les Macédoniens ne peuvent
supporter l’idée d’être remplacés par les Perses dans l’affection d’Alexandre
: ils courent en foule à sa tente, le supplient de se montrer, implorent son
pardon. Il s’avance ; à l’aspect de leur humiliation et de leur désespoir, il
est vaincu, et mêle ses larmes aux leurs : Vous êtes
tous ma famille, s’écrie-t-il ; je ne
vous donne plus d’autre nom ! Un banquet de neuf mille convives
où Alexandre tint sa place scella la réconciliation. Puis il licencia de leur
plein gré dix mille Macédoniens que l’âge ou les blessures avaient rendus
impropres aux combats. Il leur donna, outre l’argent nécessaire pour le
voyage, un talent à chacun, et chargea Cratère de les reconduire dans leurs
foyers.
Vers cette époque, Alexandre eut une grande douleur : il
perdit, à Ecbatane, Héphestion, son plus intime ami[46]. Il lui fit des
funérailles telles qu’homme n’en eut jamais; on dit qu’elles coûtèrent 40.000
talents et qu’il demanda à l’oracle d’Ammon si Héphestion devait être honoré
comme un héros ou comme un dieu[47]. Les soins du
gouvernement firent promptement diversion à sa tristesse. Entre la Susiane et la dédie, les
Cosséens habitaient un pays difficile et vivaient à peu près indépendants
dans leurs montagnes. Alexandre ne pouvait laisser, au cœur de son empire,
sur la route de Suse à Ecbatane, une liberté trop fière pour n’être pas d’un
dangereux exemple. Une campagne de quarante jours, marquée par des combats
heureux pour les Macédoniens et par une répression rigoureuse pour les
indigènes, eut raison de ces tribus farouches. A Babylone, où il rentra enfin
(printemps de 325),
il trouva des ambassades arrivées de toutes les parties du monde connu. Il en
vint d’Italie : des Bruttiens, des Lucaniens, des Étrusques ; il en vint
d’Afrique : des Carthaginois, des Éthiopiens, des Libyens. Des Scythes d’Europe
s’y rencontrèrent avec des Celtes et des Ibères[48]. Les Macédoniens
entendirent des noms inconnus, et se virent invoqués, comme arbitres, par des
peuples dont ils ignoraient l’existence et la demeure.
Au milieu de ces hommages, et pour les justifier,
Alexandre ne rêvait rien que de grand. Selon les
uns, il se proposait de faire le tour de l’Arabie, de côtoyer l’Éthiopie, la Libye, la Numidie et le mont
Atlas, de franchir les colonnes d’Hercule, de pénétrer jusqu’à Gadès, et de
rentrer ensuite dans la
Méditerranée après avoir soumis Carthage et toute l’Afrique...
Selon d’autres, il se serait dirigé par l’Euxin et le Palus-Méotide contre
les Scythes. Quelques-uns même assurent qu’il pensait à descendre en Sicile
et au promontoire d’Iapygie, attiré par le grand nom des Romains. Arrien
se trompe : ce nom n’avait rien de grand encore. Mais il est certain qu’Alexandre
fit construire en Phénicie des galères, qui devaient être transportées à
Thapsaque pour de là descendre l’Euphrate jusqu au golfe Persique et qu’il
envoya trois expéditions sur les côtes d’Arabie, afin d’achever le
jalonnement de la route maritime entre les bouches de l’Indus et celles du
Nil. La plus hardie fut celle du Cilicien Hiéron, qui paraît avoir longé à
peu près toute la côte orientale de la péninsule. Héracleidès était envoyé
dans un but semblable en Hyrcanie, sur les bords de la mer Caspienne, et
devait y construire une flotte pour chercher si cette mer n’avait pas de
communication avec le Palus-Méotide et l’océan du Nord.
En attendant qu’il pût partir pour de nouvelles conquêtes,
il s’occupait d’améliorations intérieures. Il faisait creuser à Babylone un
port capable de contenir mille galères, avec des abris pour les recevoir, et
enlever les barrages que les rois de Perse avaient jetés dans le Tigre
inférieur, pour entraver la navigation. Il parcourait le lac Pallacopas, où l’Euphrate
se déchargeait, lors de la fonte des neiges, mais où les eaux se perdaient
ensuite sans utilité. Pour mieux régler les prises d’eau qui épuisaient le
fleuve, il fit travailler dix mille hommes pendant trois mois à cet ouvrage.
Un jour qu’il naviguait sur le lac prés d’un lieu où s’élevaient les tombeaux
de quelques anciens rois, le vent emporta son diadème, qui s’arrêta aux
buissons des tombes. Un matelot se jeta dans l’eau pour aller le reprendre,
et le mit sur sa tête en regagnant à la nage la barque royale. Les prêtres
chaldéens virent dans ce fait un signe funèbre et firent mettre le soldat à
mort. Arrien dit, au contraire, qu’il fut récompensé, ce qui est plus
probable. Quant aux présages sinistres, il arriva, comme toujours, qu’après l’événement
on crut en avoir remarqué. Le conquérant de l’Asie ne pouvait disparaître si
jeune sans que les imaginations ne missent en mouvement la nature et les
dieux pour annoncer sa fin prochaine. Alexandre prépara lui-même son destin.
Dans la joie de son triomphe et après tant de misères héroïquement
supportées, il s’abandonna sans retenue à ces plaisirs de la table où tant de
fois son père et lui avaient laissé leur raison. Sous la latitude de Babylone
cette intempérance était un arrêt de mort. A la suite de plusieurs orgies
longtemps prolongées, il fut pris d’une fièvre dont il avait peut-être gagné
le germe dans les miasmes des marais du Pallacopas. Elle le mina durant dix
jours; le onzième il expira, 21 avril 323. Quelques semaines auparavant, des députés
grecs étaient venus l’appeler dieu et l’adorer.
Alexandre n’avait pas accompli sa trente-troisième année
quand il mourut. La force avait à peu près achevé son oeuvre : c’était à la
sagesse de faire le sien. Cette seconde tâche eût-elle été au-dessus de
lui ? Détruire est quelquefois facile, édifier ne l’est jamais. Le peu
qu’il a laissé entrevoir de ses desseins montre qu’il eût fait encore de
grandes choses, et la sévérité dont il usa à l’égard des satrapes
concussionnaires garantit qu’il eût donné à ses peuples une administration
vigilante.
Résumons en deux mots l’œuvre de ce conquérant qui ne
connaissait plus d’ennemis hors du champ de bataille :
Les vaincus gagnés par ses égards et associés à ses plans[49] ;
Le commerce, lien des nations, développé en de grandes
proportions et voyant devant lui les routes ou nouvelles ou pacifiées qu’Alexandre
lui a ouvertes, les ports, les chantiers, les places de refuge ou d’étape qu’il
lui a préparées ;
L’industrie vivement sollicitée par les immenses richesses
autrefois inactives et stériles dans les trésors royaux, maintenant jetés
dans la circulation par la main prodigue du conquérant[50] ;
La civilisation grecque portée sur mille points de l’empire
par tant de colonies, dont une seule, Alexandrie, reçut et versa longtemps
sur le monde un flot inépuisable, mais trouble, de richesses et d’idées[51] ;
Un nouveau monde révélé à la Grèce, et les peuples, les
idées, les religions, mêlés, confondus dans une unité grandiose, d’où une
société nouvelle serait sortie, si la plus grande des forces, le temps, avait
été accordée à celui qui eut presque toutes les autres.
Voilà ce qu’Alexandre avait préparé et pourquoi, depuis
deux mille ans, l’histoire s’arrête et s’incline devant le nom de ce
victorieux, en oubliant ce que, trop complaisante pour la jeunesse et le
génie, elle se contente d’appeler ses fautes.
Mais qu’aurait-il donné à l’univers dompté ? Nul ne
le sait ; probablement l’uniformité de la servitude au milieu d’une grande
prospérité matérielle. Je vois bien dans une des mains du conquérant l’épée à
laquelle rien ne résiste, je ne vois pas dans l’autre les idées qu’il faut
semer sur le sillon sanglant de la guerre pour le cacher sous une riche
moisson. Ses violences, son besoin de briser tous les obstacles, l’orgueil
surhumain dont il était saisi, promettaient un gouvernement impérieux et dur,
utile aux vaincus tant qu’aurait vécu Alexandre, nécessairement désordonné
après sa mort. Qu’enfanta cette civilisation hellénique transportée par lui
au coeur de l’Orient ? Affaibli à force de s’étendre et privé du souffle
vivifiant de la liberté, l’esprit grec ne porta point dans sa patrie
nouvelle, pour la poésie et l’art, ces fruits savoureux et sains que, à la
fois excité et contenu, il avait si libéralement donnés au pied de l’Hymette
et du Parnasse. Des Asiatiques apprirent et parlèrent l’idiome des Hellènes[52], aucun ne leur
prit le mâle génie de leurs beaux jours, le sentiment énergique de la dignité
de l’homme et des droits du citoyen qui avait fait leur grandeur. Comme ces
pâles lumières qui ne font que rendre les ténèbres plus visibles, l’hellénisme
en Orient ne servit qu’à montrer d’une manière plus éclatante les lâchetés,
les faiblesses et les turpitudes des cours et des populations asiatiques.
Et la Grèce,
dont ici nous faisons l’histoire, qu’y gagna-t-elle ? La victoire d’Alexandre
riva ses fers, et avec l’indépendance des cités tomba ce mouvement
intellectuel que la liberté avait produit. La Grèce vit se déplacer les
pôles du monde moral, Pergame et Alexandrie succéder à Athènes, Éphèse et
Smyrne à Corinthe. Non seulement elle cessa d’être fécondée par ce flot d’hommes,
de poètes, d’artistes, de philosophes qui, un siècle plus tôt, arrivait vers
elle de toutes les rives de la Méditerranée, mais elle s’épuisera à fournir
les nouvelles cours orientales de généraux et de ministres, de parasites et
de soldats. Tout homme qui eût pu devenir l’honneur de sa patrie passera au
service étranger. Toute sève, tout sang généreux, tout talent, toute
ambition, s’éloigneront d’elle. La vie la quittera pour retourner, affaiblie,
languissante, à ses colonies asiatiques et africaines. Les Muses ne
chanteront plus aux lieux accoutumés, mais une dernière fois et d’une voix
affaiblie, en Sicile et à Cyrène[53], ensuite plus
rien. L’art et l’éloquence passeront pour un moment à Rhodes, la philosophie
aux bords du Nil, la science partout : celle-ci puissante encore ;
celle-là troublée, inquiète et confuse. Aristote, qui, durant un séjour de
près de treize années à Athènes (335-323), y avait écrit tous ses grands ouvrages, la quitte
pour n’y plus rentrer. Lycurgue venait d’y mourir, et elle va perdre encore
Démosthène et Phocion, que nul ne remplacera. Tout, jusqu’aux dieux, décline.
Alexandre, étendant ses droits de conquérant sur l’Olympe, a donné le second
rang au temple et au dieu d’Ammon, après Olympie, mais avant Delphes.
La
Macédoine même, quel profit lui revint-il de s’être épuisée
de sang pour faire couler à flots celui de l’Asie ? Cinquante ans après
la mort du conquérant, les barbares pillaient Ægées, sa vieille capitale, et
jetaient au vent la poussière de ses rois[54] !
On a voulu constituer un siècle d’Alexandre comme nous
avons eu le siècle de Périclès. Le conquérant, qui se faisait suivre dans ses
campagnes de l’Iliade, tenue toujours près de lui dans une cassette d’or ;
qui fut l’élève et qui resta l’ami d’Aristote, qui, enfin, répandit l’hellénisme
dans une moitié de l’Asie, semble mériter que son règne marque aussi une des
grandes époques de la civilisation. Mais l’on n’y trouve point une éclosion
nouvelle du génie grec. Les écrivains, les artistes qui florissaient sous lui
étaient les continuateurs de ceux qui les avaient précédés. Les derniers
orateurs ont disparu avec la liberté athénienne et que ne doit pas l’art d’Apelles
et de Lysippe à celui de Zeuxis et de Scopas ! L’ordre ionique prend sur la
côte d’Asie son plus brillant essor surtout à Priène, à Magnésie, à Milet,
dont le temple d’Apollon Didyméen était le plus vaste que Strabon connût[55]. Mais cet ordre
n’était pas une création du temps d’Alexandre. Quant au mouvement
philosophique du quatrième siècle, on sait qu’il procède de Socrate et de
Platon. Des trois écoles le plus en vue, celles d’Épicure, d’Arcésilas et de
Zénon, ou le plaisir, le doute et le devoir, les deux premières enseignent
aux Grecs la philosophie commode qui, alors leur convenait, et ce fut à Rome
que la troisième forma de nobles caractères.
|
 Alexandre ne pouvait échapper aux faiseurs de légendes.
Alexandre ne pouvait échapper aux faiseurs de légendes. 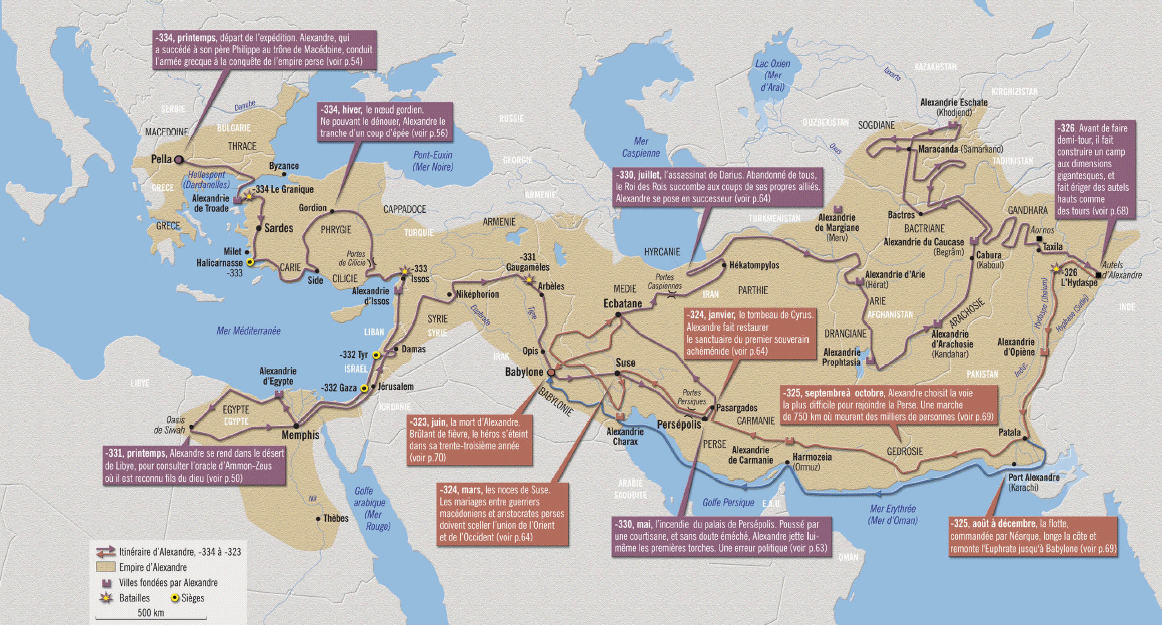
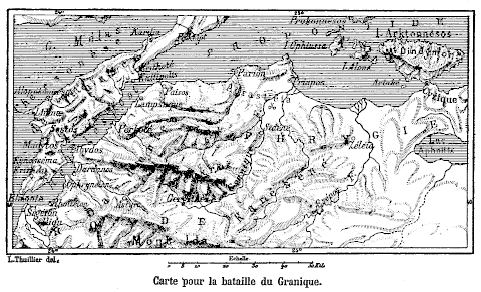
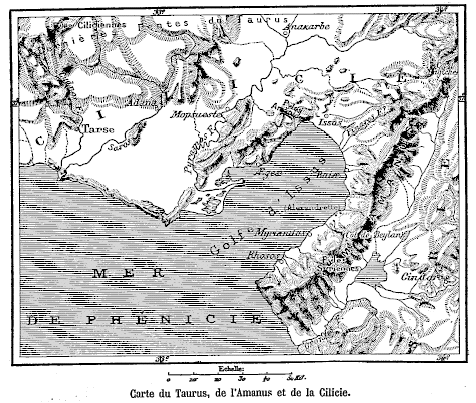
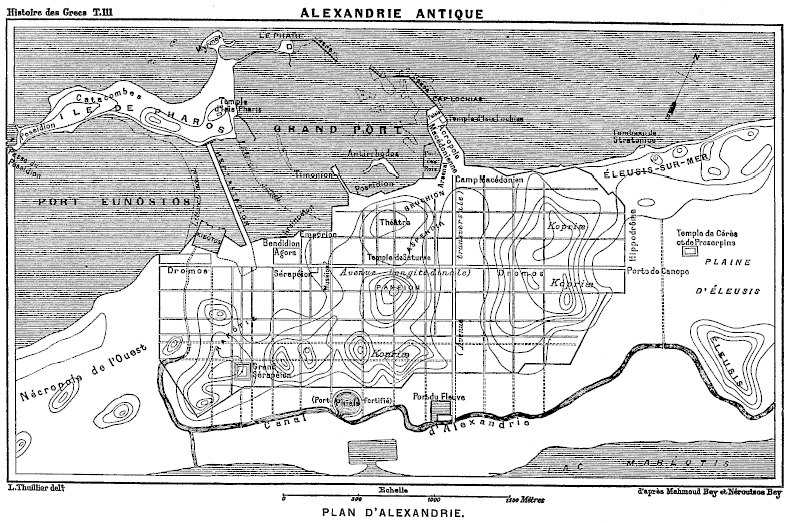
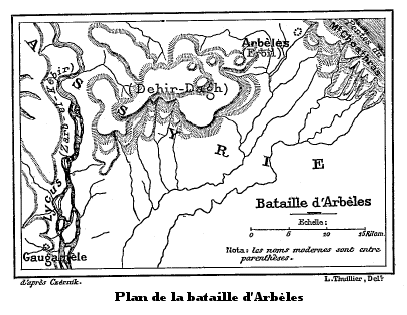
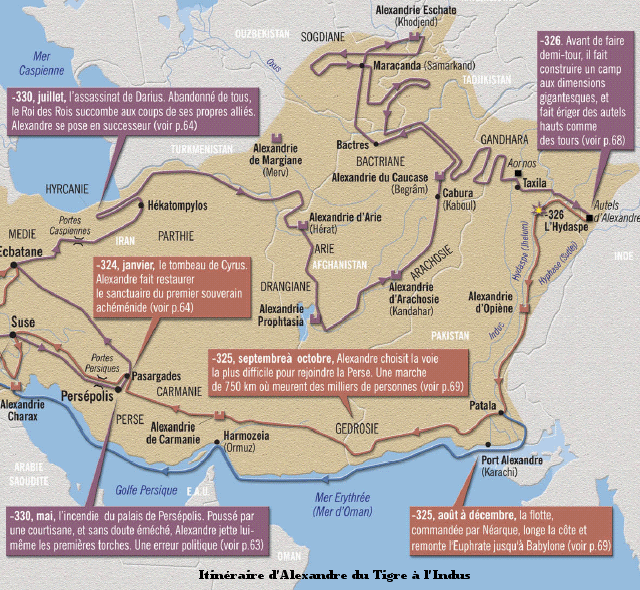
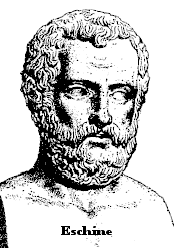 Avant que
la nouvelle de cette triste fin du dernier des successeurs de Xerxès eût
franchi la mer Égée, Eschine s’était écrié dans Athènes
Avant que
la nouvelle de cette triste fin du dernier des successeurs de Xerxès eût
franchi la mer Égée, Eschine s’était écrié dans Athènes