|
I. La Macédoine
avant Philippe
Nous avons vu s’élever rapidement une grande domination,
celle de Thèbes; mais elle resta ensevelie, avec Épaminondas, sous les
lauriers de Mantinée; jamais chute ne fut si près du triomphe. Thèbes, par
ses étonnants succès, avait enlevé à Sparte ses conquêtes et détruit le
prestige de son nom, de sorte que Lacédémone subissait le sort qu’elle avait
fait à Athènes. Les deux anciennes puissances, les deux têtes de la Grèce, se trouvaient donc
découronnées : le lien des confédérations qu’elles avaient nouées autour d’elles
était coupé. Au profit de qui ? Non pas de l’Arcadie, que la bataille sans larmes
avait dès ses premiers pas convaincue d’impuissance pour l’attaque ; non
pas d’Argos, ni de Corinthe, cités vieillies et usées ; non pas même de
Thèbes, qui brilla comme un éclair et disparut. Ainsi la Grèce manquait d’un centre
stable d’on une vie commune pût se répandre dans tous ses membres. Ce centre
avait été un moment à Lacédémone, puis à Athènes, et une seconde fois à
Lacédémone. Mais il se déplaçait encore ; l’axe de la Grèce inclinait vers les
contrées septentrionales. Thèbes avait eu son jour ; plus haut, une
puissance dominante avait failli se former et pouvait encore reparaître en
Thessalie : quand Jason s’était fait décerner le titre de tagos, une ombre avait été jetée sur l’indépendance
de la Grèce. Ce
n’est pas de là cependant, c’est de plus loin qu’allait venir le danger.
La chaîne d’où le Pinde descend, au sud, se prolonge à l’est
jusqu’à la mer Noire, sous les noms de monts Orbélos, Scomios et Hémos, en
suivant une ligne à peu prés parallèle au rivage septentrional de la mer
Égée. Le vaste espace encadré par ces montagnes et ces rivages, à partir de l’Olympe
et des monts Cambuniens, au sud, était habité par des populations thraces et
par celles qui ont formé le peuple macédonien. Celles-ci occupaient la partie
occidentale, et étaient séparées des premières par le Rhodope qui va de l’Hémos
à la mer Égée. Le Rhodope à l’est et l’Olympe au sud étaient les deux limites
extrêmes de la Macédoine,
celles du moins que ses rois voulurent lui donner.
Ce pays est partagé en plusieurs bassins par les montagnes
qui se détachent de la chaîne supérieure et descendent vers la mer. Au fond
de trois de ces bassins coulent l’Haliacmon, l’Axios et le Strymon. Les deux premiers
fleuves débouchent sur une côte basse où ils forment quantité de marais[1], le troisième au
contraire vient finir aux lieux oui s’élevèrent la puissante cité d’Amphipolis
et la forteresse d’Éion. Entre le golfe Thermaïque, où se perd l’Axios, et le golfe Strymonique, où se jette
le Strymon, le continent se prolonge dans la mer Égée, en une péninsule
presque ronde, terminée par trois langues de terre qui lui donnent quelque
ressemblance avec une main : c’est la Chalcidique. Les
larges et fertiles vallées de la
Macédoine contrastent avec les bassins étroits et le sol
infécond qui forment, de l’autre côté du Pinde, l’Épire et l’Illyrie. Il y
avait là place pour un grand peuple ; il s’y est trouvé, mais
tardivement, parce que, enfermés entre des montagnes et un littoral envasé,
les Macédoniens restèrent longtemps en dehors de la vie hellénique et eurent
besoin qu’un grand homme les y fit entrer.
On n’a pas de donnée précise sur la population de la
Macédoine[2]. Elle parait
avoir été un mélange de la race grecque et de la race barbare qui peuplait l’Illyrie
et l’Épire, bien qu’au temps de Polybe un Illyrien et un Macédonien ne
pussent s’entendre que par interprète. Lorsque les Hellènes envahirent la Grèce, une branche de
cette nation s’arrêta, sans doute, dans le sud-ouest de la Macédoine, sur le
cours supérieur de l’Haliacmon et de l’Érigon[3], tandis que le
nord, de l’Axios au Strymon, appartenait à la grande tribu illyrienne des
Péoniens, qui prétendaient descendre des Troyens; le sud enfin, à des
Thraces, Mygdons, Crestoniens, Édoniens, Bisaltes et Sitoniens. Les Thraces
Piériens habitaient entre l’Haliacmon et la mer, les Bottiéens, qui se
disaient Crétois, mais qui semblent Thraces comme leurs voisins, entre les
bouches de l’Haliacmon et celles de l’Axios. Au contact de ces barbares, la
race grecque s’altéra, et il se forma une population mixte, à laquelle
Hérodote refusait le nom d’Hellènes, mais qui montra une grande facilité à
adopter l’idiome hellénique. Si, parmi les noms Macédoniens que l’histoire et
les inscriptions nous ont conservés, quelques-uns sont barbares, le plus
grand nombre se rattachent au grec. Cependant on reconnut toujours un
Macédonien à la manière dont il prononçait certaines lettres de cette langue.
Ce peuple formait plusieurs tribus qui, chacune, avait son
chef, les Élyméens, les Orestes, les Éordéens, les Pélagoniens, les
Lyncestes, qui avaient une capitale du nom d’Hercule, Herakleia. La plus puissante habitait autour d’Ægées,
sous le nom, depuis célèbre, de Macédoniens. Chez quelques-unes de ces
vaillantes peuplades, l’homme, qui n’avait pas abattu un sanglier à la
chasse, restait assis et non couché dans les festins, et celui qui n’avait
pas tué un ennemi était marqué d’un signe de déshonneur[4]. La femme paraît
y avoir été plus libre, plus influente que dans la Grèce.
Nous n’avons, sur la primitive histoire de ce pays, ni
épopées, ni chants nationaux, ni légendes nombreuses, comme il y en eut tant
en Grèce. Thucydide raconte seulement que, vers le neuvième siècle, c’est-à-dire
au temps où les constitutions républicaines se substituaient à la royauté, un
Héraclide d’Argos, Caranos, se rendit, sur la foi d’un oracle, à la tête d’une
troupe de Grecs, dans le pays des Orestes. Le roi de cette contrée le prit à
son service dans une guerre contre les Éordéens, et, en récompense du secours
qu’il en reçut, lui donna l’Émathie, province au nord du golfe Thermaïque. On
disait que Caranos, conduit par une chèvre à Édesse, capitale de cette
contrée, lui donna, en mémoire de ce fait miraculeux, le nom d’Ægées[5]. Cette ville
continua d’être la capitale du pays jusqu’à l’époque d’Amyntas et de
Philippe, qui transférèrent ce titre à Pella, plus rapprochée de la mer[6].
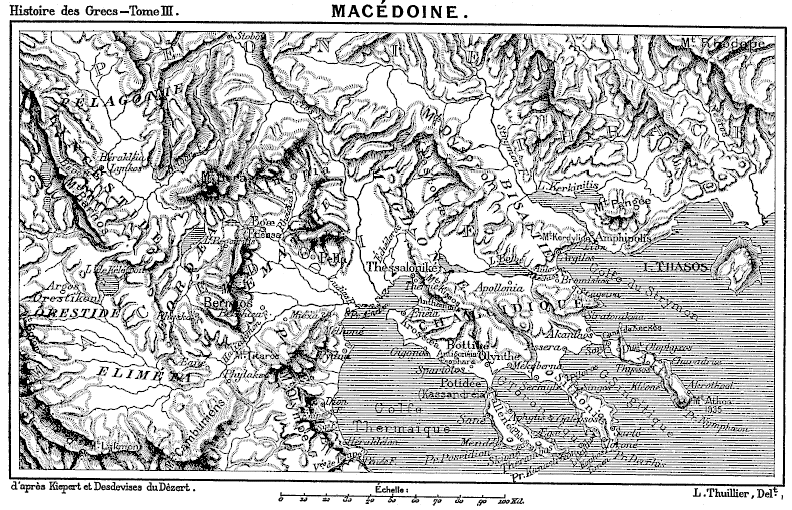
Le conteur par excellence, Hérodote, en sait plus long.
Trois frères de la race de Téménos, quatrième descendant d’Hercule, Gauanès,
Éropos et Perdiccas, exilés d’Argos, se rendirent en Illyrie et de là
passèrent dans la haute Macédoine, où ils se mirent au service du roi de
Lébéa pour garder ses troupeaux. Or, toutes les fois
que la reine faisait cuire le pain dont elle nourrissait ses serviteurs, le
pain destiné à Perdiccas doublait de poids ; elle fit part de cette
singularité au roi, qui y vit un prodige menaçant pour lui et ordonna aux
trois frères de s’éloigner de ses États. Ils répondirent qu’ils étaient prêts
à obéir aussitôt qu’ils auraient reçu les gages qui leur étaient dus. A cette
demande, le roi, qui se trouvait près du foyer où tombaient, par l’ouverture
du toit, les rayons du soleil, comme saisi d’une inspiration divine, dit en
leur montrant ces rayons : Tenez, je vous donne cela ; ce sont les
gages que vous méritez. A cette réponse, les deux plus âgés des frères,
Gauanès et Éropos, demeurèrent interdits ; mais le plus jeune, qui avait
un couteau, s’écria : Eh bien, nous acceptons ! Et ayant tracé
avec son couteau un cercle sur le plancher, autour de la lumière du soleil,
il se baissa à trois reprises, feignant, chaque fois, de mettre les rayons du
soleil dans les plis de sa robe et de les partager avec ses frères ;
après quoi ils s’éloignèrent. Un de ceux qui étaient assis près du roi lui
fait remarquer l’action du jeune homme et la manière dont il avait accepté ce
qu’on lui offrait ; le roi s’inquiète, s’irrite, et envoie après eux des
cavaliers pour les faire périr. Il y a dans cette contrée un fleuve, auquel
les descendants de ces hommes d’Argos sacrifient comme à un dieu sauveur. Ce
fleuve, après que les Téménides l’eurent passé, se gonfla tellement que les
cavaliers n’osèrent le franchir. Les fugitifs ayant gagné une autre contrée
de la Macédoine,
s’établirent prés du lac appelé les jardins de Midas, où poussent des roses à
soixante feuilles, qui l’emportent par le parfum sur toutes les autres ;
c’est là aussi que Silène fut pris, au dire des Macédoniens, mais ces jardins
sont dominés par le mont Bermios que l’hiver rend infranchissable. Les
Téménides, après avoir soumis cette contrée, partirent de là pour conquérir
le reste de la Macédoine.
Hérodote donne donc pour chef à la dynastie que nous
connaissons en Macédoine l’Héraclide Perdiccas Ier, à une époque où la
royauté héroïque existait encore en ce pays, dans son antique simplicité.
Thucydide est du même avis, et la
Grèce reconnut cette origine par l’autorisation accordée au
fils d’Amyntas Ier, Alexandre le Philhellène,
comme Pindare l’appelle, de concourir aux jeux olympiques.
Hérodote donne pour successeurs à Perdiccas Ier, Argée,
Philippe, Éropos, Alcétas et Amyntas Ier, dont on sait peu de chose. Ce n’est
qu’à l’époque des guerres Médiques qu’un demi-jour se fait dans cette
histoire. Le royaume, sans étendre bien loin son action, était déjà
considérablement agrandi : le mont Bermios avait été franchi ; les
Piériens chassés de la tâte et rejetés à l’est sur le Strymon ; les
Bottiéens, au sud, vers la
Chalcidique, tout en conservant Pella. La domination
macédonienne avait même passé l’Axios ; les Édoniens étaient expulsés d’une
partie de la Mygdonie,
Anthémous occupée à l’entrée de la péninsule Chalcidique, dans l’intérieur,
les Éordéens et le petit peuple inconnu des Almopes dépossédés ; de
sorte que les rois de Macédoine tenaient, même au delà de l’Axios, de fortes
positions et paraissaient les suzerains des petits princes qui régnaient sur
les barbares voisins. Vers la mer, ils possédaient la côte de la Piérie jusqu’aux bouches
de l’Haliacmon, où ils étaient arrêtés par les Grecs, qui, dès la 10e
olympiade, avaient couvert la péninsule Chalcidique de leurs colonies et
fondé Méthone sur la côte même de la Piérie.
Telle était la situation de la Macédoine quand les
Perses s’emparèrent de la
Thrace. Amyntas Ier, un ami des Pisistratides, y régnait.
Il suivit l’exemple des peuplades voisines qui s’étaient soumises, et
consentit à offrir aux envoyés de Mégabaze, satrape de Thrace, la terre et l’eau.
Mais, dans un repas, ces ambassadeurs ayant oublié le respect dû aux femmes
de la cour de Macédoine , Alexandre, fils du roi, irrité de cette injure, les
fit assassiner par des jeunes gens qu’il avait revêtus de l’habit des femmes
outragées. Quand le satrape envoya réclamer ses ambassadeurs ou la punition
des coupables, Alexandre gagna celui qui était chargé de cette recherche, en
lui donnant la main de sa sœur, et le meurtre demeura impuni.
Cet Alexandre devint roi en 500. Quand les Perses de Xerxès
arrivèrent, les Macédoniens furent entraînés par le torrent ; mais,
quoique dans le camp des ennemis de la Grèce, Alexandre ne négligea aucune occasion de
prouver qu’il agissait contre son gré, et qu’il ne demandait qu’à servir ses
frères d’origine. C’est lui qui avertit les Grecs de quitter la Thessalie, lui que
Mardonius envoya à Athènes pour une négociation amiable, lui encore qui, la
veille de la bataille de Platée, vint la nuit, à cheval, au camp des Grecs,
et leur révéla les desseins de l’ennemi. Il n’en avait pas moins la faveur de
Mardonius, qui lui donna la
Thrace jusqu’au mont Hémos. Après la ruine de l’expédition
médique, cette acquisition fut perdue par la révolte des tribus indigènes.
Mais peut-être faut-il rapporter à la protection des Perses la soumission des
Bryges, des Thraces de la
Bisaltique, des Pélasges de Crestone, et des villes de
Therma et de Pydna. De la dernière qui, bâtie sur la côte de la Piérie, touchait à la
mer, il fit sa résidence habituelle, afin de regarder de plus près aux
affaires de la Grèce. On
comprend quelle habileté fut nécessaire au roi de Macédoine pour se tirer d’embarras
en si périlleuse occurrence, et trouver moyen, dans l’ébranlement universel,
d’arrondir son royaume. Ses successeurs, entourés comme lui d’ennemis, eurent
à tenir une conduite analogue. L’habileté politique, nécessité de la royauté
macédonienne, devint le caractère particulier de ce gouvernement. Ce fut
comme une école qui produisit pour dernier résultat Philippe, le plus habile
homme d’État de l’antiquité grecque.
La
Macédoine avait grandi par l’amitié des Perses ; elle
grandit aussi par leurs défaites. A la faveur des victoires d’Athènes,
Alexandre Ier, l’hôte de la République,
et Perdiccas II accrurent leurs domaines : tout le pays, entre l’Axios et le
Strymon, devint macédonien. Mais Perdiccas avait un frère, Philippe, qui
possédait quelques districts de cette région, et
les deux frères étaient ennemis. Athènes s’allia avec le plus
faible, et pour avoir constamment l’œil et la main sur la Thrace et la Macédoine, elle fonda
Amphipolis à l’embouchure du Strymon. De ce jour, Perdiccas fut un de ses
adversaires les plus actifs ; il s’unit à Corinthe, soutint Potidée
rebelle, sollicita Sparte d’envahir l’Attique et prépara, dans la Chalcidique, une
autre révolte contre Athènes. Dans Olynthe, enfin, que sa position mettait à
l’abri des flottes athéniennes, il réunit la population de plusieurs petites
villes de la côte : c’était un boulevard qu’il croyait donner à la Macédoine.
Athènes ne demeura pas en reste avec lui. A l’est de la Macédoine, se
trouvaient les Odryses sous le commandement du roi Sitalcès, qui avait fait
reconnaître son autorité aux plus vaillantes peuplades de la Thrace. Il ne
demandait qu’une occasion de mettre le pied chez son voisin. Les Athéniens l’y
poussèrent, et il entra en Macédoine avec une nombreuse armée qui imposa de
dures conditions. Ces conditions, Perdiccas les viole ; Sitalcès
reparaît plein de colère, s’avance, malgré les courageux efforts de Perdiccas
et des petits princes du Nord ; jusqu’à l’Axios, ravageant tout sur sa
route, et devient si redoutable, qu’Athènes effrayée cesse de lui fournir des
provisions (429).
Perdiccas saisit le moment, il regagne le roi des Odryses qui se retire,
peut-être en livrant Philippe à son frère.
Perdiccas s’était rapproché un instant d’Athènes pour être
en état de repousser son formidable adversaire. Le danger évanoui, il
redevint son ennemi, excita contre elle les villes de la Chalcidique, s’allia
avec Lacédémone et obtint qu’elle envoyât de ce côté Brasidas (424). Il avait un
autre projet ; il voulait que le Spartiate l’aidât à dompter les petits
princes de la haute Macédoine, qui s’efforçaient d’échapper à sa suprématie.
Derdas, roi des Orestes, avait, pour cette raison, pris récemment les
armes ; actuellement, c’était Arrhibée, roi des Lyncestes. Brasidas
refusa d’abord ; puis, quand il se fut emparé de toutes les villes
chalcidiques et d’Amphipolis, il consentit à joindre ses troupes à celles de
Perdiccas. Mais, en présence de l’ennemi, les mercenaires illyriens du roi
firent défection, les Macédoniens, effrayés, s’enfuirent, et Brasidas, avec
ses Grecs, opéra une retraite difficile (423).
Cet événement altéra la bonne amitié du roi et des
Spartiates ; d’ailleurs ceux-ci, à leur tour, étaient devenus trop
redoutables : Perdiccas traita avec Athènes, et obtint des Thessaliens qu’ils
fermassent le passage aux armées lacédémoniennes. Les choses restèrent sur ce
pied jusqu’à sa mort (418).
Sa règle de conduite avait été de ne point se lier par de durables alliances,
et de faire servir tour à tour à sa puissance Athènes et Sparte, Corinthe et
les Odryses : politique peu généreuse, ne méritant pas, à qui la pratique, l’estime
de l’histoire, mais habile, hardie, et qui perd les États ou les conduit à
une grande fortune.
Alexandre Ier avait commencé la série de ces princes
macédoniens qui sentirent le besoin d’helléniser leur peuple pour ajouter,
aux forces de la barbarie, l’éclat et les ressources de la civilisation.
Perdiccas Il suivit son exemple ; il ouvrit ses États aux Grecs que la
guerre chassait de leur patrie et reçut dans sa demeure royale le poète
Mélanippide, même Hippocrate. Ses successeurs continueront cette tactique
intelligente : ce seront les Macédoniens qui donneront à la Grèce ses derniers
défenseurs et qui écriront à Pydna la dernière page de son histoire.
Après Perdiccas II, l’expédition de Sicile, les revers d’Athènes,
le déplacement du théâtre de la guerre, qui fut porté sur les côtes de l’Asie,
laissèrent respirer la
Macédoine. Sparte fit, en Chalcidique, succéder sa
domination à celle d’Athènes : elle était moins à craindre parce qu’elle
avait moins de marine. D’ailleurs le nouveau roi, Archélaos Ier, appliquait
ses soins à un autre objet ; il cherchait moins à s’agrandir qu’à fortifier
la royauté, qui n’était point encore sortie des traditions de l’âge héroïque.
Pour arriver au trône, il avait égorgé un frère, un oncle, un cousin, dont
les droits étaient supérieurs aux siens. Un tel homme, maître d’un pouvoir
acheté si cher, ne devait pas être disposé à l’abandonner aux grands. Cette
noblesse avait la fierté d’une aristocratie dorienne à demi barbare.
Archélaos soutint contre elle une lutte opiniâtre ; il réussit à la
rendre plus docile et à saisir l’autorité qui vient naturellement aux princes
quand les peuples sentent d’instinct que le pouvoir d’un seul leur est
nécessaire. Il fit, dit Thucydide, pour l’organisation et la puissance de la Macédoine, plus que
ses huit prédécesseurs pris ensemble[7]. Au lieu de
mercenaires sans fidélité et de levées tumultueuses sans expérience ni
discipline, il eut une armée régulière. Il fortifia des villes pour arrêter
les invasions et ouvrit des routes pour favoriser le commerce et l’agriculture,
peine que ne se donnaient pas les gouvernements de ce temps-là. Trouvant
Pydna trop exposée aux attaques par mer, il se construisit une autre
capitale, Pella, située dans l’intérieur des terres et défendue par des
marais, tout en étant, par un fleuve voisin, le Ludias, en communication avec
le golfe Thermaïque. Au pied de l’Olympe, sur la route qui menait à la vallée
de Tempé, il fonda Dion, où il appela la civilisation de la Grèce. A Ægées, il
institua des jeux en l’honneur de Jupiter, comme les Grecs en célébraient à
Olympie. Sa cour était magnifique : il y fit venir des artistes de la Grèce : Zeuxis exécuta
dans son palais des peintures que le roi paya 7 talents. Il s’efforça
vainement d’y attirer Sophocle, dont le fier génie ne se plaisait que dans
Athènes, et Socrate, qui eût cessé d’être lui-même s’il eût quitté l’Agora ;
mais il réussit auprès d’Euripide, qui vint terminer sa vie en Macédoine
auprès de deux autres poètes, Chœrilos et Agathon, alors célèbres, et du
musicien Timothée ; Athénée dit qu’il était en relation d’amitié avec
Platon. A ce pays enfin, demi grec et demi barbare, qui n’avait ni vie civile
régulière, ni commerce, ni industrie, ni art, ni littérature, Archélaos donna
les éléments de toutes ces choses, s’efforçant de faire regagner en peu de
temps, à son peuple, l’avance que les Grecs avaient prise sur lui. Le Pierre
le Grand de cette Russie du monde grec périt assassiné en 399, victime
peut-être des ressentiments de la noblesse.
On pourrait pousser plus loin la comparaison avec la Russie, en ajoutant que
cette civilisation hâtive ne pénétra pas dans la masse de la nation et ne fit
que polir, peut-être corrompre, la noblesse et la cour. Lorsque mon père devint votre roi, dira un jour
Alexandre aux Macédoniens mutinés, vous étiez
pauvres, errants, couverts de peaux de bêtes et gardant les moutons sur les
montagnes ou combattant misérablement pour les défendre contre les Illyriens,
les Thraces et les Triballes. Il vous a donné l’habit du soldat ; il
vous a fait descendre dans la plaine et vous a appris à combattre les
barbares à armes égales. Le roi civilisateur avait donc laissé
beaucoup à faire. Son règne d’ailleurs fut suivi de crimes, d’usurpations, de
meurtres et de guerres civiles qui remplirent quarante années (399-359). Oreste,
fils d’Archélaos, passe quatre ans sous la tutelle d’Aéropos, qui le fait
périr et règne à sa place pendant deux années. Aéropos laisse le trône à son
fils Pausanias, qui, au bout d’un an, est renversé par un descendant d’Alexandre
Ier, d’une autre ligne que celle qui avait régné jusque-là (393). Cet Amyntas
II est bientôt chassé par Bardylys, chef de brigands, devenu roi des
Illyriens, qui donne le trône à Argée, frère de Pausanias ; mais il
rentre avec le secours des gens de Thessalie et d’Olynthe. Ceux-ci étaient
alors menaçants pour la
Macédoine. Sparte brise leur puissance et les force de
rendre à Amyntas toutes les places qu’il leur avait cédées dans un moment de
détresse. Ce prince vécut alors tranquille à Pella, allié à la fois de Sparte
et d’Athènes. Ainsi la royauté de l’âge héroïque qui, dans les pays grecs, ne
s’était conservée qu’à Sparte et en Épire, mais très déchue, était encore
vivante en Macédoine. Le roi est supérieur à tous,
dit Aristote, en richesse et en honneur.
Cependant il vivait habituellement au milieu de troubles et de révolutions
qui ne donnaient pas aux peuples plus de tranquillité que les démagogues n’en
assuraient aux cités démocratiques.
Amyntas II laissa trois fils, Alexandre II, Perdiccas et
Philippe (369).
Le premier fut, après deux ans de règne, assassiné par Ptolémée d’Aloros, qui
appartenait à la maison royale, mais par une naissance illégitime. On prétend
que la mère d’Alexandre, Eurydice, trempa dans le meurtre, pour favoriser
Ptolémée qu’elle aimait et qui eut la tutelle du jeune Perdiccas III. Un
prince du sang, Pausanias, soutenu par un parti macédonien et par les
Thraces, essaya de les renverser tous deux. Iphicrate, vieil ami d’Amyntas,
se trouvait alors avec une armée près d’Amphipolis, qu’il voulait recouvrer pour
Athènes. Eurydice lui demanda une entrevue, et en lui présentant ses deux
jeunes fils, Perdiccas et Philippe, elle leur fit embrasser ses genoux comme
des suppliants. Iphicrate prit en main leur cause ; il chassa Pausanias
de la Macédoine,
et le jeune Perdiccas resta sous la tutelle de Ptolémée et dans l’alliance d’Athènes.
Thèbes vit avec dépit cette influence et la renversa. Pour tenir le régent en
bride, Pélopidas emmena à Thèbes Philippe, le plus jeune des fils d’Amyntas (368).
Dès que Perdiccas fut homme, il vengea, dans le sang de
Ptolémée, le meurtre de son frère aîné, la honte de sa mère et les dangers
que lui-même avait courus (365). Il régna cinq années encore et sembla marcher sur les
traces d’Archélaos : il entretint des relations d’amitié avec Platon et
profita de la détresse des Amphipolitains, serrés de près par Athènes, pour
mettre garnison dans cette ville; mais, attaqué en 359 par les Illyriens, il
périt en les combattant, ou tomba sous les coups d’assassins soudoyés par sa
mère Eurydice.

II. Avènement de Philippe (359) ; ses réformes ;
conquête d’Amphipolis
 Le frère de Perdiccas III, Philippe, troisième et dernier
fils d’Amyntas II, était alors âgé de vingt-trois ans. Il avait quitté Thèbes
depuis plusieurs années pour prendre le commandement d’une province que
Perdiccas lui avait cédée, peut-être à la sollicitation de Platon. Son séjour
dans la ville qui venait de prendre le premier rang dans le monde hellénique
acheva ce que la nature avait fait pour lui. Il vit la Grèce arrivée au plus haut
degré de civilisation, Thèbes au plus haut point de puissance, et il eut le
singulier bonheur de vivre auprès d’un homme qui semblait résumer en lui
toutes les qualités de sa race, grand général, orateur et philosophe : c’est
nommer Épaminondas. Et, pour un esprit sagace, que d’utiles observations à
faire au milieu de ces luttes d’ambition, conduites avec les derniers
raffinements de la politique : sur les champs de bataille, une tactique
nouvelle, supérieure même à celle de Sparte ; dans les cités, les
brusques emportements et les défaillances des assemblées populaires, la
passion siégeant au conseil plus souvent que la sagesse, la publicité des
plans, les lenteurs de l’exécution, la vénalité des chefs. Connaissance des
hommes et des choses, qui deviendra un terrible moyen d’action entre les
mains d’un homme souple et hardi, entreprenant et rusé, avide de gloire et l’allant
chercher partout, même là où elle se vend le plus cher, dans le péril[8] ; d’une
activité indomptable, servie par une santé de fer ; n’ayant rien du
tyran, affable, clément, généreux, pourvu que ces qualités aident à ses
desseins ; par-dessus tout, d’une ambition dévorante. qui, au besoin,
passait sur le corps de la justice pour atteindre et saisir la fortune ;
l’idéal enfin du politique, si le dernier mot de la politique est le succès. Le frère de Perdiccas III, Philippe, troisième et dernier
fils d’Amyntas II, était alors âgé de vingt-trois ans. Il avait quitté Thèbes
depuis plusieurs années pour prendre le commandement d’une province que
Perdiccas lui avait cédée, peut-être à la sollicitation de Platon. Son séjour
dans la ville qui venait de prendre le premier rang dans le monde hellénique
acheva ce que la nature avait fait pour lui. Il vit la Grèce arrivée au plus haut
degré de civilisation, Thèbes au plus haut point de puissance, et il eut le
singulier bonheur de vivre auprès d’un homme qui semblait résumer en lui
toutes les qualités de sa race, grand général, orateur et philosophe : c’est
nommer Épaminondas. Et, pour un esprit sagace, que d’utiles observations à
faire au milieu de ces luttes d’ambition, conduites avec les derniers
raffinements de la politique : sur les champs de bataille, une tactique
nouvelle, supérieure même à celle de Sparte ; dans les cités, les
brusques emportements et les défaillances des assemblées populaires, la
passion siégeant au conseil plus souvent que la sagesse, la publicité des
plans, les lenteurs de l’exécution, la vénalité des chefs. Connaissance des
hommes et des choses, qui deviendra un terrible moyen d’action entre les
mains d’un homme souple et hardi, entreprenant et rusé, avide de gloire et l’allant
chercher partout, même là où elle se vend le plus cher, dans le péril[8] ; d’une
activité indomptable, servie par une santé de fer ; n’ayant rien du
tyran, affable, clément, généreux, pourvu que ces qualités aident à ses
desseins ; par-dessus tout, d’une ambition dévorante. qui, au besoin,
passait sur le corps de la justice pour atteindre et saisir la fortune ;
l’idéal enfin du politique, si le dernier mot de la politique est le succès.
L’héritier du trône était un enfant, Amyntas. La tutelle
revenait naturellement à Philippe, son oncle ; il s’en empara. D’immenses
difficultés surgissaient de toutes parts et menaçaient de faire retomber le
royaume dans l’anarchie où, depuis quarante ans, il avait été tant de fois
plongé. Un cercle d’ennemis entourait la Macédoine : derrière et sur ses flancs, des
populations barbares ; devant, les Grecs qui occupaient les côtes de la
mer Égée; les Illyriens, qui, venant de tuer aux Macédoniens leur roi et
quatre mille hommes, menaçaient les provinces de l’Ouest ; enhardis par
ce revers, les Péoniens ravageaient celles du Nord ; à l’est, les
Thraces s’apprêtaient à tout envahir; et au midi, les Athéniens épiaient l’occasion de reprendre
Amphipolis, leur éternel regret; enfin les déchirements intérieurs ouvraient
la porte aux étrangers. Des discordes récentes il restait deux prétendants :
l’un, Pausanias, ce prince du sang qu’Iphicrate avait déjà chassé, sollicitait
le roi des Thraces ; l’autre, Argée, l’ancien adversaire d’Amyntas ou un
de ses fils, venait d’obtenir des Athéniens une flotte et trois mille
hoplites, sous les ordres de Mantias.
Pour faire face à tant de périls, un peuple découragé à
cause du désastre qu’il venait d’essuyer, une noblesse et des troupes
arrogantes, comme il arrive toujours dans les guerres civiles, et d’une
fidélité équivoque, au milieu de prétentions qui pouvaient faire douter où
était le droit et où serait le succès. Il y avait donc ranimer la confiance
des Macédoniens en eux-mêmes, à se les attacher et à les unir sous une forte
discipline, de telle sorte qu’ils pussent combattre avec avantage ceux qui
les regardaient comme une proie facile : voilà pour l’intérieur. Au dehors, il
fallait débarrasser les frontières, refouler à droite les Illyriens, à gauche
les Thraces, et jeter à la mer les Grecs qui barraient à la Macédoine l’accès du
golfe profond que la nature avait disposé pour être son domaine.
Ce fut là le premier plan, un plan de délivrance; le
second sera un plan de conquête : de cette Macédoine pacifiée et étendue à
ses limites naturelles, de cette forteresse qui domine la Grèce, Philippe sortira, à
l’ouest, pour envahir l’Illyrie ; à l’est, pour asservir la Thrace. Il voudra
mettre une main sur Byzance, la clef de l’Euxin, et l’autre sur les
Thermopyles, la clef de la
Grèce. Cela fait, la conquête de l’empire perse ne sera
plus qu’un jeu. Philippe, quoi qu’on en ait dit, ne conçut pas tout d’abord
ce dessein gigantesque. Une espérance nouvelle sortit pour lui de chaque
succès nouveau. Le plan grandit avec la fortune, et il avait été si bien
conçu, dès l’origine, dans ses proportions restreintes, qu’il convint ensuite
à une situation plus haute. C’est pour Philippe une assez grande gloire, sans
qu’il soit besoin de lui faire prévoir l’avenir vingt ans avant que cet
avenir fût possible. Ajoutons que les étapes successives qui viennent d’être
marquées, Philippe les suivit avec la vaillance de Mars et la prudence
astucieuse d’Ulysse ; que son fils ne le remplaça qu’à la
dernière ; et que là même il eût précédé Alexandre, sans le coup de
poignard qui l’arrêta dans la force de l’âge, de la fortune et du génie.
D’abord, pour détacher Athènes du parti d’Argée, il
déclara qu’il laisserait Amphipolis indépendante. Dés largesses habilement
distribuées achetèrent l’inaction des Thraces. Avant que les Athéniens se
détachassent tout à fait de sa cause, Argée envahit la Macédoine, il fut
battu, probablement tué, et toute la troupe qu’il commandait cernée sur une
hauteur où elle fut forcée de se rendre. Il s’y trouvait quelques Athéniens :
Philippe les renvoie comblés de présents, et les fait suivre d’envoyés qui
portent à leur ville une lettre amicale. Avec les Athéniens, de tels procédés
n’étaient pas perdus ; la paix fut faite. Libre de ce côté, il se
retourne contre ceux qui, hier, lui imposaient d’humiliantes conditions.
Malgré le courage et l’habileté de leur chef Bardylis, soldat de fortune,
parti de très bas, il bat les Péoniens, qui reconnaissent sa suzeraineté. Les
Illyriens éprouvent le même sort et lui cèdent tout le pays à l’orient du lac
Lychnitis, avec les passages des montagnes que désormais il pourra leur
fermer.
Ces succès méritaient une récompense. On couronna l’Héraclide
qui venait, en si peu de temps, de relever à ce point la Macédoine. Y eut-il
vraiment, comme on l’a dit, usurpation ? La succession royale n’était
point régie par des lois invariables ; dans un tel pays, le trône était
un cheval harnaché en guerre que montait un Héraclide ; et par son
origine, par son courage, Philippe remplissait cette condition. Du reste, il
garda son neveu à sa cour, et plus tard il lui fit épouser une de ses filles. Un autre l’eût mis à
mort ; mais, fort de ses services et de sa popularité, Philippe pouvait
être confiant. Nul prince absolu n’usa, d’ailleurs, comme lui des moyens qui
ont cours dans les États libres : à l’armée, il montrait les qualités
physiques que le soldat estime ; cavalier infatigable, nageur intrépide,
il eût remporté le prix pour tous les jeux ou exercices militaires, et il
avait en plus l’éloquence qui ajoute tant de force à l’autorité du
commandement. Au palais, dans la ville, affable et séduisant, il aimait,
selon la coutume du pays, les longs festins, les coupes profondes, et il en
plaisait d’autant plus aux Macédoniens. Mais, au besoin, il était sobre et
dur à lui-même, vivant avec ses troupes et, comme elles, au hasard des
marches qui le conduisaient en des localités plantureuses ou stériles; et ce
dédain du chef pour les commodités de la vie va toujours au cœur du soldat.
Cette popularité lui avait rendu l’accès du trône facile ; faciles aussi
rendit-elle les réformes dont le royaume avait besoin et pour lesquelles il s’assura
la faveur du ciel : des oracles habilement répandus le représentèrent comme l’homme
prédestiné à faire la grandeur de la Macédoine.
La longue faiblesse de ce royaume tenait à la mauvaise
organisation de l’armée et aux prétentions anarchiques de petits princes qui,
apparentés de près ou de loin à la famille royale, possédaient en
quasi-souveraineté de vastes domaines où ils avaient leurs gardes
particuliers. Un contemporain, Théopompe, donne à Philippe 800 hétaires ou
compagnons d’armes, aussi riches en terres à eux seuls que 10.000 hellènes. Il
se trouvait donc dans ce royaume, comme dans notre société féodale, une
noblesse en état d’embarrasser des rois faibles. Philippe profita des dangers
que le pays courait pour essayer de soumettre les uns et les autres, au nom
du salut commun et de la grandeur nationale, à une rigoureuse discipline. Il
habitua ses troupes à faire, avec armes et bagages, sous leur kausia, la coiffure nationale des Macédoniens,
des marches de 500 stades par jour (55
kilomètres). Il défendit aux soldats, même aux
officiers, l’usage des voitures, et ne permit aux cavaliers qu’un valet par
homme ; aux fantassins, un pour dix. On raconte qu’il congédia un étranger de
distinction pour avoir fait usage de bains chauds, et chassa deux de ses
généraux qui avaient introduit dans le camp une chanteuse. Un jeune noble s’était
écarté pendant une marche pour se désaltérer, il fut frappé de coups de
bâton, et un autre, qui, comptant sur la faveur du roi, était sorti des rangs
contrairement aux ordres, fut mis à mort. La foule voyait sans colère le
prince punir avec cette rudesse à demi barbare les grands dont la mollesse et
l’insolence l’avaient tant de fois irritée.
Philippe prit une autre précaution contre ses nobles, il
les amena à lui envoyer leurs enfants et à s’honorer que ceux-ci remplissent
près de lui les fonctions de la domesticité royale, en même temps que les
devoirs militaires de gardes du roi : c’étaient des otages qu’il
prenait. Ils avaient le privilège de ne pouvoir être battus de verges, si ce
n’est par ordre exprès du prince, celui de manger assis à sa table, et
surtout l’avantage d’arrêter au passage les faveurs royales. Les Βασιλιοί
παϊδες étaient des candidats désignés d’avance
pour les grandes fonctions; mais, dans cette monarchie militaire, ils
prenaient aussi part aux combats[9]. Philippe essaya
même d’en faire des lettrés qui pussent le servir en de délicates missions,
et rivaliser avec les Grecs d’instruction et d’éloquence. La royauté a
souvent employé des moyens analogues pour enchaîner l’aristocratie au trône
et transformer ses nobles eu courtisans à qui l’éclat de la cour faisait
oublier la vie rude, mais aussi l’indépendance du manoir seigneurial.
Le noyau de l’armée fut la phalange, dont l’idée première
avait été donnée par le système militaire d’Épaminondas. La phalange
présentait une masse d’hommes, serrés les uns contre les autres, sur seize
files de profondeur, couverts de fortes armures défensives, portant une
courte épée, un petit bouclier rond garni d’airain, et la sarisse, longue
pique de cinq mètres et demi[10], tenue à deux
mains, dont la pointe acérée protégeait l’homme du premier rang, à prés de
cinq mètres en avant de sa poitrine, de sorte que l’homme du second rang
portait encore sa lance à quatre mètres en avant du premier phalangiste,
celui du troisième à trois, et ainsi de suite jusqu’au soldat de la cinquième
file, dont la lance dépassait encore d’un mètre le front de la phalange. Les
autres soutenaient l’effort des cinq premiers rangs, et appuyaient leur
sarisse sur les épaules de ceux qui les précédaient, de manière à former
au-dessus de la phalange un toit de piques qui arrêtait une partie des traits
lancés sur elle. C’était donc bien cette bête monstrueuse et hérissée de fer
dont parle Plutarque : sur un terrain de niveau, rien ne pouvait lui résister.
Mais la phalange ne suffisait pas à elle seule : prise de
flanc ou en arrière, cette masse énorme était sans force, parce que, manquant
de souplesse et de mobilité, elle ne pouvait évoluer rapidement, ni changer
de front selon le besoin. Philippe lui donna l’appui d’une infanterie légère,
quoique armée de manière à combattre de prés, celle des hypaspistes, qui
commençaient le combat, gravissaient les collines et emportaient les
retranchements. En avant et autour d’eux couraient les gens de traits, troupe
irrégulière et composée d’étrangers.
La cavalerie des hétaires ou compagnons du roi,
munie d’une courte javeline et d’un sabre, pour joindre de près l’ennemi,
fut, avec la phalange, la force principale de l’armée macédonienne, et joua
toujours un rôle important dans les batailles asiatiques. Au Granique, à
Issus, à Arbelles, elle eut l’honneur de la journée : c’était notre cavalerie
de ligne ; elle se faisait aussi éclairer par une cavalerie légère, les sarissophores.
La principale noblesse du pays prenait rang parmi les hétaires[11].
Enfin, Philippe organisa encore ce que nous appellerions
un parc d’artillerie et de siège, c’est-à-dire que son armée fut toujours
pourvue de machines propres à lancer des traits contre l’ennemi ou des
quartiers de roc contre les remparts des villes, engins qu’avant lui on n’employait
pas, ou qu’on employait peu[12].
Remarquez qu’au moment où Philippe constituait si
fortement l’armée macédonienne, la
Grèce, pour les raisons que j’ai déjà dites, n’avait plus d’armée
nationale. Ce seul fait explique déjà bien des choses.
En Macédoine, le service militaire personnel était
obligatoire, comme il l’avait été dans toutes les cités grecques, avant que l’usage
s’établit d’acheter des mercenaires. Philippe eut donc autant de soldats qu’il
put en entretenir. Son armée ne compta d’abord que 10.000 hommes ; il en
accrût sans cesse le nombre, et finit par le porter à 30.000. Cette force
militaire, considérable pour l’étendue du royaume, et d’ailleurs
continuellement employée pendant un règne belliqueux, acquit une importance
qui transforma le gouvernement de la Macédoine en une sorte de despotisme militaire.
Les prérogatives dont le peuple, ou une certaine partie du peuple avait joui,
passèrent à l’armée qui, dans les lointaines contrées de l’Asie, représenta
la nation et hérita du droit de juger les criminels d’État. On verra
Alexandre consulter ses soldats dans plusieurs cas de haute trahison, et,
sous ses successeurs, les Macédoniens jouer souvent, dans les camps, le rôle
du peuple d’Athènes à l’Agora.
Deux années n’étaient pas encore écoulées depuis la mort
de son frère, et déjà Philippe avait pacifié et reconstitué la Macédoine. Un
pouvoir unique et fort était établi; une armée considérable s’organisait ;
la nation était réconciliée; les prétentions insolentes sévèrement contenues.
Les succès déjà remportés en promettaient d’autres ; car si Philippe était fort, le sol n’était
pas ingrat. Il y avait dans cette nation macédonienne une sève vigoureuse,
entretenue par le voisinage des barbares, et qu’il s’agissait seulement de
diriger. Les guerres civiles, loin d’affaiblir cette énergie, n’avaient fait
que lui donner plus de force, comme il arrive, quand cette force ne se
détruit pas en se tournant contre elle-même.
Reléguée jusqu’alors vers les pays barbares, la Macédoine ne pouvait
se faire une place dans le monde grec qu’en devenant puissance maritime,
comme la Russie
n’est devenue puissance européenne que du jour où elle a pris, avec
Saint-Pétersbourg, possession des côtes de la Baltique. Mais de
nombreuses forteresses d’Athènes et de ses alliées s’élevaient entre la Macédoine et la mer, comme les prix du combat exposés sur l’arène.
Philippe voulut les saisir. Ses premiers regards se tournèrent vers
Amphipolis qui, par sa position aux bouches d’un grand fleuve, ouvrait ou
fermait la mer à la
Macédoine et la vallée du Strymon aux Athéniens. Peu de
temps auparavant, le roi, faible encore et menacé, avait renoncé à toute
prétention sur cette ville ; maintenant il se croyait assez fort pour la
prendre. Des différends survenus à propos lui servirent de prétexte; il l’attaqua.
Mais il avait à craindre Athènes et Olynthe. Celle-ci, humiliée par
Lacédémone, s’était relevée après l’abaissement des Spartiates, sans reformer
toutefois la grande confédération à la tête de laquelle, en 382, elle était
placée. Si ces deux villes se liguaient, Philippe échouait. Avec une
merveilleuse adresse et une duplicité dont il donna par la suite plus d’un
exemple, il acheta la défection d’Olynthe en lui cédant la ville d’Anthémous ;
aux Athéniens, il persuada qu’il allait faire cette conquête pour eux, à
condition qu’ils lui permettraient d’occuper Pydna, qui, sous Amyntas, s’était
séparée de la Macédoine
pour entrer dans leur alliance. Quand ensuite les Amphipolitains, serrés dans
leurs murs par son armée, offrirent à Athènes de se rendre à elle, il lui
écrivit une lettre pour renouveler ses promesses. Les Athéniens étaient alors
fort occupés ailleurs, ils se reposèrent sur la bonne foi du roi et
rejetèrent l’offre d’Amphipolis. La ville fut prise (358), et ne paraît pas avoir été
traitée avec l’excessive rigueur dont parle Démosthène. Philippe se borna, au
témoignage de Diodore, à bannir les principaux citoyens du parti contraire. D’après
le traité avec les Athéniens, il n’était tenu de leur livrer Amphipolis qu’après
avoir occupé Pydna. Il assiégea immédiatement cette place, la prit par
trahison, et n’en garda pas moins Amphipolis : Athènes était jouée.
Son irritation ramenait la possibilité d’une ligne avec
les Olynthiens. Cette fois, ce furent ceux-ci que Philippe gagna par la
promesse de leur livrer Potidée, occupée alors par une garnison athénienne,
qui ouvrait ou fermait l’entrée de la presqu’île de Pallène. Potidée fut
prise, peut-être par trahison comme Pydna ; et le roi, fidèle par calcul
à sa parole, la livra aux Olynthiens (357) ; mais il traita avec une courtoisie parfaite la
garnison athénienne, et la renvoya dans sa patrie, protestant qu’il voulait
demeurer en paix avec Athènes. Que faisait-il ? Rien que de légitime en
apparence ; il n’attaquait pas, il reprenait ; comme disait un czar
de Russie essayant de mettre la main sur Constantinople, il reprenait les
clefs de sa maison.
La prise d’Amphipolis le faisait toucher à la Thrace et lui donnait les
bois de construction de la vallée du Strymon ; mais plus loin, à l’est,
était Crénides, au pied du mont Pangée[13], fameux depuis
longtemps par ses mines d’or et d’argent qu’on exploitait mal, parce que trop
de gens s’en disputaient la possession. Philippe s’empara de la ville des sources, en augmenta la population
par une colonie, la force par de solides remparts et lui donna son nom,
Philippes (356).
C’est dans les plaines du voisinage que la république romaine succombera,
avec Brutus et Cassius, les chefs des tyrannicides. Les mines du mont Pangée
avaient été jusque-là d’un faible produit; sous l’administration du roi,
elles rendirent annuellement plus de mille talents. Cette masse de métaux
précieux lui permit de faire une réforme monétaire qui eut pour la Macédoine une grande
importance commerciale : il frappa des tétradrachmes d’argent d’après le
système rhodien qui avait cours partout, et des statères d’or ayant la valeur
du darique persan que les Grecs ne connaissaient que trop. La Macédoine eut donc
alors le double étalon, comme on dit aujourd’hui[14]. Tétradrachmes
et statères coururent l’Hellade pour y acheter des soldats, des marins et des
traîtres.

III. Situation d’Athènes ; guerre sociale (357-356) ;
Isocrate et Démosthène
Comment les Athéniens le laissèrent-ils s’étendre ainsi
tout le long des côtes de la mer Égée ? La réponse est dans la situation
intérieure de la république et dans les embarras dont elle se trouvait
assaillie. Ce sont deux points qu’il importe d’expliquer en revenant de
quelques années en arrière.
Au dehors, Athènes ne s’était jamais complètement relevée
du coup qu’elle avait reçu à la fin du siècle précédent, bien que son
alliance avec Thèbes contre Sparte, et avec Sparte contre Thèbes, lui eût
permis de renouer quelques-uns des liens de son ancienne confédération[15]. Instruite par l’expérience,
elle avait mieux réglé ses rapports avec ses alliés et, parmi ses
concitoyens, plus équitablement réparti les charges. Mais les idées de
conquête étaient vite revenues. Timothée, rentré en grâce auprès du peuple
athénien, chassa, en 365, la garnison persane de Samos ; il s’empara de
Méthone, Pydna, Potidée, avec vingt autres villes de la Chalcidique et
soumit une partie de la
Chersonèse (364). Athènes étendit de nouveau sa domination sur l’Hellespont
et le long des côtes de Thrace ; de nouveau aussi les pauvres reçurent
des terres dans ces domaines de la république, et la politique de la
métropole se trouva gênée par les relations amicales ou hostiles qui s’établirent
alors si loin d’elle. Après Leuctres, Thèbes s’inquiéta de cette prospérité
renaissante. Elle mit garnison dans Oropos sur la frontière de l’Attique et
en face de l’Eubée, ce qui était une double menace pour Athènes ; puis
elle arma une flotte, montée par Épaminondas, qui força l’Athénien Lachès à
se retirer devant elle. Chios, Rhodes, Byzance et la Chersonèse furent
même contraintes de faire défection (364).
La mort d’Épaminondas arrêta la fortune de Thèbes, et
Athènes put retrouver la prépondérance sur mer. En 362, elle fit alliance
avec les satrapes révoltés de l’Asie Mineure ; deux ans après, pour
exploiter les lavages aurifères du district qu’on aurait pu appeler la Côte d’Or, elle envoya des
colons à Crénides, dont nous venons de voir Philippe s’emparer. Elle espéra,
un peu plus tard, recouvrer toute la Chersonèse de Thrace, par les succès de
Timothée sur Cotys, et après le meurtre de ce prince (359), par un traité avec les chefs
Odryses qui se disputèrent son royaume. Enfin un vigoureux effort de Charès
lui livra, en 357, cette province, qui lui était doublement nécessaire, car
là on commandait la grande route du commerce des blés et on percevait le
droit de douane sur les navires qui descendaient de l’Euxin. Le Bosphore
Cimmérien, au fond de cette mer, était le grenier du Pirée. Leucon, qui y
régnait alors sous le titre d’άρχων,
était un grand ami des Athéniens ; il avait autorisé leurs navires à
faire leur chargement en blé avant tous les autres, et il les avait exemptés
des droits de sortie, de sorte que leurs cargaisons, arrivant les premières
sur le marché, pouvaient se vendre à meilleur compte que celles des
concurrents. En échange, Athènes apportait dans ce royaume les mille objets
de son industrie et répandait l’influence des arts de la Grèce en des lieux sauvages
où d’anciens tombeaux nous livrent aujourd’hui des restes merveilleux de l’orfèvrerie
hellénique[16].
L’Eubée même fut ramenée dans le parti d’Athènes, par une
résolution digne des plus beaux, temps de la république. Un corps de troupes
béotiennes y avait débarqué; à cette nouvelle, Timothée s’indigne : Les Thébains sont dans l’île, s’écrie-t-il, et vous délibérez, et vous ne volez pas au Pirée, et la
mer ne se couvre pas de vos vaisseaux !
[17] Un décret est
aussitôt rendu ; mais tous les triérarques qui devaient cette année
servir avaient rempli leurs obligations, et il n’y avait personne qu’on pût
légalement contraindre à armer une galère. Comme à Rome, le patriotisme des
particuliers fournit à l’État ce que le trésor publie ne pouvait lui donner.
Les citoyens s’imposèrent volontairement, et cinq jours après, une armée
athénienne descendait dans l’Eubée et en chassait l’ennemi. Au nombre de ces
patriotes était Démosthène. Ce fut la première fois,
dit-il, qu’Athènes eut des triérarques volontaires,
et je fus du nombre[18]. »
Malheureusement ces actes, qui avaient été la vie
ordinaire du peuple athénien, n’étaient plus qu’un éclair de dévouement
passager. Les triérarques chargés de l’équipement des vaisseaux vendaient au
rabais l’entreprise à des aventuriers nécessiteux. Ceux-ci se payaient par
des rapines et des extorsions, dont les généraux mêmes ne se faisaient pas
faute. Charès volait une partie des fonds qu’il devait verser au trésor, et
achetait l’impunité en prenant les principaux orateurs à sa solde.
Avec des intentions meilleures, les Athéniens en étaient
arrivés à lasser plus qu’autrefois la patience des alliés, sans même se tenir
en état de les protéger efficacement. Dans la première moitié de la guerre du
Péloponnèse, la marine athénienne avait une telle supériorité, que marins et
amiraux étaient animés d’une confiance qui doublait leurs forces : nul
ennemi, même en nombre supérieur, n’osait les attendre. Maintenant que le
condottiérisme avait pris la place. du service par les citoyens, un
adversaire débauchait soldats, marins et pilotes, même les constructeurs.
Thèbes pouvait en quelques mois se donner une flotte et la promener
impunément à travers la mer Égée; pour son coup d’essai, Alexandre de Phères
battit une escadre athénienne ; il pilla Ténos, dont il vendit tous les
habitants, ravagea les Cyclades, assiégea Péparéthos et pénétra dans le Pirée
(366). Grâce à
cette confusion, les pirates reparaissaient, et lorsqu’ils s’étaient
enrichis, ils conquéraient, pour faire une fin, quelque ville et passaient de
bandits tyrans. Ainsi l’ancien pirate Charidèmos s’empara, sur la côte d’Asie,
de Skepsis, de Cébren, d’Ilion et y régna.
Puisqu’il n’y avait plus de sécurité, pourquoi aurait-on
maintenu une confédération coûteuse et inutile ? L’argent qui restait des
contributions des alliés, dit Isocrate, était distribué à chaque spectacle
pendant les fêtes de Dionysos, sous les yeux des alliés, témoins de ces
largesses faites au peuple du plus pur de leurs biens, par des orateurs
mercenaires[19].
En 357, ils rompirent ouvertement avec Athènes, et la guerre Sociale
commença. Rhodes, Chios, Cos et Byzance y prirent la part principale.
Il n’y a rien à dire de Cos ni de Byzance, si ce n’est que
la première avait donné le jour à Hippocrate et qu’Apelles venait d’y
naître ; que la seconde avait acquis déjà une grande importance, grâce à
son port si bien appelé aujourd’hui la Corne-d’Or, et à sa position au bout de l’Europe,
en face de l’Asie, sur la route que les navires athéniens suivaient pour
aller chercher les blés de la
Tauride et les poissons de l’Euxin. Rhodes était plus
fameuse. Vers 480 elle avait remplacé la royauté par un gouvernement
habilement mélangé d’aristocratie et de démocratie, qui avait préservé cette
île des révolutions intérieures : un vieil usage religieusement observé
obligeait les citoyens riches à soutenir les citoyens pauvres. Ceux-ci
recevaient d’ailleurs de l’État du blé ou un salaire pour des travaux publics
aux ports et dans les arsenaux, de sorte qu’ils ne restaient jamais dans la
misère ni dans l’oisiveté, deux mauvaises conseillères. L’établissement de
colonies au loin, jusqu’en Espagne et en Gaule, servit encore tout à la fois
à diminuer honorablement le nombre des pauvres et à étendre le commerce.
Cette sollicitude des riches était bien calculée : elle fit plus pour leur
repos que ne firent ailleurs toutes les violences. L’île avait trois cités
principales : durant la guerre du Péloponnèse, en 408, on résolut de lui
donner une capitale unique, et Rhodes fut fondée sur la côte septentrionale.
On en fit une ville somptueuse, pleine de temples, de majestueux édifices et
de richesses, mais pleine aussi de courage et de goût pour les choses de l’esprit.
Ces goûts devaient rapprocher les Rhodiens d’Athènes. Ils acceptèrent son
alliance et y restèrent fidèles tant que dura sa fortune. Après le désastre
de Sicile, ils passèrent dans le parti de Lacédémone; les victoires de Conon,
en 391, les ramenèrent dans celui d’Athènes[20].
Chios, l’île montagneuse, comme Homère l’appelait, où les anciens
ont placé quelquefois le séjour des bienheureux, à cause de la salubrité de
son climat, n’avait qu’un sol stérile que le granit perce à chaque pas. Mais
sur ce rocher avait grandi, par la lutte même contre une nature marâtre, une
population forte et laborieuse. Elle avait créé le sol qui lui manquait, et
les Chiotes étaient devenus les plus habiles agriculteurs de toute la mer
Égée. Un proverbe y court encore : Sous leurs mains
la terre s’améliore. Ils avaient taillé leurs montagnes en gradins, y
avaient porté de la terre, et, comme les Suisses ou nos Béarnais, avaient
forcé le rocher à produire : il leur donnait un vin renommé que Strabon et
Athénée estimaient le meilleur de la Grèce.
L’eau leur manquant, ils étaient allés en chercher au cœur
des montagnes, et, dans leurs plaines, ils avaient planté des forêts qui, au
mois de mai, embaumaient l’île entière, la mer et la côte asiatique[21]. Chios n’avait
point fondé de colonies et n’en eut jamais, mais ses négociants se
répandaient partout ; ils étaient les plus habiles spéculateurs et comme
les banquiers de tout le monde hellénique. Thucydide les regarde comme les
plus riches des Grecs. Ils avaient une institution particulière qui fut sans
doute une des suites et en même temps une des causes de leur prospérité :
tous les contrats entre particuliers devaient être passés devant les
magistrats et gravés sur la pierre ; l’État les prenait, comme nous,
sous sa sauvegarde.
Cependant ces richesses n’avaient point donné aux Chiotes
la pensée de jouer un rôle politique. Ils s’étaient bravement battus pour la
liberté de l’Ionie, à Lada, où ils avaient amené cent trirèmes; mais ils s’étaient
résignés à la domination persique, plus tard à celle d’Athènes, qui les
traita bien, ayant grand besoin de leur nombreuse marine. Dans les sacrifices
publics des Athéniens, on faisait à la fois des vœux pour Athènes et pour
Chios. Après l’expédition de Sicile, ils passèrent, eux aussi, du côté de
Sparte et, comme les Rhodiens, revinrent ensuite à Athènes.
Pourquoi ces deux peuples sages et prudents se
lancèrent-ils de nouveau dans les hasards de la guerre? L’ennui de payer un
tribut a une cité affaiblie, qui n’avait plus le prestige ni la force de la
victoire, y fut certainement pour beaucoup, mais plus encore peut-être une
révolution que nous connaissons mal et qui s’opérait en ce moment sur la côte
sud-ouest de l’Asie Mineure. Mausole[22] régnait à
Halicarnasse et sur toute la
Carie. Il paraît avoir été fort riche et puissant : on
connaît son fastueux tombeau. Nous savons qu’en 362 il fournit à Lacédémone
un subside et qu’il arma cent trirèmes; trois ans après, il fit réussir à
Rhodes et à Chios une révolution oligarchique qui plaça ces îles dans sa
dépendance ; Cos y était déjà, et en 345 son successeur y régnait encore[23]. Mausole avait
sans doute rêvé une domination maritime, et le mieux pour y parvenir, après
avoir rallié à soi les États qui tenaient le second rang sur mer, était d’abattre
celui qui, malgré tous ses malheurs, gardait encore le premier[24]. La ligue mit en
mer cent vaisseaux.
Le Pirée était vide et dans la cité il restait peu de
riches. Autrefois Athènes en avait assez pour que les galères fussent armées
chacune par un seul ou par deux citoyens. Mais ce temps était passé; il
fallut partager entre plusieurs les charges de la triérarchie. En 357,
Persandros fit appliquer à la flotte le système des symmories, établi en 378
pour l’impôt. Les douze cents citoyens portés aux registres du cens comme les
plus imposés furent réunis, selon l’importance de l’armement, en groupes de cinq
ou six, même de quinze ou seize, pour fournir à tour de rôle ce que l’État
avait, depuis Solon et plus anciennement encore, l’habitude de demander aux
triérarques. La mesure semblait nécessaire, car le temps des sacrifices
patriotiques allait revenir.
Ce système d’association réussit, et Athènes eut bientôt
deux flottes l’une de soixante galères qui partit, sous les ordres de Charès
et de Chabrias, pour assiéger Chios ; l’autre, de force égale, commandée
par Iphicrate et Timothée, se dirigea vers le nord. Dans une attaque
audacieuse contre le port de Chios, Chabrias se trouva seul au milieu de l’ennemi,
et se fit tuer plutôt que d’abandonner sa galère (357) ; c’était un vaillant homme :
peut-être fut-il le dernier des généraux d’Athènes. Ce revers décida Charès à
aller rejoindre Iphicrate et Timothée. On résolut de s’acheminer vers
Byzance, pour rappeler de ce côté les ennemis qui ravageaient les îles
restées fidèles, Lemnos, Imbros et Samos. La dernière fut sauvée ; mais
les flottes ennemies se rencontrèrent dans le canal de Chios, et Charès
voulut combattre, malgré ses deux collègues qu’effrayait l’imminence d’une
tempête. Il attaqua, espérant les entraîner et, laissé seul, fut battu ;
il s’en vengea en accusant, à Athènes, Iphicrate et Timothée de trahison. Le
peuple, charmé de sauver le favori du moment aux dépens de vieux serviteurs,
révoqua ceux-ci de leur commandement. Demeuré seul à la tête de la flotte,
Charès vendit ses services à un satrape révolté, Artabaze, pour se procurer l’argent
réclamé par ses troupes. Les Athéniens approuvèrent d’abord ce moyen de
régler les comptes avec leurs mercenaires ; mais la menace que fit le
grand roi d’envoyer trois cents vaisseaux aux alliés les décida à conclure la
paix (355),
après trois années d’une guerre dont nous savons fort mal les détails, et qui
par contrecoup entraîna la défection de Corcyre. Athènes reconnut l’indépendance
des confédérés. Elle perdit ses alliés les plus importants, avec les tributs
qu’ils lui payaient, ce qui lui en resta ne dépassa point 45 talents[25]. Ses finances et
son commerce étaient ruinés, sa foi en elle-même encore abaissée, et la
décadence de l’esprit public encore accrue. Le peuple, au lieu de s’accuser
lui-même, s’en prit à ses chefs. Timothée, qui compromettait par son caractère
la popularité que lui donnaient 6 ses services, fut condamné, en 356, à une
amende de 400 talents ; pour ne la point payer, il se retira à Chalcis,
où il mourut. Iphicrate se sauva par son fier langage, en opposant les actes
de toute sa vie aux vaines paroles du rhéteur qui l’accusait. Il avait
comparu entouré d’un grand nombre de ses compagnons d’armes, qui lui
faisaient un menaçant cortège : les juges intimidés l’acquittèrent, mais
depuis ce jour il renonça à servir. L’esprit soupçonneux de la démocratie
athénienne privait à la fois la patrie de ses deux meilleurs généraux (354).
 Vers ce
temps parut un écrit fameux, celui qu’Isocrate, un artiste en beau langage,
composa, sous forme de discours sur la Paix, probablement avant qu’elle eût été conclue,
à moins que la minutieuse lenteur de l’écrivain, trop occupé à polir ses
phrases et à mesurer des syllabes, n’ait fait un de ces plaidoyers posthumes
et d’apparat qui viennent quand il n’est plus temps[26]. Disciple du
même maître que Platon, Isocrate voulait appliquer à la conduite politique
ces grands principes d’équité que Socrate avait enseignés. Dans le discours de
la Paix
règne un sens moral élevé. L’idée dominante est que la justice seule peut
fonder des puissances durables, et que tous les malheurs d’Athènes sont venus
de ce qu’elle ne l’a pas respectée. Il pensait que l’oppression dont les
alliés étaient victimes les avait soulevés contre Athènes ; il
attribuait cette oppression à la corruption du peuple, des armées, des
généraux, et cette corruption même à l’empire de la mer, qui avait déjà perdu
Lacédémone. De là cette conclusion, qu’Athènes devait renoncer à l’empire
maritime, quand même on le lui offrirait. Vers ce
temps parut un écrit fameux, celui qu’Isocrate, un artiste en beau langage,
composa, sous forme de discours sur la Paix, probablement avant qu’elle eût été conclue,
à moins que la minutieuse lenteur de l’écrivain, trop occupé à polir ses
phrases et à mesurer des syllabes, n’ait fait un de ces plaidoyers posthumes
et d’apparat qui viennent quand il n’est plus temps[26]. Disciple du
même maître que Platon, Isocrate voulait appliquer à la conduite politique
ces grands principes d’équité que Socrate avait enseignés. Dans le discours de
la Paix
règne un sens moral élevé. L’idée dominante est que la justice seule peut
fonder des puissances durables, et que tous les malheurs d’Athènes sont venus
de ce qu’elle ne l’a pas respectée. Il pensait que l’oppression dont les
alliés étaient victimes les avait soulevés contre Athènes ; il
attribuait cette oppression à la corruption du peuple, des armées, des
généraux, et cette corruption même à l’empire de la mer, qui avait déjà perdu
Lacédémone. De là cette conclusion, qu’Athènes devait renoncer à l’empire
maritime, quand même on le lui offrirait.
Il semblait à Isocrate qu’une prudente modération et une
sagesse timide pouvaient seules faire le bonheur des États, comme celui des
particuliers. R appelait l’âge d’or d’Athènes l’époque d’Aristide et de
Thémistocle, oubliant que c’était Thémistocle qui avait jeté les fondements
de sa puissance navale, que c’était Aristide qui l’avait réglée, et que, sans
cette puissance, Athènes eût péri deux fois sous les coups de Xerxès et sous
ceux de Sparte. Plus de guerre ; qu’on désarme, les citoyens riches,
écrasés de contributions, respireront enfin ; les Athéniens ne s’aviliront
plus en confiant leurs armes à des mercenaires ; le commerce va se
relever; Athènes, désertée par les étrangers, les verra accourir de nouveau
dans son sein; les alliés, ravis de son désintéressement, tourneront vers
elle leurs regards et leurs voeux; ils se rangeront d’eux-mêmes sous cet
empire qu’elle leur a jusqu’ici imposé par la force, et le règne de la
justice arrivera. Ainsi, après avoir accusé l’empire maritime de tout le mal,
Isocrate y revenait. Tout occupé de cadencer ses périodes et plus attentif
aux mots qu’à la pensée, il oubliait à la conclusion ses prémisses. Il
voulait, ce qui était moins possible en Grèce que partout ailleurs, un empire
fort avec des villes parfaitement indépendantes, prouvant une fois de plus
que l’utopie n’est pas toujours séparée de la modération peureuse.
Nous insistons sur cet écrit et sur cet homme. C’est que
tous deux étaient l’expression d’un parti de jour en jour plus nombreux, qu’effrayaient
les tapageurs de la tribune[27] et qu’on nommait
le parti des honnêtes gens. Ce sera
cette faible école qui bientôt caressera une autre chimère, la conciliation
de Philippe avec la Grèce,
et qui, couvrant sa défaillance de la patriotique pensée de reprendre contre la Perse la guerre nationale,
appellera Philippe le nouvel Agamemnon chargé de conduire les Hellènes contre
l’ennemi héréditaire. Comme elle n’a pas l’intelligence des rudes nécessités
des choses, et qu’elle recule d’effroi à l’idée d’une résolution énergique à
prendre, elle recommandera sans cesse la plus extrême prudence. La justice,
sans doute, partout et toujours, toujours aussi la modération, mais à la
condition de ne pas hésiter devant chaque péril, de ne pas s’humilier devant
chaque injure, de ne pas s’abstenir devant chaque provocation : la morale d’un
État n’étant pas celle d’un philosophe solitaire.
En face de cette école et du timide vieillard qui n’avait
pas même assez de hardiesse pour parler en public, et qui eut toute sa vie
quatre-vingts ans, se trouvaient un autre parti, un autre homme et une autre
éloquence. Les reproches d’Isocrate, tant mêlés de précautions oratoires,
glissaient, sans entrer, sur l’esprit du peuple; s’ils avaient pu agir et
réveiller quelque antique vertu, c’eût été en sortant de la bouche de
Démosthène, quand il faisait retentir dans l’Agora cette voix animée par la
passion, ces paroles lancées comme des carreaux de foudre, sans précaution,
il semble, et sans art, tant elles s’échappaient pressées et brûlantes.
Comparez, pour voir la différence du rhéteur à l’homme d’État, le discours d’Isocrate
sur la paix et celui de Démosthène sur la guerre avec la Perse ; ils ont été
écrits à peu près dans le même temps et pour le même but[28].
Celui qui devait être durant trente années l’âme de son
peuple eut des commencements difficiles, et il est un mémorable exemple de ce
que nous pouvons sur nous-mêmes, car il a été l’œuvre de sa volonté autant
que de la nature. Enfant, il avait reçu de ses camarades le surnom d’Argas[29], pour exprimer l’âpreté
de son caractère, et ce caractère il le garda toujours. Ses bustes, qui montrent
un rude lutteur, n’annoncent pas une nature aimable, et la grâce manque à ses
discours comme à son visage. Il était fils d’un armurier qui possédait de
nombreux esclaves[30] ; mais il
fut orphelin de bonne heure. Ses tuteurs le dépouillèrent de son bien, qui se
trouva réduit de 14 talents à 1, et ils ne firent même pas les frais de son
éducation. Il s’attacha à Isée, qu’on surnommait l’impétueux[31] et il apprit par
cœur les huit livres d’histoire de Thucydide, dont la mâle éloquence
convenait à son génie. On croit qu’il médita aussi les oeuvres de Platon, car
beaucoup de ses discours reposent sur ce principe que le beau moral mérite
par lui seul notre préférence. Parvenu, en 366, à sa majorité, dix-huit ans,
il intenta un procès à ses tuteurs, le plaida lui-même et les fit condamner à
restitution : succès qui ne l’empêcha point de sortir de ces longs
débats à peu près ruiné. La première fois qu’il parut à la tribune publique,
ses longues phrases, son style tourmenté, sa voix faible, son haleine courte,
soulevèrent d’abord les rires. En ce temps-là, les acteurs avaient pris l’importance
que n’avaient plus les poètes, et le comédien Satyros était une sorte de
personnage[32] ;
il releva le cœur du débutant découragé, en lui montrant que le mal était
surtout dans son débit. Démosthène s’appliqua à vaincre ces difficultés
naturelles, et Plutarque raconte, avec sa complaisance ordinaire pour de
menus détails plus ou moins authentiques, que Démosthène se fit construire un
cabinet souterrain où il allait tous les jours façonner son geste et sa voix,
que souvent il s’y confinait deux ou trois mois de suite, la tête à demi
rasée, afin de résister, par la honte, aux plus vives tentations de sortir. D’autres
fois, il gravissait d’une course rapide une montagne, en récitant des vers à
haute voix ; ou bien, sur le bord de la mer, la bouche à demi remplie de
petits cailloux, pour forcer sa langue à se délier, il luttait de la voix
avec le fracas des vagues. On pense bien qu’après de tels efforts et pour un
tel homme, les orages de la place publique n’étaient plus redoutables.
 Que
Démosthène ait fait tout cela, nous ne le jurerons pas ; mais Démétrius
de Phalère, qui l’a personnellement connu, atteste qu’il triompha, par un
travail opiniâtre, d’une nature rebelle. Il s’exerça d’abord comme avocat
consultant et rédigea des discours que des plaideurs lui demandèrent ;
on l’accuse même d’en avoir écrit pour des adversaires. Le fils de l’armurier, dit Plutarque, vendit aux deux parties, afin qu’ils s’en servissent l’une
contre l’autre, des poignards sortis du même atelier[33]. Si le fait est
vrai, il est peu honorable. Mais n’avons-nous pas eu de grands avocats qui,
mettant l’art au-dessus de la vérité, plaidaient publiquement les plus
mauvaises causes et attestaient sur leur honneur l’innocence de criminels
avérés : c’est le danger de la profession. Encore faut-il dire que les
discours achetés aux logographes étaient des mémoires anonymes et que I’autorité
du rédacteur ne s’ajoutait pas à la force des arguments[34]. Que
Démosthène ait fait tout cela, nous ne le jurerons pas ; mais Démétrius
de Phalère, qui l’a personnellement connu, atteste qu’il triompha, par un
travail opiniâtre, d’une nature rebelle. Il s’exerça d’abord comme avocat
consultant et rédigea des discours que des plaideurs lui demandèrent ;
on l’accuse même d’en avoir écrit pour des adversaires. Le fils de l’armurier, dit Plutarque, vendit aux deux parties, afin qu’ils s’en servissent l’une
contre l’autre, des poignards sortis du même atelier[33]. Si le fait est
vrai, il est peu honorable. Mais n’avons-nous pas eu de grands avocats qui,
mettant l’art au-dessus de la vérité, plaidaient publiquement les plus
mauvaises causes et attestaient sur leur honneur l’innocence de criminels
avérés : c’est le danger de la profession. Encore faut-il dire que les
discours achetés aux logographes étaient des mémoires anonymes et que I’autorité
du rédacteur ne s’ajoutait pas à la force des arguments[34].
Dés que Démosthène put se mêler aux affaires de l’État, l’ambition
du roi de Macédoine fut sa constante préoccupation. Devenu un des dix
orateurs officiels, il apporta à Lycurgue, à Hégésippos, à Hypéridès, le
secours de sa puissante parole et il fut l’âme de ce parti généreux qui
voulait l’indépendance d’Athènes et de la Grèce. Lycurgue,
né à Athènes, vers 396, appartenait à la grande famille des Étéoboutades.
Élève de Platon, puis d’Isocrate, il entra tardivement dans les fonctions
publiques, mais les remplit avec une intégrité qui devint proverbiale. C’était
un homme des anciens jours, juste comme Aristide, sage comme Socrate, noble,
riche et vivant dans l’abstinence : figure austère que nous ne pouvons que
saluer en passant. Son éloquence sévère était quelquefois prolixe, mais il
eut douze ans la garde du trésor public, et 19.000 talents, plus de 100
millions de francs, passèrent par ses mains, sans que le moindre soupçon pût
s’élever contre sa rigide probité. Il porta les revenus ordinaires de la
ville de 600 à 1200 talents, et Boeckh le considère comme le seul financier
peut-être que l’antiquité ait eu. Il mit un terme, par des mesures
draconiennes, aux brigandages qui, dans le relâchement des moeurs publiques,
désolaient Athènes, et fut surnommé l’Ibis, ou le destructeur des reptiles,
pour la guerre sans merci qu’il fit aux concussionnaires. Il construisit ou
répara près de quatre cents galères, deux arsenaux qu’il remplit d’armes, un
théâtre, un gymnase, un stade, une palestre, et, comme Périclès, il accumula
dans les temples, pour augmenter l’éclat des fêtes, les statues d’or et les
ornements de métaux précieux, ressource des temps difficiles. Il institua des
combats de chant, et c’est à lui peut-être que nous devons ce qui nous reste
des œuvres d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide, dont il fit déposer une
copie dans les archives de l’État. Un tel homme honore le parti auquel il s’attacha[35].
Hégésippos nous est moins connu ; nous savons
seulement qu’il fut l’adversaire d’Eschine et l’ami de Démosthène, dont il
soutint les efforts contre Philippe. Deux discours conservés dans la
collection démosthénique lui sont attribués par les anciens grammairiens; c’est
dire que son éloquence n’était point sans force. Cependant il fut éclipsé à
la tribune par Hypéridès, qui, plus âgé que Démosthène de quelques années et,
comme lui, un des orateurs officiels de la république, se jeta avec énergie
dans la lutte pour la liberté. Ainsi que Démosthène encore, il servit Athènes
de sa parole dans l’assemblée, de son courage comme triérarque, de son
dévouement dans les chorégies. En 350, pour l’expédition de Phocion en Eubée,
qui se termina par la victoire de Tamynes, il arma deux galères; il en
commanda sans doute beaucoup d’autres, car dans les rares détails que nous
possédons sur lui nous le retrouvons, neuf ans plus tard, triérarque devant
Byzance. Il n’avait point l’austérité de Lycurgue, mais il méritera d’être
proscrit par les Macédoniens; c’est un autre titre d’honneur.
Ce parti, et avec lui Démosthène, a été condamné comme s’étant
voué à une œuvre impossible et mauvaise. L’œuvre était grande, et peu s’en
fallut qu’elle ne se réalisât. Les succès de Philippe ont conduit Alexandre à
la conquête de l’Orient. La civilisation du monde a gagné au contact des deux
sociétés, la grecque et l’asiatique. Mais la vie se déplaça : d’Athènes elle
passa à Rhodes, à Pergame, à Smyrne, à Éphèse, à Alexandrie, et le résultat
de la domination macédonienne fut la mort de la Grèce d’Europe. L’éternel
honneur de Démosthène est d’avoir vu que cette puissance, qui se levait du
Nord, allait tuer sa patrie, et d’avoir donné son génie, sa vie, pour la
sauver. Nous, qui avons, pour nous dédommager de cette mort d’un peuple
épuisé, et le grand mouvement philosophique et religieux qui naquit, après
Alexandre, du mélange des nations et des systèmes ; nous, placés au
point de vue de l’histoire générale, nous sommes pour Philippe et pour son
fils ; plaçons-nous au point de vue grec, et nous serons pour
Démosthène.
Assistons à ce duel de l’homme qui, armé de sa seule parole,
arrête, et plus d’une fois repousse un roi puissant et victorieux[36].

IV. Temporisation de Philippe ; seconde guerre Sacrée (355) ;
tentative de Philippe sur les Thermopyles, première Philippique (346)
Démosthène sembla hésiter à commencer l’attaque. Dans son
discours sur les Symmories (354), dont le but apparent était de détourner le peuple d’une
nouvelle guerre persique, il ne nomma point Philippe, en parlant des périls
qu’Athènes pouvait courir ; mais il insista pour qu’on se tint prêt à
passer rapidement du conseil à l’action contre n’importe quel ennemi : Le premier point, dit-il, et
le plus important, c’est que vous soyez, Athéniens, bien résolus à faire
votre devoir. Toutes les fois que, après une décision prise, chacun s’est mis
à l’œuvre pour l’exécuter, tout vous a réussi, mais lorsque vous vous
regardiez les uns les autres, chacun laissant sa tâche au voisin, rien n’aboutit.
Alors il demande que le corps des douze cents contribuables pour la
triérarchie soit porté à deux mille, et il propose les moyens qui feront
trouver l’argent nécessaire à l’équipement de trois cents galères, chose aisée, ajoute-t-il, puisque
Athènes renferme à elle seule plus de richesses que toutes les autres villes
helléniques prises ensemble. Et il finit par ces mots significatifs :
Ne rien dire, mais se préparer, qui valent
pour tous les temps[37].
Quand Philippe envoya, la même année, quelques troupes au
tyran de Chalcis, en Eubée, contre un autre tyran celui d’Érétrie, Démosthène
déconseilla au peuple de secourir le dernier, et ce fut contre son avis qu’on
chargea Phocion d’une expédition dont il se tira bien, mais d’où l’orateur
avait craint de voir sortir une guerre prématurée. Le moment ne vint que trop
tôt de renoncer à tout ménagement et de jeter hautement le cri d’alarme.
Cependant Philippe aussi temporisait. En 559, il avait
reconstitué la Macédoine,
en 558, pris Amphipolis et Pydna, en 557 Potidée. Pour laisser se calmer les
craintes, il s’arrêta au milieu de ses succès. Mais ce temps de repos ne fut
pas perdu : il améliora l’administration de ses États, compléta l’organisation
de son armée et de ses finances, observant tout en silence, au dedans et au
dehors, lion et renard, veillant, attendant, et toujours prêt à s’élancer. A
la fin de 357 il passa plusieurs mois dans les fêtes qui suivirent ses noces
avec Olympias, fille de Néoptolème, roi d’Épire, et cette ardeur au plaisir
faisait croire à ses ennemis qu’il dégénérait ; mais ce mariage était un
acte politique qui lui donnait un allié sur les derrières de l’Illyrie et de la Grèce. En 356, il
déjoua les menées des rois de Thrace, de Péonie et d’Illyrie, ligués contre
lui ; il fonda Philippes pour s’assurer les mines du mont Pangée, et il
reçut coup sur coup trois nouvelles : Parménion, son meilleur général avait
vaincu les Illyriens ; ses chevaux avaient remporté le prix aux jeux
olympiques ; enfin Olympias donnait le jour à celui qui devait être
Alexandre. On raconte qu’il écrivit à Aristote : Apprends
qu’il m’est né un fils ; je rends grâces aux dieux moins de la naissance
de cet enfant, que de ce qu’il est venu au monde de ton vivant. J’espère qu’élevé
et instruit par toi, il sera digne de moi et de mon empire[38]. Lettre qui
ferait, si elle était authentique, autant d’honneur au roi qui l’écrivit qu’au
philosophe qui la reçut.
Cette victoire aux jeux olympiques n’était pas un fait
indifférent. Elle marquait le dessein arrêté de Philippe de s’introduire dans
le monde grec : avant de lui prendre sa liberté, il prenait ses couronnes.
Déjà les révolutions et la guerre travaillaient pour lui dans la Thessalie et la Phocide. Alexandre
de Phères avait péri assassiné par ses beaux-frères, Tisiphonos, Pitholaos et
Lycophron, à l’instigation de sa femme Thébé. Une nuit, durant son sommeil,
elle lui enleva son épée et éloigna les dogues féroces qui veillaient à l’entrée
de sa chambre. Ses frères hésitaient, elle les menaça d’éveiller le tyran (359). Les
meurtriers avaient succédé à son pouvoir. Tisiphonos d’abord avec Thébé,
puis, en 353, Lycophron. Les Aleuades crurent le temps venu de renverser
enfin cette tyrannie dégénérée ; ils appelèrent Philippe à leur secours.
Le roi assiégeait alors Méthone, au nord de Pydna, dont la résistance était
énergique et où il reçut une blessure qui lui fit perdre un oeil. La ville
enfin forcée, il la rasa; c’était encore un point d’appui enlevé à Athènes
sur le golfe Thermaïque et la libération définitive du littoral macédonien.
Répondant alors à l’appel des Aleuades, il pénétra avec une armée en
Thessalie, battit Lycophron, malgré sept mille Phocidiens accourus à son
secours, et prévint les Athéniens à Pagase, port de la ville de Phères (353). Ainsi, grâce
aux discordes des Thessaliens, Philippe prenait pied dans leur pays, non pas
en conquérant mais en libérateur, et, maître du vestibule de la Grèce, il ne lui restait
qu’à en franchir le seuil. Une vieille institution religieuse qui réveilla
des prétentions surannées lui offrit un prétexte pour avancer plus loin.
Le tribunal des amphictyons, dont n’avaient parlé ni
Thucydide, durant la guerre du Péloponnèse, ni Xénophon, dans ses Helléniques,
parut en ce temps-là revenir à la vie. Sur la demande des Thébains, il avait,
quelque temps après la bataille de Leuctres, condamné les Lacédémoniens, pour
la surprise de la Cadmée,
à une amende de 500 talents, que Sparte n’avait point payée, ce qui l’avait
fait exclure des jeux pythiques. Le procédé parut bon aux Thébains contre un
autre ennemi, les Phocidiens, population remuante qui avait avec eux de
fréquents démêlés au sujet de leur commune frontière. En 357, Thèbes les
accusa devant le conseil amphictyonique de nous ne savons au juste quel
méfait : selon les uns de l’enlèvement d’une femme thébaine, la belle
Théna ; selon d’autres, qui semblent plus près de la vérité, de la mise
en culture de quelques terres consacrées à Apollon. La sentence portait
que si les Phocidiens refusaient de payer, leur territoire serait mis sous l’anathème
et consacré à la divinité, ce qui voulait dire dévasté et occupé par les
prêtres de Delphes. Un des principaux Phocidiens, Philomélos, remontra à ses
concitoyens qu’il y aurait lâcheté à se soumettre à un décret injuste, obtenu
par les Thébains, leurs ennemis ; il leur rappela, citant en preuve un
vers d’Homère, que le patronage de l’oracle de Delphes, la
rocheuse Pytho, leur appartenait et qu’ils l’avaient possédé
longtemps ; il soutint qu’ils devaient le ressaisir, et se fit fort de
le remettre entre leurs mains. Les Phocidiens le choisirent pour général avec
des pouvoirs illimités. Il se rendit à Lacédémone et décida le roi Archidamos
à faire cause commune avec lui. Sparte, n’osant pas intervenir
ostensiblement, donna du moins 45 talents. Philomélos doubla la somme sur son
propre bien, et soudoya une troupe de mercenaires qu’il ajouta à mille
Phocidiens d’élite. Avec ces forces, il s’empara du temple, tua les Thracides[39] qui le
gardaient, mit leurs biens aux enchères, mais rassura la population de
Delphes en promettant que là s’arrêteraient les violences. Les Locriens d’Amphissa,
étant accourus au secours des Delphiens, furent battus, ce qui lui donna le
loisir d’entourer le temple d’une enceinte fortifiée et de porter ses troupes
à cinq mille hommes, en attirant à lui des mercenaires par l’appât d’une paye
plus forte (355).
Cependant il envoya des ambassadeurs dans toutes les cités pour représenter
que les Phocidiens se bornaient à revendiquer leur droit de protection sur le
temple, et il offrit de rendre compte à tous les Grecs des offrandes
consacrées. Mais les Béotiens, de leur côté, sollicitèrent les Thessaliens et
les autres membres du corps amphictyonique de déclarer la guerre aux
Phocidiens, comme sacrilèges, et une vaste confédération se forma contre eux.
Les Athéniens, les Lacédémoniens et quelques peuples du Péloponnèse refusèrent
seuls d’y entrer, sans toutefois prêter aux Phocidiens un secours efficace.
Pour tenir tête à cette ligue, Philomélos fut obligé de
faire ce qu’il prétendait n’avoir pas fait encore : il mit la main sur le
trésor sacré et il traîna au trépied prophétique la Pythie éperdue, qui, dans
son effroi, laissa échapper des paroles où il prétendit trouver, pour
lui-même et pour son peuple, une promesse d’assistance divine. Mais, dirent les dévots d’Apollon et les politiques
de la Béotie,
aucun homme pieux et honnête ne se rangea sous ses
drapeaux, tandis que tout ce qu’il y avait de gens décriés et plus fidèles à
l’argent qu’aux dieux se hâta d’accourir ; bientôt une armée puissante,
toute composée d’impies prêts à profaner les temples, se trouva sur pied.
Il y avait de la vérité dans ces paroles : les mercenaires de Philomélos s’inquiétaient
bien moins de la cause qu’ils servaient que de la haute paye qui leur était
donnée. Ils vinrent en si grand nombre que les Phocidiens eurent bientôt une
armée de dix mille hommes ; alors commença une guerre qui fut marquée, comme
toutes les guerres religieuses, par d’abominables cruautés. De part et d’autre
on ne faisait pas de prisonniers, et les morts étaient privés de sépulture.
Les Locriens furent vaincus de nouveau ; les Thessaliens, qui s’avancèrent
avec six mille soldats, ne furent pas plus heureux ; mais les Béotiens,
venus en nombre double, surprirent les Phocidiens près de Tithorée.
Philomélos, sur le point de tomber aux mains de l’ennemi, après s’être
vaillamment conduit, se précipita du haut d’une roche escarpée et périt (354).
Onomarchos, qui le remplaça, se servit audacieusement des
trésors de Delphes pour recruter son armée et acheter des partisans dans les
cités grecques ; il ravagea la Locride, s’empara d’Orchomène, où un parti
antithébain subsistait toujours, et il assiégeait Chéronée, quand l’approche
d’une armée béotienne le força de rentrer en Phocide. Il était d’ailleurs
appelé au nord par le Thessalien Lycophron, que Philippe menaçait. Un secours
de sept mille Phocidiens qu’il lui envoya sous son jeune frère, Phayllos, fut
insuffisant. Il accourut lui-même, vainquit deux fois le roi, qu’il rejeta en
Macédoine, et revint en Béotie s’emparer de Coronée. Mais, durant cette
dernière expédition, Philippe reparaissait en Thessalie avec vingt mille
hommes et trois mille chevaux. Onomarchos courut à sa rencontre et fut cette
fois complètement battu. L’armée phocidienne compta six mille morts ;
trois mille prisonniers furent jetés à la mer comme sacrilèges; les soldats
du roi, défenseurs d’Apollon, étaient allés au combat le casque couronné du
laurier sacré. Le corps d’Onomarchos, trouvé parmi les morts, fut mis en
croix ; quelques Phocidiens échappèrent en gagnant à la nage une escadre
athénienne qui croisait en vue du rivage (352).
Philippe se présentait donc comme le vengeur d’Apollon et
de la religion outragée ; il prit en Thessalie un autre rôle, celui d’ami
de la liberté : il rétablit à Phères le gouvernement républicain. Mais en
même temps il se fit céder, à titre d’indemnité pour ses frais de guerre, une
partie des revenus de la province, et il mit la main sur ses chantiers et sur
ses arsenaux. Il occupait Pagase et la péninsule des Magnètes qui enveloppe
le golfe pagasétique, où se trouvaient les restes de la flotte préparée par
Alexandre de Phères, qui devinrent le commencement de la flotte macédonienne.
Une escadre athénienne n’arriva qu’après l’occupation du grand port
thessalien, fâcheux retard qui justifie les plaintes que Démosthène ne cesse
de répéter sur la lenteur des préparatifs et la répugnance des citoyens d’Athènes
à faire maintenant un service personnel à l’armée. De Pagase, Philippe
touchait à l’Eubée, presque aux Thermopyles ; de là aussi partirent
bientôt de nombreux corsaires qui infestèrent la mer Égée, troublèrent le
commerce d’Athènes, pillèrent Lemnos et Imbros, et osèrent s’aventurer jusque
sur la côte de Marathon, où ils enlevèrent la galère paralienne.
Philippe essaya de poursuivre sa fortune et, comme il
avait réglé les affaires de Thessalie, d’aller décider celles de la Grèce et de la religion,
fallût-il pénétrer jusque dans la Phocide. Il marcha sur les Thermopyles. Les
Athéniens, retrouvant cette fois leur décision des anciens jours, avaient
couru au défilé et s’y étaient retranchés fortement; Philippe recula. Cette
tentative fut un trait de lumière pour ceux qui doutaient encore; dans
Athènes des actions de grâces furent rendues aux dieux, comme après une
victoire (352).
Phayllos, frère d’Onomarchos, lui avait succédé dans le
commandement. Les premiers chefs des Phocidiens avaient craint de toucher aux
offrandes antiques, qui paraissaient plus particulièrement sacrées :
Phayllos prit tout. Les présents de Crésus, qu’Hérodote avait admirés, bien d’autres
respectés à cause de leur caractère vénérable, furent fondus et monnayés pour
les mercenaires, quelques-uns donnés à des favoris ou à des joueuses de
flûte, comme les colliers d’or d’Hélène et d’Ériphyle. Lorsque les Athéniens
empruntaient les trésors de leurs temples, ils demandaient respectueusement
assistance à leurs dieux pour une cause nationale ; dans le pillage de
Delphes, il n’y avait que la rapacité brutale et sacrilège de soldats de
fortune qui dévalisaient le commun sanctuaire de la Grèce, sans penser jamais
à restitution. Avec cet or, Phayllos acheta de nombreux mercenaires et
quelques alliés. Nous ne savons si Athènes et Lacédémone en
acceptèrent ; elles avaient d’autres raisons pour soutenir les
Phocidiens. La première donna cinq mille hoplites, la seconde mille, les
Achéens deux mille ; Lycophron, chassé de Phères, en amena autant, et
Phayllos se trouva assez fort pour descendre en Béotie, s’y maintenir malgré
trois échecs, enlever toutes les villes de la Locride épicnémidienne
et battre les Thébains, qui voulaient les sauver. Mais cet actif général
était déjà atteint d’une maladie qui l’emporta. On le remplaça par le jeune
fils d’Onomarchos, Phalaekos, à qui il fallut donner un guide, presque un
tuteur, Mnaséas, qui périt bientôt. Ces changements continuels dans le
commandement ne permettaient pas de mettre de la suite dans les desseins.
Aussi les hostilités se poursuivaient avec mollesse et l’on voyait de la
lassitude dans les deux partis. Depuis Alcibiade et Lysandre, il y en avait
toujours un qui regardait du côté de la Perse. Les Thébains demandèrent au grand roi
300 talents, et ils les obtinrent. C’était pour lui de l’argent placé à gros
intérêt, puisque cette assistance financière entretenait la guerre parmi les
Grecs.
La Grèce
centrale était en feu ; l’occasion parut bonne aux Spartiates pour
recouvrer dans le Péloponnèse l’ascendant qu’Épaminondas leur avait ôté. Ils
attaquèrent Mégalopolis, qui reçut des secours d’Argos, de Messène et de
Sicyone, même de Thèbes, d’où partirent, pour aider sa résistance, quatre
mille hoplites et cinq cents cavaliers. Mais trois mille Phocidiens
arrivèrent au secours de Sparte, et les forces se trouvèrent si bien
balancées, qu’au bout de deux campagnes inutiles on fit la paix (351).
Pendant que les yeux des Grecs étaient fixés sur ces
mouvements intérieurs, Philippe, repoussé des Thermopyles, essayait de se
dédommager en Thrace. Il s’avançait à petit bruit vers la Chersonèse, que les
Athéniens avaient récemment recouvrée, et vers Byzance, pour leur couper la
route de l’Euxin, d’où ils tiraient leurs approvisionnements : 400.000
médimnes de blé par an[40]. Mais Démosthène
suivait ses mouvements et éclata. Quand donc,
Athéniens, s’écria-t-il, dans sa première Philippique, quand ferez-vous votre devoir, et qu’attendez-vous ?
Quelque événement nouveau, ou même, justes dieux ! quelque nécessité qui vous
contraigne, Mais, pour des hommes libres, la plus pressante nécessité, n’est-ce
pas le déshonneur ? Voulez-vous, dites-moi, aller toujours par la place
publique vous demandant les uns aux autres Eh bien ! que dit-on de
nouveau ? Eh ! que se peut-il dire de plus nouveau qu’un homme de
Macédoine qui triomphe d’Athènes et domine en Grèce ? — Philippe est-il mort ? — Non, mais il est malade. — Mort
ou malade, que vous importe ? Si celui-ci mourait, vous vous en feriez
bientôt un autre par votre indolence, car c’est par elle qu’il s’est tant
élevé, non de lui-même, non par sa propre force. Puis, mettant le
doigt sur toutes les plaies du gouvernement d’Athènes, sur le vice et les
désordres des armées de mercenaires, sur la légèreté dû peuple, sur ses
résolutions sans effet, il proposa d’énergiques remèdes : Je veux d’abord cinquante galères bien équipées, et que
vous soyez résolus à monter vous-mêmes, au besoin. Ainsi vous arrêterez les
soudaines irruptions de cet homme qui s’élance de sa Macédoine aux
Thermopyles, sur la
Chersonèse, sur Olynthe, partout enfin où il lui plaît....
Qu’on ne me parle ni de dix mille ni de vingt mille mercenaires, admirables
armées dans les lettres qui les annoncent. Ce qu’il faut, c’est une armée
d’Athènes[41]... Vos mercenaires ne triomphent que de vos amis et de
vos alliés; quant à l’ennemi, ils le laissent grandir à l’aise. Ils jettent,
en passant, un coup d’œil sur la guerre où vous les envoyez, puis ils s’en
vont avec la flotte chez Artabaze ou ailleurs. Le général les suit; il le
faut bien. Comme il ne peut payer, il ne peut commander. Que veux-je donc?
Enlever tout prétexte au général et aux soldats en les payant fidèlement, en
plaçant près d’eux des citoyens qui, soldats eux-mêmes, surveilleront les
chefs. A voir comme nos affaires sont conduites, on peut en vérité bien rire
de nous aujourd’hui ! Qu’on vous dise : Athéniens, êtes-vous en
paix ? — Non, certes, répondrez-vous, nous sommes en guerre avec,
Philippe ! En effet, n’avez-vous pas choisi parmi vous dix taxiarques, autant
de stratèges, de phylarques, et deux hipparques ? Tous ces chefs, que
font-ils? Hors un seul que vous envoyez d la guerre, les autres décorent vos
fêtes à la suite des sacrificateurs. Vous fabriquez vos généraux, comme les
mouleurs d’argile leurs statuettes, pour la place publique, non pour la
guerre[42].
Avec une hardiesse qui n’était pas sans danger, il
reprochait aux Athéniens, dans un autre discours, de parler beaucoup sans
agir et de se refuser aux sacrifices nécessaires. Contribuer
de nos biens, nous ne le voulons pas; servir en personne, nous ne l’osons
pas... Non seulement nous ne donnons pas à Diopithe ce qui lui a été assigné
et nous ne considérons pas qu’il se soutient par lui-même[43], mais on le décrie, on critique ses projets, on l’accuse
de crimes passés et futurs... En vérité, Philippe peut se contenter de cette
prière : Faites, grands Dieux, qu’Athènes se conduise toujours ainsi ! Des
temporisations sans fin, de folles dépenses, des enquêtes pour le choix de
vos gouvernants, des colères, de mutuelles accusations, voilà votre vie[44].
Ailleurs il signalait la mauvaise organisation de l’armée
et les lenteurs fatales qui en résultaient : Dites-moi,
je vous prie, pourquoi vos Panathénées, vos Dionysiaques, ces fêtes si
pompeuses, d’un si grand appareil et qui vous coûtent plus cher que l’armement
d’une flotte, sont toujours célébrées au moment marqué, tandis que partout
vos flottes arrivent trop tard, ainsi à Méthone, ainsi à Pagase, ainsi à
Potidée ? C’est que pour ces fêtes la loi a tout réglé, Chacun de vous
connaît longtemps d’avance le chorège, le gymnasiarque de sa tribu ; il
sait ce qu’il doit recevoir, de qui, à quel moment, en un mot, tout ce qu’il
doit faire. Rien n’est incertain, imprévu, négligé. Pour la guerre, au
contraire, et pour les préparatifs qu’elle demande, nul ordre, nulle
prévoyance, la confusion partout. A la première alarme, on nomme des
triérarques, on procède aux échanges, on s’enquiert des subsides ;
ensuite, on appelle sur les vaisseaux d’abord l’étranger domicilié, puis l’affranchi,
puis le citoyen, puis enfin... Mais durant tous ces apprêts, ce que notre
flotte devait sauver a péri.
Ces vives peintures montrent à nu l’intérieur d’Athènes,
les vices de son administration, les défauts du nouveau peuple qu’Isocrate
signalait tout à l’heure. On voit aussi combien Démosthène était frappé du
danger actuel : Tout cela, Athéniens, est sans doute
fort peu agréable à entendre. Mais si, en supprimant d’un discours ce qui
peut vous déplaire, on supprimait l’affaire elle-même, il faudrait ne parler
que pour le plaisir de vos oreilles.... N’est-il pas honteux de se duper
soi-même, de toujours reculer devant ce qui gêne et de ne point savoir que l’habile
homme de guerre ne suit pas les événements, mais les devance ; que l’homme
politique commande aux affaires, comme le général à son armée ; qu’il les
plie, les gouverne à son gré et n’est jamais forcé de les subir ?
Athéniens, vous êtes riches en vaisseaux, en fantassins, en cavaliers en
revenus, plus riches qu’aucun peuple, mais cette force n’est jamais employée
à temps, partant vous arrivez trop tard. Votre lutte avec Philippe, c’est le
pugilat des barbares : l’athlète reçoit un coup, il y porte la main ; il
en reçoit un autre, sa main y est aussitôt. Mais parer, mais regarder son
adversaire en face, il ne le sait pas, il ne l’ose pas. Vous faites de même.
Apprenez-vous que Philippe est en Chersonèse, vite un décret pour la Chersonèse ; qu’il
est aux Thermopyles, vous courez aux Thermopyles. Vous allez après lui comme
s’il commandait vos mouvements; de vous-mêmes, nulle prévoyance. Autrefois
peut-être cette lenteur pouvait être tolérée, aujourd’hui, dans la crise où
nous sommes, cela ne se peut plus. Philippe ne s’arrêtera pas, cela est
manifeste; il faut qu’on lui barre le chemin. Quant au plan même de la
guerre, il n’en donnait aucun : Où aborder ?
dira-t-on. Osons seulement. La guerre montrera l’endroit faible de l’ennemi.
Ces paroles étaient à la fois éloquentes et justes. Il n’y
avait pas dix ans que la
Macédoine était le plus misérable royaume, et son pouvoir
ne paraissait pas encore, il s’en fallait, aussi formidable que l’avait été
celui de Lacédémone. Cependant Sparte était tombée. Pourquoi Philippe
serait-il plus difficile à abattre ? Démosthène était dans le vrai, à
égale distance de ceux qui fermaient volontairement les yeux au péril et de
ceux qui, comme Phocion, désespéraient trop tôt. Si sa demande de réformes n’est
pas plus explicite, c’est qu’il était forcé de parler sur certains points
avec une extrême réserve. Dans son commentaire sur la première Olynthienne,
Ulpien raconte qu’un décret provoqué par Euboulos, le ministre des finances
et des plaisirs du peuple, avait prononcé la peine de mort contre quiconque
proposerait de détourner pour le service de la flotte et de l’armée l’argent
destiné à augmenter l’éclat des fêtes publiques et à permettre à tous les
citoyens d’y venir honorer les dieux. J’ignore si cette peine fut jamais
appliquée; mais nous savons que le sénateur Apollodore ayant proposé d’employer
aux dépenses de la guerre olynthienne l’excédent du revenu public, au lieu de
le verser au théoricon, fut condamné à une amende que l’accusateur
fixa à 15 talents et que le tribunal réduisit[45]. Ce décret et
cette condamnation nous révoltent, parce que nous oublions que le théoricon
était une sorte de budget des cultes. La question, en ce qui le concerne,
était donc plus religieuse que politique ; et si l’on comprend que
Démosthène se soit préoccupé, avant tout, de trouver des ressources pour combattre
le Macédonien, on accordera que les dévots aient songé au service des dieux
pour assurer à la ville leur protection.
Ces dévots s’accordaient sur ce point avec les partisans
de la paix d tout prix, qui s’inquiétaient peu des nécessités militaires. Si
la guerre survient, disaient-ils, on pourvoira aux dépenses par une loi
spéciale qui mettra un impôt sur la fortune des citoyens. C’était rejeter les
charges sur les riches, qui, afin de les éviter, seront toujours pour la paix[46].
Démosthène, et plus encore la nouvelle d’une tentative de
Philippe sur un fort gardé par une garnison athénienne, entre Périnthe et
Byzance, éveillèrent dans le peuple quelque énergie. Un armement considérable
fut voté. Mais soit que Philippe ne fût pas prêt pour une lutte directe avec
Athènes, soit qu’une maladie le condamnât à l’inaction, il s’arrêta de
nouveau et laissa passer près de deux années sans faire parler de lui, plongé
dans la débauche, si l’on en croit Démosthène; mais toujours actif,
travaillant à embellir sa capitale de monuments magnifiques, y attirant les
meilleurs artistes, et prodiguant dans les villes grecques son or corrupteur.

V. Les Olynthiennes (349-348) ; surprise des
Thermopyles ; fin de la guerre Sacrée (346) ;
Athènes déjoue les projets de Philippe sur le Péloponnèse et sur l’Arcanie (346-345)
Cependant Philippe voyait encore dans la péninsule
Chalcidique une ville indépendante, dont il avait naguère acheté chèrement l’alliance,
par la cession de Potidée, mais qui, au premier jour, se tournerait peut-être
contre lui : une épine au cœur de la Macédoine. Tant
qu’Olynthe ne serait pas à lui, ses ennemis pouvaient la considérer comme une
porte prête à s’ouvrir pour donner entrée dans son royaume. Cité riche, d’ailleurs,
capitale d’une confédération de trente-deux villes, Olynthe faisait obstacle
à la vue de la Macédoine
sur la mer. Philippe en méditait depuis longtemps la ruine. L’asile qu’elle
donna à deux princes macédoniens fuyant sa colère le décida à frapper ce
grand coup. Avant de l’attaquer corps à corps, il la cerna, en enlevant les
cités voisines. Il avait pris Apollonie quelques mois auparavant : en 549 il
s’empara de Stagire, qu’il détruisit, et la terreur lui ouvrit les portes de
plusieurs autres villes. Il faut que vous sortiez de
votre ville, dit-il à des députés olynthiens, ou
moi de la
Macédoine. Olynthe implora le secours d’Athènes.
Démosthène monte aussitôt à la tribune et signale en
traits ardents les progrès et la politique perfide de Philippe, Olynthe
trompée par le don de Potidée, la Thessalie par la promesse de lui rendre la Magnésie : Amorcer les peuples assez insensés pour se laisser séduire
à ses avances, et les faire tomber dans les filets qu’il a tendus, voilà le
secret de sa grandeur[47]. Puis, comparant
à cette politique active, l’inertie du peuple d’Athènes : Nous dormons, s’écrie-t-il ; Athéniens, vous dormez ! Et il propose les vrais
remèdes, des actes, des réformes, un meilleur emploi des finances gaspillées
en fêtes et en distributions au peuple. Athéniens, ne
soyez pas surpris : je vais parler contre l’opinion du plus grand nombre.
Établissez des nomothètes, non certes pour créer de nouvelles lois, vous n’en
avez que trop, mais pour abolir celles qui vous nuisent; et celles-là je les
indique nettement : ce sont les lois sur l’argent du théâtre et quelques-unes
sur le service militaire. Les unes sacrifient aux oisifs de la ville nos
ressources pour la guerre ; les autres assurent l’impunité au lâche.
Nous étions sans rivaux, maîtres chez nous, arbitres chez les autres ;
Sparte était abattue ; Thèbes occupée ailleurs ; personne devant
nous qui pût nous disputer l’empire. C’est dans un tel état que nous nous
sommes laissé ravir nos possessions ; que nous avons dissipé sans aucun
fruit plus de 1500 talents ; que des alliances gagnées par la guerre ont
été perdues en pleine paix par nos habiles gens d’aujourd’hui ; c’est
alors enfin que nous avons suscité contre nous ce dangereux ennemi. Qu’on me
dise en effet par qui, si ce n’est par nous, il s’est tant élevé, ce Philippe
!
Sans doute, allez-vous dire, les
choses vont mal au dehors, mais au dedans que de merveilles ! Qu’avez-vous à
montrer ? Des murs recrépis, des chemins réparés, des fontaines et
autres bagatelles. Mais jetez les yeux sur les auteurs de ces beaux ouvrages
: ils étaient pauvres et les voilà riches ! Autant leur fortune a grandi,
autant a baissé celle de l’État... Vous, peuple d’Athènes, on vous enlève
tout, argent, alliés; vous êtes des valets, vous faites nombre ; heureux
que vos maîtres vous accordent l’obole du théâtre, vous envoient la pitance
du jour[48] ! Ô abaissement extrême ! Ils vous donnent votre bien
et vous les en remerciez comme d’une grâce... Je ne l’ignore pas, il pourra m’en
coûter cher de vous parler ainsi de vos misères, plus cher peut-être qu’à
ceux qui les ont faites. Car la franchise n’est pas toujours de saison avec
vous, et je m’étonne aujourd’hui de votre patience. On trouvera, en
effet, qu’il fallait du courage à Démosthène pour parler ainsi, en se
souvenant que la peine de mort avait été décrétée contre celui qui
proposerait l’abrogation des lois théâtrales.
Les Athéniens n’obéirent qu’à moitié à Démosthène et
négligèrent le point principal de ses discours, la réforme intérieure. Ils ne
changèrent rien aux finances ni à l’armée et envoyèrent seulement Charès avec
trente vaisseaux et deux mille mercenaires au secours d’Olynthe : ceci après
la première Olynthienne (349) ;
après la seconde, Charidémos et quatre mille mercenaires ; après la troisième,
deux mille trois cents soldats, cette fois tous Athéniens.
Mais, tandis que les généraux, par leurs désordres,
mécontentaient plutôt qu’ils n’aidaient les Olynthiens, Philippe achetait les
magistrats qui commandaient dans la ville assiégée et qui la lui livrèrent (348). D’abord il
fit tuer ses deux demi-frères, les princes macédoniens qui s’étaient réfugiés
à Olynthe, et il abandonna cette ville au pillage ; il vendit ses
habitants, et employa sa part de butin à semer l’or pour apaiser les ressentiments,
et à donner dans la ville de Dion des fêtes, où ne manquèrent certainement
pas les danseuses thessaliennes[49]. Nombre d’étrangers
accoururent de divers points de la
Grèce à ces jeux, célébrés avec une royale magnificence.
Philippe les accueillit tous, fit asseoir les plus distingués à sa table, les
charma, les gagna par ses manières et ses présents. C’était une campagne qu’il
conduisait encore, aussi fructueuse qu’il aurait pu la faire à la tête de son
armée. Ses convives emportèrent en partant un germe de corruption qui grandit
dans chaque cité, même dans Athènes, où un parti nombreux ne parlait que des
bonnes intentions du roi. Les uns étaient d’honnêtes dupes, les autres des
gens vendus; d’autres encore désespéraient et, d’avance, se
résignaient ; hommes de petit cœur qui s’écrieront après Chéronée : Nous périssions, si nous n’avions péri.
Quelques-uns cependant, et à leur tête Démosthène, même Euboulos, un des
chefs du parti de la paix, et Eschine demandaient qu’on assemblât un congrès
pour aviser à l’union de tous les peuples helléniques contre les nouveaux
barbares qui, en deux ans, venaient de détruire trente-deux cités grecques.
Il y eut un commencement d’exécution; on désigna des ambassadeurs, qui
parcoururent beaucoup de cités, sans rapporter autre chose que de
bienveillantes et stériles paroles ; Athènes restait seule. Sur ces
entrefaites, le bruit se répandit que Philippe consentait à traiter. Le parti
de la paix venait de s’augmenter de tous ceux qui s’intéressaient au sort des
Athéniens faits prisonniers à Olynthe. Un jour, les parents et les amis des
captifs, vêtus en suppliants se présentèrent à l’assemblée ; après avoir
déposé un rameau d’olivier sur l’autel de l’Agora, ils demandèrent au peuple
de ne pas oublier ceux qui étaient tombés pour lui en servitude. Leurs
plaintes touchèrent l’assemblée, qui décida d’envoyer dix députés au
roi ; dans le nombre se trouvaient Démosthène et Eschine.
Celui-ci, né en 390, d’un pauvre maître d’école et d’une
joueuse de tympanon, avait fait tous les métiers, copiste, greffier,
acteur ; mais, pour monter plus haut, il avait une dextérité de parole,
une souplesse d’esprit qui trouvaient leur emploi dans Athènes. Euboulos, l’adversaire
de Démosthène, fit comprendre celui-ci dans l’ambassade. A en croire Eschine,
lui-même aurait adressé au roi une fort belle harangue, tandis que Démosthène
aurait perdu, en face de Philippe, toute son éloquence : Cet homme, dit-il, qui
promettait en chemin monts et merveilles, resta court après avoir bégayé
quelques mots. Il faut entendre que Démosthène, qui parla le dernier,
étant le plus jeune des membres de la députation, trouva qu’après tant de
discours il était de bon goût, vis-à-vis du roi et pour lui-même, d’ajouter
seulement quelques mots. L’anecdote est de celles qu’on fit courir pour
mettre en doute son courage. Ses ennemis ne pouvaient contester son éloquence
ou son patriotisme ; ils essayèrent de le faire passer pour un lâche,
malgré ses campagnes comme triérarque et comme soldat ; on le dira
encore après Chéronée. Mais qu’avait-il à redouter de Philippe dans cette
entrevue pacifique ? Si le roi l’intimidait, il avait eu le temps de
reprendre contenance pendant que les beaux parleurs accablaient Philippe de
leur éloquence. Il se peut même qu’il faille retourner l’accusation et donner
le rôle ridicule à Eschine, qui, pour décider le Macédonien à restituer
Amphipolis, était remonté jusqu’à Thésée, en faisant valoir les droits qu’Athènes
tenait de ce prince mythologique sur une ville bâtie huit ou dix siècles
après lui (346).
Le roi fut des plus aimables avec les ambassadeurs, dont
quelques-uns, dans cette circonstance ou plus tard, tendirent la main et
reçurent des largesses. Philocratès afficha jusque dans Athènes le luxe qu’il
devait aux bienfaits du roi ; Eschine obtint, comme lui, des propriétés
sur le territoire d’Olynthe[50]. Pour Athènes,
Philippe eut moins de générosité. Il refusa de lui rendre Amphipolis,
Potidée, et proposa de prendre pour base du traité à intervenir ce que nous
appelons l’uti possidetis, clause très
avantageuse aux Macédoniens, qui avaient beaucoup gagné, très défavorable aux
Athéniens, qui avaient beaucoup perdu. Des ambassadeurs, parmi lesquels se
trouvaient deux futurs généraux d’Alexandre, Antipater et Parménion,
apportèrent ce projet de convention à Athènes. On discuta deux jours ; à
la fin les représentants de la confédération maritime montrèrent leurs
dispositions pacifiques en donnant, au nom des alliés, plein pouvoir au
peuple athénien de signer la paix. Un dernier mot d’Euboulos fit cesser toute
hésitation : Acceptez, dit-il, ou apprêtez-vous à payer l’impôt de guerre, à y ajouter le
théoricon et à monter sur les vaisseaux. On accepta, et les envoyés
macédoniens prirent les serments de la république en laissant comprendre
parmi les alliés d’Athènes le Thrace Kersobleptès, dont le royaume couvrait la Chersonèse
athénienne, mais en refusant ce titre aux Phocidiens, qui défendaient les
Thermopyles contre Philippe (avril 346).
Tandis qu’on discourait à Athènes, Philippe agissait. Il
détrônait Kersobleptès et s’emparait de plusieurs places fortes voisines de la Chersonèse, regardant
comme de bonne prise tout ce qu’il occuperait avant d’avoir lui-même juré la
paix. Quand, sur l’avis de Démosthène, une nouvelle députation partit pour
recevoir ses serments, elle mit vingt-trois jours à gagner Pella et dut l’y
attendre plus d’un mois. Le rusé monarque feignait d’ignorer son arrivée et
conquérait toujours au fond de la Thrace. De retour enfin, il écouta les
ambassadeurs, mais avant de leur rendre réponse, il les mena jusqu’à Phères
en Thessalie. Là, il leur déclara qu’il ne pouvait consentir à laisser écrire
le nom des Phocidiens dans le traité. Les députés étaient à peine rentrés
dans Athènes, après une absence de soixante-dix jours, que Philippe marchait
aux Thermopyles et s’en emparait. Démosthène accusa plus tard ses collègues,
et particulièrement Eschine, d’avoir été vendus à Philippe. Eschine ne fut
sans doute coupable que d’avoir contribué à répandre parmi ses concitoyens
ces sentiments de naïve confiance dans les promesses du roi qui les
perdirent. Il était un des conseillers du peuple, il fut mal venu plus tard à
dire, pour sa justification, qu’il avait partagé l’entraînement général.
Démosthène seul avait vu et signalé le péril; mais on ne l’avait pas écouté (346).
Cette guerre de Phocide, que Philippe venait de terminer,
se prolongeait depuis dix ans avec un égal succès de part et d’autre. Nulle
puissance, en Grèce, ne semblait en état d’y mettre fin. Thèbes avait déjà
obtenu du roi de Perse 500 talents pour lutter contre les trésors de Delphes.
Mais un secours plus direct lui était nécessaire : elle appela Philippe, qui
s’approcha des Thermopyles et n’eut qu’à se présenter pour décider Phalækos à
se retirer, avec ses huit mille mercenaires, dans le Péloponnèse[51]. L’expédition
était sans dangers, il n’en recueillit pas moins la gloire d’avoir pu seul
venger les dieux.
Son premier soin fut de mettre une garnison macédonienne
dans Nicée, sans s’inquiéter s’il mécontentait par là les Thébains qui
occupaient cette ville ; il voulait, en s’établissant d’une façon
permanente dans le défilé, tenir toujours ouverte pour lui la porte de la Grèce. Cette
précaution prise, il convoqua le conseil des Amphictyons afin de régler le
sort des Phocidiens. La tradition attribuait à cette assemblée une autorité
indéterminée et vague, mais à présent que Philippe mettait à sa disposition
une force considérable, elle pouvait commander. Elle décida que la Phocide cesserait de
former un État ; que ceux qui avaient pris part à la spoliation du
temple seraient jugés et traités comme sacrilèges ; que les vingt-deux
villes de la Phocide
seraient rasées, tous les habitants dispersés dans des bourgs dont aucun ne
contiendraient plus de cinquante maisons ; qu’ils conserveraient leur territoire,
mais grevé d’un tribut annuel de 60 talents pour réparer les pertes faites
par le temple de Delphes, estimées 10.000 talents[52] ; que leurs
armes seraient brisées sur la pierre et les débris jetés au feu, les chevaux
vendus, et qu’ils n’en pourraient posséder d’autres à l’avenir. Naguère, dans
la Chalcidique,
Philippe avait détruit trente-deux villes ; à présent, c’est un peuple
entier que lui et ses alliés exterminaient : ainsi s’annonçait la domination
macédonienne. Après le châtiment, les récompenses : la présidence des jeux
pythiques fut donnée à Philippe, conjointement avec les Béotiens et les
Thessaliens, et on transféra au roi de Macédoine les deux voix dans le
conseil amphictyonique que les Phocidiens avaient possédées (346). La religion
et la rivalité haineuse de cités voisines venaient de tuer l’indépendance
nationale. Un prince étranger avait maintenant la présidence du conseil
fédéral, la garde du sanctuaire hellénique, et tenait, aux Thermopyles, les
clefs de la Grèce.
Ces nouvelles avaient troublé la Grèce. Les Athéniens
s’étaient mis à fortifier le Pirée, à munir les forteresses des frontières,
et un décret avait obligé les citoyens à rentrer leurs biens meubles des
campagnes dans les bourgs fermés. Quand arriva l’époque de la convocation du
conseil amphictyonique, ils refusèrent d’envoyer à Delphes la députation
ordinaire ; Sparte fit comme eux. Ce n’était qu’une protestation
silencieuse ; cependant Philippe jugea prudent de se retirer dans ses
États, suivant sa tactique habituelle, et quand il vit l’émotion un peu
calmée, il dépêcha une ambassade aux Athéniens pour obtenir d’eux la
reconnaissance de son titre d’amphictyon : il l’obtint.
Démosthène cette fois parla pour la paix ; c’était en
effet une question de paix ou de guerre, et malgré ses craintes chaque jour
plus vives, il ne jugeait pas prudent de rompre sur ce prétexte, qui eût
exposé les Athéniens à voir renaître contre eux la ligue qui avait accablé
les Phocidiens. Mieux valait attendre des jours meilleurs où Athènes pourrait
reformer cette alliance à son profit et contre la Macédoine. Ne consentons à rien qui soit indigne de nous,
dit-il, mais restons ce que nous avons été, des politiques qui agissent après
mûre réflexion. Nous avons laissé Oropos aux Thébains, Amphipolis à Philippe,
Chios, Cos et Rhodes aux princes de Carie; nous avons permis que Cardia fût
séparée de la Chersonèse,
et nous n’avons pas puni les Byzantins pour la capture de quelques-uns de nos
vaisseaux. Pourquoi ces complaisances ? Parce que nous comptions que la
paix nous serait plus profitable que la guerre. Si donc vous avez traité avec
chacun de ces ennemis en particulier, quand il s’agissait de vos plus graves
intérêts, ne serait-ce pas une folie insigne de déclarer la guerre à tous vos
adversaires réunis pour les ombres delphiques[53] (346).
Ce qu’Athènes se proposait de faire un jour contre
Philippe, le roi l’exécutait contre elle; il cherchait à isoler cette ville
du reste de la Grèce,
et il étendait son influence, ses intrigues jusqu’au milieu du Péloponnèse.
De bonne heure il s’était promis de reprendre les vues de Thèbes de ce côté.
Une guerre civile ayant éclaté l’année suivante (345) dans l’Élide, les riches égorgèrent
quatre mille de leurs adversaires, coupables d’être entrés en armes sur le
territoire sacré ; puis ils se placèrent sous le protectorat de
Philippe. Il avait depuis longtemps noué des relations avec l’Arcadie, flatté
ce peuple qui pouvait lui servir à tenir Sparte en bride, semé l’or dans ses
villes et attiré à sa cour leurs plus ambitieux citoyens. Dés l’année 356 on
trouve le Mégalopolitain Chéron fort avant dans sa confiance : en 349,
au moment de la guerre d’Olynthe, Eschine, envoyé par Athènes à Mégalopolis,
entendit dans le conseil des Dix Mille les louanges du roi et vit les
hoplites arcadiens partir pour le rejoindre. La
haine qu’il s’appliqua, dit Pausanias, à
entretenir entre les Arcadiens et Lacédémone fut un des principaux obstacles
à ce congrès des cités helléniques qu’Athènes chercha tant de fois à réunir
contre la Macédoine.
En véritable homme d’État, Philippe compta toujours avec
le temps ; il semait et laissait mûrir. En 345, on lui avait, en
Arcadie, élevé tant de statues, décerné tant de couronnes, qu’on ne trouva
plus rien à lui offrir que de l’appeler lui-même et de décréter que toutes
les villes lui seraient ouvertes. Il n’était pas homme à s’engager à fond
dans les affaires du Péloponnèse avant d’avoir terminé celles de la Grèce du Nord. Il se
contenta d’envoyer de l’argent avec des mercenaires étrangers et de prendre
hautement Messène sous sa protection. Il écrivit aux Spartiates : Si j’entre en Laconie, je détruirai votre ville.
Ils répondirent : Si ! A Corinthe, les
habitants, malgré leur mollesse, firent des préparatifs de défense, et
Diogène, pour ne pas rester seul oisif, roula son tonneau.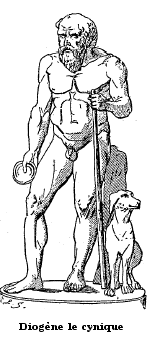
Démosthène parcourut lui-même le Péloponnèse en combattant
partout les menées de Philippe, qui cette fois n’aboutirent pas. Le
Macédonien n’avait voulu faire qu’une diversion, et il avait réussi.
Dans ses harangues aux Péloponnésiens, Démosthène avait
insisté sur les perfidies du roi : Ce Philippe qui,
ne tenant à la Grèce
par aucun lien, n’est qu’un barbare, pas même de bon lieu, mais de cette
misérable Macédoine où l’on n’acheta jamais un bon esclave[54]. Philippe crut
nécessaire d’effacer ces impressions, et la ville qui, dans son abaissement,
gardait au moins plus qu’aucune autre, avec les trophées de Marathon et de
Salamine, le sentiment de la résistance à l’étranger, vit les députés de l’ennemi
des Grecs venir devant elle disculper leur maître. Démosthène prononça alors
sa seconde Philippique (344),
dans laquelle il revint au système de la guerre, la chimère de la paix s’étant
évanouie devant les actes audacieux du Macédonien. Il rappela les discours qu’il
avait tenus aux hommes de Messène et d’Argos, pour les effrayer de l’amitié
royale, en leur montrant les Thessaliens victimes de leur propre crédulité. A peine avais-je fini, dit-il, que ce fut un tumulte d’applaudissements. Que tout cela
est bien dit ! s’écriaient-ils. Les autres envoyés parlèrent aussi et
plus d’une fois, soit en ma présence, soit après mon départ. Mais rien ne put
arracher ce peuple à l’amitié de Philippe, à l’enchantement de ses promesses.
Que des Messéniens, des gens du Péloponnèse, voient la raison et ne la
suivent pas, qui peut s’en étonner ? Mais vous, Athéniens, vous si
clairvoyants par vous-mêmes, si bien avertis par vos orateurs, ne pas voir
les pièges qu’on vous tend, l’ennemi qui vous enveloppe, et, par amour de l’indolence,
vous laisser conduire en aveugles aux mêmes calamités que les autres !
Faut-il donc que le plaisir du moment, le loisir du jour, aient sur vous plus
de pouvoir que toutes les promesses de l’avenir !
[55] Puis il signala
les traîtres et ce parti macédonien, qui était pour la Grèce le plus grand fléau.
Après la paix conclue et à mon retour de la seconde
ambassade, je m’aperçus que notre ville était indignement jouée. Aussitôt j’avertis,
je protestai, je m’opposai de toutes mes forces à ce qu’on livrât les
Thermopyles et la
Phocide. Que disaient alors ces traîtres ? Que j’étais
un buveur d’eau, partant un homme morose et difficile. Mais Philippe,
ajoutaient-ils, Philippe n’aura pas plutôt franchi le défilé, qu’il ne
songera plus qu’à vous complaire. Il fortifiera Thespies et Platée; il
abattra l’orgueil des Thébains; il percera à ses frais la Chersonèse ; il
vous donnera Oropos et l’Eubée en dédommagement d’Amphipolis. Car tout cela
vous a été dit ici, à cette tribune; vous vous en souvenez, hommes pourtant
si faciles, si oublieux avec les traîtres ! Mais voici le plus honteux:
sur l’appât de quelques espérances, vous avez enchaîné à cette paix jusqu’à
votre postérité, tant la fraude fut habile[56].
Philippe, après avoir lu ce discours, dit : J’aurais donné ma voix à Démosthène pour me faire déclarer
la guerre, et je l’aurais nommé général. Il exprimait par là l’impression
profonde que lui avait faite cette virile éloquence, bien plutôt que le vœu
de voir les Grecs se déclarer contre lui; car si une ligue hellénique se
formait, la victoire pour Philippe devenait un problème. Cette ligue était la
continuelle pensée de Démosthène ; Euboulos même s’était rallié à cette
idée. Jusqu’ici on avait échoué ; mais les derniers événements avaient rendu
le danger si évident, que l’entreprise semblait maintenant plus facile. Les
Athéniens, pour y entraîner les autres peuples, montrèrent une activité digne
de leurs beaux jours.
En 344, Philippe s’en était allé guerroyer contre les
Illyriens. Il ravagea leur pays, y prit quelques villes, puis revint à la Grèce et s’occupa de
réorganiser la
Thessalie. Il la divisa en quatre districts, plaça à la
tête de chacun d’eux des hommes dévoués, mit des garnisons dans les places
fortes, et s’attribua tous les revenus du pays : la Thessalie était
décidément une province macédonienne. Il occupait les Thermopyles, la
première porte de la Grèce
: il voulut avoir la seconde, l’isthme de Corinthe. S’il pouvait s’y établir,
il était à la fois maître du chemin de l’Attique et de celui du Péloponnèse.
II fomenta une conspiration dans Mégare pour se faire déclarer protecteur de
la ville ; les Athéniens le prévinrent : Phocion entra dans la place et
en releva les murs (343).
Cette tentative manquée, il courut à une autre, d’un côté
opposé ; il intervint en Épire en faveur de son beau-frère
Alexandre ; conquit pour lui trois villes à moitié grecques qui
refusaient de lui obéir ; et, pour son compte, chercha à s’emparer d’Ambracie,
dont la prise lui eût donné l’Acarnanie. Là, il eût trouvé, pour entrer dans
le Péloponnèse, la route qu’Athènes venait de lui fermer à Mégare. Elle lui
ferma celle-ci encore. Une troupe d’Athéniens se jeta dans Ambracie, et
Démosthène vint enflammer le courage des Acarnanes et des Achéens. Une
surprise tentée en même temps par les Athéniens sur Magnésie en Thessalie
rappela Philippe de l’Épire.
Ainsi les deux adversaires, sans oser se prendre corps à
corps, s’attaquaient de loin. Cet état n’était ni la paix ni la guerre.
Philippe s’en plaignit : il envoya à Athènes le Byzantin Python, dont l’éloquence
égalait presque celle de Démosthène, et, quelque temps après, un artificieux
message où des menaces se cachaient sous d’affectueuses paroles. Hégésippos y
répondit par un fier discours dont la conclusion nécessaire était la guerre :
Mais c’est la guerre que tu demandes, s’écria un
mécontent à l’orateur qui descendait de la tribune. — Oui, par Jupiter ! et je demande de plus des deuils,
des enterrements publics, des éloges funèbres, tout ce qui nous fera vivre
libres et repoussera de nos têtes le joug macédonien. Malheureusement
cette fois, au lieu d’agir, les Athéniens se mirent à faire un procès à
Eschine et à Philocratès, d’après les dénonciations de Démosthène, qui
cependant continuait ses efforts pour tourner leurs esprits vers les objets
véritablement grands (343)[57].

VI. Opérations de Philippe en Thrace (341-339) ;
bataille de Chéronée (338) ; mort de Philippe (336)
Tandis qu’ils perdaient ainsi un temps précieux, Philippe
construisait dans ses ports des arsenaux, des navires et préparait une expédition
dans l’intérieur de la
Thrace. Sa politique visait deux buts : la Grèce, pour hériter, par
droit de conquête, de sa vieille gloire et jouer dans le monde nouveau le
rôle épique d’Agamemnon; la
Thrace, pour arrondir son royaume, exercer son armée,
recruter des soldats et atteindre les rives de l’Euxin, où il y avait des
tributs à lever sur les villes grecques de cette côte et une marine militaire
à créer dans cette mer que sillonnaient les flottes marchandes de l’Hellade.
En 542, lorsque le soleil eut fondu les neiges de l’Hémos et chassé l’hiver
des plaines de la Thrace,
il pénétra jusqu’au centre de l’ancien royaume des Odryses et y fonda, avec
des Grecs enlevés aux villes de la côte, plusieurs colonies. Une d’elles, qu’il
peupla de malfaiteurs, à défaut de colons volontaires, prit son nom qu’elle a
gardé, et est encore une des grandes villes de la Turquie d’Europe,
Philippopoli, sur la Maritza
(Hebrus). Ces
établissements dans le voisinage de la Chersonèse et de Byzance menaçaient les
possessions, le commerce, l’existence même d’Athènes, qui se nourrissait des
blés de la Tauride. Un
de ses généraux, Diopithès, était dans la Chersonèse avec une
petite armée[58] ;
il fit quelques incursions sur les terres récemment conquises par Philippe,
qui se plaignit à Athènes. Les Athéniens, dit
Démosthène, sont les défenseurs de la liberté
grecque. Chaque coup porté à cette liberté frappe sur eux. De là leur droit
de la défendre partout. Puis, représentant Philippe comme le mortel
ennemi d’Athènes il ajoutait : Ne voyez-vous pas que
plus on le laisse prendre, plus il prend et plus il se donne de force pour
nous accabler ? Quand donc, ô Athéniens, commencerez-vous à faire votre
devoir ? Vous répondez : Certes nous le ferons, lorsqu’il sera
nécessaire. — Mais cette nécessité, il y a
longtemps qu’elle vous presse. Et il pose nettement la question : Sachez bien que tout ce que Philippe entreprend ou médite,
il le médite et l’entreprend contre nous. Qui de vous serait assez simple
pour croire que quelques bicoques de Thrace ont tenté sa convoitise ; qu’il
bravera pour elles travaux, frimas, périls extrêmes ; mais que les ports
d’Athènes, ses arsenaux, ses flottes, ses mines d’argent, ses revenus, ses
places, toute cette splendeur, enfin, ne le tentera pas ; qu’il vous en laissera
tranquilles possesseurs, heureux d’aller en Thrace, arracher aux silos le
seigle et le millet, et hiverner au fond des abîmes ? Non, non, Athènes
et ses trésors, voilà ce qu’il poursuit partout[59].
Ce n’est pas la convoitise seule qui le pousse ; il
comprend que, pour l’accomplissement de ses desseins, il faut qu’Athènes
disparaisse. Ennemi de la démocratie comme Athènes l’est
des tyrans, il ne veut pas autre chose, et il a raison de ne le point
vouloir ; c’est, chez lui, vigilance et bon sens. Regardez-le comme l’implacable
ennemi de tout gouvernement libre.
Cette pensée obsède Démosthène ; il la reprend dans
la IVe Philippique[60] : Oui, croyez que cet homme veut notre mal ; qu’il hait
tout chez nous, et notre ville, et le sol qui la porte ; tout, jusqu’à
nos dieux ! Mais c’est principalement à notre démocratie qu’il en
veut ; c’est elle qu’enveloppent ses embûches, elle qu’il s’applique à
détruire. Il faut le dire, une sorte de nécessité l’y pousse. Réfléchissez en
effet : il veut être le maître, et seuls vous lui faites obstacle. Il sait
que rien ne sera sûr pour lui tant que vous resterez un peuple libre ;
qu’à son premier revers, tout ce qu’il tient comprimé sous sa main lui
échappera pour s’enfuir vers nous. Et il terminait en revenant à la
seule proposition qui pût sauver Athènes : la réforme des abus, une ligue de
toute la Grèce[61].
La moitié de son conseil fut suivie. Des ambassades
partirent, et les mouvements qu’elles imprimèrent à l’opinion publique furent
assez forts pour engager Philippe à s’arrêter. Démosthène gagnait du temps, c’était
beaucoup, comme il le remarque lui-même, dans la lutte d’une république,
contre un monarque (341).
Philippe suspendait ses desseins en Grèce, l’attention y
étant éveillée, mais il les poussait activement vers la Thrace, où il croyait
trouver plus de facilités. Vers la fin de 541, il assiégea Sélymbrie, et peu
de temps après la place plus importante de Périnthe, sur la Propontide. Protégés
par la forte position de leur ville sur une éminence que la mer baignait de deux
côtés, les Périnthiens firent une opiniâtre résistance, malgré les trente
mille hommes dont Philippe les enveloppait, les mines qu’il creusait sous
leurs murs et les tours hautes de 80 coudées que lui construisaient ses
ingénieurs : la poliorcétique se développait. Mais la défense augmentait
aussi ses moyens de résistance : un jour que les Macédoniens pénétrèrent dans
la ville par une brèche, ils en furent chassés.
Démosthène suivait tous les mouvements de son adversaire.
Aux armées du roi il oppose encore sa parole, et ce qu’il a fait dans le
Péloponnèse, il va le faire dans la Thrace. Il se rend à Byzance, la plus grande
ville de ces régions, et, détruisant à force d’éloquence une jalousie
invétérée, il renoue l’alliance que la guerre Sociale avait brisée ;
Byzance envoie des secours à Périnthe ; les Perses, inquiets de voir les
Macédoniens si prés de l’Asie, lui font passer des soldats, des vivres, de l’argent,
et un Athénien, Apollodore, conduit ce secours. Athènes soutint cette
coalition par une diversion puissante. Tandis qu’Éphialte, envoyé à Suse,
avivait les craintes du grand roi, un chef eubéen tout dévoué à Athènes,
Callias, allait piller les villes du golfe pagaskique, capturer des vaisseaux
chargés pour la Macédoine,
et aider Phocion, débarqué dans l’Eubée, à chasser les Macédoniens, qui
voulaient faire de cette île une forteresse
menaçante pour Athènes. Phocion n’était que la main qui avait
exécuté ; c’est Démosthène qui avait fait voter l’expédition ; lui
encore qui venait de former contre le roi une ligue comprenant, avec l’Eubée
et Corcyre, presque toutes les cités riveraines du golfe de Corinthe. Au
printemps de 340, leurs députés vinrent à Athènes se concerter sur les
opérations à entreprendre et les subsides à fournir. Le peuple reconnaissant
de ces succès dus à son grand orateur lui décerna une couronne d’or.
Cependant Philippe n’avançait pas devant Périnthe ;
croyant plus facile de prendre Byzance, il divisa ses forces et assiégea les
deux villes à la fois ; en même temps il se plaignit à Athènes des
dernières hostilités. C’en était trop : Byzance aux mains du roi fermerait la
route de l’Euxin. Cette fois Philippe menaçait de tarir les sources mêmes de
la vie du peuple ; aussi l’irritation fut extrême, et Athènes enfin se
retrouva. Démosthène fit renverser la colonne sur laquelle, sept années
auparavant, le traité de 346 avec le misérable
Macédonien avait été gravé, et l’on arma cent vingt galères
montées par des hoplites athéniens, sous les ordres de Phocion[62]. Encouragés par
cette décision, les insulaires de Chios, de Rhodes et de Cos envoyèrent aussi
des secours à Byzance. Cette ville, établie à la pointe d’une péninsule
triangulaire dont deux côtés étaient baignés par la mer et le troisième
protégé par une forte muraille, pouvait tenir longtemps, surtout si les
puissances maritimes lui venaient en aide, et ce secours arrivait. La probité
de Phocion, comme l’éloquence de Démosthène, firent oublier aux Byzantins
leurs rancunes et leurs soupçons contre Athènes. Naguère ils avaient refusé
de recevoir Charès et son escadre, car c’était presque malgré ces villes qu’Athènes
les assistait ; Phocion fut admis dans Byzance, et Philippe, vaincu par
Démosthène, s’éloigna en frémissant (339)[63].
Comme Mégare , comme Ambracie, comme l’Eubée, Byzance et Périnthe
lui échappaient. A l’est, à l’ouest, au centre, il n’éprouvait qu’humiliations
et défaites ; et ceux qui lui infligeaient ces affronts répétés étaient
les vaincus d’Ægos-Potamos ! Oui, mais les restes d’un grand peuple
conduits, soutenus par un grand homme.
Périnthe et Byzance firent sculpter un groupe colossal qui
représentait les deux villes offrant au peuple athénien une couronne, et
décrétèrent que leurs députes iraient aux quatre grands jeux de la Grèce proclamer les services
d’Athènes, ainsi que leur gratitude. Sestos, Éléonte, Madytos et
Alopéconnèsos envoyèrent à Athènes une couronne d’or de la valeur de 60
talents, et dressèrent un autel consacré à la Reconnaissance et
au Peuple athénien.
Ce fut le dernier des beaux jours d’Athènes. Je me trompe,
elle en aura un encore, le lendemain de Chéronée.
Philippe alla cacher son dépit loin de la Grèce. Il fit une
expédition contre les Scythes établis entre le mont Hémos (Balkan) et le
Danube, mais fut battu au retour par les Triballes, qui lui enlevèrent son
butin et le blessèrent grièvement. Tandis qu’il s’enfonçait dans le nord, ses
amis lui préparaient en Grèce un triomphe. Eschine soulevait tout le conseil
amphictyonique contre les Locriens d’Amphissa, qui osaient cultiver quelques
parcelles du territoire crisséen adjugé au dieu de Delphes après la première
guerre Sacrée. Était-il vendu à Philippe, et voulait-il préparer une nouvelle
intervention de ce prince dans les affaires de la Grèce centrale ?
Démosthène le prétendit. Il est certain du moins qu’il servit à la fois la
cause de l’étranger et celle du fanatisme. Quand il annonça cette nouvelle à
l’assemblée athénienne, Démosthène s’écria : Tu
apportes la guerre, Eschine, au cœur de l’Attique, une guerre sacrée !
En effet, quelque temps après, le commandement des forces amphictyoniques fut
remis de nouveau au roi de Macédoine par le décret suivant :
Climagoras étant pontife dans l’assemblée
du printemps, les Hiéromnémons, les Pylagores et tout le peuple
amphictyonique ont arrêté ce qui suit : Comme ceux d’Amphissa se sont partagé
la terre sacrée, la cultivent, y font paître leurs troupeaux et que sommés de
se retirer, ils ont repoussé par la force le conseil général des Grecs, en
ont même blessé quelques-uns, Cottyphe, d’Arcadie, général des Amphictyons,
sera envoyé en ambassade vers Philippe de Macédoine, le priera de secourir
Apollon et les Amphictyons, de ne pas abandonner le dieu outragé par ces
impies Amphissiens, et que tous les Grecs faisant partie du conseil amphictyonique
l’ont élu général, chef absolu. En ce moment, la Pythie philippisait.
Philippe accepta ce devoir sacré qui lui était si utile,
et envoya aussitôt un message à ses alliés du Péloponnèse pour qu’ils eussent
à se trouver en armes, dans la
Phocide, au commencement du mois de boédromion, avec des
vivres pour quarante jours (août-sept.). Ceux qui ne viendront
pas avec toutes leurs forces, ajoutait la lettre, seront punis par
nous des peines dont le conseil nous a permis d’user. Lui-même pénétra en
Phocide avec une armée, dans l’intention apparente de descendre par la Doride sur Amphissa.
Mais, après quelques marches dans cette direction, il se détourna subitement
sur Élatée, qu’il prit. De là, il était facile de pénétrer, par la vallée du
Cephise, dans la Béotie
et l’Attique, si une vaillante armée n’en barrait pas la route. Avec des
Grecs encore libres, il y avait toujours à craindre quelque résolution
désespérée : les souvenirs de Leuctres et de Marathon commandaient la
prudence, même à ce prince audacieux que la victoire avait déjà tant de fois
suivi. D’abord, pour assurer au besoin sa retraite sur la Thessalie, il fortifia
Élatée ; puis, afin d’empêcher l’union des deus villes qui étaient
encore à cette heure les plus grandes puissances militaires de la Grèce, il chargea Python
de porter aux Thébains des paroles de paix, malgré le secret ressentiment qu’il
avait conçu contre ce qu’il appelait l’insolence
leuctrienne[64], et de demander
à ces anciens rivaux d’Athènes de lui ouvrir les passages qui conduisaient
dans l’Attique (339).
Ces effrayantes nouvelles arrivèrent de nuit à Athènes, au
moment où les prytanes prenaient leur repas accoutumé. Aussitôt des feux
allumés sur l’Acropole appelèrent dans la ville les habitants des
campagnes ; la trompette, sonnant par toutes les rues, éveilla les
citoyens, et, à la pointe du jour, une multitude inquiète se trouva réunie au
Pnyx. Les magistrats firent répéter la nouvelle par un de ceux qui l’avaient
apportée ; quand il se tut, la foule terrifiée resta silencieuse et aucun
des orateurs habituels n’osa prendre la parole, malgré les invitations
répétées du héraut. Enfin l’assemblée porta ses regards sur Démosthène ;
il monta à la tribune, exhorta le peuple à ne pas perdre courage, et proposa
un décret où se trouvaient de nobles paroles. Tant
que Philippe n’a touché qu’à des villes barbares, étrangères à la Grèce, les Athéniens ont
pu fermer les yeux sur ses envahissements ; mais quand ils le voient
porter la main sur les villes grecques, traiter les unes avec ignominie, ruiner
et détruire les autres, ils se regarderaient comme indignes de la gloire de
leurs ancêtres s’ils abandonnaient des Grecs que Philippe prétend asservir...
Après avoir offert des prières et des sacrifices aux dieux protecteurs d’Athènes,
le sénat et le peuple ont résolu de mettre en mer deux cents vaisseaux. Le
commandant de cette flotte la conduira en deçà des Thermopyles ; les
généraux de la cavalerie et de l’infanterie mèneront leurs troupes à Éleusis.
En outre, des députés seront envoyés par toute la Grèce, et d’abord vers les
Thébains, que Philippe menace de plus prés ; ils les exhorteront à ne
pas le craindre, à défendre leur liberté, celle de tous les Grecs. Ils diront
que s’il a existé quelque mésintelligence entre les deux villes, les
Athéniens l’ont oubliée, qu’ils sont prêts à secourir les Thébains de soldats
et d’argent, à les fournir de traits et d’armes. Car les Grecs peuvent avec
honneur se disputer entre eux la prééminence ; mais recevoir la loi d’un
barbare est chose indigne de leur gloire et de la vertu de leurs ancêtres.
En même temps, Démosthène demanda l’institution d’un
comité de salut public, l’emploi de toutes les forces d’Athènes, et ces
forces étaient considérables, grâce à deux mesures qu’il proposa, et dont l’une
était une victoire sur un vieil abus : il fit suspendre tous les travaux
publics, et employer à la guerre l’argent qui leur était consacré ;
auparavant, on eût ajouté au théoricon les reliquats de ce budget. En
outre, on avait sous la main une armée, déjà réunie, de dix mille
mercenaires.
Les députés partirent en toute hâte. Les Thébains avaient
des griefs contre Philippe : il leur avait enlevé Échinos sur le golfe
Maliaque ; il leur avait refusé Nicée, la clef des Thermopyles, et sa
puissante amitié les effrayait. L’ambassade macédonienne, qui était déjà dans
la ville, rappelait les services du roi et le sort de ceux qui soutenaient la
guerre contre l’autorité sacrée des amphictyons. Mais Démosthène, de son
souffle puissant, enflamma les Thébains d’une si noble ardeur, et répandit
sur toutes les autres considérations de si épaisses ténèbres que, bannissant
crainte, prudence, reconnaissance même, ils s’abandonnèrent à l’enthousiasme
du devoir. Cette oeuvre de l’éloquence parut si prodigieuse, si menaçante,
que Philippe envoya sur-le-champ des hérauts demander la paix; que la Grèce entière se dressa, l’œil
fixé sur l’avenir ; que, non seulement les généraux athéniens, mais les
chefs de la Béotie,
suivaient les ordres de Démosthène, devenu à Thèbes, non moins que dans
Athènes, l’âme de toutes les assemblées populaires.
Les alliés furent d’abord heureux dans quelques
engagements particuliers. Une ruse de Philippe, l’indiscipline des
mercenaires, peut-être l’incapacité des chefs, lui livrèrent les passages de la Doride, d’où il put
descendre sur Amphissa, qui fut prise et ruinée. Les prêtres de Delphes
étaient satisfaits : les sacrilèges avaient vécu, mais la liberté grecque
allait mourir. Cet échec encouragea le parti de la paix. Dans Thèbes, dans
Athènes, des voix s’élevèrent pour revenir aux négociations. Philippe
semblait vouloir s’y prêter, et Phocion y poussait. Prends
garde que les Athéniens ne se fâchent, lui dit un jour
Démosthène ; Et toi, répondit Phocion, prends garde qu’ils ne reviennent à la raison. Mais
Athènes était avec Démosthène ; elle lui vota, sur la proposition d’Hypéridès,
une nouvelle couronne d’or (été de 338).
L’action générale fut assez longtemps retardée pour que
les Spartiates eussent pu se lever et accourir sur ce dernier champ de
bataille de la liberté ; ils n’y vinrent même pas, comme à Marathon,
trop tard. Sauf quelques hommes de Corinthe, et peut-être de l’Achaïe,
Athènes et Thèbes restèrent seules. Les Grecs avaient beaucoup de chefs, les
Macédoniens un seul; cette différence suffirait à expliquer le résultat. L’armée
hellénique était bien inférieure par le talent des généraux, mais au moins
égale en nombre à celle de Philippe, qui comptait trente mille hommes d’infanterie
et deux mille chevaux. Démosthène, malgré ses quarante-huit ans, servait à
pied parmi les hoplites. La bataille se livra près de Chéronée. Alexandre
alors âgé de dix-huit ans prit position en tête de l’aile gauche opposée aux
Thébains ; Philippe a l’aile droite, en face des Athéniens. Au centre
des deux armées étaient les mercenaires. Alexandre, le premier, entama les
lignes ennemies par son impétueuse valeur. On dit que Philippe laissa les
Athéniens épuiser leur fougue et se débander à la poursuite des ennemis,
rompus par leur premier choc, qu’alors il fondit d’une hauteur sur leurs lignes
en désordre, et les mit en déroute. Mille
Athéniens furent tués ; deux mille faits prisonniers, et parmi eux
Démade ; le reste prit la fuite ; Démosthène fut au nombre de ces
derniers[65].
La perte des Thébains n’est pas connue, mais dut être considérable. Le
bataillon sacré resta tout entier sur le champ de bataille. On ne grava point, dit Pausanias, d’épitaphe sur leur tombeau, car la fortune les avait
trahis, mais on le surmonta d’un lion, en souvenir de leur courage (2 août 338).
Athènes, en apprenant ce désastre, montra une constance
romaine. Sur la proposition d’Hypéridès, un décret fut rendu qui, pour
décider les esclaves et les métèques à s’armer, promit aux premiers la
liberté, aux seconds le titre de citoyens. Le sénat des Cinq-Cents dut
descendre en armes au Pirée, pour y régler tous les préparatifs de défense.
Comme au temps des guerres Médiques, on se prépara à transporter dans cette
forteresse les femmes et les enfants ; les bannis furent rappelés, les
citoyens frappés d’atimie réhabilités. On prit 100 talents dans le
trésor pour réparer les murs et l’on demanda des contributions volontaires
aux citoyens riches, aux alliés : Démosthène donna 400 mines. Les timides
songeaient à fuir ; une résolution de l’assemblée assimila l’émigration
à la trahison, et plusieurs furent exécutés pour ce lâche abandon de la
patrie en deuil[66].
Des trois généraux athéniens, l’un, Stratoclès, semble
être resté sur le champ de bataille ; l’autre, Charès, échappa et ne fut
point décrété d’accusation ; tout le ressentiment d’Athènes tomba sur le
troisième, Lysiclès, qui s’était sans doute montré particulièrement
incapable : il fut mis à mort. Était-ce une victime immolée à la colère
du peuple ? L’incapacité, dans un certain poste et portée à un certain
degré, mérite un châtiment sévère. Ce fut l’intègre Lycurgue qui l’accusa. Tu commandais l’armée, et mille citoyens ont péri, et deux
mille ont été faits prisonniers, et un trophée s’élève contre la république,
et la Grèce
entière est esclave ! Tous ces malheurs sont arrivés quand tu guidais
nos soldats, et tu oses vivre, tu oses voir la lumière du soleil, te
présenter sur la place publique, toi, monument de honte et d’opprobre pour la
patrie !
Rome parut plus grande après Cannes : elle sortit tout
entière au-devant de Varron ; l’intérêt de la défense exigeait cette
magnanimité ; Athènes du moins, sous le coup qui la frappait, ne plia
pas le genou devant son vainqueur. Sur le marbre du tombeau on grava l’inscription
suivante : Nos guerriers, défenseurs de la patrie,
ont revêtu leurs armes pour le combat ; ils ont abattu l’insolence de l’ennemi
et n’ont pas, dans leur bouillante ardeur, ménagé leur vie. Entre eux et l’oppresseur,
ils ont pris Pluton pour arbitre, ne voulant pas que la Grèce sentît le joug sur
sa tête et subît l’odieux outrage de la servitude. Ils sont morts en grand
nombre ; la terre de la patrie possède en son sein leurs dépouilles. C’est le
sort que Jupiter impose aux mortels. Ne faillir jamais, réussir toujours n’appartient
qu’aux dieux ; nul mortel ne peut fuir sa destinée. C’était l’ancienne
Envie des dieux qui reparaissait, habileté oratoire bonne en face de vaincus
qu’il fallait sauver du désespoir[67].
Athènes conserva sa confiance à ceux qui avaient soutenu
son courage. Plusieurs des mesures proposées par Hypéridès étaient contraires
à d’anciennes lois, et il se trouva quelque ami zélé de la Macédoine pour l’accuser
d’illégalité. Il y répondit par un discours où se trouvent ces fermes et
fières paroles : As-tu écrit dans le décret que la
liberté fût donnée aux esclaves ? — Oui,
pour que les hommes libres ne fussent pas réduit en esclavage. — As-tu demandé le rappel des exilés ? — Oui, pour que personne ne partit en exil. — Ne savais-tu pas que de telles propositions étaient
interdites par la loi ? - Non, car les
armes des Macédoniens m’en cachaient le texte. Les juges, aussi
patriotes que l’accusé, repoussèrent l’accusation.
Athènes n’hésita pas davantage à glorifier Démosthène.
Malgré les clameurs élevées contre l’homme qui avait tant contribué à cette
guerre malheureuse, les parents des victimes célébrèrent chez lui le repas
des funérailles, et Athènes le chargea de prononcer l’oraison funèbre. Non, s’écria l’orateur, justifiant à la fois et
lui-même et Athènes dans une explosion d’éloquence, non,
Athéniens, vous n’avez pas failli en courant à la mort pour le salut et la
liberté de la Grèce !
Non, j’en jure par vos ancêtres tombés à Marathon, à Salamine, à Platée.
Et, mettant l’honneur dans le devoir accompli, non dans le succès, il termina
par ces brèves et viriles paroles : Nos morts ont
rempli le devoir de vaillants citoyens ; quant à la fortune, ils ont eu
celle que les dieux leur ont donnée.
Réservons une place, dans ces souvenirs, à un rhéteur qui
fut un jour citoyen, s’il en faut croire un récit qui n’est peut-être qu’une
légende : le vieil Isocrate, encore en santé, malgré ses
quatre-vingt-dix-huit ans, se laissa mourir de faim : son éternelle illusion
sur les bonnes intentions de Philippe venait de s’évanouir, la réalité le tua[68].
Philippe fut digne d’Athènes. On rapporte que le soir de
Chéronée, célébrant avec ses amis cette grande victoire, il ajouta, après le
sacrifice aux dieux, l’ivresse du vin à celle de la joie[69], et vint, la
tête couronnée de fleurs, insulter aux captifs. Eh
quoi ! lui dit Démade, la fortune t’a
donné le rôle d’Agamemnon, et tu joues celui de Thersite !
Rappelé à sa dignité par cette flatterie courageuse, il foula aux pieds ses
couronnes[70]
et, redevenu lui-même, le politique à la fois généreux et habile, il délivra
sans rançon tous les prisonniers d’Athènes, brûla ses morts et lui renvoya
honorablement leurs restes, par une ambassade chargée de lui offrir des
conditions de paix qu’elle ne pouvait espérer. On voudrait croire que l’élan
patriotique des Athéniens rendait cette générosité nécessaire. Philippe leur
laissait Scyros, Délos, Lemnos, Imbros, Samos, et leur donnait Oropos qu’il
ôtait aux Thébains ; mais il leur prit la Chersonèse, qui,
mettant les détroits en son pouvoir, lui permettait de tenir ce peuple sous
la menace de la famine, puisqu’il pouvait maintenant arrêter les blés de l’Euxin.
Aussi Athènes cherchera-t-elle bientôt à se garantir contre ce danger en
demandant à l’Italie son approvisionnement en céréales[71]. Les Thébains,
bien plus sévèrement traités, durent payer la rançon de leurs captifs et de
leurs morts, recevoir une garnison macédonienne dans la Cadmée, renoncer à toute
domination sur la Béotie,
où Orchomène, Thespies et Platée se relevèrent, et rappeler leurs bannis,
qui, investis du gouvernement, se vengèrent de leurs adversaires par l’exil
ou la mort.
Dans ce traitement contraire infligé aux deux peuples, il
y avait de la haine pour cette ville, naguère sauvée par Philippe, maintenant
hostile, pour ce lourd génie béotien qui, n’ayant rien donné à la Grèce, n’avait rien à
prétendre ; il y avait aussi une affection involontaire pour cet autre
peuple, artiste, éloquent et brave, pour cette cité, son infatigable ennemie,
mais où se donnait la consécration de la gloire. Philippe craignait-il les
lenteurs d’un long siège, les risques de quelque beau désespoir, les retards
pour sa grande entreprise ? Sa pensée pesait tout cela, sans doute; il
sentait aussi qu’Athènes, avec sa flotte intacte, n’était point à sa merci et
qu’elle pourrait le servir. Mais voyons le meilleur côté : il était
tout-puissant et il fut généreux. Après Chéronée, Démosthène pouvait dire aux
Athéniens : Avoir embrassé le parti le plus
honorable et se trouver encore en meilleure situation que ceux qui, en nous
trahissant, croyaient assurer leur bonheur, je reconnais là votre heureuse
fortune.
La grande entreprise que maintenant Philippe voulait
accomplir, ce n’était rien de moins que la conquête de la Perse. De Chéronée il
se rendit à Corinthe, où il convoqua les députés de la Grèce. Tous y
vinrent, moins ceux de Lacédémone, qui se tinrent dans un dangereux mais
honorable isolement. Il leur exposa ses projets et demanda leur concours. Une
ligue offensive et défensive fut conclue entre les États grecs et la Macédoine pour le
maintien de la paix intérieure et la guerre contre la Perse. On détermina
les contingents et les subsides à fournir par chaque cité ; on prononça
la peine du bannissement et de la confiscation des biens contre tout Hellène qui
s’engagerait au service du grand roi, et l’on nomma Philippe généralissime
des forces helléniques, pour venger les vieilles injures de la Grèce et conquérir le pays
de l’or. En cas de contestations au sujet des clauses de l’alliance, le
conseil amphictyonique prononcerait ; on se souvient que le
généralissime était le président de ce conseil : la nasse était donc bien
nouée. Cependant, à regarder de loin, cette confédération nouvelle du corps
hellénique, dont le roi de Macédoine devenait la tête[72], semblait
reposer sur de justes bases. Les Grecs restaient libres; ils gardaient leurs
lois, leurs propriétés, leurs revenus, mais un autre allait penser et agir
pour eux. Rome reprendra ce système contre les derniers héritiers d’Alexandre,
et de serviles acclamations salueront Flamininus proclamant, dans cette même
ville de Corinthe, la liberté hellénique, le jour où celle-ci sera
définitivement perdue pour vingt siècles.
Avant de rentrer en Macédoine, Philippe voulut montrer sa
puissance dans le Péloponnèse et humilier les Spartiates ; il ravagea la Laconie et agrandit à
leurs dépens les territoires de Messène, de Mégalopolis, de Tégée et d’Argos.
Il n’eut pas besoin d’aller dans l’Ouest : les Acarnanes chassèrent d’eux-mêmes
ses ennemis, et Ambracie reçut une garnison macédonienne, comme Thèbes,
Chalcis et Corinthe en avaient déjà : ces garnisons étaient les entraves de la Grèce. Byzance
aussi sollicita son alliance (338), de sorte que l’accès de l’Asie lui était ouvert dans le
même temps que la Grèce
lui était soumise, et il pouvait croire cette soumission sincère, car la
servilité s’affichait jusque dans la cité de Démosthène : Athènes donna son
droit de cité à Philippe, à Alexandre, à deux de leurs généraux, Antipater et
Parménion[73],
et dressa, dans sa place publique, une statue au roi de Macédoine, avec l’inscription :
Au bienfaiteur de la patrie !
L’année suivante se passa en querelles domestiques et en
préparatifs. Philippe expédia un corps d’armée en Asie, sous Parménion et
Attale. C’est alors sans doute que commencèrent les relations de la Perse et de Démosthène.
Le grand orateur n’avait pas attendu l’or du barbare pour
se décider sur la politique à suivre. Il ne vendit ni son éloquence ni son
patriotisme. On lui offrait un moyen d’aider sa cause, celle d’Athènes et de la Grèce, il l’accepta. La Perse n’était plus à
craindre, la Macédoine
l’était beaucoup : les subsides de l’une servirent contre l’autre, comme de
nos jours l’or anglais servit contre Napoléon. Si la France qui en a tant
souffert, a le droit de trouver ce moyen de guerre peu honorable, personne au
moins n’a le droit d’accuser Démosthène de vénalité.
Les préparatifs de Philippe à peu près terminés, il
consulta la Pythie
sur le succès de l’expédition. L’oracle répondit : La
victime est couronnée, l’autel est prêt, le sacrificateur attend. Dans
cette réponse il lut la ruine des Perses, mais ce jour-là la Pythie ne philippisait
pas : c’était lui la victime désignée.
Par des fêtes magnifiques, de splendides festins, des
jeux, des combats de chants, auxquels il invita tous ses amis grecs, Philippe
célébra à la fois son prochain départ et le mariage de sa fille Cléopâtre
avec Alexandre, roi d’Épire, son beau-frère. Un nombreux concours d’assistants
se trouva réuni de toutes parts dans la ville d’Ægées en Macédoine. Durant le
banquet royal, un tragédien célèbre récita, sur l’invitation du roi, des vers
qui disaient : Vous dont l’âme est plus haute que la
zone éthérée, et qui, avec orgueil, regardez l’immense étendue de vos
domaines, vous qui bâtissez palais sur palais, et croyez que votre vie ne
finira pas, voici la mort qui, d’un pas rapide, s’approche et va jeter dans
les ténèbres vos oeuvres et vos longues espérances, et Philippe
applaudissait ; il lisait dans ces vers, au lieu de sa sentence, le
destin dont il croyait la
Perse menacée.
Au milieu de ces fêtes, des couronnes d’or lui furent
offertes par les riches convives et par les principales villes. Athènes même
en envoya une avec ce décret : Si quelqu’un conspire
contre la vie de Philippe, et vient chercher refuge à Athènes, il sera livré
au roi. Le banquet terminé, la foule courut au théâtre ; la nuit
durait encore. Dès que le jour se montra, on vit s’avancer une pompe
religieuse : c’étaient les images des douze grands dieux, travaillées par les
plus habiles artistes et parées des plus riches ornements; à leur suite,
venait une treizième statue, celle du roi lui-même, placée sur un trône comme
celles des dieux, au rang desquels on le montrait, assis et présent à leur
conseil. Lorsque Philippe arriva, vêtu de blanc, il ordonna à ses gardes de
se tenir à distance, voulant faire voir à tous qu’il se fiait à l’affection
des Grecs, mais presque aussitôt un meurtrier, caché dans les couloirs du
théâtre, avec une épée celte sous les vêtements, s’élance derrière lui, le
frappe entre les côtes, et l’étend mort à ses pieds : Philippe n’avait que
quarante-sept ans. Le meurtrier était un noble macédonien, Pausanias, qui,
peu auparavant, lui avait demandé en vain justice d’un outrage. Selon d’autres,
il était l’instrument des Perses ou des Athéniens. Enfin on a aussi accusé
Olympias.
Souvent blessée par l’attention que son époux donnait à
des hétaïres de l’Hellade ou à des danseuses thessaliennes, Olympias avait
été mortellement offensée, lorsqu’en 337, suivant l’usage oriental de la
polygamie qui commençait à s’introduire en Grèce, Philippe avait épousé
Cléopâtre, nièce d’Attale, un de ses généraux, et célébré ses nouvelles noces
avec toute la pompe royale. Comme la fiancée appartenait à une grande famille
de Macédoine, son mariage fit naître des espérances politiques qui se
produisirent au milieu même du festin, lorsque Attale, échauffé par le vin, s’écria :
Macédoniens, priez les dieux de donner au sein de
notre reine la fécondité et, au royaume, un héritier ! — Me prends-tu pour un bâtard ? repartit
Alexandre, et il lui jeta sa coupe à la tête. Philippe, à moitié ivre, tira
son épée et se précipita vers son fils ; mais ses jambes
chancelaient ; il tomba, et Alexandre le montrant à ses amis : Il veut aller d’Europe en Asie et il ne peut se traîner d’une
table à l’autre ! Olympias se réfugia auprès de son frère, le roi d’Épire,
son fils chez les Illyriens, d’où il revint lorsque Philippe, intéressé à ne
point laisser derrière lui une menace de guerre, se réconcilia avec l’Épirote,
en le prenant pour gendre. Les soupçons de complicité avec l’assassin se sont
étendus à Olympias et à Alexandre. Il n’y aurait pas à s’étonner que la mère,
en qui fermentait une sève barbare, ait cherché dans un crime sa propre
vengeance et le salut de son fils[74] mais Alexandre,
capable d’ordonner des meurtres politiques, même de tuer de sa main un ami
dans un accès de colère, ne l’était pas de préparer lentement un parricide.
|