|
I. Violences de Sparte : surprise de la Cadmée
La paix d’Antalcidas, dit
Xénophon, donna aux Spartiates beaucoup de gloire.
L’histoire n’a point ratifié ce jugement du partial ami de Lacédémone. Sous
la suprématie d’Athènes, la
Grèce était montée au plus haut degré de puissance; sous la
domination de Sparte, elle était tombée, en moins de dix-sept ans, aux genoux
de la Perse,
non pas de la Perse
glorieuse et puissante de Darius et de Xerxès, mais d’un empire chancelant,
troublé par les désirs d’indépendance des
satrape, affaibli par la révolte de Chypre et par celle de l’Égypte.
Sparte n’avait su tirer de sa victoire que l’oppression, sans la grandeur du
despotisme. Ce n’est pas ainsi que les dominations se légitiment et
subsistent. Aussi la chute sera prompte. La paix honteuse d’Antalcidas fut un
temps d’arrêt dans la décadence de Lacédémone ; mais cette décadence
était commencée et elle ne s’arrêtera plus. Il est vrai que si les Grecs lui
étaient hostiles, ils étaient divisés, par conséquent impuissants. Qu’au
moins elle soit sage, comme au temps de Pausanias, et, dans cette Grèce
abaissée, elle pourra rester longtemps encore au premier rang.
La paix était proclamée, chacun retournait à ses travaux,
le laboureur à son champ, le marchand à son navire, l’artiste au temple que l’art,
depuis bien des années, délaissait. Mais un peuple avait d’autre souci que
ces préoccupations pacifiques ; les Spartiates entendaient faire sortir
du traité d’Antalcidas ce qui se trouvait au fond de cette convention, l’hégémonie
en Grèce des alliés du grand roi. Par l’affaiblissement d’Athènes, par les
garnisons lacédémoniennes établies à Orchomène et à Thespies, ils dominaient
dans la Grèce
centrale, et Corinthe, Argos, soumises à l’oligarchie, les laissaient sans
contrepoids dans le Péloponnèse. Cependant, non loin des frontières de la Laconie, une ville,
Mantinée, osait conserver une constitution démocratique. Durant la guerre,
elle avait donné quelque peu de blé aux Argiens, montré un zèle assez tiède à
fournir aux Spartiates son contingent militaire, et elle ne s’était pas
convenablement attristée des revers de Lacédémone. Des députés vinrent la
sommer d’avoir à renverser ses murailles ; sur le refus des Mantinéens,
Agésipolis ravagea leur territoire et assiégea leur ville. Il la prit, eu
détournant un ruisseau le long des murs qui, faits de briques cuites au
soleil, furent minés par les eaux et tombèrent[1]. Il dispersa les
habitants dans quatre villages, que Sparte affecta de traiter comme autant d’États
distincts, et les mit sous la direction des amis
de la paix[2] qu’il avait
ramenés. Ils y vécurent, dit Xénophon, plus heureux qu’auparavant. L’élève de Socrate ne
trouve, pour achever le récit de cette violence, que cette réflexion : Ainsi se termina le siège de Mantinée, qui doit apprendre
à ne pas faire passer de rivière à travers une ville (385).
Phlionte avait aussi chassé sa faction oligarchique : les
bannis vinrent représenter à Sparte que, tant qu’ils étaient restés les
maîtres, leur ville avait été docile et soumise. Les éphores demandèrent aux
Phliasiens le retour des exilés et la restitution de leurs biens ; ce
qui fut accordé par crainte (383).
Sparte, qui détruisait Mantinée, releva Platée : elle
autorisa ce qui restait de Platéens à rebâtir leurs murailles. C’était la
même politique sous deux formes différentes. Détruire toute grande cité,
toute force collective dans le Péloponnèse, pour n’avoir rien à craindre ;
en créer, au contraire, sur le territoire de ses rivaux pour les affaiblir.
Comme dans les autres villes béotiennes, un harmoste et une garnison
spartiate furent chargés de défendre les Platéens contre Thèbes, c’est-à-dire
de les garder sous l’influence de Lacédémone.
L’ambition de Sparte dépassa bientôt les bornes de la Grèce centrale : des
événements que, du moins, elle n’avait pas provoqués attirèrent son attention
et ses forces à l’autre bout du monde hellénique. En 383, des ambassadeurs d’Acanthe
et d’Apollonie vinrent lui demander du secours contre Olynthe, qui menaçait
leur indépendance. Les villes de la Chalcidique, unies par la communauté d’origine
et d’intérêts, avaient formé, pour se défendre à la fois contre Athènes et
contre les Macédoniens, une confédération dont le principe était très libéral
: chaque cité gardait sa constitution, mais tous les alliés avaient, les uns
chez les autres, la jouissance des droits civils, la faculté d’acquérir des
propriétés et de contracter mariage. Olynthe, à qui le roi de Macédoine,
Amyntas, pressé par les Illyriens, avait cédé la côte du golfe Thermaïque, en
était la capitale; la ville importante de Pella et celle de Potidée, qui
commandait l’entrée de l’isthme de Pallène, en faisaient partie. Défendue par
huit mille hoplites, de nombreux peltastes et mille cavaliers, cette ligue
était en bonne intelligence avec les Thraces, en amitié avec Thèbes et
Athènes. Utiles alliances, riche trésor, population nombreuse, bois de
construction, et, dans le voisinage, les mines d’or du mont Pangée, Olynthe
avait une foule de ressources qui pouvaient faire de cette cité une puissance
de premier ordre. Mais deux villes voisines, Acanthe et Apollonie, s’étaient
estimées de trop grandes cités pour consentir à aller se perdre dans une
confédération. Elles avaient repoussé les offres d’Olynthe, et, menacées par
elle, avaient cherché appui auprès des Spartiates.
Nous voulons, dirent leurs
députés, conserver les coutumes de nos pères et
rester maîtres de nous-mêmes[3]. Il ne fut pas
difficile de décider Lacédémone à faire dans la Chalcidique ce qu’elle
avait fait dans le Péloponnèse et la Béotie, à tout diviser pour tout affaiblir et
régner seule. Elle promit une armée de dix mille hommes que les alliés
devaient fournir pour la bonne part; mais, avant qu’elle fût réunie,
Eudamidas partit, avec ce qu’il put trouver d’hoplites, et il eut le temps de
couvrir les deux villes contre l’attaque des Olynthiens, même de décider la
défection de Potidée. Phébidas, son frère, le suivit à la tête d’un second
corps; arrivé prés de Thèbes, il s’arrêta pour s’entendre avec le polémarque
Léontiadès, chef du parti aristocratique dans cette ville, et mettre la
dernière main à une abominable intrigue. Le jour de la fête de Cérès, comme
toutes les femmes se trouvaient dans la Cadmée pour les sacrifices, ce qui empêchait le
conseil de s’y tenir, et que la chaleur du jour (on était en été et sur le midi) rendait
les rues désertes, Léontiadès introduisit Phébidas dans la citadelle, puis
alla au conseil, où siégeait Isménias, chef du parti contraire, et, l’accusant
de fomenter une nouvelle guerre, il le fit arrêter et conduire à la Cadmée (383).
Cet événement causa partout une indignation à laquelle les
Spartiates, tout en gardant la citadelle, parurent s’associer. Ils
condamnèrent Phébidas à une amende[4] et le privèrent
de son commandement, sans doute avec de discrets ménagements qui autoriseront
bientôt Sphodrias à suivre son exemple. Agésilas avait défendu le coupable en
mettant de côté la question de justice, et en posant le principe qu’on ne
saurait condamner un citoyen pour une action qui profite à sa patrie.
Aristide et les Athéniens avaient été mieux inspirés en face de Thémistocle
proposant une chose utile et injuste. Une commission, choisie par les
Lacédémoniens et leurs alliés, envoyée à Thèbes, condamna à mort Isménias,
sous prétexte qu’il avait reçu de l’or persique; c’était un vaillant homme et
un bon citoyen. Sparte se vengeait lâchement sur lui des craintes que la
dernière guerre lui avait causées. Environ quatre cents de ses partisans
avaient quitté la ville et cherché un refuge à Athènes.
Cette surprise de la Cadmée, cette mort d’Isménias, étaient un crime
de plus dans l’histoire de Sparte ; mais c’était aussi une facilité plus
grande pour la guerre contre les Olynthiens. Elle dura trois années et coûta
à Lacédémone deux généraux et un de ses rois : Eudamidas périt en combattant;
son successeur, Téleutias, après quelques brillants succès auxquels
contribuèrent les Macédoniens, fut tué au pied des murs d’Olynthe ; le
roi Agésipolis, venu avec des forces considérables, eut à peine le temps de
faire quelques ravages ; il s’empara bien de Toroné, mais une fièvre l’emporta
en sept jours ; son corps, embaumé dans du miel, fut rapporté à Sparte.
L’harmoste Polybiadès réussit enfin à réduire les Olynthiens. Cernés par
terre et par mer, ils demandèrent la paix, qui leur fut accordée, à condition
qu’ils auraient pour amis et ennemis les amis et les ennemis de Lacédémone,
et que, alliés fidèles, ils marcheraient sous les drapeaux de cette
république (379).
Cette ruine de la confédération olynthienne livrait à la Macédoine, pour un
avenir plus ou moins rapproché, mais certain, la Chalcidique et la Thrace, comme la ruine de
l’empire athénien avait livré aux Perses l’Asie Mineure.
Dans le même temps, les bannis rentrés à Phlionte s’étant
plaints d’y être maltraités, Agésilas avait assiégé cette ville ; après
une résistance de vingt mois, il la prit et il y laissa garnison (379). Autre fardeau
que Sparte s’imposait; tandis qu’elle mettait ainsi le pied partout et
semblait accroître sa puissance, elle s’épuisait et se rendait odieuse. D’ailleurs,
la haine grandissait contre cette cité qui prenait tout et ne donnait
rien ; contre cette alliée des deux grands ennemis des Hellènes : le roi
de Perse, qui, grâce à elle, avait rendu les Grecs asiatiques tributaires, et
Denys de Syracuse qui asservissait ceux de Sicile et d’Italie[5].
Diodore de Sicile croit devoir commencer son XVe livre en
citant au tribunal de l’histoire les Lacédémoniens coupables
d’avoir perdu par leurs fautes un empire exercé par eux sur la Grèce depuis cinq cents
ans. Xénophon voit dans cet événement la main des dieux : On pourrait, dit-il, citer quantité de faits de ce
temps-là qui prouveraient que les dieux ont l’œil ouvert sur les impies et
les méchants. Ainsi les Lacédémoniens, qui avaient juré de laisser les villes
autonomes, et néanmoins gardaient la forteresse de Thèbes, invincibles jusqu’alors,
furent punis par ceux-là mêmes qu’ils opprimaient[6]. Les dieux ne s’occupaient
ni des intérêts de Lacédémone ni des affaires de la Grèce; mais Sparte avait
mis contre elle deux forces encore puissantes : par ses iniquités, elle avait
révolté la conscience morale ; par ses violences en faveur de l’oligarchie,
elle avait irrité ceux qui aimaient les institutions libres; et ces deux
forces allaient s’unir pour son châtiment.
Depuis trois ans, les Lacédémoniens étaient maîtres de la Cadmée et, confiants dans
leur appui, les chefs de l’aristocratie thébaine, Léontiadès et Archias, ne
gardaient plus de mesure. Les prisons se remplirent, les exécutions se
multiplièrent, comme au temps des Trente à Athènes. Cependant un soupçon vint
aux tyrans, au milieu de leurs excès et de leurs plaisirs, que les quatre
cents réfugiés à Athènes supportaient avec peine leur exil et conspiraient
peut-être pour rentrer dans leur patrie. Ils résolurent de se débarrasser d’inquiétude
en les faisant assassiner. Léontiadès envoya dans ce dessein des émissaires à
Athènes. Ils échouèrent : un seul, le chef des réfugiés, Androkleidas,
succomba ; les autres se tinrent pour avertis. Leur vie n’étant plus en
sûreté, même dans l’exil, le meilleur parti était de tenter une révolution
qui précipiterait leurs adversaires. On voit que la domination des
Lacédémoniens produisait à Thèbes les mêmes effets qu’à Athènes ; ils
avaient de bien dangereux amis.
Parmi les bannis thébains se trouvait Pélopidas, homme d’un
courage héroïque, noble et riche, ennemi des tyrans, et lié avec Épaminondas
d’une amitié qui avait été éprouvée déjà sur les champs de bataille. L’exemple
de Thrasybule, parti de Thèbes pour délivrer Athènes, lui inspira le dessein
de partir d’Athènes pour délivrer Thèbes. Les Athéniens, reconnaissants de l’asile
qu’ils avaient trouvé en Béotie, au temps des Trente, avaient refusé d’obéir
à Sparte, qui réclamait l’expulsion des exilés. Pélopidas conspira à Athènes,
tandis qu’Épaminondas, que sa pauvreté et son obscurité avaient préservé de l’exil,
exhortait la jeunesse thébaine à lutter, dans les gymnases, avec les
Spartiates et à prendre l’habitude de les vaincre. Les conjurés avaient des
intelligences jusque dans la maison des polémarques, dont Phillidas, un des
leurs, s’était fait nommer greffier. Le jour était fixé. Pour sauver un
citoyen distingué qui allait être exécuté, ils partirent plus tôt. Douze
prirent les devants, vêtus de simples manteaux, menant des chiens en laisse,
et portant des pieux à tendre des rets, afin de se faire passer pour des
chasseurs. Ils entrèrent isolément dans la ville par diverses portes, et se
réunirent chez un des plus riches Thébains, nommé Charon, où quelques-uns de
leurs partisans vinrent les rejoindre. Phillidas avait invité à un repas deux
des polémarques, leur promettant que les premières femmes de la ville seraient
du festin. Ils étaient déjà dans l’ivresse, lorsque le bruit arriva jusqu’à
eux, que des exilés se cachaient dans la ville. Ils mandèrent Charon, qu’on
dénonçait ; son calme dissipa leurs soupçons. Survint un autre avis : un
ami d’Athènes écrivait à Archias de se méfier, et donnait tous les détails.
Le polémarque n’ouvrit même pas la lettre; mais la jetant sous son coussin : À demain les affaires, dit-il. Quelques instants après,
arrivèrent les conjurés. Ils avaient des robes de femmes sur leurs cuirasses,
et portaient de larges couronnes de pin et de peuplier qui leur couvraient le
visage. Dès qu’ils eurent reconnu Archias et Philippe, ils tirèrent leurs
épées, et, s’élançant à travers les tables, tuèrent sans peine ces hommes
noyés dans le vin. Phillidas courut aussitôt à la prison et en ouvrit les
portes. Dans le même temps, Pélopidas et les autres surprenaient et tuaient
Léontiadès et Hypatès.
Au premier bruit, Épaminondas s’était armé ; il
accourut avec quelques jeunes gens auprès de Pélopidas. Pour grossir cette
petite troupe, les conjurés envoyèrent dans toutes les directions des hérauts
qui sonnaient de la trompette et annonçaient au peuple sa délivrance.
Néanmoins le trouble et la frayeur étaient dans la ville : on allumait des
torches dans les maisons; les rues se remplissaient de gens qui couraient de
côté et d’autre, ne sachant rien de certain et attendant que le jour vint
révéler ce que la nuit cachait encore. Quinze cents hommes établis dans la
citadelle auraient eu bon marché des conjurés s’ils les avaient attaqués
sur-le-champ. Mais les cris du peuple, les feux dont les maisons étaient
éclairées et les courses précipitées de la multitude les effrayaient; ils
restèrent immobiles, contents de garder la Cadmée. Le lendemain,
à la pointe du jour, les autres bannis arrivèrent avec nombre d’Athéniens qui
s’étaient joints à eux, et le peuple s’assembla. Épaminondas présenta à l’assemblée
Pélopidas avec sa troupe, entouré des prêtres qui portaient dans leurs mains
les bande= lettes sacrées, et appelaient les citoyens au secours de la patrie
et des dieux. A leur vue, tout le peuple éclata en cris de reconnaissance et
salua les bannis comme les libérateurs de la cité[7] (décembre 379).
Pélopidas, Charon et Mélon, trois des chefs les plus
actifs du complot, furent nommés béotarques, titre qui annonçait que Thèbes
voulait reprendre, avec sa liberté, son ancien rang parmi les villes
béotiennes. On commença aussitôt d’assaillir la Cadmée. Un secours,
mandé en toute hâte de Platée, où Sparte tenait aussi une troupe, fut repoussé
par les cavaliers thébains ; alors, la garnison manquant de vivres, et
les alliés, qui en formaient la plus grande partie, refusant de se défendre,
la forteresse fut évacuée. Des Thébains, partisans des Spartiates, les
suivaient ; plusieurs furent égorgés avec leurs enfants et tous auraient
eu le même sort, si les auxiliaires athéniens ne les avaient pris sous leur
sauvegarde. Sparte condamna à mort deux des harmostes et frappa le troisième,
absent lors de l’attaque, d’une amende énorme qu’il ne put payer, ce qui le
força de se bannir (379).
La délivrance de Thèbes commença une suite d’événements
qui brisèrent, dit Plutarque, les chaînes dont Sparte avait chargé la Grèce. Mais quelles
causes purent tout à coup porter une ville, dont on ne connaissait encore que
la trahison dans les guerres Médiques, au degré de puissance où nous allons
la voir ? Ce qui caractérisait les Béotiens, c’était une certaine
lourdeur d’esprit devenue proverbiale, quelque chose d’épais et de sensuel.
Thèbes avait vu naître, aux temps mythologiques, Amphion, plus récemment
Pindare ; mais cette gloire était dans le passé. S’il fallait en croire
Élien, elle aurait, par décret publie, imposé à ses artistes la loi de faire
beau et condamné à l’amende celui qui enlaidirait son modèle; les arts n’en
avaient point prospéré davantage. Dès l’origine, elle avait eu cette habitude
de banquets en commun, de fêtes publiques, qui est propre aux Grecs. Nais,
tandis que ces réunions s’épuraient ailleurs, et que la musique, la danse, la
poésie, la philosophie même, en étaient les accompagnements ordinaires, par
une belle association des plaisirs les plus relevés de l’esprit à ceux du
corps, les banquets, chez les Thébains, n’étaient que des occasions d’étaler
toutes les ressources d’une sensualité grossière et d’un luge sans goût. On y
buvait, on y mangeait à outrance, comme firent ces polémarques que nous avons
vus, tout à l’heure, se laisser surprendre par les amis de Pélopidas. Une
terre très fertile[8]
et de facile culture, un air épais, peu d’industrie, point de commerce, parce
que le sol donnait tout le nécessaire ; ni le stimulant de la misère
comme dans l’Attique, ni celui du péril comme à Lacédémone : voilà pourquoi
Thèbes, éloignée d’ailleurs de cette mer qui excite les hommes, était restée
dans l’ombre. On y vivait bien et sans peine ; à quoi bon des
efforts ? A ces causes, il faut ajouter l’impuissance politique produite
par leurs divisions, le mépris où ils tombèrent après les guerres Médiques,
enfin l’attraction exercée par Athènes sur tous les hommes de mérite, et qui
agit nécessairement aux dépens des autres cités, surtout des plus voisines.
Quand Athènes eut succombé, quand Sparte se fut rendue odieuse, Thèbes, qui n’avait
pas usé ses forces dans la lutte, tira profit de la ruine de l’une, comme des
insolences de l’autre. Il n’est pas douteux que l’émigration des Athéniens
chassés par les Trente et celle de plusieurs Grecs italiotes, qui, au témoignage
de Plutarque, apportèrent en Béotie les doctrines de Pythagore, n’aient
contribué à éveiller les esprits thébains; des disciples de Socrate vinrent
même enseigner à Thèbes. Ces influences et les circonstances politiques
produisirent un certain mouvement dans ces natures béotiennes dont le fond
solide eût porté de riches moissons, si cette forte terre avait pu être
convenablement cultivée, si on y eût enfoncé le soc assez profondément. On
trouve en Béotie de la docilité, de la justesse, de la puissance, du sérieux;
mais on n’y trouve ni la finesse exquise, ni la pointe aiguë, ni la pétulance
charmante et gracieuse de l’esprit attique.

II. Épaminondas et Pélopidas ; traités de 374 et de 371
Un homme résume en lui toutes les bonnes qualités de ce
peuple, Épaminondas. Il était d’une famille distinguée, de cette race des
Spartiates qu’on disait nés des dents d’un dragon ; il était pauvre, et
le demeura toute sa vie. Au moment de conduire une armée dans le Péloponnèse,
il fut réduit, pour achever son équipage, à emprunter quarante-cinq
drachmes ; une autre fois, à l’approche d’une fête, il s’enferma
plusieurs jours chez lui, afin qu’on pût blanchir son unique manteau ;
mais, loin de souffrir de cette gêne, il se félicitait d’être par là
débarrassé de beaucoup de soucis. Sa frugalité était celle d’un pythagoricien[9] : jamais de vin et
souvent un peu de miel pour nourriture. Son instruction surpassait celle de
ses compatriotes. Les Grecs, même les plus graves, joignaient à la culture de
l’esprit celle du corps ; aux lettres, la gymnastique ; à la
philosophie, les arts. Socrate avait été sculpteur, et Polybe attribue d’étonnants
effets politiques à l’enseignement général de la musique. Épaminondas n’omit
aucune de ces études qui font l’homme complet : il apprit à jouer de la lyre
et de la flûte, à chanter en s’accompagnant, même à danser[10]. Il se livra
avec ardeur aux exercices du gymnase et au maniement des armes, moins jaloux
toutefois d’acquérir la force que l’agilité ; l’une lui semblait la
qualité de l’athlète, l’autre celle du soldat. A ce corps, qu’il avait rendu
souple et vigoureux par l’exercice, la nature avait joint les qualités de l’esprit ;
il les développa par la méditation. Pour maître de philosophie, il eut le
pythagoricien Lysis de Tarente. On le vit, presque enfant, s’attacher à ce
vieillard triste et sévère, jusqu’à préférer sa société à celle de tous les
jeunes gens de son âge. Il ne voulut se séparer de lui qu’après avoir appris
les devoirs du citoyen, autant que ceux de l’homme. Prudent, habile à profiter
des circonstances, avec l’âme grande et le courage indomptable, il savait
commander et obéir, ce qui, au jugement d’Aristote[11] et de l’histoire,
est le trait distinctif des bons citoyens : aujourd’hui vainqueur de Sparte à
Leuctres, demain simple hoplite ou édile chargé du soin des rues, et toujours
souffrant, sans se plaindre, les injustices du peuple comme celles de ses
amis. Son respect pour la vérité était si profond, qu’il rte mentait pas,
même en plaisantant. Il savait garder un secret, parlait peu, écoutait
beaucoup; habile pourtant et puissant orateur, qui servit plus d’une fois
Thèbes de sa parole aussi bien que de son bras.
Telle était l’éducation des hommes distingués de la Grèce, et telles étaient
les qualités douces et sérieuses du héros thébain; comme caractère moral, la Grèce n’a rien eu de plus
pur ni de plus élevé[12]. Quand Pélopidas
conspira, il refusa de prendre part au complot, non par lâcheté assurément,
mais il n’aimait pas les menées ténébreuses et préférait le combat à ciel
ouvert. Tandis que les bannis nouaient leurs intrigues, il préparait les
jeunes Thébains à être des hommes le jour de l’action. Ces vertus n’empêchaient
pas qu’il n’eût une grande ambition pour sa patrie. C’est lui surtout qui
voulut briser la suprématie de Sparte au profit de Thèbes, et qui, après l’avoir
renversée, essaya de jeter bas celle d’Athènes. On le vit même, en une
circonstance, à Tégée, approuver, comme général, une chose que, simple
particulier, il eût certainement flétrie. Disons toutefois qu’il diminua,
autant qu’il le put, les maux de la guerre[13].
Pélopidas était avant tout un homme d’action. Le gymnase
et la chasse avaient pour lui plus de charme que les livres et les leçons des
philosophes. Né d’une famille noble et riche, il fit participer à ses richesses
ses amis pauvres et vécut dans la simplicité. Ame noble et généreuse, avide
de gloire, ambitieux, autant pour lui-même que pour son pays, il devint un
brillant capitaine, prompt à concevoir et à exécuter; mais, pour le génie, il
resta bien inférieur, ce semble, à Épaminondas.
La grandeur de Thèbes dura autant que ces deux hommes.
Leur premier soin fut de mettre leur patrie en état de
soutenir la lutte redoutable qu’ils prévoyaient. Sparte venait de décider l’envoi
d’une armée contre Thèbes, et Agésilas avait refusé d’en prendre le
commandement, s’excusant sur son âge. Son collègue Cléombrote le remplaça, et
fit en Béotie une incursion rapide (janv. 378). A Athènes, on s’effraya de voir les Spartiates si
près. Les riches profitèrent de l’abattement publie pour faire condamner à
mort les deux généraux qui avaient généreusement soutenu les conjurés, sans 1
ordre de l’assemblée, et par là risqué d’engager Athènes dans une guerre avec
Lacédémone. L’un fut exécuté, l’autre banni. C’était une concession à la peur
et un acte de soumission envers Lacédémone dont trois députés avaient porté à
Athènes de vives réclamations contre la secrète assistance donnée aux
fugitifs de Thèbes.
Une perfidie fit relever la tête aux Athéniens. Cléombrote
avait laissé à Thespies Sphodrias avec un corps de troupes ; l’exemple de
Phébidas le tenta : il résolut d’essayer un coup de main sur le Pirée, pour
dédommager Lacédémone de la perte de Thèbes. Un soir il partit avec des
forces assez considérables pour réussir; mais le jour le surprit prés d’Éleusis;
l’affaire était manquée. On l’accusa, à Sparte, d’avoir déloyalement attaqué
une ville alliée; Agésilas, défenseur cette fois encore d’une mauvaise cause,
le fit acquitter, pour cette raison que sa conduite avait toujours été auparavant
irréprochable. Athènes, indignée, rompit avec Sparte et prépara la guerre; on
se ménagea des ressources pour l’achèvement du Pirée et la reconstitution de
la marine : cent galères furent mises sur chantier (378)[14].
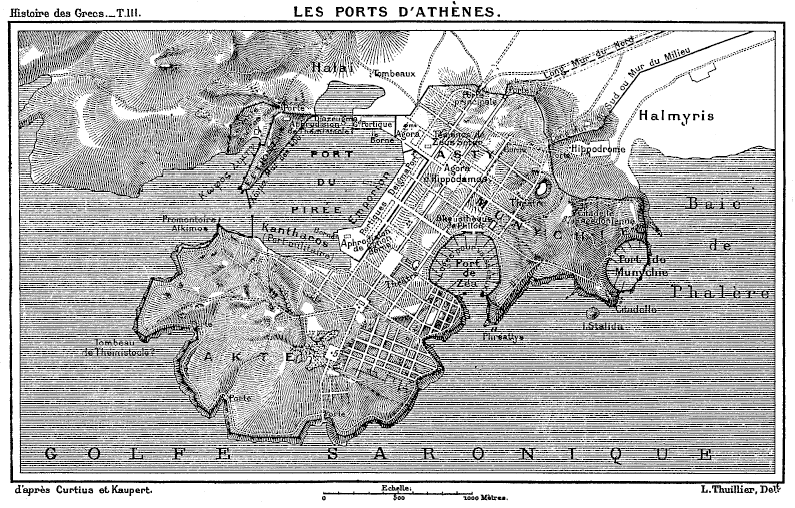
Sparte ne punissait pas Sphodrias; elle l’eût récompensé s’il
eût réussi, car elle s’inquiétait du réveil de la puissance athénienne. Conon
et Thrasybule avaient rendu à leur peuple une partie des villes qui avaient
été autrefois ses tributaires ; la paix d’Antalcidas les lui avait ôtées de
nouveau. Mais personne ne faisant alors la police de la mer, les pirates
pullulèrent bientôt[15], et les
insulaires qui avaient besoin du marché d’Athènes, des blés qu’elle allait
chercher dans la Tauride,
se rapprochèrent de la seule ville qui pût assurer à leur commerce les
produits et la sécurité dont ils avaient besoin.
Athènes venait de recouvrer l’intendance du temple de
Délos, le sanctuaire des Cyclades et de la race ionienne, qu’elle avait
perdue après 1Egos-Potamos. Changer ce lien religieux en un lien politique n’était
point chose difficile, pour peu que les circonstances y aidassent. Poussées
vers Athènes par leurs intérêts et par la hauteur, par les violences des
harmostes lacédémoniens, Chios, Byzance, Rhodes, Mytilène, l’Eubée presque
entière, enfin soixante-dix villes insulaires ou maritimes, vinrent d’elles-mêmes
lui demander de renouer cette confédération qui, durant plus de soixante ans,
leur avait donné paix, sécurité et richesse[16]. Au reste,
Athènes eut la sagesse de revenir au plan d’Aristide. Tous les membres de la
ligue, restant indépendants pour leur constitution intérieure, envoyèrent des
représentants à un congrès fédéral, qui se tenait à Athènes, et dans lequel
le moindre État avait une voix, et les plus grands, Athènes même, pas
davantage. Cette assemblée fut chargée de voter la contribution générale et
de déterminer le contingent de chaque cité. Les clérouquies avaient laissé un
mauvais souvenir; Athènes l’effaça par un acte de modération: elle renonça à
réclamer les terres qui avaient été autrefois partagées, sur le continent ou
dans les îles, entre des colons athéniens et dont ils avaient été dépossédés
à la fin de la guerre du Péloponnèse. Une loi interdit même à tout citoyen d’Athènes
d’acquérir des domaines et d’y prendre hypothèque hors de l’Attique[17]. L’admission de
Thèbes changea le caractère de la confédération qui, jusque-là exclusivement
maritime, se vit obligée de mettre sur pied des forces de terre
considérables. Dans la première ardeur de ce zèle nouveau, on se promit d’armer
vingt mille hoplites, cinq cents cavaliers et une flotte de deux cents
voiles.
En face de cette ligue, Sparte sentit la nécessité de
traiter plus doucement ses alliés et d’organiser plus équitablement les
contributions qu’elle leur imposait. La confédération nouvelle fut partagée
en dix sections : 1° les Lacédémoniens ; 2° et 3° les Arcadiens ;
4° les Éléens ; 5° les Achéens ; 6° les Corinthiens et les
Mégariens ; 7° les Sicyoniens, les Phliasiens et les habitants de l’Acté ;
8° les Acarnaniens, les Phocidiens et les Locriens; 10° les Olynthiens et les
alliés de Sparte en Thrace. La part de chaque section fut fixée ; et,
pour éviter l’arbitraire dans la levée des contingents, il fut réglé qu’un
hoplite équivaudrait à deux soldats armés à la légère, un cavalier à quatre
hoplites. Pour chaque hoplite manquant, il devait être payé 3 oboles d’Égine (0 fr. 67), le
quadruple pour un cavalier. La ville qui ne donnerait ni homme ni argent
serait passible d’une amende de 4 drachmes multipliés par le chiffre de
soldats qu’elle aurait dû livrer, et par le nombre de jours qu’aurait duré la
campagne : Sparte se chargeait de faire les recouvrements[18]. Elle reprenait
donc à son profit le système de l’ancienne confédération athénienne, en l’exagérant,
et c’était pour le détruire qu’elle avait entrepris la guerre du
Péloponnèse !
Dans l’été de 378, Agésilas fit une seconde incursion en
Béotie et, après quelques ravages, vint présenter la bataille à l’armée
confédérée. L’attitude martiale des Athéniens de Chabrias, qui attendirent le
choc. sans broncher, le bouclier appuyé contre le genou et la lance forte
ment tenue en arrêt des deux mains, l’intimida, quoiqu’il fût supérieur en
nombre, et le fit reculer. Les Athéniens élevèrent une statue à leur général,
qui le représenta dans cette attitude de combat: c’était la première de ces
flatteries qu’ils allaient tant prodiguer. Aux jours héroïques, on ne donnait
aux chefs glorieux qu’un tombeau à part. Il est vrai qu’alors c’était moins
le général qui était grand que le peuple.
Avant de reprendre la route de Lacédémone, Agésilas avait
mis garnison dans Thespies, en lui donnant pour chef Phœbidas, l’homme le
plus intéressé à surveiller et à contenir les Thébains. Ceux-ci, tout fiers d’avoir
vu le roi reculer devant eux, coururent, après son départ, à Thespies,
battirent les Péloponnésiens qui la gardaient et tuèrent Phœbidas, sans
réussir pourtant à s’assurer de la ville, où la haine des factions contraires
éclata avec violence. Les riches bannirent les chefs des démocrates et, pour
en finir avec ce parti, ils résolurent de faire un massacre général de leurs
adversaires. Agésilas, qui reparut en Béotie (377), arrêta ces ressentiments et essaya d’entraîner
les partisans de Lacédémone en ce pays à un grand effort contre Thèbes. Il
eut beau conduire cette guerre avec son habileté ordinaire, il n’en tira d’autre
avantage que de détruire des fermes, couper des arbres à fruits et brûler des
moissons : guerre sauvage qui exaspérait les populations, sans avoir l’excuse
d’un but élevé à atteindre. Les Thébains n’avaient pas, comme les Athéniens de
Périclès, la mer pour les dédommager de la terre, et ils commençaient à
souffrir de la disette, mais aussi ils s’aguerrissaient. Ils n’étaient pas restés
derrière leurs murs, où l’ennemi les eût vite bloqués et affamés ; ils
tenaient la campagne, suivaient les Péloponnésiens d’un peu loin, et par les
hauteurs, comme Fabius suivra Annibal, et ils s’habituaient par de fréquentes
escarmouches à regarder les Spartiates en face. Un jour Agésilas fut blessé dans
une rencontre avec eux : Voilà, lui dit un
Spartiate, le fruit des leçons que tu leur as
données. Lycurgue avait sagement recommandé de ne pas faire longtemps
la guerre aux mêmes ennemis.
Au printemps de l’année 376, ce fut Cléombrote qui dut mener
les Lacédémoniens en Béotie. Il n’eut pas, comme Agésilas, la prudence de s’assurer
à l’avance des passages du Cithéron, et éprouva un échec en voulant les
forcer. Les Athéniens contribuaient beaucoup à rendre cette guerre difficile
pour Lacédémone; c’étaient eux que les Péloponnésiens trouvaient toujours à
la défense des défilés. Sparte résolut de se prendre encore une fois corps à
corps avec son éternelle rivale ; elle envoya soixante galères croiser
au milieu des Cyclades pour intercepter les convois de blés dirigés sur le
Pirée. Athènes arma quatre-vingts sous les ordres de Chabrias, qui venait de
se distinguer en Chypre, au service d’Évagoras, et en Égypte, à celui d’Acoris,
le roi indigène révolté contre les Perses. Dans une bataille livrée près de
Naxos, les Lacédémoniens perdirent quarante-neuf vaisseaux. Leur défaite eût
été bien plus désastreuse si, se souvenant des Arginuses, Chabrias, au lieu
de les poursuivre, ne se fût arrêté à recueillir ses morts et les équipages
de dix-huit de ses galères qui avaient été brisées (sept. 376). Il ramena dans Athènes
trois mille prisonniers, et le butin monta à 440 talents.
Depuis la guerre du Péloponnèse, c’était la première
victoire navale gagnée par les Athéniens. Elle les releva dans l’opinion des
alliés, et, ce qui valait mieux, dans leur propre estime. Nombre de villes
entrèrent aussitôt dans leur alliance. L’année suivante, tandis que les
Lacédémoniens se préparaient à renouveler leur invasion périodique en Béotie,
Athènes reprit le plan hardi jadis proposé et exécuté par Périclès. Timothée,
fils de Conon, tourna avec cinquante galères le Péloponnèse, fit rentrer dans
l’alliance d’Athènes Corcyre, Céphallénie, les Acarnanes, Alcétas, roi des
Molosses, et battit l’amiral lacédémonien, en vue de Leucade. Ces succès
flattaient l’orgueil d’Athènes, mais les dépenses de la flotte épuisaient ses
ressources. Timothée avait reçu du trésor public 13 talents qui avaient été
bien vite épuisés; une avance de 7 mines, que lui firent chacun de ses
soixante triérarques, ne pouvait le faire vivre longtemps. Athènes, pressée
par lui d’envoyer de nouveaux subsides, s’adressa à ses alliés dont la
diversion navale servait efficacement les intérêts. Soit réelle impuissance,
ou plutôt mauvais vouloir, Thèbes ne voulut rien donner. Ce refus décida les
Athéniens, redevenus, malgré quelques pirateries des Éginètes, maîtres de la
mer Égée et par conséquent du commerce, à négocier avec Lacédémone. Sparte
aussi, inquiète de voir les côtes du Péloponnèse exposées à des descentes
désastreuses, désirait la paix : les deux villes conclurent un traité qui
reconnut aux uns l’hégémonie sur le Péloponnèse, aux autres la direction de
la confédération maritime (374). Les Athéniens aimaient encore à inviter la religion et
les arts à solenniser les grands actes de leur vie politique. Ils
instituèrent un sacrifice annuel et une fête pour rappeler la fin des jours de combat, et un sculpteur alors célèbre,
Képhisodotos, qui, au grand style de Phidias et à la sévère beauté de ses
dieux, avait déjà substitué une grâce plus humaine et plus vivante, fit, pour
un de leurs temples, une déesse de la
Paix, portant dans ses bras Ploutos, le dieu de la richesse
avec la corne d’abondance.
Cette convention semblait promettre une longue
tranquillité; elle dura quelques jours à peine : triste condition de cette
race querelleuse qui usera ses forces en d’éternels combats et, un jour,
viendra, épuisée de sang, tomber aux pieds de l’étranger. Avant de quitter la
mer d’Ionie, Timothée provoqua une révolution à Zacynthe ; Sparte essaya
d’en faire une à Corcyre, qui réclama l’assistance d’Athènes, et Thèbes
attaqua les villes béotiennes demeurées, depuis la paix d’Antalcidas, l’appui
de l’étranger, Thespies, Platée et Orchomène. Pélopidas, qui chaque année
était élu béotarque, marcha avec le bataillon sacré sur cette dernière ville,
que la garnison lacédémonienne venait de quitter pour aller en Locride ;
mais un autre corps l’avait remplacée le coup manqua. Au retour, Pélopidas
rencontra à l’improviste les Lacédémoniens près de Tégyre : Nous sommes tombés au milieu des ennemis, lui dit
un des siens. — Et pourquoi, répondit-il, ne sont-ce pas les ennemis qui sont tombés au milieu de
nous ? Il n’avait que trois cents hommes et quelques cavaliers ; les
Spartiates, bien plus nombreux, furent complètement battus. Le bataillon
sacré conquit ce jour-là sa légitime renommée. C’était une troupe d’élite
composée d’hommes unis entre eux par l’amitié. Cette troupe existait déjà
depuis longtemps, mais on dispersait ordinairement ceux qui la formaient dans
les premiers rangs de l’armée ; Pélopidas les fit agir en corps et
isolément, afin que leur valeur et leur discipline, étant mises en commun,
devinssent irrésistibles. Ce combat, dit
Plutarque, apprit pour la première fois aux Grecs
que ce n’est pas seulement sur les bords de l’Eurotas que naissent les hommes
intrépides ; mais que partout on les jeunes gens savent rougir de ce qui
déshonore et se porter avec ardeur à ce qui est glorieux, partout où le blâme
est redouté plus que le danger, là sont des hommes qu’il faut craindre.
Corcyre, vivement pressée par les Lacédémoniens, envoyait
à Athènes des appels désespérés. On manquait d’argent pour un armement
maritime; afin d’en recueillir, Timothée reçut l’ordre de visiter, avec
quelques galères, les villes alliées. La douceur de son caractère l’empêcha
de prendre de force ce qu’on ne lui offrait pas de bonne volonté, de sorte qu’il
perdit beaucoup de temps à cette mission (373). Cependant Corcyre allait succomber;
Athènes, en employant ses dernières ressources, jusqu’aux galères sacrées,
rassembla une flotte ; mais elle punit son général, trop lent au gré de son
impatience, par la perte de son commandement et le mit en jugement. Deux
puissants intercesseurs, Alcétas, roi d’Épire, et le tyran de Phères, Jason,
le sauvèrent ; tous deux vinrent à Athènes, et se logèrent dans la
demeure modeste de Timothée, qui fut obligé d’emprunter de l’argent et de la
vaisselle pour les recevoir. C’était un de ces hommes purs et honnêtes de la
famille d’Aristide, tels qu’Athènes en eut un certain nombre. Ses ennemis
niant son mérite ne parlaient que de son bonheur ; ils l’avaient fait
représenter endormi sous une tente pendant que la Fortune rassemblait pour
lui des villes prises dans un filet. Eh ! que
ferais-je donc si jetais éveillé ? dit-il. Il prouva qu’il avait
engagé ses biens pour l’entretien de la flotte et fut acquitté ; mais il
se retira chez les Perses, par un exil volontaire qui dura plusieurs années (373). La démocratie
d’Athènes se privait encore d’un bon serviteur. Iphicrate et Callistrate, ses
rivaux, le remplacèrent. Nous savons peu de chose du second qui, cependant,
passait pour le premier orateur de son temps, mais nous connaissons les
talents militaires du premier ; il les appliqua à la marine. Il n’avait
reçu que des matelots novices, il les exerça pendant la traversée. Arrivé
près de Corcyre, il épia dix vaisseaux que Denys de Syracuse envoyait aux
Spartiates et en prit neuf. Les Corcyréens s’étaient sauvés eux-mêmes par une
victoire (372).
Depuis que la guerre était devenue maritime les Athéniens
en portaient tout le poids, et Thèbes en tirait tout le profit. Elle s’était
emparée de Platée, dont Athènes recueillit encore les habitants, et l’avait
rasée de fond en comble ; Thespies avait subi le même traitement ; la Phocide était menacée.
Les Athéniens, mécontents des violences exercées contre les Platéens et
jaloux de voir une nouvelle cité monter au rang d’un grand État, firent à
Sparte des ouvertures de paix. Callistrate, leur orateur favori, désirait la
fin d’une guerre qui donnait l’influence aux généraux ; Iphicrate et
Chabrias la souhaitaient, en vue des brillants avantages que le roi de Perse
leur offrait, s’ils entraient à son service. Selon Diodore, Artaxerxés
lui-même s’occupa de rétablir la paix entre les Grecs, afin de pouvoir
prendre à sa solde leurs troupes licenciées, pour dompter ses provinces
rebelles. On disait aussi qu’Antalcidas était auprès de lui et qu’Athènes
devait se hâter de traiter, dans la crainte d’une nouvelle alliance entre
Lacédémone et l’empire oriental. Callias fut envoyé comme ambassadeur à
Sparte avec six collègues ; Callistrate l’accompagnait pour appuyer les
négociations de son éloquence.
Les discours qui furent alors prononcés et dont Xénophon,
qui a pu les entendre, nous a conservé l’esprit, ont plus d’un passage
intéressant. Celui de Callias est ridicule : il montre l’abus que les
orateurs avaient coutume de faire des souvenirs mythologiques. Pour lui, la
raison qui doit décider Sparte et Athènes à former une étroite alliance, c’est
que l’Athénien Triptolème a offert au Péloponnèse
les premiers dons de Cérès et qu’il est contre la justice que Lacédémone
ravage les moissons du peuple à qui elle doit les siennes. Autoclès s’attarde
moins dans la légende et va droit à l’histoire : Lacédémoniens,
dit-il, vous répétez sans cesse que les républiques
doivent être libres et vous obligez vos alliés à vous suivre partout où il
vous plaît de les conduire. Sans les consulter, vous déclarez la guerre, vous
décrétez des levées, en sorte que bien souvent des peuples qu’on dit libres
sont contraints de marcher contre leurs meilleurs amis. Et n’est-ce pas
porter le dernier coup à l’indépendance des cités que de mettre dans l’une
dix, dans l’autre trente hommes, moins chargés de les gouverner avec justice
que de les contenir par la force. Lorsque le roi de Perse déclara que toutes
les villes de la Grèce
seraient libres, vous dites que les Thébains agiraient contre le traité s’ils
ne laissaient pas les cités béotiennes se gouverner elles-mêmes, et vous avez
pris la Cadmée,
vous avez ravi à Thèbes sa liberté.
Ces paroles dures aux oreilles lacédémoniennes n’étaient
pas pour faciliter les négociations. Le troisième envoyé athénien,
Callistrate, plus adroit, rappela que, si Athènes et Sparte avaient, l’une et
l’autre, commis beaucoup d’erreurs, la sagesse est faite d’expérience, l’expérience,
de la connaissance des fautes dont on a souffert, et il ajouta : A en croire quelques ennemis de la paix, ce qui nous amène
à Lacédémone, c’est la crainte qu’Antalcidas, votre envoyé auprès du grand
roi, ne revienne chargé d’or ; mais ce monarque veut l’indépendance des
cités grecques, et, comme notre désir est le même, nous n’avons rien à
craindre de lui. » On voit quelle figure faisaient maintenant, aux
yeux des héritiers de la gloire de Salamine, ce roi de parade et cet empire
qui n’avait de grand que la liste de ses provinces indociles. Callistrate fut
plus dans la vérité, en disant : Toutes les villes
se partagent entre vous et nous; dans chaque cité, les uns sont partisans de
Lacédémone, les autres d’Athènes ; si nous devenions amis, quel adversaire
pourrions-nous raisonnablement redouter ? Forts de votre amitié, qui oserait
nous attaquer par terre ! Forts de la nôtre, qui vous inquiéterait par mer ?
C’était la seconde fois que Sparte et Athènes semblaient consentir à se
partager l’empire de l’Hellade. La paix fut conclue à condition que les Lacédémoniens
retireraient des villes leurs harmostes ; que des deux côtés on
licencierait les armées de terre et de mer, que chaque ville serait indépendante
et que, si l’un des contractants faisait quelque infraction au traité, les
autres pourraient se réunir contre lui. Cette clause était dirigée contre
Thèbes. Lacédémone jura la paix pour elle et pour ses confédérés ; les
Athéniens et leurs alliés prêtèrent le même serment, chacun pour sa ville. On
avait inscrit les Thébains parmi les alliés d’Athènes ; le lendemain ils
demandèrent qu’on remplaçât le mot de Thébains par celui de Béotiens.
Cette substitution eût justifié les prétentions de Thèbes à la domination de la Béotie. Agésilas
s’y opposa et demanda à Épaminondas, qui venait de parler pour Thèbes, s’il
ne croyait pas juste que Ies villes béotiennes fussent libres. Non, répliqua Épaminondas, à
moins que vous ne trouviez juste que les villes laconiennes soient
indépendantes. Agésilas raya le nom des Thébains du traité (juin 371). C’était
une déclaration de guerre faite au moment où les simples auraient pu croire
que l’on signait une paix générale.

III. Leuctres (371) : Mantinée, Mégalopol et Messène ;
Épaminondas en Laconie (370-339)
Avant l’ouverture du congrès de Lacédémone, Cléombrote
avait conduit une armée en Phocide pour protéger cette province contre les
Thébains qui la menaçaient. Il reçut l’ordre de descendre en Béotie, et vingt
jours étaient à peine écoulés depuis la signature du traité qu’il arriva dans
la plaine de Leuctres, en face de l’armée thébaine, avec les 10.000 hoplites
et les 4000 cavaliers, que Diodore lui donne peut-être trop libéralement. Au
milieu de cette plaine s’élevait le tombeau de deux jeunes filles qui s’étaient
tuées pour ne pas survivre à un outrage qu’elles avaient reçu des
Lacédémoniens. Ce monument d’un crime de leurs ennemis tut regardé parles
Thébains comme d’un heureux présage ; ils décorèrent de guirlandes le tombeau des vierges, et, dans l’armée on ne
douta pas que les Erinyes les vengeraient. De Thèbes les prêtres annonçaient
que les portes des temples s’étaient ouvertes d’elles-mêmes, que l’armure d’Hercule
avait disparu de son sanctuaire, et que ces prodiges révélaient sûrement que
les dieux étaient partis pour combattre les envahisseurs, comme Thésée avait
été vu à la journée de Marathon, et les Éacides à celle de Salamine.
Les Thébains n’avaient que six mille hommes de pied, mais
leur cavalerie était supérieure à celle des Spartiates, et Pélopidas
conduisait le bataillon sacré. On n’était point, dans le conseil, décidé à
combattre : Épaminondas, un des sept béotarques, voulait engager l’action ;
ses collègues hésitaient ; trois voix s’étant jointes à la sienne, son
avis l’emporta. Les Lacédémoniens n’avaient rien changé à leur tactique
habituelle ; leur ordre de bataille était toujours une ligne d’hoplites
qui, rangés sur douze files, présentaient un front menaçant et impénétrable
de piques et de boucliers. Mais, par une violente poussée sur un point de
cette muraille, on pouvait l’ébranler, la rompre et se faire jour au travers.
Épaminondas disposa l’armée d’après cette idée : il l’établit obliquement, engageant
vivement sa gauche, formée d’hommes d’élite, sur cinquante de profondeur, et
refusant sa droite. Comme il réservait ainsi le fort de l’action à ses
meilleurs soldats et qu’il s’assurait la supériorité du nombre au point
attaqué, il brisa facilement la ligne des Spartiates, que, d’autre part, la
cavalerie thébaine ébranlait. Cléombrote essaya d’envelopper ce coin terrible
qui s’enfonçait dans son front de bataille ; Pélopidas le chargea impétueusement
avec le bataillon sacré, et le roi tomba frappé à mort. Ses amis purent l’emporter
respirant encore jusqu’au camp, où l’armée se réfugia derrière le fossé qui
le couvrait. Mille Lacédémoniens et quatre cents Spartiates, sur sept cents
qu’ils étaient, restèrent sur la place ; il fallut demander aux vainqueurs
une trêve pour ensevelir les morts : c’était l’aveu ordinaire de la défaite.
Les Thébains l’accordèrent et aussitôt dressèrent leur trophée. Quand on
félicita Épaminondas : Ce qui me rend le plus
heureux, dit-il, c’est que mon père vit
encore ; il jouira de cette gloire (6 juillet 371)[19].
On célébrait alors à Sparte la fête des Gymnopédies ;
la ville était pleine d’étrangers et des chœurs de jeunes garçons chantaient
sur le théâtre, lorsque des courriers arrivés de Leuctres annoncèrent la
funeste nouvelle. Les éphores sentirent bien qu’ils venaient de perdre l’empire
de la Grèce.
Cependant ils ne permirent ni aux choeurs de sortir du
théâtre ni à la ville d’ôter les décorations de la fête. Le lendemain, quand
on eut la liste certaine des morts et de ceux qui s’étaient sauvés, les
parents des premiers se montrèrent en public parés et joyeux. Au contraire,
les proches de ceux qui avaient échappé à la mort s’enfermèrent dans leurs
maisons, comme en un temps de deuil ; ou, s’ils étaient forcés de
sortir, ils marchaient tristes et la tête baissée[20]. Quelle fausse
ostentation de grandeur ! Cette joie des uns, cette douleur des autres,
étaient-elles bien sincères ? N’était-ce pas plutôt un râle que Sparte
se forçait à jouer[21] ? Sous le
masque d’emprunt, il y avait le père, le fils, le frère, qui, endurcis par la
loi, ne pleuraient pas, je le veux bien, mais il y avait aussi le citoyen qui
devait comprendre que, dans cette journée, était tombé un mort de plus que
les listes n’en portaient, et sur lequel ils pouvaient pleurer Lacédémone
elle-même.
Les Spartiates avaient fui ; la loi les condamnait à
la honte et les déclarait incapables de remplir une charge. Agésilas proposa
de laisser dormir un jour la loi pour que Sparte n’eût pas à mépriser un trop
grand nombre de ses citoyens.
Thèbes usa mal, quelques jours après, de sa victoire. Sous
prétexte d’un complot aristocratique, elle fit égorger tous les habitants
mâles d’Orchomène de Béotie, vendit les femmes, les enfants, et rasa cette
ville[22]. Cet acte d’atroce
jalousie fut accompli en l’absence d’Épaminondas, qui une première fois l’avait
empêché. Thèbes avait déjà à sa charge le crime de Platée, attaquée en pleine
paix, puis détruite. Le massacre d’Orchomène rappelle la condamnation, à
Athènes, des captifs mytiléniens et ceux des défenseurs de Platée par les
Spartiates : à certains moments tous ces Grecs étaient féroces.
Quand un grand événement venait déranger en Grèce l’équilibre
des puissances, il se produisait toujours des convulsions qui se
répercutaient des grands États dans les petits. On l’a vu après la chute d’Athènes ;
on le vit davantage après la bataille de Leuctres, car c’était la puissance
la plus ancienne, la moins contestée qui, cette fois, chancelait. La
domination spartiate dans le Péloponnèse fut ébranlée jusque dans ses
fondements, et il n’y eut pas une bourgade peut-être, dans toute la presqu’île,
qui n’en fût troublée, parce que partout les deux partis aristocratique et
démocratique étaient en présence, et que, dès que l’un des deux voyait son
drapeau triompher sur quelque champ de bataille, il en tirait avantage pour
dominer dans sa localité.
Jamais les Spartiates n’avaient été si complètement
vaincus sur terre : Sphactérie n’était rien auprès de Leuctres. Athènes crut
le moment venu de recueillir une partie de leur héritage. L’accueil insultant
qu’elle fit au messager thébain qui lui annonça la victoire était un éclat de
jalousie et de regret pour n’avoir pas elle-même porté ce coup à son ancienne
rivale, et ne prouvait pas qu’elle en eût compassion. Son premier soin fut de
chercher à la supplanter jusque dans le Péloponnèse, en se faisant à son tour
l’exécutrice du traité d’Antalcidas. Elle convoqua une assemblée dans
laquelle les députés de plusieurs villes, ceux de Corinthe entre autres,
jurèrent d’observer la convention envoyée par le
grand roi et de combattre quiconque attaquerait une des villes
ayant fait ce serment. Ce n’était pas moins qu’une ligue nouvelle, non plus
seulement des cités maritimes, mais sur le continent même, et à la tête de
laquelle Athènes se plaçait à la fois contre Sparte et contre Thèbes.
Les Mantinéens sans doute y entrèrent, car ils quittèrent
aussitôt les quatre villages où Sparte les avait dispersés, et se mirent à
reconstruire leur ville. Agésilas les somma de suspendre ces travaux, leur donnant
à entendre que Sparte, trop affaiblie pour employer la force, les aiderait
elle-même un jour à relever leurs murs, s’ils consentaient à ne point offrir
à la Grèce le
spectacle de Lacédémone impunément bravée. Ils n’obéirent pas, et on n’osa
les contraindre; plusieurs villes leur envoyèrent des ouvriers ; les
Éléens donnèrent 3 talents (370).
A Phigalie, les exilés du parti oligarchique firent un
sanglant coup de main, mais sans résultat. Les exilés démocrates de Corinthe
tentèrent une entreprise semblable sur leur ville ; ayant échoué, ils se
tuèrent les uns les autres pour éviter la vengeance de leurs ennemis, qui
établirent contre leurs partisans une sévère inquisition. Pareilles scènes
eurent lieu à Sicyone et à Mégare. A Phlionte, les chefs du parti
démocratique voulurent rentrer avec des mercenaires ; ils tuèrent trois
cents hommes aux aristocrates, mais en perdirent six cents et s’enfuirent à
Argos.
Cette ville était plus malheureuse encore; elle avait
recueilli tous les Péloponnésiens bannis pour la cause populaire et elle
était devenue un foyer de démocratie incohérente, que remuaient incessamment
les démagogues. Un complot du parti aristocratique, vrai ou supposé, avant
été découvert, ouvrit la voie aux plus cruelles vengeances. D’abord
quelques-uns des accusés se tuèrent eux-mêmes; trente qui espérèrent sauver
leur vie, en dénonçant leurs complices, ne gagnèrent même pas un répit de
quelques heures ; douze cents autres, au dire de Diodore, furent encore
arrêtés et, comme les formes judiciaires paraissaient trop lentes, le peuple s’arma
de bâtons et les assomma : cet horrible massacre fut appelé le scytalisme,
du mot grec qui signifie bâton. Mais les démagogues, victimes à leur tour des
passions qu’ils avaient soulevées, périrent, et ce ne fut qu’après s’être
inondée de sang qu’Argos trouva enfin la paix. Jamais Athènes n’avait vu
pareilles tragédies ; cela marque bien,
dit Niebuhr, la supériorité de ce peuple privilégié.
J’en trouve une autre preuve dans l’effet produit par la nouvelle de ces
abominations. Pour en avoir entendu seulement le récit dans une de leurs
assemblées, les Athéniens se crurent souillés et recoururent aux cérémonies
expiatoires (370)[23].
On se demande comment on pouvait vivre avec tant d’égorgements
dans les villes, de dévastations dans les campagnes; et l’on arrive à penser
que ces agitations meurtrières et stériles justifient Sparte et Athènes d’avoir
cherché à saisir une domination qui, du moins, donnait la paix à la Grèce, quand toutes deux
ne s’armaient pas l’une contre l’autre.
La seule révolution qui ait eu alors une portée
considérable fut celle qui changea la situation politique de l’Arcadie. Avec
un territoire plus étendu que toute autre région du Péloponnèse, avec une
race robuste et belliqueuse, l’Arcadie n’avait jamais eu d’influence sur les
affaires de la Grèce. Ce
pays n’était qu’un passage pour les armées de Lacédémone, et ce peuple
laissait ses enfants aller, comme mercenaires, vendre partout leur insouciant
courage. Il perdait ainsi le meilleur de son sang, sans profit pour sa
puissance ; et tandis que les Arcadiens donnaient à des rois étrangers
la victoire et le pouvoir, l’Arcadie restait d la discrétion de Sparte. Bien
des patriotes auraient voulu changer cette situation. La bataille de Leuctres
fit prendre corps d des idées jusque-là incertaines. Un Mantinéen nommé
Lycomède, homme riche et noble, proposa d’unir le peuple arcadien en un seul
corps, comme les Spartiates et les Athéniens. Les
Lacédémoniens, dit-il, n’ont jamais fait sans
nous une incursion dans l’Attique. Sans nous, auraient-ils pris
Athènes ? Il voulait fonder une métropole, établir un conseil
national, qui serait investi de l’autorité suprême sur les affaires
extérieures, particulièrement sur les questions de paix et de guerre, enfin
organiser une force militaire pour la sûreté de l’État.
Sparte fut effrayée d’une entreprise qui allait placer sur
sa frontière du nord une puissance redoutable et ennemie. Mais Thèbes l’accueillit
avec joie ; et, si Épaminondas ne fut pas, comme on l’a dit, l’auteur du
projet, il l’encouragea de tous ses efforts ; quand on commença les
fondations de la nouvelle ville, il envoya mille soldats d’élite pour
protéger les travailleurs. Quelques mois seulement après la bataille de
Leuctres, une assemblée d’Arcadiens se réunit, et bientôt après commença à s’élever
Mégalopolis (la
Grande Ville), dans une vaste plaine du
sud-ouest de l’Arcadie, sur les bords d’un affluent de l’Alphée, non loin des
frontières de la Messénie
et de l’un des passages qui conduisaient dans la vallée de l’Eurotas. La
ville, construite sur un large plan, eut le théâtre le plus vaste de la Grèce, et quarante villes,
selon Pausanias, ou plutôt quarante villages contribuèrent à la peupler.
Quatre cantons seulement refusèrent leur concours ; trois d’entre eux furent
contraints par la force de se rallier au projet; le quatrième, celui où s’élevait
Lykosoura, qui se vantait d’être la plus ancienne cité sous le soleil, garda
pour cette raison son autonomie. Orchomène et Héræa restèrent aussi à l’écart
(370).
La nouvelle constitution de l’Arcadie semble une ébauche
de celle que se donneront plus tard les Achéens; mais les documents pour la
bien connaître font défaut. Une inscription mentionne un conseil, Βουλή, composé de démiurges
ou députés envoyés par les peuples faisant partie de la ligue arcadienne, et
il est fréquemment question d’un corps appelé les Dix Mille, qui se
réunissait d’abord à Mégalopolis, plus tard dans les autres villes
successivement, à des époques déterminées et toutes les fois que l’intérêt
public le demandait. Qu’étaient-ce que ces Dix Mille ? Sans doute une
assemblée que l’on désignait par un gros chiffre pour dire seulement qu’elle
était nombreuse[24].
Ses membres devaient être ce que nous appellerions les citoyens actifs qui,
par leur âge et leur fortune, pouvant servir comme hoplites, formaient, dans
les temps de crise, l’armée de l’État et, durant la paix, son corps
législatif. Le conseil n’avait probablement, ainsi que les sénats des autres
villes grecques, qu’un droit d’avis préalable, zrpo6ovlevµz; c’était l’assemblée
qui décidait de toutes les affaires importantes : la paix, la guerre, les
alliances, l’impôt, le contingent de chaque canton, les causes de haute
trahison, etc., et ces décisions étaient obligatoires pour toutes les villes.
On sait mal aussi ce que fut le pouvoir exécutif; on voit seulement un
stratège ou général qui commandait l’armée et présidait le grand conseil, des
archontes chargés de l’administration, et un corps de troupes soldées, comme
il y en avait alors partout, les éparites, pour faire exécuter dans chaque
ville les ordres de l’assemblée et des magistrats.
Les villes d’Orchomène et de Tégée furent les seules de l’Arcadie
qui firent une résistance énergique au nouvel état de choses. La première
reçut une garnison lacédémonienne, la seconde fut le théâtre de luttes
sanglantes entre les deux partis. Les démocrates, vaincus d’abord, prirent
leur revanche, et huit cents partisans de l’oligarchie périrent. Sparte ne
pouvait cependant abandonner ses amis et accepter de tels affronts en
silence. Agésilas vint ravager pendant trois jours le territoire de
Mantinée ; mais une armée thébaine approchait, il recula pour aller mettre
Lacédémone en défense (369).
Après sa victoire de Leuctres, Thèbes avait pris Thespies et
l’Orchomène de Béotie, pour ranger ce pays entier sous sa loi, et ses envoyés
lui avaient gagné l’alliance de l’Eubée, des deux Locrides, des Maliens, même
de la Phocide. Jason
de Phères, dont il sera question plus loin, lui avait offert celle de la Thessalie, et sa mort,
arrivée bientôt après, l’avait débarrassée d’un allié trop puissant; enfin la Pythie, jusqu’alors si
docile à Lacédémone, s’était faite Béotienne : dénoncés au conseil
amphictyonique comme infracteurs de la paix par la surprise de la Cadmée, les Spartiates
avaient été condamnés à une amende de 500 talents et exclus des fêtes
religieuses. L’axe politique de la
Grèce était changé. Pour le fixer à Thèbes, Épaminondas
proposa et fit accepter un plan d’invasion dans le Péloponnèse. Une armée considérable
fut réunie. Excepté l’Attique, presque tous les peuples, au nord du golfe de
Corinthe, avaient contribué à la former, et lorsqu’elle eut franchi l’isthme,
les Éléens, les Argiens et les Arcadiens lui amenèrent leurs contingents. Des
écrivains qui ne lésinent pas avec les chiffres lui donnent, l’un, Diodore,
50.000 hommes, l’autre Plutarque, 70.000, dont 40.000 hoplites. Dé telles
masses d’hommes, rien qu’en marchant, auraient écrasé sous leurs pieds la ville sans muraille, et l’on va voir qu’il
suffit à Sparte de bien peu de guerriers pour rendre vaine cette invasion
formidable. Mais plus était grossi le péril, plus devait s’accroître, aux
yeux de la postérité, l’honneur du peuple qui sut y échapper ; la thèse
des mérites de Lacédémone en était d’autant mieux affermie.
Épaminondas s’était proposé de rendre à la vie politique
deux peuples du Péloponnèse : les Arcadiens, qui venaient de montrer une
activité inattendue, et les Messéniens, que Sparte avait presque anéantis,
mais dont il subsistait des rejetons vigoureux en divers lieux d’exil. Il n’avait
pas compris dans son plan de campagne une invasion en Laconie, parce que l’entrée
de cette vallée, où l’on ne pénétrait que par les gorges du Taygète, était
facile à défendre, et qu’après une défaite on y serait pris comme dans un
piège. Il s’y décida pourtant, quand il apprit que les passages n’étaient
point gardés et qu’il lui fut venu, de Laconie même, de secrètes invitations.
L’armée, partagée en quatre divisions, pénétra par quatre endroits différents
et se réunit à Sellasie[25]. De là elle
descendit, en suivant la rive gauche de l’Eurotas, jusqu’auprès de Sparte
qui, depuis qu’elle était aux mains de la race dorienne, n’avait pas vu de
feux ennemis s’allumer autour d’elle. La terreur était extrême; la plus
grande partie de la population, libre et esclave, refusait d’obéir.
Heureusement Sparte avait alors un vieux soldat habitué à garder son
sang-froid au milieu du péril. Une promesse de liberté fut faite aux hilotes
qui voudraient s’armer : six mille se présentèrent. Un nombre à peu près égal
d’alliés arriva par mer, de Corinthe, de Sicyone, de Pellène, d’Épidaure, de
Trézène, d’Hermione et d’Haliées.
Après avoir tout saccagé à l’est de Lacédémone, l’ennemi
passa l’Eurotas, en face d’Amyclées, et, pendant trois ou quatre jours,
Épaminondas espéra attirer son adversaire à une bataille en ravageant la
plaine sous ses -eux; le roi ne bougea pas. Une attaque de cavalerie ne
réussit pas, bien que les Thébains eussent pénétré dans la ville. Peut-être s’étaient-ils
ainsi avancés pour soutenir des traîtres, deux cents Spartiates, qui s’étaient
saisis d’une hauteur dans le quartier d’Issorion. Les cavaliers tombés dans
une embuscade se retirèrent en désordre; quant aux traîtres, on disait autour
d’Agésilas qu’il fallait les attaquer. Cette guerre civile, en face de l’ennemi,
eût fait éclater d’autres trahisons et ruiné la ville. Agésilas feignit d’ignorer
leurs mauvais desseins ; et, sans armes, suivi d’un seul homme, il va à
eux, leur crie qu’ils ont mal entendu ses ordres, et que ce n’est point là qu’il
les a envoyés. En même temps, il leur montre de la main les différents
quartiers où ils doivent se répandre. Eux, convaincus qu’on n’a rien
découvert, descendent et obéissent. Agésilas fait aussitôt occuper l’Issorion ;
la nuit suivante, quinze des coupables périrent. D’autres conspirateurs
furent encore surpris et exécutés. Agésilas avait ainsi à veiller sur les
siens autant que sur l’ennemi.
Cependant les moyens de réduire une place étaient si
défectueux, que Ies Thébains n’osèrent tenter une attaque de vive force
contre ces collines, à travers les rues, le long de ces constructions où des
embuscades pouvaient se cacher. Et puis cet antre du lion inspirait une terreur
à ceux qui avaient si longtemps tremblé au seul nom des Spartiates. Épaminondas
descendit la vallée, saccageant villes et villages, et vint donner l’assaut à
Gytheion, le port de Sparte[26]. Mais, après
tant de ravages, le pays épuisé ne pouvait plus le nourrir. Les alliés
chargés de butin voulaient le mettre en sûreté, et peu à peu s’écoulaient ;
il fallut s’éloigner. Épaminondas laissa du moins à Sparte une trace terrible
de son passage, la construction de Messène, sur la pente occidentale du mont Ithome.
Les meilleurs architectes en tracèrent le plan, et les meilleurs ouvriers en
élevèrent les murailles, dont les ruines excitent encore l’étonnement.
Pausanias ajoute, comme d’habitude, à ce grand fait politique, des
circonstances merveilleuses. Un songe révéla au Messénien Épitelès le lieu où
Aristomène avait enseveli les règlements des anciens rites; on découvrit un
rouleau d’étain sur lequel ils étaient gravés, et le jour où l’on jeta les
fondements de la nouvelle ville, les sacrifices solennels furent accomplis
comme ils l’avaient été neuf siècles auparavant. Les grandes déesses Déméter
et Perséphone reprenaient possession de leur culte, en même temps que leur
peuple redevenait maître de la terre des aïeux[27]. Les Arcadiens,
en souvenir de leur antique alliance avec les compagnons d’Aristomène,
tinrent à honneur d’offrir les premières victimes, et les prières à Jupiter
Ithomate se confondirent sur l’autel avec celles à Jupiter Lycæos, comme
allaient se confondre les destinées des deux peuples.
Épaminondas avait rappelé tout ce qui survivait de
Messéniens, et il leur adjoignit, avec les mêmes droits de cité, les
étrangers qui se présentèrent. Les hilotes de la Messénie, descendants
des anciens maîtres du pays, favorisèrent sans doute cette entreprise par un
soulèvement, et formèrent la portion la plus considérable du nouveau peuple.
La riche vallée du Pamisos se trouva ainsi séparée de la Laconie, exemple
contagieux qui entraîna d’autres défections. Les Scirites, au nord, se
rendirent indépendants; Sellasie, dans la vallée même de l’Eurotas, fit de
même, mais ne sut garder que quatre ou cinq ans sa liberté.
Après avoir enfoncé au flanc de Sparte ce poignard, après
l’avoir cerné par Messène à l’ouest comme elle l’était au nord par
Mégalopolis et par Tégée, où il mit garnison, Épaminondas put sortir content
de la Péninsule,
dont la face était maintenant à jamais changée : l’habile général s’était
montré un grand politique. Mais, à l’isthme, il rencontra un ennemi
inattendu. Sparte, réduite à l’extrémité, avait invoqué, comme à l’époque de
Tyrtée, l’appui d’Athènes ; après quelques délibérations orageuses à l’Agora
et bien moins par amour pour Sparte que par jalousie contre Thèbes, l’assemblée
avait décidé que l’on enverrait des secours. L’envie est un mauvais
sentiment, qui d’ordinaire conseille mal ; il y eut pourtant alors, dans
celle d’Athènes, de la sagesse. Thèbes devenait menaçante ; elle régnait
dans la Grèce
centrale ; elle avait des alliés dans la Thessalie, presque des sujets dans le
Péloponnèse, et elle voudra bientôt avoir une flotte dans la mer Égée. Que
cette puissance s’affermisse, et les Athéniens seront en danger, car Thèbes
semble aspirer, elle aussi, à la domination que Sparte et Athènes ont tour à
tour exercée. Ces craintes légitimes expliquent qu’à l’appel de Lacédémone
Athènes ait enrôlé douze mille hommes pour occuper les passages de l’isthme ;
mais Iphicrate, qui les commandait, n’osa risquer une bataille, et
Épaminondas rentra en Béotie.
Suivant Plutarque, qui aime le tragique, son retour, que
Thèbes eût dû fêter avec enthousiasme, fut accueilli par une accusation
capitale. Il avait conservé le pouvoir quatre mois au delà du terme légal.
Pélopidas, accusé comme lui, chercha à émouvoir ses juges et plus tard se
vengea du rhéteur qui avait provoqué l’accusation. Pour Épaminondas, il ne se
défendit pas, se déclara prêt à mourir, et demanda seulement qu’on écrivît
sur sa tombe les noms de Leuctres, de Sparte et de Messène. Tous deux furent
absous (369).
Pausanias n’en sait pas si long[28] ; d’après
lui, le jugement fut une simple formalité dont Épaminondas, dans son intérêt,
demanda sans doute l’accomplissement, et les juges ne voulurent même point qu’on
allât aux suffrages.
Le premier soin de Sparte délivrée avait été d’envoyer à
Athènes une ambassade pour cimenter l’alliance entre les deux États : il fut convenu
qu’ils commanderaient tour à tour pendant cinq jours sur terre comme sur mer.
Mégare, Corinthe, Épidaure et Denys de Syracuse lui promirent des
auxiliaires ; mais les Arcadiens appelèrent une seconde fois les
Thébains dans le Péloponnèse. Une armée de Sparte et d’Athènes qui voulut
leur fermer le passage de l’isthme n’y put réussir, et Épaminondas força
Sicyone à entrer dans l’alliance béotienne. Une tentative sur Corinthe, que
Chabrias fit échouer, et l’arrivée du secours promis par Denys de Syracuse,
engagèrent Épaminondas à se retirer (été de 369). Avec la justice habituelle aux démocraties on l’accusa,
au retour, parce qu’il n’avait pas, dans cette campagne, réalisé les
ambitieuses espérances de ses concitoyens, et il fut révoqué de son commandement.
Durant ces opérations au nord de la Péninsule, les
Arcadiens s’étaient enhardis à faire eux-mêmes leurs propres affaires, comme
Lycomède les en pressait. Si vous êtes sages,
leur disait-il, gardez-vous de marcher toujours,
comme vous en avez l’habitude, à la suite des autres ; les Thébains
seront pour vous de nouveaux Spartiates[29]. Ils l’écoutèrent,
et envahirent seuls la
Laconie, dont ils ravagèrent impunément quelques cantons. L’année
suivante, ils voulaient recommencer : Archidamos, fils d’Agésilas, les
prévint. A la nouvelle qu’il avait franchi leur frontière, ils coururent à sa
rencontre, le firent rétrograder en Laconie et l’y attaquèrent près de Midée.
La victoire sans larmes ne coûta pas, dit-on, un seul homme aux
Spartiates. Xénophon vante, dans le récit de cette bataille, le courage des
mercenaires gaulois que Denys avait envoyés au secours de Lacédémone[30]. C’est la
première mention qui soit faite de nos pères dans les annales du monde grec (368).

IV. Intervention de Thèbes en Thessalie ; bataille de Mantinée
Les affaires de Thessalie, auxquelles Thèbes se mêla,
donnèrent quelque répit à Lacédémone. Ce pays, dès longtemps déchiré par les
dissensions intestines, avait trois villes principales, Larissa, Pharsale et
Phères, qui se disputaient la suprématie. A Phères, le pouvoir fut usurpé,
sans doute dans une lutte contre l’aristocratie, par Lycophron, qui, l’année
même de la prise d’Athènes, gagna une importante victoire sur les
Thessaliens, conjurés pour le renverser. Larissa pourtant tint bon contre
lui. Là dominait Médios, chef des Aleuades, qui, aidé d’un corps de Béotiens
et d’Argiens, s’empara de Pharsale. Agésilas, en revenant d’Asie, rendit la
liberté à cette ville, que le riche Polydamas, hospitalier
et fastueux à la mode thessalienne[31], gouverna
quelque temps avec sagesse et intégrité, du consentement de ses habitants.
Les rivalités des villes et la faiblesse de la Thessalie divisée
duraient donc toujours ; Jason, successeur et peut-être fils de
Lycophron, voulut lui faire jouer un autre rôle. Quand
la Thessalie
est réunie sous un Tagos, disait-il, elle
peut forcer tous ses voisins à lui obéir, car il lui est facile de mettre en
campagne 6000 cavaliers et 10.000 hoplites[32]. Et ce n’étaient
point de vaines paroles. Il prit à sa solde 6000 mercenaires qu’il exerça
avec le plus grand soin, et dont il s’assura la fidélité par des largesses.
Il força plusieurs villes d’accepter son alliance, c’est-à-dire sa
suprématie; conclut avec Alcétas, roi d’Épire, un traité qui faisait de l’Épirote
un vassal du prince thessalien ; et, comme Pharsale s’appuyait à Sparte,
il entra en relation avec Thèbes, mais refusa l’amitié d’Athènes, pour n’être
point gêné, par cette alliance, dans ses projets maritimes. Il avait déjà
porté de ce côté ses vues que favorisait le voisinage de Pagase, le port d’où
les Argonautes étaient partis[33]. Mais Pharsale
lui était un grand obstacle. Il amena Polydamas à une conférence, lui montra
ses forces, ses plans, et obtint de lui la promesse que, si Sparte ne le
secourait point, il ouvrirait ses portes. Sparte refusa toute
assistance ; Polydamas et Jason tinrent leur parole l’un livra la ville,
l’autre la traita en alliée (374).
Maître alors de toute la Thessalie, Jason se
fit nommer Lagos, chef suprême et légal du pays. Il porta ses forces à 20.000
hoplites et à 8000 cavaliers, sans compter beaucoup de troupes légères. Il
voulait aussi avoir une puissante marine, et ses secrètes espérances dépassaient
encore la portée de ses forces. Après Leuctres, invité par les Thébains à les
aider pour achever la ruine de Sparte, il était accouru avec une troupe
nombreuse et avait artificieusement ménagé une trêve, qui sauva Ies débris de
l’armée de Cléombrote. Il convenait à ses desseins qu’une des deux villes ne
l’emportât pas sur l’autre, afin que leur rivalité lui ouvrit un chemin plus
facile à la domination de la
Grèce. Au retour de cette expédition, où il avait paru
comme médiateur entre deux puissantes cités, il s’était emparé d’Héraclée, où
était la clef des Thermopyles, et d’Hyampolis, sur les confins de la Phocide et de la Béotie. C’étaient des
routes dont il s’assurait en diverses directions. Un jour il annonça l’intention
d’aller offrir à Delphes un sacrifice et de présider les jeux pythiens. Dans
ce but, il avait exigé de ses sujets une contribution de 1000 bœufs et de 10.000
têtes de menu bétail : prodigieuse offrande qui devait étonner et intimider la Grèce, en lui montrant l’étendue
des ressources de la
Thessalie. Mais, comme avant son départ il donnait
publiquement audience, sept jeunes gens s’approchèrent de lui, sous prétexte
de lui faire juger un différend, et le tuèrent. Quelque temps auparavant, des
Delphiens, inquiets de cette visite pour les trésors du temple, avaient
demandé à l’oracle comment ils repousseraient Jason. Le
dieu saura se défendre, leur avaient répondu les prêtres ; et le
dieu s’était défendu. Ceux des meurtriers de Jason qui échappèrent à ses
gardes, furent reçus avec honneur dans les villes grecques, qui se sentaient
menacées par l’ambitieux Thessalien ; ses grands desseins périrent avec
lui (370).
On accusa aussi de ce meurtre un des frères de Jason,
Polydoros, qui lui succéda. Polyphron, l’autre frère, tua le meurtrier, puis
fut assassiné lui-même par son neveu, devenu célèbre entre les tyrans cruels,
sous le nom d’Alexandre de Phères. Il consacra aux dieux la lance dont il
avait frappé Polyphron, tua le sage Polydamas,
et fit égorger tous les habitants de deux villes qui l’avaient offensé. Les
Aleuades de Larisse appelèrent à leur aide le roi de Macédoine, Alexandre II,
et ce prince étant trop occupé chez lui, ils s’adressèrent à Thèbes. On leur
envoya Pélopidas, dont le ferme langage effraya assez le tyran pour qu’il s’enfuît
précipitamment avec ses gardes (369). De là, Pélopidas passa en Macédoine, où il s’était déjà
rendu après la mort d’Amyntas (370) ; il y retourna cette fois pour renverser l’influence d’Athènes
alors dominante à Pella, et il obligea Ptolémée, qui venait de tuer Alexandre
II et de prendre le pouvoir comme tuteur de Perdiccas III, à faire amitié
avec Thèbes. Afin de l’enchaîner à cette alliance, il emmena comme otage
Philippe, frère du roi, et trente jeunes gens des plus illustres maisons de
Macédoine. La Grèce
put voir alors, dit Plutarque, à quel point
de grandeur les Thébains étaient parvenus, l’opinion qu’on avait de leur
puissance et la confiance qu’inspirait leur justice. Le dernier point
était douteux, mais les deux autres ne le sont pas (368).
Cependant, comme au temps de la paix d’Antalcidas, les
étrangers s’occupaient de réconcilier les Grecs. Ariobarzane, satrape de l’Hellespont,
qui avait des motifs particuliers pour tirer Sparte de ses embarras, proposa
une réunion de députés des divers États à Delphes. Il y dépêcha un homme d’Abydos,
Philiscos, avec beaucoup d’argent : mais Thèbes refusant d’abandonner
Messène, rien ne put se conclure, et Philiscos se mit à lever des troupes
pour le service des Lacédémoniens. Il fallait rompre cette alliance.
Pélopidas fut envoyé au grand roi. D’autres députés arrivèrent de Sparte, d’Athènes,
de l’Arcadie, de l’Élide, d’Argos, et la cour de Suse eut encore le spectacle
honteux de la Grèce
aux pieds de ceux qu’elle avait vaincus (368). Artaxerxés n’eut d’attention que
pour l’homme qui avait fait trembler Lacédémone, et il le trouva, vertu rare
en Grèce, aussi incorruptible qu’il était brave. Tandis qu’un des députés d’Athènes
acceptait de l’or persique, Pélopidas rejetait tous les présents du
roi ; mais, pour sa patrie, il obtenait la reconnaissance de l’indépendance
de Messène, l’ordre donné à Athènes de désarmer sa flotte, et la menace d’être
aussitôt attaquée, faite à toute ville qui refuserait d’entrer dans l’alliance
de Thèbes et de la Perse.
Il était facile au roi d’envoyer des ordres, plus
difficile de les faire exécuter. Athènes condamna à mort le député qui avait
trahi ses intérêts ; et lorsque les alliés furent convoqués à Thèbes
pour jurer, devant un envoyé perse, d’observer les conditions imposées, tous
refusèrent ; les Arcadiens sortirent même à l’instant de la ville. Un d’eux,
au retour de l’ambassade, avait dit dédaigneusement : J’ai bien vu quantité de pâtissiers, de cuisiniers, d’échansons et d’huissiers,
mais je n’ai pas vu un homme. La magnificence du roi n’est qu’une parade :
son platane d’or tant vanté ne donnerait pas d’ombre à une cigale. Ces
paroles étaient de mauvais augure pour la Perse. Il y avait
longtemps que ses armées n’intimidaient plus les Grecs ; et voici que
toutes les pompes de la cour de Suse n’excitent que la raillerie de ces
esprits moqueurs. Le traité était donc non avenu. Ainsi,
dit Xénophon, s’évanouit le prétendu empire de
Thèbes.
Cette même année, elle éprouva un échec au nord. Pour
amener Alexandre de Phères à accepter le traité dicté par la Perse, elle lui avait
dépêché Pélopidas. Le tyran, le voyant mal accompagné, s’était saisi de lui
et l’avait jeté en prison. Dans le commencement,
dit Plutarque, il permit aux habitants de Phères de
l’aller voir, mais Pélopidas les exaltait par ses discours et lui envoyait
dire qu’il était insensé de mettre à mort tant de gens qui ne lui avaient
rien fait, et de l’épargner lui, qui, une fois échappé de ses mains, ne
manquerait pas de le punir. Le tyran lui demanda pourquoi il était si
pressé de mourir. Afin que, devenu plus ennemi des
dieux et des hommes, tu en périsses plus tôt. Dès lors personne ne put
approcher de Pélopidas. La femme d’Alexandre, Thébé, vint cependant voir en
secret le héros. Il lui fit honte de laisser vivre un pareil monstre, et dès
lors elle conçut le projet qu’elle exécuta plus tard[34].
Vers ce temps-là se placent deux mauvaises actions d’Athènes
: sa crainte de la puissance thébaine la jeta dans l’alliance du tyran; elle
lui éleva une statue; elle lui envoya trente galères et mille soldats, et,
jugeant que l’utile devait passer avant l’honnête, elle essaya de surprendre
Corinthe, ville alors son alliée, pour assurer ses communications avec l’Arcadie[35]. Elle échoua de
ce côté, mais elle réussit de l’autre. Une armée que Thèbes fit partir pour
délivrer Pélopidas fut battue, et elle eût péri si Épaminondas, qui y servait
comme simple soldat, ne l’eût sauvée. Le peuple lui ayant rendu son commandement,
il reparut en Thessalie et il inspira assez de crainte au tyran pour que
celui-ci délivrât son prisonnier en échange d’une trêve de trente jours (368).
L’année suivante, Thèbes chargea Épaminondas de conduire
une troisième expédition dans le Péloponnèse pour arrêter la joie que Sparte
ressentait de son récent succès, la victoire sans larmes, et aussi
pour contenir les Arcadiens, en prenant contre eux un point d’appui dans l’Achaïe
et l’Élide. Les Achéens, qu’il réussit à faire entrer dans l’alliance de
Thèbes, abandonnèrent à leurs nouveaux amis Naupacte, sur la côte
septentrionale du golfe de Corinthe, qui allait devenir ainsi une mer
béotienne ; et ils reçurent dans leurs villes des harmostes thébains.
Mais cette alliance s’était faite au détriment des familles aristocratiques
de l’Achaïe ; chassées de leurs demeures, dépouillées de leurs biens,
elles formèrent des bandes de bannis, comme il en rôdait autour de la plupart
des cités grecques, désolant les campagnes et tenant les citadins en
perpétuelle inquiétude. Les Arcadiens, voisins de l’Achaïe, eurent beaucoup à
souffrir de ces pillards, et le peu de reconnaissance qu’ils avaient gardé
pour Thèbes en fut encore affaibli. Ainsi, par la rivalité des factions dans
l’intérieur des villes et par celle des cités les unes contre les autres,
rien de grand ne pouvait se faire, rien de durable ne pouvait s’établir dans
ce malheureux pays, où de mesquines passions étouffaient tout sentiment
général.
L’influence de Thèbes, qui diminuait dans le Péloponnèse,
était perdue en Thessalie, par conséquent en Macédoine. Athènes, au contraire,
refaisait à petit bruit son empire. Timothée, après dix mois de siège, venait
de lui soumettre Samos, dépendance incertaine du grand roi (365), l’an d’après,
le satrape révolté de la
Phrygie lui avait cédé une partie de la Chersonèse, et dans
le même temps elle rattacha à son alliance les villes de la Chalcidique. Corinthe,
effrayée de cette grandeur renaissante et des intentions qu’Athènes avait
récemment montrées à son égard, voulut se retirer du conflit. Elle envoya demander
aux Spartiates s’ils pensaient que son concours pût leur assurer la paix;
dans le cas contraire, elle sollicitait la permission de traiter. Sparte
autorisa ce qu’elle ne pouvait empêcher : Épidaure, Phlionte, quelques autres
villes encore, imitèrent Corinthe.
Thèbes n’en était pas là. Elle se raidit contre les
difficultés pour garder le rang qu’elle avait pris et le porter encore plus
haut. Épaminondas, dont l’ambition patriotique avait grandi avec ses
victoires, lui montra l’empire maritime à saisir et les dépouilles d’Athènes
à transporter dans la
Cadmée. Ce conseil n’était ni d’un sage ni d’un citoyen
clairvoyant. Si Athènes avait des arsenaux rapidement remplis et une flotte
de guerre qui se reconstituait bien vite, elle le devait aux ressources
fournies par son grand commerce. Thèbes, au contraire, placée au milieu des
terres, sans industrie, sans autres objets d’échange que les produits de son
sol, et n’ayant jamais eu un vaisseau, ne pouvait s’assurer sur mer une
domination durable. Il était donc impolitique de la jeter dans une voie qui n’était
pas la sienne. Épaminondas lui persuada de construire cent trirèmes, chose
facile à faire et prompte à exécuter ; avec cette flotte, il parcourut
la mer Égée et l’Hellespont, sans notables succès, mais aussi sans revers et
en rapportant à sa patrie l’alliance, stérile pour elle, de Rhodes, de Chios
et de Byzance. Ce fut durant son absence que les Thébains égorgèrent tous les
habitants mâles d’Orchomène.
Une autre expédition, ordonnée quelques mois plus tôt,
importait davantage à l’honneur et à la fortune de Thèbes : elle avait envoyé
de nouveau, en Thessalie, Pélopidas avec une armée. Il rencontra Alexandre
prés de Pharsale, dans une plaine parsemée de hauteurs, qu’on appelait les
Têtes de Chiens (Cynocéphales),
l’attaqua avec furie, le vainquit ; mais fut tué en voulant joindre son
ennemi, qui se cachait au milieu de ses gardes (364). Les villes thessaliennes qui l’avaient
appelé lui firent des funérailles qui n’eurent jamais d’égales, si l’on admet
que le plus bel ornement n’est ni l’or ni l’ivoire, mais les larmes vraies,
les regrets profonds et sincères d’un peuple entier. Une armée de sept mille
hommes, dirigée contre Alexandre, le força de rendre la liberté aux villes qu’il
avait prises, et de jurer qu’il obéirait fidèlement à toutes les injonctions
des Thébains.
La
Thessalie replacée sous son influence, Thèbes songea à y
remettre le Péloponnèse.
Le désordre y était extrême. Les Éléens et les Arcadiens
se battaient, et les choses allaient mal pour les premiers, bien que les
Spartiates eussent tenté, en leur faveur, une diversion qui ne réussit pas.
Les Arcadiens s’emparèrent d’Olympie, où ceux de Pise, leurs alliés, firent
célébrer les jeux. Cette vue rendit le courage aux Éléens. Ils vinrent en
armes, au milieu de la solennité, attaquer les Arcadiens, que soutenaient
1000 hoplites d’Argos et 400 cavaliers d’Athènes[36]. L’action fut vive
et glorieuse pour les Éléens, quoiqu’on les eût jusque-là regardés comme les
plus mauvais soldats de la
Grèce. Mais Olympie resta aux Arcadiens avec les trésors de
son temple (364).
Depuis que la guerre se faisait avec des mercenaires et ne cessait plus, elle
était fort dispendieuse, de sorte que les gouvernements qui n’étaient pas
assez sages pour l’éviter se trouvaient réduits à des expédients dangereux.
Athènes avait pris l’argent de ses alliés et perdu ainsi leur dévouement;
Sparte avait établi sur les siens de lourds impôts et provoqué des révoltes.
Les archontes d’Arcadie, pour solder leurs éparites, s’emparèrent sans
scrupule de l’or sacré d’Olympie. Ce fut la ruine de la confédération
arcadienne. Les dévots réclamèrent contre cette impiété; la ville de
Mantinée, qui voyait Tégée recevoir une garnison béotienne et Mégalopolis
appuyer en toute circonstance la politique ambitieuse des Thébains, se mit à
la tête de cette opposition à la fois religieuse et patriotique, mais en même
temps offrit de payer sa part de l’argent nécessaire pour l’entretien des éparites.
Cités devant les Dix Mille, sous l’accusation de vouloir rompre la
confédération, les Mantinéens refusèrent de comparaître et, menacés d’une
attaque, fermèrent leurs portes. Les Dix Mille eux-mêmes interdirent l’emploi
à de profanes usages des deniers sacrés. Aussitôt les mercenaires se
dispersèrent, et les archontes, redoutant quelque accusation de sacrilège
suivie d’un arrêt de restitution, appelèrent les Thébains.
Cependant les patriotes arcadiens firent conclure la paix
avec l’Élide, à la condition que l’or enlevé d’Olympie serait restitué. Ils
célébraient cette paix à Tégée, quand, au milieu de la fête, l’harmoste
béotien, qui commandait dans la ville une troupe de trois cents hommes et qui
voyait dans cette paix la ruine de l’influence thébaine, s’empara de toute l’assemblée
et l’emprisonna, feignant de croire à un complot pour livrer la place aux
Lacédémoniens. L’indignation publique le força de relâcher ses captifs et de
fuir à Thèbes, où des députés vinrent réclamer une punition. Épaminondas le
justifia en reprochant aux Arcadiens d’avoir violé l’alliance lorsqu’ils
avaient signé la paix avec l’Élide sans l’assentiment des Thébains. L’honnête
homme disparaissait sous le citoyen qui se croyait tenu de, tout sacrifier à la
grandeur, même injuste, de sa patrie.
Quand on connut la réponse de Thèbes, une partie des
Arcadiens s’armèrent et demandèrent des secours à Sparte et à Athènes, qui
venait de signer un traité avec eux[37]. Pour arrêter
cette défection du Péloponnèse, Thèbes y envoya, en 362, Épaminondas, qui
vint camper dans Tégée pour cacher ses mouvements. Là, apprenant qu’Agésilas,
appelé par les Mantinéens, avait quitté Sparte avec toutes ses forces, il se
jeta, par une marche de nuit, dans la Laconie. Si un Crétois déserteur n’eût couru avertir Agésilas,
Sparte, absolument sans défense, était prise comme un nid d’oiseau. Le
vieux roi revint à temps et pourvut à tout ; Épaminondas fut, comme la
première fois, arrêté devant cette ville ouverte. Il avait cru la
surprendre ; il n’espéra pas la réduire par un siège, qui se
prolongerait de maison en maison et pour lequel il n’avait pas de
vivres ; d’ailleurs il ne fallait pas se laisser enfermer dans cette
vallée étroite, entre la ville et l’armée spartiate qui accourait. Il rentra
en Arcadie à marches forcées, précédé de ses cavaliers, qui essayèrent un
autre coup sur Mantinée ; mais la cavalerie d’Athènes venait d’arriver
dans cette place : elle sortit bravement au-devant d’un ennemi qu’elle était
cependant habituée à craindre, et le repoussa. Dans cette action périt Gryllos,
fils de Xénophon. Au moment où il apprit cette mort, le père sacrifiait au
temple d’Artémis ; en signe de deuil, il ôta la couronne dont l’officiant
devait couvrir la tête ; mais quand il sut que Gryllos était tombé en
brave, il la remit sans verser une larme, en disant : Je savais que mon fils était mortel. Si le récit est vrai, le
mot était trop spartiate[38].
Le temps fixé pour la fin de l’expédition approchait.
Épaminondas ne voulut point partir en laissant derrière lui l’éclat obscurci
des armes de Thèbes. Il vint chercher l’ennemi prés de Mantinée, dans une
plaine où se croisent les routes de l’Arcadie avec celles qui viennent de l’isthme,
de l’Argolide et de la
Laconie, et on tant de fois le sort du Péloponnèse a été
disputé. Des cinq batailles livrées en ce lieu[39], celle-ci fut la
plus célèbre, car jamais Grecs contre Grecs n’avaient
mis en ligne un si grand nombre d’hommes : 22.000 du côté des
Spartiates, 33.000 avec Épaminondas, si nous acceptons les chiffres de
Diodore.
 Il suivit la même tactique qu’à Leuctres : il surprit ses
adversaires, qui ne s’attendaient pas à une action, n’engagea que ses
meilleures troupes, et concentra sur un seul point une masse profonde qui renversa
tout devant elle. Il se tenait lui-même au premier rang ; car, dans ces
républiques jalouses, les chefs devaient faire office de soldat autant que de
capitaine et être les plus vaillants en même temps que les plus habiles.
Épaminondas se laissa emporter trop loin en avant des siens ; entouré d’ennemis,
il combattit longtemps, malgré plusieurs blessures, jusqu’à ce qu’il reçut
dans la poitrine un coup de lance si violent que le bois se rompit et que le
fer resta dans la plaie. Les Thébains arrachèrent avec peine son corps à l’ennemi,
et l’emportèrent dans le camp respirant encore. Les médecins déclarèrent qu’il
mourrait quand on retirerait le fer de la blessure. Alors il appela son
écuyer pour savoir si son bouclier était sauvé ; l’écuyer le lui montra.
Il demanda ensuite de quel côté la victoire était restée ; on lui dit qu’elle
était aux Béotiens. Eh bien, je puis mourir, et
il ordonna d’arracher le fer. Dans ce moment, les amis qui l’entouraient
firent entendre de grands gémissements ; un d’eux s’étant écrié : Eh quoi ! Épaminondas, faut-il que tu meures ainsi
sans laisser d’enfants de toi ? — Non
pas, reprit-il, non pas, par le grand Jupiter
! car je laisse après moi deux filles, les victoires de Leuctres et de
Mantinée (362). Il suivit la même tactique qu’à Leuctres : il surprit ses
adversaires, qui ne s’attendaient pas à une action, n’engagea que ses
meilleures troupes, et concentra sur un seul point une masse profonde qui renversa
tout devant elle. Il se tenait lui-même au premier rang ; car, dans ces
républiques jalouses, les chefs devaient faire office de soldat autant que de
capitaine et être les plus vaillants en même temps que les plus habiles.
Épaminondas se laissa emporter trop loin en avant des siens ; entouré d’ennemis,
il combattit longtemps, malgré plusieurs blessures, jusqu’à ce qu’il reçut
dans la poitrine un coup de lance si violent que le bois se rompit et que le
fer resta dans la plaie. Les Thébains arrachèrent avec peine son corps à l’ennemi,
et l’emportèrent dans le camp respirant encore. Les médecins déclarèrent qu’il
mourrait quand on retirerait le fer de la blessure. Alors il appela son
écuyer pour savoir si son bouclier était sauvé ; l’écuyer le lui montra.
Il demanda ensuite de quel côté la victoire était restée ; on lui dit qu’elle
était aux Béotiens. Eh bien, je puis mourir, et
il ordonna d’arracher le fer. Dans ce moment, les amis qui l’entouraient
firent entendre de grands gémissements ; un d’eux s’étant écrié : Eh quoi ! Épaminondas, faut-il que tu meures ainsi
sans laisser d’enfants de toi ? — Non
pas, reprit-il, non pas, par le grand Jupiter
! car je laisse après moi deux filles, les victoires de Leuctres et de
Mantinée (362).
Avant d’expirer, Épaminondas avait voulu voir Iolaïdas et
Diophantos, deux de ses lieutenants qu’il jugeait dignes de lui succéder. Ils sont morts, lui répondit-on. — En ce cas, faites la paix. Thèbes, en effet, avait
perdu tous ses chefs et n’avait point, à Mantinée, gagné une victoire
décisive. La cavalerie athénienne avait eu quelque avantage sur l’infanterie
légère des Thébains ; de part et d’autre l’aile gauche était restée maîtresse
du terrain ; de sorte que des deux côtés on réclama les morts, et que
deux trophées s’élevèrent sur le champ de bataille.
Ce combat, dit Xénophon, laissa autant de confusion en Grèce qu’il y en avait
auparavant. C’était le dernier coup donné à l’empire spartiate et ce n’était
pas la consolidation de l’empire thébain. Tous s’accordèrent à signer, l’année
suivante, une paix qui reconnaissait l’indépendance de Messène et l’assurait
aux autres États du Péloponnèse. Sparte protesta ; mais maintenant
seule, elle ne pouvait rien.
L’ouvrage de Xénophon s’arrête à la bataille de Mantinée.
Nous avons perdu Hérodote après Platée, Thucydide en 411, Xénophon nous
manque avec Épaminondas. Les grands hommes et les grands historiens sont
morts ; la Grèce
s’en va[40].
|
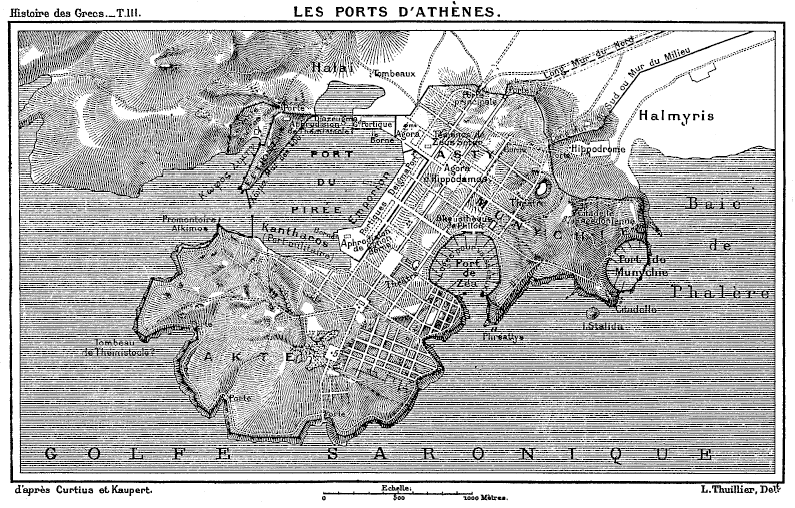
 Il suivit la même tactique qu’à Leuctres : il surprit ses
adversaires, qui ne s’attendaient pas à une action, n’engagea que ses
meilleures troupes, et concentra sur un seul point une masse profonde qui renversa
tout devant elle. Il se tenait lui-même au premier rang ; car, dans ces
républiques jalouses, les chefs devaient faire office de soldat autant que de
capitaine et être les plus vaillants en même temps que les plus habiles.
Épaminondas se laissa emporter trop loin en avant des siens ; entouré d’ennemis,
il combattit longtemps, malgré plusieurs blessures, jusqu’à ce qu’il reçut
dans la poitrine un coup de lance si violent que le bois se rompit et que le
fer resta dans la plaie. Les Thébains arrachèrent avec peine son corps à l’ennemi,
et l’emportèrent dans le camp respirant encore. Les médecins déclarèrent qu’il
mourrait quand on retirerait le fer de la blessure. Alors il appela son
écuyer pour savoir si son bouclier était sauvé ; l’écuyer le lui montra.
Il demanda ensuite de quel côté la victoire était restée ; on lui dit qu’elle
était aux Béotiens.
Il suivit la même tactique qu’à Leuctres : il surprit ses
adversaires, qui ne s’attendaient pas à une action, n’engagea que ses
meilleures troupes, et concentra sur un seul point une masse profonde qui renversa
tout devant elle. Il se tenait lui-même au premier rang ; car, dans ces
républiques jalouses, les chefs devaient faire office de soldat autant que de
capitaine et être les plus vaillants en même temps que les plus habiles.
Épaminondas se laissa emporter trop loin en avant des siens ; entouré d’ennemis,
il combattit longtemps, malgré plusieurs blessures, jusqu’à ce qu’il reçut
dans la poitrine un coup de lance si violent que le bois se rompit et que le
fer resta dans la plaie. Les Thébains arrachèrent avec peine son corps à l’ennemi,
et l’emportèrent dans le camp respirant encore. Les médecins déclarèrent qu’il
mourrait quand on retirerait le fer de la blessure. Alors il appela son
écuyer pour savoir si son bouclier était sauvé ; l’écuyer le lui montra.
Il demanda ensuite de quel côté la victoire était restée ; on lui dit qu’elle
était aux Béotiens. 