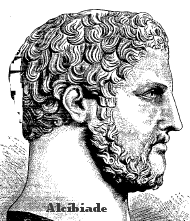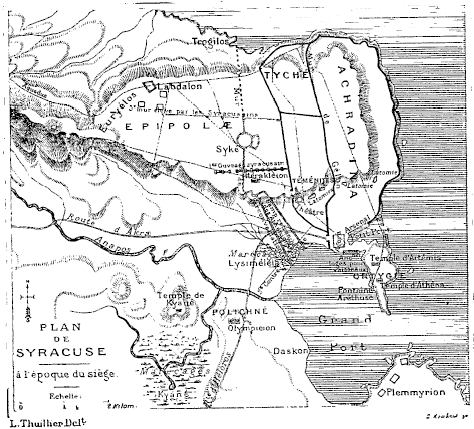|
I. Alcibiade : affaire d’Argos ; rupture de la paix (417) ; affaire
de Mélos
Parmi les prédictions qui couraient au commencement de la
guerre du Péloponnèse, une seule, remarque Thucydide, fut réputée, après la
paix de Nicias[1],
avoir reçu son accomplissement : c’était celle qui annonçait que la guerre
durerait trois fois neuf ans. Cette guerre eut en effet trois actes ; on a vu
le premier : le second est la trêve mal assise, qui va de 421 à 413, sans
qu’il y ait de guerre générale, bien que la guerre soit partout. Le dernier,
de 413 à 404, renferme la catastrophe et les péripéties qui l’amènent.
La première période est toute pleine de Périclès ; sa
politique lui a survécu et son esprit gouverne Athènes, malgré Cléon ; la
seconde et. la troisième sont toutes remplies d’Alcibiade, de ses passions,
de ses services et de ses crimes.
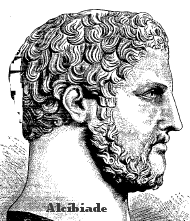
Alcibiade, qu’on faisait descendre d’Ajax, tenait par sa
mère aux Alcméonides. La mort de son père, Clinias, tué à Coronée, le laissa
sous la tutelle de ses parents, Périclès et Ariphron, qui lui remirent, quand
il atteignit sa majorité, une des grandes fortunes d’Athènes. A la noblesse du
sang et à la richesse, il joignait la beauté, qui, dans l’estime de ce peuple
artiste, ajoutait à l’éclat des talents et de la vertu, quand elle parait le
front de Sophocle ou de Périclès, et qui lui semblait toujours un don des
dieux, même sur les traits d’un athlète. Les parasites, les flatteurs, tous
ceux que la fortune, la grâce et l’audace attirent, se pressaient sur les pas
du riche et spirituel jeune homme, devenu, dans Athènes, ce qui était une
puissance, le roi de la mode. Habitué au milieu de ce cortège à se voir
applaudi pour ses folles actions, Alcibiade osa tout, et tout avec impunité,
il devint l’enfant gâté d’Athènes. La force de son tempérament et la
souplesse de son esprit le rendaient capable, suivant l’heure, le jour, le
lieu, de vice ou de vertu, d’abstinence ou d’orgie. Dans la cité de Lycurgue,
il n’y aura pas de Spartiate aussi rude pour son corps ; en Asie, il
dépassera les satrapes en luxe et en mollesse. Mais son audace, son
indomptable pétulance compromettaient, pour une plaisanterie ou une débauche,
les plans longuement médités de son ambition. Les passions vives et diverses
le portaient tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, toujours avec excès, sans qu’il
trouvât, dans cette orageuse mobilité de son caractère, le frein qui l’eût arrêté,
le sentiment du juste et du devoir. Aujourd’hui on le voyait chez Socrate,
recueillant avec avidité les nobles leçons du philosophe, pleurant
d’admiration et d’enthousiasme ; mais le lendemain il traversait l’agora, la
robe traînante, la démarche indolente, efféminée, et il allait, avec ses trop
faciles amis, se plonger en de honteux plaisirs. Pourtant le Sage le disputa,
quelque temps avec avantage, à la foule de ses corrupteurs. Dans les
premières guerres, ils partageaient la même tente. Socrate sauva Alcibiade à
Potidée, et Alcibiade protégea, à Délion, la retraite de Socrate.
Dès l’enfance, il montra cette nature de son esprit moitié
héroïque et moitié folle. Il jouait aux dés sur la voie publique lorsqu’un
chariot approcha ; il dit au charretier d’attendre ; celui-ci n’en tient
compte et, avance toujours ; Alcibiade se jette en travers du chemin et lui
crie : Passe maintenant si tu l’oses. Il
luttait avec un de ses camarades et n’étant pas le plus fort, il mord au bras
son adversaire. Tu mords comme une femme. — Non, mais comme un lion, répondit-il. Sur son
bouclier il avait fait graver un Amour lançant la foudre.
Il avait un chien superbe qui lui avait coûté plus de sept
mille drachmes. Quand toute la ville l’eut admiré, il lui coupa la queue, son
plus bel ornement, afin qu’on en parlât encore. Tant
que les Athéniens s’occuperont de mon chien, disait-il, ils ne diront rien de pis sur mon compte. Un jour
il passe sur la place publique ; l’assemblée était tumultueuse, il en demande
la cause ; on lui répond qu’il s’agit d’une distribution d’argent ; il
s’avance et en Jette lui-même, aux grands applaudissements de la foule ;
mais, suivant la mode des élégants du jour, il portait une caille privée sous
son manteau : l’oiseau effrayé s’échappe, et tout le peuple de courir après,
avec des cris, pour le rapporter à son maître. Alcibiade et le peuple
d’Athènes étaient faits pour s’entendre. Ils le
haïssent, disait Aristophane, le désirent et
ne peuvent se passer de lui.
Un jour il gagea de donner en pleine rue un soufflet à
Hipponicos, un des hommes les plus considérés de la ville ; il gagna son
pari, mais le lendemain se rendit chez l’homme qu’il avait si grossièrement
offensé, se dépouilla de ses vêtements et s’offrit à recevoir le châtiment
qu’il avait mérité. Il avait épousé Hipparète, femme d’une grande vertu, et
ne répondait à sa vive affection que par une conduite outrageante. Après une
longue patience, elle se décida à présenter à l’archonte la demande de
divorce. Alcibiade l’apprend, court chez le magistrat, et, sous les yeux de
la foule qui applaudie enlève dans ses bras, à travers la place publique, sa
femme, qui n’ose résister, et la ramène dans sa maison, où elle resta,
heureuse de cette chère violence.
Alcibiade traita Athènes comme Hipponicos et Hipparète, et
Athènes, comme Hipparète et Hipponicos, pardonna souvent à ce pêle-mêle de
défauts et de qualités aimables, où il y avait toujours ce que les Athéniens
mettaient au-dessus de tout, l’esprit et l’audace. Son audace, cri effet, se
jouait de la justice comme de la religion. On l’excuse d’avoir battu un maître
dans l’école duquel il n’avait pas trouvé l’Iliade ; mais aux
Dionysiaques, il frappa au milieu même du spectacle, sans souci de la solennité,
un de ses adversaires ; et une autre fois, pour mieux célébrer une fête, il
enleva la galère sacrée que réclamait à ce moment même un service public et
religieux. Un peintre refusait de travailler pour lui, il le retint
prisonnier jusqu’à ce qu’il eût achevé de décorer sa maison, mais il le
renvoya comblé de présents. Un poète était poursuivi en justice, il arracha
des archives publiques l’acte d’accusation[2].
Pour une république, c’étaient des actes bien peu
républicains. Mais il y avait dans la Grèce entière tant de faiblesse pour
Alcibiade ! A Olympie, il fit courir sept chars à la fois, effaçant
ainsi la magnificence des rois de Syracuse et de Cyrène, et il remporta deux
prix à la même course ; un autre de ses chars arriva le quatrième. Euripide
chanta sa victoire et des villes se cotisèrent pour la célébrer. Les
Éphésiens lui dressèrent une tente magnifique ; ceux de Chios nourrirent ses
chevaux et lui fournirent un grand nombre de victimes ; les Lesbiens lui
donnèrent le vin ; et toute l’assemblée d’Olympie vint s’asseoir aux tables
du festin où un simple particulier la conviait.
La postérité, moins indulgente que les contemporains, tout
en reconnaissant les qualités éminentes de l’homme, condamnera le mauvais
politique qui fit l’expédition de Sicile, le mauvais citoyen qui donna tarit
de fois le scandaleux exemple de violer les lois et qui osa s’armer contre sa
patrie, lever la main contre sa mère. Alcibiade restera le type du plus brillant,
niais du plus immoral et par conséquent du plus dangereux citoyen d’une
république.
Malgré sa naissance qui le classait parmi les Eupatrides,
Alcibiade, comme Périclès, passa du côté du peuple et se fit l’adversaire
d’un homme bien différent, le timide, le superstitieux Nicias, qui était
noble aussi, riche et éprouvé par de longs services. Mais Alcibiade avait sur
lui l’avantage de l’audace, de la séduction et de l’éloquence. Démosthène le
regarde comme le premier orateur de son temps ; non qu’il eût une grande
facilité de parole ; au contraire, les expressions ne lui venant pas assez
vite, il répétait fréquemment les derniers mots de ses phrases ; mais la
force, l’élégance de son discours et un certain grasseyement qui ne
déplaisait pas le rendaient irrésistible. Son premier acte politique fut une
mesure fâcheuse. Il provoqua une augmentation du tribut des alliés qui, de
600 talents fut porté à 1200 ; c’était une imprudence que Périclès n’eût pas
commise. Mais Alcibiade avait d’autres projets et. d’autres doctrines. Il
croyait ait droit de la force, et il en usait ; il entrevoyait de
gigantesques entreprises, et il préparait d’avance les ressources
nécessaires. Son inaction commençait à lui peser. Il avait trente et un ans
et n’avait encore rien fait ; aussi se remua-t-il beaucoup lus du traité de
421. Il eût voulu supplanter Nicias et se donner honneur de cette paix. Ses
flatteries aux prisonniers de Sphactérie ne réussirent pas ; les Spartiates
se fièrent davantage au vieux général, et Alcibiade leur en garda rancune.
Il ne manquait pas de gens qui ne voulaient pas de ce
traité, signé aux applaudissements des vieillards, des riches et des
laboureurs, mais où Athènes, par la faute de Nicias, s’était laissé
indignement jouer. Les marchands qui, durant la guerre, voyaient la mer
fermée à leurs rivaux et ouverte à leurs navires, les marins, les soldats,
tout le peuple du Pirée qui vivait de la solde ou du butin, formaient un
parti nombreux. Alcibiade s’en lit le chef. L’esprit de guerre, qui ne devait
disparaître qu’avec la Grèce
elle-même, lui donna bientôt, an dehors, des alliés.
Ce que Sparte et Athènes faisaient en grand, d’autres
villes le faisaient cri petit. Forts ou faibles, obscurs on illustres, tous
avaient la même ambition ; tous voulaient des sujets. Les Éléens avaient
soumis les Lépréates, Mantinée les bourgs de son voisinage ; Thèbes avait
abattu les murailles de Thespies pour tenir cette ville à sa discrétion ; et
Argos transporta dans ses murs, mais en leur accordant le droit de cité, les
habitants de plusieurs bourgades de l’Argie. Sparte voyait avec dépit ce
mouvement de concentration de villes inférieures autour de cités plus
puissantes. Elle proclama l’indépendance des Lépréates, encouragea
secrètement la défection des sujets de Mantinée et la haine d’Épidaure contre
Argos. Mais, depuis Sphactérie, elle avait perdu son prestige. À Corinthe, à
Mégare, dans la Béotie,
on disait tout haut qu’elle avait lâchement sacrifié les intérêts de ses
alliés ; on s’indignait surtout de son alliance avec Athènes. La ligue péloponnésienne
était dissoute de fait ; un peuple songea à la reconstituer à son profit.
Le repos et la prospérité d’Argos, au milieu du conflit
général, avaient accru ses ressources, et sa politique libérale envers les
bourgs du pays avait augmenté ses forces. Mais les nouveaux venus furent un
puissant renfort pour le parti démocratique dont l’influence poussa Argos
dans une direction politique opposée à celle des Spartiates. Cette ville
pouvait donc et voulait devenir le centre d’une ligue anti-lacédémonienne.
Mantinée, où dominait la démocratie, les Éléens offensés par Lacédémone,
Corinthe, qui par le traité de Nicias, perdait dans l’Acarnanie deux villes
importantes, étaient prêts à unir leurs rancunes et leurs forces. Les Argiens
saisirent habilement, l’occasion : douze députés furent envoyés dans toutes
les cités grecques qui voudraient former une confédération, d’où seraient
exclues les deux villes également menaçantes pour la commune liberté, Sparte
et Athènes. Riais on ne put s’entendre. Les oligarques de Mégare et de la Béotie se tinrent à
l’écart, et peu de temps après se rapprochèrent du peuple qui avait toujours
été l’adversaire de la démocratie. Tégée, soumise à un gouvernement
aristocratique, et une partie des Arcadiens restèrent fidèles aux Spartiates.
Enhardis par ce retour de fortune, ceux-ci envoyèrent à Lépréon les hilotes
de Brasidas, qui avaient été affranchis, et chassèrent les Mantinéens d’une
forteresse occupée par eux sur les frontières de la Laconie. Une ligue
des États du Nord était donc prématurée : rien encore ne pouvait se
faire en dehors de Sparte ou d’Athènes.
Bien des causes de mécontenteraient existaient entre ces
deux villes. Le sort avait décidé que Sparte ferait la première les
restitutions stipulées au traité de 421. Pour Athènes, la plus précieuse de
ces restitutions était celle d’Amphipolis et des villes de la Chalcidique. Sparte
retira ses garnisons, mais ne rendit pas les villes ; et cependant Nicias, joué
par les éphores, fit commettre au peuple la faute de ne pas garder les gages
qu’il avait entre les mains, jusqu’à ce que Lacédémone eût mis un terme à sa
déloyauté. Sparte avait traité pour tous ses alliés ; et les plus puissants
refusaient de faire honneur à sa parole. Les Béotiens rendaient Panactéon,
mais démantelé, gardaient les prisonniers athéniens, et ne stipulaient qu’une
trêve de dix jours[3].
Athènes, qui avait cru gagner la paix, avait encore la guerre, à dix jours de
date, avec les Béotiens, en permanence dans la Chalcidique. Elle
venait même, de ce côté, de donner un terrible exemple de sa colère. Toute la
population mâle de Scionné avait, été égorgée, en punition de sa défection
récente, en vertu d’un décret du peuple que les généraux avaient emporté avec
eux.
Dans tout cela il y avait pour Alcibiade de quoi tirer une
guerre. D’abord il empêcha les Athéniens d’évacuer Pylos. On en retira
seulement, sur les instances de Lacédémone, les hilotes et les Messéniens,
qui furent transportés à Céphallénie. Puis, averti par ses amis d’Argos que
Sparte cherchait à entraîner cette ville dans son alliance, il répondit
qu’Athènes elle-même était toute disposée à s’unir aux Argiens. La poésie
vint en aide à la politique : Euripide fit représenter en ce moment (420) sa tragédie
des Suppliantes qui montrait Thésée allant, à la prière des mères
argiennes, conquérir, les armes à la main, les corps des sept chefs tombés
sous les murs de Thèbes, pour leur rendre les hommages funèbres : pieuse
intervention qui devait imposer aux Argiens une dette de reconnaissance. Je
ne sais si les beaux vers du poète les touchèrent beaucoup, avais la haine de
Sparte les poussait vers la cité qui seule pouvait tenir tête à Lacédémone.
Sur la promesse d’Alcibiade, leurs députés arrivèrent à Athènes, suivis de
près par les envoyés de Sparte, qu’une telle ligue effrayait. Les
Lacédémoniens étaient chargés de pleins pouvoirs pour terminer tous les différends.
Déjà ils avaient fait agréer du sénat leurs propositions, lorsque Alcibiade,
qui craignait de les voir obtenir le même succès auprès du peuple, arrêta
tout par une fourberie impudente. Il alla trouver en secret les ambassadeurs
et leur promit avec serment de les appuyer, mais en leur conseillant de se
taire sur leurs pleins pouvoirs, seul moyen, disait-il, de ne pas éveiller la
susceptibilité du peuple et d’arriver à leur but. Lorsqu’ils paraissent
devant l’assemblée, Alcibiade leur demande l’objet de leur ambassade : ils
répondent qu’ils viennent proposer la paix, pourtant qu’ils ne sont pas
autorisés à conclure. Eh quoi ! réplique
aussitôt Alcibiade, n’avez-vous pas dit hier dans le
sénat que vous aviez de pleins pouvoirs ? Quelle confiance pouvons-nous
ajouter à vos paroles ? Athéniens, vous voyez que les Spartiates veulent
se jouer de nous. Les ambassadeurs demeurent confus ; le peuple
s’emporte et demande la guerre. Le lendemain cependant Nicias parvint, à
force de discours et de démarches, à calmer les passions et à se faire
envoyer à Sparte. Mais tous ces incidents avaient envenimé les choses.
Nicias, quoique reçu avec respect, n’obtint rien, et Athènes conclut aussitôt
avec les Argiens, les Mantinéens, les Éléens, une alliance offensive et défensive[4]. Dans
I’emportement de la haine contre Sparte, on fit stipuler que l’alliance
durerait cent ans : terme bien long pour de pareils esprits (420).
J’y remarque toutefois une clause nouvelle et importante,
c’est que l’alliance était conclue sur un pied parfait d’égalité. Le commandement
des troupes alliées devait appartenir au peuple .qui demanderait le secours
et sur le territoire duquel se ferait la guerre[5].
La neutralité de l’Argolide et du centre du Péloponnèse
avait jusque-là préservé Lacédémone d’une invasion continentale. La guerre,
après avoir longtemps tourné autour de la péninsule, n’avait osé se prendre,
dans les dernières années, qu’à certains points des côtes de l’ouest, du sud
et de l’est, tous bien loin de Sparte, à Pylos, à Cythère, à Méthana. Mais voici que les Argiens, les Mantinéens
et les Éléens allaient l’introduire au cœur du Péloponnèse, l’amener en face
même des hilotes. Sparte redevint la cité patiente et réfléchie d’autrefois,
au point même de dévorer de sanglants affronts. A propos de l’envoi des
hilotes à Lépréon durant la trêve sacrée, les Éléens avaient condamné les
Lacédémoniens à une amende de 2000 mines et, sur leur refus de la payer, ils
les avaient exclus par décret des jeux olympiques. Un Spartiate de
distinction, Lichas, fit cependant courir un char et gagna un prix d la même
course où Alcibiade avait déployé tant de magnificence et obtenu des couronnes.
Quand les juges surent son nom, ils le firent ignominieusement chasser à
coups de bâton. Sparte ne vengea pas cet outrage ; elle avait cessé de croire
à elle-même. Une autre insulte lui vint quelque temps après de ses propres
alliés, et, comme celle-ci, fut soufferte en silence. Elle avait, dans la
troisième année de la guerre, colonisé Héraclée, à l’entrée des Thermopyles.
Les Thessaliens attaquèrent cette place et l’auraient prise si les Béotiens
n’étaient accourus et, sous prétexte de la sauver de leurs mains, lie s’y
étaient établis eux-mêmes, après en avoir chassé le gouvernement
lacédémonien.
Enfin Alcibiade passa avec quelques troupes dans le
Péloponnèse. Athènes avait eu de tout temps des amis dans l’Achaïe ; il alla
y réveiller cette vieille affection, et pour qu’elle fût plus libre de se
montrer, il essaya d’élever un fort au Rhion d’Achaïe, le point le plus étroit
du golfe de Corinthe, et en face de Naupacte, que les Athéniens tenaient
déjà, ce qui eût mis à leur discrétion toute la navigation du golfe. Sicyone
et Corinthe s’y opposèrent ; mais elles lie purent l’empêcher de construire à
Patras de longues murailles semblables à celles du Pirée, pour unir cette
ville à la mer, et par conséquent avec Athènes. Les
Athéniens, disait-on aux gens de Patras, vous
avaleront un beau jour. — Cela pourra bien
être, répondit Alcibiade ; mais ce ne sera
que peu à peu, et en commençant par les pieds, au lieu que les Lacédémoniens
vous avaleront d’un seul coup, et ils commenceront par la tête. À
Argos, il persuada au peuple d’enlever aux Épidauriens un port sur le golfe
Saronique ; de là les Argiens pourraient plus aisément recevoir des secours
d’Athènes qui possédait Égine, en face d’Épidaure. Mais les Lacédémoniens
envoyèrent par mer dans cette ville trois cents hoplites qui repoussèrent
toutes les attaques. À cette nouvelle les Athéniens écrivirent au bas de la
colonne où le traité était gravé, que Sparte avait violé, la paix, et la guerre
commença (419).
En vain, Aristophane fit représenter à cette époque si
pièce intitulée la Paix,
en reprenant la thèse qu’il avait soutenue sept ans auparavant dans les Acharniens.
Il eut beau personnifier la guerre en un géant qui écrase les villes dans un
mortier dont les généraux sont les pilons et montrer qu’avec le retour de la Paix, enfin tirée de la
caverne où elle est captive depuis treize ans, les banquets et les fêtes
recommenceront, que la ville entière sera dans la joie, les armuriers seuls
dans le désespoir, il ne persuada personne, pas même les juges du concours qui
lui refusèrent le premier prix.
Les Lacédémoniens, commandés par Agis, entrèrent dans l’Argolide
avec les contingents de la
Béotie, de Mégare, de Corinthe, de Phlionte, de Pellène et
de Tégée. Le général argien, coupé de la ville par une manœuvre habile,
proposa une trêve, qu’Agis accepta. Ce n’était pas ce que voulaient les
Athéniens, survenus peu de temps après, au nombre de mille hoplites et de
trois cents cavaliers ; Alcibiade parla devant le peuple d’Argos et
l’entraîna : on rompit la trêve, on marcha sur Orchomène et on la prit. Le
tort de cette rupture retomba sur Agis. Les Spartiates, irrités de ce qu’il
avait donné aux ennemis le temps de faire cette conquête, voulurent d’abord
raser sa maison et le condamner à une amende de cent mille drachmes : ses
prières obtinrent son pardon ; mais il fit décidé que désormais les rois
seraient assistés à la guerre d’un conseil de dix Spartiates.
Agis, pour réparer sa faute, alla chercher les alliés ; il
les rencontra près de Mantinée. Les deux armées,
dit Thucydide[6],
s’avancèrent l’une contre l’autre ; les Argiens avec
impétuosité, les Lacédémoniens lentement et, suivant leur coutume, ait soit
d’un grand nombre de flûtes qui marquaient la mesure et faisaient garder
l’alignement. La gauche des Lacédémoniens fut enfoncée, mais la
droite, commandée par le roi, rétablit le combat et remporta la victoire (418). Cette
bataille, qui coûta onze cents hommes aux alliés et environ trois cents aux
Spartiates, est regardée par Thucydide comme la plus importante que les Grecs
eussent livrée depuis longtemps. Elle rétablit, dans le Péloponnèse, la
réputation de Sparte, et, dans Argos, la prépondérance des riches, qui
supprimèrent la commune populaire, tuèrent ses chefs et firent alliance avec
Lacédémone.
Ce traité rompait la confédération récemment conclue avec
Athènes, Élis et Mantinée. Cette dernière ville se crut même assez en danger
par la défection d’Argos, pour consentir à redescendre au rang d’alliée des
Spartiates. Un traité dicté par ceux-ci décréta que tous les États, grands ou
petits, seraient libres et garderaient, avec leur indépendance, leurs lois
nationales. Sparte ne voulait que la division et la faiblesse autour d’elle.
A la politique de concentration provoquée par Athènes, elle opposait la
politique d’isolement, qui devait mettre la Grèce à ses pieds, mais qui plus tard aussi la
mettra, avec Sparte elle-même, aux pieds de la Macédoine et des
Romains (417).
La victoire d’Agis était celle de l’oligarchie. À Sicyone,
dans l’Achaïe, elle se releva ou s’affermit. On vient de voir que, dans
Argos, elle reprit le pouvoir. Mais, dans cette ville, s’il faut en croire
Pausanias, un crime analogue à ceux qui fondèrent à Rome les libertés du
peuple amena, au bout de huit mois, la chute des tyrans. Chassés par une
insurrection, les grands se retirèrent à Sparte tandis que le peuple appelait
les Athéniens et travaillait, hommes, femmes et enfants, à relier par de
longs murs Argos à la mer. Alcibiade accourut avec des maçons et des
charpentiers pour aider à l’ouvrage ; mais les Lacédémoniens, guidés par les
bannis, dispersèrent les travailleurs. Argos, affaiblie par ces cruelles
discordes, ne se releva pas ; et avec elle tomba cette idée d’une ligue des
États secondaires, qui exit peut-être épargné à la Grèce bien des malheurs en
imposant la paix et une certaine réserve aux deux grands États (417).
Si Athènes ne pouvait absolument vivre en paix, il y avait
une expédition que, depuis cinq ans, elle aurait dû faire et qu’elle ne
faisait pas. C’était de rentrer en possession d’Amphipolis, cette colonie de
Périclès qu’il importait tant de garder pour la prospérité de son commerce et
de sa marine. Mais ses conseillers habituels, Nicias et Alcibiade, étaient
bien plus occupés de leur rivalité que des grands intérêts de la patrie. Le
premier craignait toujours, et repoussait toute guerre, même nécessaire ; le
second méditait sans cesse des projets, mais les voulait nouveaux, pour ne rencontrer
sur son chemin aucune trace glorieuse laissée par quelque prédécesseur. Ce
fut lui qui poussa le plus à une expédition qui allait se terminer encore par
une sanglante tragédie.
Les Athéniens, qui agissaient mollement dans la Chalcidique, y
avaient récemment perdu deux villes et avaient vu le roi de Macédoine se
détacher de leur alliance ; ils résolurent de se venger de tous leurs
embarras sur l’île dorienne de Mélos, qui insultait à leur empire maritime
par son indépendance. A Naxos, à Samos, ils s’étaient montrés cléments, parce
qu’ils étaient chez des Ioniens où ils pouvaient compter sur un parti
démocratique ; à Mélos, poste avancé des Doriens dans la mer de Crète, ils
frirent implacables, parce que le coup frappé sur ces insulaires, fidèles à
leur métropole, devait retentir douloureusement à Lacédémone. Une escadre de
trente-huit galères somma la ville de se soumettre, et, sur son refus, une
armée l’assiégea, la prit. et en extermina toute la population mâle adulte. Les
femmes et les enfants furent vendus[7] (416). Avant
l’attaque, une conférence avait eu lieu avec les Méliens. Pour donner le meilleur tour qu’il est possible à notre
négociation, dirent les Athéniens, partons
d’un principe dont nous soyons vraiment convaincus les uns et les autres,
d’un principe que nous connaissons bien, pour l’employer avec des gens qui le
connaissent aussi bien que nous : c’est que les affaires se règlent entre les
hommes par les lois de la justice, quand une égale nécessité les oblige à s’y
soumettre ; mais que ceux qui l’emportent en puissance font tout ce qui est
en leur pouvoir, et que c’est aux faibles à céder. Et plus loin : Nous ne craignons pas non plus que la protection divine
nous abandonne. Dans nos principes et dans nos actions, nous ne nous écartons
ni de l’idée que les hommes ont conçue de la Divinité, ni de la
conduite qu’ils tiennent entre eus. Nous croyons, d’après l’opinion reçue,
que les dieux, et nous savons bien clairement que les hommes, par nécessité
de nature, dominent partout où ils ont la force. Ce n’est pas une loi que
nous ayons faite ; ce n’est pas nous qui, les premiers, l’avons
appliquée : nous en profitons et nous la transmettrons aux temps à venir
; vous-mêmes, avec la puissance dont nous jouissons, vous tiendriez la même
conduite.
La théorie de la force a été rarement exprimée d’une
manière aussi nette[8]. La réputation
des Athéniens en a souffert, sans qu’ils aient tiré le moindre profit de
cette mauvaise action. Remarquons cependant, tout en ayant horreur de l’acte
sanguinaire accompli à Mélos, que la pratique, sinon la théorie de ce droit du
plus fort, est bien ancienne ; c’est le principe sur lequel repose toute
l’antiquité, il n’est pas autre chose que la loi fameuse, salus populi suprema lex, tant de fois invoquée
pour justifier d’odieuses entreprises ou d’iniques cruautés ; et il faut
reconnaître avec tristesse que, à peu prés partout et dans tous les temps, on
a pensé, comme Euripide, que la sagesse et la gloire
étaient de tenir sa main victorieuse sur la tête de ses ennemis[9]. Ce qui est vieux
comme le monde, c’est la force ; ce qui se dégage lentement, c’est le droit :
faut-il croire que son règne ne viendra pas ?
Les colons doriens de Mélos avaient compté sur l’appui de
Sparte. Elle vous abandonnera, avaient
répondu les Athéniens ; et la prudente cité, qui, elle aussi, en toute chose,
ne voyait que l’utile, ne leur avait envoyé ni un navire ni un soldat. Cette
inertie enfla les espérances d’Athènes ; elle crut le moment venu de
rattacher à son empire la grande île de l’Occident, où les divisions
intérieures faisaient désirer à plusieurs cités une protection étrangère.

II. La Sicile
depuis Gélon, les Athéniens appelés par Ségeste, mutilation des Hermès,
départ de la flotte (416)
Gélon, le glorieux vainqueur des Carthaginois à Himère,
était mort peu de temps après leur défaite (476). Syracuse, qu’il avait sauvée et
agrandie, lui rendit les honneurs divins accordés aux héros, et laissa son
frère Hiéron succéder à son pouvoir. Ce fut l’époque de la plus grande
puissance de Syracuse. Sur un message d’Hiéron, Anaxilaos, tyran de Zancle et
de Rhégion, laissa les Locriens en paix ; Cumes, la Campanienne, que les
Carthaginois et les Étrusques attaquaient, fut sauvée par sa flotte, et
Pindare chanta cette victoire : un casque de bronze, offrande d’Hiéron,
trouvé à Olympie dans le lit de l’Alphée, en a conservé jusqu’à nous le
témoignage. Une colonie syracusaine, établie dans l’île d’Ischia, interdit à
la marine étrusque de dépasser le cap Misène, et, en Sicile, une grande
victoire gagnée sur les Agrigentins obligea les Grecs de l’île à reconnaître
la suprématie de Syracuse. Durant le combat, Hiéron malade s’était fait
porter en litière au milieu de ses soldats.
La Sicile
avait produit un poète de grand renom, Stésichore d’Himère, dont il nous
reste quelques rares fragments, qui apprennent fort peu de chose sur son
génie ; et l’on pourrait prendre pour un Sicilien, Ibycos de Rhégion, qui
avait adouci, à la cour de Polycrate de Samos, en des chants d’amour, le rude
esprit de la race dorienne. Comme les Pisistrates, Hiéron, cruel mais magnifique,
aimait la poésie et croyait à sa puissance. Il attira dans Syracuse, alors la
plus brillante des cités grecques de l’Occident, Pindare, Simonide de Céos,
son neveu Bacchylide, le grand Eschyle et Épicharme, l’audacieux adversaire
des dieux de la foule. Cette cour brillante était comme un prélude à l’Athènes
de Périclès. Thrasybule, frère d’Hiéron, lui succéda (467) ; mais sa tyrannie amena une
révolution : les Grecs de l’île aidèrent les Syracusains à chasser le tyran
pour se débarrasser des leurs (466). La royauté fut partout abolie, et le gouvernement
démocratique prit sa place. La réaction contre la dynastie de Gélon ne
s’arrêta pas à la conquête des libertés populaires ; les anciens habitants
déclarèrent ceux qui tenaient des tyrans le droit de cité incapables
d’aspirer aux charges. Ce fut le commencement de nouveaux troubles et de
nouveaux combats, qui se répétèrent dans toutes les villes. Le désordre
devint tel clans l’île entière, qu’une diète générale fut assemblée. On y
convint que ceux qui avaient été exilés par les dynasties déchues
rentreraient dans leurs biens, et que l’on céderait aux anciens mercenaires
et aux amis des tyrans la ville déserte de Camarine avec soit territoire.
Syracuse ne gagna point, par cette décision, la paix
intérieure ; des prétendants s’élevèrent, qu’il fallut abattre ; et
l’ostracisme, introduit sous le nom de pétalisme, peut-être sans les sages
garanties que Clisthénès lui avait données à Athènes, ne rendit pas le repos
à la cité. Peu à peu, cependant, les agitations se calmèrent, le gouvernement
républicain s’affermit et la puissance de Syracuse reprit son essor. Ses
flottes purgèrent la mer Tyrrhénienne des pirates étrusques : l’île
d’Elbe fut conquise, la Corse
attaquée (453).
Au centre de l’île, dont tout le littoral avait été
hellénisé, subsistait, dispersé en petits villages, le peuple qui était le
vrai propriétaire de cette contrée, puisqu’il lui avait donné ses plus
anciens habitants et son nom. Les Sicules défendaient encore leurs coutumes
et leur langue contre l’influence étrangère. Dans trois siècles ils les
auront perdues, et Cicéron ne trouvera que des murets dans l’île aux trois
promontoires. En 452, un de leurs chefs. Ducétios, entreprit de sauver ce
peuple et cette indépendance qui se mouraient. Il persuada aux Sicules de
former une confédération et de bâtir une cité défendue, comme celles des
Grecs, par de fortes murailles. Le plan fut exécuté, et Ducétios se trouva à
la tête de forces assez considérables pour oser attaquer Agrigente, qui
demanda et obtint le secours de Syracuse. Vainqueur d’abord des deux
puissantes cités, il fut vaincu dans un second combat ; et, désespérant
d’échapper à l’ardente poursuite des Grecs, il se dirigea de nuit sur Syracuse,
entra seul dans la place, sans être reconnu et vint s’asseoir sui’ l’autel de
l’agora (451).
Le peuple, redoutant
Némésis s’il violait les lois de l’hospitalité, cria tout d’une
voix qu’il fallait épargner le suppliant ; on le relégua à Corinthe. Il
s’échappa quelque temps après et reparut dans file, mais sans y rien
entreprendre de considérable. Syracuse mit à profit sa victoire pour faire de
nouveaux progrès dans l’intérieur de la Sicile. Une guerre heureuse
avec Agrigente augmenta la secrète espérance qu’elle nourrissait de réduire
file entière sous son pouvoir. Elle doubla sa cavalerie, construisit cent
trirèmes et donna un nouvel essor à son commerce. Ses marchands payaient
leurs acquisitions avec des pièces d’argent ou d’or qui étaient des œuvres
d’art : les monnaies de Syracuse sont les plus belles que l’art grec
nous ait laissées.
Agrigente, sa rivale, qui approvisionnait Carthage et la
côte d’Afrique de vins et d’huiles, gagnait tant à ce commerce, que ses
monuments effaçaient en magnificence ceux de Syracuse ; son temple de Zeus
était double du Parthénon d’Athènes, sans être plus grand. Les autres Grecs
siciliens participaient à cette prospérité en proportion de leur puissance.
Mais, pour tous, les jours de malheur allaient venir.
Quand la guerre du Péloponnèse commença, Sparte demanda
avec instance du secours aux cités doriennes de la Sicile et de l’Italie ;
elles en promirent ; puis trouvèrent plus utile de profiter de l’impuissance
à laquelle elles croyaient. Athènes réduite polir attaquer les cités
ioniennes de l’île : Naxos, Catane et Léontion. La dernière, vivement
pressée en 427, envoya Gorgias solliciter l’appui d’Athènes. Périclès se fût
opposé à une expédition aussi lointaine ; mais, à cette époque, il était mort
: vingt galères partirent pour la Sicile. D’autres les suivirent, sans jamais
donner de grandes proportions à cette guerre, qui s’éteignit, en 424, quand
un sage citoyen de Syracuse, Hermocrate, eut montré, à tous les Grecs de
Sicile réunis en congrès, qu’Athènes envenimait à dessein leurs querelles,
pour en profiter le jour où un traité avec Sparte lui rendrait la libre
disposition de ses forces.
Malheureusement ces sages avis furent vite oubliés. Des
troubles à Léontion amenèrent la ruine de cette ville ; une partie de sa
population émigra à Syracuse ; et, dès l’an 422, Athènes avait reformé une
ligue contre la grande cité dorienne. Pourtant, jusqu’en 415, elle ne trouva
pas jour à une expédition sérieuse ; mais, dans une querelle qui s’éleva
entre Ségeste et Sélinonte, la dernière obtint l’aide de Syracuse. L’autre,
après avoir vainement demandé le secours de Carthage, implora celui
d’Athènes, où les bannis siciliens affluaient.
Alcibiade avait été un des plus ardents à animer le peuple
contre Mélos ; il ne manqua pas cette occasion de le pousser à une entreprise
bien autrement considérable et où il espérait un commandement. Il eut
pourtant quelque peine à décider l’assemblée. On envoya d’abord des
commissaires pour étudier les ressources de Ségeste ; mais ils se laissèrent
tromper par des ruses grossières ; ils virent de l’or là où il n’y avait que
misère et les 60 talents qu’ils rapportèrent comme solde du premier mois pour
les équipages de soixante galères, firent accepter le tableau qu’ils
tracèrent des richesses de la cité. Tous les esprits, à Athènes, se
gonflèrent d’ambitieuses espérances. Partout on trouvait, dit Plutarque, des
jeunes gens dans les gymnases, des vieillards dans les ateliers et dans les
lieux de réunion, traçant le plan de la Sicile, et dissertant sur la mer qui
l’environne, sur la bonté de ses ports, sur sa position en face de l’Afrique.
Elle leur servirait de place d’armes, pour aller de là soumettre Carthage et
dominer jusqu’aux colonnes d’Hercule. Les riches n’approuvaient pas ces
témérités, mais craignaient, en s’y opposant, qu’on ne les soupçonnât de
vouloir éviter le service et les frais de l’armement des galères. Nicias fut
plus hardi ; même après que les Athéniens l’eurent nommé général, avec
Alcibiade et Lamachos, il prit la parole, montra l’imprudence d’aller
chercher de nouveaux sujets quand les anciens étaient en pleine révolte,
comme dans la
Chalcidique, ou n’attendaient qu’un désastre pour rompre la
chaîne qui les liait à Athènes. Il finit par reprocher à Alcibiade de jeter
la république, pour satisfaire sa seule ambition, dans une guerre d’outre-mer
qui l’exposerait aux plus grands dangers. Il énumérait les forces nécessaires
du moins cent galères, cinq mille hoplites, des vaisseaux de charge,
d’immenses approvisionnements, etc. Il croyait effrayer le peuple. Un des
démagogues se leva et dit qu’il allait faire cesser toutes les hésitations de
Nicias : en même temps il proposa et fit passer un décret qui donnait aux
généraux plein pouvoir d’user des ressources de la ville pour les préparatifs
de l’expédition (24
mars 415).
Nicias avait pleinement raison. L’expédition de Sicile
était impolitique, insensée. C’est dans la mer Égée qu’était et que devait
rester l’empire d’Athènes, à sa portée, sous sa main. Toute acquisition par delà
le Péloponnèse était un affaiblissement. Syracuse, même conquise, ne fût pas
demeurée longtemps sujette. De quelque façon que l’expédition tournât, des
malheurs étaient au bout. D’ailleurs, dans la mer Égée, n’y avait-il pas
Amphipolis à reprendre, la
Chalcidique insurgée à soumettre, la Macédoine hostile à
retenir dans la faiblesse ? Mais le peuple, cette fois, était, comme
Alcibiade, ivre de sa force et de sa fortune. Eupolis eut beau, dans sa
comédie des Dèmes, faire descendre le brave Myronidès aux enfers pour
en ramener les sages du bon vieux temps, Solon, Miltiade, Aristide et
Périclès, le peuple ne reconnaissait plus ses anciens héros, et l’on dit
qu’il laissa Alcibiade mettre à mort le poète qui l’avait livré aux risées de
la foule.
Comme toujours, à rapproche des événements considérables,
les présages et les prédictions des devins se multiplièrent pour ou contre
l’entreprise, au gré des partis. Les oracles avaient perdu de leur autorité
sur les esprits supérieurs ; celui de Delphes ne décidait plus de la paix et
de la guerre, comme il l’avait fait tant de fois, et Périclès, Thucydide
n’invoquaient dans les affaires d’État que la seule raison ; mais beaucoup
gardaient les vieilles superstitions et écoutaient les bruits qui arrivaient
des grands sanctuaires. Dodone était favorable ; Délos, contraire ; Alcibiade
avait fait venir un oracle du temple d’Ammon, dont le prestige, accru par
l’éloignement, frappait beaucoup le peuple. Mais l’astronome Méton n’augurait
rien de bon de l’expédition, et le démon familier de Socrate lui en avait
annoncé la désastreuse issue. Un événement, qui eut lieu peu de temps avant
le départ de la flotte, dans la nuit du 8 au 9 juin, jeta la terreur dans la
ville : un matin les hermès, ou bustes de Mercure, dressés le long des rues,
aux vestibules des maisons particulières ou devant les temples, se trouvèrent
mutilés. C’était lune insulte aux dieux. Le conseil des Cinq Cents se réunit
aussitôt[10]
; on chercha les sacrilèges, on promit une récompense de 10.000 drachmes à
qui les dénoncerait ; car la ville semblait aux dévots menacée de grands
malheurs, à moins qu’on ne parvînt à apaiser la colère du ciel par une
expiation suffisante. Si Alcibiade avait de nombreux partisans, il avait
aussi d’ardents ennemis. Naguère un homme méprisable, Hyperbolos, avait
failli le faire exiler : et il n’avait échappé qu’en réunissant sa
faction à celle de. Nicias pour faire retomber l’ostracisme sur la tête du
démagogue. L’affaire des hermès parut à ses adversaires une occasion
favorable de recommencer la tentative d’Hyperbolos, et, l’on est autorisé a
croire à une machination politique en voyant ce meule peuple applaudir,
quelques mois après, l’audace impie d’Aristophane dans sa comédie des Oiseaux.
Une enquête fut commencée ; des métèques et des esclaves, sans rien déposer
sur les hermès, rappelèrent que des statues avaient été précédemment brisées
par des jeunes gens, après une soirée de débauche et d’ivresse : c’était
Alcibiade que chargeaient ces révélations indirectes. D’autres l’accusaient formellement
d’avoir, dans un festin, parodié les mystères d’Éleusis ; et on profitait des
craintes superstitieuses du peuple pour éveiller ses craintes politiques. On
répétait que les briseurs des saintes images, les profanateurs des mystères,
respecteraient moins encore le gouvernement que les dieux, et, tout bas, l’on
disait qu’aucun de ces méfaits n’avait été commis sans la participation
d’Alcibiade : en preuve, on citait la licence tout aristocratique de ses
moeurs.
Était-il véritablement l’auteur de cette équipée
sacrilège ? L’en croire capable ne serait pas le calomnier. Ou bien
était-ce un coup monté contre lui ? Quoique les preuves matérielles
manquent, il est évident que parmi les riches, sur qui retombait le lourd
fardeau des dépenses maritimes, il existait un complot dont le but était de
ruiner la puissance d’Alcibiade et peut-être d’empêcher le départ de la
flotte[11]. Les démagogues,
qui avaient enivré le peuple d’espérance, étaient pour l’expédition, mais la
popularité d’Alcibiade Ies gênait ; il y eut, entre les deux factions
contraires, un compromis, comme il s’en fait dans les temps où la moralité
publique chancelle, et Alcibiade se trouva menacé de tous côtés. Malgré sa
légèreté et son dédain pour le peuple et les lois, il sentit qu’il ne devait
pas laisser derrière lui de telles accusations et il demanda à être jugé
avant son départ. Ses ennemis craignirent que le peuple ne reconnût trop
aisément son innocence, dans l’intérêt même de l’entreprise : car
c’était par son influence qu’un corps d’Argiens et de Mantinéens accompagnait
l’armée. Ils firent décider que, pour ne pas suspendre l’expédition,
Alcibiade s’embarquerait immédiatement, et que, s’il en était besoin, la
question pourrait être mûrement examinée à son retour.
On était déjà au milieu de l’été. Le jour prescrit pour le
départ, toute la ville, citoyens et étrangers, descendit au Pirée dés
l’aurore. Chacun conduisait ses amis, ses parents, ses fils. Ils marchaient
remplis d’espérance, le cœur attristé pourtant ; car, tout en songeant à ce
qu’ils allaient acquérir, ils pensaient aussi à ceux que peut-être ils ne
reverraient plus. À cette heure, on sentait mieux ce que l’entreprise avait
de redoutable, et les dangers, et la distance ; mais les regards étaient en
même temps frappés de la force des apprêts et l’orgueil, la confiance,
séchaient les larmes.
La flotte se composait de cent galères dont soixante à
marche rapide, de trente navires pour le transport des vivres et des
ouvriers, de cent autres nolises par la république et d’un grand nombre de bâtiments
qui suivaient volontairement. Les alliés la rejoindront, à Corcyre, avec
trente-quatre trières et deus pentecontores rhodiennes. Alors l’armée s’élèvera
à cinq mille cent hoplites dont quinze cents Athéniens, quatre cent
quatre-vingts archers, sept cents frondeurs rhodiens, cent vingt bannis de
Mégare armés à la légère ; ajoutez quinze ou vingt mille rameurs, peut-être
davantage[12].
Jamais Athènes, ni aucune ville de la Grèce, n’avait préparé un pareil armement.
Quand les troupes furent montées sur les galères et qu’on
crut chargé les bâtiments de tout ce qu’il fallait emporter, la trompette
donna le signal du silence. Les prières accoutumées avant le départ ne se
firent pas en particulier sur chaque navire, avais sur la flotte entière, à
la voix d’un héraut ; la foule répandue sur le rivage y joignait les siennes.
On versa le vin dans les cratères ; chefs et soldats firent des libations
dans des coupes d’or ou d’argent ; puis l’armée tout entière entonna le pæan.
Alors les rames s’agitèrent, la voile s’enfla, et bientôt la flotte se perdit
dans la brume sur la route d’Égine. Les Athéniens venaient de voir pour la
dernière fois leurs vaisseaux et leurs soldats (juillet 415).
L’expédition avait été décidée le jour où l’on célébrait
la fête funèbre d’Adonis. Pendant que, à l’Agora, les orateurs en montraient
les avantages, les femmes, se frappant la poitrine et poussant des
lamentations, criaient : Hélas ! hélas. Adonis
est mort ! Pleurez le Seigneur !
[13] Cette rencontre
avait parti aux superstitieux un funeste présage ; mais le peuple, dans
l’orgueil de sa puissance, n’avait rien entendu.

III. Les Athéniens devant Syracuse (414) ; Gylippos ; destruction de
l’armée
Une entreprise audacieuse veut être audacieusement
exécutée ; mais les généraux n’emportaient point d’instructions précises. On
les envoyait pour faire quelque chose de grand en Sicile ; et on n’avait pas
dit précisément quelle grande chose il fallait faire. D’ailleurs Nicias
paralysait tout. Il avait eu raison de s’opposer à l’expédition avant qu’elle
fût résolue, mais, après avoir inutilement tenté
d’en détourner les Athéniens et de se faire exempter du commandement, il
n’était plus temps de montrer de la crainte, d’agir avec lenteur, de regarder
sans cesse, comme un enfant, du vaisseau vers le rivage, de répéter que, sans
aucun égard à ses représentations, on l’avait chargé, malgré lui, d’une
guerre imprudente, et par là d’émousser ce premier élan de confiance qui
assure le succès des entreprises. Le long des côtes d’Italie la flotte
fut très froidement reçue ; les villes fermaient leurs portes et refusaient
de vendre des vivres ; Rhégion même, alliée d’Athènes dans la dernière
guerre, ne voulut pas sortir de la neutralité. On comptait sur les richesses
de Ségeste : trois vaisseaux envoyés à cette ville rapportèrent la promesse
d’un subside de 50 talents : c’était tout ce qu’elle pouvait donner. On
comptait sur les villes ioniennes, aucune n’appela les Athéniens. Que faire
quand on ne trouvait que défiance ou misère, là où l’on espérait de chaudes
amitiés et des secours ? Lamachos fut d’avis d’aller droit aux
Syracusains, et de livrer bataille sous leurs murs. Alcibiade voulait qu’on
commençât par détacher les autres villes et, les Sicules du parti de
Syracuse, pour attaquer ensuite cette ville et Sélinonte. Nicias ne goûta
aucun de ces deux avis : il proposa de sommer les Ségestains de tenir leurs
promesses ; s’ils refusaient, d’obtenir pour eux quelques bonnes conditions
des Sélinontains, puis de revenir en côtoyant tranquillement la Sicile, pour faire voir
les armes d’Athènes et l’immense armement. Le parti le plus sage était celui
de Lamachos, le pire celui de Nicias : on adopta le plan d’Alcibiade, qui
était un moyen terme entre les deux autres (juillet 415).
Messine ferma ses portes, Naxos les ouvrit ; à Catane,
Alcibiade fut admis dans la ville, mais seul. Pendant que le peuple écoutait
ses raisons sur la place, quelques soldats surprirent une porte mal gardée. Catane
entra dans l’alliance d’Athènes, et devint la station de la flotte. L’armée y
revenait d’une expédition sans résultat sur Camarine, quand on vit paraître
la galère salaminienne, arrivant d’Athènes avec l’ordre d’y ramener
Alcibiade. Pour ne pas irriter l’armée, on l’invitait simplement à venir se
justifier.
Quand l’excitation produit par l’armement et le départ de
la flotte fut tombée, la foule revint à ses craintes. On n’avait vu d’abord
que les côtés brillants de l’expédition, on n’en voyait plus que les périls ;
on implorait les dieux pour qu’ils les écartassent, et l’on redoutait qu’ils
ne fussent sourds aux prières d’une ville qui ne savait pas les venger ; peu
à peu une sorte de terreur religieuse se répandit dans la cité entière. Comme
il est arrivé si souvent, la peur avivait la superstition et toutes deux
excitaient des colères implacables. Tout devint matière à soupçon[14]. Les outrages
faits aux dieux épouvantaient ; et l’on a déjà dit que certaines gens étaient
intéressées à profiter de cette terreur pour faire croire à une conspiration
qui menaçait la république et la constitution. Un mouvement des armées
béotienne et spartiate vers les frontières de l’Attique parut une preuve de
la connivence des traîtres du dedans et de l’ennemi du dehors. La peur gagna
Argos, alors étroitement lige avec Athènes ; les partisans de l’oligarchie y
furent mis à mort ; à Athènes, dix-huit citoyens, condamnés comme sacrilèges,
furent exécutés ; quelques jours après, quarante-deux autres furent proscrits
; enfin Alcibiade lui-même fut atteint. Lorsque Thessalos, fils de Cimon et
un des chefs du parti oligarchique, reprit l’accusation relative à la parodie
des mystères d’Éleusis, les dévots à Déméter et à Cora, les initiés, les
femmes surtout qui étaient comme les gardiennes du culte des déesses vénérables répandirent dans la ville
une sourde irritation contre l’audacieux contempteur. Alcibiade fut rappelé.
il comprit qu’une sentence de mort l’attendait à Athènes, et il s’enfuit à
Thurion, de là dans le Péloponnèse, auprès de ses amis d’Argos. Peu de temps
auparavant, quelques Grecs de dessine s’étaient engagés à lui livrer la place
; avant de quitter la Sicile,
il dénonça le complot aux magistrats de la cité. Ceux de leurs compatriotes
qu’il avait gagnés furent exécutés, et les Athéniens perdirent un poste qui
eût été pour eux d’une extrême importance. C’était le commencement de la
vengeance qu’il voulait tirer de sa patrie et, d’un seul coup, deux mauvaises
actions.
Dès que la fuite d’Alcibiade fut connue à Athènes, on le
condamna à mort ; on confisqua ses biens, et les prêtres prononcèrent contre
lui les malédictions dans la forme antique, à l’approche des ténèbres, lie
visage tourné vers l’occident et en secouant leurs robes de pourpre, comme
pour rejeter le sacrilège du sein de la cité et loin de la protection des
dieux. L’hiérophantide Théano refusa seule d’obéir ait décret. Je suis prêtresse, dit-elle, pour bénir, non pour maudire.
Pour compléter ces actes d’hypocrisie religieuse, de
superstition féroce et de jalousie politique, on fit passer une loi qui
interdisait aux poètes dramatiques les allusions contre les choses du jour (414). C’était la
censure pour les pièces de théâtre[15]. Aristophane y
répondit par un chef-d’œuvre, sa comédie des Oiseaux, féerie
charmante, mais satire universelle qui n’épargnait ni les faiseurs de lois ni
les devins, pas même les dieux. Dans la bienheureuse cité que le poète fait
construire par les Oiseaux, entre ciel et terre, on vit tranquille, sans
crainte des délateurs, de la galère salaminienne et des procès. C’était une
protestation de l’esprit et du bon sens. Athènes comprenait et riait
d’elle-même avec le poète, mais ne se corrigeait pas. Quand Alcibiade se fut
réfugié dans le Péloponnèse, elle réclama par des ambassadeurs son
extradition.
En Sicile, le départ d’Alcibiade avait découragé les
troupes, et Nicias n’était plus l’homme qu’il fallait, pour remonter le cœur
des soldats. Il perdait le temps a promener ses galères en vue des côtes,
comme s’il n’avait d’autre charge que de montrer aux insulaires la flotte
athénienne, et l’automne arriva sans qu’il eut rien fait. Syracuse avait
longtemps repoussé les avertissements du sage Hermocrate et refusé de croire
à une attaque des .Athéniens. L’apparition de la flotte dans les eaux de la Sicile ouvrit enfin tous
les yeux. À ce moment, Nicias aurait encore pu enlever la ville par un coup
de main hardi. Mais il laissa aux Syracusains le temps de revenir de leur
effroi et de faire des préparatifs ; ils étaient prêts à tout, quand il
reprit le projet de Lamachos.
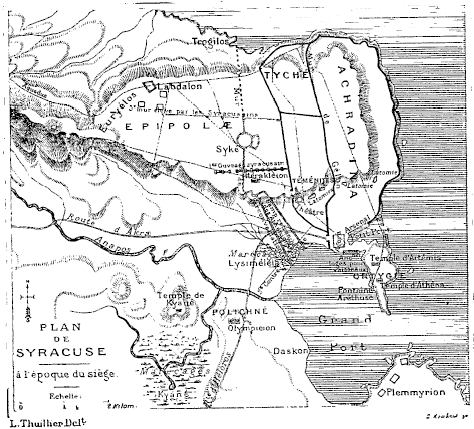
Plan
de Syracuse à l’époque du siège de 714[16].
Lent et indécis dans le conseil, Nicias ne manquait pas de
vigueur dans l’action. Ayant réussi par un adroit stratagème à attirer hors
de leurs murs toutes les forces ennemies, il se présenta subitement devant la
place dégarnie de troupes, et débarqua son armée, qu’il fit camper, pour n’avoir
rien à craindre de la cavalerie syracusaine, entre un marais où se perdait l’Anapos
et les pentes de l’Olympiéion. Un combat qui suivit fut tout à l’avantage des
Athéniens. Sur cette colline se trouvaient un temple de Zeus et de riches
trésors que les soldats de Nicias auraient voulu piller. Le scrupuleux
général n’osa toucher à ce bien sacré, et laissa cette ressource à ses
adversaires. L’hiver survenant, il se retira à Masos, et de là fit demander à
Athènes de la cavalerie et de l’argent. En même temps il détachait les
Sicules de l’alliance de Syracuse et tâchait d’attirer dans celle d’Athènes Carthage
et l’Étrurie, deux ennemies des Grecs italiotes et siciliens. Syracuse
s’adressa, de son côté, à Corinthe, à Sparte, à Agrigente qui refusa de se
lier à l’un ou l’autre parti. Sur la proposition d’Hermocrate, le peuple
réduisit de quinze à trois le nombre des généraux, augmenta leurs pouvoirs,
et comprenant le besoin d’une dictature, durant le péril publie, s’engagea à
ne point gêner leur action par l’indiscrète curiosité propre aux démocraties.
En Grèce, Alcibiade n’eut pas honte de se joindre aux
députés de ceux contre lesquels il avait soulevé cette guerre, d’être leur
guide et leur intercesseur. Il pressa les Lacédémoniens de faire passer une
armée à Syracuse, tandis qu’ils fortifieraient, dans l’Attique, le poste de
Décélie, pour mettre Athènes entre deux dangers. En apprenant sa condamnation
à mort, il avait dit : Je saurai bien leur
montrer que je suis encore en vie ; et il tenait parole.
Sparte résolut d’envoyer un des siens, Gylippos, fils de
Cléandridas, l’exilé de 445, avec des vaisseaux de Corinthe ; mais la lenteur
qu’elle y mit laissa le temps aux Athéniens de revenir l’été suivant devant
Syracuse (414).
Heureusement les habitants avaient profité de la retraite de Nicias pour se
couvrir, pendant l’hiver, d’une muraille qui défendit l’approche de
l’Achradine et d’Ortygie. Ils allaient occuper aussi le sommet de l’Épipole,
quand les Athéniens arrivèrent et les prévinrent[17]. Nicias
construisit aussitôt une vaste enceinte retranchée, le Cercle, et de
la fit partir, pour envelopper la ville, deux murs de circonvallation qui
devaient aboutir, d’un côté, au port de Trogile et, de l’autre, au Grand
port. Il pressa activement cette construction, malgré la difficulté du
terrain, tantôt en collines, tantôt en marais. Pour la rendre inutile, les
Syracusains commencèrent une muraille transversale qui devait couper les
travaux de l’assiégeant ; celle-là prise, une autre fut poussée jusqu’à
l’Anapos ; les Athéniens s’en emparèrent encore. Dans un de ces combats,
Lamachos fut tué : c’était un général habile et brave. Aristophane, qui
raille sa fougue belliqueuse, l’appelle pourtant un héros. Il était pauvre et
honnête : Lorsque, après une expédition, dit
Plutarque, il rendait ses comptes au peuple, il
portait toujours en dépense un habit et une paire de chaussures.
Nicias resta seul à la tête de l’armée. Ses derniers
succès lui attirèrent de nombreux renforts de la Sicile, de l’Italie, même
des Étrusques, qui lui envoyèrent trois galères. Il commençait à espérer ;
les Syracusains, au contraire, perdaient courage ; déjà ils parlaient de se
rendre, et la capitulation était prête, quand une galère de Corinthe, échappée
aux croisières des Athéniens, vint annoncer qu’une flotte se rassemblait à
Leucade et que Gylippos était en Sicile. Il avait, en effet, débarqué à
Himère. Avec les secours que lui fournirent cette ville, Sélinonte, Géla et
quelques Sicules, il réunit une armée de 3000 hommes. Nicias, au lieu de
marcher à sa rencontre, le laissa entrer paisiblement dans Syracuse. Aussitôt
la face des choses changea. Gylippos, dit
Plutarque, envoya d’abord un héraut aux Athéniens
pour leur offrir toute sûreté dans leur retraite, s’ils voulaient évacuer la Sicile. Nicias ne
daigna pas même répondre, et quelques-uns de ses soldat demandèrent au
héraut, d’un ton railleur, si l’arrivée d’un bâton et d’un manteau
lacédémonien avait subitement donné aux Syracusains une telle supériorité,
qu’ils n’eussent plus que du mépris pour ces Athéniens qui, tout récemment,
avaient rendu aux Spartiates 300 prisonniers qu’ils tenaient dans les fers,
tous beaucoup plus forts et plus chevelus que Gylippos.
Mais le Spartiate avait ramené la confiance ; il
rétablissait la discipline, il aguerrissait les troupes et pour coup d’essai
il surprit le fort Labdalon, dont la garnison fut égorgée[18]. Puis il éleva
un troisième mur, qui coupa la ligne des Athéniens et qu’il prolongea le long
des hauteurs d’Épipole pour gagner la pointe du triangle, clef de cette
position. Au lieu de porter ses forces de ce côté, Nicias, avouant publiquement
ses craintes et sa faiblesse, s’occupa de fortifier le promontoire Plemmyrion,
à l’entrée du grand port, et y construisit trois forts ; c’était presque
abandonner le siège. Si là, en effet, les secours arrivaient aisément par
mer, il fallait aller chercher au loin l’eau et le bois, et les soldats ne
pouvaient sortir sans être harcelés par les cavaliers ennemis qui étaient
maîtres de la campagne[19]. Une victoire
remportée par Gylippos et, l’arrivée d’une escadre corinthienne achevèrent de
rendre l’année athénienne plutôt assiégée qu’assiégeante.
Nicias expédia alors à Athènes une dépêche où il révélait
la détresse de l’armée et l’inquiétude de son âme. Il annonçait l’arrivée de Gylippos
l’interru1ration du mur de circonvallation, le délabrement de la flotte et
des troupes, le mauvais état des vaisseaux restés trop longtemps à la mer, la
désertion des rameurs et des auxiliaires soudoyés, l’épuisement des villes
alliées, Naxos et Catane, le découragement des soldats et des matelots. Ce qui est le plus embarrassant, ajoutait-il, c’est que, tout général que je suis, je n’ai pas le pouvoir
d’empêcher ces désordres ; car vous êtes des esprits difficiles à gouverner…
Je voudrais vous mander des choses plus agréables, disait-il en terminant,
mais je ne pourrais vous en écrire de plus importantes, puisqu’il faut que
vous soyez bien informés de l’état de ce pays-ci, pour en faire l’objet de
vos délibérations. D’ailleurs, je vous connais, je sais que vous n’aimez
recevoir que de bonnes nouvelles, et qu’ensuite, si les événements n’y répondent
pas, vous rejetez le mal sur ceux qui vous l’apprennent : j’ai donc regardé
comme le plus sûr de vous dire la vérité. Soyez persuadés que chefs et
soldats se sont conduits sans reproche. Mais à présent que toute la Sicile est liguée contre
nous, et qu’on y attend une nouvelle armée du Péloponnèse, délibérez avec cette
idée que vous n’avez ici que des forces insuffisantes. Il faut on les
rappeler, ou envoyer une seconde armée de terre et de mer, aussi forte que la
première, avec de grandes sommes d’argent. Il faut aussi me donner un
successeur : la maladie néphrétique dont je suis tourmenté ne me permet plus
de garder le commandement. Je mérite de votre part cette condescendance :
tant que j’ai eu de la santé, je vous ai bien servis. Au reste, ce que vous
jugerez à propos de faire doit être prêt au commencement du printemps. Point
de lenteur : nos ennemis de Sicile n’en mettront pas dans leurs dispositions
; ceux du Péloponnèse tarderont davantage ; mais si vous n’y faites
attention, les uns vous surprendront, comme ils l’ont déjà fait, et les
autres vous préviendront[20].
Cette pressante missive, loin d’abattre les Athéniens, ou
d’exciter leur colère contre l’incapable général, Ies porta à de plus grands
efforts. Ils votèrent un nouvel armement, qui fut placé sous les ordres de
Démosthène et d’Eurymédon, adjoints à Nicias pour le généralat de Sicile. Une
autre détermination était prise, presque le même jour, à Lacédémone, celle
d’envoyer, au printemps suivant, une armée à Syracuse et une autre dans
l’Attique, pour occuper Décélie. La guerre générale allait donc recommencer. Braver
tant de dangers à la fois, c’était peut-être très héroïque, mais c’était d’une
souveraine imprudence. En attendant les secours promis, Gylippos poursuivait
avec activité ses premiers succès. Il sortit de Syracuse, parcourut les
villes jusqu’alors flottantes et les entraîna toutes, excepté Agrigente, dans
le parti que la victoire favorisait. De retour auprès des Syracusains, il les
décida à attaquer à la fois par terre et par mer. Tandis que toute l’armée
athénienne regardait du rivage le combat naval, Gylippos surprit les forts de
Plemmyrion. Les Athéniens y perdirent leurs provisions, leurs bagages, le
trésor de l’armée et une position d’où les Syracusains pouvaient, à leur
tour, intercepter tous les arrivages de la haute mer. Deux actions navales,
où les Athéniens eurent le dessous, accrurent encore les dangers de leur
position (juillet 413).
Mais Démosthène arrivait. Il parut tout à coup au-dessus
du port, à la vue des ennemis, dans un appareil magnifique et formidable. Sa
flotte était composée de 73 vaisseaux, montés par 5000 hommes d’infanterie et
3000 archers, frondeurs ou gens de train. L’éclat des armes, les couleurs
brillantes des navires et des enseignes, le grand nombre des officiers et le
son bruyant des trompettes, tout faisait de ce spectacle quelque chose à la
fois de pompeux et d’effrayant. Les Syracusains furent de nouveau en proie à
de vires alarmes : ils ne volaient plus de terme à leurs maux, plus d’espoir
d’un meilleur sort. Ils allaient, disaient-ils, perdre le fruit de leurs
travaux et pétrir certainement, car Athènes qu’ils croyaient épuisée, Athènes,
malgré les dangers dont elle était menacée, à cette heure même, sur son
propre territoire occupé par une garnison ennemie, envoyait en Sicile une
seconde armée plus formidable que la première.
Démosthène voulait terminer promptement la guerre. Dès qu’il
eut tout examiné, il déclara que son avis était d’attaquer la muraille des
Syracusains, afin de pouvoir achever la circonvallation. S’il réussissait, il
entrerait dans Syracuse ; sinon, il ramènerait l’armée, sans perdre inutilement
les hommes et l’argent de la république. Nicias, effrayé de son audace, resta
dans les retranchements. Démosthène et Eurymédon assaillirent au milieu de la
nuit l’Épipole, afin de tourner la touraille des ennemis. Cette attaque
imprévue ébranla les Syracusains, mais les Athéniens se crurent trop tôt
victorieux : ils se dispersèrent à la poursuite de quelques fuyards, tandis
que l’ennemi, revenu de sa stupeur, reformait ses rangs. Les Béotiens, alliés
de Syracuse, s’arrêtèrent les premiers ; ils chargèrent ces assaillants en
désordre et les tirent reculer. Comme la lune brillait, on apercevait bien la
forme des corps, mais sans distinguer si l’on avait affaire à des amis ou à
des ennemis. Des hoplites des deux partis s’égarèrent ; et le mot d’ordre,
que les Athéniens se donnaient à haute voix pour se rallier, fut vite connu
des ennemis. Ils en profitèrent pour augmenter la confusion. Si les
Corcyréens, et tout ce qu’il y avait de Doriens dans l’armée d’Athènes,
chantaient le pæan, les Athéniens se croyaient au milieu des troupes de
Syracuse et frappaient : on se battait amis contre amis, citoyens contre
citoyens, et la cruelle méprise n’était reconnue que trop tard. La descente
d’Épipole est étroite ; poursuivis sur cette pente rapide, beaucoup se
jetèrent dans les précipices et se tuèrent. Ceux qui, sans accident,
parvinrent dans la plaine, se sauvèrent à leur camp, surtout les soldats de
la première armée qui connaissaient mieux le pays ; mais plusieurs des
derniers arrivés se trompèrent de chemin, et, le jour venu, furent enveloppés
par la cavalerie syracusaine. Les Athéniens perdirent 2000 hommes dans ce
combat.
Après un tel désastre, il n’y avait pins qu’un parti à
prendre : la tentative de Démosthène ayant échoué, il fallait quitter la Sicile. Mais la
décision est ce qui manque le plus aux esprits irrésolus. Quand Démosthène
paria de mettre à la voile, Nicias s’y opposa. Il n’osait prendre sur lui une
si grande résolution: il prétendait qu’il fallait rester, que les Syracusains
manquaient d’argent, qu’ils n’étaient pas dans un état aussi prospère qu’ils
paraissaient. Au fond, il redoutait de se retrouver en face du peuple
d’Athènes, qui imputerait à ses continuelles hésitations le mauvais succès de
la guerre. Eurymédon s’était d’abord rangé à l’avis de Démosthène ; mais,
comme on savait que Nicias avait des intelligences dans la ville, on crut,
quand on le vit s’opposer si obstinément au départ, qu’il conservait des
espérances que la prudence lui défendait de révéler : on resta.
La détresse de Syracuse n’était pas une invention de
Nicias. Mais le succès la rendait plus facile à supporter. Gylippos parcourut
une seconde fois la Sicile,
et ramena de nouveaux renforts. Comme ils avaient eu la victoire sur terre,
les Syracusains voulurent l’avoir sur mer. Pour fermer la retraite aux
Athéniens, ils entreprirent de leur barrer l’issue du port.
Lorsqu’on eut résolu de continuer l’expédition,
Démosthène, voyant tout le danger de la position, avait proposé de se retirer
à Catane ou à Naxos, pour y passer la saison des maladies. Le campement était
malsain ; une épidémie affaiblissait l’armée. Nicias avait fini par se ranger
à cet avis, et on allait s’éloigner, lorsqu’une éclipse de lune effraya le
superstitieux général : il refusa de nouveau de quitter la place avant que
trois fois neuf jours se fussent écoulés, et il rie s’occupa que de
sacrifices pour apaiser la déesse irritée. Les Syracusains mirent ce retard à
profit : ils attaquèrent la flotte athénienne, lui prirent 18 vaisseaux et
fermèrent le port en y mettant à l’ancre des trirèmes et des vaisseaux de
charge attachés ensemble par des chaînes.
Il fallait à tout prix rompre cette barrière : les Athéniens,
qui avaient encore 110 vaisseaux, s’y résolurent : ce fut la lutte suprême.
Nous laissons Thucydide la raconter. Démosthène,
Ménandre et Euthydème, commandants de la flotte athénienne levèrent l’ancre
et se dirigèrent. droit sur le barrage qui fermait le port, Les Syracusains
et leurs alliés se mirent aussitôt en mouvement avec une flotte a peu près
égale en nombre. Une partie de leurs navires étaient auprès du passage, le
reste autour du port, afin de pouvoir tomber à la fois sur les Athéniens et
sur l’armée de terre rangée le long du rivage pour soutenir les vaisseaux qui
viendraient s’y réfugier.
Dans l’impétuosité du premier
choc, les Athéniens défirent les vaisseaux qui gardaient le barrage et
cherchèrent à rompre l’estacade. Mais les Syracusains et leurs alliés se
précipitèrent sur eux de toutes parts ; ce fut un combat acharné, tel qu’il
ne s’en était jamais livré. Des deux côtés les matelots étaient pleins
d’ardeur ; les pilotes opposaient l’art à l’adresse ; les soldats, placés
surf le. pont pour l’abordage, rie montraient pas moins d’ardeur ; chacun, au
poste où il était, voulut paraître le plus brave. Les navires combattaient dams
un espace resserré, car les deux flottes réunies en comptaient près de deux
cents ; aussi, comme ils ne pouvaient reculer pour prendre du champ, il y eut
peu de chocs ; c’étaient des attaques irrégulières, quand ils se
rencontraient en fuyant ou en se dirigeant ailleurs. Pendant qu’un navire
s’avançait contre un autre, on lançait du tillac une multitude de javelots,
de flèches et de pierres, dès que l’abordage avait lieu, les soldats en
venaient aux mains et s’efforçaient de parvenir sur le vaisseau ennemi. A
cause du manque d’espace, il arrivait souvent que le vaisseau qui en frappait
un autre de l’éperon était lui-même frappé, et que deux vaisseaux ou même
davantage étaient, sans le vouloir, accrochés à un seul. Les pilotes devaient
veiller en même temps, ici à la défense, là à l’attaque ; et le bruit de
cette multitude de vaisseaux se heurtant empêchait d’entendre la voix des
chefs. Des deux côtés retentissaient les exhortations et les ordres : les
Athéniens criaient qu’il fallait forcer le passage et que c’était le moment
ou jamais d’assurer, en montrant du cœur, le salut et le retour dans la terre
natale ; les Syracusains et les alliés, qu’il était beau d’empêcher l’ennemi
de se sauver, et d’accroître par la victoire la puissance de leur patrie. Les
généraux, dans les deux flottes, quand ils voyaient un vaisseau reculer sans
y être contraint, appelaient les triérarques par leur nom et leur demandaient
s’ils aimaient mieux une terre couverte de leurs plus cruels ennemis, que la
mer, conquise par eux au prix de tant de travaux ? Les Syracusains
disaient aux leurs : L’ennemi ne cherche qu’à s’échapper, cet c’est devant
des fuyards que vous fuyez.
Pendant que la victoire était
disputée sur mer, les deux armées de terre étaient dans une grande agitation
d’esprit. Les Siciliens désiraient obtenir une gloire plus grande ; les
Athéniens redoutaient un sort plus triste. Les espérances de ceux-ci étaient
dans leurs vaisseaux ; aussi l’avenir les effrayait, et le présent était pour
eux plein d’anxiété. Comme l’ensemble de la bataille leur échappait, tous
voyaient du rivage le combat sous un aspect différent. Ceux qui apercevaient quelque
part les leurs victorieux reprenaient courage et priaient les dieux de ne pas
les priver de leur salut ; ceux, au contraire, qui les croyaient vaincus,
gémissaient et criaient. D’autres, regardant un point de la bataille où le
succès était incertain, se sentaient sur le point d’être sauvés ou de périr
et exprimaient par des mouvements troublés leurs impressions de crainte ou
d’espérance. On entendait retentir, parmi les troupes athéniennes, les cris :
Vainqueurs ! Vaincus ! et les mille bruits divers qui
s’élèvent nécessairement d’une grande armée dans un grand péril.
Après un combat acharné, les
Syracusains mirent les Athéniens en déroute, et les poursuivirent jusqu’à la
côte. Alors ceux de la flotte qui n’avaient pas été pris en mer, se jetèrent
au rivage et coururent au camp, tandis que les soldats de terre allaient, les
uns au secours des vaisseaux, les autres à la garde de ce qui restait des
retranchements ; d’autres encore, et c’était le plus grand nombre, fuyaient
éperdus. Le désastre présent leur rappelait celui qu’ils avaient infligé aux
Lacédémoniens, de Pylos, et ils n’avaient aucun espoir de se sauver par
terre, à moins de quelque événement invraisemblable[21]. C’en était
fait, l’expédition se trouvait maintenant prisonnière (1er sept. 413).
Le combat avait été si rude, que des deux côtés on avait
fait de grandes pertes. Les vainqueurs dressèrent un trophée ; les Athéniens
ne songèrent même pas à réclamer leurs morts.
Démosthène, dont rien n’abattait le courage, proposa de
couvrir de troupes le reste des bâtiments, et d’essayer encore de forcer le
passage au lever de l’aurore. Il représentait qu’ils avaient plus de
vaisseaux capables de tenir la nier que les ennemis ; car il leur en restait
60, et ceux-ci en avaient moins de 50. Nicias était du même avis ; mais les
équipages refusèrent de s’embarquer. Frappés de leur défaite, ils ne se
croyaient plus capables de vaincre, et tous n’avaient qu’une pensée, celle de
fuir par terre.
Le surlendemain de celte fatale journée, l’armée se mit en
marche. 40.000 hommes partirent, abandonnant leurs blessée leurs malades qui
s’attachaient à leurs vêtements, les suppliaient de ne les point laisser et
les suivaient aussi loin que le permettaient leurs forces épuisées. L’armée
marchait en deux divisions, commandées l’une par Nicias, l’autre par
Démosthène qui, tous deux, s’efforçaient de ramener, par leur contenance de
leurs paroles, un peu de confiance et de courage dans ces esprits abattus.
Pendant les huit jours que dura cette retraite désastreuse, les ennemis ne
cessèrent d’attaquer l’armée en tête, en queue et sur les flancs. Démosthène,
qui faisait l’arrière-garde, fut enveloppé avec toute sa division à
Polyzélion, et forcé de mettre bas les armes, à la seule condition que ses soldats
auraient la vie sauve. A cette nouvelle, Nicias fit porter des propositions à
Gylippos. Il demandait qu’on laissât sortir librement de Sicile les
Athéniens, et promettait, à celte condition, qu’Athènes rembourserait les
frais de la guerre. Ces demandes furent rejetées avec mépris, et la poursuite
continua avec acharnement. Le lendemain, les Athéniens arrivèrent au fleuve
Asinaros. Ils essayèrent de le passer. Dévorés par la soif, ils s’y jetèrent
en foule ; beaucoup s’y noyèrent, et les Syracusains, postés sur les hauteurs
voisines, n’avaient qu’à lancer leurs traits au hasard pour tuer : le fleuve
fut bientôt rempli de morts. Ce dernier revers décida Nicias à se rendre, et
Gylippos arrêta le massacre (10 sept.
413).
A peine les vainqueurs furent-ils rentrés dans Syracuse,
couronnés de fleurs, sur des chevaux magnifiquement harnachée que l’orateur
Euryclès proposa dans l’assemblée le décret suivant : Le jour où Nicias a été fait prisonnier sera consacré à jamais par des
sacrifices et par la suspension de tout travail publie : cette fête sera
appelée Asinaria, du nom du fleuve que les Syracusains ont illustré par leur
victoire. Les valets des athéniens et tous leurs alliés seront vendus à
l’encan : les Athéniens de condition libre et les Siciliens qui ont embrassé
leur parti seront relégués dans les carrières, excepté les généraux, qu’on
fera mourir. Ce décret fut adopté. Deux hommes s’opposèrent à son
exécution : Hermocrate au nom de la modération et de l’humanité ; Gylippos,
au nom de Sparte. Gylippos réclamait les deux généraux captifs, pour les
emmener dans sa patrie. Il se souvenait que Nicias s’était toujours montré
bienveillant envers les prisonniers de Sphactérie, et opposé à cette guerre
qu’il avait si mal conduite ; il savait combien les Spartiates désiraient
tenir entre leurs mains ce Démosthène qui leur avait fait tant de mal à Pylos.
Mais les Syracusains, déjà las de la sévérité toute spartiate de son commandement,
et qui lui reprochaient aussi son avarice et ses concussions, rejetèrent sa demande
en l’accablant d’injures. Ils firent mourir les deux généraux, quelques
Syracusains qui avaient eu des intelligences avec eux hâtèrent l’exécution,
dans la crainte que Nicias ne révélât leur trahison. Nicias et Démosthène
lurent lapidés, ou, suivant Timée, prévenus à temps par Hermocrate, ils se
donnèrent la mort.
Ils furent encore les moins malheureux. Les autres
prisonniers, au nombre de 7000, avaient été entassés dans de profondes
carrières, à ciel découvert, où ils étaient alternativement tourmentés par
l’étouffante ardeur du soleil et glacés par la fraîcheur des nuits d’automne.
Pour toute nourriture, ils recevaient la moitié de la ration d’un esclave,
deux cotyles d’orge et un cotyle d’eau par homme. Leurs blessés, leurs
malades, mouraient au milieu d’eux, et ils ne pouvaient ensevelir leurs
cadavres. L’air qu’ils y respiraient était infect. Ils restèrent ainsi
pendant 70 jours, au bout desquels on vendit comme esclaves ceux que ces
misères n’avaient pas tués, d’abord les étrangers, puis, six mois plus tard,
les Athéniens et les Siciliens.
Cette fatale expédition, qui ébranla l’empire d’Athènes et
lui ôta ses meilleurs généraux, sembla porter malheur aux chefs victorieux.
Le sauveur de Syracuse finit mal. Comme son père Cléandridas, qui s’était
vendu à Périclès, Gylippos fut convaincu de plusieurs actions honteuses et
chassé de Lacédémone. Hermocrate, accusé de trahison, fut banni ; trois ans
après, il tenta de rentrer à Syracuse les armes à la main et fut tué sur la
place publique.
La poésie seule vainquit la fortune contraire et désarma
la haine. Plutarque raconte que quelques prisonniers athéniens durent leur
salut à Euripide, les uns parce qu’ils avaient été mis en liberté pour avoir
appris à leurs maîtres lek morceaux qu’ils avaient retenus de ses pièces ;
les autres, parce que, errant dans la campagne après le combat, ils avaient
été nourris par ceux à qui ils chantaient ses vers. De, retour à Athènes, ces
captifs allèrent, porter leur reconnaissance au poète dont le génie avait
payé leur rançon.
|