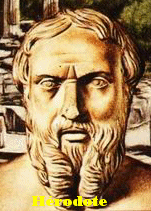HISTOIRE DES GRECS
QUATRIÈME PÉRIODE — SUPRÉMATIE D’ATHÈNES (479-434) - GRANDEUR DES LETTRES ET DES ARTS.
Chapitre XXII — Les lettres et les arts hors d’Athènes au cinquième siècle.
I. Le progrès de la culture intellectuelle dans tout le monde grecChaque peuple grec de ce temps n’a pointa sa tête un homme comme Périclès dont on puise, sans trop d’adulation, donner le nom au siècle que nous étudions; niais ceux qui ne cultivent ni les arts ni les lettres, au moins les comprennent, et par leur enthousiasme donnent l’inspiration aux artistes et aux poètes. lux fêtes de Delphes et d’Olympie, en face de la plus belle nature, sur un sol comme imprégné de divinité et de poésie, sous ce ciel transparent qui jamais ne pèse lourdement sur les âmes, voici que se déroule, le long des rampes du Parnasse ou sur les rives de l’Alphée, les théories qui entourent les victimes sacrées, ou l’immense cortège qui suit le poète, le musicien et les athlètes vainqueurs. La foule s’arrête : c’est Hérodote qui récite quelques passages de ses histoires ; ou ce sont les rapsodes qu’un décret publie appelle à chanter les vers d’Homère, d’Hésiode, et d’Empédocle ; ou quelque tableau, une statue nouvelle, qu’un artiste expose aux regards. Car ces fêtes sont la publique exhibition de toutes les sortes d’adresse, de courage et de talent. Si la force et l’agilité, qualités essentielles d’un peuple militaire, y reçoivent des couronnes, la beauté dans toutes ses manifestations, qu’elle vienne du corps ou de l’âme, du travail des mains ou des efforts de l’intelligence, y a obtenu un souverain empire. Mais comme le mal se mêle toujours au bien dans notre fragile nature, le Grec va si loin dans ce culte nouveau, qu’il en pervertit les instincts les plus vrais du coeur. Un adolescent aux formes élégantes lui inspire autant d’amour que la plus belle des vierges[1]. De ces fêtes chacun rapporte dans sa cité natale le goût des belles choses qu’il vient d’admirer. Alors les villes rivalisent de magnificence ; l’architecture et la statuaire multiplient leurs œuvres, que les Grecs, guidés par leur instinct d’artistes, placent presque toujours en des sites admirablement choisis[2]. Platée demande à Phidias un colosse d’Athéna et une statue de Zeus ; Lemnos, une autre Minerve, que l’antiquité appela la belle Lemnienne ; Delphes, une Diane et un Apollon, Olympie, cette statue de Jupiter qui rendit visible la majesté du maître des dieux[3]. Delphes et Corinthe instituent des concours de peinture, où Panénos est vaincu par Timagoras de Chalcis qui, clans un poème, chante lui-même sa victoire ; où Polygnote de Thasos remporte un si éclatant triomphe que les amphictyons lui donnent les droits de l’hospitalité dans toutes les cités grecques. Sicyone, dont l’école de peinture succédera à celle d’Athènes, a déjà Polyclète, l’émule heureux de Phidias qu’il surpassa peut-être par la correction du dessin et les Argiens vont lui demander une statue colossale de Junon, en ivoire et en or, dont ils puissent se glorifier, comme Athènes de sa Minerve. L’artiste réussit, et passa pour avoir aussi bien réalisé le type de la beauté noble et pure de Junon que Phidias avait reproduit l’imposante grandeur du souverain des dieux. Olympie vante son temple, Delphes son sanctuaire, dont deux Athéniens, Praxias et Androsthénès, ont sculpté le fronton. Égine, rocher stérile, a pourtant cinq temples, dont les ruines ont gardé pour nous de précieux débris; Épidaure, le plus magnifique théâtre de l’antiquité; Tégée, le temple le plus vaste du Péloponnèse. Argos, punie de son isolement par la stérilité de son
génie, n’a pas donné de successeur à la poétique et guerrière
Télésilla ; tout au plus a-t-elle quelques musiciens et un statuaire,
Agéladas, qui eut l’honneur de former les trois plus grands sculpteurs de.
ce. temps, Phidias, Myron et Polyclète de Sicyone, les chefs d’une nouvelle
école qui, donnant la vie au marbre et au bronze, commença, si l’on peut
dire, la sécularisation de l’art. Corinthe a bâti des sanctuaires à tous les
dieux de l’Olympe, et les décore avec magnificence; mais il lui a fallu pour
les construire la main d’artistes du dehors ; comme si l’art, importation
étrangère, n’était, chez elle, qu’un luxe dont ses riches marchands trouvent
de bon goût de se parer. N’entrons pas à Sparte ; nous cherchons le génie, il
n’y a là que de la force, et trop souvent une théâtrale vertu. Sales Pindare,
Thèbes, Les îles et les colonies fournissent aussi leur contingent
de grands hommes; Héraclée donne, Zeuxis ; Éphèse, Parrhasios, dignes
rivaux qui payèrent l’admiration des Athéniens, l’un en faisant le portrait
allégorique de ce peuple violent et doux, humble et glorieux, plein de
grandeur et de faiblesse[4] ; l’autre,
en peignant pour lui cette Hélène que le peintre Timomachos de Byzance
contemplait deux heures chaque jour. Cos produisait un des plus vigoureux
esprits dont De l’autre côté de II. Les poètes et les historiens ; les philosophes et les médecinsAprès cette course rapide à travers le monde hellénique, revenons à quelques hommes supérieurs, pour mieux marquer leurs traits et montrer la part qui leur revient dans l’œuvre de la civilisation de l’Hellade. En dehors d’Athènes, J’ai parlé déjà du premier qui, par le charme de ses vers, avait mérité d’être mis à côté de Pindare, dont il avait aussi les croyances religieuses : Zeus, dit-il, tient dans sa main la fin de tout ce qui est, et il dispose de toutes choses selon sa volonté. Mais l’histoire n’a rien à demander à ce grand lyrique, si ce n’est son héroïque épitaphe de Léonidas. Épicharme était de race dorienne par la langue et par le caractère sentencieux de quelques-uns de ses vers, ruais il ne l’était point par la nature de son esprit, puisqu’il fut poète comique très fécond, fort applaudi des Syracusains et admiré d’Horace, qui le met au-dessus de Plaute. Comme il écrivit à la cour d’Hiéron, où il était en grande faveur, et que ce prince ne se serait pas accommodé de la liberté aristophanesque, Épicharme, ne pouvant s’attaquer aux rois, s’en prit aux hommes et aux dieux. Ses comédies furent des pièces à caractères ou des parodies irrévérencieuses des légendes mythologiques[8]. On sait qu’il inventa, comme personnage comique, le
parasite, qui fit, à Rome, si brillante fortune, et nous verrons plus tard
comme il traitait les Olympiens. Nous n’avons à peu près rien gardé de lui,
et c’est sur des vases peints de Ceux qui veulent faire d’Épicharme un philosophe le rattachent, à l’école pythagoricienne. Il n’a droit sans doute à ce titre que pour quelques sentences graves, telles qu’on en trouve ça et là dans toute œuvre poétique. Théocrite écrivit sur la statue de bronze que Syracuse lui éleva : Il a dit beaucoup de choses utiles à la vie et laissé un trésor de sages préceptes. Platon, oubliant son jugement sur l’auteur des Nuées, fait d’Épicharme le maître des poètes comiques[10]. Empédocle d’Agrigente qui, par certains côtés, se rattache à l’école pythagoricienne et à celle des Éléates, fut un grand poète et un homme d’action[11]. Il donnait des constitutions aux villes, desséchait les marais pestilentiels[12], barrait le haut des vallées pour arrêter les vents funestes et connaissait les remèdes qui sauvent de la mort. Platon et Aristote l’admirent ; Lucrèce l’a chanté. C’était un homme de génie, mais le génie confine parfois à la folie : Empédocle se crut dieu et le fit croire, ce qui, chez les anciens, n’était pas difficile, quand on avait la richesse, le génie ou la puissance. Amis, dit-il en tête de son poème des Purifications, vous qui habitez les hauteurs de la grande ville baignée par le blond Acragas, zélés observateurs de la justice, salut ? Moi qui ne suis pas un homme, mais un dieu, je viens à vous, ceint de bandelettes et couronné de fleurs. A mon entrée dans les villes florissantes, hommes et femmes se prosternent. Tous me suivent implorant ce qui leur est profitable. Les uns me demandent des oracles et le sentier qui conduit au bonheur, les autres les remèdes puissants qui les guériront[13]. Il prétendait avoir des secrets pour arrêter la vieillesse, exciter ou contenir les ouragans et faire sortir les morts des enfers : c’était un illuminé. Il enseigna quelque temps à Athènes et lut aux jeux olympiques, au milieu d’acclamations enthousiastes, son poème des Purifications. Malgré ces triomphes, il y avait dans son âme un écho de la tristesse d’Hésiode. Il croyait à un péché originel, à une déchéance de l’homme qui expie dans la vie présente des fautes passées[14]. Triste race des mortels, dit-il au commencement de son livre, race malheureuse ! de quels désordres êtes-vous sortis ? Pour moi, je suis tombé d’un comble de bonheur parmi les hommes et j’ai gémi à la vue de cette terre qu’habitent le meurtre, l’envie et les autres maux. Il croyait à l’expiation par la métempsycose. L’âme errait pendant trente mille ans d’un corps dans un autre et descendait jusque, dans les végétaux, où elle devenait la force vitale de la plante : idée singulière, mais qui, réduite à n’être que l’expression d’une ressemblance entre les principales fonctions de la vie dans la nature organisée, a fait de nos jours une brillante fortune[15]. De cette vue doctrinale ! Empédocle concluait que tous lu êtres vivants devaient être respectés, puisque dans l’un d’eux, même dans le plus humble, pouvait se cacher l’âme d’un parent. Ces âmes immortelles finissaient pourtant, lorsqu’elles avaient pratiqué la vertu, par jouir d’un bonheur sans fin. Empédocle disparut obscurément. Les Agrigentins n’acceptèrent pas cette fia modeste qui ne convenait ni à l’éclat de sa vie ni aux merveilles qu’on lui avait attribuées : on pensa que, pour pénétrer le grand mystère des feux volcaniques, ou pour faire croire par une subite disparition qu’il avait été ravi au ciel, il s’était précipité dans le cratère enflammé de l’Etna. Le volcan garda le téméraire, mais rejeta sa sandale. Ses doctrines philosophiques, mélange de physique et de
théologie, sont confuses. D’où viennent les vicissitudes des choses, la
séparation des éléments la formation du monde et tous les phénomènes qui s’y
produisent ? De la domination de deux principes contraires, l’Amour et Anacréon et Pindare n’intéressent que l’histoire littéraire. En parlant du poète, Platon l’appelait chose légère, ailée et sacrée. De ces trois mots, les deux premiers conviennent au vieillard de Téos, qui aimait à trouver près de lui le jeune Bathylle, et à voir le vin rire dans une coupe d’or[17] ; mais tous trois semblent faits pour Pindare, qui reçut de ses compatriotes des honneurs divins et qu’Alexandre admira presque à l’égal d’Homère. Aujourd’hui, il ne séduit plus que de fins lettrés[18], parce que ses odes n’ont pas, comme les œuvres de Phidias, une beauté de tous les temps : elles charment sans émouvoir, et, pour les comprendre, la connaissance approfondie de la vie grecque est nécessaire. Nous avons déjà noté, pour le compte de l’histoire, qu’il est encore très religieux, tandis qu’Épicharme ne l’est plus, et qu’au sujet de la vie future il en est resté aux idées d’Homère : le séjour des bienheureux réservé aux victorieux et aux puissants[19]. L’histoire est née dans l’Ionie. Hérodote était citoyen de la ville dorienne d’Halicarnasse
en Carie ; mais, après ses grands voyages, il vint à Athènes, aima les
Athéniens et célébra leurs exploits. On dit qu’après une lecture publique de certains
passages de son histoire, qu’il fit à la fête des grandes Panathénées, un
décret du peuple lui accorda 10 talents. Il a gardé près de nous sa
popularité, car, sans lui, nous n’aurions de la grande lutte entre
Thucydide et Hérodote sont contemporains, car l’un n’a précédé
l’autre au tombeau que de quelques années[22], mais, par leur
esprit, ils appartiennent à deux âges différents de Anaxagore, Démocrite, le Crétois Diogène et surtout Socrate, commencent, au cinquième siècle, la grande époque de la philosophie. J’ai dit pourquoi je ne m’occuperai pas en ce moment du maître de Platon, mais je dois parler de deux hommes supérieurs, Anaxagore et Démocrite, qui ont engagé l’esprit hellénique dans des voies nouvelles. Anaxagore, né vers l’an 500 à Clazomène, vécut trente ans
é Athènes, dans l’intimité de Périclès, qui le sauva en 431 d’une accusation
d’impiété, mais non de l’exil. Il enseignait que le soleil n’était qu’une
pierre enflammée et il donnait le même caractère aux astres. C’était bien
irrévérencieux pour Apollon, Hélios et toutes les divinités que la piété
populaire confondait avec les étoiles. Le surnaturel était du coup frappé au
cœur, et, jusqu’alors, Comme tous les philosophes de l’école ionienne, il chercha une explication du monde sensible, et les anciens l’ont appelé le grand physicien, ce qui lui valut les dédains de Platon. Pour lui, la matière est éternelle, mais variable dans ses éléments. Rien ne naît, disait-il, rien ne périt ; ce qui est se mêle ou se sépare, se confond ou se distingue. La naissance est une composition, la mort une décomposition. Un moderne ne parlerait pas autrement. La force qui impose ces modifications à la matière n’est ni le destin, qui a trop longtemps régné dans les croyances, ni le hasard, mot commode pour cacher notre ignorance ; c’est l’Esprit. Empédocle, qui était poète, explique le mouvement par l’action contraire de deux puissances mythiques, l’Amour et 1a Haine. Les atomistes ne voyaient dans l’univers que des effets mécaniques produits par la pesanteur des atomes ; Anaxagore enseigna l’existence d’une force incorporelle, immuable, pensante et active, qui ne crée pas la matière, mais qui la coordonne. Toutes choses étaient confondues, dit-il, l’Intelligence, cause formatrice et principe de mouvement, mit l’ordre dans le chaos. La matière étant agitée par elle circulairement, les parties pesantes se réunirent au centre, les parties légères à la circonférence. C’est pourquoi la terre est au milieu de l’univers. Au-dessus d’elles sont les eaux, puis l’air, dont le tourbillon la soutient à la place qu’elle occupe; plus haut, enfin, le feu, qui a enflammé certaines parties solides, détachées de la terre par la violence de la rotation, telles que le soleil et les étoiles. Sur la pluie, le vent, les éclipses, etc., ses idées se rapprocheraient des nôtres, et l’on trouverait encore une certaine ressemblance doctrinale entre lui et les penseurs modernes qui admettent l’uniformité du plan dans la création des êtres du règne organique. L’Intelligence d’Anaxagore, qui est l’âme du monde, se répand en tout et forme les âmes particulières de l’homme, de l’animal, de la plante. Elle est en tous identique à elle-même, mais elle agit en eux, selon que l’organisation du corps qui l’enferme le lui permet. Ainsi l’homme est supérieur à l’animal parce qu’il a des mains et une voix ; l’animal l’est à la plante parce qu’il a plus d’organes, conséquemment plus de fonctions. Privée, de ses instruments nécessaires, l’Intelligence reste inactive, et les âmes particulières, parcelles de l’âme universelle, meurent avec le corps qui se dissout, ou tout au moins perdent leur individualité spirituelle. L’impression produite par cette doctrine fut très vive. Un siècle plus tard, Aristote parlait encore du philosophe de Clazomène avec admiration. Quand un homme vint proclamer que c’est une Intelligence qui, dans la nature aussi bien que dans les êtres animés, est la cause de l’ordre et de la régularité qui éclatent partout dans le monde, ce personnage fit l’effet d’avoir seul sa raison, et d’être en quelque sorte à jeun après les ivresses extravagantes de ses devanciers[23]. Mais l’Intelligence d’Anaxagore qui, afin de pourvoir à l’organisation du monde, avait l’omniscience et la pensée, n’avait pas la connaissance du bien et du juste. Elle était une force intelligente de la nature ; elle n’était pas le dieu personnel de la conscience ; il lui manquait le gouvernement moral du monde. Du moins l’architecte du cosmos était trouvé et une route venait de s’ouvrir qui conduira l’humanité à la conception de l’unité divine. Ce sera aux écoles socratiques à donner au principe immatériel d’Anaxagore les attributs que la raison imaginera pour constituer une Providence, sans que les efforts de Socrate et de Platon aient réussi à rendre inutile la révélation qu’un jour saint Paul fera aux Athéniens du Dieu inconnu. La date de la naissance de Démocrite flotte entre 494 et
460 ; il la faut mettre, parait-il, plus prés de la dernière année que de la
première. La date de sa mort est aussi incertaine, et on le fait vivre cent
neuf ans, ce qui est un bien grand âne. Il voyagea beaucoup, de l’Égypte à Les anciens attribuent à Démocrite soixante-douze ouvrages, qui sont perdus, sauf de rares fragments, et ils le rapprochaient de Platon pour l’éclat du style, du Stagyrite pour la curiosité scientifique. Aristote même disait de lui : Il semble avoir porté sur toutes choses ses puissantes méditations[24]. La théorie des atomes a surtout fait sa renommée. Ce n’est
pas ici le lieu de parler de cette doctrine des indivisibles,
qui, entraînés par la pesanteur ou le mouvement, flottent éternellement dans l’espace
infini, se heurtent, se combinent pour former le monde et les êtres particuliers
qu’il contient, puis se séparent pour revenir à d’autres combinaisons ;
de sorte que tout se transforme et que rien ne périt. La vie elle-même
résulte de la rencontre d’atomes plus subtils qui donnent à l’homme sa
supériorité. L’histoire, moins habituée que la philosophie à pénétrer dans ces
ténèbres, se borne à constater que le système atomistique qui n’admet qu’un seul être, le corps, une seule force, la
pesanteur, est une doctrine naturaliste, comme l’avaient été celles des
Ioniens, d’Héraclite et d’Empédocle, qui ne reconnaissent point d’êtres
incorporels; que Démocrite, en contestant la vérité de la perception
sensible, préparait le scepticisme de Protagoras et de Pyrrhon ; qu’en recommandant
de fuir tout souci et en particulier le mariage, pour arriver au bonheur, sa
morale ouvrait la porte à celle d’Épicure ; qu’enfin il ôtait aux âmes
un appui dont beaucoup avaient besoin, lorsqu’il enseignait que les dieux
étaient une création de l’imagination des hommes effrayés par les convulsions
de la nature. Riais Démocrite ne fut pas le seul coupable; pareil reproche
peut être fait à toute l’ancienne philosophie. Du gour où La théorie des atomes est encore en honneur parmi nos savants. Lorsqu’ils cherchent en quels éléments la matière se résout, ils ne peuvent aller ni à l’unité numérique des pythagoriciens, ni à l’unité panthéiste des éléates; l’atome leur fournit l’unité corporelle nécessaire à leurs combinaisons. Les philosophes, eux, demandent à ce système comment, du monde matériel soumis aux lois mécaniques du mouvement, on passera au monde de la pensée où règne la volonté libre. Mais qui a dévoilé ce secret ? Envoyant partout des lois physiques, Démocrite rendait le surnaturel inutile. Cependant il admit l’existence de génies aériens, bons et mauvais, mais mortels, qui pouvaient révéler l’avenir, ce qui supposait un gouvernement du monde par les dieux. Cette contradiction provenait-elle de ce qu’il subsistait en lui un reste de la croyance populaire aux démons, qu’il n’avait pu arracher de son esprit ; ou fût-ce un acte de prudence envers la religion établie pour sauver la divination si chère à tous ces superstitieux ? Il faut plutôt admettre que ce grand logicien qui voulait trouver, derrière chaque idée, un objet réel, se rallia à la doctrine des démons pour expliquer les rêves, les hallucinations, les avertissements donnés par ces êtres supérieurs à l’homme en intelligence. Reconnaissons à notre philosophe un mérite d’une nature particulière : il a été l’inspirateur du grand poème de Lucrèce. Diogène d’Apollonie en Crète, contemporain de Démocrite, suivit une voie bien différente, qui le rapprocha de celle où Anaxagore avait marché : il regarda l’univers comme le produit d’un principe intelligent qui l’avait vivifié et ordonné; mais il n’osa constituer ce principe rationnel et sensible en un être distinct du monde. C’en fut cependant assez pour que les dévots lui aient fait courir risque de la rie. On fait de Diagoras de Mélos un affranchi de Démocrite. II fut poète et toujours tête légère. D’abord fervent adorateur des dieux, il les abandonna, lorsqu’ils se refusèrent à punir les parjures d’un dépositaire qui l’avait trompé. Il se moqua des mystères de Samothrace, bafoua, dans Athènes, ceux d’Éleusis et n’échappa que par la fuite à la ciguë ou du Barathron. Comme il arriva en France, il y a un siècle et demi, on
voit, dans
On veut que Démocrite ait été un des maîtres d’Hippocrate.
S’ils se sont rencontrés, le philosophe d’Abdère lui aura parlé de ses études
sur les animaux et les plantes. Mais le grand Asclépiade était de ces hommes
qui se font tout seuls ; et nous avons une autre raison pour le
rapprocher des philosophes. N’a-t-il pas écrit, dans son traité De Bien que les Hellènes eussent élevé Esculape à la dignité d’un dieu et qu’Homère ait célébré la science de ses fils, Podalire et Machaon, du devin Mélampos et de son descendant Amphiaraos, qui lisait dans l’avenir, la médecine grecque ressembla longtemps à celle des sorciers d’Afrique. Elle se pratiquait dans les asclépions, à l’aide de quelques simples et de beaucoup de sortilèges, de longs jeûnes, d’apparitions nocturnes, de rêves provoqués qui agissaient sur l’imagination des malades et, de temps à autre, en guérissaient un[25]. La foi, qui transporte les montagnes, ne peut-elle déterminer des actions nerveuses dont les effets semblent opérer des miracles sans confondre l’incrédulité[26] ? Avec la curiosité croissante des esprits dans toutes les directions de la science, les Asclépiades ou prêtres d’Esculape arrivèrent à trouver des moyens plus rationnels, sans renoncer toutefois aux pratiques superstitieuses qui servaient à gagner la confiance du malade et assuraient sa docilité. Ces cures étant lucratives, les dieux se firent concurrence ; Apollon ouvrit boutique contre son fils Esculape, et avec tant de succès, que, pour reconnaître ses services, un temple fut élevé à Phigalie, en Arcadie, à l’Apollon Épikourios, ou le Secourable. Dans la suite des temps, les dieux guérisseurs se multiplièrent. Diane, Cérès, Bacchus, Mercure, Hercule, Vulcain, même Vénus, qu’on ne s’attendait pas à voir occupée de pareils soins, et l’égyptien Sérapis, donnèrent des consultations[27]. Minerve n’attendit pas si longtemps. Elle révéla en songe à Périclès les propriétés d’une herbe qui sauva Mnésiclès, tombé dit haut des Propylées ; en récompense, elle eut une nouvelle statue et un autel nouveau, celui d’Athéna-Hygia. Après les dieux, les héros : un d’eux, Amphiaraos, obtint un tel succès, qu’il ruina les asclépions de la Béotie[28]. Ces choses sont très humaines et de tous les temps; aussi n’y a-t-il pas lieu de s’en étonner. Mais au milieu de ces recettes de bateleurs se rencontrèrent des conseils avisés, dont le nombre augmenta à chaque génération. Le temple d’Esculape, dit Strabon, est toujours plein de malades ; des tableaux y sont suspendus qui portent l’indication du traitement suivi. Ces renseignements datent de loin, puisque les Sentences cnidiennes sont antérieures à Hippocrate, et ils devaient constituer un fond d’expérience qui, peu à peu, s’accroissait. La médecine se sécularisa ; il se forma des médecins qui étudièrent le corps humain, comme les philosophes étudiaient l’univers ; et si les travaux anatomiques ne pouvaient se faire alors que sur les animaux[29], ils n’en profitaient pas moins à la science, ainsi qu’il arrive de nos jours, où ces expériences renouvellent la médecine. Dans chaque ville importante, il s’organisa un service médical, même gratuit pour les pauvres, et les médecins trouvèrent des élèves qui payèrent leurs leçons[30], des administrations municipales qui les subventionnèrent et de riches clients qui les firent arriver souvent à la fortune. Tel, par exemple, cet Apollonidès, compatriote et prédécesseur d’Hippocrate, qui guérit un seigneur persan et fut en grand crédit à la cour de Suse, mais s’oublia dans une intrigue de harem qui le conduisit à une fin terrible ; tels encore Démocède de Crotone et Ctésias de Cnide, l’un médecin de Darius, l’autre d’Artaxersés-Mnémon[31]. Au cinquième siècle, cieux écoles rivales étaient célèbres en Grèce : celle de Cnide et celle de Cos. Ce fut de celle-ci qu’Hippocrate sortit. Il naquit vers 460 d’un Asclépiade qui prétendait descendre d’Esculape en ligne directe, d’Hercule par les femmes, et il mourut à Larissa en Thessalie, dans un âge très avancé. Sa légitime renommée a fait courir sur lui, dans l’antiquité, des anecdotes fameuses : il aurait refusé les présents d’Artaxerxés, guéri les Athéniens de la peste, et le fils d’un roi de Macédoine du mal d’amour dont souffrit le fils de Séleucus Nicanor. La critique moderne regrette d’être contrainte à rejeter ces histoires ; mais la gloire d’Hippocrate est assez grande pour qu’il puisse se passer d’elles. Son principal honneur est de n’avoir voulu croire qu’aux faits bien observés. Il n’aime pas les hypothèses ; dans ses Aphorismes, il fonda l’art de guérir sur l’expérience et sa vie fut un continuel effort pour tirer du chaos de l’empirisme des règles médicales. Il voyagea beaucoup, étudiant l’homme, le milieu où il vivait, les stèles votives laissées par les malades dans les asclépions, les notes conservées dans les temples et les traitements qui avaient été pratiqués. L’école de Cnide, en faisant autant de maladies distinctes qu’elle constatait de symptômes différents, créait une foule d’espèces pathologiques pour chacune desquelles le traitement variait. On risquait donc à Cnide de s’égarer en cherchant le mal où il n’était pas. A Cos, on suivait Ies phases diverses de la maladie constatée, afin de s’attaquer toujours à l’ennemi véritable; on réduisait les remèdes au lieu de les multiplier, comme on simplifiait les maladies en les ramenant à un petit nombre d’affections morbides. Niais en portant toute son attention sur les développements du mal, l’école de Cos n’en étudiait suffisamment ni le siège ni la condition anatomique : c’était là sa faiblesse. Il n’est pas de notre ressort d’entrer dans le détail de la médecine hippocratique ; mais il nous appartient de citer au moins le traité Des airs, des eaux et des lieux. Il est court, excellent, et l’idée qui l’a inspiré est acceptée aujourd’hui non seulement par le médecin, mais par l’historien philosophe : l’influence du milieu sur l’homme, par l’air qu’il respire, le froid ou le chaud qui l’enveloppe et le pénètre, le sol qu’il habite, les aliments dont il se nourrit. Quand une haute culture de l’esprit n’a pas encore égalisé les conditions de la vie morale, l’homme des montagnes ne peut avoir les mêmes habitudes d’existence ni les mêmes idées que l’habitant des plages marines, des sables brûlants ou des plaines que recouvrent une végétation luxuriante. En des lieux si différents, les constitutions médicales diffèrent comme le développement social. Il faut, disait Hippocrate, étudier le corps humain dans ses rapports avec toute chose ; et il avait bien raison de donner son attention à cette partie de la science, où l’hygiène doit régner souverainement. La médecine a un double devoir : étudier ces influences extérieures et pénétrer par la science dans l’intimité des tissus, pour y connaître ce qu’Hippocrate appelait les humeurs, dont il a fait la théorie, et, ce qui intéresse davantage la médecine moderne, l’état des organes. Hippocrate a bien rempli la première de ces obligations et aine partie de la seconde, mais il ne pouvait remplir celle-ci tout entière, puisque l’anatomie du corps humain était interdite. Faire prévaloir l’observation de tout l’organisme sur l’observation d’un organe, l’étude des symptômes généraux sur l’étude des symptômes locaux, l’idée des communautés de maladies sur l’idée de leurs particularités, telle est la médecine de l’école de Cos et d’Hippocrate[32]. C’est ce qu’il appelait la prognose, ou l’étude de l’état passé, présent et futur du malade. Niais cette étude patiente ne conduisait pas à une médecine très active. Un adversaire l’appelait avec autant de méchanceté que d’esprit : Une méditation sur la mort. Lorsqu’on cherche, dans ces vieilles doctrines hippocratiques, ce qui a pu traverser les siècles, on y trouve l’animisme de, Van Helmont et de Stahl, le vitalisme qu’enseignèrent longtemps diverses écoles, la théorie enfin qui ne sépare point ce qui fait vivre de ce qui fait penser. On est plus étonné encore d’y rencontrer une thèse qui se rapproche d’une éclatante doctrine tout récemment imposée à la science : la maladie vient d’un principe morbifique qui est entré dans l’organisme, et c’est ce principe qu’il faut expulser[33]. Ces vues de génie justifient le mot qu’a prononcé sur Hippocrate. un maître, qui avait le droit d’être difficile en fait de grandeur humaine : Quand on dit le grand Hippocrate, ce n’est pas de l’homme qu’il s’agit, c’est du médecin[34]. On pourrait réclamer aussi ce titre pour l’homme qui a écrit : Le médecin s’accommodera toujours à la fortune de ses clients. Lorsqu’il y aura des étrangers ou des pauvres à secourir, c’est à eux qu’il ira d’abord et il les assistera non seulement de ses remèdes, mais de son argent. Le Serment hippocratique est encore aujourd’hui, pour ce qui concerne la dignité de la profession, la loi du corps médical. III. Les artistesLe cinquième siècle est l’âge d’or pour l’art grec. Nous avons dit quels artistes Athènes avait fournis, voyons ceux qui se sont produits dans le reste de l’Hellade, ceux du moins dont les noms sont venus jusqu’à nous avec l’indication de leurs œuvres. Chersiphron et son fils Métagénès, de Knossos en Crète, sont en dehors de la période qui nous occupe, puisqu’ils commencèrent au sixième siècle la construction du grand temple d’Éphèse. Pour qu’ils aient été chargés d’un ouvrage qui s’exécutait aux frais de l’Ionie entière, il fallait qu’ils fussent les architectes les plus renommés de leur temps ; et comme le temple ne fut achevé qu’au bout de 220 ans, Éphèse a dû être une école féconde pour l’art architectural. Nous avons déjà parlé d’Hippodamos de Milet, le constructeur du Pirée. Mais nous ne savons qui construisit le temple d’Égine, d’où l’art semble être parti pour arriver, par le Théseion, au Parthénon. La statuaire eut un grand artiste que les anciens ont
placé à côté de Phidias, Polyclète de Sicyone ou d’Argos[35]. Les artistes du
siècle de Périclès ne se cantonnaient pas dans un coin du domaine de l’art;
ils le cultivaient tout entier. Polyclète fut aussi habile architecte que
grand sculpteur. Il construisit, à Épidaure, un monument circulaire, le
Tholos, et un théâtre qui fut très admiré des anciens; à Argos, sa Junon
était la rivale de Polygnote de Thasos, que Cimon ramena de cette ville, en
465, vécut longtemps au bord de l’Ilissus et reçut à Athènes le droit de
cité, en récompense de ses travaux pour la décoration du temple de Thésée et
de l’Anacéion, du Pœcile et d’une partie des Propylées. A l’Anacéion,
le sanctuaire des Dioscures, il représenta les noces des Leucippides[38] avec Castor et
Pollux. Plusieurs bas-reliefs de sarcophages qui reproduisent cette légende
sont peut-être une imitation du tableau de Polygnote. Le Pœcile, portique où
l’on venait s’abriter du soleil, était formé, d’un côté, par une longue
colonnade qui supportait le toit, de l’autre, par un mur que les peintres
couvrirent de scènes rappelant les hauts faits du peuple athénien. De là son
nom : le portique peint. A Platée, Polygnote peignit, dans le temple
d’Athéna, Ulysse vainqueur des prétendants et, dans Zeuxis d’Héraclée du Pont et Parrhasios d’Éphèse, son
rival, étaient plus jeunes que Polygnote. Leur peinture est déjà plus
savante, moins idéale et plus près de la réalité : Aristote reproche à Zeuxis
de céder trop à la mollesse ionienne. A en croire des anecdotes souvent
racontées, ce qui ne les rend pas plus authentiques, ils auraient fait
jusqu’à des trompe-l’œil : l’un, une grappe de raisin que des oiseaux vinrent
becqueter ; l’autre, un rideau que Zeuxis voulut tirer croyant qu’il
cachait le tableau véritable. Ce serait des tours de force plutôt que de
l’art. Dotons que tous deux puisaient encore à pleines mains dans le fonds si
riche de l’ancienne poésie. Zeuxis peignit, en combinant harmonieusement la
lumière et les ombres, une Hippocentauresse, dont Sylla fit son butin, mais
qui fut perdue dans une tempête, prés du cap Malée, un Hercule enfant, un
Jupiter entouré des autres dieux, un Marsyas, une Pénélope, image, dit Pline,
de la chasteté, et une Hélène qui semblait faire revivre celle d’Homère, etc.
De Parrhasios, on vantait le combat des Lapithes et des Centaures, Dans En voyant les statuaires et les peintres demander à Homère
leurs inspirations, on est conduit à dire que l’Iliade a été IV. ConclusionDans le long voyage que nous venons de faire à travers Le centre et comme le foyer d’où cette vie rayonne est
Athènes, la ville où tant de cités envoyaient, pour le temple d’Éleusis, les
prémices de leurs moissons[40] et à qui Platon
était forcé de rendre cet hommage que, par rapport à
Sparte fit honteusement rejeter ce projet. Elle eut craint
qu’Athènes n’apparût comme la métropole de |