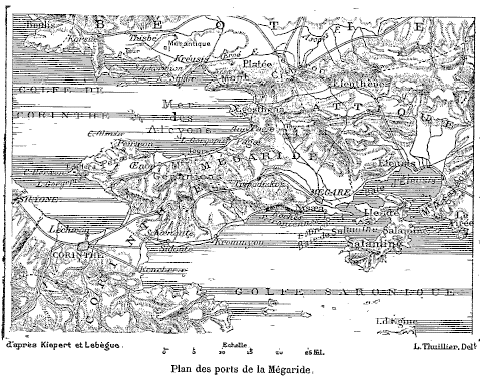HISTOIRE DES GRECS
QUATRIÈME PÉRIODE — SUPRÉMATIE D’ATHÈNES (479-434) - GRANDEUR DES LETTRES ET DES ARTS.
Chapitre XVIII — Depuis la fin de l’invasion persique jusqu’à la trêve de Trente ans (479-445).
I. Les Longs Murs ; le Pirée ; confédération athénienneSi le triomphe de
Nous connaissons Thémistocle, génie souple, rusé, hardi, plein de ressources, même au milieu du péril ; peu scrupuleux sur les moyens, pourvu qu’ils le menassent au but. Il n’eut pas toujours les mains pures, disent Hérodote et Plutarque ; il se laissa acheter, mais il sut concilier la vénalité avec le patriotisme, et il fit souvent servir l’argent de la corruption à la cause de la liberté. La postérité, qui n’aime point ces alliances adultères, est sévère pour lui, ainsi que le fut Athènes : au-dessus de son nom, elle a placé celui de l’homme qui fut comme le bon génie de la cité, Aristide, que le peuple, assemblé au théâtre, salua du nom de juste, et qui retenait, par sa modération, Thémistocle et les Athéniens. Thémistocle, après la guerre, proposait une résolution importante qui exigeait le secret. Tout d’une voix l’assemblée chargea Aristide d’en prendre connaissance et de décider pour elle-même. Il déclara que le projet était très utile, mais très injuste, et le peuple, sans plus en savoir, le rejeta : il s’agissait, dit-on, de brûler tous les vaisseaux des alliés alors réunis au port de Pagase, ce qui eût fait d’Athènes la seule puissance maritime. Aristide avait combattu à Salamine ; à Platée, les Athéniens s’irritaient des continuels changements que les Lacédémoniens leur imposaient pour qu’ils fissent toujours tête aux Perses ; Aristide les calma : Toute place est bonne, dit-il, pour remplir fidèlement son devoir et mourir à son poste. Après le combat, ce fut encore le Juste qui apaisa la rivalité des deux peuples. Tels s’étaient donc montrés, sous leurs illustres chefs, les Athéniens courageux, intelligents, résolus à servir en tous lieux et de toutes façons, la cause commune. Sparte, au contraire, était restée dans l’ombre, bien que placée, da consentement unanime, au premier rang. Dans l’une et l’autre guerre, ses inconcevables lenteurs avaient laissé Athènes sans assistance. Elle avait donné le glorieux soldat des Thermopyles, Léonidas ; mais Eurybiade, qui reçut le prix du courage, ne méritait pas celui de la prudence ; et Pausanias, le vainqueur de Platée, qui avait peu fait pour la victoire, souilla bientôt son nom par une ambition coupable. Cependant tel était l’ascendant du vieux renom de Lacédémone, qu’Athènes, malgré ses services, ne trouvait partout que froideur ou envie. C’était une parvenue dont la gloire blessait. Thémistocle ne s’était pas laissé éblouir par les honneurs dont Sparte l’avait comblé, et peut-être lui valurent-ils, de la soupçonneuse démocratie qu’il servait, des défiances qui le retinrent loin des commandements dans la mémorable année de Mycale et de Platée. Il vit le danger et trouva le remède. Athènes était en ruines et les statues de ses dieux brisées : six siècles plus tard, Pausanias les vit encore noircies et calcinées par les flammes. Elle avait gardé ces débris informes pour n’oublier jamais l’injuste agression de celui qui devint l’ennemi héréditaire. En ce moment, il ne restait plus de la cité de Minerve que l’inexpugnable rempart dont parle le poète, de vaillantes poitrines. Thémistocle arracha au peuple une patriotique déclaration. Défense fait faite à chacun de relever sa maison, de toucher à ses propres ruines, avant que la ville eût été entourée d’une forte muraille. Le peuple entier se mit à l’œuvre; pour matériaux on prit tout : les pierres des tombeaux, les colonnes des temples, les statues des héros et des dieux. Le mur en allait plus vite et semblait devoir en être plus fort. Il fallait se hâter, car déjà des émissaires d’Égine
étaient accourus à Lacédémone pour dénoncer l’entreprise. Sparte envoya une
députation à Athènes Il convient,
disait-elle, de ne fortifier aucune ville en dehors
de l’isthme de Corinthe ; c’est préparer une citadelle pour les
barbares, un repaire d’où ils ne sortiront plus. La vraie forteresse de Quelque temps après, il excita encore leur dépit : ils voulaient exclure du conseil amphictyonique les peuples qui n’avaient pas combattu contre les Perses. Ce n’eût été qu’une bien faible punition pour leur lâche abandon. Mais Athènes avait intérêt à s’appuyer, contre la suprématie continentale de Sparte, sur les États secondaires, sur Argos, Thèbes et les Thessaliens. Thémistocle représenta que si l’on accueillait la proposition, où livrerait le tribunal suprême de la nation hellénique à deus ou trois cités : elle fut rejetée. Sparte n’oublia pas celui qui déjouait ainsi tous ses projets. Athènes était fortifiée ; il lui fallait nu port digne de sa puissance. Phalère était trop petit et peu sur. A. l’ouest de ce havre et à 40 stades de la ville, la côte présentait trois déchirures assez profondes pour abriter 400 vaisseaux. Depuis longtemps Thémistocle avait jeté les yeux sur ce point du littoral. Des travaux considérables y avaient hème été exécutés, il les reprit et enceignit le Pirée et Munychie d’un mur haut de 14 coudées (6m,47), long de 60 stades (11 kil.), assez large pour que deus chariots pussent y passer de front et formé d’énormes pierres équarries scellées avec des tenons de fer. Il restait à relier le Pirée à la ville par une autre muraille qui assurât les communications[4]. Thémistocle en conçut le projet ; Cimon et Périclès l’exécutèrent. Pour maintenir la suprématie maritime d’Athènes, il voulait que chaque année elle construisit 20 trirèmes ; et, pour accroître le nombre de ses habitants, il engagea ses concitoyens à promettre des immunités aux étrangers, surtout aux ouvriers qui viendraient s’établir dans la ville[5]. Ce dernier conseil, libéralement suivi, eut les plus heureuses conséquences. De toutes parts on accourut vers la cité, et Athènes trouvera dates sa population croissante les moyens d’envoyer au dehors de nombreuses colonies qui contribueront à sa prospérité. Après la victoire de Mycale, les vainqueurs avaient tenu conseil pour décider du sort des ioniens. Les Spartiates, déclarant qu’on ne pouvait protéger des villes assises sur le continent asiatique, demandaient aux Ioniens d’abandonner leurs cités et de s’établir sur les terres des peuples grecs qui n’avaient pas combattu pour la liberté. Détruire Milet, Phocée, Smyrne, Halicarnasse, c’était rendre l’Asie à la barbarie. Mais Sparte s’en inquiétait peu. Athènes répondit que personne n’avait rien à voir aux affaires de ses colonies, et elle laissa pour le montent les Ioniens s’accommoder comme ils pourraient avec les Perses, en attendant qu’elle fût assez farte pour les délivrer. Chios, Lesbos, Samos et la plupart des cités insulaires furent déclarées membres du corps hellénique. La victoire de Mycale donnait aux Grecs la mer figée, mais
l’ennemi possédait encore Ainsi, avant même qu’Athènes fût sortie de ses ruines, sa flotte reconstruisait son empire maritime. Dès l’année suivante, les hardis marins reprirent la mer. Aux 30 vaisseaux d’Athènes commandés par Aristide et par Cimon, fils de Miltiade, se joignirent 20 galères du Péloponnèse, et la flotte, sous le commandement de Pausanias, fit voile vers Chypre, chassa les Perses de la plus grande partie de file, puis remonta vers l’Hellespont, et s’empara de Byzance, où furent pris plusieurs nobles perses et beaucoup de richesses. Pausanias n’avait pu supporter sa fortune et sa gloire. Il
ne comprenait pas que le vainqueur des Perses restât un simple roi de Sparte,
étroitement surveillé et contenu par les éphores. La dîme du butin de Platée
n’avait fait qu’allumer sa soif de richesses. Ses captifs l’initiaient aux
mœurs de la cour de Suse ; ils lui contaient comment vivaient les
grands, leur mollesse, leurs plaisirs, leur pouvoir sur tout ce qui était
au-dessous d’eux ; et ce séduisant tableau, mis en regard des lois
sévères de Sparte, acheva de troubler cette faible et vaniteuse intelligence.
Parmi ces captifs était un Érétrien qui, pour une trahison inutile, avait
reçu de Darius quatre villes considérables de l’Éolide. Que ne donnerait donc
pas le grand roi à qui lui livrerait C’était en effet une révolution. Sparte eut beau rappeler Pausanias en toute hâte et lui substituer un autre amiral, les alliés persistèrent dans leur résolution. La suprématie maritime passait de Sparte à Athènes ; le corps hellénique se divisait, la nation avait deux têtes. Division heureuse, parce qu’elle est suivant la nature des choses. Mais n’en sortira-t-il pas quelque jour une guerre terrible ? Sparte déjà on parle de recourir aux armes pour conserver ce commandement suprême qu’Athènes elle-même avait maintes fois reconnu aux Spartiates. Mais, au même temps, le second roi Léotychidas, le vainqueur de Mycale, envoyé en Thessalie pour en chasser les Aleuades et les autres alliés de Xerxès, s’était laissé acheter à prix d’argent. Les vieillards s’effrayèrent de cette corruption qui pénétrait par toutes les voies dans la cité de Lycurgue, et un sénateur montra, en citant l’exemple de Pausanias, le danger pour Sparte d’envoyer ses guerriers si loin, au milieu des barbares et des tentations de l’Asie. Sparte n’aura pas toujours cette sagesse. Aristide était pour beaucoup dans la résolution des
alliés. Reprenant l’idée qu’il avait eue à Platée d’une ligue permanente
contre l’ennemi commun, il la fit cette fois accepter. D’un consentement
unanime, il fut chargé de rédiger les stipulations de l’alliance et de régler
les obligations des confédérés. Il fut convenu que les Grecs d’Asie et des
îles formeraient une ligue dont les intérêts seraient discutés par une
assemblée générale; qu’Athènes aurait la direction des opérations militaires,
mais que chaque cité conserverait une complète indépendance dans son
gouvernement intérieur ; qu’elle n’aurait à fournir pour la cause
commune que les hommes, les vaisseaux ou l’argent, suivant le tableau approuvé
par la diète. Ce tableau fut dressé par l’homme qui n’était plus seulement le
juste d’Athènes, mais celui de toute Délos avait été de tout temps le sanctuaire de la race ionienne, qui, comme les Doriens, avait pris Apollon pour sa grande divinité. Thucydide (II, 104) montre le concours antique des Ioniens dans cette île, leurs fêtes, leurs jeux, les combats des musiciens et des athlètes, sous les yeux des théories envoyées par toutes les cités. Ô Phœbus ! dit un vieil Homéride, tu chéris surtout Délos, où se rassemblent, avec leurs enfants et leurs chastes épouses, les Ioniens aux robes traînantes. Athènes, qui s’efforça de rendre à ces fêtes leur ancienne splendeur, fit de l’île sainte le centre de la confédération. C’est aux solennités du dieu que les députés se réunirent, c’est dans le trésor de son temple que la contribution commune fut déposée. La protection du dieu couvrait l’alliance et li sanctifiait. Aristide fut élu gardien de ce trésor, et il l’administra avec une telle probité, qu’après lui il sembla aux alliés qu’ils ne pouvaient en confier la garde à d’autres mains qu’à celles d’un athénien. Sa vertu fut utile à sa patrie, même après sa mort. II. Développement des institutions démocratiques à Athènes ; Aristide, Thémistocle et PausaniasOn dit que Thémistocle avait déplacé la tribune aux
harangues, pour que les orateurs pussent de là montrer sans cesse au peuple
la mer qui s’étendait à ses pieds comme son domaine. C’était de ce côté qu’il
:hait tourné son attention et ses forces. Il avait réussi : Athènes avait
maintenant une flotte de guerre, une flotte marchande et une population
nombreuse de négociants et d’industriels ; mais il avait donné une telle
importance au Pirée, que, suivant l’expression d’Aristophane, il avait mêlé et
confondu la ville et le port, celui-ci dominant celle-là, car lorsque la
foule des marins accourait à l’agora elle y assurait la prépondérance à
l’élément populaire. Aristide, plus réservé, tenant plus de compte des
vieilles familles et des intérêts des propriétaires fonciers, inclina
cependant, à la fils de sa vie dans le même sens, en rendant toutes les charges
publiques, même celle d’archonte, accessibles à tous les citoyens. C’était la
suppression des privilèges reconnus à la propriété foncière et une nouvelle
atteinte à la constitution de Solon. Mais cette constitution, qui datait de
plus d’un siècle, ne pouvait rester immuable quand, autour d’elle, tout
changeait. Si Solon eût vécu au temps d’Aristide, il eût fait ce que le sage
venait de faire. Pourquoi quelques champs d’oliviers dans l’Attique, ou des
terres en Thrace, eussent-ils donné le droit de commandement sur ces vingt
mille citoyens qui eux-mêmes commandaient à une partie de Ainsi les guerres Médiques avaient décidément assuré à Athènes ce gouvernement démocratique qu’Hérodote ne cesse d’admirer. C’est le plus beau nom, dit-il, car il s’appelle l’égalité. La délibération y appartient à tous, l’action à quelques-uns, aux magistrats; et ceux-là sont responsables de leurs actes[7]. Un fait qui n’a pas été assez remarqué, et qui réduit à néant bien des accusations banales, est celui que Strabon atteste (VII, 3, 2). Après la guerre Médique, dit-il, ce fut la tendance générale en Grèce de réunir des bourgades séparées en une seule cité. Élis, Thèbes, Argos, Mantinée, Phigalie, détruisirent les bourgs ou villes de leur voisinage, et obligèrent les habitants à résider dans la capitale. Ce changement amena presque partout où il eut lieu une révolution politique. La direction des affaires communes, jusqu’alors abandonnée à un petit nombre de citoyens établis dans la ville forteresse, tomba aux mains du peuple, devenu l’hôte habituel de l’agora, et le gouvernement démocratique prévalut à Argos, à Mantinée, comme à Athènes, dont ces deux villes devinrent les alliées et les points d’appui dans le Péloponnèse contre l’aristocratique Lacédémone. Mais Athènes avait encore des eupatrides, et son commerce va lui donner de nouveaux riches; les uns et Ies autres formeront une seconde noblesse qui disputera l’influence aux orateurs du peuple et contiendra longtemps cette démocratie dans les voies glorieuses où la conduiront Cimon et Périclès. Dans toute société qui vit, c’est-à-dire qui se développe, il faut un frein qui empêche le mouvement de se précipiter, comme il en faut un à l’homme pour contenir ses emportements. Ce frein, Athènes l’eut pendant quelques générations, Rome durant des siècles. La grandeur de l’une et de l’autre république fut au prix de cette lutte de la faction aristocratique et de la faction populaire, la première modérant la seconde, mais aucune assez forte pour étouffer sa rivale et aller se perdre dans ses propres excès. Depuis qu’Hérodote a terminé son histoire au siège de
Sestos, nous sommes sans guide, et les faits nous manquent pour remplir les
derniers jours d’Aristide et de Thémistocle. Nous ne savons même avec
certitude ni l’époque, ni le lieu, ni les circonstances de leur mort. Notre
ignorance est grande, surtout en ce qui concerne Aristide. On sait seulement
qu’il était si pauvre, après avoir administré longtemps les plus riches
finances de Thémistocle fut moins heureux. Il eut le tort de rappeler
trop souvent à ses concitoyens qu’il les avait sauvés : le temple qu’il éleva
à la déesse du Bon-Conseil, et où il nuit sa statue, semblait vouloir
éterniser le reproche. Ses rapines lui suscitaient aussi des ennemis. Il
était entré aux affaires avec 3 talents ; une partie seulement de ses
biens, celle que ses amis ne purent soustraire é la confiscation et lui faire
passer en Asie, rapporta au trésor 80, selon d’autres, 100 talents. Il
n’estimait pas que la probité dans les affaires publiques fût quelque chose
de plus que la vertu du coffre-fort qui rend fidèlement ce qu’on lui a
confié ; en un jour qu’il parlait des qualités d’un général, il s’attira
cette réplique sanglante d’Aristide : Tu en oublies
une, c’est d’avoir les mains pures. Thémistocle ne les avait pas.
Plutarque nous a conservé quelques vers du Rhodien Timocréon, qui vécut
longtemps à Athènes, où il fut l’hôte et quelque temps l’ami de Thémistocle.
Il l’accuse de l’avoir trahi ; nous ne pouvons vérifier le fait, mais la
poésie vengeresse subsiste. Loue, si tu veux,
Pausanias, Xanthippe et Léotychidas, moi je loue Aristide, l’homme le plus
vertueux qui soit né dans Athènes la grande. Quant à Thémistocle, ce menteur,
ce traître, Latone le déteste. Il s’est laissé corrompre par un vil argent,
et il a refusé de ramener Timocréon dans Ialysos sa patrie. Pour 3 talents,
il a rappelé ceux-ci d’exil, banni ceux-là et en a mis d’autres à mort. Repu
d’or, il étale insolemment sa richesse aux jeux que Les bruits qui couraient sur le vainqueur de Salamine finirent par trouver de l’écho dans la foule, et par susciter un orage contre Thémistocle ; il souffrit la peine qu’il avait infligée à Aristide : il fut condamné à un exil de dix ans. Comme un platane au large feuillage, disait-il, sous lequel on cherche abri pendant l’orage et dont on coupe les branches dès que le beau temps revient, je vois les Athéniens courir à moi quand le danger les presse, et me chasser dès que la paix revient. Il se retira à Argos, qui fit bon accueil à l’ennemi de Sparte (470). Sa prétendue complicité avec Pausanias le força plus tard de fuir chez les Perses. Rappelé, comme on l’a vu, à Lacédémone, Pausanias s’en
était échappé au bout de quelque temps, et était retourne à Byzance, pour
traiter de plus près avec l’agent de Xerxès, Artabaze, satrape de Bithynie.
Il fut encore rappelé. Comptant sur ses trésors, il osa revenir, car il
savait que la vieille vertu de Sparte était bien ébranlée. La vénalité, ce
mal que les Perses inoculèrent à Pausanias avait fait quelques ouvertures à Thémistocle. L’Athénien était trop habile pour se lier avec un tel insensé. Mais des traces de ces rapports furent découvertes, et les Spartiates se hâtèrent d’accuser, à Athènes, Thémistocle de trahison. Il s’enfuit d’Argos à Corcyre, qui lui devait la possession de Leucade, et de là en Épire, auprès d’Admète, roi des Molosses (466). Il avait jadis offensé ce prince, et il redoutait sa colère. Admète était absent. À son retour, il trouva Thémistocle assis à son foyer. L’exilé tenait dans ses bras un des enfants du roi, qui suppliait pour lui. Admète, oubliant sa haine, refusa de livrer le fugitif et, quelque temps après, lui donna les moyens d’atteindre Pydna, en Macédoine, où il s’embarqua pour l’Ionie. Poussé par les vents au voisinage de la flotte athénienne stationnée à Naxos, il se nomma au capitaine du navire, qui voulait y chercher un refuge, et obtint, par prières et promesses, que malgré la tempête on restât au large. Arrivé en Asie, il se rendit hardiment à la cour de Suse, où Xerxès menait de mourir (465). Quand l’Athénien parut devant son successeur : Je suis Thémistocle, dit-il, celui des Grecs qui t’a fait le plus de mal, mais aussi celui qui vient aujourd’hui te faire le plus de bien. Il invoqua le prétendu service qu’il avait rendu à Xerxès en l’engageant à fuir précipitamment, après Salamine, et demanda une année pour apprendre la langue des Perses, afin de pouvoir dévoiler ses plans sans recourir à un interprète. Artaxerxés, admirant son génie et son audace, l’accueillit avec faveur et lui donna trois villes de l’Asie Mineure : une, Magnésie du Méandre pour le pain, une autre pour la viande, la troisième pour le vin[9]. Divers récits coururent sur sa mort. On dit que, pressé d’exécuter ses promesses, il s’empoisonna pour n’être pas réduit à porter les armes contre sa patrie. Cette fin ferait oublier ses fautes, et cette expiation volontaire rendrait sa gloire plus pure; mais au récit de Diodore il convient de préférer celui de Thucydide, qui le fait mourir de maladie. Ses ossements furent, dit-on, secrètement rapportés à Athènes. On montrait, au Pirée, son tombeau, qui n’était peut-être qu’un cénotaphe. La grande guerre est finie. Les hommes de l’époque héroïque viennent de disparaître. D’autres temps commencent. Bientôt les fils des vainqueurs de Platée et des Thermopyles ne craindront pas de prendre pour une guerre fratricide les armes de leurs pères, chaudes encore du sang des barbares. Deux vieilles et glorieuses cités disparurent aussi en ce temps-là. Mycènes et Tirynthe furent détruites par les Argiens ; il ne resta d’elles que les souvenirs homériques, des ruines imposantes[10] et quelques objets curieux trouvés dans les fouilles récentes. III. CimonCimon, fils de Miltiade, appartient, par ses exploits et sa politique à la première époque, celle des héros de la guerre d’indépendance. Il n’avait ni l’éloquence ni aucun de ces talents qui donnaient à Athènes la popularité. Sa vie était peu régulière, mais on l’aimait pour son caractère décidé et bienveillant. La vivacité avec laquelle il avait appuyé Thémistocle au moment de l’invasion perse et la valeur déployée par lui à Salamine l’avaient rendu célèbre ; aussi, lorsque Aristide, pour maintenir l’équilibre des partis, le poussa sur la. scène politique et l’opposa à l’influence trop démocratique de Thémistocle, il fut accueilli avec faveur. Il parait avoir contribué au décret qui bannit le vainqueur de Salamine. Plutarque l’accuse même d’avoir fait condamner à mort l’homme qui amena secrètement à Thémistocle exilé sa femme et ses enfants. Que la honte de toutes ces ingratitudes retombe moins sur le peuple d’Athènes que sur ses chefs qui lui représentent tour à tour, et par les mêmes raisons, la condamnation ou l’exil de ses plus grands citoyens comme nécessaire à son repos ou à sa liberté ! Aujourd’hui, les partis politiques se repoussent du pouvoir dans l’opposition ; à Athènes, ils se repoussaient du pouvoir dans l’exil. Le défaut d’éloquence interdisait à Cimon les succès de la
place publique. Il en chercha d’autres dans le vaste champ ouvert aux
Athéniens sur la mer, et saisit l’occasion de servir à la fois la cause
nationale de tous les Grecs et les intérêts particuliers de sa patrie. En
476, il débuta par deux expéditions très populaires. En Thrace, il enleva
Éion, dont le commandant, le Perse Bogès, plutôt que de se rendre, mit le feu
à la ville et périt dans les flammes avec sa femme, ses enfants, ses esclaves
et ses trésors. Par la prise d’Éion, Cimon donnait à sa patrie des terres,
qu’on put distribuer aux citoyens pauvres, et une importante position
militaire aux bouches du Strymon. Par la conquête de l’île de Seyros, il
purgea la mer de pirates que le conseil amphictyonique venait de mettre au
ban de Le Théséion, long de Ainsi Athènes poursuivait glorieusement la lutte contre les Perses et assurait la sécurité de la mer. La conscience de ses services la rendit dure vis-à-vis des alliés qui tardaient à livrer leur contribution ou leur contingent de guerre. Deux villes furent rudement châtiées : Carystos, en Eubée, et la riche Naxos furent toutes deux prises après un long siège et restèrent sujettes d’Athènes (467). Cet événement était grave : il annonçait qu’Athènes, usant d’un droit légitime, ne permettrait pas à une ville alliée de se retirer de la confédération, ni à un membre de la ligue de se soustraire aux obligations communes, en profitant de la sécurité acquise aux dépens de tous. C’était justice. Les alliés eux-mêmes l’avaient compris, et Athènes n’avait fait, dans cette guerre, qu’exécuter les ordres de la diète de Délos. La seule réclamation que les alliés fissent entendre alors était la demande de remplacer par une augmentation du tribut les secours d’hommes et de vaisseaux qu’ils avaient fournis jusque-là. Cimon s’empressa d’accepter un changement qui, en désarmant les alliés, devait donner à sa patrie la suprématie maritime. Au reste, ce n’était pas une royauté fainéante que celle
d’Athènes. L’année même de la prise de Naxos, et comme pour effacer le
souvenir de ce triste succès, Cimon arma deux cents galères athéniennes ;
les alliés en donnèrent cent, et avec cette flotte il fit voile vers Ce grand succès enhardit Cimon à reprendre ses projets sur
A la nouvelle de ce désastre, les hilotes et les Messéniens soulevés marchèrent sur Lacédémone. Le roi Archidamos avait prévu ce mouvement et réuni en toute hâte les citoyens en armes. Sa ferme attitude sauva la fortune de l’État sur les ruines mêmes de la ville. Les hilotes tremblants d’avoir un jour regardé leurs maîtres en face, se dispersèrent. Les plus braves d’entre eux suivirent les Messéniens sur le mont Ithôme, où ils se retranchèrent, et une troisième guerre de Messénie commença (464). Elle dura dix années, non sans gloire pour les rebelles, car plus d’un lieu illustré jadis par Aristomène reçut une nouvelle consécration. Un jour ils défirent, aux champs de Stényclaros, un corps de Spartiates, qui laissa trois cents morts sur la place, et parmi eux cet Alimnestos qui avait tué Mardonius à Platée. Les Thadens étaient donc abandonnés à eux-mêmes ; il fallut se rendre et accepter de dures conditions : démanteler leur ville, livrer leurs vaisseaux, leurs mines d’or de Scapté-Hylé (le Bois Creux), leurs possessions sur le continent, payer une forte amende et un tribut annuel (463). Comme butin de victoire, Cimon ramena dans Athènes un grand peintre, Polygnote. Durant cette guerre, les colons athéniens des Neuf-Voies, surpris par les Thraces dans une expédition à l’intérieur du pays, avaient été exterminés. Cimon reçut commission de les venger. Les moyens sans doute lui manquèrent, car il ne donna pas satisfaction à l’honneur national. Le peuple en montra un vif mécontentement ; et Cimon, accusé de s’être laissé acheter par le roi de Macédoine, auquel il ne plaisait pas d’avoir les athéniens pour voisins, fut, selon les uns acquitté, selon les autres condamné à une amende de 50 talents. Il ne s’était pas reposé sur ses victoires du soin de sa popularité. Son patrimoine et ses richesses, glorieusement conquises, semblaient être moins à lui qu’à ses concitoyens. Il les employait à orner d’arbres et de statues les places de la ville, à construire un des remparts de la citadelle et une partie des longs murs projetés par Thémistocle. Il fit abattre la clôture de ses jardins pour les livrer au public ; chaque jour il tenait table ouverte pour les citoyens de son dème, et jamais il ne sortait sans être suivi d’un esclave, qui distribuait aux pauvres honteux de l’argent et des vêtements. Tout cela par humanité, sans doute, mais aussi dans l’intérêt du parti dont il était le chef. La popularité cependant lui échappait. Les pauvres
comprenaient que ces largesses intéressées étaient la rançon des honneurs
dont par leurs votes, ils le comblaient. On se souvenait de Pisistrate
distribuant aussi le produit de ses jardins au peuple, et on écoutait plus
volontiers un nouvel orateur qui déclarait que l’État était assez riche pour
ne pas laisser à un particulier le soin de nourrir ses pauvres. Ce nouveau venu
était Périclès, le vengeur de Thémistocle, l’exécuteur de ses projets, mais
plus grand que lui parce qu’il se respecta toujours. Cimon, l’allié des
Spartiates dans le procès de Thémistocle, l’admirateur de leurs vertus
guerrières et de leur forte discipline, au point de donner à un de ses
enfants le nom de Lacédémonios[11], oublia
qu’Athènes était trop grande maintenant pour aimer à entendre sans cesse
l’éloge d’une rivale, qui an fond était une ennemie. Depuis vingt ans Sparte
faisait à Athènes, en toute circonstance, une opposition haineuse. Elle avait
voulu l’empêcher de reconstruire ses murailles; dans son irritation d’avoir
perdu le commandement de la flotte et de voir que, sans elle, il s’était
formé une ligue puissante dont Athènes était à la fois la tête et le bras,
elle venait de promettre aux Thasiens son alliance et, pour sauver ce peuple,
elle avait médité une invasion dans l’Attique. La concorde établie naguère
par Aristide et le serment prêté sur le tombeau des glorieux morts de Platée
n’existaient donc plus ; la faute en était à ceux qui prétendaient faire
reconnaître de Les Athéniens furent peu touchés de cette nécessité d’avoir nu contrepoids. Laissez-la ensevelie sous ses ruines, s’écria Éphialte, et foulez aux pieds l’orgueil de Lacédémone. Pourtant les sentiments d’honneur et de magnanimité l’emportèrent : Cimon fut envoyé avec une nombreuse armée devant Ithôme. Le siège ne paraissant pas en aller plus vite, les Spartiates crurent à quelque trahison, et, tout en gardant leurs autres alliés, ils congédièrent les Athéniens, sous prétexte qu’ils n’avaient plus besoin de leur assistance (461). C’était un affront sanglant. Athènes y répondit par une alliance avec Argos, qui venait de profiter des embarras de Sparte pour assouvir sa haine séculaire contre Mycènes[12]. Les Thessaliens entrèrent dans la même ligue, et, à quelque temps de là, Mégare, par opposition à Corinthe, admit une garnison athénienne dans ses murs et dans son port de Pagées, sur le golfe Corinthien. Les Athéniens occupèrent aussi l’autre port, Nisée, sur le golfe Saronique, qu’ils rattachèrent à Mégare, comme le Pirée l’était à Athènes, par deux murs longs de 8 stades dont ils eurent la garde.
Ces événements étaient autant d’échecs pour l’ami de Sparte, et Cimon irrita encore le mécontentement populaire en combattant une mesure qui devait compléter celles d’Aristide. Le Juste avait ouvert les charges aux plus pauvres citoyens, par conséquent aussi l’aréopage; mais l’aristocratie, cantonnée dans ce conseil suprême, en faisait un foyer d’opposition au gouvernement. Un ami de Périclès, Éphialte, homme qui avait, avec une fougueuse éloquence, la pauvreté et la vertu d’Aristide, proposa d’ôter à ce tribunal vénéré la plus grande partie des causes dont la connaissance lui appartenait, celles sans doute qu’il jugeait en vertu du pouvoir censorial que Solon lui avait reconnu. Composé de membres à vie et irresponsables, l’aréopage était essentiellement, dans la constitution athénienne, l’élément conservateur, l’obstacle aux nouveautés[13]. En vain Eschyle, qui était un eupatride, plaida pour l’aréopage, en faisant jouer sa tragédie des Euménides, où il montrait Minerve fondant elle-même le tribunal, gardien incorruptible de la justice et des lois[14] : la proposition passa. Les aréopagites n’eurent donc plus à connaître que des causes de meurtre prémédité, φόνος έx προνοίας, des cas d’incendie et d’empoisonnement. Les peines étaient la mort et la confiscation des biens (460). Cimon, dit Plutarque, ne put retenir son indignation de voir la dignité de l’aréopage avilie. Il fit tous ses efforts pour le remettre en possession des jugements, et rétablir le gouvernement aristocratique. Jusqu’où ces efforts allèrent-ils ? On ne le sait. Le peuple les arrêta par l’ostracisme ; Cimon fut banni (459). Eschyle, qui l’avait soutenu, craignit un sort pareil. Il avait déjà été traduit devant l’aréopage sous l’inculpation d’avoir dévoilé au théâtre des mystères dont la connaissance était interdite aux profanes, et allait être condamné, quand son frère (?) Amynias, relevant son manteau, montra son bras mutilé à Salamine et demanda aux juges pour récompense la vie du poète. Cette fois Eschyle s’exila lui-même et se retira en Sicile, où il était déjà allé au temps du roi Hiéron, vers 476[15]. L’aréopage avait été clans l’État le pouvoir modérateur
avec un droit de veto contre toute mesure qui lui paraissait téméraire ou
dangereuse. Pour conserver à la république cette garantie que la réforme lui
ôtait, il fut décidé que sept gardiens des lois, nomophylaques, choisis
au sort chaque année parmi les citoyens, pourraient s’opposer aux propositions
contraires à la constitution. Ils conservaient les décrets du peuple dans le
sanctuaire de IV. Guerres intestines en GrèceLes troubles intérieurs n’avaient pas ralenti les efforts d’Athènes pour étendre ou consolider sa puissance; jamais elle n’avait déployé une activité plus grande. Nous avons une inscription dans laquelle la tribu d’Érechthée célèbre, avec la magnifique simplicité de ce temps, ses guerriers morts en une même année aux rivages de Chypre, de Phénicie et d’Égypte, à Haliées dans l’Argolide, devant Égine et Mégare. Athènes s’était proposé d’expulser les Perses des îles et
des côtes de Mais ceux-ci, victorieux au loin, voyaient du haut du Parthénon, par-delà Salamine, des îles et des rivages habités par des ennemis, de sorte qu’il leur fallait garder au Pirée une partie de leur flotte pour parer à quelque entreprise imprévue tentée par leurs adversaires. C’était d’une sage prévoyance, car pendant qu’ils avaient 200 galères et une adnée en Égypte, une guerre éclata à leurs portes. Contre Mégare, leur alliée, qui pouvait fermer aux Spartiates la sortie de l’isthme et l’accès de l’Attique, Corinthe, Égine et Épidaure armèrent des troupes et des vaisseaux. Repoussés dans une descente sur le territoire d’Épidaure, les Athéniens furent plus heureux clans une bataille navale : ils défirent la flotte alliée, qui perdit 70 galères, et assiégèrent Égine, leur mortelle ennemie : elle avait fait cette loi : Tout Athénien surpris sur le territoire d’Égine sera mis à mort sans jugement ou vendu comme esclave[17]. Pour sauver cette place, les Corinthiens marchèrent sur Mégare. Il ne restait à Athènes que des enfants et des vieillards ; Myronidès en tira pourtant une armée, sans affaiblir d’un soldat le corps qui opérait contre les Éginètes, lutta deux fois contre l’ennemi dans les gorges de l’isthme et lui infligea un sanglant désastre (458). Le siège d’Égine dura neuf mois ; la ville fut démantelée ; les habitants livrèrent ce qui leur restait de vaisseaux et promirent un tribut. Ainsi En 457, les Spartiates se crurent en état de faire une
incursion dans En l’année 456, une flotte, sous le commandement de Tolmidès, alla brûler Gythion, le port de Sparte, insulter Corinthe jusque dans son golfe, battre les Sicyoniens et enlever Naupacte. La guerre de Messénie finissait alors. Les défenseurs d’Ithôme avaient obtenu de sortir librement du Péloponnèse ; Athènes les accueillit et leur donna Naupacte, qu’elle venait de prendre. C’est de là que leurs ancêtres étaient partis pour faire la conquête de la presqu’île ; ils pouvaient y rêver le même avenir. Ces succès rendirent moins douloureux les désastres éprouvés en Égypte, où l’armée expéditionnaire et une escadre de 50 galères envoyée à son secours avaient été détruites. Mais une tentative pour rétablir un chef thessalien et punir la trahison de la cavalerie thessalienne à Tanagra n’eut point de succès ; une expédition en Acarnanie, conduite par Périclès, ne réussit pas mieux (454). On se souvint alors du chef à qui la victoire n’avait jamais été infidèle. Cimon fut rappelé, sur la proposition de Périclès. Sa noble conduite et celle de ses amis à Tanagra avaient montré qu’il ne fallait pas le comprendre dans la faction qui intriguait avec l’ennemi, comme, à Marathon, à Platée, elle avait intrigué avec les Perses, et qui venait de faire assassiner le vertueux Éphialte. Il était tombé sans doute pour le même crime que lui reproche Platon : pour avoir mutilé l’aréopage et fait boire à longs traits aux Athéniens la coupe de la liberté. Plutarque, un ennemi cependant des démocrates, nous dit mieux quel fut le crime de cet ami de Périclès : Il s’était rendu redoutable aux grands par son inflexibilité à poursuivre les concussionnaires et tous ceux qui avaient commis quelque injustice. Les temps qui suivirent sont mal connus. La guerre languit des deux côtés ; on négocia longtemps pour la paix, et Cimon ne parvint à ménager qu’une trêve de cinq ans (451). Ce dernier service rendu à sa patrie, il fit voile vers Cypre avec 200 galères et assiégea Kition, comptant de là passer en Égypte. Il mourut devant cette place, d’une maladie ou d’une blessure (449). Ses compagnons lui firent les funérailles qu’il eût souhaitées. En rapportant ses restes à Athènes, ils tombèrent au milieu d’une grande flotte phénicienne et perse, qu’ils détruisirent en vue de Salamine en Chypre ; et, débarquant le même jour, ils dispersèrent une armée qui les avait attendus sur le rivage opposé. Cette double victoire fut le dernier acte des guerres Médiques. Athènes la termina par un traité où elle s’engageait à ne plus troubler le grand roi dans ses domaines et à ne donner aucun secours aux Égyptiens. Mais, de son côté, le roi renonçait à la possession des villes grecques du littoral asiatique, c’est-à-dire les laissait dans la clientèle d’Athènes, et, reconnaissant la mer Égée pour une mer grecque, s’ôtait le droit d’envoyer un vaisseau de guerre au delà des îles Chélidoniennes, sur les côtes de Lycie, et au delà des roches Cyanées à l’entrée du Bosphore de Thrace[21]. Athènes renonçait à la guerre médique ; c’est que
déjà les nuages s’amoncelaient sur Les Delphiens, alliés de Lacédémone, avaient l’intendance
du temple d’Apollon ; les Phocidiens, alliés d’Athènes, la leur
enlevèrent. Une armée spartiate la rendit aux premiers ; une armée
athénienne conduite par Périclès la reprit pour les seconds (448). Ces
promenades militaires des deux peuples dominateurs à travers Elle était commandée par le jeune roi Plistoanax, que les éphores avaient placé sous la direction de Cléandridas. Celui-ci se laissa acheter par Périclès et ramena les troupes sans avoir combattu. Accusé de trahison, il fût condamné à mort, mais réussit à s’enfuir à Thurion ; Plistoanax, frappé d’une lourde amende qu’il ne put payer, perdit ses droits de citoyen et se réfugia en Arcadie. En rendant ses comptes au peuple, Périclès porta une somme de 10 talents sous le titre de dépenses nécessaires. Le peuple comprit et ratifia. Cette dépense resta inscrite au budget annuel d’Athènes. Le soupçonneux peuple en abandonna, les yeux fermés, l’emploi à Périclès, qui les envoyait à Sparte pour y acheter les voix à vendre. C’étaient ses frais de police secrète. Cependant cette guerre finit mal. Par le traité de 445,
qui établit une trêve de trente ans entre Sparte et Athènes, celle-ci
abandonna les deux ports de Mégare, qu’elle ne pouvait plus garder depuis le
soulèvement de cette ville, Trézène et les points qu’elle occupait dans
l’Achaïe sur le golfe de Corinthe. Ce traité fut-il une concession arrachée
par la faction aristocratique? On le croirait, en voyant son chef, Thucydide,
banni l’année suivante par l’ostracisme et se réfugiant à Sparte ; à
moins qu’on ne préfère y trouver un acte de haute prudence de Périclès, qui,
depuis la chute de l’influence athénienne en Béotie, aurait compris qu’il
n’était pas bon pour Athènes de chercher des agrandissements dans |