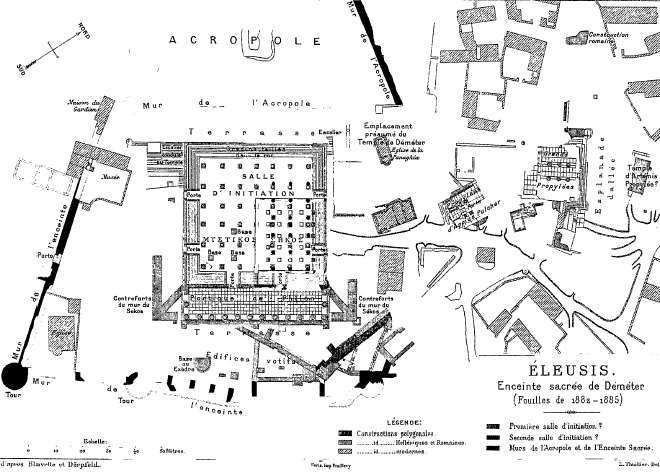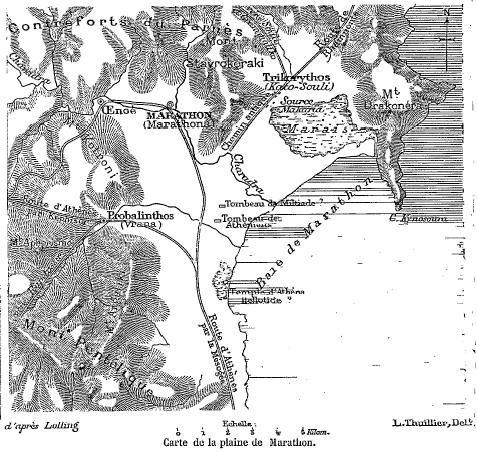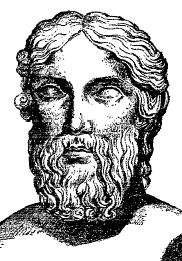HISTOIRE DES GRECS
TROISIÈME PÉRIODE — LES GUERRES MÉDIQUES (492-479) — UNION ET VICTOIRES.
Chapitre XVI — Première guerre médique (492-490).
I. Révolte de l’IonieHérodote, qui naquit au milieu des guerres Médiques, en
484, étonné de ce grand choc du monde grec et du monde barbare, en chercha
les causes par delà la guerre de Troie, jusqu’aux temps mythologiques. Il n’est
pas nécessaire de remonter si haut, ni de rappeler Io et Hélène ravies par
des Asiatiques, Europe et Médée enlevées par des Grecs, pour expliquer la
haine de deus mondes. La fuite du médecin Démocédès, qui trompa Darius afin
de revoir Crotone sa patrie, et le désir de la reine Atossa d’avoir parmi ses
esclaves des femmes de Sparte et d’Athènes ne sont que de puérils incidents.
Ires instances d’Hippias pour être rétabli dans Athènes, celles des Aleuades
de Thessalie pour être délivrés d’adversaires qui les gênaient, eurent une
influence plus sérieuse. Niais la vraie cause fut la puissance même de Mégabaze soumit Périnthe, les Thraces qui résistaient
encore, Quelques années s’étaient écoulées dans une paix profonde,
quand une petite affaire et un homme obscur mirent tout en feu. Naxos la plus
grande des Cyclades, était alors puissante; elle commandait à plusieurs îles,
possédait une marine considérable et pouvait mettre sur pied huit mille
hoplites. Malheureusement Naxos avait, comme tout État grec, deux partis,
celui du peuple et celui des riches. Ceux-ci se perdirent par un de ces
attentats qu’on ne pardonne point, comme celui dont Lucrèce fut victime à Rome,
vers le même temps. Chassés de l’île, ils proposèrent à Aristagoras, gendre d’Histiée,
et en son absence tyran de Milet, de les ramener à Naxos. Il accueillit avec
ardeur ce projet, et déjà il voyait les Cyclades, peut-être l’Eubée soumises
à son autorité. Mais il ne pouvait accomplir seul une telle entreprise ;
il sut y intéresser le satrape de Sardes, Artaphernès, qui mit à sa
disposition une flotte de deus cents voiles, commandée par le Perse Mégabaze.
Celui-ci s’indigna bientôt d’être sous les ordres d’un Grec : une querelle s’éleva
entre eux, et Mégabaze, pour se venger d’une humiliation, avertit les
Naxiens. Le succès de l’expédition dépendait du secret : une fois éventé, elle
échouait. Aristagoras s’y opiniâtra quatre mois, y dépensa tous ses trésors
et ceux que le roi avait donnés pour l’entreprise. Il craignit d’être obligé
d’en rembourser les frais. Les chances d’une révolte lui parurent meilleures
et de secrets encouragements d’Histiée le décidèrent. L’armée qu’il avait
conduite devant Naxos était encore réunie, tous les tyrans des villes de la côte
asiatique s’y trouvaient ; il se saisit d’eux, les rendit aux cités qu’ils
gouvernaient et qui les bannirent ou les tuèrent, et rétablit partout la
démocratie (499).
Mais, après ce coup, il fallait s’attacher quelque allié puissant.
Aristagoras se rendit à Lacédémone. Le roi Cléomène lui demanda combien il y
avait de chemin entre la mer et la capitale des Perses : Trois mois de marche, répondit-il. — Alors, répliqua le Spartiate, vous sortirez dès demain de cette ville. Il est insensé de
proposer aux Lacédémoniens de s’éloignera trois mois de marche de la mer.
Aristagoras essaya d’acheter son consentement. Cette fois la vertu spartiate
fut incorruptible, et l’Ionien passa à Athènes. Introduit dans l’assemblée,
il parla des richesses de Les Ioniens continuèrent la lutte ; ils entraînèrent
dans leur mouvement toutes les villes de l’Hellespont et de Il y avait sur la flotte grecque un homme habile, qui eût sauvé l’Ionie si elle eût voulu l’être. C’était un Phocéen nommé Dionysios : il fit comprendre aux alliés qu’une discipline rigoureuse et une grande habitude des manoeuvres leur assureraient le succès, et pendant sept jours il exerça les équipages à tous les mouvements d’un combat naval : mais, au bout de ce temps, les Ioniens efféminés se lassèrent : ils descendirent à terre, y dressèrent des tentes et oublièrent l’ennemi. Comme, à ce régime, les âmes se relâchent, la trahison bientôt se glissa parmi eux. Quand le jour de la bataille arriva, les Samiens au fort de l’action quittèrent leur poste et firent route pour leur île. Les Ioniens furent vaincus, malgré le courage héroïque des marins de Chios, malgré celui de Dionysios, qui prit trois galères ennemies. Quand il vit la bataille perdue, il se porta audacieusement jusqu’en face de Tyr, coula à fond plusieurs vaisseaux marchands et se retira avec son butin en Sicile; il passa le reste de sa vie à poursuivre sur mer les navires phéniciens, carthaginois et tyrrhéniens. Tout espoir était perdu pour Milet : elle fut prise,
et ses habitants transportés à Ampée, à l’embouchure du Tigre (494). Chios,
Lesbos, Ténédos, eurent le sort de Milet. Plusieurs villes de l’Hellespont
périrent dans les flammes. Les habitants de Chalcédoine et de Byzance quittèrent
leur cité, pour chercher un asile sur la côte nord-ouest du Pont-Euxin, à
Mésembrie. Miltiade aussi jugea prudent de quitter II. Expéditions de Mardonius et d’Artaphernès ; Marathon (490)Cependant Darius n’avait pas oublié qu’après l’incendie de
Sardes il avait juré de se venger des Athéniens. Il donna à son gendre
Mardonius le commandement d’une nouvelle armée, qui devait pénétrer en Europe
par
Déjà toutes les nations comprises entre l’Hellespont et Un armement plus formidable fut aussitôt préparé. Avant de le faire partir, Darius envoya en Grèce des hérauts qui demandèrent en son nom l’hommage de la terre et de l’eau, et, de plus, aux villes maritimes, un contingent de galères. La plupart des îles et plusieurs cités du continent firent cet hommage. Égine alla au-devant des désirs du grand roi. Pour Athènes et Sparte, leur indignation fut telle, qu’elles en oublièrent le droit des gens : Vous demandez la terre et l’eau ? dirent les Spartiates aux envoyés ; vous aurez l’une et l’autre ; et ils les jetèrent dans un puits. Les Athéniens les précipitèrent dans le barathron, et, s’il faut en croire un douteux récit, condamnèrent à mort l’interprète qui avait souillé la langue grecque en traduisant les ordres d’un barbare. Athènes était toujours en guerre avec les Éginétes. Elle profita de leur conduite pour les accuser à Lacédémone de trahir la cause commune. Cet appel aux Spartiates équivalait à une reconnaissance de leurs prétentions à la suprématie, comme chefs avoués de l’Hellade ; la difficulté des circonstances avait fait taire l’orgueil. Cléomène partageait le ressentiment des Athéniens, il accourut à Égine pour saisir les coupables. Mais son collègue Démarate, qui l’avait déjà trahi dans une expédition en Attique, avertit les insulaires, et l’entreprise échoua. Pour mettre un terme à cette opposition tracassière de son collègue, Cléomène fit déclarer parla Pythie, qu’il avait gagnée, que Démarate n’était pas de race royale, et il obtint qu’il fût déposé. Léotychidas s’était concerté avec lui dans cette intrigue; il succéda au roi déclin, dont il était le plus proche héritier, et, par ses outrages, le força de quitter Sparte. Démarate alla rejoindre Hippias dans l’exil, et mendier comme lui l’hospitalité du protecteur des rois. Cléomène se rendit alors à Ugine et y prit dix otages, qu’il remit aux Athéniens. Cet acte fut le dernier de la vie publique de ce chef turbulent, qui, devenu fou, périt misérablement de ses propres mains. Léotychidas, convaincu plus tard d’avoir reçu de l’argent d’un ennemi qu’il devait combattre, alla mourir en exil. Les dieux, dit Hérodote, punirent ainsi le parjure des deux princes. Cependant les Éginètes réclamèrent leurs otages ; et Athènes refusant de les rendre, ils surprirent la galère sacrée qui portait au cap Sunion plusieurs des principaux citoyens. La guerre éclata aussitôt. Un Éginète essaya de renverser dans son île, le gouvernement oligarchique ; il s’empara de la citadelle, mais ne put être secouru à temps, et laissa aux mains de l’ennemi sept cents des siens, qui furent froidement égorgés. Un de ces malheureux réussit à s’échapper et à atteindre le temple de Cérès où il croyait trouver un asile et le salut. La porte était fermée ; il saisit fortement un anneau de la serrure, et tous les efforts pour lui faire lâcher prise étant inutiles, les bourreaux lui coupèrent les mains, qui, crispées par la mort, restèrent attachées à la poignée de la porte. Hérodote, habitué à ces guerres civiles, n’a pas un mot d’horreur pour cette boucherie de sept cents citoyens; il ne remarque que le sacrilège commis au sujet d’un d’entre eux. Aucun sacrifice, dit-il pieusement, ne put apaiser la colère de la déesse, et les nobles furent chassés de l’île avant d’avoir expié le sacrilège[2]. Cette guerre ne se termina, en effet, que neuf ans après la seconde expédition des Perses. La nouvelle armée, 100.000 fantassins et 10.000 cavaliers
portés par 600 galères, s’avançait sous les ordres du Mède Datis et d’Artaphernès,
neveu du roi. Darius leur avait commandé de se rendra maîtres d’Érétrie et d’Athènes,
d’en faire les habitants captifs, et de lui envoyer ceux qu’il appelait ses esclaves. Il voulait voir de ses yeux des
hommes assez audacieux pour le braver. Cette fois la flotte, pour éviter le
mont Athos, prit route à travers la nier Égée. Elle soumit, en chemin, Naxos,
dont la capitale fut brûlée avec tous ses temples respecta les sanctuaires de
Délos, qu’on disait aux Peau, consacrés aux dieux qu’eux-mêmes adoraient, le
soleil et la lune, et arriva enfin en Eubée où elle prit Carystos et assiégea
Érétrie. Cette ville songea d’abord à se défendre, et les Athéniens
offraient, pour la soutenir, leurs quatre mille citoyens établis dans
l’île ; mais les grands ouvrirent les portes à l’ennemi, qui saccagea la
ville et la brûla avec ses temples, en représailles de l’incendie de Sardes.
Tous les habitants, amis ou ennemis, furent réduits en esclavage et conduits
à Darius, qui leur assigna pour demeure un de ses domaines non loin du golfe
Persique. Cent soixante ans après, Alexandre les y retrouva fidèles à la
langue et aux meurs de leur première patrie. Platon composa une épitaphe pour
ces enfants que D’Érétrie, les Perses vinrent jeter l’ancre dans la baie de
Marathon. La plaine de ce nom, bordée par la mer, des marais et les dernières
collines du Pentélique et du Parnès, à de 9 à Une armée de 11.000 hommes s’avança donc contre 110.000
ennemis[3]. Elle était sous
les ordres de dix généraux ou stratèges, élus un par tribu et qui devaient
commander pendant un jour, chacun à son tour. Un d’eux était Miltiade, fils
de Cimon. Il s’était rendu célèbre comme tyran de Les avis étaient partagés : cinq généraux voulaient qu’on attendît des renforts, les quatre autres qu’on livrât bataille sur-le-champ, parce qu’ils redoutaient les intrigues d’Hippias et l’or des Perses plus encore que leur nombre. Le sort d’Érétrie montrait le danger de donner le temps à la trahison de se glisser dans le camp ou dans la ville : tel était l’avis de Miltiade. Il réussit à mettre dans son opinion le polémarque Callimachos, dont la voix était prépondérante, et il fut décidé que l’on combattrait. Aristide, un des généraux, reconnaissant la supériorité de Miltiade, engagea ses collègues à lui céder leur tour de commandement; il n’accepta pas et attendit que son jour fût venu. Callimachos se plaça, selon l’usage, à l’aile droite ; les Platéens formaient la gauche. Les Athéniens, afin de n’être pas tournés, dégarnirent leur centre et étendirent leur ligne jusqu’à ce qu’elle présentât un front égal à celui des Perses. Ils mirent leurs principales forces aux ailes, qu’un abatis d’arbres protégea contre la cavalerie ennemie, de sorte que celle-ci ne pouvait plus les tourner qu’en gravissant les pentes de la montagne, manœuvre difficile à exécuter et qui aurait rompu leur ordonnance. Aussi, après avoir reconnu cette plaine entourée de montagnes et marécageuse sur ses bords, Datis et Artaphernès renoncèrent à y lancer leur cavalerie. Dans la position qu’il avait prise, Miltiade couvrait les deux routes qui menaient à Athènes par Cephisia et Aphidna ; il laissait ouverte aux Perses celle de Pallène, entre le Pentélique et l’Hymette, mais les Perses n’auraient pu s’y engager que par une marche de flanc, dangereuse en présence d’une armée ennemie. Dès que le signal fut donné, dit Hérodote, les Athéniens descendirent en courant de la hauteur sur laquelle ils étaient postés, au grand étonnement des Perses, qui ne comprenaient pas cette folie d’une attaque faite à la course par un si petit nombre d’hommes, sans cavalerie ni archers. La bataille dura longtemps les barbares furent vainqueurs au centre ; les Perses et les Saces qui s’y trouvaient percèrent la ligne des Grecs et les poursuivirent dans les terres : les Athéniens furent, au contraire, vainqueurs aux ailes ; mais, laissant fuir l’ennemi, ils se replièrent des deux côtés sur ceux qui avaient forcé le centre, les défirent complètement et les suivirent de si prés l’épée dans les reins, qu’arrivés en même temps qu’eux sur le rivage, ils attaquèrent les vaisseaux en demandant du feu à grands cris pour les incendier. Le polémarque fut tué, ainsi qu’un
des dix généraux, Stésiléos : Cynégire, frère d’Eschyle, se jeta à la
mer pour arrêter un vaisseau qui fuyait ; il le saisit à la poupe, mais
un coup de hache lui trancha la main[5]. Sept vaisseaux seulement furent pris, le reste se sauva
en forçant de rames, sans même prendre le temps de virer de bord; ils s’empressèrent
de doubler le cap Sunion, avertis, par un bouclier élevé en l’air, que la
ville était sans défense. Mais les vainqueurs revinrent à marche forcée ; ils
étaient campés dans le Gynosarge, quand les vaisseaux des barbares se montrèrent
en face de Phalère. Le coup était planqué, la flotte retourna en Asie[6] (
A cette bataille, la première, dit Hérodote, où des Grecs osèrent regarder en face ces Aèdes dont le nom seul était un objet de terreur, les barbares perdirent environ 6400 hommes, les Athéniens seulement 192. Hippias était probablement resté parmi les morts, Eschyle fut blessé. Hérodote ne parle pas de ce soldat qui vola d’un trait de Marathon à Athènes et expira en annonçant aux magistrats la victoire. Mais il ignorait bien d’autres choses que le peuple savait sur cette étonnante victoire : les uns avaient vu Thésée, d’autres le héros Échetlos, combattant dans les rangs des Athéniens. La dîme du butin fut consacrée aux divinités protectrices, Athéna, Apollon, Artémis, et, en souvenir de la promesse de victoire entendue par le coureur Phidippide, on fit d’une grotte ouverte au flanc de l’Acropole, un sanctuaire de Pan. Les Platéens tombés dans le combat furent réunis sous un tertre à côté de celui des Athéniens; la généreuse cité n’oublia pas les esclaves qui l’avaient aidée à vaincre : eux aussi eurent, sur ce glorieux champ de bataille, leur stèle funéraire. Pour tout honneur, Miltiade se vit représenter, ainsi que Callimaque, sur les murs du Poecile, au milieu d’un groupe de demi-dieux et de héros. C’était beaucoup; Athènes en faisait moins d’habitude, sans qu’on ait le droit d’incriminer, à ce sujet, sa jalousie envieuse. N’était-ce pas le peuple qui avait voulu combattre et qui avait vaincu ? L’histoire ne répondra pourtant pas aux accusations de l’injustice
populaire, comme ce citoyen d’Athènes qui disait à Miltiade : Quand vous vaincrez seul les barbares, Miltiade, vous
aurez seul l’honneur de la victoire[7] ; parce qu’elle
sait tout ce que l’habileté d’un chef peut ajouter à la force d’une armée.
Plus tard, on éleva à Miltiade un tombeau à part dans la plaine de Marathon,
à côté de celui qui renfermait les restes des citoyens. Prés de celui-ci
étaient dix colonnes, une pour chaque tribu, et sur elles furent gravés les
noms des 192 héros. On dit que les Perses avaient, pour en raire un trophée,
apporté à Marathon un bloc de marbre de Paros d’où Phidias aurait fait sortir
Némésis; c’est une légende. On consacra bien, dans cette plaine, un édicule à
la déesse des justes vengeances ; mais Les Platéens furent associés aux honneurs comme ils s’étaient associés au péril : chaque fois que le héraut, dans les sacrifices, implora les dieux pour Athènes, il dut prier aussi pour les Platéens. Deux jours après le combat, les Spartiates arrivèrent; ils
n’avaient mis que trois jours à faire le chemin. Ils félicitèrent les
Athéniens de leur triomphe, et se rendirent sur le champ de bataille encore
jonché de morts. Mais, en -voyant les trophées et l’enthousiasme des
vainqueurs, ils durent comprendre que le jour où l’immense empire des Perses
avilit reçu ce sanglant affront, un grand peuple était né à III. Miltiade, Thémistocle et AristideLa guerre était repoussée de l’Attique ; il fallait l’en
éloigner à jamais, en formant autour de Diodore, Cornélius Népos et Plutarque ont accumulé ici les circonstances les plus défavorables aux Athéniens. Hérodote, qui put converser avec des hommes témoins de l’évènement, le raconte plus simplement. Xanthippe, dit-il, intenta au général une affaire capitale et l’accusa d’avoir mal conseillé le peuple. Miltiade ne comparut pas. La gangrène, qui s’était mise à sa cuisse, le retenait au lit ; mais ses amis présentèrent sa défense, et, en rappelant la gloire dont il s’était couvert à Marathon et à la prise de Lemnos, ils mirent le peuple dans ses intérêts. Il fut déchargé de la peine de mort, mais condamné pour sa faute à une amende de 50 talents (295.000 francs). La gangrène ayant fait des progrès, il mourut quelque temps après ; Cimon, son fils, paya les 50 talents. On ne voit là ni la prison où gémit le libérateur d’Athènes, ni le corps du héros pieusement racheté par son fils au bourreau qui garde le cadavre encore chargé de ses liens, ni la belle Elpinice, donnée au riche Callias par Cimon son frère en échange des 50 talents[9] que le fisc impitoyable exige. L’intérêt dramatique y perd ; mais la vérité y gagne, et aussi l’honneur de ce peuple athénien tant calomnié par les rhéteurs de tous les âges. Toutefois, si dans ce procès la loi avait été rigoureusement suivie, la justice, suivant nos idées modernes[10], qui veulent que le crime non l’erreur, la trahison non la défaite, soient punis, avait été violée, et cette fin du vainqueur de Marathon est restée une tache pour Athènes. Du moins, quand il eut expiré, ni les éloges ni les honneurs éternels ne manquèrent à sa mémoire. Quand les Athéniens envoyèrent à Delphes, en souvenir de Marathon, treize statues de dieux et de héros sculptées par Phidias, le seul Miltiade fut admis dans la troupe divine.
Trois hommes le remplacèrent : un neveu de Clisthénès, Xanthippe, qui n’est célèbre que par sa victoire de Mycale et par son fils Périclès ; Aristide et Thémistocle, qui le sont, l’un par sa vertu, l’autre par ses services. Thémistocle était né vers l’an 535. Son père était un homme obscur, mais riche, et sa mère une femme étrangère. Dans la commerçante Athènes, les préjugés de naissance étaient faibles, il les diminua encore. Les enfants de race mêlée ne pouvaient se livrer aux exercices du gymnase que dans le Cynosarge ; Thémistocle parvint à y attirer les enfants des eupatrides, et fit tomber par là cette distinction injurieuse. Pour lui, au jeu il préférait le travail; mais il négligeait les études de spéculation ou de plaisir, auxquelles les Grecs attachaient tant d’importance, pour suivre les leçons d’un de ces hommes qu’on appelait Sages, et qui s’occupaient surtout de l’art de gouverner les États. On le raillait un jour de ce qu’il ne savait pas jouer de la lyre. Chants ni jeux ne me conviennent, répondit-il ; mais qu’on me donne une ville petite et faible, et je la rendrai bientôt grande et forte. En voyant cette ambition et cette ardeur, un de ses maîtres prédit qu’il ferait beaucoup de bien ou beaucoup de anal. S’il tâcha de briller aux jeux olympiques, c’était pour le bruit qui se faisait autour des vainqueurs. II voulait qu’Athènes crût que son nom était dans toutes les bouches. Aussi attirait-il dans sa maison les artistes étrangers et les personnages de distinction qui venaient clans la ville. Son père cherchait a le détourner des affaires publiques. Un jour il lui montra de vieilles galères brisées qu’on laissait pourrir sur la grève : C’est ainsi, lui disait-il, que le peuple traite ses chefs et qu’il oublie leurs services. Mais ces conseils de l’égoïste expérience sont heureusement mal écoutés. Thémistocle étudia l’art de la parole, sachant bien que l’éloquence, dans une république, est l’arme la plus redoutable. Si prodigieuse mémoire lui permettait de retenir les noms de tous les citoyens; et pour gagner leur confiance, il plaidait leur cause et accommodait leurs différends. Il se donnait ainsi doucement un grand crédit, quand la guerre Médique vint déranger ses calculs. Pour résister aux Perses de Datis et d’Artaphernès, il fallait un général et non un orateur : Miltiade eut tous les honneurs de la première guerre. Thémistocle, interrogé par ses amis, qu’il fuyait sur son air sombre, agité et pensif, répondait que les trophées de Miltiade l’empêchaient de dormir. Mais bientôt il allait en dresser lui-même ; car, dans l’effroyable crise où Athènes va se trouver, il lui faudra un homme qui ne donne rien à la peur ni à l’audace imprudente, que jamais rien d’imprévu ne surprenne et qui juge sainement les choses, voie les conséquences et trouve immédiatement le remède. Cet homme sera Thémistocle. À Marathon, il avait combattu à côté de celui qui devait être son rival. Aristide se distingua de bonne heure par une probité sévère et acquit, sans la chercher, l’influence que Thémistocle eut tant de peine à conquérir. À la mort de Miltiade, ils se trouvèrent les premiers dans la cité; mais leurs vues différaient comme leurs caractères. Thémistocle cherchait plutôt son appui dans le peuple ; Aristide ambitionnait davantage la faveur de la classe élevée. L’un était tout-puissant dans l’assemblée générale, l’autre dans les cours de justice. Personne n’osait contester les lumières de Thémistocle ; mais on savait qu’il avait peu de scrupule quand le succès était au bout d’une injustice; l’équité d’Aristide était, au contraire, devenue proverbiale. Ami de Clisthénès et sans engagements avec les partis, il était l’homme de la loi et de la justice Il aurait voulu conserver les anciennes mœurs, la vie rustique, le travail des champs ; son rival, en portant l’activité des Athéniens vers la ruer et le commerce, allait faire passer la prépondérance des classes rurales aux classes marchandes, des propriétaires fonciers aux capitalistes nomades, du laboureur attaché à sa terre et à ses dieux, au marin qui les oublie en courant les mers. L’un tenait à conserver les éléments aristocratiques de la constitution, l’autre ne redoutait pas un nouveau progrès de la démocratie. De cette opposition naissaient des luttes continuelles qui troublaient la ville. Athènes ne sera tranquille, disait Aristide, que quand on nous aura jetés l’un et l’autre dans le barathron. Thémistocle parvint à réaliser la moitié de cette parole, aux dépens du seul Aristide. II répandit sourdement le bruit qu Aristide s’arrogeait une espèce de royauté, en attirant à lui tous les procès, pour les accommoder, ce qui laissait les tribunaux dans l’inaction. Ces insinuations produisirent leur effet. On oublia les services du bon citoyen, car la reconnaissance sommeille, dit Pindare, et l’Envie, qu’on avait mise au ciel, était restée sur la terre, au cœur de la démocratie : Aristide fut exilé par l’ostracisme (483). On raconte qu’un citoyen obscur, qui se trouvait à côté de lui dans l’assemblée, s’adressa à lui-même pour faire écrire son nom sur la coquille du vote. Aristide vous aurait-il offensé ? demanda celui-ci. — Non, répondit l’homme du peuple, je ne le connais pas ; mais je suis las de l’entendre toujours nommer le Juste. En quittant Athènes, le Juste pria les dieux qu’il n’arrivât rien à sa patrie qui pût faire regretter son exil. N’oublions pas qu’un siècle plus tôt cette rivalité se fût
décidée par les armes et eut ensanglanté la ville, au lieu de se décider
paisiblement par un vote. Il a injustice, sans doute ; mais l’Athènes de
Thémistocle vaut mieux que celle de Pisistrate ; c’étaient ses libres
institutions qui la sauvaient de la guerre civile. Au reste, Thémistocle
effaça cette mauvaise action par ses services. Après Marathon, le peuple
croyait la guerre finie ; seul il comprit qu’elle était à peine
commencée ; que le maître de l’Asie, de |