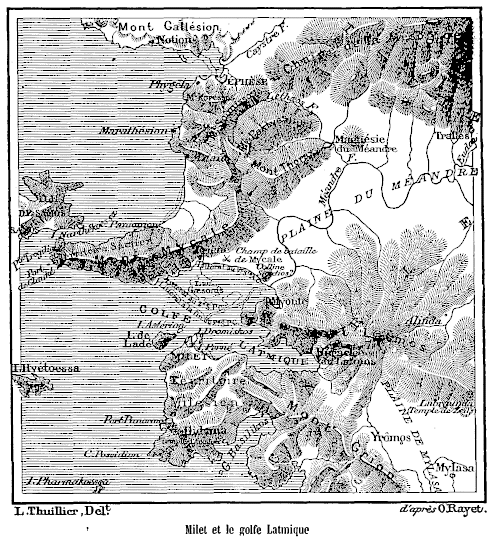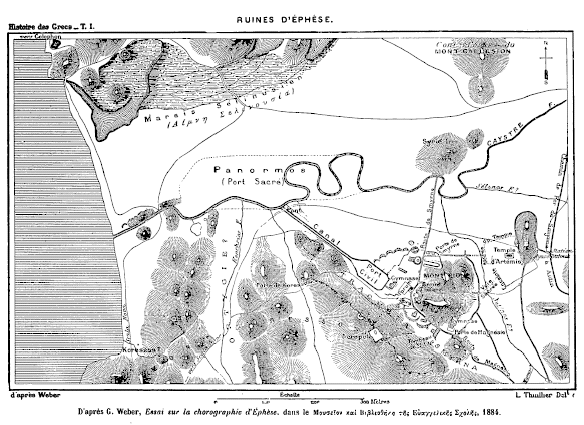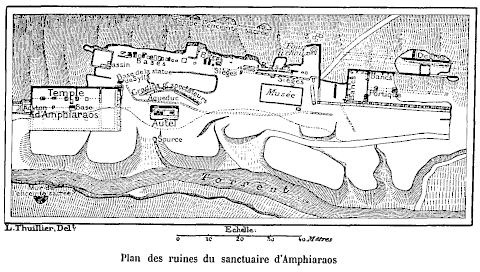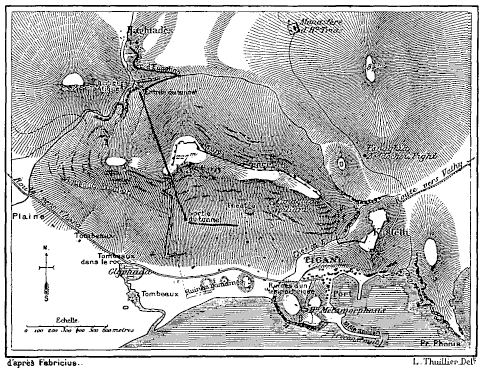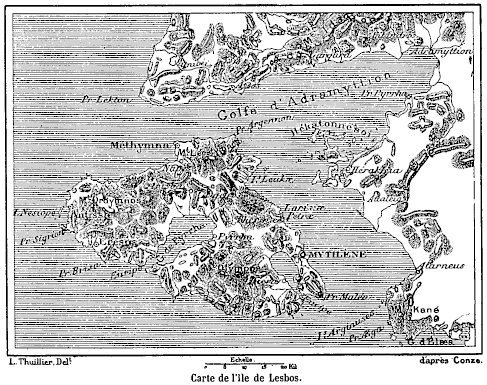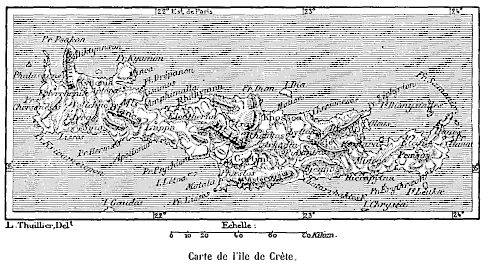HISTOIRE DES GRECS
DEUXIÈME PÉRIODE — DE L’INVASION DORIENNE AUX GUERRES MÉDIQUES (1104-490) — ISOLEMENT DES ÉTATS - RÉVOLUTIONS INTÉRIEURES - COLONIES.
Chapitre XIV — Asservissement des colonies grecques avant les guerres médiques.
I. Conquêtes des Lydiens et des PersesLes colonies ioniennes furent longtemps gouvernées par des princes de la maison de Codrus, dont les descendants jouissaient encore à Éphèse, du temps de Strabon, de prérogatives qui rappelaient leur ancien pouvoir ; mais. dans ces cités commerçantes et formées d’éléments très divers, il était inévitable que la démocratie prît un rapide essor. La royauté y fut abolie peu de générations après l’arrivée des colons sur les eûtes d’Asie. Comme dans la mère patrie, l’aristocratie voulut prendre la place des rois, et de longues discordes déchirèrent les cités. Hérodote parle, pour Milet, d’une guerre qui dura deux générations. La liberté à la fin l’emporta ; c’était bien. Mais il eût fallu songer aussi à l’indépendance en mettant toutes les forces en commun, et nulle de ces brillantes cités ne songea à sortir de son isolement égoïste.
Cependant il était facile de voir que derrière elle était un grand danger. Ayant occupé tous les rivages occidentaux de l’Asie Mineure et mis une grande ville, Éphèse, Smyrne et Milet, à l’embouchure de chacun de ses fleuves, l’Hermos, le Caystre et le Méandre, elles interdisaient aux rois de Lydie l’approche de la mer. Quand ces rois, dans le courant du septième siècle, furent devenus puissants, ils tournèrent leurs armes contre les étrangers établis sur leurs domaines. Des lydiens on a fait des Sémites ; Hérodote, leur voisin, est tout près de les croire Grecs ; du moins il leur donne pour premiers rois des Héraclides et montre leur seconde race royale en constante communication avec l’oracle de Delphes. Lui-même vit et toucha, dans le temple, les riches dons envoyés par eux à Apollon. Cependant le plus généreux de ces princes envers le grand sanctuaire hellénique, Gygès, commença la guerre contre les Ioniens ; il s’empara de Colophon, et Priène tomba aux mains d’Ardys, son successeur. Mais, vers ce temps, un grand mouvement ébranlait le monde barbare, au nord de l’Euxin, du Caucase et de l’Oxus. Les nomades qui erraient dans ces vastes solitudes se jetèrent de deux côtés à la fois sur l’Asie. Tandis que les Scythes s’avançaient, à travers le pays des Mèdes et des Assyriens, jusqu’à l’Égypte, les Cimmériens pénétraient dans l’Asie Mineure dont ils ravagèrent toute la partie occidentale. Sardes fut prise, et l’Ionie elle-même souffrit des maux dont le douloureux écho est venu jusqu’à nous dans les poésies de Callinos. C’était un poète d’Éphèse. Pour ranimer le courage des guerriers qui n’osaient plus affronter les barbares, il reprit les vers que Tyrtée avait composés durant la seconde guerre de Messénie : Jusques à quand cette indolence, ô jeunes gens ? et quand donc aurez-vous un cœur vaillant ? Ne rougissez-vous pas de vous abandonner lâchement vous-mêmes ? Vous voulez vivre clans la paix ; mais la guerre embrase la contrée entière… Marchez devant vous la lance haute ; que votre cœur, sous le bouclier, se ramasse en sa vaillance ait moment où commencera la mêlée ; et qu’en mourant on lance encore un dernier trait, car il est honorable à un brave de combattre pour son pays, pour ses enfants, pour sa légitime épouse. Quant à la mort, elle viendra à l’instant que marquera le fil des Parques. Nul ne peut l’éviter, eût-il les Immortels pour ancêtres; et souvent celui qui fuit le combat et les traits, au sifflement aigu, tombe plus vite dans sa maison. Pour lui, alors, nul regret. L’autre, au contraire, petits et grands le pleurent, car, vivant, on l’estimait à l’égal des demi-dieux, puisqu’il était pour ses concitoyens un rempart assuré. Nous ne savons ce qu’il advint des barbares. Le flot recula sans doute comme il était venu et se perdit ; du moins, ces barbares, décimés par les maladies et la guerre, disparurent peu à peu. Sadyatte et son fils Alyatte reprirent les projets de leurs prédécesseurs contre les colonies grecques. Le dernier s’attaqua surtout à Milet. Incapable de la réduire parla force, il essaya de la dompter par la famine. Chaque été, dit Hérodote, dès que les fruits et les moissons commençaient à mûrir, le roi partait à la tête de son armée, qu’il faisait marcher et camper au son des instruments. Arrivé sur le territoire des Milésiens, il respectait les habitations éparses dans les champs, et n’en faisait pas même enlever les portes, mais il détruisait les récoltes et les fruits, puis se retirait. Comme les Milésiens étaient maîtres de la mer, il était inutile de tenter un siège régulier de la ville avec une armée qui n’avait point de vaisseaux. Quant aux maisons, s’il empêchait de les abattre, c’était pour y rappeler les habitants, qui ne manquaient pas, après son départ, de se remettre à travailler la terre et à l’ensemencer, de sorte que l’année suivante il trouvait toujours quelque chose à ravager.
Les Lydiens firent ainsi la guerre à ceux de Milet pendant
onze ans. La douzième année, avant mis le feu aux blés, comme de coutume, le
feu se communiqua à un temple de Minerve, et presque aussitôt Alyatte tomba
malade. Il consulta l’oracle de Delphes qui répondit : Le roi ne guérira qu’après avoir fait reconstruire le
temple de la déesse. Alyatte envoya alors demander aux Milésiens une
trêve qui lui permît d’exécuter l’ordre de Milet était sauvé ; mais Smyrne et Éphèse furent prises, quoique les Éphésiens eussent consacré leur ville à Artémis en attachant à son temple un cordage qu’ils tendirent jusqu’à leurs murailles éloignées de sept stades. Les autres cités tombèrent les unes après les autres sous les coups de Crésus qui les força d’abattre une partie de leurs remparts, pour que ses troupes pussent en tout temps y entrer. Il songeait même à porter la guerre chez les insulaires ; Bias l’en détourna. Le bruit court, dit le sage, que les habitants des îles rassemblent dix mille cavaliers pour venir vous attaquer dans Sardes. — Plaise aux dieux, s’écria Crésus, qu’ils soient assez insensés pour le faire ! — Oui, repartit Bias, les Grecs seraient insensés s’ils venaient vous combattre avec de la cavalerie qui est la force, des Lydiens ; mais, vous, ô Crésus, ne le seriez-vous pas si vous alliez les chercher sur la mer où ils ont tant d’avantage ? Le roi abandonna son projet, contracta avec les insulaires des traités d’hospitalité et usa de sa domination sur les Grecs d’Asie avec tant de douceur, qu’ils repoussèrent les sollicitations que Cyrus leur fit porter quand il attaqua les Lydiens. Crésus, qui avait pour mère une femme d’Ionie, était un roi puissant, généreux, ami des arts, presque Grec : il consultait fréquemment l’oracle de Delphes, recevait à sa cour Bias de Priène, Pittacos de Mytilène, peut-être l’Athénien Solon, et subissait l’empire qu’exerce une civilisation supérieure. Il avait étendu sa domination jusqu’au fleuve Halys. Quand les Mèdes et leur roi Astyage eurent été vaincus par Cyrus, il crut le moment venu de saisir l’empire de l’Asie. Hérodote s’est complu à raconter les malheurs de ce prince. Écoutons-le sans toujours le croire; il nous distraira des pensées plus sévères de l’histoire philosophique. C’est le Joinville des Grecs et il est aussi pieux que le nôtre. Dans ses vivants récits, nous trouverons la confirmation et, pour ainsi dire, la mise en action des idées religieuses que nous avons précédemment exposées. Ce contemporain de Thucydide est le dernier représentant de l’ancienne théologie que l’historien de la guerre du Péloponnèse ne connaîtra plus. Si la vérité n’est pas dans les détails donnés sur les tragiques aventures de Crésus et de ses fils, elle est dans l’esprit de celui qui les raconte. Il nous fait connaître, par son exemple, ce que le peuple grec pensait encore au milieu du cinquième siècle, et nous comprendrons mieux le rôle important des oracles durant les guerres Médiques, en voyant la sollicitude d’un roi barbare à les consulter. Une nuit, Crésus fut troublé par un songe qui lui révéla qu’une triste fin menaçait un de ses fils. Il en avait deux : l’un, affligé d’une infirmité naturelle : il était muet ; l’autre, qui surpassait en tout les jeunes gens de son âge : il se nommait Atys. Ce fut Atys que le songe indiqua à Crésus, comme devant périr par une arme de fer. Le roi, tremblant pour son fils, l’éloigna des armées, à la tête desquelles il avait coutume de l’envoyer, et fit ôter les dards, les piques, des appartements où ces armes étaient suspendues, de peur qu’il n’en tombât quelqu’une sur son fils. Sur ces entrefaites, vint à Sardes un malheureux dont les mains étaient impures : cet homme était Phrygien et issu de sang royal. Arrivé au palais, il pria Crésus de le purifier suivant les lois du pays. Les expiations faites, Crésus voulut savoir d’où il venait et quel homme ou quelle femme, il avait tué ! Seigneur, je suis fils de Gordius, et petit-fils de Midas : je m’appelle Adraste ; j’ai tué mon frère sans le vouloir. Chassé par mon père, je suis venu chercher ici un asile. — Vous sortez, reprit Crésus, d’une maison que j’aime. Vous êtes chez des amis ; rien ne vous manquera dans mon palais, tant que vous jugerez à propos d’y rester. Supportez votre malheur avec patience, c’est le moyen de l’adoucir. Adraste demeura donc à la cour de Crésus. Dans ce même temps, il parut en Mysie un sanglier d’une grosseur énorme, qui, descendant du mont Olympe, faisait un grand dégât dans les campagnes. Les Mysiens l’avaient attaqué à diverses reprises, mais sans lui faire aucun mal, tandis qu’il leur en avait fait beaucoup. Enfin ils s’adressèrent à Crésus : Seigneur, lui dirent leurs députés, il a paru sur nos terres un effroyable sanglier qui ravage nos campagnes ; malgré nos efforts, nous n’avons pu nous en défaire. Nous vous supplions, pour en purger le pays, d’envoyer avec nous votre meute et le prince votre fils, à la tête d’une troupe de jeunes gens choisis. Crésus, se rappelant le songe qu’il avait eu, leur répondit : Ne me parlez pas de mon fils, je ne puis l’envoyer avec vous, mais je vous donnerai mon équipage de chasse, avec l’élite de la jeunesse lydienne, à qui je recommanderai de s’employer avec ardeur pour vous délivrer de ce sanglier. Les Mysiens furent très contents de cette réponse. Atys, qui avait entendu leur demande et le refus qu’avait fait Crésus de l’envoyer avec eux, entra sur ces entrefaites, et s’adressant à ce prince : Mon père, lui dit-il, les actions les plus nobles et les plus généreuses m’étaient autrefois permises, je pouvais m’illustrer à la guerre et à la chasse ; mais vous m’éloignez aujourd’hui de l’une et de l’autre, quoique vous n’ayez remarqué en moi ni lâcheté ni faiblesse. Quand j’irai à la place publique ou que j’en reviendrai, de quel œil me verra-t-on ? Quelle opinion auront de moi les citoyens ? Permettez-moi donc, seigneur, d’aller à cette chasse. — Ce n’est pas, mon fils, reprit Crésus, que j’aie remarqué dans votre conduite la moindre lâcheté ; mais un songe m’a fait connaître que vous deviez périr par une arme de fer. C’est pour cela que je ne vous envoie pas à cette expédition et que je prends toutes sortes de précautions pour vous dérober, du moins pendant ma vie, au malheur qui vous menace. Je n’ai que vous d’enfant, car mon autre fils, disgracié de la nature, n’existe plus pour moi. — Mon père, répliqua le jeune prince, après un pareil songe, le soin avec lequel vous me gardez est bien excusable ;mais il me semble que vous n’en saisissez pas bien le sens. Les dieux vous ont fait connaître que je devais périr d’une arme de fer. Mais un sanglier a-t-il des mains ? Est-il armé de ce fer aigu que vous craignez ? Si votre songe vous eût appris que je dusse mourir d’une défense de sanglier ou de quelque manière semblable, on approuverait vos précautions ; mais il n’est question que d’une pointe de fer. Puis donc que ce ne sont pas des hommes que j’ai à combattre, laissez-moi partir. — Mon fils, répond Crésus, votre interprétation est plus juste que la mienne. Je cède à vos raisons ; ma défense est révoquée, la chasse que vous désirez vous est permise. En même temps, il mande le Phrygien Adraste, et lui dit : Vous étiez sous les coups du malheur, Adraste (me préserve le ciel de vous le reprocher !), je vous ai purifié, je vous ai reçu dans mon palais. où je pourvois à tous vos besoins : prévenu par mes bienfaits, vous me devez quelque retour. Mon fils part pour la chasse : je vous confie la garde de sa personne ; préservez-le des brigands qui pourraient vous attaquer sur la route. D’ailleurs il vous importe de rechercher les occasions de vous signaler : vos pères vous l’ont enseigné, la vigueur de votre âge vous le permet. — Seigneur, répondit Adraste, sans un pareil motif, je n’irais point à ce combat. Au comble du malheur, se mêler à des hommes de mon âge et plus heureux, je n’en ai pas le droit, je n’en ai pas la volonté : souvent je m’en suis abstenu. Mais vous le désirez, il faut vous obéir et reconnaître vos bienfaits. Soyez sûr que votre fils, confié à ma garde, reviendra sain et sauf, autant qu’il dépendra de son gardien. Le prince Atys et lui partirent après cette réponse, avec une troupe de jeunes gens d’élite et la meute du roi. Arrivés au mont Olympe, on cherche le sanglier, on le trouve, on l’environne, on lance sur lui des traits ; mais le javelot d’Adraste manque la bête et frappe le fils de Crésus. Le jour des funérailles, comme un silence lugubre régnait dans l’assemblée, on vit cet Adraste, qui avait été le meurtrier de son frère et du fils de son hôte, terminer lui-même sa vie misérable en se tuant sur le tombeau d’Atys. Crésus pleura deux ans la mort de
son fils. Mais les révolutions mirent un terme à sa douleur. Il ne pensa plus
qu’aux moyens de réprimer cette puissance avant qu’elle devint menaçante pour
lui-même, et tout d’abord il résolut de consulter les oracles les plus
fameux. Il envoya des députés en divers endroits, les uns à Delphes, les
autres à Abès, en Phocide, d’autres encore à Dodone, quelques-uns à l’oracle
d’Amphiaraos, à l’antre de Trophonios, aux Branchiales dans Ces députés partirent, le même jour de Sardes avec l’ordre de ne se présenter devant l’oracle que le centième jour depuis leur départ, et de demander ce que ce moment-là. On ne connaît que la réponse de l’oracle de Delphes. Aussitôt que les Lydiens furent entrés dans le temple pour consulter le dieu, et qu’ils eurent interrogé la pythie sur ce qui leur avait été prescrit, elle leur dit : Je connais le nombre des grains de sable et les bornes de la mer ; je comprends la langue du muet ; j’entends la voix de celui qui ne parle point. Mes sens sont frappés de l’odeur d’une tortue qu’on fait cuire avec de la chair d’agneau dans une chaudière d’airain dont le couvercle est aussi d’airain.
Quand les députés furent de retour avec les réponses des oracles, Crésus ouvrit leurs lettres ; en lisant la réponse de l’oracle de Delphes, il la reconnut pour vraie et adora le dieu, persuadé que cet oracle était le seul véritable, puisqu’il était le seul qui eût découvert la vérité. En effet, après le départ des députés, Crésus avait imaginé la chose la plus impossible à deviner et à connaître. Il avait coupé lui-même par morceaux une tortue et un agneau, et on les avait fait cuire ensemble dans un vase d’airain, dont le couvercle était de même métal. Quant à la réponse que reçurent les Lydiens dans le temple d’Amphiaraos, je n’en puis rien dire. On sait seulement que Crésus reconnut aussi la véracité de cet oracle. Ce prince tâcha ensuite de se rendre propice le dieu de Delphes par de somptueux sacrifices, dans lesquels on immola trois mille victimes de toutes les espèces d’animaux qu’il est, permis d’offrir aux dieux et par des dons en or et en argent qu’il consacra dans son temple. Quant au héros Amphiaraos, il lui fit offrande d’un bouclier d’or massif, avec une pique de même métal. De mon temps, on voyait encore l’un et l’autre à Thèbes, dans le temple d’Apollon Isménien. Les Lydiens, chargés de porter
ces présents aux oracles de Delphes et d’Amphiaraos, consultèrent les oracles
en ces termes : Crésus, roi des Lydiens et d’autres nations, persuadé que
vous êtes les seuls véritables oracles qu’il y ait dans le monde, vous envoie
les présents qu’il croit dignes de votre habileté. Maintenant il vous demande
s’il doit marcher contre les Perses, et s’il doit joindre à son armée des
troupes auxiliaires. Les deux oracles s’accordèrent dans leurs réponses.
Ils prédirent l’un et l’autre à ce prince que, s’il entreprenait la guerre
contre les Perses, il détruirait un grand empire, et lui conseillèrent de
rechercher l’amitié des États de Crésus, charmé de ces réponses et concevant l’espoir de renverser l’empire de Cyrus, envoya de nouveaux présents à Delphes et, interrogeant le dieu pour la troisième fois, lui demanda si sa monarchie serait de longue durée. La pythie répondit : Quand un mulet sera roi des Mèdes, fuis alors, Lydien efféminé, sur les bords de l’Hermos : garde-toi de résister, et ne rougis point, de ta lâcheté. Cette réponse fit encore plus de
plaisir à Crésus que toutes les autres. Persuadé qu’on rie verrait jamais sur
le trône des Mèdes un mulet, il conclut que ni lui ni ses descendants ne seraient
privés de la puissance souveraine. Il rechercha ensuite quels étaient les
peuples les plus puissants de Malheureusement régnait alors à Suse un roi dont les
parents étaient de race différente, Cyrus, fils du Perse Cambyse et de
Mandane, princesse du sang royal de Médie. C’était lui le mulet de l’oracle,
et Crésus le provoqua en franchissant l’Halys, limite des deux empires.
Hérodote raconte la bataille perdue par les Lydiens, le siège, puis la prise
de Sardes (546).
Mais il ne pouvait admettre que les choses se fussent passées avec cette
simplicité, que ce grand royaume eût été le prix d’une seule bataille, et que
ce roi si pieux envers les divinités de Crésus, dit-il, avait un fils doué de toutes sortes de bonnes qualités, mais qui était muet. Dans le temps de sa prospérité, Crésus, pour le guérir, avait eu recours à l’oracle de Delphes. La pythie avait répondu : Lydien, roi de plusieurs peuples, insensé Crésus, ne demande pas d’entendre en ton palais la voix tant désirée de ton fils. Il commencera de parler le jour où commenceront tes malheurs. Crésus avait régné quatorze ans, soutenu un siège d’autant de jours et, conformément à l’oracle, détruit un grand empire. Les Perses qui l’avaient fait prisonnier le menèrent à leur roi. Cyrus le fit monter, chargé de fers et entouré de quatorze Lydiens, sur un bûcher, pour éprouver si Crésus, dont on vantait la piété, serait garanti des flammes par la divinité. Sur le bûcher, malgré l’excès de sa douleur, Crésus se rappela ces paroles de Solon : Nul homme ne peut se dire heureux tant qu’il respire encore ; et il lui vint à l’esprit que ce sage ne les avait pas proférées sans la permission des dieux. Rappelé à lui-même par cette pensée, il sortit avec un profond soupir du long silence qu’il avait gardé et prononça par trois fois le nom de Solon. Cyrus, frappé de ces paroles, lui fit demander par ses interprètes quel était celui qu’il invoquait. Ils s’approchèrent et l’interrogèrent. Crésus ne répondit pas d’abord; forcé de parler, il dit : C’est un homme dont je préférerais l’entretien aux richesses de tous les rois. Ce discours leur paraissant obscur, ils l’interrogèrent de nouveau. Vaincu par l’importunité de leurs demandes, il répondit qu’autrefois Solon d’Athènes était venu à sa cour ; qu’ayant contemplé toutes ses richesses, il n’en avait fait aucun cas ; que tout ce qu’il avait dit se trouvait confirmé par l’événement, et que les avertissements de ce philosophe ne le regardaient pas plus, lui en particulier, que tous les hommes en général et principalement ceux qui se croyaient heureux. Ainsi parla Crésus. Le feu était déjà allumé, et le bûcher s’enflammait par les extrémités. Cyrus, apprenant de ses interprètes la réponse de ce prince, se repentit de l’ordre cruel qu’il avait donné. Il songea qu’il était homme, que cependant il faisait brûler un homme qui n’avait pas été moins heureux que lui, que la vengeance des dieux viendrait peut-être, à son tour, le frapper. En conséquence il ordonna d’éteindre promptement le bûcher, et d’en faire descendre Crésus ainsi que ses compagnons d’infortune; mais les plus grands efforts ne purent surmonter la violence des flammes. Alors Crésus, à ce que disent les Lydiens, instruit du changement de Cyrus et voyant la foule empressée à éteindre le feu sans pouvoir y réussir, implore à grands cris Apollon, le conjure, si ses offrandes lui ont été agréables, de le secourir, de le sauver d’un péril si pressant. Ses prières étaient accompagnées de larmes. Soudain, au milieu d’un ciel pur et serein, des nuages se rassemblent, un orage éclate et une pluie abondante éteint le bûcher[2]. Ce prodige apprit à Cyrus combien Crésus était cher aux dieux. Il le lit descendre du bûcher, et lui dit : Crésus, quel homme vous a conseillé d’entrer sur mes terres avec une armée et de vous déclarer mon ennemi, au lieu d’être mon ami ? — Votre heureux destin et mon infortune m’ont jeté, seigneur, dans cette malheureuse entreprise. Le dieu des Grecs en est la cause ; lui seul m’a persuadé de vous attaquer. Eh ! quel est l’homme assez insensé pour préférer la guerre à la paix ? Dans la paix, les enfants ferment les yeux à leurs pères ; dans la guerre, les pères enterrent leurs enfants. Après ce discours, Cyrus commanda
qu’on lui ôtât ses fers ; il le fit asseoir près de lui, le traita avec
beaucoup d’égards et lui dit : Demandez-moi ce qu’il vous plaira, vous
l’obtiendrez sur-le-champ. — Seigneur, répondit Crésus, la plus
grande faveur serait de me permettre d’envoyer au dieu des Grecs, celui de
tous les dieux que j’ai le plus honoré, les fers que voici, avec ordre de lui
demander s’il lui est permis de tromper ceux qui ont bien mérité de lui. Le
roi l’interrogea pour savoir quel sujet il avait de s’en plaindre, et quel
était le motif de sa demande. Crésus répéta les projets qu’il avait formés,
et l’entretint des réponses des oracles, de ses offrandes surtout et des
prédictions qui l’avaient animé à la guerre contre les Perses. Il finit en
lui demandant de nouveau la permission d’envoyer faire au dieu des reproches.
Non seulement cette permission, dit en riant Cyrus, mais ce que
vous souhaiterez désormais, je vous l’accorde. Crésus envoya donc des
Lydiens à Delphes, avec ordre de placer ses fers sur le seuil du
temple ; de demander au dieu s’il ne rougissait pas d’avoir, par ses
oracles, excité Crésus à la guerre contre les Perses, dans l’espoir de ruiner
l’empire des Perses; enfin de lui montrer ses chaînes, seul trophée qu’il pût
lui offrir de cette expédition, en disant : Est-il dans l’usage des dieux
de Les Lydiens exécutèrent, à leur
arrivée à Delphes, les ordres de Crésus ; on assure que la pythie leur
fit cette réponse : Il est impossible, même à un dieu, d’éviter le sort
marqué par les destins. Crésus est puni du crime de son cinquième ancêtre (Gygès), qui, simple garde du roi de la race des Héraclides, se
prêta aux instigations d’une femme artificieuse, tua son maître et s’empara
de la couronne, à laquelle il n’avait aucun droit. Apollon a mis tout en usage
pour détourner de Crésus le malheur de Sardes, et ne le faire tomber que sur
ses enfants ; mais il ne lui a pas été possible de fléchir les Parques.
Tout ce qu’elles ont accordé à ses prières, il en a gratifié ce prince. Il a
reculé de trois ans la prise de Sardes. Que Crésus sache donc qu’il a été
fait prisonnier trois ans plus tard qu’il n’était porté par les destins. En
second lieu, le dieu l’a secouru lorsqu’il allait devenir la proie des
flammes. Quant à l’oracle rendu, Crésus a tort de se plaindre. Apollon lui
avait prédit qu’en faisant la guerre aux Perses, il détruirait un grand
empire. Pourquoi n’a-t-il pas demandé au dieu de quel empire il
s’agissait ? N’ayant ni saisi le sens de l’oracle ni fait interroger de
nouveau le dieu, qu’il ne s’en prenne qu’à lui-même. Il n’a pas non plus, en
dernier lieu, compris la réponse d’Apollon relativement au mulet. Cyrus était
ce mulet, les auteurs de ses jours étant de deux nations différentes : son
père était d’une origine moins illustre que sa mère : celle-ci était Mède et
fille d’Astyage, roi des Mèdes ; l’autre, Perse et sujet de Dès que la nouvelle de la prise de Sardes arriva aux Ioniens et aux Éoliens, ils envoyèrent des ambassadeurs à Cyrus, pour le prier de les recevoir au nombre de ses sujets aux mêmes conditions qu’ils l’avaient été de Crésus. Ce prince répondit à leur proposition par cet apologue : un joueur de flûte aperçut des poissons dans la mer ; il joua de la flûte, s’imaginant qu’ils viendraient à terre. Trompé dans son attente, il prit un filet, enveloppa une grande quantité de poissons qu’il tira sur le bord, et, comme il les vit sauter : Cessez, leur dit-il, cessez maintenant de danser, puisque vous n’avez pas voulu le faire au son de la flûte. Il tint ce discours aux Ioniens et aux Éoliens, parce qu’ayant fait auparavant solliciter les Ioniens, par ses envoyés, d’abandonner le parti de Crésus, il n’avait pu les y engager, et qu’il ne les voyait disposés à lui obéir qu’après qu’il était venu à bout de toutes ses entreprises. Sur le rapport des députés, les Ioniens fortifièrent leurs villes et s’assemblèrent au Panionion, à la réserve des Milésiens, les seuls avec qui Cyrus fit un traité aux mêmes conditions que celles qui leur avaient été accordées par Crésus. Il nomma le Perse Tabalos gouverneur de Sardes, chargea le Lydien Pactyas de transporter en Perse les trésors de Crésus et retourna à Ecbatane, pensant qu’il suffisait d’envoyer un de ses lieutenants contre les Ioniens. Il ne se fut pas plus tôt éloigné, que Pactyas fit soulever les Lydiens. Comme il avait entre les mains de grandes richesses, il se rendit dans les cités grecques du bord de la mer, prit des troupes à sa solde, engagea les habitants à s’armer en sa faveur, puis revint à Sardes, où il assiégea Tabalos dans la citadelle. A cette nouvelle, Cyrus ordonna au Mède Mazarès d’aller à Sardes réduire en servitude ceux qui s’étaient ligués pour assiéger la citadelle et de lui amener Pactyas vivant. A l’approche des Perses, Pactyas, pris d’épouvante, se sauva à Cymé. Mazarès fit d’abord exécuter à Sardes les ordres du roi, puis il somma les Cyméens de lui livrer le fugitif. Avant de répondre, ils consultèrent l’oracle des Branchides sur le parti qu’il fallait prendre à l’égard de Pactvas, afin de se rendre agréables aux dieux. L’oracle répondit qu’ils devaient le livrer aux Perses. On se disposait à obéir au dieu, quand Aristodicos, homme de distinction parmi les Cyméens, empêcha qu’on exécutât cette résolution jusqu’à ce qu’on eût envoyé une seconde députation dans laquelle il fut admis, soit qu’il se défiât de l’oracle, soit qu’il soupçonnât d’infidélité le rapport des députés. Les députés arrivés aux Branchides, Aristodicos porta la parole pour eux, et dit : Grand dieu, le Lydien Pactyas est venu chercher un asile parmi nous pour éviter la mort dont le menacent les Perses. Ceux-ci le redemandent et nous ordonnent de le remettre entre leurs mains ; mais, quoique nous redoutions leur puissance, nous n’avons pas osé jusqu’ici leur livrer ce suppliant, que nous n’ayons appris de vous avec certitude ce que nous devons faire. Le dieu fit la même réponse. Alors Aristodicos alla autour du temple et chassa les oiseaux qui y avaient fait leur nid. On raconte que, tandis qu’il exécutait son dessein, il sortit du sanctuaire une voix qui s’adressait à lui et disait : Ô le plus scélérat de tous les hommes ! as-tu bien la hardiesse d’arracher de mon temple mes suppliants ? et qu’Aristodicos, sans se déconcerter, répondit : Quoi ! grand dieu, vous protégez vous-même vos suppliants, et vous ordonnez aux Cyméens de livrer le leur ? — Oui, je le veux, reprit la même voix, et c’est afin qu’ayant commis une impiété, vous en périssiez plus tôt, et que vous ne veniez plus consulter l’oracle pour savoir si vous devez livrer des suppliants. Sur le rapport des députés, les Cyméens envoyèrent Pactyas à Mytilène, ne voulant ni s’exposer à périr en le livrant, ni se faire assiéger en continuant de lui donner un asile. Mazarès fit aussitôt réclamer Pactyas auprès des Mytiléniens, et ils se disposaient à le lui remettre moyennant une somme d’argent, lorsque les Cyméens, qui avaient appris ce marché honteux, envoyèrent à Lesbos un vaisseau pour transporter Pactyas à Chios. Mais les habitants de cette île
l’arrachèrent du temple de Minerve Poliarchos et le livrèrent à Mazarès, à
condition qu’on leur donnerait l’Atarnée, pays de Quand les habitants de Chios
eurent livré Pactyas, Mazarès. marcha contre ceux qui s’étaient joints à ce
rebelle pour assiéger Tabalos. Il réduisit les Priéniens en servitude, fit
une excursion dans la plaine du Méandre et permit à ses soldats de tout
piller. Il traita de même Les Ioniens avaient décidé qu’ils demanderaient du secours
à Sparte. Leurs envoyés, arrivés à Lacédémone, firent parler un Phocéen qui,
revêtu d’une robe de pourpre, débita un verbeux discours. Une si longue
harangue déplut aux Spartiates; ils n’accordèrent rien et congédièrent les
ambassadeurs. Mais, en même temps, ils firent partir des émissaires, chargés
d’observer l’état des choses. Ceux-ci virent sans doute trop de faiblesse
d’un côté, trop de force de l’autre, pour engager leurs compatriotes à
intervenir. Les Ioniens, laissés à leur sort, succombèrent. Ils devinrent
tributaires de Le peuple de Phocée donna un grand exemple. Assiégés par
Harpagos et près d’être forcés, les Phocéens montèrent sur leurs vaisseaux,
emportant les images de leurs dieux, et firent voile vers l’île de Chios. Ils offrirent aux habitants une somme d’argent en échange
des îles Œnusses (ou riches en vignobles) ; ceux-ci n’y ayant pas consenti,
dans la crainte de voir s’établir près d’eux un commerce rival, ils se
rembarquèrent pour se diriger vers Les habitants de Téos imitèrent les Phocéens et allèrent fonder Abdère en Thrace. Mais ces deux peuples furent les seuls qui préférèrent l’exil à la servitude. Les autres, même ceux des îles voisines du continent et qui y avaient des domaines, comme Lesbos et Chios, consentirent à payer tribut. J’ai appris, dit encore
Hérodote, que, dans une assemblée générale du
Panionion, Bias de Priène avait ouvert un avis plein de sagesse : il conseillait
aux Ioniens de réunir en une seule flotte leurs vaisseaux, de s’y embarquer
tous, et de se rendre en Sardaigne où ils fonderaient une cité unique qui
comprendrait toute l’Ionie. Il leur démontrait que, dans cette grande île,
ils seraient à l’abri de la servitude, et supérieurs en force à tous les
autres insulaires. Thalès de Milet leur avait aussi donné un très utile avis,
avant que l’Ionie fût subjuguée. Il leur proposait de n’avoir qu’un seul
conseil général, βουλευτήριον,
qu’ils établiraient à Téos, ville située au centre de toute l’Ionie, ce qui n’empêcherait
pas que les autres villes ne continuassent à se gouverner intérieurement par
leurs lois particulières, comme des cités séparées. C’étaient là de sages conseils,
mais les Ioniens n’en profitèrent pas[4]. S’ils eussent
suivi celui de Bias, l’avenir du monde occidental pouvait être changé. La
soumission des Grecs d’Asie au grand roi était un grave événement, car elle
conduisit leurs maîtres à rêver aussi la conquête de II. Prospérité des insulairesLa ruine des Ioniens du continent fit passer la puissance
maritime à une île voisine, à Samos. Polycrate, avec l’aide du tyran de
Naxos, Lygdamis, y avait usurpé le pouvoir entre les années 556 et 552, et
l’avait d’abord partagé avec ses deux frères. Mais, se débarrassant de l’un
par le meurtre et de, l’autre par l’exil, il était resté seul maître et avait
contracté une alliance avec Amasis, roi d’Égypte. Sa puissance s’accrut au
point qu’il eut cent vaisseaux à cinquante rameurs et mille archers. Avec ces
forces, il protégeait le commerce des Samiens et s’enrichissait lui-même par
des courses qui tenaient plus du pirate que du prince. Il se rendit maître
d’un grand nombre d’îles, même de plusieurs villes du continent, et il fut,
dit Hérodote, le premier des Grecs, après Minos, qui eût conçu le projet de
saisir l’empire de la mer. Au reste, il employait ses richesses à orner Samos
d’ouvrages utiles ou magnifiques, un aqueduc creusé à travers à une montagne,
un môle immense pour agrandir et protéger le port et le temple ionique de
Héra (Junon),
qu’Hérodote comptait au nombre des merveilles de
Plan de l’ancienne Samos[5]. Cependant, à Samos comme à Athènes, il y avait des mécontents. Lorsque Cambyse envahit l’Égypte, Polycrate lui offrit quarante vaisseaux, Il eut soin d’y faire monter tous ceux qui lui étaient contraires, et il pria son allié de faire périr les équipages après s’en être servi. De tyran à roi fou, un pareil arrangement n’était qu’un échange de services. Par malheur, les victimes, soupçonnant le danger, se saisirent de la flotte et revinrent sur Samos pour exciter un soulèvement. Repoussés, ils implorèrent le secours des Spartiates, qui se faisaient alors volontiers les redresseurs des torts, surtout quand il s’agissait de renverser quelque tyran puissant au profit d’une oligarchie. Corinthe, qui avait eu à se plaindre des pirateries de Polycrate, donna aussi des secours. Les alliés restèrent quarante jours devant Samos. Le tyran était sur ses gardes, rien ne bougea dans l’inexpugnable ville ; il fallut se retirer (625). On prétend que s Polycrate avait payé la retraite des alliés avec une monnaie de plomb doré, que les Spartiates, dans leur inexpérience, avaient prise pour de l’or au meilleur titre. Les Samiens, qui les avaient appelés, pillèrent Siphnos, Hydrea, et descendirent en Crète, à Cydonia, où cinq ans après ils furent battus, pris et vendus tous comme esclaves. Polycrate se trouva plus fort après cette épreuve. Sa fortune était au comble; il commença à trembler, se souvenant qu’Amasis n’avait pas voulu de son alliance, parce qu’il l’estimait trop heureux, c’est-à-dire trop près de quelque misère éclatante. Pour conjurer la colère et l’envie des dieux, on conte qu’il se décida de faire un sacrifice. Il monta sur un vaisseau, se rendit en pleine mer et y jeta un anneau très précieux. Puis il revint dans son palais pour se livrer au chagrin que lui causait la perte qu’il venait de faire. Il croyait avoir acheté du bonheur pour longtemps et fait avec la fortune un bail sûr. Trois jours après, un pêcheur prend un magnifique poisson, l’apporte au roi ; on l’ouvre : ô prodige ! on y trouve l’anneau. Ainsi l’offrande de Polycrate était rejetée. Quelque temps après, le satrape Orétès, qu’il avait offensé, l’attira sur le continent, sous prétexte qu’il l’aiderait dans ses projets de domination, et le fit mettre en croix (522). Hérodote ne doute pas de la vérité de toute cette légende, dont s’amusait l’esprit des Grecs, et qui, d’ailleurs, était d’accord avec leurs sentiments religieux les plus intimes. Ils croyaient les dieux jaloux de toute prospérité trop grande pour un mortel ; derrière le bonheur, ils voyaient Némésis armée de ses vengeances et prête à frapper, pour abaisser l’orgueil de celui qui oubliait l’infirmité de la nature humaine. Tel est aussi le fond, bien plus moral qu’historique, de la belle et tragique histoire de Crésus, telle qu’Hérodote nous l’a donnée. Avec Polycrate tomba la puissance de Samos. Méandrios, qu’il avait laissé gardien de l’acropole et de ses trésors, voulut abdiquer la tyrannie. Au lieu d’applaudir à ce désintéressement, on lui demanda des comptes, on l’injuria. Il ressaisit ce qu’il abandonnait. Les Samiens, dit avec tristesse Hérodote, ne voulurent pas être libres. Attaqué par une armée persique que conduisait Syloson, frère de Polycrate, Méandrios s’enfuit avec ses richesses. Les Perses tuèrent jusqu’au dernier homme dans Samos. Otanès la repeupla dans la suite et la laissa sous le dur gouvernement de Syloson, devenu le tributaire du Grand Roi. Trois îles mériteraient encore d’être citées : Naxos, alors très puissante, mais dont je parlerai en racontant la révolte des Ioniens, Lemnos, où les Grecs, pour expliquer les éruptions volcaniques, avaient placé les ateliers de Vulcain et où ils entendaient, dans les grondements du sol, le bruit des marteaux des Cyclopes forgeant la foudre de Jupiter ; enfin Lesbos, que Pittacos, un des Sages, que ses musiciens et ses poètes, Terpandre, Arion, Alcée, Sappho avaient rendue célèbre. La légende savait bien pourquoi toute cette veine de poésie y coulait : après qu’Orphée eût été mis en pièces par les Bacchantes furieuses, sa tête et sa lyre, jetées dans l’Hèbre, rendaient encore des sons harmonieux, et furent roulées par les flots jusqu’aux rivages de Méthymne. Les Lesbiens ensevelirent la tête du poète et suspendirent sa lyre dans le temple d’Apollon. Le dieu récompensa leur piété en leur donnant le don de la musique et de la poésie. On vantait aussi la beauté de ses femmes et leur adresse à filer la laine[6].
Lesbos, une des grandes îles de la mer Égée, renfermait
quatre États. Mytilène et Méthymne y tenaient le premier rang, et firent de
longues guerres où la première l’eniporta; mais sa rivale asservie se vengea
par de fréquentes révoltes et de constants appels à l’étranger. Mytilène
avait deux ports[7],
une marine puissante et des possessions dans Ce Pittacos, aidé des frères d’Alcée, avait tué le tyran Mélanchros, mais non l’anarchie. Des dissensions continuelles désolaient la cité; un parti chassa l’autre, et les bannis tinrent la ville comme assiégée. Pittacos fut enfin élu ésymnète pour dix ans avec un pouvoir illimité. Nous ignorons quelles mesures il prit, mais nous savons que cet ami de Solon sut, comme lui, rétablir le calme et, comme lui aussi, résister à la tentation de garder le pouvoir. Au bout de dix ans, il s’en démit et redevint simple citoyen. On s’étonnait de ce désintéressement inaccoutumé. J’ai été effrayé, répondit-il, de voir Périandre, à Corinthe, devenir le tyran de son peuple. Il est trop difficile de garder toujours la vertu. Quand la domination des Perses s’approcha d’elle, Lesbos traita avec Cyrus ; après la défaite des Ioniens à Ladé en 494, elle partagea leur sort. Cyrène, en Afrique, perdit aussi sa liberté et eut les mêmes maîtres. Composée d’éléments contraires, la population grecque de Cyrène fut agitée de révolutions qui ne lui laissèrent jamais de repos. La famille de Battos y domina pendant plusieurs générations. Sous Battos III l’Heureux (de 574 à 554), l’oracle ordonna d’accueillir indistinctement les Grecs de toute tribu ainsi s’accumula dans toute la ville, qui renfermait déjà beaucoup de Libyens, une multitude considérable et hétérogène. Pour donner les terres promises aux nouveaux venus, il fallut déposséder les Libyens du voisinage, qui invoquèrent l’assistance du roi d’Égypte, Apriès. Il leur envoya une nombreuse armée; elle fut détruite et cette défaite causa une révolution en Égypte, où Apriès fut renversé du trône. Amasis, son successeur, fit la paix avec les Cyrénéens et épousa une femme de la famille de leurs rois. Arcésilaos II régna ensuite (554 à 544). Dans une guerre contre les Libyens, il laissa sur le champ de bataille sept mille de ses hoplites. Jamais une ville grecque n’avait subi pareil désastre. Cyrène parut à peine le sentir, mais Arcésilaos n’y survécut pas. A son retour, il fut assassiné par son frère Léarchos : sa femme le vengea en tuant le meurtrier. Sous Battos le Boiteux, on fit venir de Mantinée, par
ordre de En regard de ces révolutions et de ces malheurs nés de la division, mettons la sagesse et l’obscure prospérité d’un petit peuple qui entrevit dès l’antiquité les avantages du système politique que pratique l’Europe moderne, le gouvernement représentatif. Les Lyciens avaient fait trois classes de leurs vingt-trois cités ; celles de la première possédaient chacune trois voix à l’assemblée générale ; celles de femmes, leurs enfants, leurs trésors, et allèrent mourir les armes à la main, au plus épais de l’armée persique. Léonidas et ses trois cents Spartiates sont plus célèbres, mais non plus héroïques. Plus loin encore que Au milieu de cette mer et du monde grec, nous avons oublié
Le lieu le plus célèbre de l’Europe, aux anciens jours, a
été
Montesquieu a dit, en exagérant la portée des emprunts de Lycurgue,
que les lois de III.
|